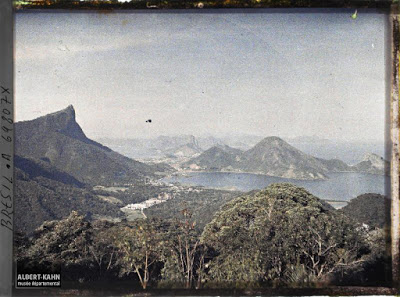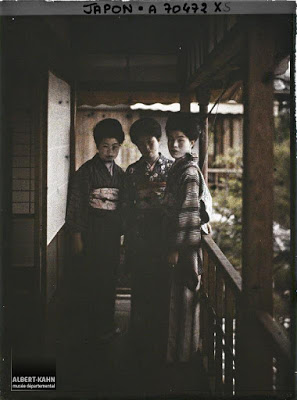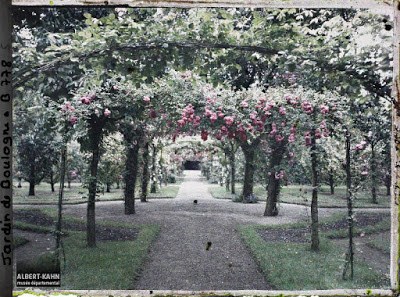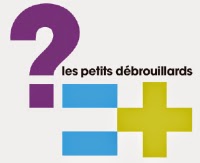A la rencontre des professionnels : la formation MEM en live
Albert Khan : se dévoiler par nuances
Les deux promotions du Master MEM ont rencontré Valérie Perles et Jean-Christophe Ponce lors de leur « semaine expographique ». Cette dernière permet aux étudiants de rencontrer des professionnels qui fourniront un point de vue concret sur un thème prédéfini : celui de cette année est la rénovation et l’extension de musées. La conservatrice et le scénographe se sont libérés en pleine période de travail pour une journée d’échange afin d’exposer le projet de rénovation du Musée Albert Khan.
Un autochrome, s’il s’apparente à une des premières formes de photographie en couleur, se rapproche de la peinture par l’apport de couches successives afin de former une image. Cette dernière est captée grâce à l’application de vernis, de fécule écrasée, de carbone et d’émulsion sensible. Le résultat donne une photographie à l’aspect un peu décalé, voire poétique. La couleur tranche franchement avec l’aspect solennel des premières photographies, elle leur donne un ressort qui promet à celui qui prend le temps de les regarder un aperçu vivant et succinct du passé. Toutefois, l’autochrome est fragile, son procédé nécessite des conditions particulières de conservation qui ne permet pas une exposition sur le long terme. Des reproductions sont nécessaires pour pouvoir révéler ce qu’un autochrome veut donner à voir.
La plus grande collection d’autochromes a été formée par Albert Khan dans ce qu’il a appelé « Les Archives de la planète ». Ce banquier français a fait converger sa fortune et ses idéaux philanthropiques pour mobiliser des photographes et cameramen sur plus de 60 pays entre 1909 et 1931. Cela afin de saisir « des aspects,des pratiques et des modes de l’activité humaine » dont Khan avait -déjà- conscience de la disparition prochaine. Cet engouement documentaire a permis de constituer une collection de 72000 autochromes, portant sur les coutumes, les paysages, les portraits. Ce projet avait pour but de faire connaître les cultures étrangères afin de promouvoir le respect de chacune dans une optique pacifiste. Quatre axes permettent de comprendre la démarche de départ : le voyage, la géographie,l’actualité, l’ethnologie.
N°A69 807 X © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine
N°A70 472 XS © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine
Mais ce projet documentaire avait aussi vocation à être diffusé : Khan invitait dans sa maison de Boulogne-Billancourt artistes & diplomates internationaux dans le but de les confronter à l’étranger, au dépaysement et à sa propre sensibilité. La visite se déroulait alors entre deux espaces : la sphère intime avec le cabinet de projection et l’extérieur dans les quatre hectares de jardin qui entourent la maison, composés de serres, de reconstitutions d’architectures asiatiques.
Dans les années 1930, le krach boursier n’épargne pas Albert Khan : le département de la Seine rachète alors collections et jardins afin d’en faire un musée éponyme. Il ouvre ses portes au public en 1937. Le musée actuel prend place à Boulogne-Billancourt dans l’ancienne maison du banquier et s’accompagne des jardins départementaux qui le corroborent. Si le jardin est retravaillé dans les années 1990, la rénovation du musée débute en 2013, quatre ans après, les espaces d’exposition sont en phase d’aménagement ;
N°B778 S © Collection Archives de la Planète- Musée Albert-Kahn
© Département Hauts-de-Seine
Quel a été ce projet de rénovation ? Comment travailler à la fois sur une démarche universelle et sur la personnalité d’Albert Khan ?
Il était question alors de donner une cohérence à la pluralité des domaines qui composent les collections du musée : de l’immatériel recueilli, un jardin immense, des heures de films, des objets personnels, une maison.. et les fameux autochromes des Archives de la Planète. Dans le musée Albert Khan, le parti pris a été de se concentrer sur la démarche à la fois documentaire et philanthropique du banquier afin de plonger le visiteur dans le temps, le remettre dans les pas des invités d’antan. Mais alors serait-ce une énième immersion biographique à coup de dioramas, de photographies personnelles illustrant l’œuvre d’Albert Khan ? Loin de là, ici point d’épitaphe surannée, mais un voyage immobile, où l’imagination du visiteur est sollicitée afin de recréer l’univers de Khan, où on suggère un espace temporel plutôt qu’on ne l’impose.
© Scenorama- esquisse de parcours
Il existe une porosité entre le présent et le passé, rappelé par à-coups par la forme du mobilier, le dispositif scénographique, les montages sonores… Le portrait chinois d’Albert Khan en est représentatif : un plâtre de Rodin, un écorché, un vase en porcelaine bleue, une paire de lunettes … Khan est présenté au visiteur à travers une évocation de sa personne plutôt qu’une illustration explicite des différentes étapes de sa vie. Cette mise à distance permet en même temps une approche plus intime du personnage, une rencontre anachronique avec une personnalité pacifiste et réformiste.
L’évocation de la transmission des Archives de la Planète est aussi visible à travers un bâtiment nouveau qui propose un aperçu original et poétique des collections, articulant modernité et patrimoine. Le cabinet de diffusion du banquier est présenté par un espace voué à la projection des autochromes.
© Scenorama- esquisse du cabinet de diffusion
La salle n’est pas une reconstitution mais la suggestion dudit cabinet : le visiteur prend place face à l’écran aux côtés d’un extrait du mobilier original. Un montage sonore accompagne cette rencontre entre deux époques et propose au voyageur de comprendre d’emblée l’esprit documentaire et humaniste de Kahn.
Au milieu du désordre ambiant que propose l’actualité, aller au musée Albert Khan à sa réouverture en février 2018 promet une méditation sur les liens entre cette période et la nôtre ainsi qu’une pause poétique à travers le temps. Le projet du musée Albert Khan se comprend finalement comme un autochrome : par suggestions, il propose au visiteur un parcours réflexif sur une personnalité emblématique de son temps ; par touches successives, il met en exergue les nuances de l’âme humaine.
Coline Cabouret
#nuances
#autochromes
#rénovation
_________________________________________________________________________________
Pour en savoir plus : http://renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Avec les Petits Débrouillards, embarquement immédiat vers la science
Etudiants et étudiantes en première et deuxième année du Master Muséographie-Expographie, nous avons eu l'occasion cette année 2014 de rencontrer de grands professionnels de la culture scientifique qui nous ont exposé leur fonctionnement et leur démarche.
Né au Québec en 1984, l'association les Petits Débrouillards vise à vulgariser la culture scientifique et technique par le biais d'activités destinés aux enfants. Présente partout en France, son antenne nationale se situe en Île-de-France et plusieurs antennes sont en région.
Former le citoyen à la culture scientifique
Les intervenants nous ont expliqué l'objectif de leur association : faire découvrir la science aux jeunes, tout en s'amusant. Il s'agit de donner le goût à la culture scientifique et de favoriser la curiosité des petits et des grands. Dans le dialogue qui s'établit alors, le respect de l'autre est fondamental pour permettre de nombreux échanges et débats entre l'enfant et l'animateur mais aussi entre les jeunes eux-mêmes.
Les différentes animations sont d'abord prévues pour des enfants de 7 à 12 ans mais elles visent finalement tous les publics. Les membres des Petits Débrouillards font des activités régulières toute l'année avec les jeunes en allant dans les écoles et les centres de loisirs. Ils amènent la science aux jeunes pour leur donner envie de se déplacer ensuite vers les institutions scientifiques.
Ils conçoivent trois types d'outils pédagogiques : des expositions itinérantes sous forme de panneaux, des mallettes pédagogiques avec des fiches parcours et des activités à réaliser ainsi que des livrets pédagogiques et des fiches d'activités.
Une démarche innovante
Je vous propose une petite expérience qu'ils nous ont fait partager lors de cette journée enrichissante.
Prenez une feuille de papier que vous divisez en trois verticalement. La première feuille consiste à un pliage. Chiffonner la deuxième feuille de sorte à faire une boule de papier et laisser la dernière feuille intacte.
Monter sur une chaise, laissez tomber les feuilles une par une et observez.
On constate que la première feuille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La boule tombe selon une ligne droite et la feuille non modifiée fait un simple zig-zag.Vous venez de mener une expérience sur la gravité.
Comme vous venez de le découvrir, la démarche des Petits Débrouillards consiste à favoriser le questionnement par le biais de l'observation. Cette démarche se veut expérimentale puisqu'elle se réfère au geste de la personne menant l'expérience. Pour l'association, la science ne doit pas se préoccuper du Pourquoi immédiatement mais plutôt commencer par aborder le Comment, concret et observable. Par exemple, si nous ne savons pas pourquoi la feuille de papier tombe, nous savons comment elle tombe. Dans la médiation, l'importance est d'apprendre à poser des questions. Les réponses ne sont pas le cœur du problème, elles viennent ensuite.
Les enjeux fondamentaux desPetits Débrouillards
-
L'engagement et la participation des jeunes sont l'un des enjeux de l'association. Il s'agit de sensibiliser les jeunes aux préoccupations sociales et environnementales, à l'actualité scientifique, à travers la mise en place d'actions et de projets. Ces actions doivent permettre aux jeunes d'acquérir une base scientifique. Par exemple, chaque année, l'association met en place le Festival des Explorateurs où plus de 400 projets sont créés et animés par des jeunes. Ouvert au grand public, cet événement a pour but de valoriser la culture scientifique et technique du territoire.
-
Le développement durable est l'une des préoccupations majeures des Petits Débrouillards. Des outils pédagogiques et des expositions sont créés sur cette thématique pour sensibiliser les jeunes sur les problèmes actuels liés à la planète telles que la disparition des espèces animales et végétales ou la pollution de l'air, de l'eau et de la terre.
-
La solidarité entre les jeunes est une base importante pour avoir la notion d'échange et de partage dans la vie de tous les jours. Par exemple, des actions de médiation sont spécialement créées dans le cadre de cohésion sociale pour mettre l'insertion des jeunes dans la vie active. Ils apportent un soutien à l'enfant par la pratique des sciences.
-
L'association souhaite lier sciences et sociétés pour permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société au sein des problèmes actuels pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, et les inciter, pourquoi pas, à participer à des débats et à agir.
Un événement débarque chez vous
Développé et conçu par les Petits Débrouillards, en partenariat avec C'est Pas Sorcier et France Télévisions, le Science Tourvient chez vous, de mai à décembre 2014, en Franche-Compté, en Ile-de-France, dans le Centre, en Bourgogne, en Corse, en Midi-Pyrénées, dans le Languedoc-Roussillon, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pays-de-la-Loire et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Plusieurs camions équipés d'outils pédagogiques et d'expositions itinérantes viennent vous rendre visite. Avec des médiateurs scientifiques, les jeunes peuvent mener des expériences scientifiques et découvrir le monde des sciences et des techniques. Pourquoi ne pas aller à la rencontre de ces camions ?
Ludivine Perard
©Les PetitsDébrouillards
Adresse de l'Antenne Nationale :
La Halle aux Cuirs
2 rue de la Clôture
75930 Paris Cedex 19
Tél : 01 40 05 75 57 Fax 0140 05 79 21
Pour en savoir plus :
- Le site internet de l'association
- Informations sur les étapes du "Science Tour"
#science#jeunesse#expérience

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940
Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?
Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.
Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?
L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne
Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?
La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.
Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?
Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?
Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne
Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.
Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?
Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.
Charlène Paris
#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive
#histoire-mémoire
#brèvesd’apprentissage
#patrimoine-société

Des expos recyclées
La production d’expositions et leur recyclage figurent au cœur des préoccupations alliant musées et développement durable. À Paris, le Viaduc des Arts accueille les Ateliers Chutes Libres et l’agence de design et d’architecture intérieure Premices and co. Ces deux structures sont formées par une seule équipe particulièrement soucieuse de l’économie circulaire. Rencontre avec Jérémie Triaire, designer scénographe et co- fondateur.
Pourriez-vous nous décrire ce lieu ?
Les Ateliers Chutes Libres ont été portés par l’agence Premices and co fondée en 2012 avec Camille Chardayre et Amandine Langlois suite à une formation à l’École Boulle et une résidence d’un an à l’incubateur des Ateliers de Paris.
Les premiers ateliers ont eu lieu dans le cadre de l’exposition Matière Grise conçue par Encore Heureux Architectes au Pavillon de l’Arsenal. Nous y proposions des sessions de valorisation de chutes de bois, ateliers qui se sont prolongés après l’exposition et que nous avons ensuite proposé à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.
Par la suite, nous avons souhaité occuper un lieu permettant de stocker les matériaux récupérés et d’accueillir des publics pour des ateliers. Nous sommes installés au Viaduc des Arts depuis plus d’un an.
Quels sont vos matériaux et d’où proviennent-ils ?
Ce sont surtout des chutes de bois que nous collectons exclusivement auprès d’entreprises, dont le Pavillon de l’Arsenal et le Théâtre du Châtelet. Ces chutes sont de nature variée. Pour les expositions, le pin et le bouleau sont majoritairement utilisés.
Nous récupérons aussi de petits dépôts de cuirs, de tissus ou de sangles, qui proviennent de la Réserve des Arts et que nous utilisons pour concevoir des accessoires lors des ateliers.
Comment est organisé ce lieu ?
Par pôles. Au rez-de-chaussée, un lieu dédié à l’assemblage et à la finition, composé de grandes tables, de perceuses, de visseuses et d’une quincaillerie. Au sous-sol, un espace insonorisé qui accueille des machines de découpe comme une scie sauteuse et des scies circulaires sur table. À l’étage, nos bureaux.
Comment répartissez-vous votre agenda entre les ateliers et l’agence ?
Notre temps est généralement divisé en deux. Parfois, les projets des ateliers et de l’agence peuvent aussi se rejoindre. Par exemple, via Premices and co, nous avons travaillé sur un projet d’aménagement de bureaux et décidé d’utiliser les Ateliers Chutes Libres pour accueillir nos clients et leur proposer de concevoir certains meubles, ainsi qu’un logo à installer dans leurs bureaux.

Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn
Quelles activités proposez-vous aux publics ?
Différents formats d’ateliers, de 2 à 4 heures, à la fin desquels les participants repartent avec leur création : une table, une lampe, une chaise ou encore une petite étagère. Pendant la réalisation, nous les sensibilisons à la provenance des matériaux et à la notion de récupération. Au sein-même des ateliers, nous tentons de générer le moins de chutes de matériaux possible.
Comment avez-vous financé ces ateliers ?
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) nous a octroyé un soutien financier. Par ailleurs, nos ateliers sont payants pour les participants, qui ont accès au lieu, aux matériaux, aux machines et consommables, ainsi qu’aux conseils des encadrants.
Avez-vous de futurs projets ?
Nous souhaiterions proposer des ateliers plus individualisés, ainsi que des formats plus courts, qui permettraient aux participants de repartir avec de plus petits objets.
Aussi, pour le moment, le prix auquel proposons nos ateliers attire un public plutôt privilégié, en partie car le lieu coûte cher à la location. Nous recherchons donc des aides pour pouvoir en proposer à moindre coût et sommes aussi ouverts à des partenariats. Par le passé, nous avions notamment collaboré avec Paris Habitat et proposé des ateliers gratuits dans les espaces communs d’un immeuble.
Signalétique Nuit Blanche 2016 © Premices&Co
Pourriez-vous nous présenter certaines réalisations de l’agence ?
Chaque projet implique des contraintes différentes et donc des solutions différentes. De manière générale, nous allons toujours tenter d’avoir un impact moindre, en sélectionnant certains types de matériaux, en privilégiant le local, en réemployant du matériel ou en privilégiant la location à l’achat.
Par exemple, dernièrement, nous avons conçu l’accueil de la Mairie de Paris où figurait initialement un tribunal. Le mobilier originel étant de bonne qualité, nous avons proposé de le conserver en partie pour concevoir la banque d’accueil. Cela ne s’est pas prémédité à l’avance, mais s’est décidé en voyant les meubles existants, conçus dans un beau bois.
Pour la scénographie d’une petite exposition dans un kiosque entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, portant sur les travaux en cours dans ces deux lieux, nous avons utilisé des projecteurs inutilisés du Théâtre du Châtelet et des échafaudages de chantier, qui ont ensuite retrouvé leur fonction première.

La maison du chantier, Exposition Figures Marquantes, réalisation Jean-François Aimé et Premices&co © Benjamin Verlomme
Et pour la signalétique de Nuit Blanche 2016, nous avons réemployé des caisses de transport d’œuvres d’art, que créent parfois les musées pour un usage unique et qui étaient destinées à être jetées, afin de s’en servir comme balises repères le long de la Seine. Faciles à repérer et utiles pour protéger les programmes du vent et de la pluie.
Avez-vous été confrontés à une problématique de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le recyclage de la scénographie d’une exposition ?
C’est un point qui pose vraiment problème. Nous n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre d’un concours, pour lequel nous proposions de réemployer le mobilier existant et n’avons pas été retenus. Bien que cela se comprenne et soit lié à une peur du recours, il devrait exister des solutions, comme grouper des marchés de scénographie pour plusieurs expositions, ou de façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord.
Propos recueillis par Laurence Amsalem
#economiecirculaire
#developpementdurable
#atelierschuteslibres
https://atelierschuteslibres.com/
Image de vignette et image d'introduction : Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Éric Miot, un passionné du 7ème art
Délégué général du Festival international du film d'Arras et de l'association Plan séquence, Éric Miot met en valeur le patrimoine cinématographique grâce à un certain nombre de missions notamment avec le jeune public. Entre le professionnel et l'associatif, la structure existe depuis 21 ans et est remaniée en 2003.
Éric Miot a présenté d'abord le patrimoine cinématographique de manière générale. Un panorama de la grande histoire du Cinéma nous est brossé, de la création du média par les frères Lumière en 1895 en passant par l'impulsion des films muets comme ceux de Georges Méliès, l'industrie Gaumont, Hollywood, l'expressionnisme allemand de Metropolis, l'apparition du film sonore avec Le chanteur de Jazz, ou encore les films de propagande de Goebbels.
Éric Miot a également mis en avant les problèmes de conservation liés aux supports fragiles et a insisté sur l'intérêt de préserver ce patrimoine, source et témoin historique.
Le professionnel a ensuite parlé de son activité et de son rôle dans le cadre du Festival international du film d'Arras. Gagnant en notoriété, il met en valeur le cinéma européen à travers une sélection de films à la fois artistiques et divertissants, tout en portant un regard sur notre société. De nombreuses activités et thèmes sont proposés tels que des compétitions, des avants-premières, des ciné-concerts, des hommages, des expositions ainsi que des projections de films européens mais également du monde, ou destinés aux enfants.
Lucile Tallon

Etudes des publics et recherche : Au service du Louvre
Au cours du mois d’octobre, les Master 2 sont partis en visite au Louvre Paris afin de rencontrer l’équipe d’Anne Krebs. Celle-ci dirige le service d’études et de recherche de la Direction de la politique des publics et de l’éducation artistique du musée, le premier dans son genre. Depuis 2002, cette équipe mène des analyses pour approfondir les connaissances sur les publics dans le but de développer une offre culturelle et éducative toujours mieux adaptée aux nouvelles tendances muséales. Au-delà de ce travail principal, nous avons pu découvrir qu’elle mène aussi des études externes en partenariat avec d’autres musées franciliens.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval
Lors de notre rencontre avec une partie de l’équipe, nous avons parlé plus particulièrement de l’organisation des études sur les expositions temporaires en amont de la présentation au public, afin de définir le visuel le plus adapté pour l'affiche. L’objectif de cette action est de rendre la communication de l’évènement la plus efficace possible. Des sessions de groupe avec différents panels de publics sont organisées dans ce cadre. Elles sont animées par un enquêteur dont le rôle est de donner les thèmes de discussion, de stimuler, recadrer, synthétiser et enfin contrôler le temps. Le Louvre part du postulat que le visuel d’une exposition doit savoir parler de la thématique abordée tout en la rendant attractive pour les visiteurs. Ce sont donc les réactions du groupe face aux couleurs, au format et à la typographie qui sont analysées par le service.
Puis nous sommes allées tester le nouveau dispositif de médiation embarquée mis en place dans le Louvre depuis le premier semestre 2012 : la Nintendo DS3D ©. Celui-ci comprend deux écrans qui permettent au visiteur de se situer dans le vaste espace du musée grâce à un système de géolocalisation ainsi que plusieurs parcours en fonction de ses attentes de visite, le tout en proposant le discours d’un audioguide de base. Après avoir passé environs trois heures à tester l’audioguide par nous-même ainsi que d’interroger et d’observer l’utilisation de ce système par les visiteurs, une session de débriefing a été organisée par Anne Krebs et son équipe. Ils ont la mission d’évaluer l’impact de ce nouveau système sur les parcours de visite mais aussi plus généralement sa réception par le public. La session s’est déroulée sous forme de brainstorming mettant en avant nos principales impressions quant à l’utilisation de la Nintendo.
Crédits : MTDF

A partir de toutes les informations et impressions que nous avons données, les membres du service présents nous ont montré quels étaient les faits importants à mettre en avant dans une évaluation d’un dispositif interactif, comme les aspects techniques par exemple.
Cette journée a permis à l’ensemble de la promotion de découvrir concrètement les missions d’un service d’étude des publics ainsi que d’appréhender leurs méthodes de travail. Nous remercions Anne Krebs et son équipe de nous avoir accueilli dans leur locaux et fait partager cette expérience.
Laura Clerc
[1] Voirla liste des études réalisées par le service études et recherche du Louvre

In Flanders fields...
Crédits : MTDF
"In Flanders fields the poppies blow / Between thecrosses, row on row...» 1 ainsi commence le poème du lieutenant-colonel canadien John McCrae, écrit après la deuxième bataille d'Ypres le 3 mai 1915. Poème qui est devenu, au Canada et en Grande-Bretagne, l'emblème des morts de la Première Guerre Mondiale et qui est à l'origine du choix du poppy/coquelicot comme symbole des soldats. Poème, enfin, qui donne son nom au musée commémoratif d’Ypres. La ville rend tous les soirs hommage aux 54 896 soldats disparus sur son sol, lors de la cérémonie du Lastpotsous les voûtes du mémorial de la Porte de Menin.
In Flanders fields museum est à l'origine un musée associatif qui se professionnalisera en 1998. Quinze ans plus tard, la muséographie vient d'être complètement revue. A deux ans du centenaire de la Grande Guerre, ce n'est pas anodin, à l'heure où ses derniers témoins ont disparu, le rapport à l’événement se modifie. Il y a lieu de réfléchir sur la transmission de cette mémoire, et du rôle des musées de guerre aujourd'hui, comme l'ont rappelé les journées d'études organisées par le master les 11 et 12 décembre à Ypres : «Comment construire collectivement un patrimoine commun ? »
Comme à Péronne, l'historiographie, sans cesse plus riche sur cette période, a porté ses fruits, tous les belligérants sont représentés dans le musée d'Ypres, mais l'histoire commémorée est locale et donne à voir la guerre vécue en Flandre Occidentale, In flanders fields...
La scénographie dernier cri, s'accompagne d'une bande-son parfois oppressante. Les concepteurs ont choisi une ambiance grave un tantinet sensationnelle, sans toujours éviter la mise en scène macabre. Entre deux cimaises grises, une série de clichés, à l'accrochage esthétisant, représente des soldats morts, photographiés afin d'être ultérieurement reconnus.
Crédits : MTDF

Crédits : MTDF
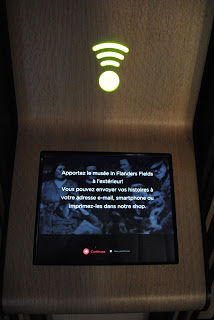
En résumé, le visiteur vivra une expérience forte qui l'interpellera dans son vécu (une borne permet de rechercher ses ancêtres morts sur le front) et cherchera àl'impliquer dans la construction de cette mémoire. A l'aube de 2014, c'est un site à ne pas manquer !
Noémie Boudet
Site internet du musée In Flanders Fields Museum
1 : "au champ d'honneur lescoquelicots,entre les croix de lot en lot"
2 : " RFID : radioidentification, permet de mémoriser et repérer à distance des informationscontenues sur les marqueurs
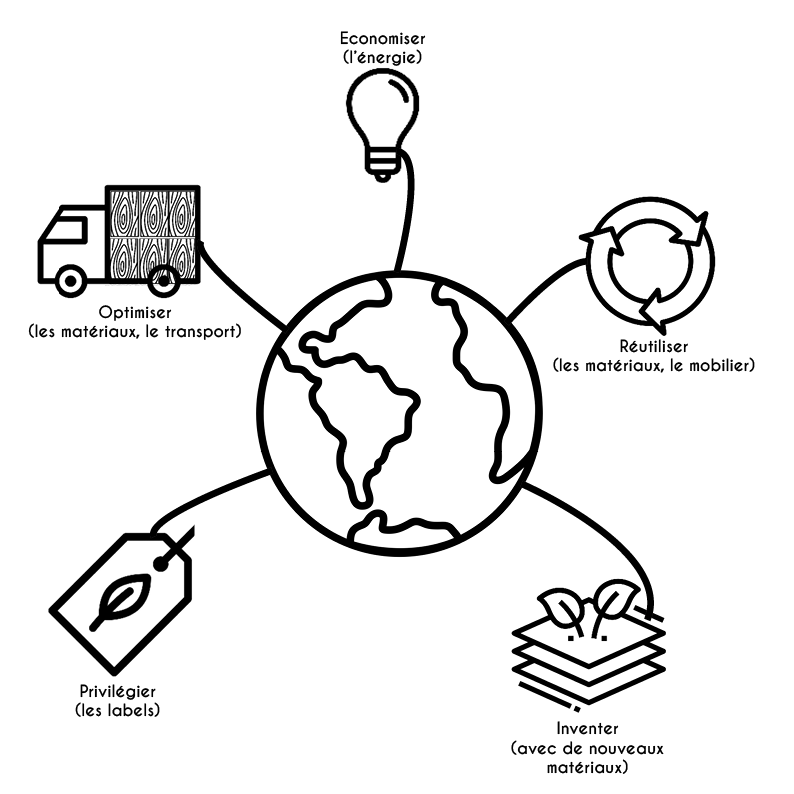
L'avenir écologique de la scénographie d'exposition - post Covid
“Sans doute faut-il redessiner notre manière d'habiter le monde. On ne peut plus continuer sur la lancée actuelle, même en usant de prouesses technologiques. On ne peut plus autant se déplacer. On ne peut plus autant renouveler. On ne peut plus autant gaspiller. On ne peut plus autant tuer. Nous n'avons pas vraiment d'autres choix que d'accepter cette évidence.”
Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité -
édition Michel Lafon, 2019
À l’heure où j’écris, je devrais être en stage, à imaginer des scénographies pour des expositions et des musées.
Sauf que je suis sur ma terrasse, en train de relire Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité”d’Aurélien Barrau, paru en 2019. En pleine crise du coronavirus, le pays est à l’arrêt et la nature reprend quelque peu ses droits.
Je fais des efforts dans mon quotidien, j’ai choisi un métier qui pourtant pollue : construire pour l'éphémère, être outil de spectaculaire, utiliser des matériaux nocifs et autres substances chimiques. Bien sûr ce n’est rien comparé aux industries du textile et agro-alimentaire, mais quand cet outil est censé éduquer et être au service du visiteur, je remets en question son utilité. Comme j’ai le temps de réfléchir, je me suis interrogée sur les solutions alternatives qui existent ou qui existeront peut-être après cette crise, celles qui ne sont pas enseignées en école en Design, en espérant qu’il y ait une prise de conscience d’un point de vu global.
Créer revient-il à polluer ? Quels sont les différents impacts d’une exposition ?
La scénographie tient une place centrale dans une exposition. Je ne le dis pas parce que je suis une fervente défenseure de ce métier mais parce qu'elle permet de donner vie au travail de muséographie dans un espace. Mais elle a aussi une place centrale dans l’impact écologique qu’aura le projet.
Voici le trajet d’une planche de contreplaqué issu du système classique : la matière première, le bois donc, et extrait, généralement dans des “plantations” cultivées à cet effet. Puis le bois est transformé pour lui donner sa forme de planche, pour cela on utilise de l'énergie. Ensuite, la planche et ses consœurs sont acheminées dans des camions vers le lieu de chantier, ce qui provoque des émissions de gaz à effet de serre. Cette planche n’est généralement pas à nu, on la revêtue par la suite de peinture, de colle… qui sont des produits toxiques. Enfin, une fois l’exposition assemblée, le lieu doit être prêt pour accueillir le public et mettre en avant le propos, on utilise à nouveau de l’énergie pour chauffer et éclairer l’espace.
Bien sûr cela n’est pas que l'apanage de la scénographie. Mais avec l’accroissement des expositions temporaires, d’une durée variable de 3 à 6 mois, le coût écologique est important.
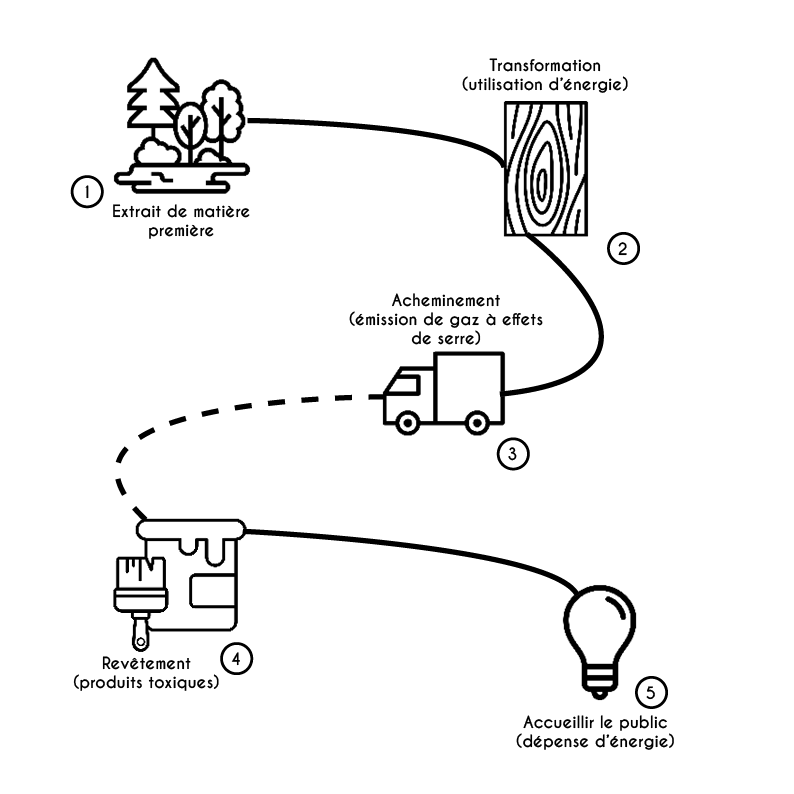
Illustration ©JD
Les lignes bougent
Il faut tout d’abord préciser que les enjeux soulevés par le développement durable sont fondamentaux et liés à l’avenir de notre société.
Le problème donc avec l’éphémère c’est son coût écologique important sur une courte durée et le gâchis de matériaux. A moins de rentabiliser un maximum l’exposition et de la faire voyager sur une longue période, ce qui pose aussi des soucis de transport et de Co2.
La BNF a publié en 2011 un guide de scénographie et développement durable, appelé Projet Coal. Même si il date de bientôt dix ans, il est encore aujourd'hui extrêmement d’actualité et offre des solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact écologique sur notre environnement. Parmi celles-ci, il est préconisé d'optimiser les matériaux et l'énergie dès la phase conception du projet, de privilégier les labels et des encres sans solvants pour l’impression. Cela est déjà ancré dans le processus de création scénographique, l’optimisation à un rôle important d’un point de vue économique.
Il est maintenant possible d’utiliser des matériaux alternatifs, tel que le carton, le tyvek, ou des matériaux recyclés. Un concept créé il y a quelques années dans l’événementiel s’est développé dans la scénographie d’expositions temporaires: la scénographie en palettes L’une des premières expositions réalisées par le Master MEM en 2013, L’Objectif en coulisses, faisait usage de palettes comme éléments scénographiques. Le dernier exemple en date est l’exposition Liaisons vitalesau Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, conçue entièrement en palettes louées à des entreprises spécialisées, puis récupérées pour servir un autre projet. Certaines agences de designer ont même fondé leurs principes de création sur le recyclage.

Exposition Ionesco, mobilier scénographique en carton ©BNF

Exposition Liaisons vitales, Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, © La voix du nord
Le sujet de l’exposition a aussi son rôle dans l’éco-conception de l’exposition. Certains sujets se prêtent mieux au développement durable, et plus d’efforts sont faits de la part des organisateurs en ce sens. Les musées de sciences et muséums sont généralement les plus concernés et ceux qui choisissent une démarche écologique dans chaque projet, sans doute car leurs expositions font souvent l’objet de scénographies plus variées.
Repenser la fin de vie d’une exposition
Là où ça coince (mais ça commence à bouger !), c’est au moment du démontage de l’exposition et de la fin de vie du mobilier scénographique. Ce processus est très rarement pris en compte dès la conception du projet, pourtant il est tout aussi important que l’ensemble des choix faits précédemment. Actuellement, le mobilier est soit entreposé, soit mis à recycler (si cela est possible). Or si on s'appuie sur les principes du zéro déchet Refuse, Reduce, Reuse, Recycle ( refuser, réduire, réutiliser, recycler,), la réutilisation est à privilégier, et le recyclage arrive en bout de chaîne. Pourquoi réutilise-t-on si peu le mobilier scénographique ? Parce que l’œuvre appartient à son auteur, et qu’une clause dans le droit à la propriété intellectuelle interdit la réutilisation du mobilier. Mais la plus grosse difficulté reste le stockage de ces mobiliers.
Pourtant certains musées ont instauré la réutilisation dans leur cycle de conception d’exposition. Le MNHN le fait déjà, et lorsque ce n’est pas possible, propose son mobilier à la Réserve des Arts, une recyclerie qui distribue ensuite ces mobiliers aux étudiants en art.
Il serait urgent de rendre systématique le réemploi de certains éléments scénographiques, en l'imposant dans le cas des marchés publics, et ainsi de mettre à disposition une liste de matériel disponible. Cela implique aussi de repenser la scénographie non pas comme une seule exploitation mais pour un cycle d’expositions.
Pourquoi ne pas proposer une banque de mobiliers scénographiques, et de rémunérer des groupements pour les gérer, tels que l’association des scénographes? Ou dans un réseau de musées ?
Les initiatives viennent aussi des designer, pour voir au-delà des principes de l’éco-conception, à l’image des Rad!cales, qui s’adressent aux professionnels de la création et à leurs partenaires. Ils militent pour un design radical et responsable face à l’urgence climatique et sociétale, en mettant en communs les ressources de chacun.
Less is more
Peut-être serait-il temps de repenser le système de création d’une exposition ? Le principe de location est intéressant pour ce qui est de rentabiliser une scénographie et de prolonger sa durée de vie. Des institutions comme le Mémorial de la Shoah ou l’Institut du monde arabe ont un service d’itinérance mais les expositions ont la forme simple de panneaux. Les centres de cultures scientifique, techniques et industriels sont plus ambitieux et proposent des expositions à la location adaptées à l’espace à disposition, à l’image du MNHN ou d’Universcience.

Exposition Viral présenté au Forum des sciences de Lille, produit par Ciencia Viva et Pavilhão do Conhecimento avec Universcience et Heureka ©JD
Mais cela reste très minoritaire. Pourquoi ne pas penser moins mais mieux ? Less is more, célèbre maxime de Mies Van Der Rohe, qui était architecte et designer.
En prenant exemple sur la Suède et son Riksutställningar ( en gros: un établissement public pour concevoir des expositions itinérantes), il serait possible de créer un groupement de musées pour concevoir des expositions itinérantes. Chaque année, des moyens seraient concentrés sur une exposition importante, au lieu de plusieurs petites expositions, pendant que les anciennes expositions seraient rentabilisées dans différents musées appartenant au groupement.
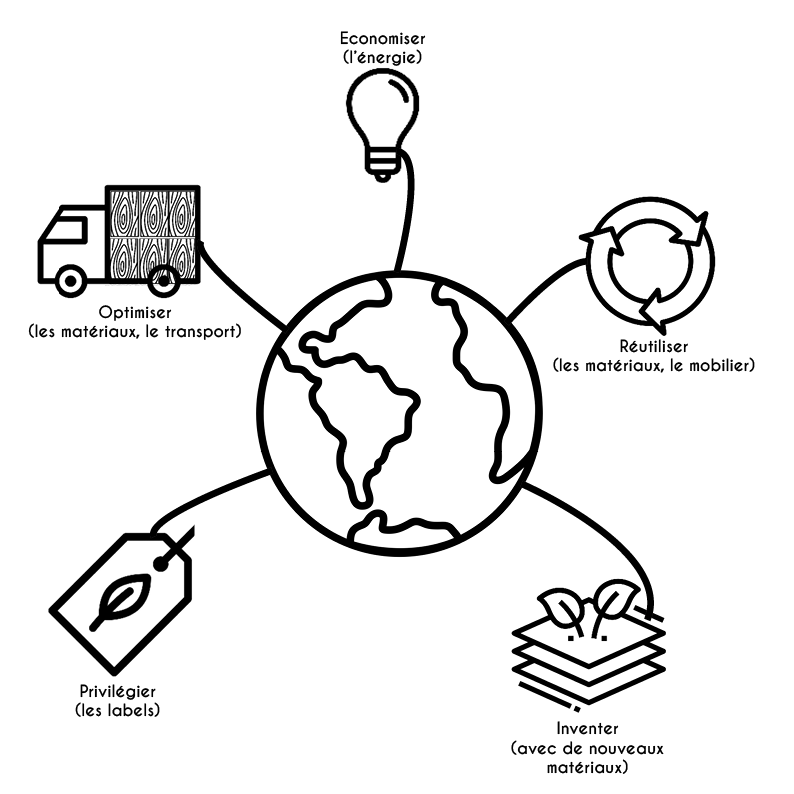
Illustration ©JD
Et si tout disparaissait ?
Et si, dans une vision pessimiste et post-apocalyptique, on imaginait très probable la disparition des expositions, des lieux publics. Avec la crise économique qui se profile, ou sera la priorité de financement ? Comment va évoluer notre système ? Opter pour plus de numérique ?
Tout reste encore très flou, mais l’ICOM et l’OCDE se sont penchés sur le sujet, je vous invite à lire le résumé ici si ce n'est déjà fait.
Juliette Dorn
#scénographie
#écoconception
#les rad!cales
Pour aller plus loin : http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
Manifeste Les Rad!cales
https://mcusercontent.com/28599b64a04cac8ef53cd3c68/files/ae5908c4-83da-4c22-ae7d-3714f258244f/LES_RAD_CALES.pdf

L’Alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentation
Lors de son épopée suisse, la caravane arrageoise s’est arrêtée le temps d’une matinée à L’Alimentariumde Vevey. Monsieur Denis Roher, conservateur du musée, nous a accueillis et guidés au sein de cette institution entièrement dédiée à l’alimentation. Cette rencontre nous a permis de comprendre l’évolution du musée, ses partis pris mais également ses projets, car le musée prépare sa troisième version et fermera ses portes en 2014 pour deux ans de rénovation.
Muséographier l'alimentation
Crédits : Camille Savoye
 Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.
Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.
L’alimentation est un objet d’études complexe et passionnant qui s’insère au sein de nombreux domaines : des implications liées au corps à un aspect sociologique, d’une approche anthropologique à celle économique ou encore écologique. Ces différentes approches sont exploitées tout au long du parcours et intègrent l’ensemble des espaces muséographiques par le biais de dispositifs qui questionnent et interpellent. En arrivant dans l’espace acheter, deux grandes tables sont accrochées à la verticale le long du mur, sur celles-ci sont disposés les différents produits de consommation courante au XIXème siècle pour l’une et au XXIème siècle pour l’autre. Ce dispositif permet non seulement de comparer les différents modes de consommationmais également de penser à l’évolution des manières de tables et de questionner nos propres habitudes de consommation. La médiation orale, qui sera privilégiédans la troisième version du musée, permet d’exploiter toute la richesse de ce dispositif.
Médiation de la cuisine
Crédits : Camille Savoye
Valoriser une médiation orale semble en effet opportun pour un musée vivant ou le visiteur expérimente tout au long de sa visite. N’est-ce pas, par ailleurs, la meilleure façon d’aborder l’alimentation, par le biais du partage et d’une démarche conviviale ? Ce caractère inhérent à l’alimentation est par ailleurs très bien exploité dans la partie cuisine du musée où de nombreux ateliers sont animés par les médiateurs-cuisiniers. Les ateliers permettent d’explorer l’aliment selon des thématiques, déterminées géographiquement ou historiquement. Ces ateliers ne sont pas conçus pour apprendre à manger équilibré mais pour expérimenter, découvrir des cultures à travers leur alimentation et interpeler notre palais. Chaque participant repart avec sa préparation, une belle occasion de partager chez soi l’expérience vécue au musée et de prolonger sa visite.
La cuisine semble avoir pris beaucoup de place au sein de la structure au fil des années, ce qui ne semble pas être au déplaisir du public : le musée enregistre en moyenne 65 000 entrées par an, composé d’autant d’adultes que d’enfants. Afin de rééquilibrer le musée et d’insérer une approche plus scientifique Monsieur Denis Rohrer, conservateur du musée, souhaite mettre en place une politique d’acquisition afin d’enrichir la collection. Bien qu’il s’agisse d’une fondation Nestlé celle-ci ne se constitue non pas autour de l’entreprise mais bien sur l’alimentation en général.
Crédits : Camille Savoye
 On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.
On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.Camille Savoye

L’itinérance : une force de diffusion
Mobilisée depuis le XIXe siècle, l’itinérance s’est aujourd’hui intensifiée comme outil indispensable pour la diffusion d’une exposition sur le territoire régional, national voire international.
Produite par une même institution ou coproduite entre plusieurs acteurs, réalisée en interne ou externalisée, elle nécessite, comme tout outil, une gestion de projet particulière propre à chaque structure.
Image d'introdution : ©Tiffany Corrieri
Le Forum départemental des Sciences (FDS), Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel où je réalise mon apprentissage, privilégie l’itinérance et réalise des outils depuis 1984. À ce jour, une cinquantaine d’outils, dont 30 créations originales parfois déclinées en plusieurs exemplaires afin de pallier les demandes d’un même produit, composent le catalogue. Je vous propose un bref état des lieux des spécificités des expositions et outils itinérants, grâce aux échanges que j’ai eu avec Catherine Ulicska, coordinatrice de projet itinérance au Forum départemental des Sciences.
Pourquoi choisir l’itinérance ?
Développer le musée et diffuser ses savoirs hors les murs pour toucher un public plus large et éloigné géographiquement et culturellement, sont des points essentiels pour la promotion d’une exposition. Ainsi la force de diffusion permet d’identifier plusieurs intérêts :
Avoir une portée plus grande sur le territoire quand la situation géographique de certaines institutions est trop lointaine. Ces dernières ne peuvent pas se déplacer jusqu’au musée faute de moyens, de temps ou de ressources humaines. Par ailleurs, aller vers le public et proposer ses outils dans des structures, c’est aussi faire tomber les barrières du transport.
L’itinérance des expositions affirme donc la mission de diffusion de culture scientifique au sein du territoire, en exprimant son savoir-faire en termes de médiation et d’ingénierie culturelle. De par son historique, le FDS peut se positionner comme une référence en termes de conseils en gestion et réalisation de projet, pour les acteurs qui auraient envie de tenter l’expérience. Ces partages et retours pratiques sont une des missions du poste dédié à l’itinérance.

Le planétarium itinérant est très sollicité. Il permet de diffuser le savoir scientifique et faire découvrir l’astronomie sur l’ensemble du territoire. © Forum départemental des Sciences
Proposer une mise à disposition pour les institutions éducatives de la région s’inscrivant dans l’offre de service public, lors de réalisation de dispositifs. Au Forum départemental des Sciences, les emprunteurs qui participent à Science Collège Nord ou l’Appel à projets peuvent bénéficier de la gratuité des outils. Ainsi écoles maternelles, primaires, collèges ou médiathèques peuvent gratuitement accueillir une exposition et un ou plusieurs outils.
Néanmoins, au FDS, à chaque sortie, prêt ou location, le transport, montage et démontage restent à la charge de l’emprunteur.
Apporter une seconde vie à l’exposition après son implantation et ainsi renforcer ou renouveler la programmation sur une thématique spécifique. Le FDS renouvelle sa programmation par la location d’une exposition tous les ans, portant sur une thématique de saison. Il reste cependant plus compliqué de trouver des expositions à destination des tout-petits (3-6 ans) en location.
En plus de ces aspects sociaux, des critères économiques sont évidemment prépondérants: faire itinérer une exposition peut amortir les coûts de production en intéressant des institutions et un public plus larges, et ainsi dégager quelques recettes. Pour autant, cette intention s’applique davantage aux producteurs privés, que je ne vais pas développer ici, puisque je limite mon propos aux institutions publiques.
Quelle gestion de projet ?
Puisque les expositions itinérantes demandent une gestion de projet mobilisée par une équipe dédiée, des institutions bénéficient aujourd’hui d’un poste ou des missions dédiées à l’itinérance, au vu de la professionnalisation du secteur de production d’exposition.
Anticiper et réfléchir aux critères d’itinérance en amont, lors de la réflexion du projet, sont des points clés pour ce type d’exposition. Le manque de vigilance au préalable peut apporter des modifications bien lourdes et onéreuses à effectuer par la suite.
Intégrer une équipe diversifiée pour penser le projet en termes de co-design, et gérer le cycle de vie du projet permet d’identifier les difficultés pouvant être rencontrées et de souligner les points de vigilance à intégrer. Au Forum départemental des Sciences l’équipe se constitue d’un.e chef.fe de projet, d’un référent technique, d’une coordinatrice itinérance, d’un.e médiateur.trice, et éventuellement d’une référent accueil. Outre l’équipe projet, les prestataires doivent aussi être conscients des critères de réalisation; au FDS la chargée d’itinérance insiste sur la durée de vie prévue à minima de 10 ans des expositions auprès des prestataires, afin qu’ils privilégient des matériaux durables.
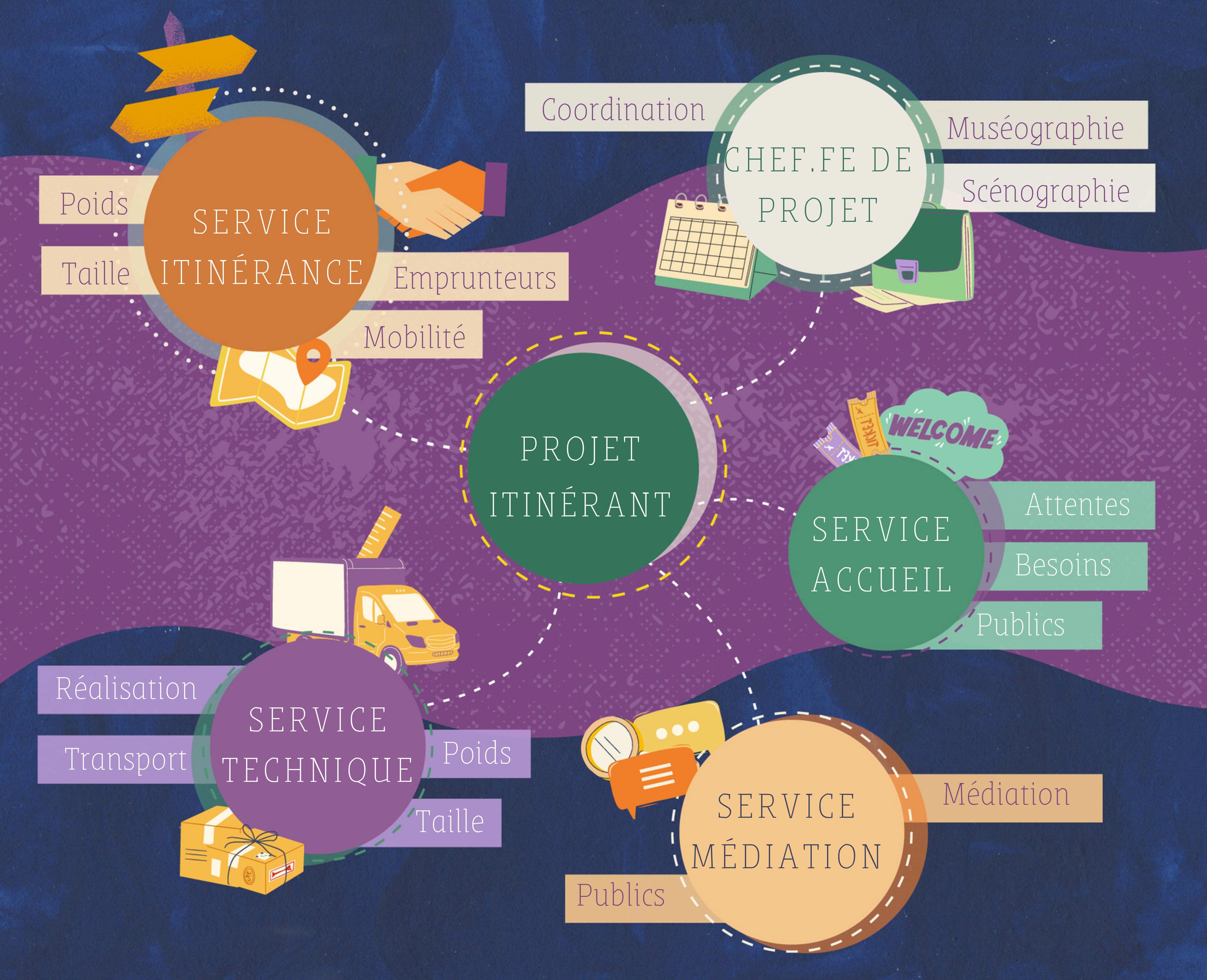
La réalisation d’un projet ou outil itinérant demande une transversalité des différents services de l’institution. ©Tiffany Corrieri
Une exposition itinérante demande donc une mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières importantes.
Enfin dans la durée de vie de l’exposition, les retours emprunteurs, premiers confrontés aux critères de location de l’exposition, sont à prendre en compte car ils permettent de réaliser un bilan sur le fond et la forme de cette dernière, et éventuellement de réaliser des modifications.
Quelle évolution du poste de coordinatrice de projet d’itinérance ?
«Le poste de Chargé.e de l’itinérance au FDS consiste en la promotion, la prospection, l'évaluation des expositions sur le territoire, et la coordination entre services afin que les mises à disposition se déroulent au mieux. Il s’agit également de participer à l’animation des réseaux des emprunteurs et futurs emprunteurs, en place depuis longtemps et agrandie par des mises en relation, pour parfois aboutir à des co-productions dans lesquelles chaque entité se complète.
L’évolution du poste en interne porte sur la gestion de relation client (CRM) via un logiciel dédié, les besoins en termes de communication étroitement liés à la promotion, la consultation pour de nouveaux projets d’exposition ou d’animations à venir. Puis, d’un point de vue externe, il s'agit de mettre en place des dispositifs d’intégration des réseaux emprunteurs, de mettre en relation des acteurs culturels entre eux avec des moyens complémentaires».
Carte d’identité technique d’une exposition ou outil itinérant
Afin de mieux répondre aux besoins d’itinérance, certains points sont à prendre en compte dès la réflexion du projet. Néanmoins ces derniers dépendent de l’objectif de réalisation de l’exposition et des moyens.
Une taille et un poids mesuré : l’exposition ne doit pas être trop encombrante pour pouvoir être accueillie dans un maximum d’institutions, particulièrement pour les petites entités qui détiennent un espace restreint pour accueillir l’exposition (médiathèques, écoles). Comme cela, la logistique (transport, montage/démontage, maintenance) reste accessible financièrement et techniquement. Ainsi, au FDS les expositions pour le Petit Forum, à destination des 2-7 ans, occupent moins de 100m2.

De grands modules avec de hauts montants en aluminium composent l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran. Ici un fond vert de 12 mètres 30 de long. © Forum départemental des Sciences
Certaines institutions proposent une déclinaison de l’exposition en plus petit format à l’instar du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris avec ses grandes expositions déclinées en Petit forme, en exposition panneaux.
La prise en compte du poids et de la taille s’applique aussi à l’emballage dont les dimensions vont influencer sur le stockage des caisses.
Néanmoins, le parti-pris existe d’assumer une taille plus importante des modules, comme avec l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran réalisée par la Cité des Sciences qui va être accueillie par le FDS en octobre 2022, et demande la mobilisation de 3 semi-remorques.

L’exposition L’Homme est-il un grand singe ? est composée de bâches qu’on peut enrouler et de montants en aluminium, facilement démontables qui permettent un transport facile.
© Forum départemental des Sciences
Un mobilier stable : le mobilier de l’exposition doit être résistant, notamment les manipulations, à l’épreuve des enfants. Les normes incendies sont aussi un point à réfléchir en amont. Ce mobilier doit pouvoir être facilement déplaçable et résistant pour ne pas être remplacé tous les ans.
Un montage et démontage facile : l’institution hôte (comme les écoles, ou les petites collectivités) peut ne pas avoir le matériel nécessaire pour le déplacement ou le montage de l’exposition. Par leurs poids et taille, les modules se doivent d’être pratiques et intuitifs à monter. Au FDS, les expositions du Petit Forum (2-7 ans) sont réfléchies en termes de praticité pour un montage et démontage sans encombres pour les emprunteurs; certains modules ne demandent pas d’assemblage et sont livrés sans besoins de montage.

Préparation du montage de l’exposition Mon Dodo © Forum départemental des Sciences
Le service associé à l’exposition : certains musées ou centres de sciences proposent un service clé en mains avec une prestation prête à l’emploi portant sur des animations ou spectacles associés à l’exposition louée, comme à la Cité de l’Espace à Toulouse, ou par le déplacement d’un animateur en camionnette pour animer des ateliers sur place comme avec Le colporteur des Sciences au Pavillon des sciences à Montbéliard.
La plupart du temps la médiation et l’animation d’outils itinérants est réalisée par des médiateurs.trices de l’institution hôte, qui, mené.es par des guides d’animations, se réapproprient le sujet de l’exposition pour l’adapter à la thématique mise en avant par leur établissement.
Profils d’emprunteurs diversifiés
Les emprunteurs d’une exposition itinérante sont divers et les conditions d’emprunt propres à chaque structure proposant le contenu. Il peut exister des forfaits comprenant certains critères qui définissent si le transport, le montage et/ou la médiation sont compris dans le prix de location.
Les emprunteurs peuvent être issus du service public, tel que les écoles, médiathèques et bibliothèques, les musées, les bâtiments administratifs ou touristiques (mairies, office de tourisme), et les associations. Il peut également être question d'une société privée identifiée dans le domaine artistique et scientifique ou non, comme des sièges d'entreprises, des gares, aéroports ou centres commerciaux. Il est aussi possible pour des particuliers de louer des expositions ou outils itinérants.

Vue d’ensemble des outils itinérants empruntés par la ville d’Ostricourt. Les modules sont présentés dans la salle des fêtes de la ville. © Tiffany Corrieri
Certains établissements sont fidèles à la location d’expositions d’une même institution et créent ainsi un réseau au fil des années. Les loueurs sont toujours demandeurs, d’où l'importance de créer de nouvelles expositions à un rythme régulier qui peut être difficile à tenir lors de restrictions budgétaires, et de prendre en compte leurs retours.
Quelle vie après avoir fait le tour de France ?
Afin de savoir quelles expositions ou outils pourraient être améliorés, mis à jour ou jetés, un état des lieux annuel est réalisé avec la direction, en suivant des critères d’évaluation spécifiques. Initialement, le FDS s’appuyait sur le seul fait de faire itinérer l’exposition au maximum 10 ans. Néanmoins les demandes et le renouvellement difficile des offres ne permettent pas de proposer des créations originales, afin de faire tourner la programmation et de remplir le catalogue, en remplaçant les précédentes.
L’obsolescence est le critère le plus favorisé pour trier les expositions et outils du catalogue et définir leur fin de vie ou non. En effet, certaines conceptions pédagogiques du FDS, de par leur ancienneté, présentent une obsolescence technique par l’utilisation de CD, de diapositives ou de clés USB qui ne correspondent plus aux normes et pratiques couramment utilisées.
Ainsi, les outils itinérants sont passés sous le crible de l’évaluation financière, du réinvestissement humain, du renouvellement des droits à l’image et du traitement du sujet qui peut devenir obsolète. Les évaluations post-location permettent de rester à jour sur l’impact de l’exposition en termes de contenu, scénographie, de maintenance etc, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs lors de la prochaine création.
Quand un mobilier est marqué comme obsolète, le matériel est parfois récupéré et réutilisé, ce qui n’est plus exploitable est jeté. D’autres fois l’exposition peut avoir une seconde vie via une vente ou une donation.
Je remercie Catherine Ulicska pour sa disponibilité et son expertise.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
- Méliné Kéloglanian, «Le marché de l’exposition itinérante internationale, ses acteurs et sa filière », La Lettre de l’OCIM 178 | 2018.
- Catalogue des outils itinérants pour la médiation scientifiques et techniques en Hauts-de-France, édition 2020.
- Les expositions itinérantes : guide à l’usage des gestionnaires de tournées, Société des Musées du Quebec.
#itinerance #technique #ingenierie

La Chartreuse de Douai, un musée à la médiation exemplaire
Une architecture incontournable
© http://www.musenor.com/Les-Musees/Douai-Musee-de-la-Chartreuse
La Chartreuse de Douai est un musée de beaux-arts municipal. Nous pouvons y accéder en franchissant un portillon et un petit parc recouvert de gravier blanc et de végétaux variés. Là nous découvrons une architecture très authentique qui nous invite à entrer dans ce bâtiment, ou plutôt monument. L'architecture est une partie prenante de ce lieu attrayant. Une des caractéristiques de ce musée est qu'il est installé dans un ancien couvent. Les noms des salles ont d'ailleurs été conservés tels quels : le petit cloître, le réfectoire, la salle capitulaire, et la chapelle.
Ce musée possède une large collection de peintures, sculptures, orfèvrerie et objets d'arts. Il s'inscrit dans un scénario chronologique, entre néo-classicisme et réalisme et parcourt diverses contrées.
Il prend en compte l'accessibilité tarifaire : le tarif réduit est de seulement 2,30 euros et le plein tarif est de 4,60 euros. Ceci est plutôt rare et permet d'attirer davantage le public ! Puis, pour chaque personne, des visites guidées gratuites sont organisées chaque premier dimanche du mois, ce qui permet au public d'appréhender les collections sous divers angles.
L'équipe de médiateurs, qui sont conférenciers ou plasticiens, est composée de six salariés très investis dirigés par une chargée des publics ancienne infirmière anesthésiste ! Ce qui est plutôt atypique ! Les médiateurs créent des contenus, des activités et des visites à destination du public scolaire et adulte et également à destination du public handicapé, hospitalier et pénitentiaire. Chaque personne est prise en considération et trouve sa place au sein de cet espace culturel.
De nombreux musées se cantonnent souvent à des actions culturelles envers les scolaires et les groupes d'adultes. Ici le musée saisit l’idée de démocratisation culturelle tout en l’élargissant. Il valorise ses collections en les proposant à une palette de publics très large. Malgré des périodes difficiles et un budget qui est plus faible que celui de grands musées nationaux, le musée est fort de propositions très attractives envers chacun.
Le musée propose ses activités à de nombreux acteurs tels que les associations, les comités d'entreprises, les centres sociaux et les centres de formation, les centres hospitaliers et les maisons d'arrêt. Il souhaite toucher un public vaste et créer des partenariats forts avec ces institutions. Les projets proposés sont d'ailleurs adaptés selon la demande de ces lieux.
Des actions culturelles en milieu pénitentiaire

Le cloître : lieu d'expression des publics
Crédits : Lilia Khadri
Les projets à destination du public handicapé sont à long terme, sur l'année, ce qui permet de mieux s'approprier les collections et de créer un lien fort avec l'art et le lieu.
Pour les malvoyants le musée a créé le musée au bout des doigts en s'appuyant sur le patrimoine architectural du lieu qui est intéressant à explorer. Pour cela une maquette tactile a été créée, elle comprend la distribution des salles mais aussi les époques de construction. De nombreux musées implantés dans ce type de lieu patrimonial pourraient s'inspirer de ce dispositif. De plus les personnes malvoyantes peuvent tout de même découvrir des œuvres du musée, durant des visites au sein desquelles le médiateur présente une collection d'œuvres qu'il a choisi, à travers des tables d'orientation accompagnées de commentaires audio et des équipements en braille.
Le public en situation de handicap mental est confronté lors d'évènements aux notions de temps, corps ou encore beauté.
La chapelle du musée Crédits :Lilia Khadri

Ce que chaque visiteur peut retenir de sa visite au sein de la Chartreuse est l’architecture remarquable, la collection très variée et bien mise en valeur, et un musée compréhensible par tous !
Lilia Khadri
En savoir plus :
- http://www.museedelachartreuse.fr/
# Musée pour tous
# Beaux-Arts
# Région des musées

La Piscine, championne de médiation
Suivez l'animateur, pieds nus et esprit libre ! Bienvenue à La Piscine, musée d'art et d'industrie de Roubaix, à la politique des publics enthousiasmante.
(c) Marie Tresvaux du Fraval
Ouvert en 2001 dans l'ancienne piscine municipale fermée en 1985, le musée de Roubaix a connu une histoire mouvementée : d'abord musée industriel de 1835 à 1861, puis les collections s'installent à l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles construite à partir de 1881. Gravement atteint lors de la Seconde Guerre Mondiale, le musée sera déclassé en 1959 et ses collections dispersées, fait unique en France. Le renouveau viendra avec le don du fonds d'atelier du peintre Jean-Joseph Weerts et l'installation d'un musée dans l'hôtel de ville de 1963 à 1980, années pendant lesquelles le projet du musée actuel est en gestation et les équipes font leurs armes au sein de la mairie. Actuellement, le service de médiation s'organise en deux équipes qui correspondent à deux offres distinctes : les animations pour les moins de 18 ans et les visites au-delà de cet âge. Les animations retiendront ici notre attention. Suivons par exemple Julien Ravelomanantsoa (dit Julien), artiste-animateur-fantaisiste, le temps de l'animation « 4 sens ».

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval
Plus tard allongés sur le sol au pied de l'ancien grand bassin, non loin de paisibles statues, nous méditons. Julien nous invite à livrer nos impressions du moment présent : « vastitude et au-delà » pour certains « bien-être » pour d'autres. En effet nous sommes dans un ancien cloître (bien antérieur à la piscine). Ailleurs, des meubles tactiles conçus eux aussi par Astuguevieille, au contact des textiles nous recréons des histoires. Ce parcours décalé et désinhibant au sein des collections permanentes du musée a l'air iconoclaste mais il sert un discours sérieux et accessible sur les œuvres. L'aspect ludique et l'attention portée à l'individu (enfant), son vécu, son imaginaire permet une lecture et une approche de l'art très stimulante, véritable parti pris du lieu, le jeune public est d'ailleurs prioritaire par volonté politique de la ville. Mais liberté et plaisir ne sont pas synonymes de « n'importe quoi », les animateurs, souvent plasticiens, font montre d'un grand professionnalisme qui convainc même les plus récalcitrants.
Crédits : MTDF

Notre enthousiasme ne doit pas faire oublier la réalité des moyens, nos animateurs sont pour la plupart vacataires et donc précaires et les animations dans les salles, si elles permettent une mise en valeur du site, désengorgent aussi les deux ateliers trop petits. Car c'est là le paradoxe, La Piscine est victime de son succès et booke en quelques jours ses réservations pour l'année. Débordés, les animateurs-concepteurs n'entendent toutefois pas se complaire sur leurs lauriers et remettent sans cesse leur ouvrage et leur imagination sur le métier. Espérons que l'extension prochaine du musée (en 2015) qui verra notamment la recréation de l'atelier du sculpteur Henri Bouchard, un agrandissement des salles d'expositions temporaires et de nouveaux ateliers pour le jeune public, améliore les conditions de travail, quoiqu'il en soit La Piscine garde une longueur d'avance !
Noémie Boudet
La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent
23 rue de l'espérance, 59 100 Roubaix
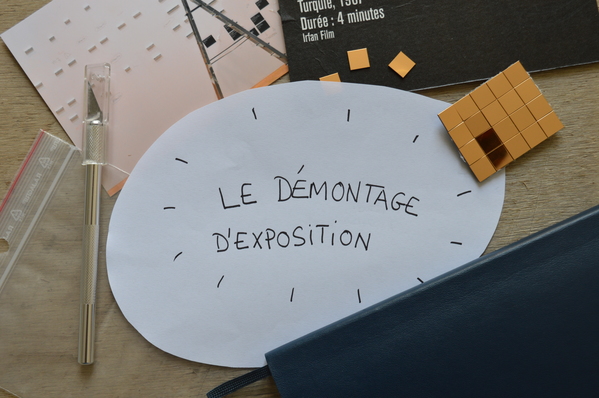
Le démontage d'exposition
Quand s’achève une exposition ? Quand le dernier visiteur est sorti ? Quand le dernier convoyeur est parti ? Aujourd’hui j’ai découvert ce qu’est le démontage d’une exposition, celui de Roman-Photo qui occupait le Mucem du 13 décembre au 24 avril 2018.
Cette dernière relevait de ce média particulier qui relate une histoire en fonctionnant comme une bande dessinée, au détail près que les personnages de l’histoire sont photographiés. L’exposition allait des origines du roman-photo en Italie à ses déclinaisons politiques ou humoristiques. Elle permettait de voir combien cette lecture populaire avait pu être décriée ou réutilisée et avait été l’occasion d’une création photographique de Thierry Bouët, véritable enquête sur les lecteurs de roman-photo aujourd’hui. De même, elle permettait d’étudier les différents genres qui en ressortaient, du ciné-roman au roman-photo érotico-noir, comique et satirique, au photo-roman…
L’opération de démontage d’une exposition suit les principes suivants : retirer les expôts et les protéger pour un transport ou un retour en réserves, démonter les vitrines et cimaises qui les contenaient, quitter les lieux d’une salle d’exposition. Les objets prêtés et exposés, quels qu’ils soient, doivent faire l’objet d’un constat d’état. On les retire des vitrines et on les observe sur une table éclairée avec une lumière rasante afin d’observer les éventuelles altérations. Les objets sont ensuite enveloppés puis déposés dans leur emballage attitré. Alors un convoyeur spécialisé les ramène au lieu prêteur. Lorsque les œuvres ou les artefacts font partie des collections du musée qui expose, ce constat d’état doit aussi être fait.

Eclairage à la lumière rasante pour constat des oeuvres © CC
Le démontage est idéalement assuré par les mêmes personnes qui avaient monté l’exposition : cela permet de se remémorer les difficultés rencontrées lors de l’installation des œuvres et ainsi de mieux anticiper les risques qu’elles pourraient rencontrer.
Lorsque nous entrons dans les locaux de l’exposition, les murs sont pratiquement nus et des annotations marquent les cimaises afin d’identifier les prêteurs ou les productions réalisées par le musée. Les adhésifs sont retirés à la spatule ou à la main. On pourrait penser à un déménagement très organisé : les emballages (depuis le montage conservés en réserves) qui doivent être réutilisés ce-jour sont entreposés dans un angle. Jean-Luc Delest, régisseur des expositions au Mucem annote au fur et à mesure la liste d’œuvres afin de vérifier que chaque œuvre est traitée convenablement puis bien restituée dans son enveloppe, cadre ou boîte d’origine. Il dresse peu à peu la liste de colisage qui recense tous les objets déposés dans telle caisse.
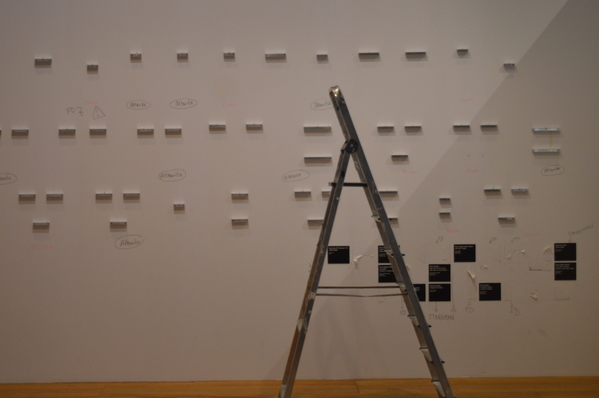
Mur vidé de ses œuvres avec les annotations qui permettent d'identifier les prêteurs © CC
Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le traitement des maquettes du ciné-roman A bout de souffle de Jean-Luc Godard, publié en 1969 dans le Parisien Libéré, soit 10 ans après son tournage. Il s’agit de photographies collées directement sur du carton et des bouts de papier sont collés dessus afin de former les paroles des personnages. Il s’agit d’objets graciles, dont le maintien est fragile et menace de se décoller. Comme ces maquettes appartiennent aux collections du Mucem, il est de les protéger et de les remettre en boîtes avant de retourner en réserve, avec l’aide de Marie-Charlotte Calafat -co-commissaire de l’exposition. Sémira Möller, staigiaire en régie des collections, m'accompagne pour l'assister et pour nous renseigner sur ce moment particulier.
Ces maquettes sont disposées de manière à ne pas être au contact d’un adhésif. Le Mucem a alors fait appel à Bianca Petrea, restauratrice spécialisée dans les arts graphiques. Lors du montage, elle avait collé des angles en plastique sur une plaque centrale de plexiglass, glissé les maquettes dedans et deux plaques de plexiglass étaient fixées de part et d’autre afin de protéger les vignettes tandis qu’un cadre maintenait le tout.
La suite, vous l’attendez, c’est bien entendu, une solution pour retirer dans de bonnes conditions ces maquettes !

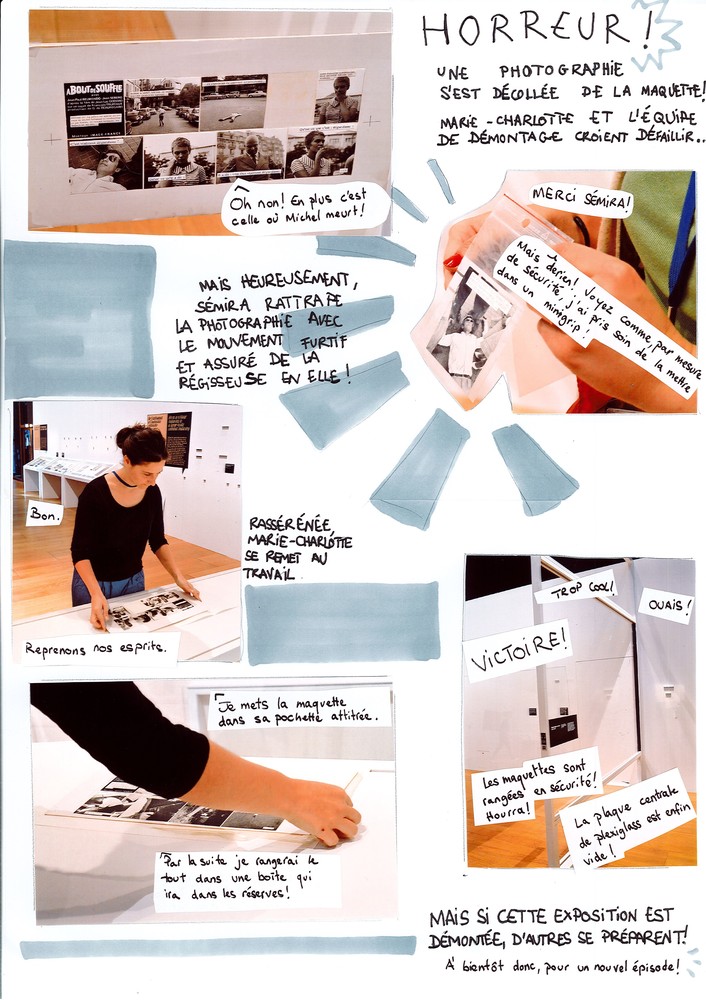
Un grand remerciement à Marie-Charlotte Calafat, Sémira Möller et Bianca Petrea de s’être prêtées au jeu !
Coline Cabouret
#régie
#démontage
#roman-photo

Le participatif pour la mémoire des deux guerres Journées d'études à Ypres les 11 et 12 décembre 2012
« Dans les musées de guerre,on passe du vécu au récit, alors que la question de la transmission entre les générations est très importante » a déclaré Dominiek Dendooven, le directeur du musée In Flanders Fields, en introduction des deux journées d'études où nous avons eu le plaisir d'être reçus. Organisées par le master MEM conjointement entre son équipe et le département du Nord, il s'agissait de dresser un panorama d'expériences menées avec les techniques participatives pour les musées des deux guerres mondiales.
C'est Sébastien Magro, le chargé de projet pour les nouveaux médias au Musée du Quai Branly, qui a ouvert le bal, avec le travail de recensement des logiques participatives qu'il a effectué ces dernières années. Il nous a montré, à travers l'histoire fictive d'une visiteuse nommée Sophie, toutes les interactions qu'il est possible pour un musée d'avoir avec son public aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Avec les réseaux et les nouvelles technologies, on assiste maintenant au passage vers le « transmédia », où une interaction est possible avec le média, contrairement à ce que le propose par exemple la télévision où l'on ne peut que recevoir et non échanger. Il a alors cité le projet « le défi des bâtisseurs », mené par l'équipe de la cathédrale de Strasbourg, où avec un webdoc, une application mobile et un blog, il est à chaque fois possible de partager son expérience.
Crédits : L'Art de Muser

Le musée était en train de préparer le centenaire de la grande guerre, qui commencera l'année prochaine en 2014, et une collecte avait justement lieu au musée In Flanders Fields pendant les journée d'études. Nous avons eu l'occasion de participer et c'était impressionnant : des dizaines de personnes viennent avec un objet leur appartenant datant du premier conflit pour le recenser dans la banque de données européenne.
James Whitman a ensuite expliqué le rapport à internet du Musée canadien de la guerre (le War Museum) dont il est le vice-président à Ottawa. Le point de départ était d'offrir un survol pour les étudiants de la guerre 14-18, afin d'apporter des informations certifiées et lisibles. Il y a aussi de nombreux cours préparés pour les enseignants, et de nombreux liens vers d'autres sites. Ainsi, le musée répond à sa mission de divulgation des connaissances, en se trouvant là sur internet, là où se formulent les premières demandes de renseignements.
Patrick Pecatte a ensuite raconté l'évolution du projet Photo Normandie, où un groupe d'une soixantaine de contributeurs bénévoles font de la « redocumentarisation » des photos de la bataille de Normandie sur Flikr. Ils ne sont jamais rencontrés dans la vraie vie, mais forment sur le netune communauté de passionnés. Il nous explique que pour un bon fonctionnement, il est nécessaire d'animer cette communauté, de relancer pour avoir toutes les informations, et chercher la vérification des sources. Ils arrivent généralement à une validation collective au bout d'un temps. Diverses institutions ont parfois parlé de projet commun, mais sans que cela n'aboutisse à chaque fois. Alors, dit-il « on fait notre travail sans savoir si ça plaît ou si plaît pas ».
Après la pause de midi, PaulinaBrault nous a parlé du Musée virtuel de la résistance, où elle est chargée de projet. Créé par l'Association d’Études sur la Résistance Intérieure (AERI), cela avait commencé par la diffusion de CD-rom sur les réseaux de la résistance de France pendant la guerre 39-45. Depuis, c'est sur une base de donnée internet que l'on peut retrouver toutes ces informations, qui continuent d'être complétées peu à peu. Un musée virtuel permet notamment de montrer des sites fermés au public, comme c'est le cas d'Eysses.
Crédits : L'Art de Muser
 Julien Goetz a ensuite relaté son expérience d'OWNI, qui a mis en ligne des informations de Wikileaks sur la guerre d'Algérie. Constatant que les archives étaient disponibles mais qu'il était difficile d'y accéder, ils ont alors décidé en petit groupe de créer un site internet pour partager ces informations publiques. Comme un média en Algérie faisait un appel à témoignages sur le conflit au même moment, un partenariat s'est engagé pour que le site rassemble les prises de paroles. Les document militaires ont été anonymes et il témoigne qu'il était difficile de trancher parfois entre ce que l'on cache et ce que l'on diffuse. Deux historiennes ont été associées au projet, pour qu'une expertise existe. Il avait été mis en garde contre un danger possible, des réactions négatives, mais il n'y en a eu aucune. Au contraire, il y a une réaction positive très forte, en Algérie comme en France, et le site enregistre des temps de visite très longs. Il recense aujourd'hui 1500 visites par jour.
Julien Goetz a ensuite relaté son expérience d'OWNI, qui a mis en ligne des informations de Wikileaks sur la guerre d'Algérie. Constatant que les archives étaient disponibles mais qu'il était difficile d'y accéder, ils ont alors décidé en petit groupe de créer un site internet pour partager ces informations publiques. Comme un média en Algérie faisait un appel à témoignages sur le conflit au même moment, un partenariat s'est engagé pour que le site rassemble les prises de paroles. Les document militaires ont été anonymes et il témoigne qu'il était difficile de trancher parfois entre ce que l'on cache et ce que l'on diffuse. Deux historiennes ont été associées au projet, pour qu'une expertise existe. Il avait été mis en garde contre un danger possible, des réactions négatives, mais il n'y en a eu aucune. Au contraire, il y a une réaction positive très forte, en Algérie comme en France, et le site enregistre des temps de visite très longs. Il recense aujourd'hui 1500 visites par jour.Pour conclure cette première journée, Martine Aubry, ingénieur de recherche à l'Université Lille 3, a retracé l' histoire de son travail sur la base de données des monuments aux morts dont elle est en charge. Un partenariat a été proposé aux mairies de France pour documenter la premièreguerre mondiale en s'appuyant sur les stèles commémoratives qui proposent une liste de toutes les personnes tombées au front dans chaque commune. Ils font aussi des collectes de cartes postales auprès d'amateurs éclairés, car ce n'est qu'en croisant les sources qu'une information se complète.
Anne Labourdette, conservatrice du Musée de la Chartreuse de Douai, a ouvert la deuxième journée avec le projet des conservateurs du Nord-Pas-de-Calais « Guerres & Paix ». Il va s'agir d'une grande numérisation de collections en lien avec ces thématiques, et d'un cycle d'exposition que va concerner 25 musées pour le centenaire de la Grande Guerre. L'idée serait de faire une indexation participative, car les conservateurs sont plutôt des spécialistes d'art que d'histoire. Le projet est en préparation, affaire à suivre...
Héléne Blanc a présenté les apports du logiciel d'inventaire Transmusite 14-45, acquit dans le cadre d'un projet transfrontalier. Les musées ont ainsi l'occasion de se rencontrer et d'échanger autour de leurs collections et de leurs méthodes d'indexation.
Michèle Gellereau et Alain Lamboux-Durand ont poursuivi avec le projet Témuse. Ce projet de recherche sur trois ans du Laboratoire GERIICO de l'Université de Lille 3 avait pour objectif de rassembler les informations des collectionneurs d'objets de guerre, et de réfléchir à leur transmission et leur capitalisation. Pour beaucoup de collectionneurs, « tout est dans la tête », mais il est nécessaire de les faire partager car ils possèdent de nombreuses connaissances. 17 entretiens ont ainsi été menés à deux caméras pour faire raconter l'histoire de ces objets, souvent étonnante. La réflexion sur la mise en partage est en cours.
En guise de conclusion, avant que nous allions visiter le musée In Flanders Fields, Dominiek Dendooven a raconté comment s'est déroulée la rédaction du cahier des charges ayant abouti à la nouvelle muséographie en 2011. Il y a ainsi quatre parcours qui s'entrecroisent, un chronologique, un thématique, un personnel, et un réflectif. L'article que nous avons écrit sur ce musée pourra vous en dire davantage. Il est intéressant de noter que le musée est considéré à Ypres comme un centre de ressources : au moins une fois par jour des personnes viennent demander des informations sur leur aïeul. La Grande Guerre de 14-18 semble ne pas avoir fini d’intéresser, et gageons que tous les projets dont nous avons entendu parler trouveront bien leurs publics.
L'Art de Muser

Les mains du musée
Dans nos expositions fourmillent des savoirs. Vous en trouvez en tous genres : l’étendue du territoire et du pouvoir de Napoléon, la génétique des lépidoptères, la révolution du Bauhaus, le mode de vie des peuples d’Egypte antique… Ces savoirs nous éclairent sur des sujets et des angles infinis. Ils nous éclairent si intensément, et sont si valorisés, que d’autres savoirs des expositions restent dans l’ombre, méconnus et invisibles aux visiteurs et pourtant si chers à la bonne réussite d’une exposition.
Pour mettre toute exposition en œuvre, celui·celle qui travaille de ses mains, spécialiste de son domaine, détient un savoir qu’iel maitrise. Iel a les clés, aime les transmettre ou parfois les sauvegarder précieusement. Elles sont ses secrets de fabrication, le résultat d’une bonne combinaison d’ingrédients pour réussir la recette. Maîtriser la connaissance pour la matérialiser, la transformer, nécessite un savoir bien particulier, celui du savoir-faire. Faire de la connaissance sienne pour construire, fabriquer, créer avec le geste juste.
Ses solutions lumineuses participent à la mise en forme de l’exposition. L’ensemble de ses expertises manuelles pourtant méconnues de tous, est essentiel à la bonne expérience du visiteur et à la magie de l’exposition. Iel pense puis concrétise ses idées dans le respect des œuvres, de la scénographie et du visiteur.
Parmi ces spécialistes, en voici quelques-un·e·s.
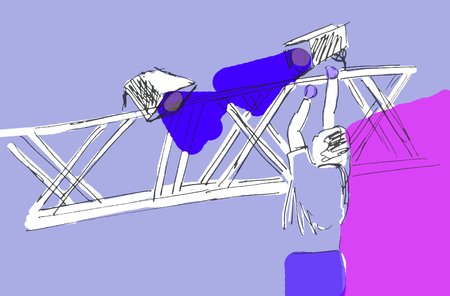
Eclairagiste © CD
Eclairagiste
Présent dès le début du montage d’exposition, iel installe les câbles et le matériel d’éclairage. Iel doit savoir anticiper les problèmes techniques et organiser son espace de travail car iel peut être amené à agir dans des temps très réduits avant l’ouverture de l’exposition au public.
C’est l’éclairagiste qui a le privilège de terminer l’exposition. Des compétences à la fois techniques et sensibles sont essentielles. Véritable matériau sensible, la lumière est la touche finale, elle fait vivre les œuvres et donne une toute autre dimension à l’espace de visite. Ce métier exige la prise en compte de nombreux paramètres. L’intensité lumineuse doit être adaptée à chaque objet et à ses critères de conservation, un certain esthétisme est aussi recherché entre les ombres, les contrastes et les reflets pour chaque pièce et l’ensemble de l’espace. Notamment, les installations ne doivent pas gêner ni éblouir le visiteur dans la bonne appréciation des expôts.

Menuisier·e © CD
Menuisier·e
Le·la menuisier·e fabrique, découpe, répare, adapte, agence et assemble le bois, parfois le peint pour donner forme à du mobilier ou tout autre élément matériel utile à l’exposition. Iel maitrise le matériau à la perfection, connait les charges et les contraintes qu’il peut supporter, et sait l’utiliser justement en fonction de la demande. Le bois, matériau tendre, répond par le biais d’outils à l’intention du·de la menuisier·e qui suit de près les plans du scénographe.

Socleur·se © CD
Socleur·se
Véritable analyste de l’objet à exposer, iel apprend à bien le connaitre dans ses forces et fragilités. Dans le respect de la pièce concernée, iel crée un juste équilibre entre protection et valorisation. Iel assure un support assez solide et sécurisé. Le socle est le plus discret possible, tout l’enjeu est qu’il soit invisible à l’œil du visiteur pour que l’objet vive dans sa vitrine. Il est valorisé sous son meilleur angle pour faciliter sa lecture, sa compréhension et son esthétisme. Pour chacune des œuvres, un socle sur mesure ! Parfois, d’autres contraintes sont prises en compte, comme l’intégration d’éclairage ou de son. Ce travail demande patiente, minutie, organisation, persévérance, capacité à trouver rapidement des solutions.
C’est le plaisir de la création, l’amour des objets et de la matière.
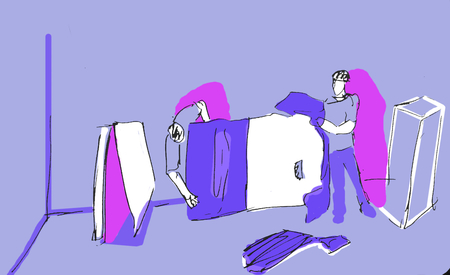
Monteur·se © CD
Monteur·se
Le·la monteur·se assemble et installe les éléments d’expositions : mise en place de vitrines et de mobilier, montage des cimaises… Iel répond au cahier des charges du scénographe et déchiffre parfaitement son plan technique. Marquage au sol, prise en compte des mesures : Le·la monteur·se fait usage de précision, de concentration et de rigueur, il doit être au plus près de l’intention du·de la scénographe.
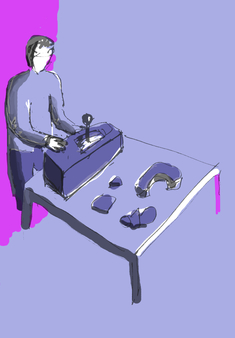
Manipeur·se © CD
Manipeur·se
En réalisant de nombreux prototypes en amont, iel doit user d’ingéniosité pour réaliser des manipes et des jeux à finalité pédagogique. Iel prend en compte l’ergonomie et l’esthétique du dispositif pour faciliter l’interaction avec le visiteur. Les matériaux et la technologie sont choisis en fonction du message à transmettre et des contraintes telles que la durée de l’exposition et sa possible itinérance.
Ces spécialistes ne représentent pas l’ensemble des professionnels du musée qui travaillent de leurs mains, et dépendent de la taille et des besoins de chaque structure. Parmi eux, les restaurateurs·trices et les régisseurs·e·s.
Pour en savoir plus sur la régie, c’est par ici (Le démontage d'exposition), ou bien ici (Workshop régie) !
Coline Declercq

Les métiers de l'exposition, une diversité passionnante
Le directeur, la directrice, vecteur de liens

© Anaïse Lafontaine
Le conservateur / la conservatrice, l'érudit passionné

© Anaïse Lafontaine
Le / la commissaire, le carnet d'adresses

© Anaïse Lafontaine
Le muséographe, le chef d'orchestre

© Anaïse Lafontaine
Le / la scénographe, le créateur 3D

© Anaïse Lafontaine
Le / la graphiste d'exposition, le créateur 2D

© Anaïse Lafontaine
Le médiateur, le curieux sociable

© Anaïse Lafontaine
Le régisseur d'oeuvres, le petit rat des réserves

© Anaïse Lafontaine
Le régisseur technique/le technicien/le préparateur, le bricoleur
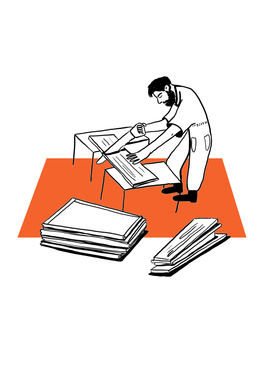
© Anaïse Lafontaine
Le restaurateur, le minutieux

© Anaïse Lafontaine
Laurence Louis
#Métiers
#Exposition
#OrientationProfessionnelle
Illustrations : Anaïse Lafontaine, illustratrice. Instragram : anaiise_lafontaine
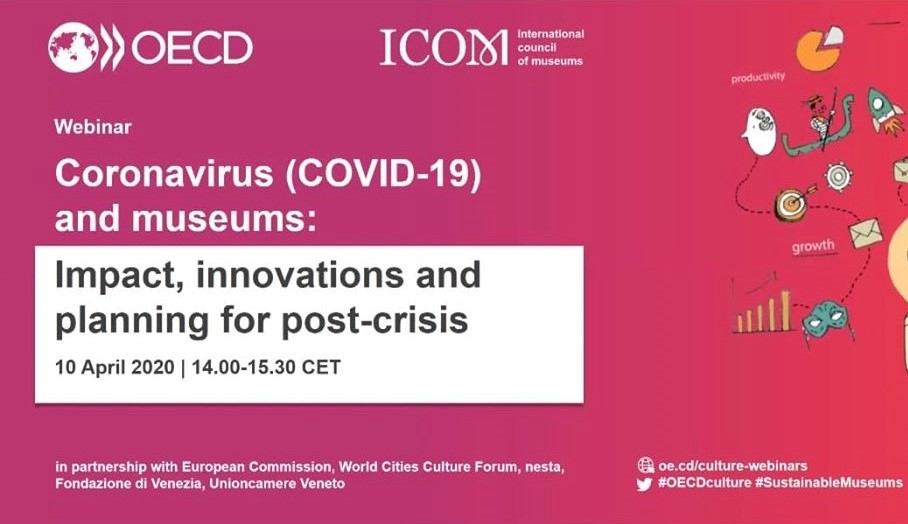
Les musées de demain – Webinaire ICOM et OCDE « Coronavirus and museums : impact, innovations and planning for post-crisis »
Avril 2020, en confinement, je me laisse emporter aux quatre coins du monde. Derrière mon écran, défilent des professionnels de la culture et des musées. L’anglais prend mille et unes couleurs du Canada à la République de Corée en passant par l’Italie. J’assiste en direct au Webinaire (j’ai découvert le sourire aux lèvres ce mot qui signifie séminaire en ligne) organisé par l’ICOM (Conseil International des Musées) et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Les professionnels se penchent sur l’après crise sanitaire pour les institutions muséales, le webinaire est intitulé : « Coronavirus and museums : impact, innovations and planning for post-crisis » (en partenariat avec la Commission Européenne, World Cities Culture Forum, nesta, Fondazione di Venezia et Unioncamere Veneto). 1400 participants se joignent à moi dont environ 700 européens.
Ekaterina Travkina, membre de l’OCDE, modère le webinaire qui accueille huit participants. Elle donne le rythme, la séance est organisée en trois parties. D’abord, les impacts à court et long termes de la fermeture des musées ; ensuite, l’émergence d’innovations et d’opportunités pour le futur ; enfin, les politiques de soutien au secteur muséal.
Impacts à court et long termes de la fermeture des musées
La première intervenante Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) au Canada, rappelle que les musées publics ne subissent pas les mêmes sorts que les musées privés. Le MBAM est un musée privé qui bénéficie de subventions de la part de la province montréalaise. Comme une entreprise, il fait face à un défi financier. Concernant son personnel, le MBAM est en grande réflexion, certains membres du bureau refusent de garder des personnes qui ne peuvent pas travailler à 100%. Quant à Nathalie Bondil, pour éviter le pire, elle invite à la créativité. La directrice insiste également sur le fait que les musées ne sont pas les seuls à pâtir de la crise sanitaire, ils font partie d’un écosystème. Un propos qu’appuiera, Joan Roca, le directeur du musée d’histoire de Barcelone (MUHBA) en Espagne, pour qui les musées ne sont que le sommet de l’iceberg du secteur culturel ; il faut soutenir l’entièreté de l’écosystème culturel menacé.
Depuis l’Italie, Mattia Agnetti, secrétaire exécutif de la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), parle d’un impact d’une durée de 10 à 12 mois pour les musées. Pour le moment, le numérique s’affirme comme la seule offre que les musées peuvent donner. Lorsque les institutions culturelles vont rouvrir, face au manque de ressources, elles devront piocher dans leurs ressources propres. C’est pourquoi Mattia Agnetti appelle les musées à coopérer à l’échelle internationale.
A la tête du Musée du fer en République de Corée, Inkyung Chang donne les résultats d’une enquête menée par la Korean Museum Association qui traite les conséquences de la crise sanitaire sur les musées fermés depuis le 25 février 2020. Pour le mois de février dans 122 musées privés, l’enquête chiffre à 1 million de dollars américains la perte de bénéfices mensuels. Elle note qu’au moment de l’enquête 40% des musées étaient encore ouverts. Si les grands musées perpétuent le lien avec le public grâce au développement de programmes numériques, ces dispositifs restent hors d’atteinte pour les musées à petits budgets. Pour elle, l’expérience muséale numérique est un nouveau paradigme. Il faut s’approprier les outils technologiques pour éduquer à la culture et échanger avec le visiteur. Les métiers muséaux vont changer en ce sens.
Emergence d’innovations et d’opportunités pour le futur
Selon Joan Roca (MUHBA), les musées changent constamment, cette crise est une opportunité pour innover. Dans les interventions, à plusieurs reprises, la nouvelle définition des musées proposées par l’ICOM à Kyoto est évoquée. Pour Joan Roca, « nous avons besoin d’une nouvelle génération de musées qui combine les innovations culturelles et les mesures sociales d’une part ; avec un développement de l’économie locale d’autre part ». Selon lui, si la révolution est purement technologique, elle sera morte. Joan Roca évoque alors cinq idées pour l’enrichir, cinq révolutions : narrative (créer du discours pour les collections, les musées doivent être des lieux de recherches…), patrimoniale (idée que le musée n’est rien sans ses collections, elles constituent un moyen privilégié pour créer du lien avec le public), de l’organisation (flexibilité du lien avec les autres institutions), des citoyens (les musées sont cruciaux dans les démocraties culturelles ; lier la culture et l’éducation sont la clé pour faire venir les jeunes et le public éloigné de la culture aux musées) et du tourisme (les musées doivent diversifier leurs objectifs, offrir diverses expériences de visite). En effet, de nouvelles valeurs émergent dans le secteur culturel affirme Nathalie Bondil (MBAM). C’est pourquoi, elle souhaiterait voir apparaître deux termes dans la définition des musées de l’ICOM : « inclusion » et « bien-être ». Pour elle, la technologie n’est pas uniquement un moyen promotionnel, elle constitue également de riches archives et documente cette crise : des artistes et professionnels du secteur culturel parlent de leur travail notamment. Le site du ministère de l’éducation canadien a mis en ligne un outil précieux à destination des parents qui font l’école à la maison : un lien vers la plateforme EducArt mise en place par le MBAM, une preuve que l’éducation se fait en osmose avec les musées. Si Inkyung Chang (Musée du fer) précise que le comportement des visiteurs avait changé, Nathalie Bondil ajoute que si les musées doivent s’adapter à de nouvelles mesures sanitaires, la qualité primera désormais sur la quantité. La modératrice Ekaterina Travkina laisse alors planer une question : Est-ce la fin des expositions blockbuster ?
Capture d’écran prise durant la conférence © EB
Le directeur général des musées au ministère italien du patrimoine culturel et du tourisme (MIBACT), Antonio Lampis croit fermement que c’est le temps des alliances. Ces dernières doivent se faire avec la télévision, avec de nouveaux systèmes de paiement (dont le paiement sans contact), des systèmes de contrôles d’entrée aux musées, théâtres, espaces d’écriture… pour créer de nouvelles histoires. Le musée doit être plus durable, être une sorte de Netflix dans lequel le visiteur pourrait voir et écouter une multitude de récits. En Italie, chaque université adopte un musée. Joan Roca intervient, inversement, les musées doivent adopter des universités aussi !
Les politiques de soutien au secteur muséal
Dans l’Union Européenne, la culture est une compétence locale et nationale, l’UE ne peut rien imposer mais elle peut aider. NEMO, le réseau européen des musées a entamé une enquête auprès de 600 musées dans 41 pays de l’UE. Maciej Hofman est directeur général pour l’éducation et la culture à la Commission Européenne, il fait un état des lieux de la situation actuelle. L’UE se veut plus flexible dans ses règles, elle va étirer les délais pour les appels d’offre et, les demandes de budget émises par les institutions vont être évaluées au plus vite afin qu’elles puissent préparer l’avenir au mieux. Actuellement, au sein de l’Union Européenne, les budgets pour une période de sept ans (2021-2027) sont évalués. Pour Hofman, il est important de s’assurer que le budget pour le secteur culturel sera conséquent, un « budget ambitieux » sera défendu. Aussi, il fait mention d’un outil important appelé « Mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création », dans le cadre du programme « Europe créative ». 121 millions d’euros sont mobilisés pour la période 2014-2020. Cet instrument à destination des intermédiaires financiers (banques par exemple) propose des financements pour les initiatives des PME du secteur culturel et de la création. Les intermédiaires financiers peuvent choisir où va leur prêt, ils peuvent bénéficier de formations pour mieux comprendre ces secteurs (plus d’informations ici).
Hofman précise que les politiques de collaborations entre les états membres de l’UE et l’UE vont mettre l’accent sur des problématiques abordées au cours du webinaire : la culture et le bien-être, les nouvelles technologies pour les musées, connaître le public numérique, les moyens de lier culture et éducation, la condition des artistes ou encore la culture. Avec l’OCDE, l’UE souhaite maximiser l’impact culturel à l’échelle locale pour le développement.
D’intervenants en intervenants, je perçois la solidarité qui se crée entre les institutions culturelles, elles se rassurent et ensemble, dessinent le futur. Les acteurs culturels, soudés plus que jamais, sont prêts à coopérer pour concevoir des musées plus sociaux et ancrés dans leurs territoires. Avec ce webinaire, les professionnels du secteur muséal ont fait entendre leur voix auprès des organismes qui les soutiennent. Nathalie Bondil (MBAM) conclut la session en évoquant cette citation d’Ernesto Ottone R., assistant du directeur général de la culture à l’UNESCO : « Now, more than ever, people need culture […] Culture makes us resilient. It gives us hope. It reminds us that we are not alone. » Le 22 avril 2020, l’UNESCO fera une réunion en ligne avec les ministères de la culture du monde entier. Pour ce qui est de ce webinaire, il a été enregistré et sera accessible en ligne. D’autres séances ont lieu au mois d’avril 2020 et abordent le secteur culturel au-delà des musées.
Estelle Brousse
#futur
#crise
#coronavirus
Pour aller plus loin :
Guide de l’ICOM et de l’OCDE pour les gouvernements locaux, des communautés et des musées : https://icom.museum/fr/news/developpement-durable-licom-sassocie-a-locde-pour-elaborer-un-guide-a-lintention-des-gouvernements-locaux-des-communautes-et-des-musees/
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202004/10/01-5268872-les-musees-du-monde-planifient-lapres-covid-19.php
Les intervenants :
- Ekaterina Travkina, coordinatrice – culture, industries créatives et développement local, OCDE
- Peter Keller, membre de l’ICOM
- Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Canada
- Inkyung Chang, directrice du Musée du fer, République de Corée
- Antonio Lampis, directeur général des musées, ministère italien du patrimoine culturel et du tourisme (MIBACT), Italie
- Maciej Hofman, directeur général pour l’éducation et la culture à la Commission Européenne
- Joan Roca, directeur du Musée d’histoire de Barcelone (MUHBA), Espagne
- John Davies, chercheur économique, économie créative et analyse des données, Nesta/PEC
- Mattia Agnetti, secrétaire exécutif, Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), Italie

Osez, osez, Evelyne !
La Zouzeau Next festival : embarquez à bord du Galaxia, une expérience unique
Article à plusieurs mains
La Zouze est une compagnie de danse, notamment conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, basée à Marseille et dirigée par Christophe Haleb, tour à tour chorégraphe, directeur artistique, danseur et pédagogue. Née il y a 20 ans, cette compagnie a la particularité d’investir sans cesse de nouveaux lieux et de construire des créations de manière collective, y faisant intervenir le réseau culturel local. L’expression « laboratoire participatif public » la définit parfaitement. Espace, corps et interdisciplinarité en sont des maîtres mots. Depuis ses débuts au Théâtre Contemporain de la Danse à Paris, puis sa participation au festival d’Avignon, au Théâtre National de Chaillot, à la Townhouse Gallery au Caire ou encore lors de l’inauguration du MUCEM, La Zouze cherche toujours à s’ouvrir à de nouveaux spectateurs et à multiplier les regards. Sa participation à la soirée de clôture « See You NEXT Time » du Next festival, qui s’est déroulé du 15 au 30 novembre 2013, fut une nouvelle occasion de choix pour proposer son univers à un public habitué aux créations contemporaines novatrices et engagées. Elle proposait son spectacle Evelyne House Of Shamedécliné pour l'occasion en Galaxia. C'est de cet événement dont nous allons développer le déroulement.
Evelyne House Of Shame
Ce festival international et transfrontalier vise à soutenir, produire et diffuser la création et les nouvelles formes artistiques dans le domaine des arts vivants au sein de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai et Valenciennes. En collaborant ensemble, ce sont cinq structures culturelles qui s’unissent pour dynamiser cette région : la Maison de la Culture de Tournai, le Cultuurcentrum de Kortrijk, le centre d'arts de BUDA de Courtrai, La Rose des Vents à Villeneuve d'Ascq et l'Espace Pasolini, théâtre international de Valenciennes.
Crédits : Lucie Vallade
Le Master MEM impliqué dans le spectacle vivant ?
En ce qui concerne notre stricte participation en amont, rappelons tout d’abord que d’autres étudiants préparaient également cette soirée avec nous, « muséophiles ». Trois étudiants en Arts du spectacle de l’Université d’Artois répétaient au sein de l’atelier chorégraphique et des étudiants des Beaux-Arts de Tournai s’occupaient des projections vidéos et autres technologies iconographiques et ont, comme nous, collaboré à la mise en place d’éléments plastiques et scénographiques. Pendant ce temps, nous nous sommes astreintes, ainsi que Aurélien, étudiant en Master 2 Arts du spectacle à l’Université d’Artois, à des tâches manuelles et artistiques : peinture de socles/estrades et atelier graphique.
Crédits : Lucie Vallade
Eh bien oui, ces cubes blancs que vous voyez dans cette photo à droite, ce sont nos petites mimines qui les ont peints, et en rythme, pendant les répétitions chorégraphiques ! Sous-couche, couche et retouches, nous sommes prêtes pour nos montages d’expo !
En ce qui concerne l’atelier graphique, nous mettions à contribution nos imaginaires et nos références en tous genres. Notre objectif ? Concevoir et dessiner des typographies, les attribuer à des phrases puis les apposer sur des plaques en polystyrène. Dans quel but ? Comme à l’arrivée en gare ou à l’aéroport, que chaque danseur tienne une plaque afin d’accueillir le public. Nous y avons mis soin et rigueur, mais nous ignorions alors le destin des dites plaques… être détruites : l’art de l’éphémère. Ce que nous retiendrons ? L’esprit d’équipe et d’initiative, de la bonne humeur sous des ambiances festives avec un accueil chaleureux de la part de la compagnie : un régal ! Enfin, n’oublions pas l’essentiel, participer à cet évènement aura nourri et stimulé notre regard sur la place des arts du spectacle au sein des musées et des espaces d’exposition.
Entre les guides et la piste de danse : entre organisateurs et spectateurs
Samedi soir, 23:00, le moment est venu pour nous d'accomplir la modeste – mais ô combien importante – tâche qui nous a été confiée : actionner les guindes de la structure qui constitue la pièce maîtresse de la soirée. C'est notamment autour de cette impressionnante méduse de papier que la fête s'articule. Imposante et informe, ajourée à la manière d'une délicate dentelle, elle devient un support à des projections lumineuses faisant varier l'atmosphère.
Crédits : Marine
 Sa robe, tantôt mauve ou bleutée, accompagne une musique parfois enjouée puis inquiétante. Le temps d'une soirée, nous devenons marionnettistes et jouons avec les ficelles de ce décor qui respire au rythme de la fête. Attentifs, nous travaillons en symbiose avec les collègues situés de part et d'autres de la salle afin de chorégraphier les mouvements de l'élégant OVNI. L'interaction entre également en jeu avec la musique, les danseurs, les chanteurs et les participants qui se retrouvent parfois enfermés dans le ventre de la bête qui finira en miettes. En effet, à mesure que les passagers du vaisseau imaginaire GALAXIA s'approprient les lieux, ils commencent à jouer avec la structure en allant jusqu'à la déchiqueter pour en faire des confettis ou un habit de fortune. La force de ce décor éphémère réside dans l'esthétique de la destruction. Qu'il s'agisse des pancartes que nous avions confectionnées, du décor tout entier ou des costumes des danseurs, tout finit par être dissolu dans l'atmosphère festive. A l'image de l'ambiance, le décor évolue jusqu'à laisser place à un nostalgique capharnaüm, comme dans toute fête réussie...
Sa robe, tantôt mauve ou bleutée, accompagne une musique parfois enjouée puis inquiétante. Le temps d'une soirée, nous devenons marionnettistes et jouons avec les ficelles de ce décor qui respire au rythme de la fête. Attentifs, nous travaillons en symbiose avec les collègues situés de part et d'autres de la salle afin de chorégraphier les mouvements de l'élégant OVNI. L'interaction entre également en jeu avec la musique, les danseurs, les chanteurs et les participants qui se retrouvent parfois enfermés dans le ventre de la bête qui finira en miettes. En effet, à mesure que les passagers du vaisseau imaginaire GALAXIA s'approprient les lieux, ils commencent à jouer avec la structure en allant jusqu'à la déchiqueter pour en faire des confettis ou un habit de fortune. La force de ce décor éphémère réside dans l'esthétique de la destruction. Qu'il s'agisse des pancartes que nous avions confectionnées, du décor tout entier ou des costumes des danseurs, tout finit par être dissolu dans l'atmosphère festive. A l'image de l'ambiance, le décor évolue jusqu'à laisser place à un nostalgique capharnaüm, comme dans toute fête réussie...
Grâce à ce rôle « d'actionneurs de guindes » synchronisés, nous faisons désormais partie intégrante de la troupe. Une intégration qui s'est difficilement mise en place pendant la phase de préparation. Côtoyer des danseurs dont le rapport au corps est tout à fait différent du nôtre nous a renvoyées à notre propre relation au corps. Leur « décomplexion » suscite l'admiration autant qu'elle nous confronte crûment à notre pudeur « intériorisante ». Lorsque notre mission est achevée, nous pouvons désormais nous mêler à la foule, portées par la joie d'avoir participé à la mise en place des festivités. Nous pouvons alors laisser s'exprimer nos corps dans la folie galaxienne. Situés entre membres actifs de la troupe et simples spectateurs, notre statut particulier nous a permis de nous investir dans un rôle de relais avec le public en lui montrant la marche à suivre pour le quadrille ou le jeu du Kissing-Game.
Concentrées puis décontractées, nous avons pu expérimenter la soirée selon différents points de vue ce qui l'a rendue d'autant plus agréable à vivre. Une expérience iconoclaste qui fait du bien et que nous avons hâte de renouveler uniquement du côté du spectateur ! Notre perception en sera-t-elle changée ?
Evelyne, je t'aime... moi non plus...
Chez Evelyne, le public catapulté spect’acteur se trouve sur le plateau, ou plus exactement l’espace du spectateur et l’espace du performeur, traditionnellement distincts, forment un éden unique à vivre ensemble. Si une partie du public (averti de l’originalitéde l’œuvre dans laquelle il a choisi d’entrer) joue le jeu et profite pleinement de ce moment hors du temps pour s’exprimer et éprouver sans taboucette contrée de liberté, cette aire partagée demeure pour beaucoup difficile à investir et apprivoiser.
 Sous-estimer le cadre et le rôle habituellement dévolu au spectateur et la proposition de s’en écarter constitue, dans le meilleur des cas, une maladresse. Troquer les limites rassurantes de son fauteuil contre l’inconnu in situ demande parfois efforts et encouragements.
Sous-estimer le cadre et le rôle habituellement dévolu au spectateur et la proposition de s’en écarter constitue, dans le meilleur des cas, une maladresse. Troquer les limites rassurantes de son fauteuil contre l’inconnu in situ demande parfois efforts et encouragements.
Crédits : Marine
Au cours du spectacle, le public est notamment sollicité afin de former différents groupes en fonction de caractéristiques capillaires. Une jeune femme blonde paraît désorientée. Elle hésite à rejoindre le groupe en train de se constituer, à la périphérie de la salle, autour d’un danseur chef de file des créatures à la chevelure couleur des blés.
Quels risques prend-elle ? Quelles peuvent être les raisons de ses tergiversations ?
Quitter temporairement son groupe d’amis et être confrontée directement à des inconnus.Être exposée au regard de l’assemblée le temps de l’exposition de ce petit groupe sous les feux des projecteurs. Participer et être éventuellement entraînée, ensuite, dans les circonvolutions du spectacle qu’elle ne maîtrise pas.Cette jeune femme, rassurée sur la suite des événements, rejoint finalement quelques courageux intrépides et s’installe au pied du podium où trône la reine des êtres de son espèce. Elle contribue ainsi à la création d’un des nombreux tableaux de la pièce… Elle n’a cependant pas connu le souffle rafraîchissant du lâcher prise.
Le spectacle suit son cours, avec ou sans elle, mais le principe est la participation du public. Il s’enrichit de celle-ci et s’épanouit à cette condition.Dans cette optique les professionnels et amateurs bénévoles référents au cœur de la structure protéiforme d’Evelyne ont tout à gagner à prendre quelques instants supplémentaires pour guider en douceur les participants. Mieux accompagnés, ces derniers bénéficieront de la dynamique d’enrichissement par l’expérience initiée par la Diva.
Deux spect'actrices livrent sans détour leurs impressions :
Pauline, intéressée par « le concept de spectacle interactif », regrette qu'il ne soit pas « complètement exploité par la troupe qui propose surtout une déconstruction de l'organisation spatiale de la pièce de théâtre. Une grande partie de la soirée se passe à observer les différentes performances. Le public reste dans le flou quant au rôle et aux initiatives qui lui sont laissés. Le point culminant de la soirée reste le quadrille, qui rassemble le public. Mais la participation[de celui-ci], trop irrégulière par rapport aux nombreux moments de flottement, ne m'a pas permis de me prendre au jeu ». Cyrielle est arrivée à la Maison de la Culture « pleine de curiosité et d'attentes » se demandant d'emblée « comment la troupe [animera] cette soirée présentée comme totalement folle ? ». Lors du concert d'ouverture, elle est « surprise par l'immobilité du public ». « La troupe nous emmène ensuite dans les différents espaces où se déroulent des performances auxquelles le public est parfois invité à participer. Ces moments participatifs sont très amusants mais on peut regretter que les performances non participatives soient parfois trop longues et trop à distance du public qui, n'étant pas dans le même monde que la troupe, a parfois du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui. La troupe a voulu déstructurer les codes de la fête et elle y est arrivée mais peut-être un peu trop, car le fêtard devient souvent plus spectateur qu'acteur de la fête, d'autant que les temps morts entre deux performances sont souvent longs. »
Toutes deux auraient souhaité des moments consacrés à la danse plus développés aucours de la soirée ainsi qu'une plus forte présence de la musique, mais concluent respectivement ainsi : « certains moments étaient vraiment bien, mais trop rares pour exploiter le concept jusqu'au bout »,« j'ai passé une très bonne soirée, inhabituelle, déjantée, à l'image de La Zouze."
Le public d'Evelyne, tout comme elle, est exigeant et cela ne peut qu'être source d'émulation pour de futures expériences plus riches et appréciées.
Evelyne propose, en plus de cette invitation à faire « spectacle » ensemble, son corps augmenté, détourné, paré, nu. Ce corps n’est pas à bonne distance, sur le plateau, mais effleure, entoure le spect’acteur. Le regard et l’attitude, mis en question, se travaillent.
Certains considèrent Evelyne comme une provocation, d’autres comme une créature séduisante qu’il faut suivre sans crainte, d’autres encore comme un cadre privilégié où expérimenter prudemment ses différentes limites.
Evelyne peut être tout cela et plus encore, c’est à vous de la sculpter, de la vivre, de la partager.
Osons entrer dans la danse, apprenties muséographes !
Quel intérêt des étudiantes en muséographie peuvent-elles bien trouver à participer à l'élaboration de la soirée de clôture du festival Next ? A priori cela n'a rien d'évident, et pourtant, le travail fourni par la compagnie La Zouze n'est pas si éloigné du travail du muséographe. Le muséographe conçoit les contenus d'une exposition. Il construit un discours dont le déroulement se traduit sous la forme d'un parcours rythmé. La compagnie travaille à la construction d'un scénario dont la pertinence tient aux rythmes, à l'interaction publics-troupe et à une mise à distance avec les codes de la fête. Notre participation à l'élaboration d'un spectacle vivant intégrant diverses disciplines telles que la danse, le théâtre, les arts plastiques et la musique nous a permis d'entrer, pendant quelques jours, dans un milieu culturel que nous avons peu l'occasion de côtoyer de l'intérieur. Ce temps nous a permis d'appréhender les parallèles et les différences entre la construction et la mise en scène d'un spectacle vivant et d'une exposition. La place du corps, centrale chez les danseurs, nous a forcées à interroger nos propres rapports, plus abstraits, plus distanciés. Ces moments vécus sont nécessaires à la réaffirmation de la place éminente que doit faire le muséographe au corps du visiteur, de parler autant à ses sens qu'à son intellect pour produire un parcours d'exposition sensé. Une exposition efficace travaille donc le corps du visiteur pour lui faire prendre conscience de lui-même par rapport à un espace donné. Les dispositifs de médiation étant à la fois outils et conditions de ce rapport singulier du corps à un espace.
Lucie Vallade, Anne Hauguel, Marine, Ophélie Laloy
étudiantes en Master Expo-Muséographie à l'Université d'Artois
La forme participative de cet article traduit l’ambiance de la soirée et le travail de la Compagnie La Zouze. C’est en unissant nos expériences, nos idées et nos savoir-faire qu’il a pu voir le jour !
Nous remercions la Compagnie La Zouze de nous avoir accueillies et tout particulièrement Christophe Haleb et Laurent Le Bourhis ; Amièle Viaud de La Rose des Vents ; la Maison de la Culture de Tournai ; nos collègues d'Arts du Spectacle ;notre responsable de formation Serge Chaumier et tuteur de projet Isabelle Roussel-Gillet.
Légende des photos :
Photo 1. J-1, répétition sur ces socles.
Photo 2.J-1, (avec Laurent) le moment où il faut penser et réaliser les panneaux qui accueillent les spectateurs comme les voyageurs dans les aéroports.
Photo 3 . Jour J, la structure de papier respire doucement, nous tirons les ficelles.
Photo 4. Jour J, le moment où il faut rejoindre le groupe auquel on appartient, la reine des créatures blondes sur son piédestal.
Liens des reportages vidéo de Notélé :
Si on sortait… avec la compagnie de laZouze - 29/11/13
See you next Time - Spectacle declôture du festival Next à Tournai - 06/12/13
# La Zouze
#Evelyne HouseOf Shame
#Galaxia
#Next Festival
#participatif-interdisciplinarité
[1] Lesvendredi 17 & samedi 18 janvier à 20h30 : EVELYNE HOUSE OF SHAME aux Halles de Schaerbeek à BRUXELLES. Du08 au 16 janvier : résidence in situ, ateliers chorégraphiques etplastiques.

Petit Vade-mecum de la Conservation préventive
Conservation entropique pour œuvre périssable ?
La conservation préventive vise à anticiper et ralentir la dégradation des biens culturels. Des méthodes et des protocoles visant à réduire les effets (climat, lumière, agents biologiques, polluants) permettent de garantir les modalités de stockage et de conditionnement des artefacts. Les pratiques de la conservation préventive couvrent aussi des recommandations de stockage, d’accrochage, d’emballage et de téléchargement. Mais également l’archivage et la documentation en cas de perte ou de vol grâce à des Thésaurus tel que la base TREIMA II et l’Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels (OCBC), le groupe OVNAAB (pour objets volés de nature artistique d’antiquité et de brocante) ainsi que la base JUDEX. Il existe aussi un système d’alerte
Nous proposons ici de questionner ces pratiques dans les champs de l’art contemporain, afin de mieux cibler au plus tôt les modes de conservations préventives les plus adaptées selon leur contexte et médium. Quelles stratégies adopter selon les œuvres ?
LA CONSERVATION PRÉVENTIVE DANS L’ART “ULTRA”- CONTEMPORAIN EN POINTS CLEFS
Contre le vieillissement, mais pour le vivant ! ou L’art contemporain une histoire (hyper) matérielle à usage de nos crises actuelles
Certaines œuvres d’art contemporaines, par leurs matérialités - des organismes vivants qui se transforment posent question : comment accepter de conserver le périssable ? Le restaurateur est celui qui redonne vit, mais ne doit se poser en traître. Il sauve l’éphémère, mais ne peut rien faire sans les secrets de fabrication. Quand l'artiste est vivant, il rêve qu’il lui transmette son mode d’emploi.
Les nouveaux laboratoires sont constitués d’équipes tout terrains comprenant des : électriciens, taxidermistes, ébénistes, jardiniers, projectionnistes… pour pouvoir tout sauver.
À l’heure où le requin dans le formol de Damien Hirst a déjà été remplacé à l’identique, la question des vernis, des pigments est dépassée par l’accumulation de savoir. L’armada de spécialistes se pose des questions, en pose aux artistes qui n’ont pas toujours des réponses. Les œuvres d’art contemporaines nécessitent un entretien continu et pour ce faire un restaurateur à demeure existe depuis un moment dans des structures aux USA, au Royaume-Unis et en Hollande. En France, si la cathédrale de Strasbourg possède sa maison de chantier à son chevet depuis le commencement de son chantier, les musées ont recours au coup par coup à des spécialistes extérieurs. Ainsi, des œuvres se dégradent dans les réserves et les musées, à défaut de conservation préventive, doivent avoir recours à de lourdes opérations de restauration.
Comment gérer les œuvres d’art contemporaines ? Faut-il repenser le rapport au temps ? Une œuvre d’art se résume-t-elle à son support, aux matériaux employés ? Ou bien à son médium, aux concepts qui la constituent ? En changeant de statut les œuvres ont-elles modifié le rôle des musées ?
Volontés d’artistes - volontés du vivant
Dans les musées, il est très important d’être au contact des artistes vivants. Ce qui constitue un des avantages de l’art contemporain. On peut faire appel à eux. Il s’agit d’une gestion en direct avec les techniciens spécialisés. Pour Catherine Grenier (conservatrice en chef du Patrimoine et historienne de l'art), cela nécessite une réflexion en continu, au moment où l’on achète l’œuvre, au moment où on la présente et au-delà. Quelles seront les meilleures conditions d’expositions? Selon les volontés de l’artiste, elles peuvent être évolutives ou fixes. Il y a aujourd’hui autant de conceptions du devenir de l'œuvre que d’artistes, à l’image des pratiques. Les problèmes d’usures, peuvent par exemple lors de nouvelles expositions de l’œuvre générer de nouvelles contraintes ? Les prises en charge par les mécénats sont cruciales dans ses opérations.

Bianca Bondi, Ectoplasm (son), 2019 dans l’exposition Le Vaisseau d'Or Une proposition de Gaël Charbau à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois 36 rue de Seine, 75006 Paris ©Aurélien Mole
Entre réparation mimétique et acception mécanique
Une des premières pièces de Jean Tinguely des collections historiques du centre Pompidou, la méta-mécanique automobile se composait de petits fils de fer rouillé et cassé. Et le centre Pompidou avait demandé à l’artiste s’il pouvait faire quelque chose. Il était alors arrivé avec des morceaux de fer neuf, brillant. Mais ça ne l'intéressait pas de re-faire de la fausse rouille. Il avait alors montré comment il fallait tordre, préparer ses tiges et puis se débrouiller en suivant sa technique après démontage de sa réparation trop brillante. Mais le mécanisme pour remonter la machine était cassé, il n’a pas été remplacé et cette œuvre finalement ne bougera pas, avec l’accord de l’artiste.
Documenter les œuvres dès leur genèse et ou première acquisition
La différence entre la restauration des œuvres de la collection dite historique et la collection contemporaine, est une question de démarche, de réflexion. Comment sont faites les œuvres ? Le comité d’acquisition joue un rôle très important dans cette étape. Il travaille avec les assistantes de conservation, étudie les œuvres en détail. Au moment où l’œuvre rentre dans la collection, elle doit être complètement documentée. Comment l’œuvre a été faite ? Comment l’artiste a trouvé les matériaux ?
Ceci constitue des démarches obligatoires des nouveaux musées d’art contemporain.
Une proposition de réponse à ces problèmes est d’adresser un questionnaire spécifique aux artistes contemporains afin qu’ils livrent le mode d’emploi de leurs œuvres. Afin de combler le manque d’informations par secteurs (art graphique, photographique … ), le questionnaire reste ouvert pour être complété lors de la venue des artistes sur place. L’artiste n’est pas obligé de répondre. Il ne sait pas forcément quantifier les matières qu’il a utilisées lors de la création ou bien ne souhaite pas en faire part.
Les œuvres peuvent être faites de matériaux qui se dégradent extrêmement rapidement et avec des matériaux étrangers aux connaissances des restaurateurs qui travaillent sur des matériaux et œuvres beaucoup plus classiques en adéquation avec la formation qu’ils ont reçue. Faut-il faire évoluer la formation des restaurateurs qui aujourd’hui est divisé par secteurs et techniques ? Ce qui compte c’est l’expérience, c’est souvent du bricolage, comme un antiquaire qui sent le matériau, l’objet afin de le remettre en circulation.
Réseau documentaire
L’œuvre atypique de Daniel Dezeuze de l’époque support-surface témoigne dans son caractère sériel d’évolutions spécifiques aussi nombreuses que le nombre de musées qui la conserve. Il s’agit d’assemblages en réseaux en bandes de placage qui forment des sortes d’échelles. Chaque musée est confronté à des problèmes de vieillissement mécanique : de lacération des bandes de placage, de déformation, d’accrochage, de suspension, de stockage. On a ainsi eu au départ des œuvres à peu près identiques, et maintenant nous avons de nombreuses dérives par rapport au modèle initial, et sont par conséquent de moins en moins homogènes dans leur ensemble.
Aujourd’hui il est important de créer des réseaux où les spécialistes puissent s’informer, afin de ne pas avoir à chaque fois devoir réinventer des solutions, si ces dernières ont été traitées sur des problèmes identiques par d’autres musées. Cela pose la question de la fédération d’un réseau documentaire.
En découle une autre question celle de l’unique et du multiple. Jusqu’à la photographie, une œuvre était en principe unique et autographe. La question du multiple n’est pas la vraie question puisqu'elle est bien antérieure à la photographie si l’on pense aux images imprimées, à la gravure. Mais c’est celle plutôt de l’obsolescence et des œuvres médiatiques. Les matrices sont copiées, mais selon des formats et des standards différents, les soucis de transferts et de téléchargements apparaissent.
Geste artistique et conformité ou divergence du modèle d’origine
Buddha’s Catacomb de Nam June Paik, au musée des sables d’Olonne, acquise en 1996, créé en 1984 avec moniteur bulle des années 1960 tombait en panne. La solution, en accord avec l’artiste, a été de présenter l’œuvre sur un moniteur contemporain de la panne, présentant une image couleur au lieu du noir et blanc. Puis le moniteur JVC a été réparé pour une nouvelle exposition. Puis, le moniteur a été dérobé. La dernière solution de l’artiste fut finalement de refondre une coque selon le modèle d’origine avec un système neuf à l’intérieur. Dans un cas le geste artistique est respecté mais l’œuvre est non conforme, dans le second cas, l’œuvre est plus conforme à l’original mais le geste artistique ready-made du moniteur n’est plus respecté. Ce qui n’est pas sans poser la question des pratiques muséales.
Suivre la vie de l’œuvre
Une mentalité bien ancrée pense que respecter une œuvre suppose de la figer. Une œuvre numérique continue de vivre si on l’a changé de support régulièrement et au bon moment. Cependant l’œuvre ne peut pas être réduite à sa technique. Par exemple les ampoules électriques vont disparaître, beaucoup d’œuvres en sont constituées, comment fera-t-on ? etc … Si on peut le prévoir avec l’artiste, il faut le faire, sinon il faut trouver des solutions possibles afin de rester le plus proche de l’esprit de l’œuvre. Autrement, il faudra déterminer ce qui était le plus important pour l’artiste, et pour le musée ou tout autre responsable de l’œuvre, afin de rendre l’œuvre exposable. Est-ce que c’était de signifier un contexte et dans ce cas il vaut mieux garder l’objet et il n’est pas exposé dans son état initial prévu comme par exemple une sculpture de César dans laquelle une télévision est imbriquée. Nam June Paik, lui n’a pas de soucis pour changer le modèle comme nous l’avons vu. Nous n’avons pas de solutions uniques, mais sont conservées les différentes “peaux” de l’œuvre.
Intégrer la vie, y compris la vie de l’œuvre
Le piano recouvert de feutre de Joseph Beuys a marqué une étape de conservation préventive dans la restauration d’œuvre d’art contemporaine. Avant, les visiteurs pouvant s’approcher du piano, tapotaient les touches recouvertes de feutre. Une proposition a été de retourner le feutre de le doubler tel un col de chemise usé renforcé. Beuys n’a pas du tout aimé la proposition il a donc changé la house, et a créé une nouvelle pièce. La peau et le piano avec sa nouvelle housse constituant ainsi un nouvel ensemble de pièces distinctes.
Intégrer la vie dans l’œuvre, y compris la vie de l’œuvre qui va vieillir, se modifier, voire mourir. Certains artistes programment la mort de leur œuvre, soit si l’œuvre est totalement périssable et disparaît soit on refait l’œuvre et le processus de désagrégation reprend. Pas de solution idéale comme norme, mais essayer de conserver au maximum. On ne peut pas rendre une œuvre vivante comme un humain.
Vanité que la restauration préventive ? Révolte douce que d’échapper à sa fétichisation par le périssable ?
Michel Blazy, peint avec de la Danette en couche infra mince pour obtenir des sortes de laques, glacis. Cependant ce produit est adoré par les souris. Ce type d’œuvre peut “contaminer” le reste de la production. Au Palais de Tokyo, l’artiste, a eu carte blanche en 2007 et comme seule contrainte, celle de ne pas tacher le sol. Il pouvait venir re-alimenter l’ensemble de son œuvre durant toute la durée de l’exposition. Le temps n’épargne rien. Pour Michel Blazy, il est difficile de définir ce qui est vivant ce qui ne l’est pas. Cet artiste travaille donc avec des échelles de temps différentes.
Vendre des kits / dossiers de prévention pour les travaux à base d’aliments ?
L’artiste Michel Blazy fabrique des dossiers afin de re-fabriquer l’œuvre, selon le désir, et l’énergie. Si les conditions ne sont pas réunies, alors l’œuvre restera dans les dossiers, dans cet archivage qui constitue l’œuvre et intègre sa conservation et même l’anticipe par ce format mode d’emploi. Par extension, des enjeux anthropocènes actuels invitent les musées à devenir des bunkers en se prémunissant de guides et kit de suivies voir de survies alimentaires autonomes.
Les contrats : prévoir la conservation des œuvres
Au moment de l’acquisition, il faut prévoir sur les contrats pour les éventuels risques de l’œuvre. Par exemple, les accidents ir-restaurables, peuvent être anticipés par la prise en charge des assurances et le contrat permet d’obtenir que l’artiste re-travail sa pièce en cas d’imprévus, et recréer la pièce manquante en cas d’accident. Ce recours peut être intéressant en cas de rétrospective de l’artiste, s’il y a des difficultés à rassembler des pièces dispersées par exemple. Mais face aux urgences anthropocènes, l’urgence des musées n’est-elle pas de révéler le pouvoir d’action concrète des œuvres plutôt que leurs risques ?
Qu’est-ce que la conservation préventive en quelques points clefs
1 Une gestion a priori lourde mais gérable si anticipée
La restauration a pris de l’ampleur depuis des pratiques artistiques des années 1970. La restauration prévention reste lourde et coûteuse à chaque fois qu’une pièce est prêtée. Mais ce n’est pas une raison de ne pas acheter / acquérir des œuvres sous prétexte qu’elles sont périssables. (La preuve en est avec le travail de Yanna Sterbak. Sa robe de biftecks est facile à refaire, par son mode d’emploi. Certains musées la jettent une fois séchée, d’autres non. On achète la mannequin et le patron. Il faut coudre les biftecks, selon des gabarits de viande approximatifs retenue par un grillage.) On peut se demander ironiquement en cas de situation d’urgence, mais les denrées, surtout d’origine bovine très mal vue actuellement notamment par leur méthane généré, ne seront-elle pas nos réserves alimentaires de demain telles les poires tapées du terroir de Touraine (qui se conservent plus d’une dizaine d’années) ?
2 Qualifier l’œuvre permet de mieux assurer le devenir de l’œuvre et l’usage de savoirs oubliés en cas de crise
La question du statut de l’œuvre est cruciale. Les œuvres sous forme de performances posent la question de la documentation de l’œuvre. Le musée devient par conséquent un accompagnateur d’œuvres en tant que partenaire des artistes dans la conception de ce que va être le devenir de l’œuvre. On remarque que “l’idée de l’œuvre éphémère” dans les années 1970 est pérenne. Cependant des modes de présentation, des processus transcendent l'éphémère.
3 La conservation préventive doit permettre une approche globale afin d’être pertinente et de faire sens.
Elle a pour mission de trouver des modes de présentation qui sont conformes à ce que l’œil contemporain peut voir de la vérité de ses œuvres sans les trahir. La prévention doit donc être inclusive et contextuelle et surtout applicable à l’usage concret de gestions nécessaires à la pérennisation des des collections.
Charlène Paris
Crédit de l'image de haut de page : Michel Blazy, Pull Over Time, exposition du 6 février 2015 au 7 mars 2015 à la Galerie Art Concept
#conservationpréventive
#artcontemporain
#obsolenscencetechnologique
Pour aller plus loin :

Pompidou-Metz : entre centre d’art et musée…
Rencontre avec Hélène Guénin, responsable adjointe du pôle programmation
Découvrir par matin d’hiver, le centre Pompidou-Metz endormi sous une fine couche de givre blanc relève d’un bel instant de grâce… C’est une œuvre architecturale absolument impressionnante quand on sait que la source d’inspiration de l’architecte Shigeru Ban est née de l’achat d’un simple chapeau traditionnel chinois acheté à la Maison de la Chine à Paris ! Le bâtiment se présente coiffé d’un assemblage de poutres d’épicéa en lamelles collées qui s’entrelacent pour former un maillage hexagonal recouvert d’une fine membrane de téflon opaque et transparente de nuit.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval
On retrouve l’idée de l’hexagone dans l’architecture globale de l’édifice avec trois galeries auto portées traversant l’espace en se croisant. Ces trois galeries sont apposées à une colonne métallique sur laquelle est suspendue la toiture, laquelle va se reposer sur plusieurs poteaux-tulipes contournant le bâtiment. Passé le seuil de l’édifice, on entre alors dans une véritable relation sensorielle jouant entre l’espace architectural intérieur et l’environnement extérieur. Celui ci se dévoile à chaque étage par des pans de murs vitrés mettant en œuvre une magnifique interaction avec le panorama de la ville de Metz.
La structure se décline en trois parties avec ses trois galeries, un bâtiment annexe administratif, et un studio ; espace modulable de 500 m² dédié aux arts vivants. La grande nef, vaste hall translucide, permet d’accueillir une diversité d’évènements et dispose d’un premier espace d’exposition. Un auditorium pouvant diffuser films et conférences dont la particularité originale et innovante est attribuée à la réalisation de Shigeru Ban. Le plafond en forme de vagues conçues en tubes cartonnés contribue ainsi à la performance acoustique du lieu. Restaurant, café, bibliothèque, boutique terrasses et jardins enrichissent le lieu.
Le projet visant le mouvement de décentralisationdes collections nationales a été amorcé en 2003 et développé sous le ministère de la Culture dirigé par Jean-Jacques Aillagon. Il représente donc la première expérience de ce type en France. Metz a été retenue pour combler un manque en matière de structures régionales d’art moderne. La ville disposait d’une implantation urbaine et géographique intéressante avec l’idée de construire le musée dans le quartier de l’amphithéâtre (lieu d’anciennes friches ferroviaires). Plus d’une centaine d’hectares autour de l’édifice est dédiée à la construction de centres d’affaires, de commerces et d’habitations dans une démarche de projet HQE[1].
Un fonctionnement autonome
Le centre Pompidou-Metz est un EPCC[2]. Ce fonctionnement autonome lui confère également une plus grande liberté au niveau du choix de la programmation scientifique et culturelle qui cependant est validée et entérinée par Beaubourg. L’établissement ne possède pas de collections propres. Celles-ci ne dépendent pas non plus uniquement de Beaubourg mais peuvent passer par les circuits internationaux et nationaux. Les expositions reçues peuvent être itinérantes comme l’une des prochaines d’Hans Richter, programmée en septembre 2013 et coproduite avec le Lacma de Los-Angeles.
L’un des objectifs du projet scientifique et culturel est de mettre en avant la pluridisciplinarité, en présentant les arts vivants (danse, performance, musique, théâtres, cirque), le cinéma ou des cycles de conférences variés. Le budget alloué aux arts vivants ne représente que 10% du budget global mais cette programmation dans le prolongement des expositions et permettant de mettre en lien un chorégraphe avec un artiste ou un auteur comble les visiteurs. Ainsi dans le cadre d’un partenariat, et sous forme de coproduction avec l’EPCC Metz/Arsenal, l’œuvre majeure Fasede la chorégraphe Thérésa de Keersmaeker sera présentée au mois de janvier 2013 accompagnée d’une conférence Danse les années 80 et la naissance de l’auteur.
Actuellement la danse s’expose, la grande nef présente Parade, ballet présenté en 1917 au théâtre du Châtelet à Paris. Evènement exceptionnel dans l’histoire des arts qui rassembla Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso, Léonil de Massine et Serge Diaghilev autour d’une œuvre magistrale de l’histoire de la danse. De la genèse au processus de création le visiteur défile au gré d’un parcours circulaire aux tons nacrés parmi une sélection documentaire exceptionnelle et centralisé par l’œuvre incontournable du rideau peint de Picasso.
Le FRAC au Pompidou Metz

Crédits : Isabelle Capitani
Au niveau de la galerie 2 est présentée une rétrospective sans précédent en Europe de l’artiste conceptuel américain Sol Lewitt (1928-2007). Trente-trois œuvres murales s’imposent magistralement à travers plusieurs combinaisons de noir et blanc, composées de lignes ou de formes géométriques. Contrairementaux deux autres expositions le parcours se poursuit rectiligne suivant l‘espace parallélépipède rectangle de la galerie.
Œuvre en lui-même, le centre Pompidou Metz rayonne au cœur d’un espace encore en construction ; contraste qui justifie la grandeur de l’art au service dudéveloppement culturel et économique d’une région et l’on ne peut éviter le clin d’œil au petit frère Louvre Lens en lui souhaitant un même second et grand succès dans la nouvelle conquête du territoire Nord-Pas de Calais…
Nous remercions chaleureusement Hélène Guénin pour son aimable présentation de l’institution.
Isabelle Capitani
[1] haute qualité environnementale
[2] établissement public de coopération culturelle

Privilégier le contexte, conversation avec Joanna Lang
Joanna Lang, restauratrice et conservatrice d'œuvres picturales au début de sa carrière, est maintenant curatrice et conservatrice du musée de l'insurrection de Varsovie depuis son ouverture, il y a 13 ans. Elle a été l’invitée du Master MEM pendant une semaine expographique consacrée à l’extension et la rénovation des musées.
Retour sur une histoire. L'insurrection de Varsovie est une histoire marquante de la Pologne qui se déroule à la fin de la Seconde guerre mondiale. Fin juillet l944, le peuple polonais ne pouvait plus se résoudre à vivre sous le joug allié, il décide de prendre les armes et de récupérer le Varsovie occupé. L'insurrection a duré du 1er août au 2 octobre 1944, la résistance s'est élevée avec l'armée et les civils. Tous se sont soulevés. Le 2 octobre, après des pertes humaines immenses et la destruction à 80 % de la vieille ville de Varsovie, l'armée polonaise capitule. Les civils survivants sont transportés dans des camps de travail par les Allemands, les plus chanceux réussissent à fuir la ville.
Les grands parents de Joanna ont fui Varsovie à cette époque. Elle n’a regagné Varsovie que bien plus tard. Si le lien familial à l'insurrection de Varsovie est évident dans l'histoire de Joanna, le grand challenge de son travail était de sortir du carcan « Beaux-Arts » où seules les « belles œuvres » comptent pour rendre aux souvenirs de cet événement toute la précaution de conservation qui leur est due.
Un musée sur l'insurrection de Varsovie
 Le projet muséal sur l'insurrection de Varsovie s'est fait en quatre ans, le bâtiment a été construit en une seule année. Ce temps court s'explique par une volonté politique d'ouvrir le musée pour célébrer les 60 ans de l'insurrection et réunir les survivants ainsi que les nouvelles générations. Un rythme de travail soutenu jusqu'àl'ouverture était de mise. L'appui du maire de la ville a été capital, et toute décision fut prise de manière rapide, quasi expéditive.
Le projet muséal sur l'insurrection de Varsovie s'est fait en quatre ans, le bâtiment a été construit en une seule année. Ce temps court s'explique par une volonté politique d'ouvrir le musée pour célébrer les 60 ans de l'insurrection et réunir les survivants ainsi que les nouvelles générations. Un rythme de travail soutenu jusqu'àl'ouverture était de mise. L'appui du maire de la ville a été capital, et toute décision fut prise de manière rapide, quasi expéditive.
Le temps de réalisation du musée était très court par rapport à la moyenne, il a été facilité par une grande équipe d'historiens, de scénographes, de conservateurs ayant travaillé sur le projets cientifique et culturel du musée, mais également facilité par une collection déjà existante et grandissante.
Cette rapidité dans l’exécution est exceptionnelle en France comme en Pologne. Les musées sont soumis aux mêmes contraintes européennes et les marchés publics, les obligations diverses telles que l'accessibilité sont également les mêmes. Joanna insiste sur l'importance de privilégier un temps long pour la conception d'un musée ou sa réhabilitation. Il est nécessaire que le projet soit mature et soit compris de tous. Cette cohérence ne peut se faire que par un temps de réflexion, de conception et de discussion afin de ne pas passer à côté de son propos.
Les murs abritant le projet muséal tout juste né ont une grande importance. Si le lieu abritant le futur musée a une histoire locale, il semble primordial d'utiliser ce lieu et de garder le contexte du musée pour créer un attachement de la population proche.
Ne pas jurer par le nouveau est un maître mot de Joanna. Un musée d'objets usuels aura tout intérêt à garder ces objets dans leur contexte domestique car, si pour nous leur utilisation semble évidente, la prochaine génération aura du mal à être attentive aux objets dont ils ne connaissent pas l'usage et s’ils sont placés dans un lieu neutre.
Il en est de même pour des musées d'art dont la collection vient de notables locaux. Il est judicieux de montrer dès l'entrée l'apport de ces collectionneurs pour ancrer le visiteur et ainsi le placer face à une chose palpable et immuable à laquelle ils peuvent se raccrocher.
L'importance du contexte muséal
 L'importance du contexte. Selon Joanna Lang, le contexte est la base évidente à la bonne implantation d'un musée sur le territoire. Que ce soit par l'utilisation d'un lieu inscrit dans l'inconscient (ou le conscient) collectif d'une population locale ou par l'utilisation d'une histoire locale à inscrire dans un nouveau lieu, il est essentiel de créer un lien. Le lien est souvent l'histoire commune. Cela permet de rencontrer un public, d'évoluer avec lui, de ne pas être l'alien de sa propre ville. Les musées font parfois peur et souffrent des à priori qu'on leur plaque. Si on rentre plus facilement dans un groupe quand on y a un contact, le contexte est notre allié.
L'importance du contexte. Selon Joanna Lang, le contexte est la base évidente à la bonne implantation d'un musée sur le territoire. Que ce soit par l'utilisation d'un lieu inscrit dans l'inconscient (ou le conscient) collectif d'une population locale ou par l'utilisation d'une histoire locale à inscrire dans un nouveau lieu, il est essentiel de créer un lien. Le lien est souvent l'histoire commune. Cela permet de rencontrer un public, d'évoluer avec lui, de ne pas être l'alien de sa propre ville. Les musées font parfois peur et souffrent des à priori qu'on leur plaque. Si on rentre plus facilement dans un groupe quand on y a un contact, le contexte est notre allié.
© Adrian Grycuk
Plus que pour gagner en popularité, le contexte est également la base du développement du musée. « Pour savoir où tu vas, sais d'où tu viens » en somme. Le contexte du musée, son implantation auprès d'une population locale permet d'évoluer à plusieurs. Si le contexte est ancré, il sera plus simple d'agir vers un but commun, de sortir de divers orgueils intra-musée et d'ainsi travailler en équipe pour une chose plus grande.
Le musée, s'il est bien implanté devient alors une institution scientifique permettant de montrer l'impact d'une exposition sur les individus mais également l'impact des individus sur les projets muséaux à venir. Le musée peut alors s’agrandir et devenir égalementune zone d'actions sociales diverses, d'ateliers variés, un lieu de rencontre etc. L'histoire, l'utilisation d'un ancrage local, la valorisation du contexte de création d'un musée permettent d'animer le lieu et de valoriser les actions qui s'y passent. Ce n'est qu'à ce prix qu'un musée peut être compris et peut s'épanouir avec ses visiteurs.
Donner au musée de l'insurrection de Varsovie ces lettres de noblesses par l'Histoire, c'était la mission belle et bien accomplie de Joanna. Merci à elle,
Do zobaczenia !
( « à bientôt », en polonais).
Alice Majka
#semaineexpographique
#joannalang
#muséedelinsurrection
#pologne
Un muséographe révélé ?
Interview d’Olivier Romain Rouchier
Vélo © Olivier Romain Rouchier
Olivier Romain Rouchier est commissaire de l’exposition « Objets révélés » programmée au musée de la Chartreuse de Douai pour 2018, c’est un homme vif et chaleureux qui me parle avec passion, de sa nouvelle mission dont il se sent pleinement investi. Son parcours est atypique et ne le prédestinait pas à travailler un jour pour un musée. Cette opportunité s’est toutefois présentée à lui presque par hasard et il ne regrette pas du tout cette expérience, bien au contraire !
Quel a été ton parcours avant de devenir commissaire d’exposition au musée de la Chartreuse de Douai ?
Depuis tout petit j’ai la passion des vieux objets. Dès mes 12 ans je commençai à collectionner des objets que je trouvais dans des brocantes ou chez les antiquaires. Très tôt, et de façon autodidacte, je me suis documenté sur ces objets et j’ai acquis une connaissance assez pointue et spécifique sur ce sujet. A 23 ans je deviens antiquaire Nancy, métier que j’ai exercé jusqu’en 2007. J’ai vendu beaucoup de choses identiques à celles qui sont dans les réserves du musée !
A ce propos, comment en es-tu arrivé à travailler au sein du musée ?
C’est Anne Labourdette, la conservatrice, qui m'a contacté. Elle avait besoin d’une expertise pour certains objets (des boucles de chaussure du 18eme siècle). J’ai commencé à travailler comme consultant bénévole en 2015, mon rôle a été de décrire et d'identifier certainsobjets et aussi de corriger des descriptions anciennes erronées.
Identifier un objet, le retrouver àl’inventaire, retrouver son histoire, le comprendre, c'est pour moi une sortede sauvetage et donc une grande joie. Cette première expérience fut un émerveillement.
Vous avez fait des trouvailles excitantes ou bien était-ce du simple étiquetage ?
C’était une chasse au trésor ! Je suis tombé sur des objets dont je ne soupçonnais même pas l’existence comme un objet en fer et en laiton du XIXe siècle qui servait à mesurer les sabots des chevaux. Chasse au trésor mais aussi un voyage puisque nous avons trouvé, parfois au fond d’une grosse caisse ou incognito à proximité de plusieurs objets banals, des objets rares et exotiques. J’ai par exemple reconnu une amulette égyptienne rescapée de l’ancienne collection d’ethnologie du musée perdue pendant les conflits historiques. Celle dont je suis le plus fier reste quand même cet éperon à molette du XIVe qui (après des recherches) s’avérait apparaître dans l’inventaire de 1807 qui le rangeait déjà dans les antiquités de l’Antiquité et du Moyen-âge ! C’est un objet rare. Il faut dire qu’Anne Labourdette est très active pour impulser une recherche d’œuvres disparues en région.
Mais comment a germé l’idée de concevoir une exposition autour de tous ces trésors ?

Sac à tête © Olivier Romain Rouchier
L’exposition semble surtout reposer sur le sensationnalisme, as-tu pensé en amont à un concept muséographique ?
Bien-sûr, j’ai décidé de regrouper les objets autour de thèmes universels et intemporels comme « Naître et mourir », « La Violence », « l’Amour », « l’Exotisme et le Voyage »... Mon but est de parler au plus grand monde. J’assume le parti-pris de jouer avant tout sur l’émotion du visiteur. C’est selon moi le meilleur moyen de relier ce dernier avec ses vieux objets dans leur cœur et dans le temps. Je ne veux pas qu’on reste indifférent à ce que nous allons exposer. En même temps que je dessinais le parcours de visite, je me suis documenté sur les objets sélectionnés ce qui va me permettre de les décrire, de rédiger les cartels, les textes de salle et le catalogue de l’exposition. Je vais à l’essentiel dans un souci de vulgarisation scientifique. Mon exposition sera libre : pas de parcours de visite, seulement des petits îlots à thème autour desquels les visiteurs pourront naviguer à leur guise.
Un véritable travail de muséographe en somme, et la scénographie c’est toi qui t’en occupes ?
 Jusqu’ici pour la muséographie j’ai travaillé seul et j’ai des idées pour la scénographie. Cependant je ne pense pas que j’endosserai un rôle de scénographe en plus de celui de muséographe. Ce sera un travail collectif dans lequel je pense tout de même avoir mon mot à dire. Je n’abandonne pas mon projet une fois que je l’ai écrit, je serai là pour sa mise en place, sachant que des réajustements au niveau du contenu auront peut-être lieu face à certains problèmes que l’équipe scénographique auront pointé. Je souhaite par exemple, à la fin du parcours de visite, organiser un couloir ( ré)créatif de médiation innovante. Je veux que le public soit intéressé, qu’il réagisse à ce qu’il voit.
Jusqu’ici pour la muséographie j’ai travaillé seul et j’ai des idées pour la scénographie. Cependant je ne pense pas que j’endosserai un rôle de scénographe en plus de celui de muséographe. Ce sera un travail collectif dans lequel je pense tout de même avoir mon mot à dire. Je n’abandonne pas mon projet une fois que je l’ai écrit, je serai là pour sa mise en place, sachant que des réajustements au niveau du contenu auront peut-être lieu face à certains problèmes que l’équipe scénographique auront pointé. Je souhaite par exemple, à la fin du parcours de visite, organiser un couloir ( ré)créatif de médiation innovante. Je veux que le public soit intéressé, qu’il réagisse à ce qu’il voit.
Podomètre © Olivier Romain Rouchier
Quel regard portes-tu sur les musées aujourd’hui ?
Souvent dans les musées et les expositions, les cartels sont illisibles ou incompréhensibles, et on peut rarement s'asseoir ! Il n'y a pas assez de jeunes dans les musées d'art ancien, trop de gens se disent " le musée ce n'est pas pour nous, c'est ennuyeux ". Il faut aller à leur devant et renouveler et régénérer le public des musées. Notre exposition est destinée à tous bien sûr, mais j'espère qu'elle attirera les jeunes. Ce serait pour moi un beau compliment qu'un adolescent me dise qu'il ne pensait qu'un musée pouvait être aussi "cool". Donc l’exposition seraludique, libre et pour tous ?
Exactement ! Je rajoute qu’elle sera confortable, il y aura des sièges ! Ce sera une exposition sérieuse qui ne se prendra pas au sérieux.
Etla cohabitation avec des muséographes « du cru », un choc des cultures ?
En réalité j’ai été très étonné par l’accueil et la confiance dont les collègues du musée ont fait preuve. Ils ont fait l’école du Louvre, moi je n’ai aucun bagage muséographique, juste mes connaissances de spécialiste autodidacte. Pourtant, on m’a adopté immédiatementet on a porté une grande attention à mes avis. C’était très confortable comme situation. On m’a même demandé d’organiser une visite des réserves au conseil municipal, c’est là que j’ai remarqué que j’arrivais à intéresser les gens même aux trucs moches et détériorés.
Amaury Vanet
#Objets
#Antiquités
#Réserves
Pour en savoir plus : http://www.

Une année 2012 finie en beauté !
Au cours du mois de décembre 2012, la promotion Marie-Geneviève Bouliard est partie en voyage d’étude à travers la Belgique, la Lorraine et la Suisse. Ces cinq jours organisés par Serge Chaumier furent intenses en découvertes.
Notre première escale fut la ville d’Ypres en Belgique où se tenaient les journées d’études sur les Constructions mémorielles participatives organisées par le département du Nord. En plus des interventions, nous avons découvert In Flanders Field Museum : musée commémoratif de la première Guerre Mondiale et nous avons même participé à la cérémonie du Last Postau Mémorial de la Porte de Menin, accompagné par le collaborateur scientifique recherche du musée, Dominiek Dendooven.
En passant par la Lorraine
La suite de notre voyage s’est poursuivie par la Lorraine avec la visite du Centre Pompidou Metz où Helène Guénin nous a accueillis et fait découvrir la programmation culturelle du lieu. Le FRAC Lorraine nous a aussi ouvert ces portes et Chéryl Gréciet, chargée des publics et de la programmation culturelle, nous a fait découvrir leur collection axée sur les artistes féministes contemporaines travaillant sur toutes formes de support (arts graphiques, vidéo/son, etc).
Nous posons finalement nos bagages à Neuchâtel, au bord du Lac après avoir bravé la neige suisse. Après une nuit de repos, nous sommes accueillis au Musée d’Ethnologie de Neuchâtel par Marc-Olivier Gonseth – conservateur - et Grégoire Mayor - conservateur adjoint. Une majeure partie de la journée sera consacrée à l’étude de l’exposition temporaire actuelle Hors-Champs,hymne à l’intérêt que Jean Gabu, créateur du musée, portait aux régions.
A nous la Suisse !
Le lendemain nous voici à Vevey : au bord du Lac Léman, une fourchette géante plantée dans l’eau nous indique que nous sommes arrivés à l’Alimentarium. Denis Rohrer, conservateur au musée, nous accompagne dans la visite du lieu et nous en profitons aussi pour flâner dans la délicieuse exposition sur les collectionneurs.
L’après-midi, nous prenons la direction de Lausanne pour visiter la Fondation Verdan - Musée de la main. Ce centre d’expositions est consacré à la culture scientifique, médicale et artistique. L’exposition du moment Touch a été un moment plein d’expérimentations et de (re)découverte de l’utilisation des sens, en particulier du toucher, à travers de nombreux dispositifs interactifs.
Le séjour s’est fini par la visite du Laténium – musée archéologique de Neuchâtel. Construit au bord du lac, le parcours muséographique intègre toutes les époques (de la préhistoire au moyen-âge) d’occupation de ces rives. La rencontre avec Marc-Antoine Kaeser, conservateur du musée, nous a permis de mieux comprendre les ambitions du lieu un peu différentes de ceux plus « archéo-classiques ». La volonté est de mettre le visiteur en position de réflexion par rapport aux objets qui l’entoure, afin de l’amener à créer des liens entre les époques, sans suivre un parcours chronologique.
Ce séjour hors de la région Nord-Pas de Calais s’inscrit dans la continuité de la formation qui est, non pas d’assister à de nombreux cours théoriques à l’Université, mais d’aller à la rencontre des professionnels, le plus souvent sur leur lieu de travail. Ceux-ci nous donnent une approche concrète de leur travail et de certaines problématiques qui les touchent. En ce début d’année 2013, nous avons notamment rencontré Cyril Dermineur au Musée des Beaux-arts de Valenciennes, pour une journée sur le récolement, ainsi que Véronique Mary, directrice du Forum Antique de Bavay, et Anne Labourdette, conservatrice du musée de la Chartreuse de Douai, sur les questions que soulèvent l’écriture du Projet Scientifique et Culturel.
Promotion Marie-Geneviève Bouliard
Musée d’Ethnologie deNeuchâtel
Fondation Verdan –Musée de la main
Le Laténium Neuchâtel
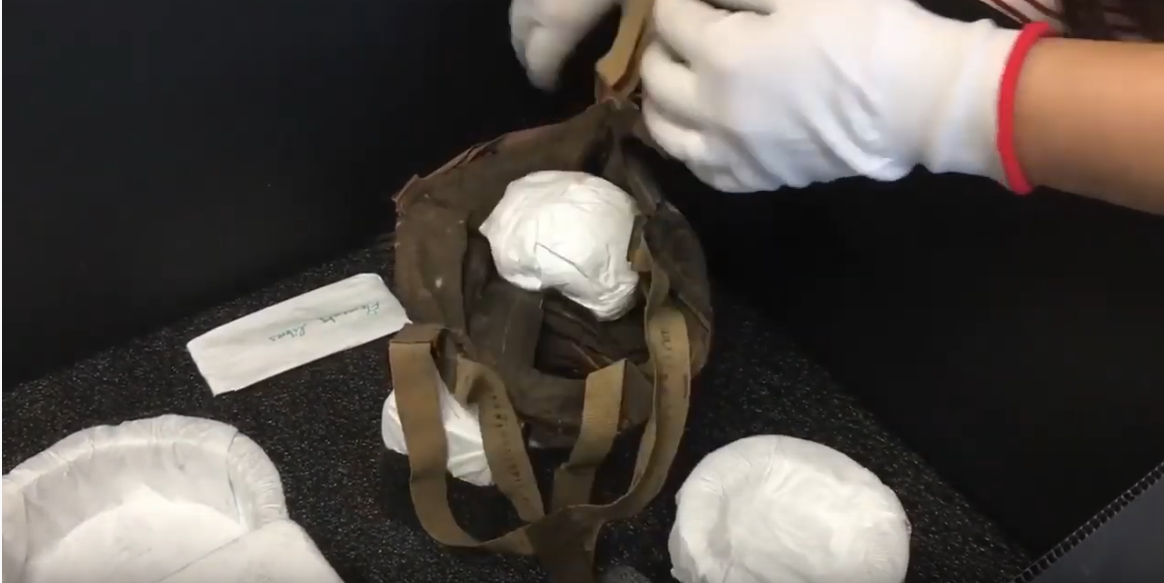
Workshop Régie
Pendant trois jours le Musée d'Histoire et d'Archéologie de Harnes a confié la mission de conditionnement de quelques-uns de ses expôts aux étudiant.e.s de Master MEM et de Régie des Œuvres et Montage d’expositions à l’UPJV d’Amiens. En image, le suivi d’un de ces conditionnements…
Retrouvez l'intégralité des vidéos produites par le Master Expographie-Muséographie sur YouTube.
Coline Declerq

Zoom métier : la sécurité dans les musées

Emmanuel Decoupigny © Damien Maurin
En quoi consiste votre métier ?
Il y a plusieurs volets dans mes missions, j’ai d’abord un rôle de conseil technique et de coordination au niveau de l’ensemble du réseau des musées. La partie sécurité, c’est la sécurité incendie essentiellement : la gestion des installations, des contrôles annuels, les remontées d’informations, les commissions de sécurité auxquelles je participe pour tous les établissements, à titre de conseil technique et d’expertise. Pour le volet sureté, c’est-à-dire la protection des œuvres, mon rôle est de conseiller les chefs d’établissement sur les installations et le niveau de sécurité à mettre en œuvre pour telle et telle exposition. J’ai également en charge la gestion du contrat de gardiennage des loges, j’ai aussi un regard sur la partie accueil et surveillance des musées. Dans ce cadre je réalise des formations pour les agent·es.
Il m’a été confié une mission complémentaire qui est donc la prévention des risques professionnels à l’échelle des musées, pour l’ensemble des agent·es quelles que soient leurs fonctions, leurs missions et leurs postes. Je fais donc partie du réseau des préventionnistes de la culture. La prévention des risques professionnels couvre tous les domaines : problème d’organisation, de stress au travail, problème de matériel, d’équipement de protection individuel, accidents de travail, etc. C’est un pendant du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
Quel a été votre parcours ?
J’ai un parcours un peu atypique… Je suis un ancien officier de l’armée de terre, où j’ai passé près de 20 ans. En fin de carrière je me suis surtout spécialisée dans la partie sécurité et sureté, j’ai passé des diplômes au niveau militaire. Au bout de 20 ans, j’ai décidé de quitter l’institution. Je suis parti pendant une année dans un centre hospitalier comme chargé de sécurité. J’y assurais des fonctions similaires (prévention des risques professionnels, sureté, sécurité) mais le travail n’était pas exaltant et ne correspondait pas à mes attentes. J’ai décidé d’en changer et j’ai donc postulé aux musées en 2013.

Poste de sécurité © Damien Maurin
Avec qui travaillez-vous ?
Je suis seul mais je supervise les loges, les agent·es de surveillance dans un rapport de formateur et de conseil technique sur le travail quotidien. J’interagis avec tous les corps de métier, notamment dans la cadre de la prévention des risques professionnels. Pour le volet sureté mes interlocuteurs sont surtout les conservateurs et les entreprises de maintenance. Pour les aspects de sécurité c’est par exemple le service éducatif qui vient me voir pour les protocoles d’évacuations. C’est moi qui suis chargé d’organiser les exercices d’évacuation annuels. J’assure l’interface avec un certain nombre d’institutions : le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), la Police Nationale et notamment l’Office Centrale de lutte Contre le trafic de Biens Culturels (OCBC), la police municipale ainsi que les visites de la Mission Sécurité du Ministère de la Culture.
Est-ce que la situation des musées, c’est-à-dire leur fonctionnement en réseau, amène une difficulté à votre métier ?
Non au contraire, c’est même plus une facilité car cela permet de mettre en place des mesures globales. C’est-àdire que là où on aurait besoin d’un élément pour un établissement, on peut le généraliser à tous, ce qui permet de faciliter sa mise en place. Le Plan de Sauvegarde du Patrimoine est le même pour tous les établissements, même s’ils ont chacun leurs spécificités, la structure de fonctionnement reste la même. Ce qui facilite le travail.
Quel est votre rôle dans le projet de L’Union Sociale, pôle d’étude et de conservation des musées ?
Il s’agit surtout d’épauler Ludovic Chauwin (chef du projet et régisseur des collections au sein des musées) notamment dans les tous les aspects très techniques de la partie sureté/sécurité. Parce que sur ce genre de chantier d’ampleur, s’il n’y a pas un œil d’expertise, on est soumis aux aléas d’un architecte qui prend des décisions techniques. On se retrouve donc parfois avec des chantiers livrés avec des systèmes qui finalement ne fonctionnent pas, ou mal, ou qui induisent des fonctionnements compliqués, parce que cela n’a pas été réfléchi en amont. Depuis le début je donne des préconisations, c’est le cas notamment pour le type de serrure, le type de système d’alarme, de caméra, etc. Parfois c’est suivi, parfois ça ne l’est pas, parce qu’il y a des arbitrages qui sont menés à d’autres niveaux, mais au moins il y a un avis qui a été donné. Le positionnement du poste de sécurité, les rondes, le nombre de gardiens, le type de gardiennage ou en télésurveillance complet, toutes ces choses ont fait l’objet de fiches, d’études, etc. C’est parfois frustrant parce qu’un avis n’est pas toujours suivi d’effets, mais au moins la décision a été prise en toute connaissance de cause par l’échelon supérieur.
Avez-vous déjà fait face à des crises ou des situations compliquées ?
Ah oui ! Peut-être pas autant que celle du Covid-19. Mais de toute façon en tant que militaire on est formé à la gestion de crise : on apprend à travailler en situation compliquée, dans des environnements contraints, avec des temps contraints, des manques de moyens, etc. On apprend à gérer.
Vous avez un exemple pour les musées ?
On a eu des grosses inondations. Il y a deux-trois ans au musée de l’Œuvre Notre-Dame un tuyau de chauffage avait cédé en pleine nuit, suite à des travaux. Inondation des salles qui perlait des murs, bureaux de la fondation inondés, il y avait un centimètre d’eau partout au premier étage. Je me souviens très bien du lendemain matin, avec une collègue, on essayait de trouver des cartons pour absorber l’eau. C’était folklorique ! Il y en a eu d’autre… mais c’est celle-là que je retiens.
Suite aux attentats, les musées ont dû appliquer le plan Vigipirate. Quel a été votre rôle ?
D’abord de former les agentes, parce que le plan Vigipirate, de manière générale dans l’administration, ce n’est pas quelque chose que l’on maîtrise. Au début, dans les années 2000, le plan Vigipirate était relativement confidentiel pour le grand public. Suite aux attentats en France, il y a eu un changement de posture du gouvernement qui a décidé de rendre la population et les collectivités responsables de l’application de ce plan. Dans ce cadre-là il a fallu former tous les agent·es à ses spécificités et à la mise en œuvre des consignes et des mesures. Cela a nécessité la réécriture du règlement de visite, un document qui est signé par le conseil municipal et par le maire et qui fait office de loi puisqu’il fait l’objet d’un arrêté municipal. Il a également été nécessaire de former les 130 agent·es d’accueil et de surveillance à ces procédures (comment accueillir un visiteur, comment lui demander d’ouvrir son sac, qu’a-t-on le droit de faire, de ne pas faire, où se limitent nos interventions…).
Et dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ?
Comme toutes celles et tous ceux qui ont participé activement à la gestion globale de la crise à distance, remonter les informations sur ce qu’il se passait exactement, assure un suivi réglementaire, et puis très tôt travailler sur le Plan de Reprise d’Activité avec un certain nombre de questionnements. Comment allait-on faire ? Comment s’organiser ? Beaucoup de choses sont arrivées, avec des consignes qui tombaient régulièrement, parfois contradictoires, du Ministère de la Culture, de la Préfecture, de la Ville. Tout n’était pas toujours en concordance. Donc ce n’est pas évident de faire le tri dans tout cela et d’arriver à mettre sur pied quelque chose de cohérent.

Entrée du palais Rohan avec les installations pour lutter contre le Covid-19 © Damien Maurin
Comment imaginez-vous l’après épidémie pour votre métier et pour les personnels des musées ?
Ça pourrait se résumer en un mot : Compliqué. J’étais en train de travailler sur une note à propos du plan canicule qui va arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un point important cette année c’est que nous n’aurons pas le droit de mettre de ventilateurs dans les espaces communs. Dans les bureaux oui, dès lors que l’on est seul mais pas dans les espaces de visite et les espaces communs. Ça veut dire que les agent·es vont être confrontés à des températures élevées dans certains musées, sans possibilité de ventilation, et avec un masque. Ça va être excessivement compliqué. Je pense qu’on risque d’avoir des périodes où l’on va fermer des salles quand il fera trop chaud. Ce n’est bon pour personne : agent·es, visiteur·euses et œuvres. Donc voilà, compliqué.
Propos recueillis par Chloé M.
#sécurité #musées #métier