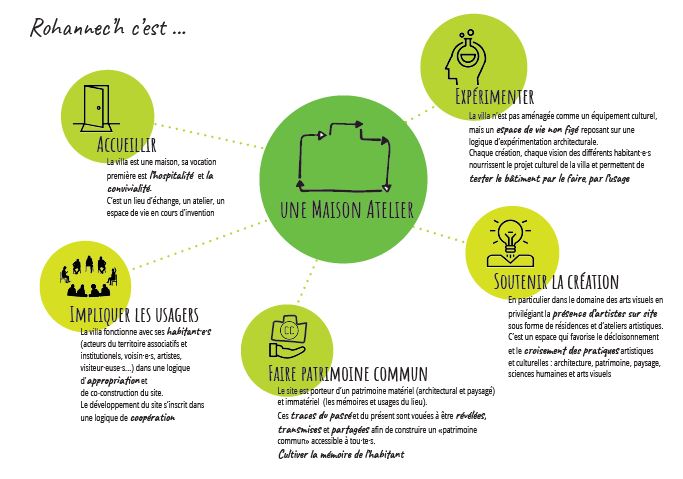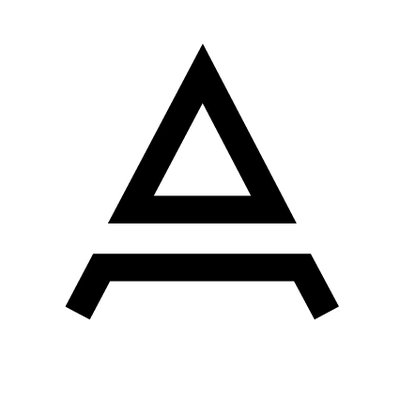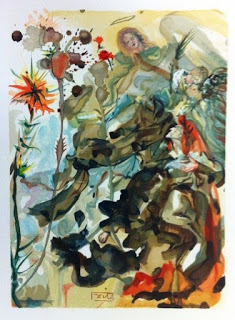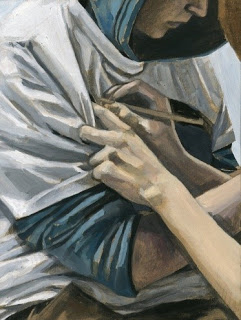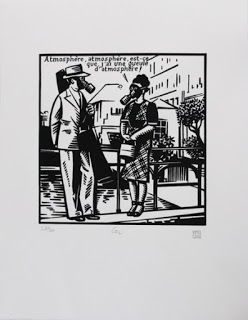Brèves de stage et d'apprentissage

Assaisonnez votre été à la Maison du Sel
À quoi sert le sel, ce petit grain blanc si banal ? Relever le goût des aliments, les conserver, déneiger les routes en hiver… Il se cache pourtant dans bien plus d’objets inattendus de notre quotidien. Alors pour l’extraire en grande quantité, en Lorraine, on emploie les grands moyens ! La Maison du sel relève le défi de tout vous dire sur le sel et son exploitation en seulement quelques mètres carrés d’exposition grâce à de nombreuses astuces !
Un territoire aux enjeux complexes
Patrimoine bien souvent méconnu des Lorrains eux-mêmes, le sel est en réalité exploité dans la région depuis environ 3000 ans. Depuis 2004, les autorités culturelles et touristiques régionales ont la volonté de mettre en valeur cette ressource, richesse identitaire jusqu’alors sous-estimée. Entre le Musée départemental du sel de Marsal, les Salines royales de Dieuze ou encore la mine de sel de Varangéville, La Maison du sel doit tirer son épingle du jeu. De même, il ne faut pas non plus négliger les partenariats potentiels avec les industriels du sel mais aussi répondres aux questionnements de la population locale face aux bouleversements paysagers engendrés par cette exploitation intensive.
Au sein de ces enjeux complexes, la petite équipe de ce centre d’interprétation en milieu rural ne manque pas d’idées créatives pour participer au développement de son territoire, mais aussi pour se démarquer de l’offre culturelle et touristique classique des centres urbains de Nancy et Metz.
De la créativité comme carburant
Qui a dit qu’une unique pièce de 200 m² c’était insuffisant pour vivre une expérience de visite atypique ? Grâce à l’ingéniosité de sa conception en espaces modulables, La Maison du Sel est à la fois salle d’exposition abondamment illustrée à propos des propriétés et de l’exploitation du sel, espace de projection pouvant accueillir cinquante personnes pour se plonger au cœur de la mine de Varangéville, mini laboratoire expérimental pour comprendre les réactions chimiques de ce cristal, petit buffet dégustation pour comparer les nuances de goût des variétés de sel sur un carré de chocolat, sans oublier la boutique qui titille la curiosité des petits et grands.
Et pour encore plus de surprises, il faut suivre les médiatrices dans la salle pédagogique située dans l’annexe construite en 2015. Participer aux ateliers proposés c’est fabriquer ses propres cosmétiques à base de sel, décrypter des étiquettes alimentaires, démasquer les nombreuses cachettes du sel dans notre corps et dans les objets qui nous entourent, découvrir les métiers de géologue et de paléontologue, construire une cité ouvrière idéale ou encore se mettre dans la peau d’un artiste et exprimer sa créativité grâce à ces petits grains blancs.
Pour appuyer son ancrage dans le territoire, La Maison du Sel se veut aussi lieu de rencontre et d’échange à travers la construction de partenariats, comme par exemple avec l’université de Lorraine par la co-organisation de journées de formation pour les enseignants.
Afin d’élargir son champ d’action, elle collabore également ponctuellement avec les industriels du sel présents dans le secteur pour partager ressources documentaires, connaissances… mais aussi lopin de terre !

Visite ludique pour enfants dans l’espace d’exposition © Laurence Louis
Une vue panoramique unique
Quoi de mieux pour comprendre l’impact paysager de l’exploitation intensive du sel en sous-sol que de se rendre sur place ? À quelques pas de La Maison du Sel, cette activité a laissé derrière elle d’immenses étendues d’eau bordées de falaises en plein milieu des champs. Dénommé « effondrements salins », ce phénomène est la conséquence de l’affaissement de cavités souterraines, vidées du sel gemme. L’entreprise Solvay, propriétaire des lieux, a accepté de mettre à disposition du musée une parcelle en surplomb pour permettre aux visiteurs d’admirer le panorama. Observer à travers des jumelles les nombreuses espèces animales et végétales qui s’y sont développées, profiter d’un moment de détente assis aux tables de pique-nique ou apprendre des informations surprenantes en parcourant les panneaux d’interprétation, l’Observatoire participe à la singularité de l’établissement.

L’Observatoire © Laurence Louis
Des projets plein la tête
Créée seulement en 2010, La Maison du Sel poursuit au fil du temps la construction de son identité. Mais l’effectif réduit du personnel et les problématiques liées à sa situation en milieu rural (notamment doubler d’effort pour bénéficier d’une certaine visibilité, attirer du public) sont des réels freins à ses ambitions.
Mon rôle durant ce stage est donc de donner un coup de pouce pour les matérialiser par la conception de signalétique et de supports interprétatifs. Après immersion au cœur du site par la participation à des journées de formation, échanges avec mes collègues, documentation et rencontres avec des scientifiques (géologues), j’ai pu prendre conscience des nombreux enjeux que recouvre ce centre d’interprétation modeste au premier abord, quoique sur un vaste territoire. Prochaine étape, la rédaction des contenus !
En attendant la matérialisation de ces projets, si vous êtes de passage en Lorraine cet été, pensez à assaisonner votre séjour à La Maison du Sel !
Laurence Louis
#LaMaisonDuSel
#PatrimoineSalin
#Lorraine
AZAY-LE-RIDEAU : ENCHANTEMENTS ET RENAISSANCE
Originaire de la région Centre-Val de Loire, inutile de préciser que je demeure une aficionada des châteaux de la Loire depuis ma plus tendre enfance. Je me souviendrai toujours de ses visites qui ont marqué mon imaginaire d’exploratrice, et qui ont été la porte d’entrée vers cette passion pour le patrimoine culturel. Comment ne pas oublier ce majestueux édifice qu’est le Château de Chambord ? Les somptueux jardins de Villandry qui forment des tableaux colorés de verdure ? Ou encore le Château des Dames,plus connu sous le nom de Chenonceau, qui m’a impressionnée par la richesse de ses collections ?
Mais il en est un plus discret face aux bâtisses les plus renommées dela région, et qui pourtant, demeure de loin mon favori :Azay-le-Rideau. Je ne saurais me rappeler l’âge exact auquel je l’ai découvert pour la première fois, mais je me souviens de la somptueuse vue depuis la façade Sud magnifiée par son miroir d’eau. Une véritable révélation, semblable à la description qu’en a fait Honoré de Balzac dans son roman Le Lys dans la vallée, où il le compare à « un diamant taillé à facettes sertis par l’Indre ».
La façade Sud du château d’Azay-le-Rideau © Joanna Labussière
Il est fort probable qu’une majeure partie d’entre vous ne le connaisse pas, mais si vous suivez l’actualité de près, il se peut que vous en ayez entendu parler récemment. En effet, le Châteaud’Azay-le-Rideau était sous les feux de la rampe, puisqu’il a bénéficié d’un important programme de restauration entrepris parle Centre des Monuments Nationaux durant presque trois ans. Au total : huit millions d’euros ont été investis dans ce chantier de mise en valeur et de restauration.
Autant vous dire que lorsque j’ai appris le jour de mes vingt-six printemps que j’allais prendre mes fonctions au sein de ce monument, je n’en revenais pas. Je crois même qu’à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai encore du mal à m’en rendre compte.Mais passons ! Le jour de ma prise de poste, quelle ne fut pas ma surprise de revoir ce château qui m’était si cher restauré àla perfection ; le soleil de ce début d’automne se reflétant dans la blancheur de la pierre de Tuffeau si caractéristique de l’architecture régionale.
C’est un château comme neuf que je (re)découvre : rénovation du parc romantique du milieu du XIXème siècle, façade extérieure entièrement restaurée, intérieur remeublé en son état historique. En tant qu’apprentie chargée de médiation culturelle,j’étais d’autant plus intéressée par la refonte du parcours de visite, et plus particulièrement par ce qui se tramait au premier étage. Je remarque alors avec étonnement que plusieurs pièces sont parsemées d’œuvres contemporaines, faisant du château un palais enchanté où se mêlent mythologie, magie et théâtre. Mais avant de vous en dire davantage, une petite explication s’impose !
Tout est parti du Centre des Monuments Nationaux qui a fait appel aux artistes plasticiens Piet.sO et Peter Keene pour concevoir un parcours d’installations oniriques destinées à être exposées au sein du monument. Le duo collabore ensemble depuis seize ans déjà,et parmi les six créations, cinq ont été spécifiquement conçues pour Azay-le-Rideau. Un an aura été nécessaire à la réalisation des esquisses de chaque installation, puis sept mois de conception.
Intitulé« Les enchantements d’Azay », ce projet a pris place parmi les collections le 6 juillet 2017, date de réouverture du château suite aux trois années de travaux. Influencés par l’imaginaire de la Renaissance, les artistes se sont notamment inspirés des personnages d’Armide et de Psyché, toutes deux représentées dans les tapisseries des chambres situées au premier étage : La Jérusalem Délivrée et l’Histoire de Psyché. Tel un hommage aux artifices des arts du spectacle de l’époque où se côtoient installations féeriques et objets fantastiques, ces enchantements envoûtent à différents niveaux antichambres, chambres et salle de bal du premier étage. La magie opère dès lors que les visiteurs passent à proximité, puisque les installations se déclenchent à leur passage. Certaines œuvres sont accompagnées de fonds sonores. Si vous-même, chers lecteurs et chères lectrices, êtes tentés par cette expérience surprenante,suivez le guide !
Si l’on suit le parcours de visite classique, notre déambulation nous mènera en premier lieu dans la grande salle. Lieu de réception par excellence, c’est dans cette partie publique que le maître de maison recevait pour ses affaires ainsi que pour son plaisir en organisant bals et festins. A notre arrivée, trois installations monumentales font face à la cheminée. Au centre trône un imposant banquet, entouré de part et d’autre par un automate (un officie rsur la gauche et une magicienne sur la droite). Ces installations s’animent au fur et à mesure : la magicienne et l’officier tournent sur eux-mêmes, tels les annonciateurs d’un banquet fantastique qui s’ouvre avec des panneaux se levant sur la table.Inspirés par les festins sorciers, Piet.sO et Peter Keene puisent également leurs influences dans l’art cinématographique.Références entre autres au grand banquet dans La belle et la bête de Jean Cocteau (1946), ou encore aux fêtes données dans les jardins dans Vatel de Roland Joffé (2000). Le festin fait aussi écho au palais d’Eros dans lequel Psyché est servie par des esprits bienveillants. Enfin, la mise en scène volontaire des animaux renvoie à la cuisine de la Renaissance, époque où l’on présentait autant la tête que le corps de l’animal.
Le banquet © Léonard De Serres
La visite se poursuit en pénétrant dans la Chambre de Psyché.Autrefois chambre du maître de maison, elle était sûrement destinée à Gilles Berthelot, commanditaire du château d’Azay-le-Rideau. Cette pièce s’apparentait à un espace multifonctionnel où l’on se reposait autant que l’on travaillait et recevait. Face aux trois tapisseries qui habillent les murs, se dresse un automate tournant sur lui-même, portant une lanterne et vêtu d’une robe décorée de miroirs. Il s’agit d’une mise en scène de Psyché, symbolisée par la robe aux miroirs, référence au miroir du personnage, tel un écho au labyrinthe proposant plusieurs destinations. Elle semble observer les tapisseries murales qui relatent son histoire. Sorte de quête initiatique, les miroirs servent à éclairer une partie de son vécu, tout en lui indiquant le chemin à suivre. La lanterne éclairée lui sert également de guide afin de l’aider à retrouver son chemin.
La robe aux miroirs © Léonard De Serres
Jouxtant la Chambre de Psyché, la garde-robe est métamorphosée en « Cabinet des petits prodiges » au sein duquel automates, miroir et mondes miniatures se transforment grâce à des effets d’illusion.Trois mécanismes y sont disposés et se mettent en mouvement les uns à la suite des autres : tout d’abord, deux mécanismes en horlogerie fine, puis un miroir représentant des papillons. Bien que celui-ci ne soit pas éclairé, il est tout de même possible d’observer les papillons flotter au travers. Ici, Piet.sO et PeterKeene ont choisi Armide comme source d’inspiration, personnage capable de changer les petits projets en palais.
Cabinet des petits prodiges © Léonard De Serres
La déambulation se poursuit dans la chambre Renaissance, qui était probablement la chambre de Philippe Lesbahy, l’épouse de Gilles Berthelot. C’est dans le secrétaire, cabinet de retrait de la chambre qu’est exposé un « Livre aux grotesques »,conférant une apparence féerique à la pièce. Réalisé en papier de jonc, il laisse apparaître des ombres de créatures chimériques de par sa forme et les jeux de lumière. Le jonc fait écho aux murs de la chambre de Philippe Lesbahy restaurée en 2013, qui sont recouverts de nattes de jonc. Cette technique de tressage manuel était d’usage au XVIème siècle, car elle permettait d’isoler la pièce par temps froid, et de conserver la fraîcheur en cas de températures élevées.
Livre aux grotesques © Léonard De Serres
Passons à présent à l’antichambre précédant les appartements du roi,où patientaient les visiteurs avant d’être reçus. Ici, le baroque prend tout son sens, avec un théâtre animé faisant apparaître et disparaître plusieurs animations et décors à l’aide de jeux de ficelles, ou encore de poulies. L’aspect brut véhiculé par la boîte réalisée en bois de frêne renvoie à la Renaissance,où le rideau n’existait pas pour la représentation du petit théâtre. Celui-ci fera son apparition au XVIIème siècle avec des rideaux bleus pour symboliser la couleur royale, puis les rideaux rouges sous Napoléon. L’emploi de la ficelle dans les décors était courant à la Renaissance ainsi qu’au XVIIème siècle, avec une scénographie conçue à partir de décors suspendus. Encore une fois, le duo d’artistes a choisi Armide comme référence principale, à travers ce théâtre animé, où trois à quatre décors suspendus apparaissent au fur et à mesure pour raconter une histoire.
Le petit palais d’Armide © Léonard De Serres
Détail du petit palais d’Armide © Léonard De Serres
Pour conclure, direction la chambre du roi, baptisée ainsi en souvenir des quelques jours passés par le roi Louis XIII à Azay-le-Rideau en juin 1619. On y découvre un cabinet « automate », seule installation qui n’a pas été créée spécifiquement pour Azay-le-Rideau. Intitulée « L’entrée ouverte au palais fermé du roi », ce palais-théâtre motorisé a été conçu dans le cadre de l’exposition « Les Chambres des Merveilles »qui s’est tenu au Château-Maisons de Maisons-Laffitte d’octobre 2015 à juin 2016. Dans l’esprit des meubles à secrets, le visiteur s’approche et découvre un théâtre qui s’ouvre où apparaît la reine d’un côté et le roi de l’autre. Surgit ensuite une forêt envahissant un palais qui prend forme petit à petit, avant de conclure par l’ouverture d’un grand tiroir symbolisant un vide poche qui contient des objets d’époque, voire plus contemporains. L’utilisation de l’ébène pour la réalisation du meuble fait référence à l’impact crée par l’arrivée du mobilier au XVIIème siècle.
L’entrée ouverte au palais fermé du roi © Léonard De Serres
C’est quasiment envoûtée que je ressors de cette déambulation originale qui m’a permis de poser un tout autre regard sur les collections du château. J’ai été littéralement charmée par cette œuvre à quatre mains, qui réunit l’impact de la mémoire et la place du corps chez Piet.sO, ainsi que l’exploration de l’utopie et les installations mécaniques et sonores chères à Peter Keene.Redevenue exploratrice dans l’âme, j’ai retrouvé le temps de quelques heures cette curiosité enfantine qui rythmait mes toutes premières visites.
Offrir une nouvelle vision de la Renaissance à travers l’installation d’œuvres contemporaines qui s’intègrent dans les salles du château : tel est l’objectif de ces enchantements. Mission réussie pour les deux artistes qui donnent à voir un aspect décalé des collections, tout en restant cohérent avec les œuvres originales. Banquet animé, meubles à secrets, mondes miniatures et robes immenses : en misant sur l’imaginaire à travers l’automate, cette expérience de visite inédite invite le visiteur dans un parcours féerique où la magie produit son effet.
Joanna Labussière
#azaylerideau
#pietsOetpeterkeene
#installationsoniriques
Pour en savoir plus :
-Sur le château d’Azay-le-Rideau :http://www.azay-le-rideau.fr/
-Sur l’exposition « Les enchantements d’Azay » :http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-enchantements-d-Azay
-Sur le travail des plasticiens Piet.sO et Peter Keene :http://www.pietso.fr/,http://www.peter-keene.com/home.html
-Petit tour d’horizon des « Enchantements d’Azay »guidé par l’artiste Piet.sO :https://www.youtube.com/watch?v=tILcUSMAg_Y

Bienvenue dans le monde de l'ingénierie culturelle
Projet opérationnel, programmatique, AMO, pré-programme fonctionnel ou muséographique, étude d'opportunité, de faisabilité, diagnostic, appels d’offres, dimensionnement… tututu je vous arrête tout de suite! Ce n’est pas de l'ingénierie informatique ou du codage mais bien du jargon d'ingénierie culturelle. Alors embarquez dans cet univers.
Je suis en expédition au sein de l’agence DECALOG dans une ville bordée de montagnes aux neiges éternelles, à Grenoble. J’ai parcouru 774,4 km pour rejoindre cette entreprise, une agence d'ingénierie culturelle et touristique qui compte à son actif une multitude de projets qu’elle accompagne, de l’étude d’opportunité (le projet est-il pertinent?) à l’étude de faisabilité (est-ce possible?) jusqu’à la programmation muséographique et quelques fois scénographique. L'ingénierie culturelle, un oxymore dissonant qui m’était jusqu’ici inconnu.
Dans ce vaste paysage ingénieurial, je suis chargée d'assister et d’aider au mieux les chargé.es de projet à toutes les phases possibles de conception et de réalisation d’un projet. J’accompagne majoritairement deux projets de muséographie. Sur une rive, la Galerie Eurêka, lieu de vulgarisation scientifique dont l’objet est la montagne de Chambéry. Les dispositifs doivent être repensés et développés jusqu’à la rédaction des fiches muséographiques. Sur l’autre rive, le Musée de l'épopée des amazones et des rois du Danhomè qui ouvrira au Bénin dans plusieurs années pour lequel j’ai une mission bien précise de rédaction de certains niveaux de textes dans une partie du projet. Il m’a fallu donc assimiler l’envergure et les phases du projet, m’en faire une certaine culture, des sciences à l’histoire. Enfin, d’autres sentiers me permettent de voir certains aspects de la méthodologie de projets : réunions avec des commanditaires, des élus, les phases de diagnostic et les phases embryonnaires de réflexion autour d’un appel d'offres...
Petits, petits, petits … grands, grands, grands
Ce qui étonne dans cette contrée, c’est le passage d’un tout petit sentier bordé de jonquilles pour se retrouver la colline d’après dans une jungle humide de l’Amazonie. Une gymnastique intellectuelle incroyable inhérente à ce type d’entreprises qui navigue entre petits projets et énormes projets, qui ne nécessitent pas du tout le même type de gestion. Je vous épargne donc les parchemins Excel interminables reprenant les budgets ou tous les dispositifs présents dans l’exposition.
C’est aussi une course contre la montre car dans cette aventure pas question de se faire rattraper par les insectes qui grouillent (le temps, les charges..) il faut speeder! Il faut donc être capable de fournir des solutions à des problèmes pragmatiques et techniques mais aussi être capable de mettre en forme des idées plus rapidement que la vitesse de la lumière. Pas de panique! Les grands Jédi sont là pour guider l’expédition : nous ne sommes pas seuls, il faut coopérer avec tous les acteurs qui garantissent la sortie de terre du projet et cette coordination nécessite beaucoup de retours de mails, d’échanges et de négociations.
La muséographie, grande quête de l’aventure
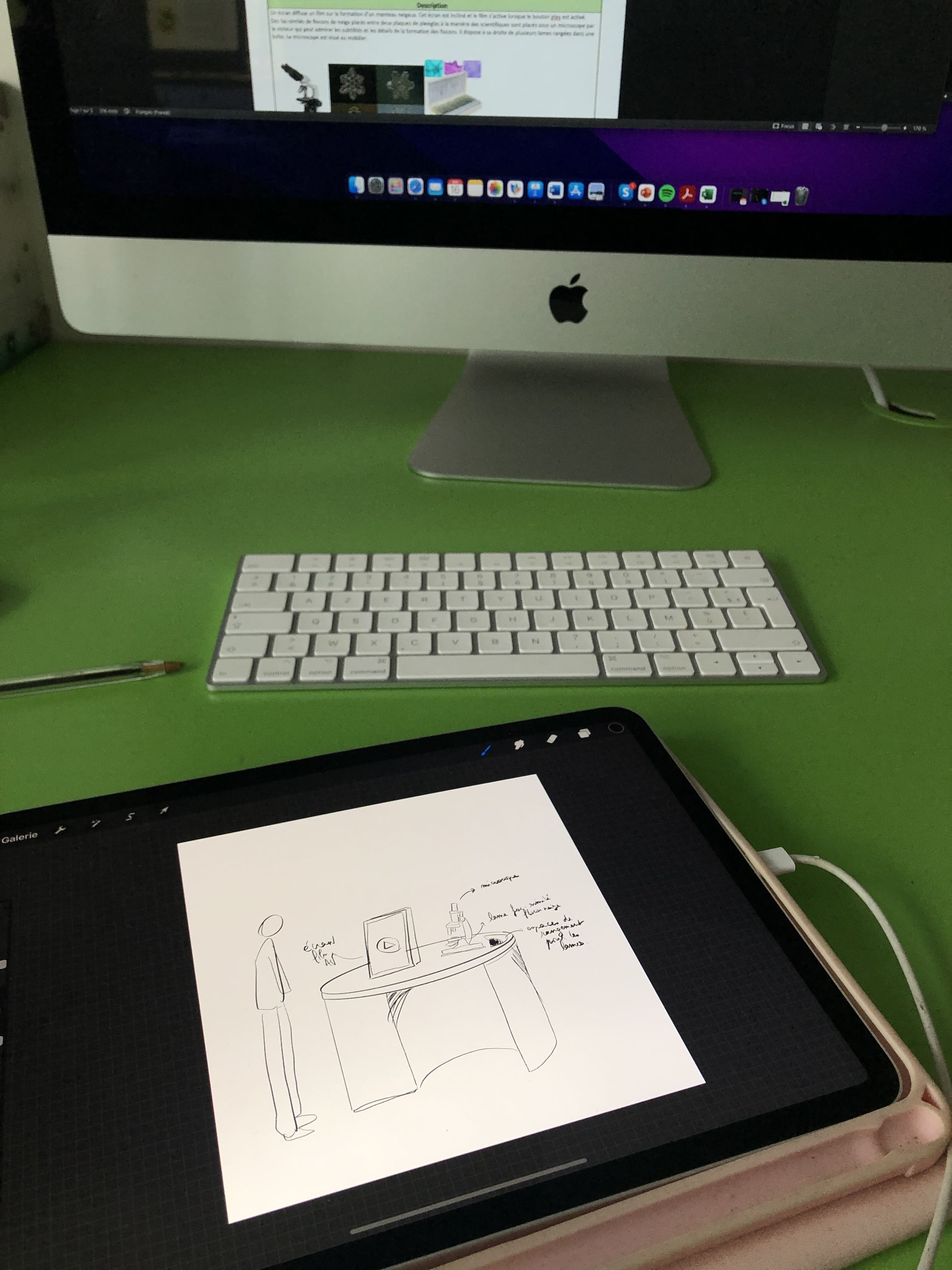
Mon bureau © EA
Si il y a bien un magot que l’on trouve difficilement sur la carte, c’est la muséographie! Espèce cachée parmi les arbres ou dissimulée au fond des eaux, c’est une grande quête. La muséographie semble disparaître au profit de la gestion de projet qui grignote toujours plus de place aux yeux de la maîtrise d’ouvrage. J’observe que c’est souvent un long processus de pédagogie et d’explication pour faire entendre que la muséographie n’est ni la scénographie, ni la méthodologie mais bien l’essence de ce que l’on va raconter, faire expérimenter au futur visiteur de l’institution. Comment vendre cet immatériel, c’est bien la question. Elle est pourtant bien présente au sein de mes missions de tous les jours et les habiletés auxquelles elle fait appel sont autant de créativité, de rigueur, et de souci du détail.
Merci de m’avoir suivie jusque-là, je dois rejoindre le Bénin, euh… vous n’auriez pas vu ma boussole ?
Eva Augustine
Liens :
#ingénierie #breve de stage #culture
Brève de stage : Dans la ville. Architecture et "cartels ambulants"
En première année du Master Expo-Muséographie j’ai effectué mon stage à la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes à Lyon. J’y occupais le poste de chargée d’exposition mais participais également aux autres projets de la structure. Par exemple, j’ai eu en charge de rédiger quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole, version 2014. Avant de détailler plus en avant cette mission, voici quelques éléments de contexte…

Crédits : Archipel CDCU
En perpétuelle transformation, les villes se sont construites au fil des siècles et recèlent de vrais trésors d’architecture. Les édifices composent notre cadre de vie et définissent nos modes d’habiter, de se déplacer, voire nos rapports sociaux. Chaque ville possède son caractère et tire une partie de son identité dans son architecture. Ou plutôt ses architectures, puisque de la période antique à nos jours en passant par la Renaissance, des milliers d’édifices se juxtaposent et interagissent entre eux. Ils forment une collection impressionnante racontant l’histoire des villes comme celle des hommes. De véritables musées à ciel ouvert… Si les musées possèdent leurs propres outils de médiation, qu’en est-il pour les villes ?
Il existe des lieux comme les Maisons de l’Architecture qui ont pour vocation de sensibiliser les publics à la culture architecturale. Chaque région à sa Maison de l’Architecture, chacune organise des expositions, des conférences, des ateliers afin de diffuser le plus largement possible et sous différents modes, les savoirs et les enjeux actuels de l’architecture.
La Maison de l’Architecture Rhône-Alpes, aussi appelée Archipel Centre de Culture Urbaine, offre aux publics plusieurs formes de médiation, susceptibles de parler au plus grand nombre. Elle est située place des Terreaux, en plein centre de Lyon, on peut notamment y admirer la maquette au 1/1000° de la ville de Lyon. Actuellement, Archipel met à l’honneur les meilleurs Projets de Fin d'Etudes 2013 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon à travers l'exposition Futur Architecte. Si maquette et photographie sont des outils de médiation incontournables lorsqu’on parle d’architecture, il en existe un autre : le texte.
Logements, quartier Confluence E. Colboc, architecte. ©www.emanuelle-colboc.com
Lors de mon stage, j’ai donc eu en charge la rédaction de quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole. Cette application, présente les constructions du XXèmeet XXIème siècle du Grand Lyon. Véritables « cartels ambulants » les notices jouent donc le même rôle que les cartels de musée : donner des informations sur « l’objet » que l’on a en face de soi. Ainsi le promeneur-visiteur peut déambuler au gré de ses envies à travers la ville contemporaine et se constituer un parcours inédit dans cette riche collection. La plupart de sédifices dont j’ai rédigé les notices se situent dans le nouveau quartier Confluence, comme le groupe scolaire Germaine Tillion.
Voici un exemple de notice :
Groupe Scolaire Germaine Tillion
Rue Casimir Périer, rue Denuzière 69002 Lyon
Livraison : 2013
Architectes : Bernard Garbit & Jean-Pierre Blondeau
Maître d’ouvrage : Ville de Lyon
Groupe scolaire Germaine Tillion - Garbit et Blondeau architectes ©www.pss-archi.eu
L’écriture de ces cartels n’est pas chose aisée…Délivrer un message clair avec un maximum d’informations et ce, avec peu de mots (600 signes), relève du défi ! Mais tout l’intérêt est bien là. Il s’agit de transmettre un message court comportant les informations essentielles concernant l’édifice. La consigne est d’être le plus neutre possible, le lecteur n’a que faire de mon propre ressenti… Attirer son attention sur un détail d’architecture, sur la position urbaine du bâtiment, sur les matériaux de construction sont autant de manières de parler de l’édifice, et par là même, d’architecture au sens large. C’est donc important de bien choisir ses mots, et de bien construire son discours.
Ainsi, cette première expérience d’écriture est-elle très formatrice et également très agréable. En effet, se promener dans les rues de Lyon, à la découverte de ces nouvelles présences architecturales dans la collection architecturale de la ville Rhodanienne, est un réel délice.
CI
Pour en savoir plus :- Lien vers le site d'Archipel CDCU- L'application Archiguide-Lyon
#archipelcdcu
#architecturecontemporaine
#cartel

Ça déménage !
Petits ou grands à l’instar du Louvre, seul ou à plusieurs comme à Bourges, en France ou à l’étranger tel le muséum de Neuchâtel : plusieurs musées se sont lancés ces dernières années l’ambitieux défi de déménager tout ou partie de leurs collections. Pourquoi ? À cause d’un manque de place dans les infrastructures d’origine, d’une nécessité de mutualiser des espaces afin de réduire certains coûts ou encore afin de garantir une conservation optimisée des collections. Alors on sort les cartons et le papier bulle et on s’y met ? Pas si vite...Au musée comme à la maison, un déménagement nécessite un endroit approprié où atterrir, des moyens humains et financiers ainsi qu’une bonne dose d’organisation. Car si certain.e.s profitent d’un déménagement pour réagencer la disposition des meubles du salon, les nouvelles réserves, elles, doivent pouvoir accueillir les collections dépoussiérées, étiquetées et classées dans un ordre bien précis. Pour cela de nombreuses étapes et différents outils sont pensés afin de faciliter le déroulé de cette phase importante dans la vie d’un musée.
Camion du muséum permettant le déplacement des équipes. Derrière, le congélateur.
L’exemple du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel en Suisse.

Diorama de la collection permanente
Il comporte une riche collection de dioramas, fortement inspirés des œuvres des peintres naturalistes Léo-Paul Robert (1851-1923) et son fils Paul-André Robert (1901-1977). Cette technique de mise en scène, très appréciée dès les années cinquante, permet de présenter des animaux dans leurs environnements naturels et leurs milieux de vie. Mais seule une infime partie des spécimens abrités par le musée est exposée.
Au total, on recense plus de 20 000 oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et poissons mais aussi 8 642 coquilles d’œuf, 1 veau à deux têtes, 32 366 mouches et bien d’autres choses. Plus précieux encore d’un point de vue scientifique, trois cents spécimens ayant servi à la description d’espèces sont conservés. On les appelle des « types » et ils restent encore aujourd'hui des références à l’échelle mondiale pour les professionnels de la biologie et de l’histoire naturelle. Par ailleurs, certains animaux appartiennent à des espèces disparues comme le Grand Pingouin ou le Thylacine. On comprend dès lors la volonté du muséum d’apporter un soin particulier à ses collections et de les conserver dignement tout en les gardant accessibles pour la recherche.
1, 2, 3...déménagements !
Installé à son origine dans le collège latin puis dans une ancienne École de Commerce depuis presque 50 ans, le muséum n’en est pas à son coup d’essai en matière de migration des collections. L’année 1982 avait déjà marqué certains esprits puisque le musée, fidèle à sa thématique, avait adopté la méthode « fourmi ». La légende dit que, mobilisant l’école secondaire voisine, chaque élève s’était vu confier le transport d’un spécimen de petite taiIle, acheminé à pied jusqu’au nouveau musée à trois cents mètres de là, créant une joyeuse file indienne. Un procédé écologique et farfelu que l’institution n’a pas souhaité remettre en place cette fois-ci.
Aujourd’hui, les réserves situées au sein du bâtiment ne permettent plus d'assurer de bonnes conditions de conservation. En effet la place se fait rare et les fluctuations de
températures et d’humidité relative, surveillées de près en conservation préventive, ne correspondent pas aux normes climatiques souhaitées. Heureusement, un important
chantier a été mis en place afin d’assurer le transfert de tout ce monde dans un nouveau lieu appelé le pôle muséal. Celui-ci, dont la a construction s’est achevée en 2022, est géré par la ville de Neuchâtel. Le lieu abrite également les réserves du musée d’ethnographie, du jardin botanique, du musée d’art et d’histoire ainsi que les archives de la ville. Le muséum y dispose d’une salle pour les spécimens en alcool, une salle oiseaux, deux salles mammifères, une salle géologie, une salle insectes, un espace pour le travail sur les collections, etc. Les équipes se rendent d’ailleurs chaque début de semaine sur site, épaulés par des déménageurs spécialisés en transport d’œuvres d’art. Jour de fermeture de l’institution au public, le lundi est en effet un moment privilégié pour effectuer des transferts.

Collection d’oiseaux dans les anciennes réserves.
Au matin, les caisses qu’il contient en sont extraites après avoir passé une semaine à -35 degrés. De quoi permettre aux spécimens ayant bénéficier de ce traitement rafraichissant de se débarrasser d’éventuelles larves d’insectes cachées entre deux plumes ou poils. Après cela, ils pourront être déplacés en camion afin de découvrir leur
nouveau lieu de vie. Là-bas, les tablars qui permettront de les accueillir ont été montées sur mesure afin qu’aucune tête ne dépasse ou se cogne. Chaque rangée d’étagères a également reçu un nom correspondant à sa localisation et à la typologie de spécimens qui s’y trouvera. MAM/B, OIS/ W... Mais comment faire le lien entre ces nouveaux
emplacements et les centaines de caisses qui arrivent ? Revenons un peu en arrière... Initiée il y a déjà plusieurs années, une vaste campagne a permis de faire le point sur
ce que contenait précisément le musée. L’occasion d’attribuer à chaque spécimen un QR code facilitant l’accès aux données le concernant mais aussi de vérifier son état et
de le débarrasser des poussières. À présent, lorsqu’un spécimen se prépare à quitter le musée, il est soigneusement installé dans une caisse ayant au préalable reçu un numéro. Celui-ci est reporté dans un tableau à côté des numéros d’inventaire et des anciennes positions de chaque individu se trouvant dans la caisse. Les intitulés des
anciennes rangées sont également reportés sous le numéro de caisse. Du côté du pôle muséal, un document permet d’associer chaque nouvelle rangée à un ou plusieurs anciens emplacements. Ce jonglage numérique permet de garder de l’ordre et de ne pas perdre un spécimen en route. C’est ce que l’on appelle l’adressage.

Collection d’oiseaux en cours de déménagement.
Le carnet de souche, un outil précieux.

Vérification des conditions climatiques au pôle muséal.
Ce nouveau voyage vient désormais s’inscrire dans l’histoire de chaque spécimen déplacé. Au même titre que sa date d’acquisition, sa provenance, son âge, le nom de son espèce ou de sa famille, cette information est documentée. Le but est d’assurer un suivi et d’en garder trace pour les décennies à venir. Chaque étape (mise en caisse, congélation, transport) est donc soigneusement inscrite dans un document papier appelé carnet de souche dont chaque page est ensuite scannée et dont les informations sont retranscrites dans une version numérique au fur et à mesure du déménagement. Ces différentes sauvegardes permettent une très grande traçabilité des collections et sont facilement accessibles pour toute l’équipe. Cela permet également de rendre visible l’avancée du déménagement, même auprès de celleux qui n’y participent pas. Celia Bueno, conservatrice et adjointe de direction mais également coordinatrice du déménagement peut ainsi se faire une joie de partager avec les collaborateurs du Muséum, lors des séances hebdomadaires, l'avancée du chantier et le nombre d’unités déménagées. Mais attention aux chiffres ! Certaines petites caisses, appelées rako, peuvent contenir plusieurs dizaines d’oiseaux lorsqu’ils sont de petites tailles et/ou en peaux (c’est à dire non montés sur socles). À l’inverse, un carton de taille imposante ne renferme parfois qu’un seul mammifère de taille plus imposante. Une chose est sûre, le volume du congélateur lui reste le même et ne désemplit pas depuis de nombreux mois.

Singe prêt à être congelé.
L’ensemble de ce processus est donc un travail titanesque. Pour relever le challenge, le muséum peut compter sur l’aide de nombreuses personnes : étudiant.e.s, stagiaires,
civilistes, conservateur.ice.s mais aussi l'association des amis du musée dont plusieurs membres se proposent comme bénévoles dans le cadre de ce projet. Grâce à toutes ces petites mains, fourmis 2.0, la vie du Muséum peut continuer en parallèle, proposant des expositions temporaires, permanentes, itinérantes, des actions culturelles et bien d’autres surprises !
Je remercie tou.te.s les collaborateur.ice.s du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel pour leur accueil chaleureux et mon intégration, en tant que stagiaire, à ce projet de déménagement.
SP
Crédit photos : Sasha Pascual
Pour plus d’informations sur le muséum : https://museum-neuchatel.ch/
À propos des dioramas (re)lisez l’article de l’Art de Muser : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2271-la-vraie-fausse-nature-des-dioramas
|
#déménagementdescollections #museum #conservationpreventive |

Ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens au Musée de Bretagne
Très chère petite sœur,
Je t'écris car je sais que tu es intriguée par mon stage au Musée de Bretagne. Déjà, sache que c'est ma première longue expérience dans un musée et que j’en suis ravie. J’ai conscience que cela ne t’est pas familier, aussi je vais tout t’expliquer.
Pour commencer, le Musée de Bretagne est un musée ethnographique, ses collections sont des objets permettant de retracer la vie sur le territoire breton. De la Préhistoire à aujourd’hui, il y a des objets du quotidien à travers le temps, ainsi que des objets relatifs à l’agriculture ou aux guerres. Il a pour objectif de faire (re)découvrir l’histoire de ces terres bretonnes à ses habitants.
Le musée présente ses collections dans une exposition permanente : Bretagne est Univers. Ce titre d’exposition vient d’un poème de Saint-Pol-Roux à la fois centré sur la Bretagne et ouvert sur le monde. En voici une strophe que j’apprécie tout particulièrement, elle me ramène à la Bretagne mystérieuse :
Strophe VI
J’ai l’opportunité de consacrer certaines de mes après-midis au sein de l’exposition, où travaille le personnel, dont les médiateur/rices et les agents de sécurité. Je travaille en grande partie dans cet espace que j’ai appris au fil des premières semaines à apprivoiser car c’est un long parcours de 2000 m2. J’ai plusieurs missions au musée. La plus importante, c’est d’aller à la rencontre des visiteur/ses afin de savoir ce qu’ils pensent de l’exposition. Je réalise ainsi des entretiens à la fin de leur visite. J’apprends à établir ce contact, fragile et fugitif, aboutissant sur une rencontre unique. C’est très enrichissant de pouvoir échanger avec les visiteur/ses parce que cela met des mots sur des objectifs fixés. Lorsqu’une exposition est construite, on pense au visiteur/se afin que tous les éléments lui soient clairs. Souvent, une fois l’exposition ouverte, une enquête est menée et on cherchera à savoir ce que pense le public. Puis l’exposition vit et le public continue de la fréquenter. Ce que je fais va permettre de se redemander quels sont les avis des visiteur/ses aujourd’hui. Qu’ont-ils vu ? Qu’ont-ils ressenti ? Je découvre leurs points de vue, parfois surprenants, souvent rassurants. Il est captivant de comprendre que la Bretagne réunit autant de passionnés et de curieux. Il y a une véritable identité et le public parvient à faire du lien avec son vécu et ce qui est présenté dans l’exposition. Echanger avec les visiteurs permet aussi de les connaître : qui sont-ils et pourquoi viennent-ils ? Toutes ces rencontres sont une opportunité pour le musée de revoir l’exposition sous un nouvel angle. En effet, comme tout évolue rapidement : les modes de visite sont par exemple influencés par le développement des technologies, il semble alors important de chercher à réévaluer les envies des visiteurs quant au contenu et au discours de l’exposition pour leur proposer une visite de qualité.
Entre deux entretiens, je déambule à mon tour dans les espaces rendus vivants par l’ensemble de sons diffusés. Tous ces objets figés, en attente de contemplation, de regards, d’attention, ont été soigneusement positionnés il y a déjà une dizaine d’années. Et pendant que les êtres, eux-mêmes qui ont créé, porté, utilisé ces objets sont toujours plus en mouvement, ces objets sont présentés sous leur plus beau jour les uns par rapport aux autres. C’est ce que les primo-visiteurs, ceux qui viennent pour la première fois, trouvent « moderne » ou « contemporain ».
Il est fascinant de travailler dans ces espaces âgés de treize ans ayant vécu quelques modifications mais apparaissant aux yeux de ses explorateurs comme presque neufs. Peut-être que l’architecte et le scénographe avaient consulté Merlin l’Enchanteur.
Pour faire vivre cette exposition permanente, elle est alimentée grâce aux expositions temporaires qui croisent des éléments communs aux collections. En ce moment, l’exposition temporaire Rennes, les vies d’une ville peut trouver des résonnances dans le permanent, cela est notamment fait grâce à des visites spécifiques.
Ce qui est certain, c’est que dans ce lieu où chaque objet semble se montrer malicieusement à celui qui le regarde, je me forme et j’apprends de toutes ces petits moments tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis comme un arbre : aujourd’hui mes racines sont bien ancrées et le tronc se développe peu à peu. Plus je découvre et m'émerveille du monde muséal, plus cela me devient familier et me donne envie de grandir et de me déployer.
Tu sais maintenant ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens au Musée de Bretagne. J’espère t’avoir éclairée et peut-être que de bienveillants korrigans t’amèneront jusqu’au musée.
Avec tendresse,
Ta grande sœur.
L.L.
#Brèvedestage
#Enquêtepublics
#MuséedeBretagne
Si tu es curieuse : https://www.musee-bretagne.fr
Quelques croquis et photographies :
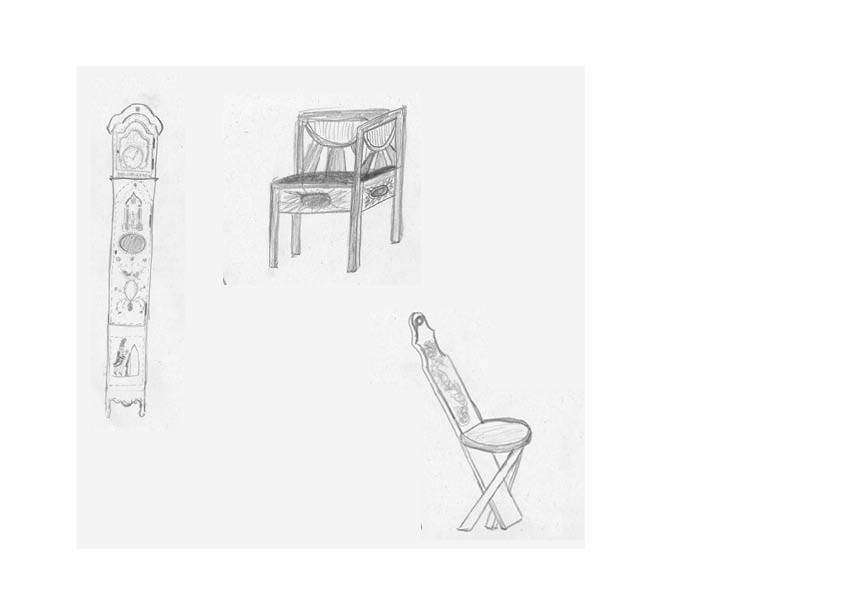
Meubles croqués dans l’espace d’exposition © L.L.
Espace d’exposition, Du 19e siècle à nos jours © L.L.
Espace d’exposition, vitrine S’habiller en Bretagne © L.L.

Chargé de communication : un aperçu du métier
En première année de Master Expo-Muséographie, j'ai eu le chance de réaliser mon stage au sein du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, en Suisse.
Crédits : A.G.
En première année de Master Expo-Muséographie, j'ai eu le chance de réaliser mon stage au sein du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, en Suisse. Ma première mission était de mettre en place l'exposition du travail pratique d'ethnomuséographie avec les étudiants de l'institut d'ethnologie. Ce TP propose tous les deux ans la possibilité de monter une exposition temporaire dans une partie du MEN : « la fosse ». Cette année, les stagiaires du musée ont étés invités à concrétiser ce projet. Je fus donc amenée à intégrer l'équipe, qui était constituée de 7 stagiaires -étudiants et d'un conservateur, Bernard Knodel. Durant plusieurs mois, nous avons donc établi le discours muséographique, la scénographie, le graphisme, etc. Cet exercice nous a ainsi permis d'avoir des missions plurielles. Pour ma part je me suis également chargé de l'aspect communication de l’exposition. Du graphisme, de l’affiche au dossier de presse, des réseaux sociaux aux articles de presse, j'ai ainsi découvert le métier de chargée de communication.
L'exposition : Home sweet home
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) et l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel se sont associés pour présenter, dans le cadre des manifestations de Neuchàtoi 2013,une exposition conçue par les étudiants du travail pratique d’ethnomuséographie et les stagiaires du MEN.
Inaugurée le 13 juin 2013, l’exposition a été présentée au musée jusqu'au 1er décembre 2013.
Home sweet home propose une réflexion basée sur le travail de la journaliste Valérie Kernen Vivre ici en venant d’ailleurs.L’exposition s’appuie sur plus de 120 témoignages récoltés auprès de migrants – de plus de 100 nationalités différentes –illustrant la diversité de la communauté étrangère neuchâteloise.

Crédits : A.G.
Dans un espace d’un blanc aseptisé et neutre - deux clichés communément attribués au home sweet homesuisse - le visiteur est invité à explorer des thématiques universelles récurrentes dans ces récits de vie. En résonance avec les citations apposées sur les murs, six installations mettent en perspective ces thématiques autour d’éléments mobiliers, réduits au rang de signes par leur blancheur, et servant de supports ou de vitrines aux artefacts des collections muséales. Un chariot à bagages matérialise ainsi l’idée de déplacement ; un lit conjugal évoque la famille et le couple ; un bureau symbolise le travail ; une cabine téléphonique fait allusion à la communication ; un lave-linge renvoie à l’apparence vestimentaire et physique ; et enfin un autel fait référence aux croyances.
Confrontant la « suissitude » à l’altérité extrême et le local au global, les tensions nées de la mise en relation des objets exposés amènent à renverser les perspectives spatiales et temporelles liées à la perception de l’autre. Loin des récupérations politiques, des réponses partisanes et des jugements à l’emporte-pièce trop souvent générés par ce sujet de société qu’est la migration, il s’agit plutôt de révéler la complexité de ces problématiques en suscitant une réflexion sur les rapports entre les cultures à l’ère de la globalisation.
Ma mission de chargée de communication

Vernissage de Home sweet home, Crédits : A.G.
Pour reprendre l'ordre chronologique des tâches, et d'après mes compétences, je me suis proposée de réaliser le graphisme de l'exposition et par extension de me charger de l'aspect diffusion.Que communiquer ? A qui ? Combien d'invitations ? Combien d'affiches ? En s'appuyant sur les anciennes expositions de petite envergure, j'ai établi un planning allant de l'impression des supports visuels à l'organisation de l'inauguration.
Une fois les affiches, flyers et invitations finalisés, imprimés et diffusés aux différents contacts, donnés par le musée et la journaliste Valérie Kernen, j'ai pu me concentrer sur les relations presse : rédaction du dossier de presse et articles, ainsi que des rendez-vous avec les journalistes pour des visites guidées près exposition.
Pour la dernière partie des tâches, en collaboration avec Valérie Kernen et l'équipe de conception, nous avons mis en place une fête multiculturelle, célébrant les dix ans du projet Vivre ici en venant d’ailleurs,pour prolonger l’inauguration de l’exposition. À cette occasion, ont été présents divers groupes de musiques du monde ainsi que des danseuses mauriciennes et africaines.
La réussite d'une exposition, notamment pour une retombée auprès du public, dépend d'une bonne diffusion. Certains grands musées ont la possibilité d'avoir un service communication riche et performant,mais une simple connaissance du territoire et des médias permet d'obtenir une communication efficace. Cette expérience riche en rencontres, m'a permise de découvrir brièvement, le métier de chargé de communication, une activité essentielle dans l’organigramme d'un musée.
Agathe Gadenne
MEN - Musée d'Ethnographie de Neuchâtel
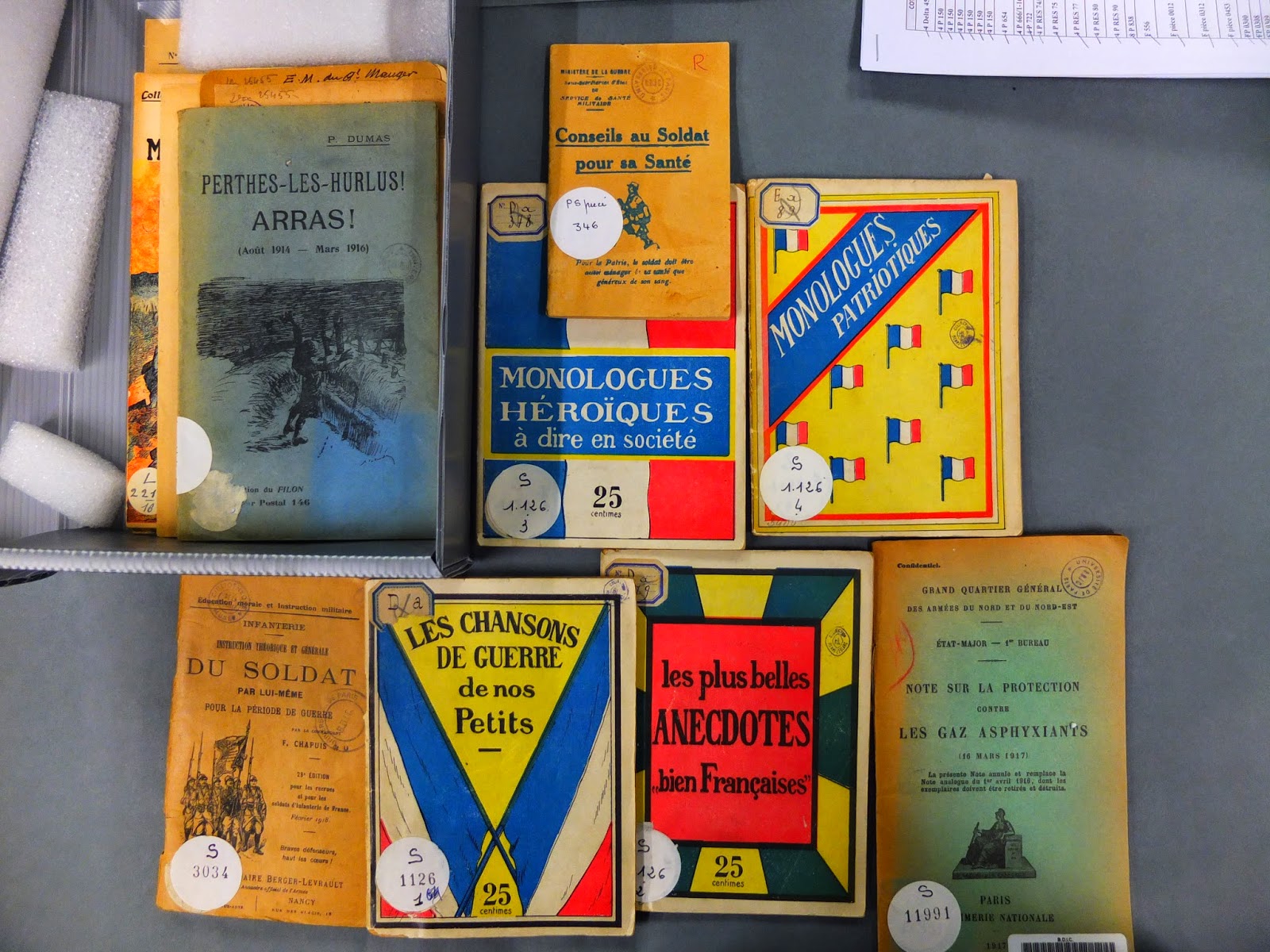
Chaumont Design Graphique : deux étudiantes, un lieu de stage
Nous sommes deux étudiantes de master 1 en stage au Festival Chaumont Design Graphique qui aura lieu du 17 mai au 9 juin 2014 à Chaumont. Cela fait plus d’un mois que notre stage a commencé et à travers ces quelques lignes, nous voulons vous faire partager nos missions déjà effectuées ainsi que les joies et tracas liés à ce type d’évènement !
Un festival international d’art graphique
Chaumont Design Graphique est un évènement majeur dans le domaine de la culture graphique internationale. Depuis 25 ans, le festival s’empare de la ville de Chaumont en investissant divers lieux surtoute la ville. Cet évènement propose chaque année des expositions phares autour desquelles s’articulent de nombreux temps forts proposant des cycles de conférences, tables rondes, workshops, ateliers participatifs pour le jeune public, salon des éditeurs, soirées afin de privilégier des moments de rencontre entre professionnels et festivaliers.
Des missions très diverses
Nos missions au sein du festival s’orientent autour de la conservation, la production d’expositions et la médiation.
Le centenaire bien sûr !
Cette année, une exposition est consacrée au 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918. Elle présente différents visuels et textes de propagande (affiches, réclames) mais aussi cartes postales,lettres de poilus ou tickets de rationnement.
Les œuvres ont été pour la plupart empruntées à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine de Nanterre et aux Archives Départementales. Un constat d’état lors de l’arrivée des œuvres en réserves était donc nécessaire et fut effectué par nos soins. Chaque pièce a été minutieusement observée et analysée afin de rendre compte d’éventuelles altérations dues au transport ou des traces d’usures qui n’auraient pas été remarquées par les institutions prêteuses. C’est seulement après ce constat que les œuvres ont pu rejoindre leur lieu d’exposition en toute sécurité ! Avec l’équipe conservation, nous étions 5 personnes mobilisées pendant cinq jours entiers pour quelques 300 documents.
Une fois les constats effectués, notre mission s’est poursuivie avec le travail d'encadrement de tous les documents iconographiques empruntés. Ce travail de minutie et de patience extrême est une des plus intéressantes étapes en amont de l'accrochage. Nous nous y sentons au plus proches de l'œuvre.
Le concours international autour de l’affiche
Le concours international est un lieu incontournable du festival. Il est ouvert à tous les graphistes professionnels proposant une commande graphique réalisée au cours de sa carrière. Exposées, elles nous offrent un panorama des tendances actuelles du design graphique autour de l'affiche.

© Helmo
Une fois la sélection du jury effectuée, nous avons procédé au référencement de chaque affiche car toutes celles sélectionnées vont rejoindre les collections de Chaumont. Durant la période de préparation, une étape indispensable fût de réaliser le plan d'accrochage : comment penser un plan qui ne se contenterait pas de miser sur une contemplation simplement esthétique car les composantes de l'affiche sont un parti pris à part entière ? L'affiche est aussi sujette à débat, et son contexte comme son histoire peuvent être des arguments à prendre en compte. Si le concours international n'a pas pour but de penser à un discours, une cohérence d'accroche ne peut être négligé, la composition, la technique, la colorimétrie, l’année, l’auteur, le contexte, etc.
Felix Pfäffli, le graphiste aux 1001 affiches
Une autre mission fut de monter l’exposition du graphiste suisse Felix Pfäffli. Celle-ci est très singulière car les esquissesen noir et blanc seront exposées aux Subsistances, un ancien entrepôt militaire de 2000m2 dont les coursives sont ainsi investies. Les productions finies, en technicolor, seront présentées au Havre, dans le cadre du festival Une saison graphique.

© Thi-My Truong
Comment accrocher plus de 500 affiches efficacement avec des contraintes qui sont l’humidité, un sol courbe, des cimaises pas tout à fait régulières ? Pendant trois jours, en présence de l’artiste, nous avons décidé d’un plan d’accrochage des affiches et fait en sorte de toutes les agencer parfaitement !
Ce n’est pas fini …
Ce premier mois et demi de stage nous a rapidement immergées dans l'organisation et le rythme du festival. La date d'ouverture approchant, nos missions sont loin d’être terminées. Du 17 mai au 9 juin, nos missions vont se poursuivre avec la médiation de certaines expositions, médiations dont le contenu est en voie d’achèvement. Cette périodede festival est pour nous le moment de nous consacrer aux médiations mais aussià la mise en place d'ateliers auprès du jeune public : réalisation de tampon, foulard, sérigraphie, etc. Des modules qui permettent aux plus jeunes de s’initier aux pratiques du graphisme.
Cette expérience s'avère très intense et très passionnante. Le poste de chargée d'expositions n'est pas toujours de tout repos : d’une part, savoir anticiper les demandes des graphistes, les accompagner et les conseiller dans leur projet et, d’autre part, pendant les périodes de montage, rattraper les manques de dernières minutes, gérer ses budgets ! Un vrai marathon que ces expositions évènementielles !
Marie Despres & Thi-My Truong
# Festival
# Graphisme
# Centenaire
Pour aller plus loin :http://www.cig-chaumont.com/

Comment faire de la médiation culturelle dans un lieu fermé au public ?
Insensé, impossible, étrange me direz vous !? C’est pourtant l’une des missions qui a rythmé mon année d’apprentissage à la Villa Rohannec’h à Saint-Brieuc.
Avant de livrer mes « secrets » de médiatrice, un peu de contexte historico-politique
La villa est un lieu en semi-friche, ancienne villa d’armateur, datant du début du 20ème siècle, dont le style architectural est directement influencé des riches villas italiennes.
Achetée par le département des côtes d’Armor en 1946, elle est mise à disposition du Ministère de l’agriculture pour y installer une école ménagère. Collège agricole féminin puis lycée agricole mixte la villa devient un établissement d’enseignement public pendant une quarantaine d’année. Le site ferme en 1994 pour cause de vétusté du bâtiment. Le lieu est semi-abandonné jusque dans les années 2010. Il accueille des réfugiés bosniaques en 1995 et une exposition d’art contemporain Extérieurs/Intérieurs en 1999.
Entre 2011 et 2015, la villa fonctionne sous forme de programmation estivale. Chaque été une équipe composée de vacataires se forme le temps de quelques mois. Les usagers s’approprient le site et en deviennent les « habitants ». Les espaces s’aménagent et se transforment au gré des thématiques des saisons culturelles d’année en année. Les visiteurs sont accueillis au rez-de-chaussée, seul espace aux normes.
Une situation malheureusement fragile au regard du fonctionnement départemental.En 2015, un changement de mandature réoriente le devenir de la villa Rohannec’h. Un restaurant panoramique, une maison de retraite ou un bulldozer pour la détruire ? Que faire de cette vieille villa qui tombe en ruine ? Le site est finalement conservé en tant que site culturel.
Depuis 2016 le site se réinvente en fabrique artistique, culturelle et territoriale à travers le soutien à la création contemporaine. Les artistes et étudiants, plasticiens, designers, paysagistes, cinéastes s’approprient les lieux et proposent des créations faisant écho au lieu et à son contexte territorial. L’accueil de ces différents « habitants » éphémère et leur vision du site de Rohannec’h nourrissent le projet culturel.
L’accueil et la co-organisation de Museomix en novembre 2018, permet un tournant dans le projet culturel de la villa, lui permettant d’affirmer de grands axes de travail : accueillir, faire patrimoine commun, soutenir la création, expérimenter et impliquer les usagers.
Projet culturel de la villa Rohannec’h © designed by Justine Faure
Accueillir, impliquer les usagers ? Dans un lieu qui n’ouvre que trois fois par an, accessible uniquement au rez-de-chaussée, seul espace mis aux normes pour l’accueil du public (la villa est composé de 3 étages, d’un toit terrasse et d’un sous sol, le tout équivalent à 1300m²) ?
Le problème ? Comment une équipe de 2 personnes peut-elle être présente sur tous les fronts : communication, médiation, logistique, administratif, accueil,… ? Impossible ! Ces grands axes de travail sont des aspirations de développement du lieu, mais cela reste très complexe.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre le contexte dans lequel j’arrivais en apprentissage.
Visiteurs du parc, collègues, élus, voisins… Personne ne semblait comprendre le lieu, ses idées, son devenir… Je devais donc faire preuve d’ingéniosité pour faire comprendre ce qu’il se passait derrière ces grandes fenêtres sans faire entrer le public ! Le parc de villa étant ouvert au public tous les jours, c’est environ 100 000 milles personnes qui déambulent chaque année.
Alors comment ai-je fait ?
Etape 1 : M’identifier auprès des visiteurs pour établir un dialogue avec eux.
« Cher.e.s curieux.ses, je m’appelle Justine et je serai votre hôte pendant les six prochains mois. Je vous embarque dans la vie de la villa à la découverte des traces laissées par ses habitant.e.s d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et des histoires qu’elles nous racontent. La villa est mon terrain de jeu : entre intérieurs et extérieur, les murs, fenêtres et terrasses seront mes outils pour dialoguer avec vous ! »
Pendant les rares ouvertures de la villa ou lorsque j’étais de passage dans le parc, cela a permis aux visiteurs ayant des connaissances sur l’histoire du lieu ou ayant vécu à la villa, de pouvoir s’identifier auprès de moi. J’ai ainsi commencé une collecte de témoignages oraux. Même en faisant de la médiation sur un lieu fermé, le contact humain reste important !
Etape 2 : Faire parler les façades : supports de dessins et d’anecdotes

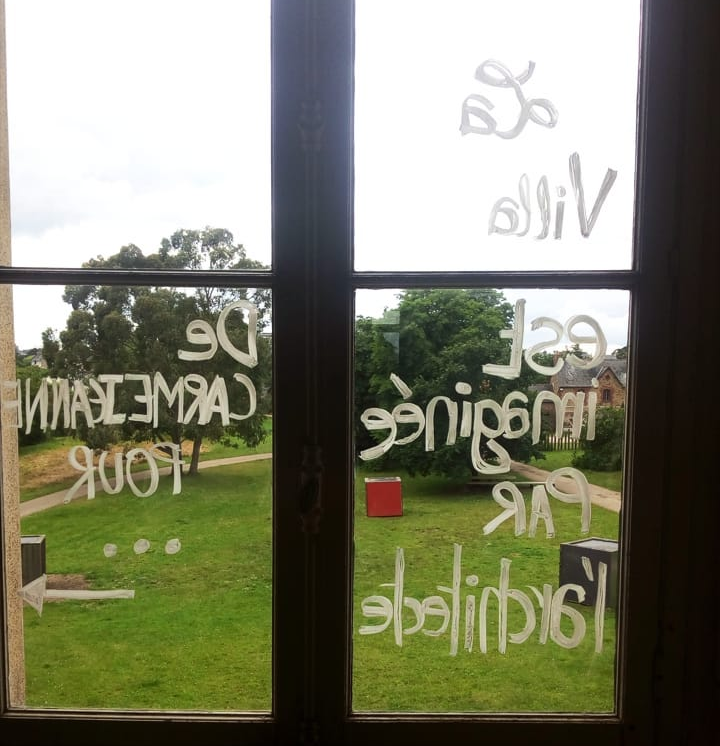
Fenêtres de la ville Rohannec’h © Justine Faure
Aussi simple que cela puisse paraître, c’est ce qui a le mieux fonctionné. En écrivant sur les différentes fenêtres de la villa, je livrais un message, une anecdote sur l’histoire de la villa. C’était assez amusant de voir les passants, depuis mon bureau, lever la tête en l’air pour lire tout en faisant le tour de la villa pour découvrir la phrase complète. Même si ce n’était que quelques mots, une phrase par ci par là, c’était la seule chose que les visiteurs avaient à se mettre sous la dent pendant leur promenade.
Etape 3 : Quand Instagram devient un outil de médiation culturelle
Outre l’idée de faire passer un message historique, je me suis aussi demandé comment montrer l’intérieur sans ouvrir.
J’ai décidé de créer un compte Instagram, réseau social de la photographie. Cependant j’ai utilisé cet outil de communication comme un outil de médiation culturelle. Le but était de réaliser une sorte « d’exposition virtuelle » montrant les intérieurs de la villa et leurs usages à travers le temps et l’histoire du site. Sur le principe du story-telling, les usagers pouvaient chaque semaine découvrir la villa selon une thématique différente et surtout apercevoir et découvrir les intérieurs, les détails, en bref tous les aspects cachés de la villa.
Un principe qui a permis de générer une banque d’images des intérieurs de la villa, des traces laissées par ses divers habitants au fil du temps.
Etape 4 : Un support pour parler de la villa hors les murs
Dans le cadre de la mise en place d’une « bibliothèque buissonnière » dans le parc de Rohannec’h, avec la bibliothèque de la ville de Saint-Brieuc, j’ai eu l’occasion de co-construire un dispositif de médiation.
L’idée était de proposer aux visiteurs un atelier d’expression sur la villa Rohannec’h. Dans un premier temps ils pouvaient écrire et/ou dessiner pour raconter un souvenir, témoigner, inventer la villa du futur, etc.
Dans un deuxième temps les visiteurs étaient invités à deviner les usages et occupations des différentes pièces de la villa par le biais du dispositif suivant :
Le support de médiation villa Rohannec’h © Justine Faure
Les façades de la villa Rohannec’h ont été découpées en quinze morceaux représentant chacun des espaces différents de la villa. Ces morceaux forment de petits carnets construits à la manière des livres de Tana Hoban. Cette photographe et auteur utilise son travail photographique dans la réalisation de livres pour enfants. Le livre Regarde bien1est celui qui a inspiré la démarche créative pour réaliser ce dispositif. Une page noire, un cercle découpé au milieu de la page, duquel on aperçoit un détail de la photo se trouvant sur la page suivante.
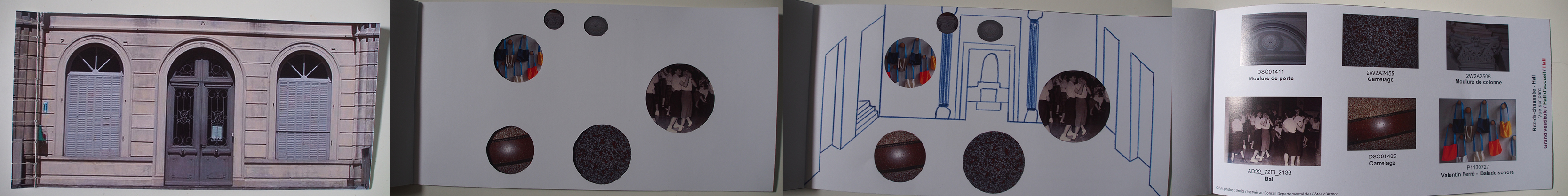
Les différents volets du carnet à la manière de Tana Hoban © Justine Faure
Comme l’enfant l’est dans le livre, à travers les photographies, le visiteur est ici invité à se demander ce qui se cache derrière telle fenêtre ou telle porte de la villa. Il peut ensuite vérifier en ouvrant le premier volet du carnet. Des images apparaissent, représentant chacune une période différente de l’histoire de la villa. Le deuxième volet représente la pièce avec les photographies situées dans l’espace. Enfin le dernier volet donne le crédit des photographies et leur légende. De cette manière nous pouvons échanger avec le visiteur sur l’histoire du lieu à travers les différentes pièces de la villa. Ont-elles eu différents usages ou au contraire ont-elles toujours gardé les mêmes ?
Le dispositif rend le visiteur acteur dans sa quête d’informations et nous permet d’instaurer un dialogue sur les usages passés et actuels du lieu. Les visiteurs comprennent pourquoi la villa est fermée actuellement en comprenant qu’elle accueille des artistes en résidence. Cela permet également de parler du projet culturel et des aspirations de la villa tout en concertant les visiteurs de manière informelle. En effet, à terme l’idée est d’utiliser le lieu comme une maison où les notions d’accueil et d’hospitalité prennent une place importante. Mais plus largement cela permet de créer du lien entre les usagers du site, de fédérer une communauté de personne et de peut être faire émerger de nouveaux usages pour faire évoluer le projet culturel et permettre aux « habitants » de prendre part réellement à la construction du site.
Faire de la médiation sur un lieu fermé au public la plupart du temps, implique de reconnecter ce lieu avec ses potentiels visiteurs afin qu’ils puissent eux aussi se l’approprier et en parler. Informer et transmettre permet de (re)donner vie au lieu et d’affirmer une position face aux politiques. Faire de la médiation, devient alors un moyen de résister !
Justine Faure
1. Regarde bien, Paris, coll. « Kaléidoscope / L'École des loisirs », 10 mars 1999, 48 p.
https://www.instagram.com/villa_rohannech/
#communiquer
#dialoguer
#etremediateur

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940
Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?
Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.
Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?
L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne
Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?
La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.
Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?
Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?
Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne
Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.
Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?
Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.
Charlène Paris
#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive
#histoire-mémoire
#brèvesd’apprentissage
#patrimoine-société

En construction:
Je suis en apprentissage au Museon Arlaten, ce n’est pas un musée comme les autres, c’est un musée en construction.

Une arlésienne en tenue de chantier © Museon Arlaten
Bien sûr, il a plus de 100 ans, ses fondations sont solides. Il serait plus exact de parler de reconstruction. Les murs, les objets, l’esprit du lieu sont les mêmes, mais le discours, la méthode et la scénographie sont bouleversés ! À la vision parfois trop subjective et datée de Mistral et des autres prédécesseurs, se substitue un propos contemporain et scientifique. De la scénographie vieillissante naît une mise en scène rafraichissante. Afin d’arriver à ce changement, le Museon1 est nourri du travail des différentes équipes. Elles modifient sa gestion, son administration, sa présentation, son activité, etc. Elles l’alimentent, le font grandir comme elles le font avec moi. Être apprenti c’est aussi être en construction, ou en reconstruction. Les fondations bâties durant nos études sont solides, mais ce terrain particulier questionne, et façonne. Les projets se pensent et se font sur le long terme, c’est un travail différent de celui demandé lors des stages, des projets d’études ou des workshops. La position occupée, le statut de salarié est lui aussi autre. Cela pousse donc à réfléchir diversement sur le métier, à en percevoir plus encore ses réalités, à découvrir ses limites et comment les dépasser. Présente constamment au sein d’une structure, j’ai par exemple davantage perçu l’emprise du politique et de l’administratif.
L’activité dans un musée fermé est parfois plus dense que dans un musée ouvert ! Il y a toujours les collections à gérer, mais aussi tout l’administratif, les marchés, etc. Bien que rattachée à l’unité recherche et muséographie, j’ai la chance de pouvoir observer de près cette agitation et de participer au travail des différents services. J’ai appris à utiliser Micromusée en conservation, mais aussi en documentation, pour pouvoir l’exploiter en muséographie. Je sais comment s’est passé le chantier des collections, autant que décrire les activités de la médiation. J’acquiers de nouvelles compétences auprès de mes collègues comme le musée acquiert sa substance grâce à eux.
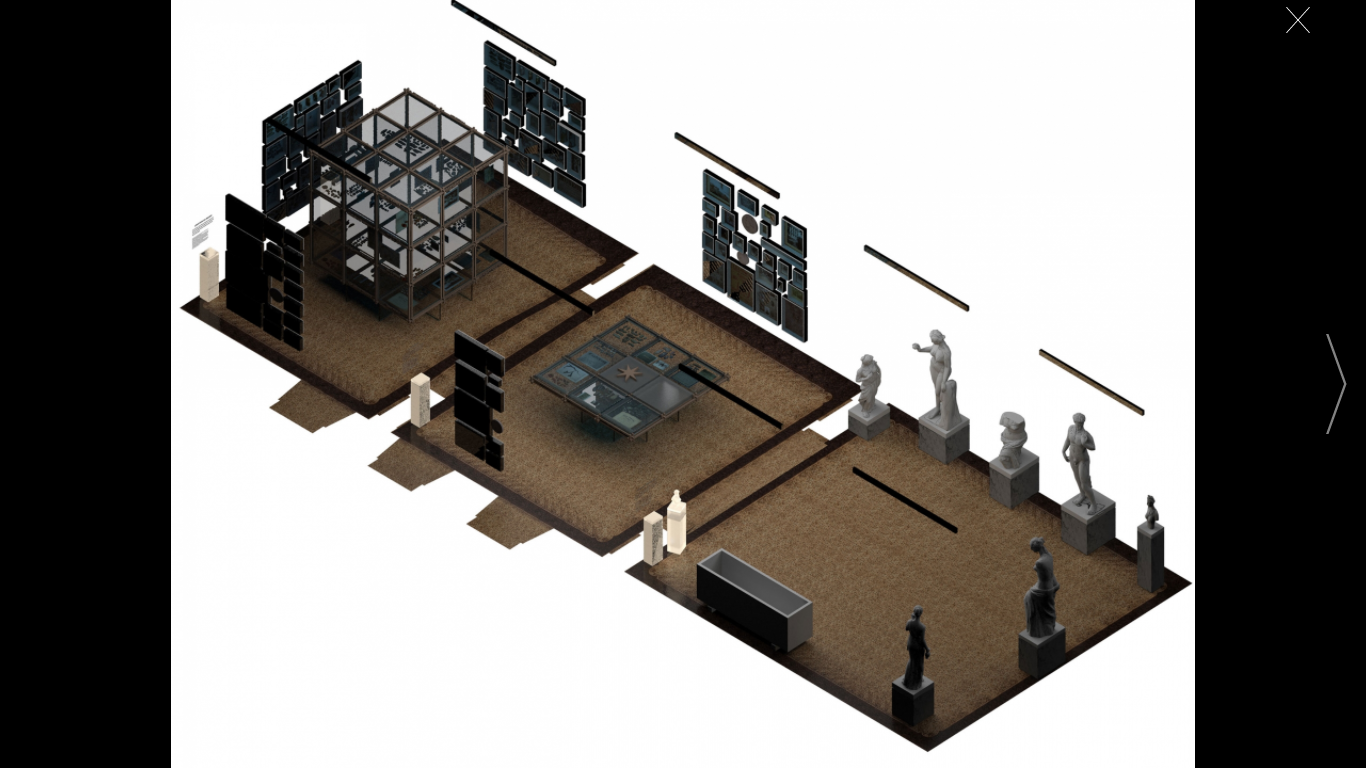
Planche du projet de rénovation du museon © Tetrarc
Il s’agit aussi d’une co-construction, j’aide cette structure à devenir un musée de demain et elle m’aide à devenir une muséographe de demain.
Chaque recherche faite sur les collections enrichit son fonds et mes connaissances. Chaque réunion à laquelle j’assiste développe ma compréhension du monde muséal, ainsi que ma perception du musée. Chaque texte écrit donne du contexte au musée et m’aide à améliorer mes capacités rédactionnelles.
C’est surtout cela l’apprentissage, un échange entre la structure et l’apprenti pour en sortir tous les deux plus grands. Parce que l’un apporte des connaissances à l’autre qui les met en pratique pour lui.

Le chantier, vue d'artiste ©Muséon Arlaten
L’apprentissage est un instant de construction, où l’on développe de nouvelles compétences et élargit ses connaissances toutes les semaines, où l’on est guidé, où l’on peut se tromper, être requestionné, mais aussi apporté les fondations sur lesquelles nous nous étions déjà appuyées.
En 2019, diplômée, je serai prête à rejoindre un poste et le Museon ouvrira ses portes, une grande partie du chantier sera fait pour nous, même si l’on reste toujours en construction.
Océane De Souza
#co-construction
#brève d'apprentissage
#Museon Arlaten
Le musée : http://www.museonarlaten.fr/
Un article du Museon sur cet apprentissage : https://www.facebook.com/notes/museon-arlaten/-accueillir-une-apprentie-au-mus%C3%A9e-une-tr%C3%A8s-belle-id%C3%A9e-/1977571738947037/

Et toi, il est comment ton Open-Space ?
J’aimerais raconter une découverte de mon apprentissage : le travail en Openspace.
Openspace© Méline Sannicolo
Dans mes expériences précédentes, j’ai eu un bureau solo ou un bureau partagé à deux, mais jamais d’Openspace. Selon sa définition première, un Openspace est un espace ouvert où les bureaux ne sont pas séparés par des cloisons. Pour cet article nous considèrerons que l’on parle d’Openspace à partir de trois personnes dans un même bureau.
L’Openspace est apparu en France dans les années 80. Son but est de faire gagner de la place et du temps. Ainsi, alors que les cadres avaient souvent leur bureau individuel, bien à part du reste du service, les Openspace avec leur moquette et leur éclairage néon un peu blafard, voient le jour et offrent des espaces totalement modulables en cas d’évolution de l’entreprise.
Cette organisation peut avoir des avantages : le gain de temps est important car en posant une question à un collègue du même bureau, la réponse est immédiate, la communication est instantanée et plus fluide. Le travail en équipe est aussi facilité par cette proximité. Mais cette organisation présente également de nombreux inconvénients et le premier d’entre tous est paradoxalement la perte de temps. En moyenne, un salarié serait dérangé toute les 11min (David Rock, « Votre cerveau au bureau »). Entre les questions des collègues, les coups de téléphone, les discussions des autres collègues entre eux, etc. Le fait d’être autant dérangé augmenterait d’ailleurs le stress des salariés ce qui accentuerait l’inefficacité.
Retrouve-t-on les mêmes avantages et inconvénients dans une institution culturelle ?
Ce qui suit est une brève analyse non exhaustive faite à partir des expériences de huit de mes camarades, qui ont bien voulu répondre à mes questions. La moyenne est d’environ cinq personnes par bureau, allant de 3 à 14 pour le plus grand Openspace. Les personnes interrogées travaillent dans des services d’expositions ou bureaux de médiation, dans des institutions muséales ou des centres d’art contemporain.
L’idée de convivialité est souvent revenue dans les réponses : partage, bonne humeur, ce qui suppose néanmoins une bonne entente avec les personnes du bureau car dans le sens inverse, le fait de partager un espace exacerbe les tensions. L’autre avantage qui ressort est le partage de l’espace comme vecteur de rencontre des personnes de l’institution, de discussions avec les autres services et d’être plus au courant de ce qui se passe dans le musée. Cela permet des échanges sur les différents projets, qui n’auraient peut-être pas lieu autrement, et qui peuvent amener à de nouvelles réflexions, un partage d’expérience ou de références etc. Pour celles qui travaillent en équipe, le gain de temps est flagrant quand il ne faut pas passer par le téléphone ou le mail.
Mais de nombreux problèmes liés à l’Openspace ont aussi été soulevés, comme le bruit et la déconcentration (entre le téléphone, les discussions entre des personnes qui parlent fort, ceux qui rigolent, ceux qui font la discussion sur la météo etc.). Le revers de la médaille est que nous aussi, pour nos échanges, il faut faire attention à notre propre bruit ! Si le chef du service est du genre à surveiller ou si les collègues ne sont pas toujours bienveillants ou aiment comparer et commenter, tout cela peut conduire à une impression de contrôle très désagréable : tout le monde sait ce que tu fais, combien de temps tu vas à un rendez-vous, ce que tu dis à un prestataire par téléphone, combien de temps tu mets pour manger, à quelle heure tu pars le soir etc. Et dans les cas où ton bureau sert parfois à d’autres personnes, l’ordinateur peut être fouillé : l’historique internet ou dans les documents ou notes qui se trouvent sur le bureau… rien de très agréable et peu de confiance.
D’autre inconvénients comme des besoins différents entre collègues (lumière, musiques etc.) ou les différents savoirs vivres (pour la propreté, le rangement, etc.) peuvent également donner lieu à des tensions et même dans les mauvais jours, il est quand même nécessaire de parler, de faire la discussion avec les collègues etc. Les fournitures sont parfois à l’origine de certains problèmes. Dans certains cas, les fournitures sont à partager : quand il s’agit des stocks de papiers ça va, mais lorsqu’il faut partager un téléphone, un ordinateur c’est plus compliqué ! Parfois, les fournitures sont individuelles, il n’est pas impossible de voir disparaitre ciseaux, stylos etc. parfois même du papier toilette. Le dernier cas de figure rencontré est de devoir amener son propre matériel, son ordinateur, ses stylos, car la structure ne fournit rien, souvent pour une question de coût.
Les espaces d’Openspace, bien que modulables sont souvent trop petits pour accueillir plus de salariés, si bien que plusieurs d’entre nous ont du mal à accéder à leur bureau sans embuche. Des bureaux prévus pour trois accueillent finalement plus de personnes : espaces trop fournis en meubles, en décorations et donc visuellement très chargé, créant du stress supplémentaire.
Depuisles années 80, les pratiques et les idées ont changé et de nombreuses études ont été menées pour savoir comment rendre le travail le plus efficace possible. L’idée de « bien-être » au travail est un concept qui est de plus en plus présent, surtout pour les Start-Up ou pour les grandes multinationales « cools ». L’idée est de se sentir bien au travail, mais ce n’est pas de bonté d’âme : les personnes travaillent de plus en plus, les cas de burnouts se multiplient. Les entreprises cherchent à augmenter l’efficacité des salariés pour pouvoir en réduire le nombre. Ceci explique cela. Ces entreprises présentent de nouvelles tendances. Le bureau partagé est toujours là, mais une multitude d’autres pièces sont ajoutées, permettant de nouvelles pratiques : salle ou box pour des réunions, salles pour téléphoner sans déranger les autres ou être dérangé ; salle de repas, salle de repos, salle de jeux...
Ces espaces rythment le travail en offrant un lieu pour chaque type d’action. Les lieux comme la salle de repos permettent de s’isoler. Les lieux communs, comme la salle de repas, ou l’espace café, sont des espaces associés à un temps précis hors du travail. Cela favorise la cohésion de groupe et créer un sentiment d’appartenance. Il s’agit de rites d’entreprises importants pour maintenir leur bon fonctionnement, comme le souligne l’anthropologue Jean-Pierre Jardel. La présence de plantes, de matériaux naturels (meubles en bois etc.), est aussi encouragé afin d’améliorer la qualité de l’air et donner un air plus « naturel et sain ». L’entreprise Nestlé a même rajouté un espace avec des animaux, car la présence de ces derniers réduirait le stress et renforcerait la cohésion d’équipe.
Retrouve-t-on ce genre de pratiques et pensées dans les institutions culturelles ?
Une seule de mes camarades, dans un centre d’art contemporain, travaille dans un espace multiusage avec des bureaux, une cuisine, un espace de repos. De plus, les tables sont amovibles et donc peuvent être déplacées et utilisées selon les besoins (grandes réunion, entretiens d’embauche etc.) Souvent tout de même, un espace pour manger ou boire un café, existe mais parfois le repas se prend dans son bureau, par manque d’espace dédié. Dans une autre institution, des canapés sont mis à disposition, dans un coin de l’Openspace. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans des dispositions énoncées auparavant, d’un espace dédié pour chaque activité mais des aires de repos ou de repas existent malgré tout.
L’enquête a révélé la récurrence d’un environnement agréable. Seulement, le côté « sain » n’a pas été soulevé, contrairement à la notion d’espace « personnalisé ». Pour commencer, les institutions culturelles se trouvent souvent un cadre particulier, avec de beaux paysages, de beaux bâtiments. Ainsi les beaux paysages à travers la fenêtre, une grande luminosité etc. ont toujours été mentionnés avec beaucoup d’entrain. C’est vrai qu’il y a pire que de voir le château d’Azay-le-Rideau ou le Jardin des Plantes de Paris, à travers sa fenêtre. Il s’agit de lieux privilégiés. A l’inverse, les environnements froids, mal isolés, sans lumière directe ou sortie directement vers l’extérieur, sont aussi ressorti de l’enquête, comme étant des lieux moins sympathiques, mais rendu agréables par la décoration.
Car oui, la décoration est un autre grand enjeu pour se sentir bien : certaines ont créé des décorations personnalisées par exemple avec des affiches, des photographies ou des éléments ramenés de chez soi ou de son travail précédant. Parfois les bureaux sont déjà décorés ou aménagés, parfois avec des matériaux pour isoler du bruit, avec des images du bâtiment ou des éléments d’anciennes expositions. C’est la vraie particularité des espaces de travail de lieux d’exposition : une multitude de choses sont gardées des expositions qui ont déjà eu lieu et ainsi cartels, affiches, éléments de scéno, des panneaux ou photographies faites en interne, font offices de décoration et donnent un cachet particulier. Le fait que la décoration se rapporte très souvent au monde des expositions ou plus largement au monde « culturel », montre une identification au groupe précis des « personnes qui travaillent dans la culture » et pourrait être qualifié de rite de marquage ou de reconnaissance, par Jean-Pierre Jardel.
Voilà, ce petit plongeon dans nos quotidiens d’apprentissage est terminé. Loin d’être exhaustif, cet article a voulu mettre en avant nos ressentis sur ces lieux où l’on passe, tout de même, une grande partie de notre temps !
Méline Sannicolo
#Openspace
#apprentissage
#bureau
#institutionsculturelles

George Clooney is not inside ! - Mes aventures de stage - Episode 1
Sous ce titre bien tapageur se cache une chronique de ces petits moments bien agréables qui font que le statut de stagiaire peut vous faire vivre des moments qui sortent de l'ordinaire...
Par exemple quand le samedi 12 avril, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie officielle de remise d'un tableau tout droit sorti de « Monuments Men » si ce n'est que non l'action ne se passe pas pendant la seconde guerre mondiale et que re-non, George Clooney n'était pas assis à mes côtés ce jour-là. Hélas !

Après la lecture, 1865Alix Marie de La Pérelle-Poisson Crédits : S.V
Qu'importe, car c'est dans la chapelle du musée de la Chartreuse, à l'initiative de Madame Labourdette, conservatrice du lieu, entourée de sommités culturelles (parmi lesquelles Mesdames Christina Kott, commissaire scientifique et Gaëlle Pichon-Meunier commissaire associée), et devant un auditoire de professionnels de l'univers muséal et culturel, de photographes, de journalistes et d'élus locaux parmi lesquels j'évoluais/je déambulais (merci au master expo-muséographie encadré par Serge Chaumier de me permettre de mettre facilement un nom sur un visage et d'avoir la chance/la possibilité de saluer et d'échanger avec ces personnes), que je fis partie des privilégiées qui eurent la chance d'assister à ce moment assurément unique : la restitution de « Après la lecture » dérobé par l'armée allemande en septembre 1918 d'Alix de Lapérelle-Poisson dont le destin rocambolesque ne peut nous laisser de marbre tant il questionne les problématiques hélas encore actuelles autour de la propriété, de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine archéologique et artistique en tant de guerre notamment.
De quoi, en tout cas, avoir envie de se précipiter à l'exposition « Sauve qui veut » pensée conjointement et présentée simultanément à Douai et à Bavay.
Les discours et échanges se firent en français et en allemand... traduit, heureusement pour moi d'ailleurs, car après « Guten Tag », j'eus comme une perte d'audition... et de compréhension subite, mais comme un sens (ou plusieurs dans mon cas !) compense toujours la défaillance d'un autre, c'est à l'issue des discours que la vue, puis l'odorat et enfin le goût me permirent de profiter d'un très savoureux buffet. De quoi dépasser l'adage « après l'effort, le réconfort » car ce moment exceptionnel de ma vie de stagiaire à la photothèque Augustin Boutique-Grard fut pour moi source de découvertes, de rencontres et d'échanges.
What else ?

Vue de l'exposition - Crédits : S.V
D'autres moments de rencontres conviviales et riches aussi bien professionnellement qu'humainement m'attendent encore car le vendredi 16 mai aura lieu le vernissage de l'exposition « deux regards sur la grande Guerre : Charles Goujaud et Edouard Baron » présentée en deux actes par la photothèque et, dès le lendemain, la Nuit des musées permettra au plus grand nombre des publics de découvrir gratuitement ce lieu (accueillant en outre l'aquarium et le musée des Sciences Naturelles) et l'exposition. A cette occasion, je verrai bien si l'atelier pour enfants que je compte mener et le livret de médiation à destination des familles que j'ai conçu durant le stage plaisent. Certainement pour moi l'occasion d'écrire la suite de ces aventures d'une accro du...master MEM !
Sabrina
#vernissage
#stage
#restitution
Pour en savoir plus sur l'exposition « Sauve qui veut » présentée en deux lieux : A Bavay, « Sauve qui veut ! Des archéologies mobilisés : 1914-1918 »
A Douai, « Sauve qui veut ! Des musées mobilisés : 1914-1918 »

Il faut sauver le soldat Goujaud ! - Mes aventures de stage - Episode 2
Pour de multiples raisons, c'est une exposition qu'il me tient à cœur de vous présenter dans cette seconde chronique des « Aventures de Sabrina en stage » (de master 1 expo-muséographie).
Mes respects mon maréchal ! C'est tout d'abord pour moi l'occasion de communiquer sur la photothèque Augustin Boutique-Grard du musée de la Chartreuse de Douai qui, à travers l'exposition « Deux regards sur la Grande Guerre : Charles Goujaud et Edouard Baron », met en avant le courage de ces hommes qui, de par leur travail photographique mené il y a un siècle, devinrent les témoins de l'Histoire.

Vue de l'exposition - Crédits : S.V
Plus concrètement, c'est le premier regard proposé actuellement aux visiteurs, celui de Charles Goujaud (1880-1956), maréchal des logis du 25ème régiment d'artillerie qu'il faut sauver de l'ignorance et de l'oubli. Parce que finalement rien ne prédestinait ce représentant de commerce en vins et spiritueux il y a 100 ans à s'engager à l'arrière-front du conflit et à saisir sur plaques de verre les instants de la vie quotidienne des soldats de son régiment, tout comme les destructions massives des villages de la Meuse, la Marne, la Somme et l'Aisne... Rien si ce n'est la possession d'une malle et de matériel photographique (elle aussi exposée!...et inventoriée et dépoussiérée par votre serviteur herself ! L'occasion de retrouver des instruments protégés dans du papier journal daté de 1914, « emballage » d'époque qui prend une toute autre valeur historique et patrimoniale un siècle plus tard... Un bon sujet de mémoire, non ?) et la volonté consciente ou non d'être le témoin direct de ce conflit pour les générations futures...
Plus prosaïquement, c'est aussi le moyen de remercier du fond du cœur l'équipe de la photothèque qui m'a accueillie chaleureusement, m'a aidée et m'a fait confiance notamment lors du montage de l'exposition.
De l'action !Ce sont en effet des responsabilités et des fiertés de future professionnelle, comme la réalisation d'une vitrine (après constitution du discours et sélection des expôts), l'élaboration du livret-jeu familial, mais aussi des rencontres avec des collectionneurs et prêteurs qui m'enthousiasmèrent.
Ce sont aussi de réelles réjouissances que furent pour moi le vernissage du vendredi 16 mai et l'animation d'un atelier à destination des enfants dès le lendemain lors de la Nuit des musées où l'accueil et le contact avec le public adulte et enfant de ce samedi nocturne sont pour moi essentiels.
Séquence émotion !

Atelier à destination des enfants - Crédits : S.V
Et telle l'heureuse lauréate de la palme d'or de l'expo-muséographie, saisie par l'émotion qui m'envahit fréquemment, je remercie pour leur présence et leur soutien ce soir-là mes enfants, mon mari, ma maman, mes collègues et surtout mes élèves et leurs parents qui me firent la surprise de leur visite... ainsi que tous les visiteurs « anonymes » qui partagèrent leurs découvertes et leurs connaissances... comme ce gentil monsieur (il avait 15 ans en 1914, faites le calcul) qui revint spontanément ce vendredi nous présenter les documents officiels ayant appartenus à son père et son grand-père... L'émotion était à fleur de son regard... et du mien. La preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la richesse et des apports en terme de professionnalisation, de culture personnelle et de relations humaines des stages dans lesquels le master nous plonge pour mon plus grand plaisir !
Sabrina
#guerre
#exposition
#stage
Pour en savoir plus sur l'exposition :
« Deux regards sur la GrandeGuerre : Charles Goujaud et Edouard Baron »

Immersion au Musée Léon Dierx à la Réunion.
Bienvenue à tous sur l’île de la Réunion. Je vous invite à découvrir le musée des beaux-arts de ce département : le Musée Léon Dierx, du nom d’un peintre et poète réunionnais, qui a ouvert ses portes en 1912. Cette institution culturelle prend place dans l’ancien évêché de Saint-Denis, chef-lieu de la Réunion, au sein de l’emblématique rue de Paris.
L’entrée du Musée Léon Dierx, © LK
Sa collection permanente aborde les courants propres au 19ème siècle. Le parcours y est chronologique (le romantisme, l’école de Barbizon, l’impressionnisme etc) et thématique (le nu, les marines, le paysage urbain etc). Ces peintures relèvent de deux genres principaux, les portraits et les paysages. Les collections du musée, hors réserves, sont actuellement dotées également de sculptures et d’estampes. Les collectionneurs et marchands d’arts, pour la majorité réunionnais, qui ont enrichi le musée, ayant beaucoup voyagé, les paysages et les portraits proviennent de divers pays. Vous pouvez découvrir des œuvres de Cézanne, Chagall, Picasso, Gauguin, Valtat, Redon…
Une salle de la collection permanente du Musée Léon Dierx, © LK
L’espace du musée mesure environ 700 m2. Ce musée de petite taille entraîne un confort de visite et l’intimité d’une maison. Il est appréciable de s’y promener. Le musée est entouré d’un jardin très agréable, foisonnant de plantes locales. Le Musée Léon Dierx propose chaque année environ trois grandes expositions temporaires et deux petites. Les expositions ont toujours un lien avec l’art d’aujourd’hui. Le directeur et conservateur du musée souhaite, en effet, mettre en avant la création artistique réunionnaise et au-delà de l’Océan indien. Le musée appuie le propos d’une création actuelle en lien avec la société.
Le jeudi 2 juillet, nous avons accueilli plus de 500 visiteurs à l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition : L'Envers de l'île. Cette exposition tisse des liens entre l’art contemporain réunionnais et les archives anciennes, entre collections publiques et privées, entre artistes formés aux beaux-arts et autodidactes. Elle présente des œuvres qui ont été réalisées sur l’île de la Réunion, à des périodes très différentes. L’exposition est dédiée à tous, aux personnes qui connaissent l’île en profondeur, aux personnes qui rêvent de la découvrir. Elle se prête à provoquer un dialogue entre les visiteurs sur leur perception de l’île. La pluralité des œuvres est vouée à intéresser chacun, entre photographies, peintures, dessins, sculptures, installations…
L’entrée de l’exposition, avant l’arrivée de visiteurs © LK
Durant le vernissage, © LK
La scénographie de l’exposition nous emmène à la découverte et à l’ouverture dans cette île aux multiples facettes. L’exposition se compose de différentes salles, toutes ouvertes. La visite peut s’effectuer avec calme et légèreté. Nous pouvons ressentir une grande liberté en arpentant les espaces.
Des salles ouvertes, un sens de visite libre ©LK
Au fur et à mesure nous en découvrons davantage sur l’île depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur, pour arriver en son cœur. L’exposition nous dévoile d’abord le territoire et la représentation que nous pouvons nous faire de la Réunion : photographies du Piton de la fournaise et côtes terrestres, installation entre nuages et montagnes, cartes et dessins représentant le territoire de l’île de la Réunion, etc.
La Réunion, entre ciel et terre : un territoire aux représentations communes©LK
Notre cheminement nous entraîne plus près, à proximité de l’homme réunionnais, entre identités et pratiques culturelles plurielles. La population réunionnaise étant composée de personnes provenant de Madagascar, d’Inde, de Mayotte, des Comores, de France, d’Afrique et de nombreux lieux du globe. Cette richesse entraîne des pratiques culinaires, religieuses, culturelles d’une grande ouverture. Cette exposition, forte de sens, rassemble le public local autour d’un territoire. Elle reflète des fondements de cette société. Elle réunit chaque individu autour d’un patrimoine commun.
Une terre aux multiples pratiques©LK
Une terre aux multiples pratiques©LK
Une population diversifiée et tolérante©LK
Le travail de l’artiste Stéphanie Hoareau m’a particulièrement marquée. Première œuvre : une femme âgée en résine. Certains la frôlent, d’autres l’observent. Cette femme nommée Jacqueline est une sans domicile fixe de la Réunion. Elle est assise sur un banc, dans l’attente de quelque chose que nous ignorons. Puis dans une autre salle nous découvrons Jack le fou. « Qui est-il ?» demandais-je ? On me raconte alors des légendes sur cet homme nomade qui se déplace de villes en villes, cette figure emblématique que tous les Réunionnais connaissent. L’artiste souhaite honorer ces personnes considérées comme hors normes. Leur présence dans un espace muséal leur redonne une identité, une place dans la société. A travers plusieurs techniques, elle dresse les portraits des marginalisés.
Jacqueline, Sculpture en résine et bois,2014
Je laisse les derniers mots à Stéphanie Hoareau :
« Chacun a croisé au détour d’une rue, d’une place, ou d’un bâtiment, un personnage énigmatique, toujours présent, qui se fond dans le décor.
Chacun a entendu des histoires extraordinaires sur ces personnes qui font partie des récits folkloriques et de l’imaginaire commun des villes et des quartiers. Chacun les ignore, les observe, les craint, ou leur apporte soutien et bienveillance par compassion ou encore par empathie.
Mais personne ne peut les sortir de leur torpeur car personne ne peut les priver de ce qu’ils ont de plus cher : leur liberté».
Lilia Khadri
En savoir plus :
http://www.cg974.fr/culture/index.php/L%C3%A9on-Dierx/pr%C3%A9sentation-dierx/musee-leon-dierx.html
# Beaux-arts
# Identité
# La Réunion
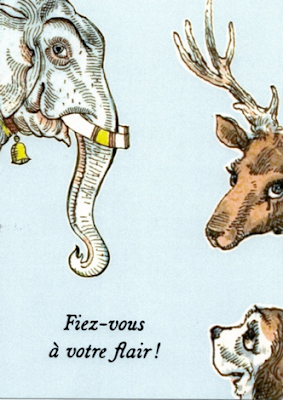
La Maison-Musée Hector-Berlioz : à voir et à entendre !
« Je suis né le 11 décembre 1803 à la Côte Saint-André »
(c) Musée Hector-Berlioz
Cette simple phrase amorce les mémoires rédigés par Hector Berlioz publiés en 1865. C’est naturellement que l’on trouve dans cette commune iséroise le musée qui lui est dédié, au sein même de sa maison natale. Elle a été acquise en 1932 par l’association « les Amis de Berlioz » dans le but d’en faire un musée dédié à la mémoire de celui-ci, puis inauguré en juillet de la même année après réhabilitation. Le musée devient un établissement départemental à partir de 1968 mais sera géré par l’association jusqu’à la fin du XXème siècle. Par la suite, trois phases de réhabilitation seront initiées (1969-1975, 1989-1990 et 2002-2003). Ces différentes étapes de travaux ont pour objet la reconstitution du cadre de vie de la maison au moment où le jeune Hector y habitait. L’avant-dernière phase a aussi permis d’ajouter une boutique et une salle d’exposition temporaire qui confère alors une meilleure envergure au musée.
La scénographie du lieu est composée en trois parties. Tout d’abord au rez-de-chaussée, une première salle présente Hector Berlioz en son temps avec différents repères chronologiques. Le courant artistique et littéraire du romantisme est l’axe qui relie le compositeur avec d’autres personnalités majeures de cette philosophie (Hugo,Liszt, Byron, etc). Une introduction succincte sur la vie personnelle de Berlioz, ainsi que ses succès et ces déconvenues vient clore ce premier niveau.Etant le seul accessible aux personnes à mobilité réduite, il était nécessaire d’y faire une présentation générale de la vie et de l’œuvre du compositeur. Ensuite,les étages ont été reconstitués pour mettre en scène la vie de la maison lorsque Berlioz enfant y vivait. Lors de la dernière réhabilitation, des enduits et peintures murales du XIXème siècle ont été retrouvées sous des couches de décors précédents. Leurs restaurations permettent de mettre en scène au mieux le mobilier d’époque. Pour finir, un voyage musical est proposé dans l’auditorium du musée. Installez-vous confortablement et laissez la musique vous faire découvrir l’univers de Berlioz.
Une majeure partie des collections du musée est composée de dons de la descendance d’Hector Berlioz. Ce sont surtout des ressources manuscrites, partitions, mémoires et carnets de voyage du compositeur. Mais une part importante de la correspondance de la famille Berlioz y est aussi conservée. Il y a deux espaces de conservation des collections dans le musée : la réserve pour les objets et le centre de documentation (créée en 1965) pour les collections papier.
Les missions
Mes missions au sein du musée Hector-Berlioz avaient pour fil conducteur de me faire découvrir le métier de régisseur des collections. Au cours de ces quatre mois, j’ai pu étudier toutes les étapes de l’œuvre dans les collections, de son arrivée dans le musée à sa mise en exposition.
A ce titre, je me suis occupée du classement de trois fonds. Le premier fonds concerne une cantatrice iséroise,Ninon Vallin. Il contient environs 400 photographies et 700 articles de presse.Le second a été donné par l’Orphéon Municipale de Grenoble, association musicale importante de l’Isère au XXème siècle. Il est composé des documents administratifs de l’association, des photographies de leurs représentations ainsi que de médailles. Ces deux fonds n’ont pas de lien direct avec Hector Berlioz mais ils permettent une veille patrimoniale de l’histoire musicale de l’Isère. Le troisième a été légué au musée par une descendante de la famille Berlioz, Catherine Reboul-Vercier, et contient près de 700 lettres et documents administratifs ayant appartenu au compositeur et à sa famille. Un point important est donné à la cohérence dans l’organisation de ces fonds. Du classement au rangement, cela doit être fait de la manière simple et juste afin que toutes personnes souhaitant l’étudier puissent le faire le plus facilement possible.
Par la suite, je me suis occupée de réorganiser la réserve du musée. Elle se compose d’un meuble à plan, de trois armoires et de rangement pour tableaux. Mon travail s’est surtout centré sur du dépoussiérage et conditionnements d’objets. Ce sont des étapes importantes permettant de mettre en œuvre les bonnes conditions de conservation préventives pour les collections. Selon les caractéristiques physiques des objets,différents conditionnements ont été choisis. Pour les objets sans trop de volume, comme les médailles et baguettes de chefs d’orchestres, le conditionnement choisi est de la mousse de polyéthylène dans laquelle sont formés les emplacements pour les objets pour ensuite être ranger dans des boites de conservation. Ce système permet de les ranger par type. Les objets plus lourds et volumineux, tel que la vaisselle, n’ont pas été conditionnés pour une meilleure observation. Les étagères où elle est rangée sont protégées par des films de polyéthylène afin d’éviter le contact de l’objet avec des surfaces non-neutres.
Enfin, j’ai participé au montage de l’exposition « Berlioz en Italie. Voyage Musical ». Je me suis intéressée aux parties administratives préalables à la venue et au convoiement des œuvres. Cette mission passe par la création des fiches de mouvement d’œuvres, la prise de contact avec des convoyeurs spécialisés et la création des fichiers d’assurances. J’ai accompagné mon tuteur à Marseille pour récupérer une dizaine d’instruments de musique méditerranéenne, prêtés par un musicologue. L’exposition était essentiellement composée de tableaux, gravures et de manuscrits de Berlioz. De mauvaises mesures des tableaux avaient été données ce qui a causé une remise en question de la scénographie une semaine avant l’inauguration. La place restreinte des salles et des contraintes de l’agencement (deux salles avec plafond voûté) ont été problématiques pour résoudre les problèmes. Finalement, nous avons dû supprimer des lithographies pour laisser plus de places aux tableaux et aux textes.

(c) Portrait d'Hector Berlioz, Émile Signol - Villa Médicis
L’exposition vise à faire connaître une étape importante dans la vie du compositeur français. Lorsqu’il gagne leprix de Rome en 1830, par deux tentatives infructueuses, Berlioz quitte à regret Paris pour devenir pensionnaire à la Villa Médicis durant un an. La cité romaine lui semble bien moins attractive que la capitale française et il méprise la musique italienne. Il va s’évader le plus souvent possible pour découvrir les provinces et paysages qui formeront trente ans plus tard l’Italie unifiée. Le musée a choisi de présenter des tableaux et lithographie de la première moitié du XIXème siècle représentant les régions telles que Berlioz les a visitées pendant son voyage. Des manuscrits sont présents afin de compléter ses œuvres montrant que le compositeur a gardé en lui les souvenirs passé en Italie. Il s’est inspiré de ces sonorités tout au long de sa carrière pour de nombreuses œuvres, de Benvenuto Cellini à Béatrice et Bénédict en passant par Les Troyens.
Laura Clerc

La régie au Musée Maurice Denis !
Le Musée Départemental Maurice Denis
Etudiante en deuxième année du Master Expographie-Muséographie, je suis en apprentissage en régie des collections au Musée Maurice Denis, à Saint-Germain-en-Laye.
Ce charmant petit lieu situé en banlieue parisienne était à l’origine un hôpital général royal, construit au XVIIème siècle à la demande de Madame de Montespan. Devenue demeure du peintre Maurice Denis en 1914, le site se compose du musée, d’une chapelle entièrement décorée par l’artiste et d’un jardin. L’ancien atelier du peintre, construit par l’architecte Auguste Perret en 1912 se situe aussi sur la propriété, mais il n’est pas accessible au public. La création du musée remonte à 1976, date à laquelle la famille Denis fait don du bâtiment et d’environ 1500 objets au Département des Yvelines. Des travaux sont nécessaires à l’aménagement de la bâtisse en lieu d’exposition, c’est pour cette raison que le Prieuré Maurice Denis ouvre ses portes au public seulement en 1980, soit quatre années après le versement du fonds de dotation. Aujourd’hui dirigé par Marie-Aline Charier et connu sous le nom du Musée Départemental Maurice Denis, le musée fêtera en fin d’année 2020 ses quarante années d’existence et les cent cinquantième anniversaires de Maurice Denis. Classé Monument Historique, le Prieuré est aussi Musée de France et Maison des Illustres. Actuellement fermé pour travaux, il devrait ré-ouvrir ses portes en 2021.

© SUMNER MAUD, Vue du Prieuré côté jardin, aquarelle, Musée Départemental Maurice Denis
Le récolement des œuvres in situ
C’est avec enthousiasme qu’en septembre dernier, j’ai rejoint le service de conservation des collections du musée pour devenir apprentie auprès d’Elisabeth Verbecq, la régisseuse des collections du musée. Les travaux n’avaient pas encore commencé mais les espaces muséographiques avaient déjà été vidés.
Une des premières missions à laquelle j’ai pu participer a été le récolement des œuvres destinées à rester in situ, tant à l’intérieur du musée quand dans le jardin. Il s’agit d’une opération qui vise notamment à localiser les expôts inscrits à l’inventaire, constater leur état de conservation, appliquer des mesures de conservation préventive ou encore prendre des photos actuelles, permettant ainsi de voir l’évolution de ces derniers au cours du temps. Depuis, les Musées de France sont soumis à des obligations (régies par l’article L 451-2 du Code du Patrimoine et article 12 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France) de récoler l’ensemble de leur collection tous les dix ans. Il s’agit d’un travail de fond, qui nécessite parfois beaucoup de temps et de moyens humains et financiers.

© Marie-Aline Charier, directrice du Musée Maurice Denis, lors du récolement de l’Epopée Polonaise pour le monument à Mickiewicz d’Antoine Bourdelle
La protection des œuvres – préparation au chantier
A la suite de la mission précédente et afin de ne pas endommager les œuvres lors de l’intervention des ouvriers, nous avons fait appel à des professionnels pour réaliser des mises à distance de protection. Des protections molles dans des matériaux neutres ont été disposées, puis des coffrages en bois ont été réalisés sur mesure afin de permettre les interventions à venir. Cela concernait plusieurs typologies d’œuvres : des vitraux, une cheminée en céramique, les boiseries du salon de l’Eternel Printemps de Gabriel Thomas ou encore des statues en bronze d’Antoine Bourdelle. Certaines se trouvaient à hauteur d’homme et ne présentaient pas de reliefs particuliers, d’autres étaient installées en hauteur dans l’escalier monumental à double révolution ou bien dans le jardin. De plus, l’intervention à proximité des œuvres impliquait de trouver des systèmes d’attache non invasifs pour les murs et les œuvres, afin que les protections ne soient pas des obstacles au bon déroulement des travaux, et que leur retrait n’implique pas de nouvelles actions.

© Marie-Aline Charier, directrice du Musée Maurice Denis, lors de la réalisation d’un coffrage autoportant pour l’Epopée Polonaise pour le monument à Mickiewicz d’Antoine Bourdelle
Le traitement par anoxie
Au cours de l’année d’apprentissage, j’ai participé à d’autres missions de régie, comme le traitement d’œuvres par anoxie. Cette opération consiste à placer les expôts dans un milieu privé d’oxygène afin de stopper la prolifération puis traiter les potentielles infestations (qu’il s’agisse d’insectes ou encore de moisissures). Pour ce faire, il s’agit principalement d’installer les œuvres dans des poches hermétiques puis d’en retirer l’air, il est aussi possible de placer des sachets de gel de silice pour absorber l’humidité. Les contenants sont par la suite isolés, mis en quarantaine, afin de ne pas contaminer le reste des collections. A l’issue de cette démarche, qui dure en moyenne au moins trois semaines, les œuvres sont sorties de leurs conditionnements et doivent être inspectées et nettoyées. Cela permet de constater l’ampleur des dégâts et de déterminer s’il est nécessaire ou non de prévoir une intervention de restauration.
Le conditionnement sur rouleau
A titre d’exemple, ma maître d’apprentissage et moi nous sommes occupées des anciens rideaux en velours de la chapelle du Prieuré. Inscrits à l’inventaire du musée, ils ont donc un statut patrimonial et doivent être traités au même titre que les autres expôts des collections. Nous avons procédé à leur dépoussiérage par micro-aspiration, avant de les conditionner sur des tubes d’une vingtaine de centimètres de diamètre, composées de matière neutre (c’est-à-dire non abrasive, sans évolution des conditions de conservation dans le temps) à l’aide de larges feuilles de papier de soie. Les rouleaux ont été sécurisés par des bandes de mylar avant d’être installés sur les cantilevers (des rayonnages en porte-à-faux) des réserves du musée. La conservation préventive, née aux alentours des années 1980, a pour principe d’augmenter l’espérance de vie d’un objet en les préservant des détériorations naturelles ou accidentelles pouvant subvenir au cours de leur existence. Elle se différencie de la restauration, qui intervient à posteriori, pour stopper ou masquer les dégradations. Celle-ci n’est cependant pas une solution universelle, car elle s’avère excessivement chère et peut contribuer à la dépréciation du bien, notamment si elle n’est pas réalisée par des spécialistes. A titre d’exemple, il est possible de se référer à la restauration d’une fresque murale renommée humoristiquement « Christ-singe » en 2012, ou encore celle de la statue représentant saint Georges en 2018.

Conditionnement sur rouleau d’un ancien rideau de la chapelle du Prieuré, © C. Quernée
Bilan
Cette année d’apprentissage riche en enseignement et en pratique, alternait des cessions sur le terrain et au bureau, pour les tâches plus administratives. Ces deux aspects sont à la fois éloignés et complémentaires. Si je devais résumer mon apprentissage en quelques mots, je dirais que la régie des collections est une expérience fascinante, où l’on rencontre et travaille avec et pour des œuvres qui pour la plupart sont bien plus âgées que nous et nous survivrons. Le travail que nous effectuons a pour objectif de leur permettre d’exister dans les meilleures conditions possibles, afin qu’elles puissent être présentées au public, autant dans notre musée que dans d’autres instituions, mais surtout et bien encore, qu’elles puissent être transmises aux générations futures. De cette expérience, je garde en mémoire ma rencontre avec mes collègues, avec le lieu, mais aussi avec les œuvres que j’ai découvertes en travaillant à leur contact. Mon alternance s’achève mais le musée réserve de belles surprises à sa réouverture.
Camille Quernée
#apprentissage
#conservationpréventive
#patrimoineculturel
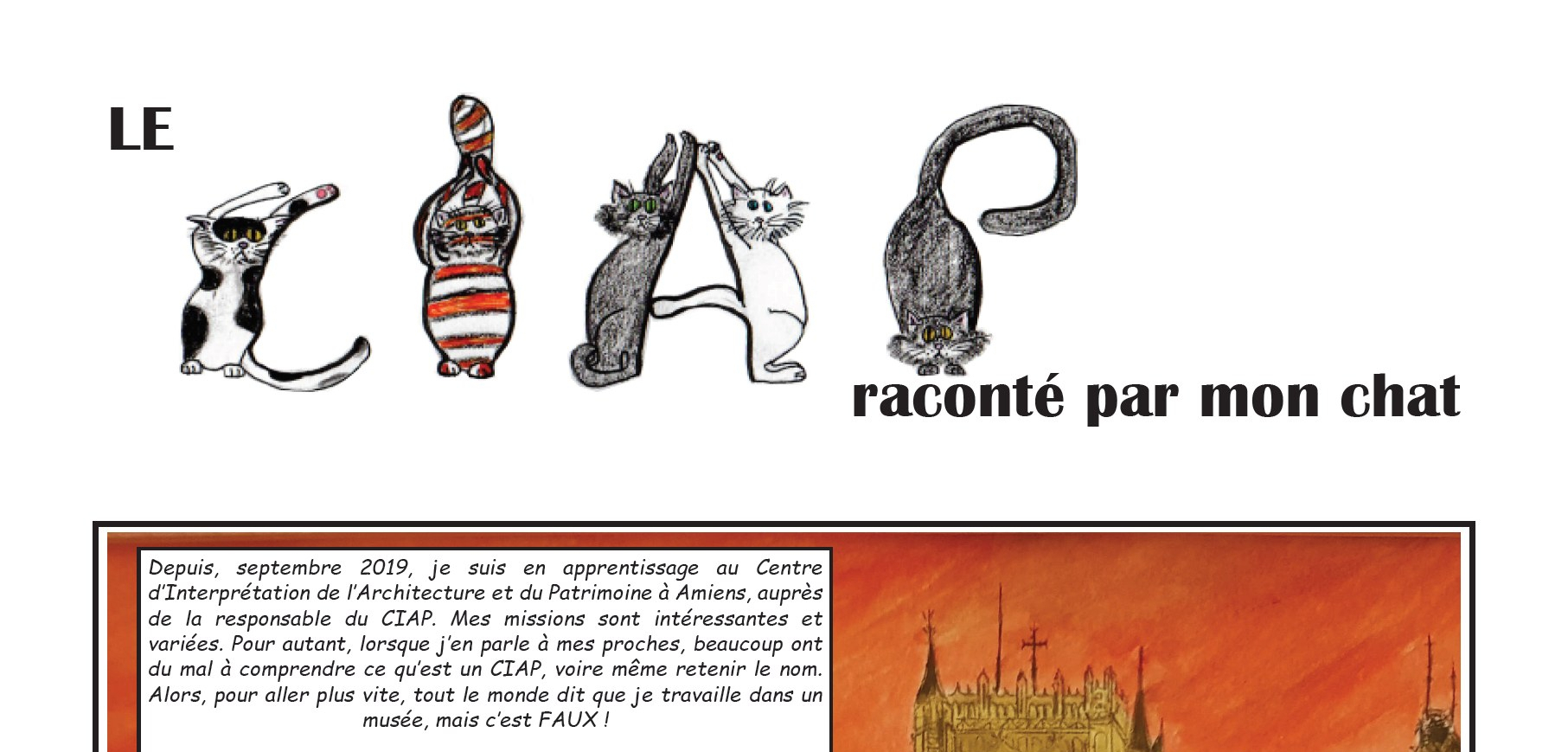
Le CIAP raconté par mon chat


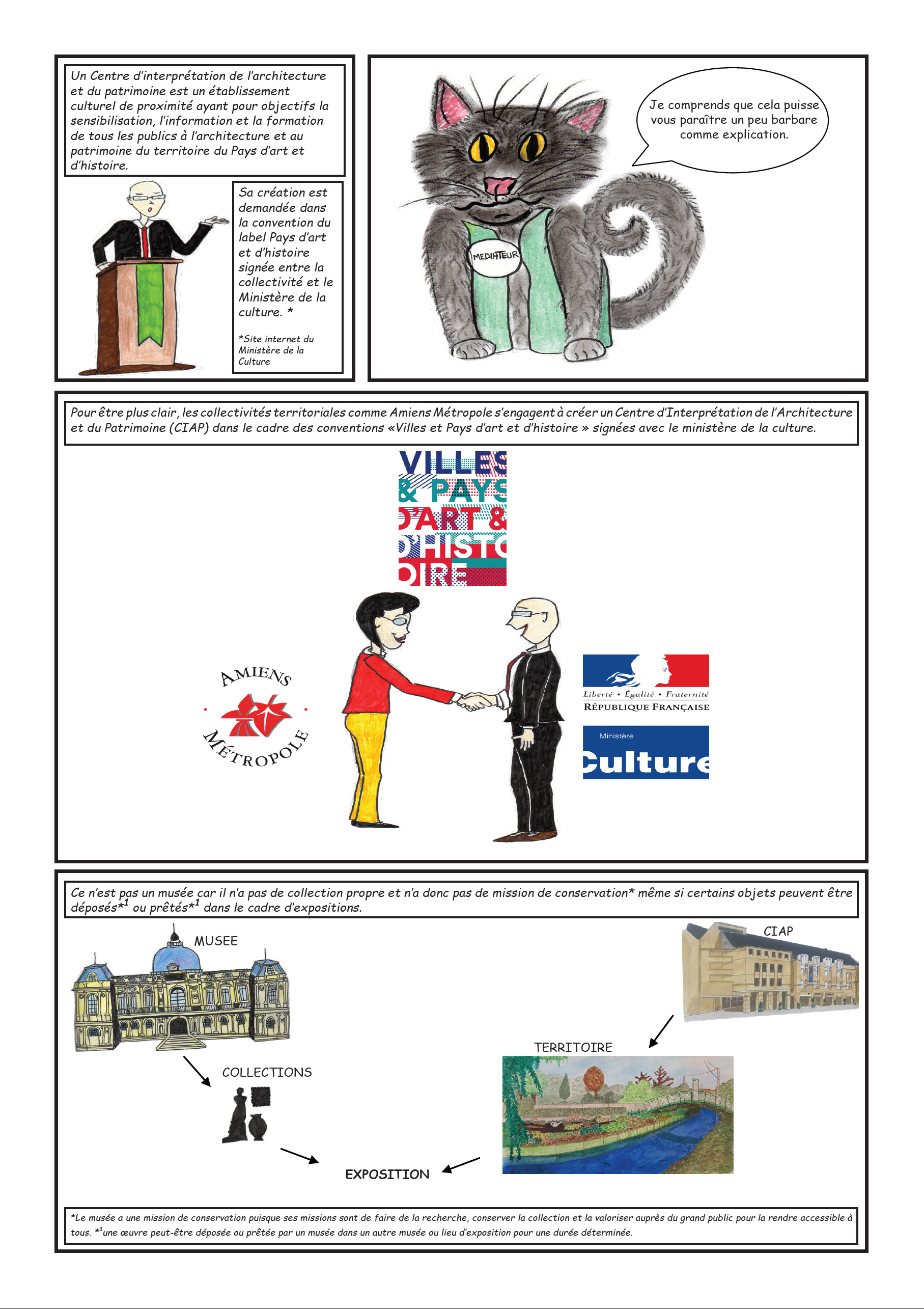
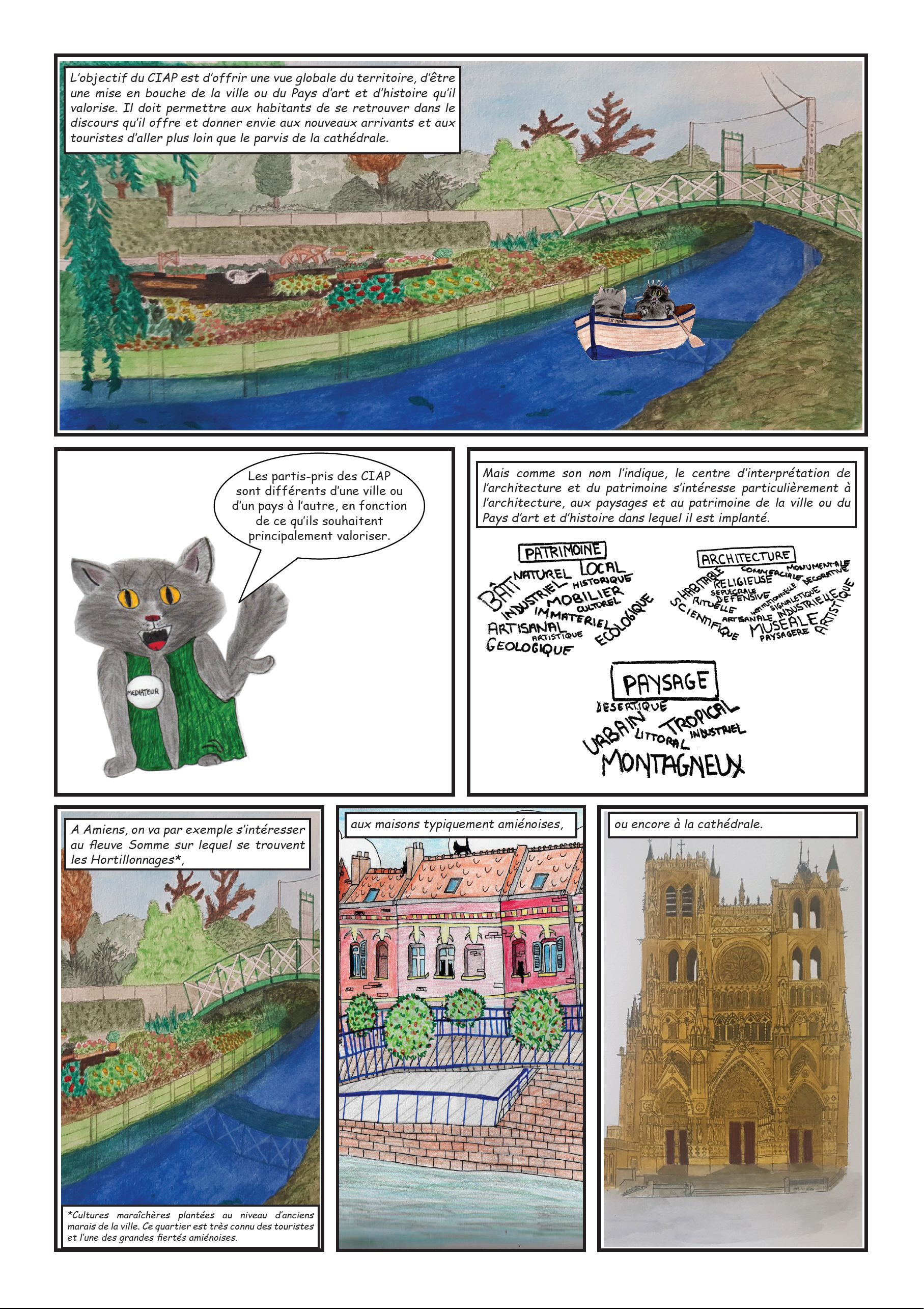
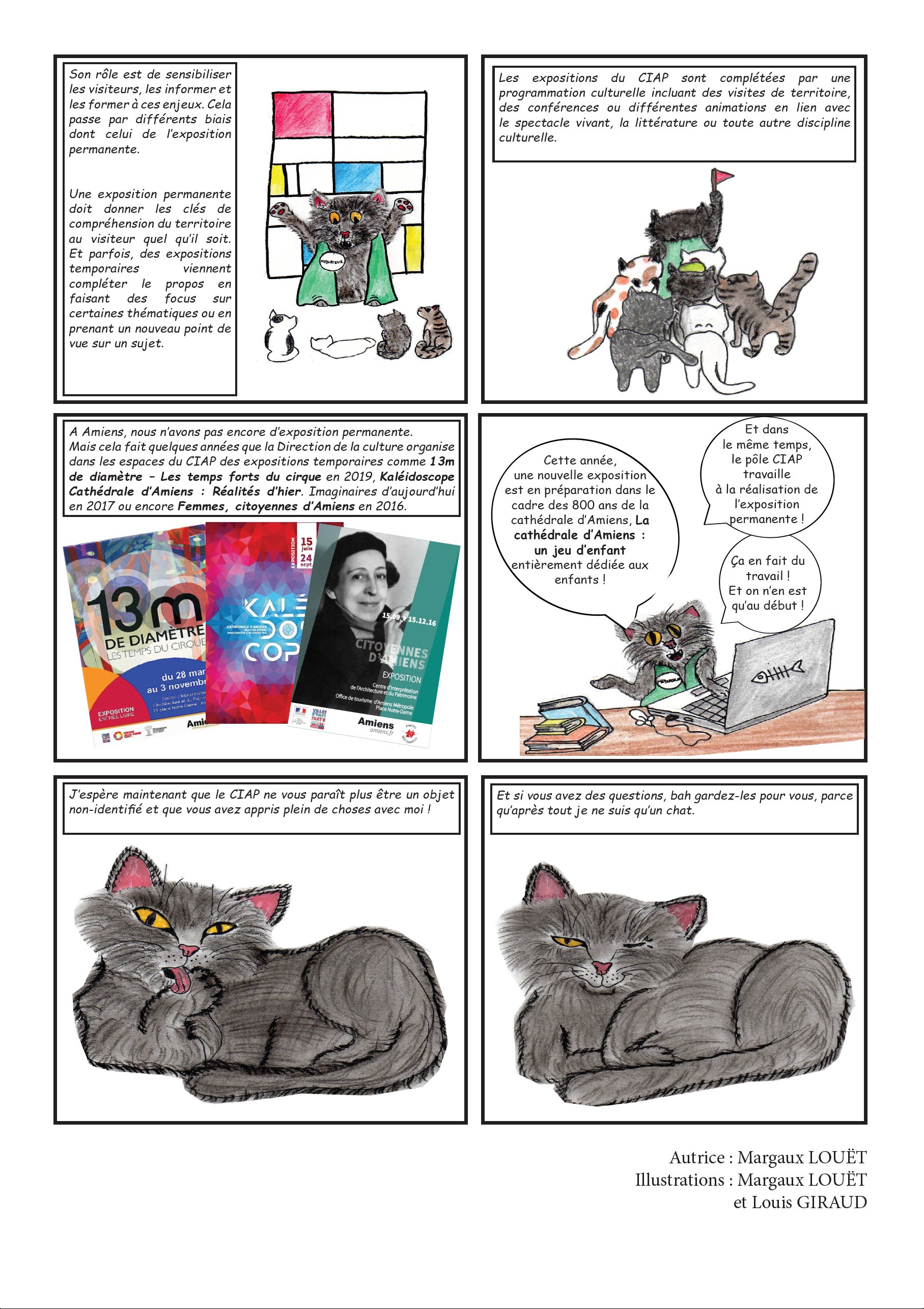
©Le CIAP illustré par mon chat, Margaux LOUËT & Louis GIRAUD
Margaux Louët
#CIAP
#centredinterpretation
#apprentissage
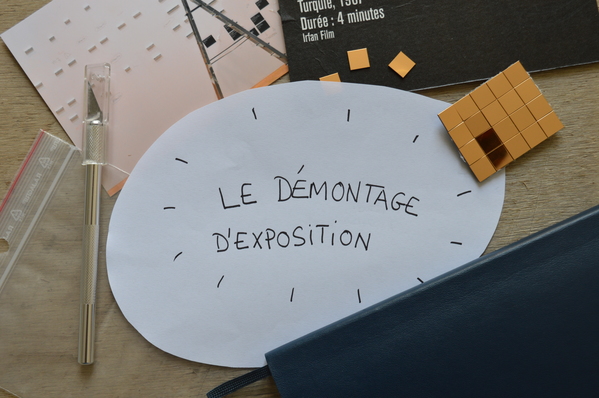
Le démontage d'exposition
Quand s’achève une exposition ? Quand le dernier visiteur est sorti ? Quand le dernier convoyeur est parti ? Aujourd’hui j’ai découvert ce qu’est le démontage d’une exposition, celui de Roman-Photo qui occupait le Mucem du 13 décembre au 24 avril 2018.
Cette dernière relevait de ce média particulier qui relate une histoire en fonctionnant comme une bande dessinée, au détail près que les personnages de l’histoire sont photographiés. L’exposition allait des origines du roman-photo en Italie à ses déclinaisons politiques ou humoristiques. Elle permettait de voir combien cette lecture populaire avait pu être décriée ou réutilisée et avait été l’occasion d’une création photographique de Thierry Bouët, véritable enquête sur les lecteurs de roman-photo aujourd’hui. De même, elle permettait d’étudier les différents genres qui en ressortaient, du ciné-roman au roman-photo érotico-noir, comique et satirique, au photo-roman…
L’opération de démontage d’une exposition suit les principes suivants : retirer les expôts et les protéger pour un transport ou un retour en réserves, démonter les vitrines et cimaises qui les contenaient, quitter les lieux d’une salle d’exposition. Les objets prêtés et exposés, quels qu’ils soient, doivent faire l’objet d’un constat d’état. On les retire des vitrines et on les observe sur une table éclairée avec une lumière rasante afin d’observer les éventuelles altérations. Les objets sont ensuite enveloppés puis déposés dans leur emballage attitré. Alors un convoyeur spécialisé les ramène au lieu prêteur. Lorsque les œuvres ou les artefacts font partie des collections du musée qui expose, ce constat d’état doit aussi être fait.

Eclairage à la lumière rasante pour constat des oeuvres © CC
Le démontage est idéalement assuré par les mêmes personnes qui avaient monté l’exposition : cela permet de se remémorer les difficultés rencontrées lors de l’installation des œuvres et ainsi de mieux anticiper les risques qu’elles pourraient rencontrer.
Lorsque nous entrons dans les locaux de l’exposition, les murs sont pratiquement nus et des annotations marquent les cimaises afin d’identifier les prêteurs ou les productions réalisées par le musée. Les adhésifs sont retirés à la spatule ou à la main. On pourrait penser à un déménagement très organisé : les emballages (depuis le montage conservés en réserves) qui doivent être réutilisés ce-jour sont entreposés dans un angle. Jean-Luc Delest, régisseur des expositions au Mucem annote au fur et à mesure la liste d’œuvres afin de vérifier que chaque œuvre est traitée convenablement puis bien restituée dans son enveloppe, cadre ou boîte d’origine. Il dresse peu à peu la liste de colisage qui recense tous les objets déposés dans telle caisse.
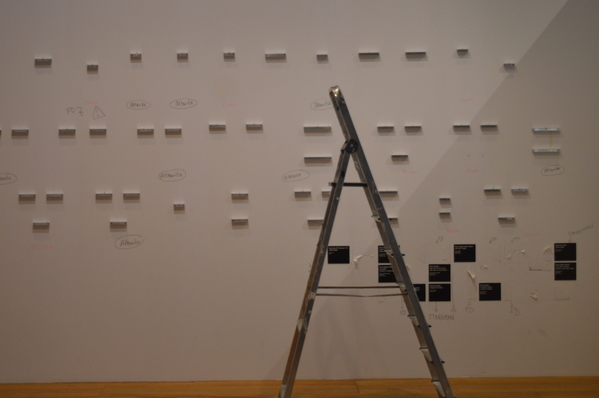
Mur vidé de ses œuvres avec les annotations qui permettent d'identifier les prêteurs © CC
Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le traitement des maquettes du ciné-roman A bout de souffle de Jean-Luc Godard, publié en 1969 dans le Parisien Libéré, soit 10 ans après son tournage. Il s’agit de photographies collées directement sur du carton et des bouts de papier sont collés dessus afin de former les paroles des personnages. Il s’agit d’objets graciles, dont le maintien est fragile et menace de se décoller. Comme ces maquettes appartiennent aux collections du Mucem, il est de les protéger et de les remettre en boîtes avant de retourner en réserve, avec l’aide de Marie-Charlotte Calafat -co-commissaire de l’exposition. Sémira Möller, staigiaire en régie des collections, m'accompagne pour l'assister et pour nous renseigner sur ce moment particulier.
Ces maquettes sont disposées de manière à ne pas être au contact d’un adhésif. Le Mucem a alors fait appel à Bianca Petrea, restauratrice spécialisée dans les arts graphiques. Lors du montage, elle avait collé des angles en plastique sur une plaque centrale de plexiglass, glissé les maquettes dedans et deux plaques de plexiglass étaient fixées de part et d’autre afin de protéger les vignettes tandis qu’un cadre maintenait le tout.
La suite, vous l’attendez, c’est bien entendu, une solution pour retirer dans de bonnes conditions ces maquettes !

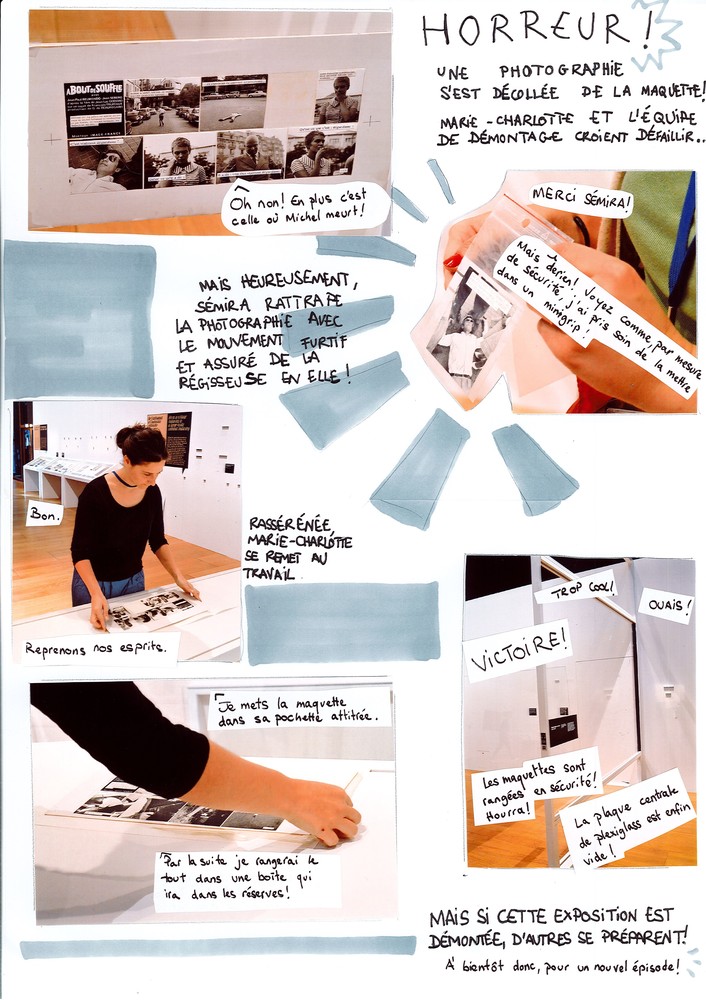
Un grand remerciement à Marie-Charlotte Calafat, Sémira Möller et Bianca Petrea de s’être prêtées au jeu !
Coline Cabouret
#régie
#démontage
#roman-photo

Le MUba Eugène Leroy un musée en perpétuel questionnement et renouvellement
A l’occasion d’un stage au MUba Eugène Leroy de Tourcoing, j’ai eu la chance de participer au premier renouvellement des collections pour l’année 2014. Créé en 1860, et anciennement dénommé Beaux-Arts de Tourcoing, le MUba Eugène Leroy présente ses collections dans un dialogue permanent entre art classique, art moderne et artcontemporain. Peintures, dessins, estampes, sculptures se côtoient dans les parcours où l’on croise par exemple Boilly ou Rembrandt en écho avec les contemporains Antoine Petitprez, Philippe Cazal ou encore avec des figures du xxe siècle comme Martin Barré ou bien sûr Eugène Leroy.
Les collections permanentes occupent la moitié de la surface d'exposition. Leur accrochage est régulièrement renouvelé pour faire écho aux grandes expositions temporaires programmées deux fois par an. L’exposition Permanente / Provisoire a été repensée à travers le thème de la forme et de la sculpture afin de faire écho aux deux expositions temporaires réalisées par le MUba. Le musée des Beaux-arts de la ville propose une grande rétrospective de l’œuvre de l’artiste contemporain autrichien Elmar Trenkwalderet une exposition plus réduite sur la forme et le design pratiquée à la Manufacture de Sèvres par le biais de vases. Ces expositions sont visitables depuis le 17 avril jusqu’au 24 novembre 2014, alors n’hésitez pas à vous y rendre car les expositions mais aussi le lieu valent le détour!
Vue de la salle d'exposition temporaire (c) F.Kleinefenn
L’exposition phare du moment "Ornement et Obsession" est la première rétrospective organisée autour de l’œuvre fantasmagorique d’Elmar Trenkwalder. L’amateur confronté pour la première fois à l’art de cet artiste autrichien, qu’il s’agisse de ses dessins, de ses premières peintures ou des sculptures de terre cuites des dernières années, n’a pas fini de s’étonner. Installé à Cologne au milieu des années 1980, l’artiste né en 1959 et qui vit aujourd’hui à Innsbruck,connaît un succès rapide avec des dessins et des tableaux d’inspiration symboliste dont les cadres, d’abord en moquette, puis en terre, font reculer le contenu du tableau vers la périphérie et l’élargissent. Les premiers travaux en terre émaillée de couleur frappent par l’extraordinaire expression physique du corps masculin dans la droite ligne d’une certaine tradition autrichienne de transgression des limites sexuelles.
Cette grande expositionprésente l’œuvre monumentale de l’artiste, des peintures et dessins, en incluant et mettant en perspective les œuvres acquises par le MUba. Elmar Trenkwalder crée des sculptures monumentales en céramique. Ses structures et ses architectures qui rappellent l’art flamboyant du gothique tardif, fusionnent des formes imaginaires biomorphiques et végétales. La représentation figurative, quant à elle, est déformée, elle joue de symboles féminins et masculins. L'artiste dresse un panorama complexe, fantastique et délirant empreint de formes de l’histoire de l’art, des arts appliqués ou des arts populaires. La grande nef du MUba est emplie de ses œuvres créant une atmosphère particulière, quasi-magique.
 Vue de la salle d'exposition Permanente/Provisoire(c) D. Knoff
Vue de la salle d'exposition Permanente/Provisoire(c) D. Knoff
En liaison avec l’exposition "ElmarTrenkwalder - Ornement et obsession" , l’exposition Permanente /Provisoire intitulée en réponse à la formule de Baudelaire "Un objet pas si ennuyeux que ça, la sculpture?", s’est façonnée à partir de la collection de sculptures du MUba, qui sont ainsi interrogées dans un parcours dynamique sur toutes les composantes de la sculpture, sa matière du marbre à la simple planche de contreplaqué, du bronze à la céramique, en passant par le bois de récupération, de la fonte d’aluminium au plâtre en passant par la terre ; son accrochage, sur un socle, sur le mur, directement au sol, dans l’espace, ou simplement représentée ; ou encore son sujet figuré, réaliste, suggéré ou abstrait. L’exposition Permanente / Provisoire est repensée comme une exposition temporaire, dont la présentation est renouvelée régulièrement. Le parcours de l’exposition propose une déambulation au rythme des œuvres exposées autour de la question de la sculpture selon le concept de la relation de l’art contemporain et l’art ancien. Ces nouvelles relations apportent un nouveau regard sur les œuvres en établissant entre elles des parallèles, multipliant ainsi les lectures possibles de l’œuvre. L’exposition permet de mettre au centre la question du rapport de l’œuvre au lieu et de son expérience.
Autour de ces expositions, le MUba Eugène Leroy, toujours dans un souci de faire dialoguer les arts et les formes, a pensé une exposition temporaire, "V de S", en étroit lien avec la Cité de la Céramique. Le parcours de l’exposition propose de circuler autour des vases et formes emblématiques de la Manufacture autour de la question du renouvellement des formes des vases et de l’étroit lien entre l’art ancien et l’art contemporain. Ces nouvelles relations, associant les plus grands créateurs internationaux aux collections du patrimoine national, apportent un nouveau regard sur les œuvres, multipliant ainsi les grilles de lectures possibles. La Cité de la Céramique représente l’excellence des métiers d’art et de lacréation en France. Les résidences exploratoires d’artistes et de designers qui s’enchaînent depuis des décennies à la Cité de la Céramique, occupent quotidiennement plus d’une centaine de céramistes d’art, et ouvrent l’horizon sur de nouveaux territoires et de nouvelles potentialités artistiques encore inédites. L’exposition propose un parcours au travers d’une double perspective : la continuité de la forme en blanc, que l’on retrouve chez Charpin, Arp ou encore Renonciat et les ruptures, qui ne sont qu’apparentes, proposées par de nombreux artistes et designers tels que Sottsass ou Biecher.
Pour tout cela et bien plus encore, venez découvrir ces expositions particulières et différentes mais toujours en dialogue les unes avec les autres et participant à l’éternelle quête de questionnement et de renouvellement que suit le MUba Eugène Leroy, exemple dont pourrait bien s’inspirer nombreuses autres structures.
Elisa Bellancourt

Le pôle patrimonial de la 27e BIM : son Hôtel de Commandement et son Musée, un ensemble unique
Qui sont les Troupes de Montagne ?
Créées en 1888 pour défendre l’Arc Alpin, les Troupes de Montagne sont dès l’origine une force interarmes spécialisée dans le combat en montagne. Elles apportent une contribution considérable du ski en France et de pratique collective de la Montagne grâce à l’esprit de cordée. Elles acquièrent le statut de Troupes d’élites lors de la Première Guerre mondiale. Les chasseurs de l’unité sont alors surnommés les “diables bleus” par l’adversaire. Cette Armée des Alpes invaincue, confirme sa renommée lors de la Seconde Guerre mondiale à Narvik. Elles sont présentes en 1945 en Autriche et en Kabylie entre 1955 et 1962. La division élargit son cadre d’emploi habituel en 1983 avec la force d’action rapide déployée au Liban et en ex-Yougoslavie. En 1999, la 27e BIM, dépositaire des traditions des Troupes de Montagne, se professionnalise. En 2007, est dévoilé l’existence d’un groupement de commando montagne. L’année 2018 marque les 130 ans de la création des Troupes de Montagne. Aujourd’hui, la qualité première de la 27e BIM est de s’adapter à son environnement afin de pouvoir réaliser toutes ses missions dans un relief escarpé et/ou montagneux dans ses conditions climatiques extrêmes tout en gardant sa “spécificité montagne” dans ses aptitudes morales, physiques, techniques et tactiques, individuellement et collectivement .
Le patrimoine de l’Hôtel des Troupes de Montagnes : chantier de rénovation et de valorisation
Un travail considérable de conservation de l’Hôtel des Troupes de Montagne, est en cours. Les façades en pierre ont été rénovées en 2016-2017, des actions de restaurations du décor intérieur ont été faites, les huisseries et volets sont en train d’être terminés. D’autres opérations continuent d’être menées pour la décoration intérieure - à savoir la restauration du mobilier et des marbres par Monsieur Frédéric Marcos de l’Atelier Pierre et Décoration. Les horloges font également l’objet d’une restauration par un artisan horloger de France d’une maison locale, Monsieur Constant Benoni. La bibliothèque patrimoniale est actuellement remise en place avec des ouvrages datant parfois du XVIIe siècle. Un plan de réaménagement des jardins est actuellement à l’étude afin de retrouver l’esprit des lieux avec l’aide experte du jardinier du Château de Sassenage. Les rénovations permettent ainsi de garder l’Hôtel de Commandement des Troupes de Montagne, exemple unique de notre patrimoine national datant de l’époque Napoléon III (construit entre 1863 et 1868) exceptionnellement proche de son état d’origine. Parallèlement aux chantiers, un écrit d’état des lieux du patrimoine est à venir, afin de répertorier la genèse des lieux ainsi que son état actuel afin que sa mémoire puisse être protégée.
Hôtel des Troupes de Montagne, Horloge et salon Néo-Pompéien © Musée des Troupes de Montagne
Le Musée des Troupes de Montagnes et ses collections
Récemment, le Musée a pu mettre en place ses collections dans des conditions plus optimum en dédiant dans ses réserves des salles par unités d’objets : peinture et documents graphiques, équipements techniques de montagne, uniformes, armements. Il répond ainsi aux normes des Musées de France. Actuellement, il continue à mettre en place ses espaces de stockages adéquats pour la suite des collections comme le département skis et raquettes. Corrélativement à cette mise en place, les équipes effectuent le récolement numérique. Tout ce travail œuvre dans le dessein du programme de l’ICOMAM(le Comité international pour les Musées et les Collections d’armes et d’histoire militaire) en offrant une approche historique, scientifique et objective liée à un contexte social. À ce titre, le Salon des Artistes des Troupes de Montagnes est un événement de solidarité entre les la 27e BIM et des artistes contemporains.
Réserves du Musée des Troupes de Montagne 2021 © Musée des Troupes de Montagne
Pourquoi protéger ce patrimoine militaire ?
Si l’Histoire nous laisse des traces, ses supports de mémoire se font parfois rares. Pourtant, prendre soin de notre héritage, constitue un rempart de nos vies. L’architecture des bâtiments militaires est peu connue, à part quelques illustres exemples tels que les citadelles de Vauban ou bien l’Hôtel national des Invalides qui abrite le Musée de l’Armée. Ces dernières années, ils ont souvent été récupérés pour d’autres usages. Un exemple contemporain culturel d’envergure de reconversion est l’ancienne base sous-marine de Bordeaux devenue “Bassins de Lumières”centre d’art numérique. D’autres exemples renaissent de leurs cendres ; c’est le cas du collège Royal et Militaire de Thiron-Gardais à l’initiative de son dépositaire passionné, Stéphane Bern. Avec ces différents exemples aux programmes variés, force est de constater, combien le patrimoine militaire est fédérateur.
Le patrimoine bâti militaire et les spécificités de l’Hôtel des Troupes de Montagne
Par leur fonction, l’époque, les édifices militaires se sont distingués des constructions civiles par des traits caractéristiques : un plan-masse articulé avec une place d’armes, des volumes et des formes sobres, une façade à la trame répétitive rythmée par des ornements symboliques, des seuils d’entrées de sites particulièrement soignés, un pavoisement toujours présent. La qualification des espaces a toujours été pensée de pair avec l’identification des usages, et dans un esprit de rigueur.
L'Hôtel des Troupes de Montagne a pour spécificité forte d’avoir toujours gardé ses activités opérationnelles dans son site militaire urbain à forte valeur patrimoniale, lui assurant ainsi une protection contre les affres du temps tel que l’abandon, là où d’autres ont eu une parenthèse d'oubli dans le temps. Cette visibilité ne peut se satisfaire d’une simple présence comme protection. En effet, le travail de conservation, de restauration, de publications scientifiques et d’activités muséales est indispensable à sa pérennisation. D’autres leviers restent encore à explorer : l’Armée occupe moins la cité/ville de Grenoble en terme d’étendue facilement identifiable, même si ses ensembles imprègnent profondément l’espace urbain et l'imaginaire collectif de ses habitants, ne serait-ce qu’en terme de repères spatiaux, parcellaires et esthétiques. Présent depuis le XIXe siècle, son existence témoigne de la relation ancrée qui unit la ville à l’institution militaire.
Pour Hannah Arendt, la culture c’est ce qui dure. Ainsi, l’Hôtel des Troupes de Montagne n’a jamais perdu son identité militaire. Aujourd'hui, il affiche clairement ses spécificités en étant force d’actions conjointement avec le Musée des Troupes de Montagnes. Lors des journées du patrimoine, en 2020, le Général de la 27e BIM a ouvert son bureau officiel au public pour la première fois, actant le lien militaire civil et rappelant que ce patrimoine appartient à la Nation française. Ce patrimoine vivant, ne cesse de mener une politique de remise en valeur interne et externe avec l’exigence de la représentation militaire. Ce patrimoine architectural et muséal militaire est doté de multiples fonctions : l’héritage de l’histoire des Troupes de Montagne, une reconnaissance au service des familles qui dédient leurs vies à la Nation, une identification et une pérennisation de sa présence. Et, surtout un vecteur de transmission de la culture militaire qui incarne l’esprit de Défense auprès du monde civil comme du monde militaire qui n’en a pas toujours justement conscience.

Hôtel des Troupes de Montagne, 37ème édition des Journées du Patrimoine © Musée des Troupes de Montagne
Charlène Paris
#architecture #patrimoine #conservation #gestioncollection #museesdefrance #journéesdupatrimoine

Les coulisses d'un montage
Comment arrive-t-on en cours de projet d’exposition ? Qu’est-ce qui fait un montage réussi ? Dans le cadre de mon stage au service Muséologie du Musée Royal de l’Afrique Centrale à Bruxelles, j’ai eu l’opportunité de monter Where we are at ! Other voices ofgender, une exposition de Christine Eyene, commissaire indépendante franco-camerounaise invitée par les deux institutions culturelles belges organisatrices : le Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC) et Bozar.

ZANELE MUHOLI, Miss Lesbian I, 2009 C-type print Photograph: Sean Fitzpatrick© Zanele Muholi
Comment arrive-t-on en cours de projet d’exposition ? Qu’est-ce qui fait un montage réussi ? Dans le cadre de mon stage au service Muséologie du Musée Royal de l’Afrique Centrale à Bruxelles, j’ai eu l’opportunité de monter Where we are at ! Other voices ofgender, une exposition de Christine Eyene, commissaire indépendante franco-camerounaise invitée par les deux institutions culturelles belges organisatrices : le Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC) et Bozar. Cette exposition a été présentée du 18 juin au 31 août 2014 à Bozar. Programmée dans le cadre de Summer of Photography, l’exposition répondait au thème de cette année : la question du genre. Tout en faisant la part belle aux seize artistes photographes et/ou vidéastes de l’exposition, Christine Eyene proposait de développer sa pensée et de retracer l’histoire du mouvement féministe noir.
Arrivée depuis peu en stage, j’ai été directement mise au courant de l’avancée du projet et présentée aux personnes parties prenantes, c’est-à-dire mes collègues du MRAC, les personnes en charge à Bozar et la commissaire d’exposition. J’ai donc effectué des recherches sur les artistes invitées, l’évaluation des besoins en tirages et encadrements des photographies, ainsi qu’un inventaire des cadres du service Muséologie.
Installation du matériel vidéo, Crédits:O.L
Vue du même endroit à la fin du montage, Crédits : O.L
Quand un projet d’exposition est programmé dans une institution aussi importante que Bozar, des aléas inévitables surviennent : la commissaire a eu, un mois avant le vernissage, la validation définitive des salles dévolues à l’exposition. Cela fait parti du jeu. Régler l’épineuse question du parcours de l’exposition fut donc un des objectifs principaux. Etant donné la configuration des salles (étroites et en enfilade), la nature des œuvres (photographies, projections vidéos et vidéos sur moniteurs) il nous a fallu trouver les solutions optimales afin de satisfaire le propos de la commissaire et la cohérence de celui-ci tout en sélectionnant le meilleur emplacement possible pour les projections. En effet, projeter une vidéo dans une salle étroite pose de nombreux problèmes techniques et sans les compétences de Ludo Engels, en charge de l’audiovisuel au MRAC, nous aurions été démunis. De plus, exposer alternativement des vidéos et des photographies demande une grande vigilance quant à la question de l’éclairage.
Documents indispensables : plan et liste d’œuvres,
Crédits : O.L
C’est en nous réunissant régulièrement, en communicant les propositions de chacun que nous avons pu trouver le parcours optimal. Toute la complexité d’un montage réside en la prise en compte de multiples paramètres comme ne pas dénaturer les œuvres des artistes mais aussi l’espace d’exposition, la nature des œuvres, le propos du commissaire, le confort du public, les difficultés techniques, le respect des budgets. Il faut donc trouver le bon dosage. C’est sur le chantier qu’opère ou non l’alchimie subtile. Allons donc voir de plus près cette étape singulière.
Initialement, Ludo Engels et moi-même devions être les petites mains du MRAC à Bozar. Par un concours de circonstances nous nous sommes retrouvés co-responsables du montage. Nous voici donc en train de mettre en espace un des événements culturels majeurs de l’été. Quelle chance et quelle confiance on nous faisait ! La première semaine j’ai beaucoup attendu car l’équipe technique montait les cimaises et la black box, peignait les murs. Ludo Engels se battait avec ses fils, connections, fixations, moniteurs,vidéo-projecteurs. Et il pratiquait la méthode Coué quand les fichiers vidéos arrivaient au dernier moment. Pour ma part, après avoir eu la chance d’accompagner Christine Bluard chez l’encadreur pour choisir les cadres et les marie-louise et par la même occasion voir les tirages de près, j’ai gardé à l’esprit les souhaits de Christine Eyene en indiquant aux techniciens free-lance parfaitement professionnels où et à quelle hauteur accrocher les photographies. Bon, tout de même quant arrivait un imprévu, comme un changement d’œuvres de dernière minute, il fallait bien que j’improvise, et quand l’accrochage ne mettait pas en valeur les photographies, je réfléchissais (et oui) à la meilleure disposition des photos, me mettant tour à tour dans la peau du visiteur lambda, de la commissaire et de la responsable technique de Bozar.
Installation des œuvres de Lisa Hilli et Hélène Jayet, Crédits : Danae Tezapsidou
Les art Handlers installant une série de Zanele Muholi, Crédits : O.L
Et puis, il fallait surtout penser au public et aux œuvres. Oui il faut des assises dans un parcours d’exposition, oui, même devant une vidéo de 3 minutes ! Et aux œuvres, oui telle œuvre doit se découvrir au dernier moment, « parfait les rideaux », « ah, quelle vitrine pour les documents d’archives ? ", "Quelle position sur le mur pour un poème ?"... Heureusement mes expériences de médiatrice culturelle et d’artiste plasticienne m’ont aidée. Et, quand la commissaire arrive, le grand stress, ai-je fait ce qu’il fallait ?Heureusement l’ensemble du personnel du MRAC, de Bozar et les free-lance, par leur professionnalisme et leur expérience, m’ont énormément appris.
Et ce moment si particulier, quand nous enlevons les derniers outils, les derniers emballages oubliés un peu partout et qu’enfin, le parcours et les œuvres deviennent une exposition prête à être visitée, qu’arrivent les artistes, que la commissaire sourit, soulagée, et qu’on a enfin le temps de penser à prendre un peu l’air avant les discours et le verre tant attendu, quel plaisir et quelle chance ! Je n’ai qu’une hâte, le prochain montage !
Entrée de l'exposition, vidéo de présentation, Christine Eyene,
Crédits : Danae Tezapsidou
Ophélie Laloy
Je remercie chaleureusement Christine Bluard, Ludo Engels, Christine Eyene, Kathleen Louw, Isabelle Speybrouck ainsi que les techniciens free-lance et les équipes de Bozar.
Pour aller plus loin :
- La page de l'exposition sur le site de Bozar- Le blog du MRAC
#art contemporain
#montage d’exposition
#brève de stage

Ma licorne a un zizi...
Ma licorne a un zizi. Pour être tout à fait exact, elle en a même plusieurs et n'a pas que cela.
Nota Bene : lorsqu'une personne part à la recherche d'un stage ou d'un emploi, entreprise digne de la quête du Graal, nous employons volontiers le terme licorne. Celui-ci a le mérite de planter le décor et fédère la grande communauté de « chercheurs » y compris les plus réticents à tout univers onirique et fantastique.
La Licorne de Stéphane Laurent © marin
J'ai eu la chance de trouver une licorne étonnante, effectivement pourvue de nombreux zizis.
Elle propose au public de découvrir le travail des artistes qu'elle soutient. Bertrand Mandico, Tom de Pékin, Eve Servent, Mavado Charon, Anne Van Der Linden, Jean-Louis Costes, Charles Pennequin, Honoré, Francis Deschodt, Gérard Duchêne, Marc Brunier Mestas, Emmanuelle Gailliez, Paul Armand Gette, Benjamin Monti, entre autres, composent la famille éclectique, riche et fantasque de ma licorne. Ils l'aiment, lui font confiance et vivent en parfaite symbiose.
Ma licorne est une galerie.
Née d'une envie forte de présenter des travaux différents, associée à une passion pour le papier, le dessin et l'estampe (gravure, sérigraphie) à une époque qui voyait à peine resurgir l'engouement pour ces médiums, ma licorne s'est rapidement étoffée autour de ce noyau fondamental et ouverte aux autres pratiques artistiques.
Ma licorne est experte et éclectique.
Parmi ses dernières créations, Bilan provisoire. 5 ans d'éditions à la Belle Époque et Curiosa1 ont comblé le public, habitué comme novice. La première exposition proposait la découverte - ou la redécouverte - de cinq années d'éditions dans un espace qui échappait à l'effet de saturation grâce à une scénographie rythmée : les livres de la Collection Or voisinaient gaiement avec une centaine de cadres, écrins des sérigraphies, photographies et dessins « production maison », savamment présentés en série, nuage et autres formes de blocs organisées de façon à offrir de nécessaires espaces de respiration. La seconde introduisait le volume. Le travail de deux complices, Eve Servent et Stéphane Laurent, offrait une nouvelle dynamique et un dialogue savoureux avec les travaux des autres artistes tout aussi impertinents mais sur papier cette fois. Ces deux formes ont été visibles quelques semaines seulement.
Ma licorne est multiple et intense.
Elle célèbre le commencement et la fin de ces « objets éphémères ». Si vernissages et finissages représentent le contexte idéal pour un coup de foudre entre œuvres et particuliers, ils sont surtout l'occasion de rencontres ou de retrouvailles.
Ma licorne est un réseau.
Pour vivre, elle s'octroie un pourcentage sur les ventes d’œuvres qu'elle initie, emmène un joli nombre d'adhérents, concocte livres et sérigraphies - ma licorne est également maison d'édition2 - , réalise des ateliers autour de la pratique de la sérigraphie. Tout cela lui permet de mener une existence sereine, hors du circuit des subventions, libre de posséder tous les zizis qu'elle souhaite.
Ma licorne est autofinancée.
Parmi le petit groupe de personnes qui veille sur elle, une personne la bichonne tout particulièrement : son créateur. Puissant magicien, il a réalisé la métamorphose de cette très belle licorne et lui permet de s'épanouir. Il met un point d'honneur à ce qu'elle garde son indépendance.
Ma licorne a un caractère bien trempé.
Empreinte d'une certaine irrévérence, elle convoque des sentiments entiers : elle séduit ou déplaît mais ne laisse personne indifférent. Je ne résiste pas à vous confier un petit florilège d'expressions, gênées mais amusées, recueilli à son sujet : « C'est malsain, mais c'est drôle, mais c'est malsain... Mais c'est drôle. » ; « C'est crapouillou. » ; « C'est carrément énorme. » ; « C'est cru. » ; « Ah, non, moi je ne peux pas regarder sinon...3 ».
Ma licorne est impétueuse et pleine de poésie.
Elle vit au pied des immeubles d'une petite cité accrochée à un gigantesque centre commercial, non loin de Lille.
On la rencontre parfois hors de son antre, à l'occasion de diverses manifestations (salons, etc.) toujours choisies avec soin.
Ma licorne est à contre-courant et exigeante.
L'aventure à ses côtés fut belle et enrichissante. D'autres sont à venir, à vous de me rejoindre pour la suivre !
Devanture de la galerie © David Ritzinger
M.
1: « Objets littéraires illustrés à la facture soignée et à la typographie raffinée, les Curiosa, tour à tour cocasses et coquins, sont des livres apparus à la fin du 19ème siècle qui peuplaient « les Enfers » des bibliothèques avant que ceux-ci ne disparaissent des collections. » Définition composée par D. Ritzinger à partir, notamment, de celle trouvée sur le site : http://curiosaetc.wordpress.com/curiosa-caetera-une-collection-litteraire-au-castor-astral-editeur/
2: Les éditions La Belle Époque sont également présentées à Paris, galerie Arts Factory ; à Saint-Ouen, galerie La Couleuvre ; à Marseille, librairie Le Lièvre de mars ; à Bécherel en Bretagne ; à Bruxelles, galerie E-Carré et à Liège, galerie/librairie Le Comptoir dulivre.
3: Jeu : trouver la phrase prononcée par un certain S. C..
Pour en savoir plus sur la maison de la licorne :
- Exposition du moment : A fleur de peaux du 8 novembre au 19 décembre2014
Emmanuelle Gailliez (dessin / objet), Michel Gouéry(céramique), Cécile Jarsaillon (broderie)
- Rendez-vous à :
Association Loi 1901, La Belle Époque [Arts Contemporains]
Galerie Une Poussière Dans L'Œil
17 bis Chemin des Vieux Arbres
59650 Villeneuve d'Ascq
Métro Hôtel de Ville – Parking Auchan V2
Ouverture de 15h à 18h30 le mercredi, vendredi et samedi durant les périodes d'exposition, ainsi que sur rendez vous au 06.09.96.71.47
#licorne
#La Belle Époque
#Une Poussière Dans L’Œil
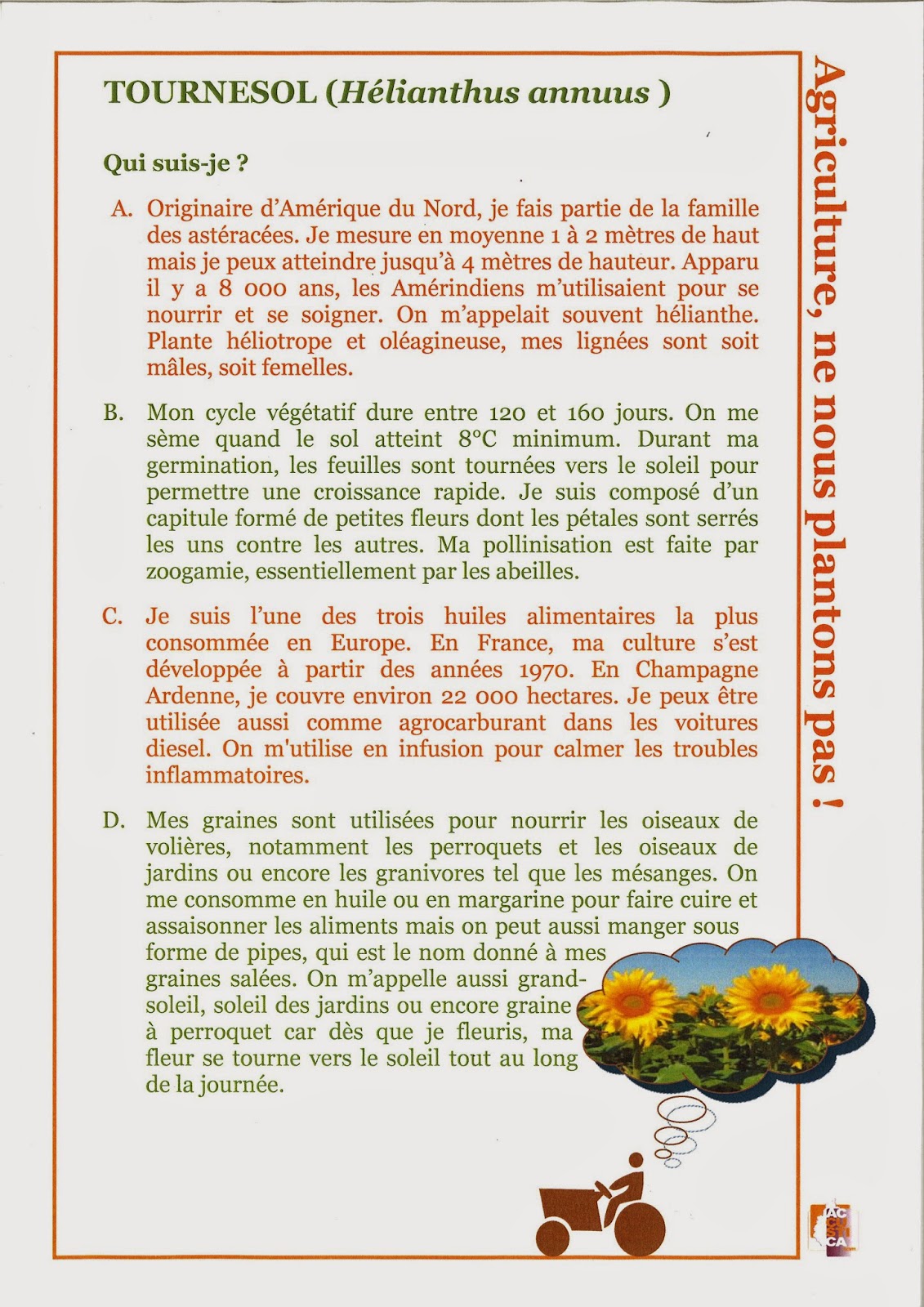
Mallette pédagogique, brève de stage
En première année du Master Expographie Muséographie, j’ai effectué mon stage à Accustica à Reims en tant que chargée de mission pour la création d’une mallette pédagogique sur l’agriculture. Il a fallu concevoir le contenu, penser les objectifs des outils, prévoir leurs formes et leur faisabilité mais aussi acheter le matériel en lien avec la malle ainsi que des livres et des jeux pouvant l’accompagner. Il s’agit de donner les clés à l’emprunteur de la malle pour qu’il comprenne l’agriculture.
Accustica, un CCSTI, une association
Créée en 2005, l'association Accustica est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Elle vise à promouvoir la culture scientifique en Champagne-Ardenne.Elle fut aussi nommée Pôle Territorial de Référence (PTR) en 2012 par le préfetde Région et le Président du Conseil régional. Par cette nomination, l'associationdoit animer le réseau régional des CSTI dans le respect de la diversité locale,proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives et inscrire lapolitique d'action culturelle régionale dans un projet global national pilotépar Universcience.
Les missions d'Accustica
- Rendre accessible au plus grand nombre les Sciences et les Techniques : enfants des écoles primaires, collégiens, lycéens, étudiants du supérieur et grand public.
- Favoriser la création et la diffusion d'outils de médiation et d'expositions itinérantes pour les professionnels et les amateurs de science.
- Mettre en place de nombreuses actions avec l'ensemble de ses partenaires, comme par exemple la Fête de la Science, organiser des conférences scientifiques et des visites d'industries ainsi qu'organiser des rencontres entre scientifiques et grand public (cafés des sciences, spectacles, portes ouvertes, Exposciences, Classes en Fac).
- Mettre en œuvre une politique globale de culture scientifique et technique en région Champagne-Ardenne en créant un réseau qui regroupe tous les acteurs locaux de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (industriels, laboratoires de recherche publics et privés, collectivités territoriales, milieux éducatifs, monde culturel et associatif,...), pour permettre une meilleure diffusion de cette culture scientifique, technique et industrielle sur l'ensemble du territoire régional.
Ma mission de chargée de médiation
J’avais pour mission de créer une Malle Doc sur le thème de l’agriculture, intitulée :« Agriculture, ne nous plantons pas ! ». Elle est composée de cinq outils pédagogiques. L’un des outils représentatifs de cette mallette, le « Qui suis-je » est un jeu qui consiste à deviner le nom d'une plante par le biais d'une courte biographie, d'une vingtaine de lignes, énoncée par l'animateur. Celle-ci commence toujours par des indices difficiles, puis de plus en plus faciles, de telle sorte que s'il est en général difficile de donner la réponse au début, tout le monde est susceptible de trouver la réponse à la fin de l'énoncé. Le candidat gagne de 4 points à 1 point selon la rapidité de sa réponse. Les habitués de Question pour un champion connaissent le principe…
Je vous propose de tester une énigme :
Qui suis-je ?
A. Originaire d’Amérique du Nord, je fais partie de la famille des astéracées. Je mesure en moyenne 1 à 2 mètres de haut mais je peux atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur. Apparu il y a 8 000 ans, les Amérindiens m’utilisaient pour se nourrir et se soigner. On m’appelait souvent hélianthe. Plante héliotrope et oléagineuse, mes lignées sont soit mâles, soit femelles.
B. Mon cycle végétatif dure entre 120 et 160 jours. On me sème quand le sol atteint 8°C minimum. Durant ma germination, les feuilles sont tournées vers le soleil pour permettre une croissance rapide. Je suis composé d’un capitule formé de petites fleurs dont les pétales sont serrés les uns contre les autres. Ma pollinisation est faite par zoogamie, essentiellement par les abeilles.
C. Je suis l’une des trois huiles alimentaires la plus consommée en Europe. En France, ma culture s’est développée à partir des années 1970. En Champagne Ardenne, je couvre environ 22000 hectares. Je peux être utilisée aussi comme agrocarburant dans les voitures diesel. On m'utilise aussi en infusion pour calmer les troubles inflammatoires.
D. Mes graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux de volières, notamment les perroquets et les oiseaux de jardins ou encore les granivores tels que les mésanges. On me consomme en huile ou en margarine pour faire cuire et assaisonner les aliments mais on peut aussi me manger sous forme de pipes, qui est le nom donné à mes graines salées. On m’appelle aussi grand-soleil, soleil des jardins ou encore graine à perroquet car dès que je fleuris, ma fleur se tourne vers le soleil tout au long de la journée.
La conception d’un outil pédagogique n’est pas facile : le contenant comme le contenu, à la fois ludique et pédagogique, donneront-ils envie d'utiliser l'outil et de comprendre le message que fait passer cette activité ? Tel est le défi.
Avez-vous trouvé ?
Si non, j’espère que vous avez appris des informations sur cette plante.
Si oui, bravo vous devez être un as de l’agriculture, j’espère que vous avez appréciéles explications pour la conception d’outils pédagogiques simples.
Voici la réponse :
L'une des fiches du jeu "Qui suis-je ?" - © Ludivine Perard
Ludivine Perard
#science
# brève de stage
# mallette pédagogique
Pour aller plus loin :
Mon truc.
Vous allez découvrir « le truc » d’une apprentie en médiation et conception de médiation au Musée portuaire de Dunkerque.
Voilà mon truc. © L.T.
Pour devenir déléguée de classe, maire ou présidente de la République, parrain ou marraine dans certaines religions, il faut que chaque personne aille chercher au plus profond d’elle et couche sur papier sa profession de foi. Moi en tant qu’individu, d’après mon vécu et mes ambitions, quels projets et quelles propositions suis-je prête à mener ou faire pour servir et défendre La cause ? Quelles sont mes motivations et serai-je à la hauteur ?
Lorsque vous décidez de vous lancer dans l’incroyable aventure de la Culture, vous n’avez pas assez de vos dix doigts pour compter le nombre de personnes qui vous disent : « mais c’est pas une voie bouchée ? », « tu sais, ce sont souvent des contrats précaires… », « 5 ans d’études pour gagner le SMIC, quand même ! », « mais d’où ça te vient cette idée ? »… Et pourtant, au bout de ces (minimum) cinq années d’études, peut-être ponctuées de crises existentielles, de remises en question pour savoir « mais oui, qu’est-ce que je fous-là ? », de moments de flottements et d’autres périodes dont je tairais le nom : vous êtes toujours là, toujours vivante, toujours debout. Bien que cela ne vous empêche pas de vous demander régulièrement pourquoi vous faites ça. Mais au fond vous savez…parce que, comme moi, vous avez trouvez votre truc, ce truc.
Je ne peux écrire votre profession de foi à votre place mais peut-être vous retrouverez-vous dans la mienne. Cette profession de foi n’est une liste de mes résolutions professionnelles 2018 car comme beaucoup, je ne tiens pas mes résolutions. Non, cette profession de foi est plutôt une définition de ce qu’est mon truc, voire une déclaration d’amour (en tout bien, tout honneur). À regarder les modèles de profession de foi des candidats aux élections de délégué de classe : mes motivations, mes projets et propositions, ma présentation, j’ai trouvé l’inspiration pour en créer un nouveau genre. Voici donc ce qu’est mon truc.
Ce truc, ce n’est pas ce qui me permet de me lever de bonne humeur tous les matins ou de m’empêcher de mettre six réveils... Ce truc, ce n’est pas ce qui va me rendre souriante et heureuse d’être collée à des inconnus dans le métro, de ne pas trouver de place libre dans le train ou d’être coincée comme chaque matin dans les bouchons… Ce truc, ce n’est pas ce qui va me permettre de ne pas finir mon mois le 15 ou de ne plus manger de pâtes à partir du 15… Non, définitivement, ce n’est pas ça mon truc. Bien sûr la liste de ce que n’est pas mon truc pourrait être plus longue mais je n’ai pas envie de me démotiver ou de laisser penser que finalement, ce n’est pas mon truc. Qu’est-ce donc alors ?
Mon truc, c’est de ne pas être découragée quand les gens me regardent avec de gros yeux parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est la muséographie ou la médiation culturelle. C’est d’être à chaque fois, oui à chaque fois, contente d’expliquer ce que c’est mon métier, de pouvoir faire découvrir et transmettre pour mon truc parce qu’au final, c’est ça aussi la médiation. Mon truc, c’est de ne jamais me lasser de raconter toujours la même explication à des membres de ma famille, des professionnels, des visiteurs quand on me demande ce que je fais et surtout de terminer en disant « j’ai trouvé mon truc ». Mon truc, c’est de rencontrer des gens de tout âge, de tout horizon social et géographique pour leur raconter une histoire pendant qu’ils me racontent la leur. C’est se sentir utile, tenter de faire des blagues qui ne fonctionnent pas vraiment…et pourtant ne jamais désespérer et croire que cela marchera un jour avec un autre groupe de visiteur. Mon truc, c’est accueillir les gens en souriant même si je n’ai pas le moral, commencer et finir une visite trempée par la pluie et bousculée par le vent. C’est entendre les gens me remercier et me dire qu’ils « se coucheront moins bêtes ce soir ! », c’est rire avec les enfants qui s’exclament que le corsaire dunkerquois s’appelle Jean-Luc ou Jean-Marc. Mon truc, c’est d’être sûre d’avoir le sourire en arrivant au bureau et de partager des moments avec des collègues qui ont le même truc que moi. C’est aussi de rêver la nuit des événements que j’organise, souvent des rêves qui se transforment en cauchemar…et de me rendre compte que je ne suis justement pas la seule au musée à qui cela arrive, non, c’est normal : « le métier qui rentre ». Mon truc est composé de mille trucs…
Alors, au terme de cette définition non exhaustive, je me rends compte que je ne suis finalement pas avancée et incapable de savoir ce que c’est ce truc. Or, le plus important à retenir est qu’il ne suffit pas de pouvoir mettre des mots mais d’en ressentir toutes les facettes car comme dans la vie, le bonheur est fait de petits trucs.
Lucie Taverne
#apprentissage#mediation#2018

Muséologie à la Suisse
J’aime les musées parce que ce sont des lieux où je me suis toujours senti à l’aise. Jamais froids comme les églises, ni bruyants comme les magasins, parfois je m’y rends simplement pour passer un bon moment, seule ou en compagnie.
Cette année j’ai eu la possibilité de découvrir la vie cachée et mystérieuse d’un musée, en travaillant au “cœur” du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel. Arrivée en avril 2016 pour contribuer au déménagement des collections que le prestigieux MEN s’est imposé d’accomplir à l’occasion de sa rénovation, j’ai enfilé la blouse blanche et les gants bleu que le protocole d’hygiène exige et j’ai commencé à découvrir les coulisses d’une des institutions qui ont fait école en matière de muséographie.

Musée d'Ethnographie de Neuchâtel
Le travail au récolement des réserves (la vérification de la présence des objets dans l’inventaire informatique) est minutieux et patient, étant avant tout la reconstitution d’une histoire : celle des pièces et du chemin qui les a amenées jusqu’à la Colline de Saint-Nicolas.
C’est un puzzle de vieilles lettres jaunies par les temps, des biographies des missionnaires, des cartes géographiques obsolètes qu’il me faut compléter pour pouvoir récupérer leur mémoire.
Liste non exhaustive des certaines pièces incroyables que j’ai pu traiter :
- Panier de divination de la tribu Thonga du Mozambique avec les osselets humains servant aux rites
- Poupée de fertilité Akuaba que les femmes du Congo portent sur le dos lorsqu’elles désirent rester enceintes
- Flèches empoisonnées au curare du Sud Afrique

Réserves d'Afrique australe du MEN © F.Valla
La fascination est telle que je commence à me demander : et si ce séjour en Suisse me transformait en une fétichiste des objets museaux ?
Heureusement, j’ai l’occasion d’en discuter avec un interlocuteur très spécial : Jacques Hainard, conservateur du MEN de 1980 à 2006, 25 expositions temporaires à son actif et partisan de la muséologie de la rupture.
Sur la terrasse du musée qui nous offre une vue de carte postale sur le lac de Neuchâtel, Monsieur Hainard nous accorde (à moi et aux autres chanceuses stagiaires) deux heures de discussion sur la place des objets dans les musées, les changements de la société et la conséquente évolution de la place du muséographe.
Jusqu'à peu, nous dit-il, les objets structuraient le musée, mais aujourd’hui nous observons l’arrivée de musées d’idées. Il s’agit d’un nouveau moyen de diffuser le savoir, de produire un discours qui est désormais plus important que les objets des collections.
Quelques exemples en Suisse :
- L’Alimentarium de Vevey (qui a ouvert ses portes le 4 juin) : très peu d’objets, large utilisation du numérique.
- Le MUCIVI (Musée des civilisations de l'Islam) de La-Chaux-de-Fonds : pas de collection propre au musée, mais une audioguide d’1h30 à écouter, nécessaire pour profiter de la visite.
- Le Musée international de la Croix-Rouge à Genève : également peu d’objets, mais une muséographie innovante et une scénographie crée par trois architectes différents. Ce musée s’est vu attribuer le Prix Kenneth Hudson, distinction décernée à « la réalisation muséale la plus insolite et audacieuse permettant d’appréhender sous un angle nouveau le rôle des musées au sein de la société »
En effet, les objets changent de matérialité avec la numérisation. Nous pouvons “acheter une exposition”, y accéder depuis notre salon, via les bases de données, les documents, le virtuel. Et si, selon Hainard, les objets ne sont que l’équivalent des illustrations d’un livre pour les expositions, il paraissait logique que la tendance actuelle soit de s’en passer, en profitant de nouvelles possibilités offertes par la révolution numérique.
“Avec les mêmes pièces mais un scénario et une scénographie différents on peut produire deux expositions qui disent exactement le contraire de l’autre”, poursuit-il, la voix enflammée et les yeux qui sourient derrière les lunettes. Il donne alors l’exemple de l’exposition « La différence ». De février à octobre 1996, trois musées de société – le Musée de la Civilisation de Québec, le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, le Musée dauphinois de Grenoble – ont coproduit et présenté successivement cette exposition. Le principe était celui de la confrontation : chacun prépare, en secret, une exposition de 200m², sans autre consigne ou coordination que la définition commune du thème, qui vaut pour titre. Les trois expositions ont ensuite été réunies pour n’en former qu’une seule en trois parties. Pour unique avertissement au visiteur, une introduction commune présentait les règles du jeu et les établissements partenaires. Une expérience muséologique unique pour mettre en évidence les différences de traitement d’un même sujet.

Conversation avec J. Hainard © A. Giostra
Au MEN, il est courant de parler “d’exposition mille-feuilles” : ayant plusieurs couches de sens. Mais le but reste de faire passer une réflexion, un propos, que le public peut s’approprier à sa façon. Dans le meilleur des cas, il arrive d’assister à un prolongement des idées de l’exposition par le public, qui est un sujet actif, qui se positionne, se fâche, apprécie ou non.
Le travail du muséographe, conclut Jacques Hainard, est d'être attentif aux changements de la société, de comprendre où ils commencent et comment ils se propagent, pour pouvoir instaurer un dialogue avec son public.
“Donc, aujourd’hui, vous ne manquez pas de travail !”
L.Z.
#MEN
#JHainard
#ethnologie
Pour aller plus loin :
- http://www.men.ch/de/histoires/portraits/hainard-jacques/jacques-hainard-detail/
- http://www.men.ch/de/expositions/anciennes-expositions/black-box-depuis-1981/le-musee-cannibale/
- Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaehr. Cent ans d’ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas. 1904-2004 (compte rendu), Chaumier Serge, Culture & Musées, 2006, Volume 8, Numéro 1, pp. 176-179

PARTICIPATIVE ROOM - un zoom sur le futur parcours permanent du MRAC
Je vous propose une petite immersion dans les coulisses du Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC) de Tervuren en Belgique.
©Justine Faure – MRAC

© Justine Faure - Nouveau pavillon d’accueil
Un environnement en pleine effervescence où muséographes, scénographes, scientifiques, graphistes, régisseurs s’affairent pour la réouverture prochaine du musée. La date de réouverture vient de nous être officiellement communiquée, le musée rouvrira ses portes le 8 décembre 2018, presque exactement 5 ans après sa fermeture. Cette rénovation, c’est un changement en profondeur du musée dont la plupart des éléments n’avaient pas été modifiés depuis la fin des années 1950. Bâtiment, muséographie, scénographie, médiation culturelle, tout est construit autour d’un nouveau projet. Plus complexe qu’il n’y paraît, il pose de nombreuses questions et suscite des débats entre muséographes, scientifiques, directeur, diasporas congolaises…, mais l’idée qui me semble la plus forte est cette volonté de décolonisation des regards.
© MRAC logo
Les salles du parcours permanent raconteront, documenteront et expliqueront les différentes facettes de la culture d’Afrique centrale et de l’histoire coloniale. Le but est de parler de l’Afrique d’hier, d’aujourd’hui et du futur mais également de ses liens passés, présents et futurs avec la Belgique.
Mais comme le souligne Bambi Ceuppens :
« (…) Le MRAC ne peut réussir sa décolonisation que si les Congolais le « colonisent ». Etant donné l’histoire du MRAC et le contenu de sa dernière exposition permanente, ce processus est loin d’être évident. (…)».[1]
Mû par cette réflexion, le musée a créé un partenariat avec les diasporas africaines de Belgique et plus particulièrement celles d’Afriques centrale. Dès les prémisses du projet de rénovation, en 2003, un comité nommé COMRAF, représentant les communautés d’Afrique Centrale (République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi), a été fondé. Celui-ci peut émettre des propositions sur tout aspect concernant le fonctionnement et les activités du MRAC, plus particulièrement sur le contenu et la programmation des expositions et des activités éducatives et culturelles.
Ce travail de co-construction du nouveau musée permet également l’implication d’artistes et d’autres acteurs issus des diasporas. Dans ce cadre, est né le concept d’une salle qui se propose de retracer l’histoire de la présence africaine en Belgique, salle atypique, sur laquelle je vous propose un zoom.
L’idée est de montrer à partir de quand il y a eu une présence africaine en Belgique, dans quelles circonstances ces personnes sont arrivées et quels ont été leurs rôles. De cette manière, l’histoire ne se résume pas à la période coloniale mais démarre au 16ème siècle et s’échelonne jusqu'à aujourd’hui. Cette frise chronologique prend comme référence des dates qui répondent à l’histoire intime des familles, d’individus ou d’ associations (conflits mondiaux, génocides, migrations, résistances politiques….). En ce sens, cette chronologie ne répond pas à l’idée classique que l’on se fait d’une ligne du temps.
Dans un premier temps le fil rouge se construit à travers le fond d’archives photographiques du musée. Mais le but n’est pas de s’arrêter là, au contraire il faut enrichir, compléter et aller à la recherche des personnes que l’histoire a bien souvent laissées de côté et dont les noms ne sont que rarement mentionnés dans les anciennes légendes des photographies des collections. Nous travaillons actuellement sur les cartels de ces photographies qui composent la ligne du temps. Souvent le numéro d’inventaire correspond à leur date d’entrée dans les collections et donc également la légende. Datant des années 1940-1950-1960, le propos est fortement emprunt du contexte colonial et bien souvent choquant. Ce travail de réécriture permet donc de restituer le contexte, le lieu, les personnes présentes et la date.
Bambi Ceuppens est commissaire de cette salle et co-commissaire de la rénovation. Anthropologue, elle est chercheuse en section « Culture et Société » au musée. Son travail porte sur la culture populaire congolaise au Congo et en Belgique, la diaspora congolaise en Belgique et l’histoire belgo-congolaise en Belgique et au Congo.
Elle réalise des recherches concernant l’histoire de la présence africaine en Belgique depuis plusieurs années. C’est à partir de la chronologie qu’elle a co-écrite avec la diaspora, que les images s’articulent.
En tant que muséographe et chef de projet, notre rôle est de donner à voir et à comprendre cette histoire par les publics. Pour cela nous travaillons en étroite collaboration avec Laura Nsengiyumva, une artiste belge d’origine rwandaise et architecte de formation, qui réalise un dossier visuel afin d’agencer les images dans les vitrines. Elle met en page cette histoire humaine prenant en compte la sensibilité afro-descendante. Son travail permet ainsi de mettre en relation le contenu scientifique et la sensibilité des personnes directement concernées.
En effet, cette salle a également une grande vocation participative. Le but est d’écrire conjointement cette histoire afin que les personnes issues des diasporas viennent avec leurs enfants et petits enfants pour leur expliquer leur propre histoire au sein de la grande Histoire. A la manière de la galerie des dons du musée de l’immigration à Paris, et afin d’enrichir et de compléter le contenu, chacun est invité à venir déposer objets ou images ayant un lien avec l’histoire de la présence africaine en Belgique. L’idée n’est pas d’enrichir la collection du musée mais simplement d’ouvrir ces vitrines pour des prêts à moyen ou long terme. Cette démarche permet de donner de la visibilité au patrimoine mais celui-ci reste possession des familles.
Par définition, cette salle se veut également évolutive. En effet, elle est vouée à être complétée au fil des années et grâce aux visiteurs. A l’ouverture du musée, les vitrines ne seront pas complètes. Comme le dit souvent Christine Bluard, chef de projet, nous garderons les clefs des vitrines afin de pouvoir aisément modifier, rajouter, agrémenter le contenu en fonction des dons et des témoignages récoltés.

© Justine Faure – zoom sur la salle à l’intérieur du musée
Conçu comme un espace de documentation, la scénographie laissera de la place pour prendre le temps de regarder, de rechercher et de raconter, créant une base à la transmission intergénérationnelle. Le long des murs, dans les vitrines classées du MRAC, se dévoilera la ligne du temps composée des photographies et des objets. Au milieu de la salle, une table ronde permettra de regarder une sélection d’extrait de films documentaires traitant de différents moments clefs de cette histoire. La pièce est agencée de manière a créé un parcours enveloppant, dans lequel le visiteur se trouve au centre du contenu.
Ce système de recherche et de collaboration permet de générer des rencontres, des discussions et laisse pleinement ouvert cet espace à la collaboration. La muséographie, la manière d’aborder le contenu et de le présenter au public font références aux nouveaux lieux hybrides destinés au croisement des savoirs et des publics. Entre bibliothèque et salle d’exposition, évolutive et participative, dans son processus même de création, elle met en relation des corps de métier et des personnes d’horizons différents ayant un même but, raconter et restituer l’histoire de la présence africaine en Belgique à des publics.
Justine Faure
#africamuseum
#présenceafricaine
#histoirehumaine
#participativeroom
Pour aller plus loin :
Un article de Lucie Vallade sur le musée avant la fermeture : http://lartdemuser.blogspot.be/2013/02/le-mrac-un-espace-hors-du-temps-recit.html?q=Lucie+Vallade
Un article d’Ophélie Laloy sur la notion d'"afropéanité" : http://lartdemuser.blogspot.be/2015/04/afropean-une-experience-polymorphique.html?q=Oph%C3%A9lie+Laloy
En attendant la réouverture du musée : http://www.africamuseum.be/
[1] Bambi Ceuppens, « La nécessaire colonisation du Musée Royal de l’Afrique Centrale par les Belgo-Congolais », Créer en post-colonie, 2010-2015 voix et dissidences belgo-congolaises, Sarah Demart et Gia Abrassart (dirs.), Africalia & BOZAR, mai 2016, p. 169.

Souvenir de stage : Une approche de la conservation préventive
C’était où ?
Mon stage de M1 s’est déroulé au sein des Musées d’Art et d’Histoire de la Rochelle : un ensemble de trois musées regroupant le musée des Beaux-arts, le Musée du Nouveau Monde, et la collection du musée d’Orbigny-Bernon, actuellement fermé au public.
Grâce à mon poste polyvalent, ce stage m’a offert une vision plurielle permettant de découvrir ou d’approfondir un grand nombre de disciplines du musée, notamment en termes de muséographie, de scénographie, d’animation, de public, d’organisation d’évènements, etc. J’aimerais aujourd’hui partager mon incroyable expérience du monde étonnant et fascinant de la conservation préventive, au sens professionnel du terme.
En effet, durant une semaine, une petite vingtaine d’étudiants de l’Institut National du Patrimoine est venu réaliser un chantier d’école dans les collections. Ils ont eu pour mission de mettre en place une action de conservation préventive sur les collections du musée fermé au public. Avec mes deux acolytes stagiaires, nous avons eu la chance de les assister et de participer à leur projet en tournant au sein de leur équipe.
Organisation !
Nous avons été répartis en plusieurs ateliers, qui ont fait l’objet de roulement suivant les journées, pour que tout le monde puisse s’exercer dans les différentes spécialités. La collection Extrême-Orient a été prise en charge par 2 équipes : les bouddhas et les laques (+ collection samouraï). Une grosse équipe s’est chargée des plâtres, une autre des arts graphiques (peintures, posters, cartes, …) puis une équipe en textiles et accessoires d’uniforme (casques, armures, épaulettes,…).
Ce travail m’a fortement fait penser à un texte de Bruno Foucart dans lequel il parle des moyens de conservation du patrimoine comme d’un service de santé[1]. En effet, pendant une semaine j’ai plutôt eu l’impression de travailler dans un bloc opératoire que dans un musée.
D’abord, il faut toujours porter des gants, puisque notre peau n’est pas neutre et que son acidité est une menace pour les objets. Le port du masque est fortement conseillé, car même si l’on ne voit pas la poussière, celle-ci est bien présente et elle provoque rapidement des quintes de toux chez les personnes qui ne sont pas protégées. Enfin la blouse est préconisée dans le traitement des gros objets et des objets infestés.
Qu’est-ce qu’on a fait ?
Ma première mission a été le dépoussiérage d’une multitude de bouddhas. Pour cela, on utilise des brosses en poils de chèvre, des microfibres avec des piques en bois pour aller dans les interstices, des minis aspirateurs, et des brosse à poils plus durs pour les plâtres. Les gestes de dépoussiérages doivent être précis et organisé. On ne le fait pas dans n’importe quel sens, et on ne commence pas n’importe où. Avant de commencer, on doit d’abord vérifier l’éventuelle fragilité de l’objet.
Après le dépoussiérage, chaque objet est ensuite photographié et inventorié. Ainsi, une saisie numérique permet de rapporter un certain nombre d’informations sur l’identité de l’objet et sa localisation précise de l’objet dans les réserves, des informations descriptives sur les matériaux, la taille, la technique…, un descriptif précis de l’état de l’objet (diagnostic général, et précision sur les altérations, les marquages, …)
Puis les objets sont conditionnés. Le conditionnement répond à une technique bien précise, et doit pouvoir s’adapter aux différents objets.
Le cas des bouddhas montre le professionnalisme du conditionnement : les cartons acides ont été protégés par du papier spécial qui est poli d’un côté pour empêcher la réaction électrostatique. Puis les bouddhas sont placés dans des mousses où leur contre-forme est faite sur mesure, puis protégés par du Tyvek©. Le tout est entreposé dans des étagères qui sont venues remplir les anciennes salles d’exposition du musée. Les étages, les salles, les étagères, les rayonnages et les cartons sont numérotés de façon à pouvoir localiser exactement les objets.
En conclusion...
Le travail avec les étudiants était extrêmement riche et important pour le musée. A 20, nous avons traité et conditionné 450 objets en une semaine. Il permet de faire une formation au personnel du musée sur les bonnes pratiques de conservation préventive. Ensuite, il a permis un travail titanesque en un laps de temps très réduit.
Les objets ont été stockés dans des lieux plus adaptés à leur conservation (température, hydrométrie) et une salle de quarantaine a été aménagée pour les objets infestés. Cela permet à la fois de ne pas infester les autres objets qui eux sont sains mais cela va aussi permettre de contrôler les évolutions possibles des infestations ou des moisissures. Cette salle va continuer d’être étudiée par les élèves et restera à leur disposition pour leurs recherches, pour leurs cours, comme un cas pratique. Travailler conjointement entre étudiants est extrêmement bénéfique, tout le monde se retrouve gagnant. Le musée a sauvé une grande partie de sa collection qui était extrêmement menacée, et il a appris des notions importantes en termes de conservation préventive.
Mélanie TOURNAIRE
[1] « Les architectes-chirurgiens chargés d’opérer sur le front des ruines sont assistés d’un véritable service de santé monumentale. » Bruno Foucart, « A l’aube du troisième millénaire », in Des Monuments historiques au Patrimoine du XVIIIe siècle à nos jours, ou les égarements du cœur et de l’esprit, Françoise Bercé, éditions Flammarion, Série Art-Histoire-Société, 2000.
Liens :
Musées d'Art et d'Histoire de la Rochelle

Un comité scientifique 007
En direct de la Cité des sciences et de l'Industrie à proximité d'un parc considérable et plein de Folies, je suis en mission spéciale pendant 4 mois accompagnées d'As1trid A. et Ma13ud G. Par chance, une coéquipière est venue en renfort, A15naïs spécialisée dans l'Histoire et la philosophie des sciences.
Campagnol (un compagnon fidèle ?) © Site internet Vue des collines
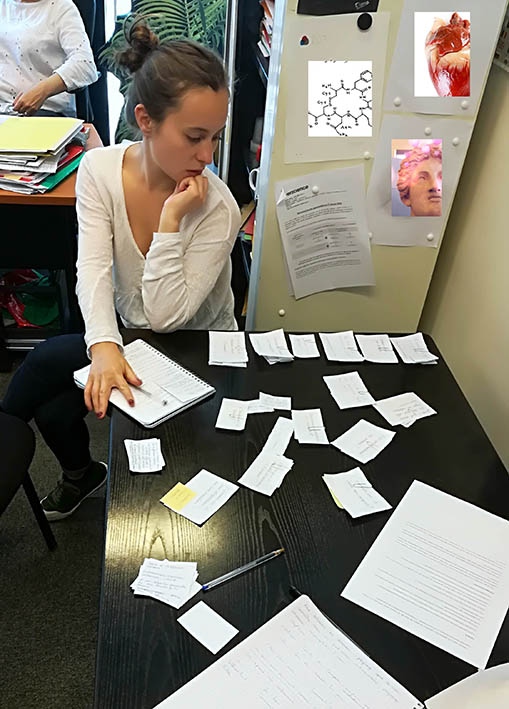
Séance de réflexion avec post-its © Charlène C.

QG © Charlène C.
1 13 15 21 18
15 3 25 20 15 3 9 14 5
19 5 3 18 5 20
cœur,
#Comitéscientifique
#Spécialistes
#Amour
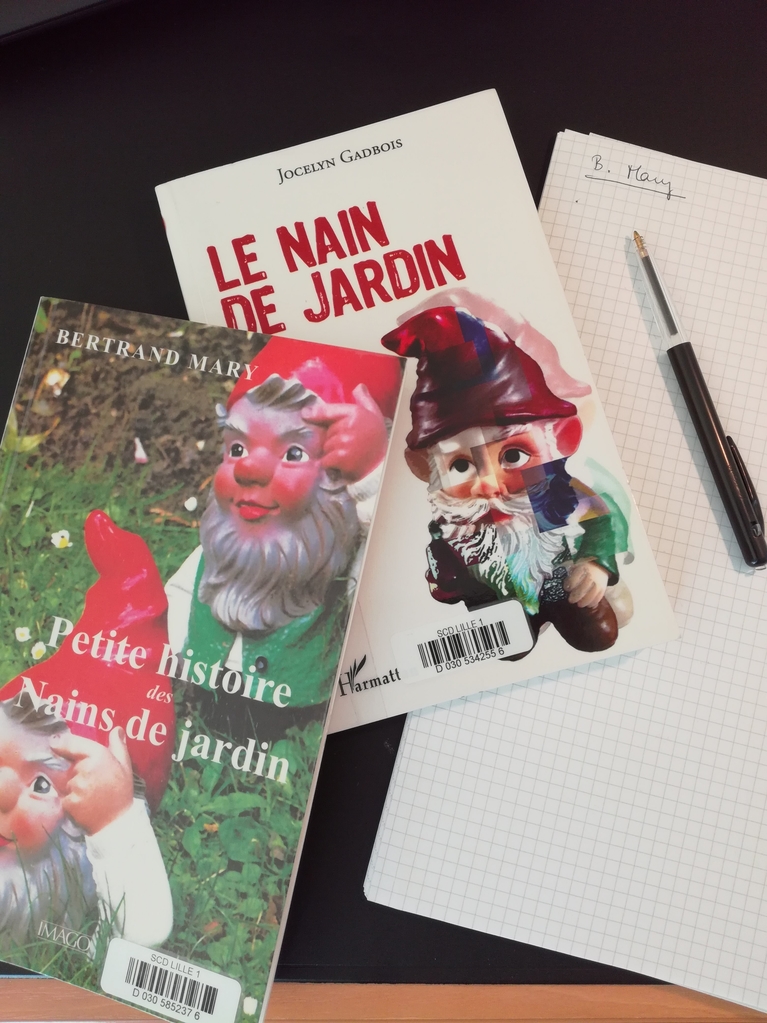
Un nain de jardin et moi
Saviez-vous que la première apparition du nain de jardin remonte à la Renaissance ? Et bien moi non !
Ce petit barbu au bonnet rouge m’accompagne tout au long de mon apprentissage à la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, au sein du Service de la médiation archéologique, pour cette année 2017-2018. Que vient faire ce drôle de personnage dans mes missions professionnelles ? Patience, patience…
Permettez-moi de commencer par vous présenter ma structure d’apprentissage.

Crédit : Fanny DAVIDSE
La Direction de l’Archéologie a inauguré en 2016 un bâtiment à Dainville pour accueillir son service, en cohabitation avec le Centre de conservation et d’études du Pas-de-Calais : la Maison de l’Archéologie. Elle regroupe une secrétaire et une logisticienne, des archéologues ayant chacun leur spécialité, une documentaliste, une régisseuse-restauratrice et des médiateurs, qui travaillent ensemble pour mener à bien les différentes étapes des découvertes archéologiques : de la fouille à l’exposition.
Le Service de la médiation archéologique propose divers dispositifs pédagogiques : une à deux expositions par an à la Maison de l’Archéologie, le prêt d’expositions itinérantes dans les collèges, de nombreuses animations sur place et hors-les-murs, le prêt de mallettes pédagogiques, des visites guidées de chantiers de fouille, ainsi que des rencontres « café-archéo ».
Comment ai-je rencontré mon nain de jardin ?
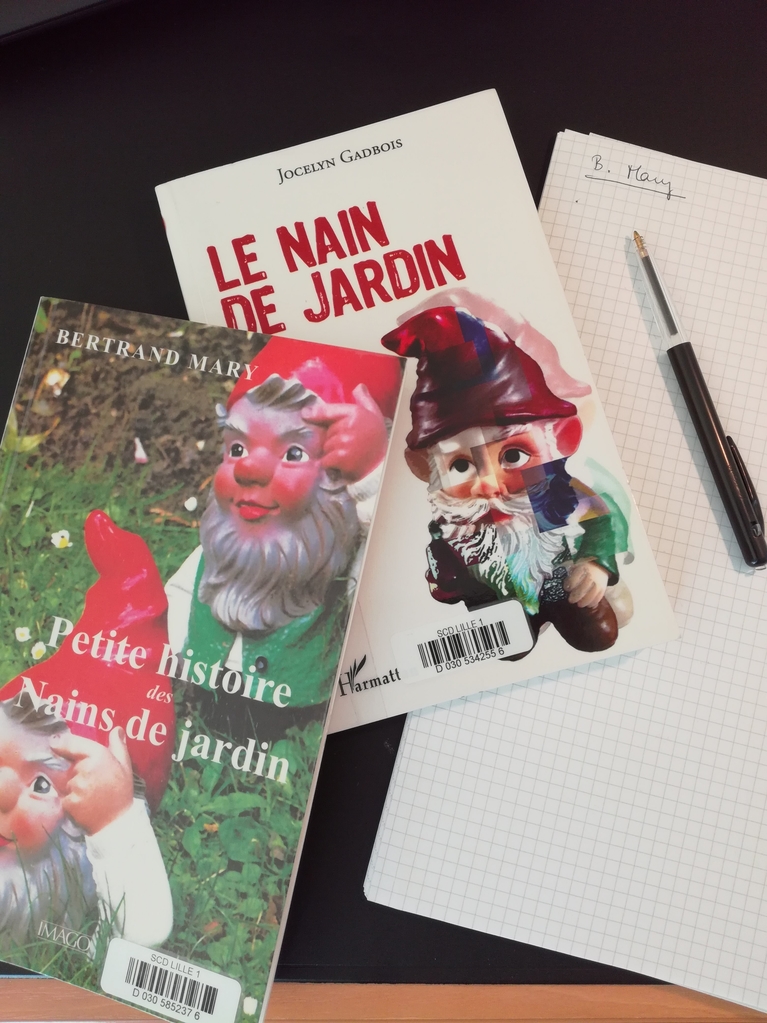
Crédit : Fanny DAVIDSE
La Maison de l’Archéologie accueille dans ses locaux l’exposition « Futur antérieur. Trésors archéologiques du XXIème siècle après J.-C. » de mars à juin 2019. Créée par le musée romain de Lausanne-Vidy en 2002 et louée auprès de la Cité de la Préhistoire de l’Aven d’Orgnac, cette exposition met en exergue la découverte de notre civilisation du XXIe siècle par les archéologues du futur, 2 000 ans plus tard. Mêlant archéologie et humour, le visiteur découvre le métier d’archéologue et toutes les problématiques d’interprétation qu’il peut rencontrer. L’exposition invite à réfléchir sur la stabilité temporelle des matériaux utilisés de nos jours, ou encore sur la transmission de la mémoire écrite et audiovisuelle de notre monde actuel à nos successeurs. La pièce maîtresse de l’exposition n’est autre que ce fameux nain de jardin, qui, selon nos archéologues du futur, représente un notable ou un prêtre (mais si, mais si…) grâce à ses attributs distinctifs tels que la barbe, le bonnet et les grands yeux. En 4019, un nouveau regard se porte sur le nain de jardin !
Mon apprentissage consiste à adapter cette exposition, notamment au niveau des outils de médiation et à lui insuffler un ancrage local dans le Pas-de-Calais. Dans le prolongement des précédentes expositions, je conçois quatre dispositifs permettant au visiteur de comprendre un thème ou acquérir un savoir de façon interactive. Mon cher et tendre nain de jardin a le droit à sa propre « manipe » !
Par ailleurs, je travaille sur le contenu du livret fourni au visiteur : informations détaillées sur les thèmes de l’exposition autour des textes affichés, photographies des objets et jeux à effectuer pendant la visite ou chez soi.
Manipes de l’exposition et jeux du livret doivent se compléter, sans se chevaucher. C’est là qu’intervient l’analyse de l’objectif de l’exposition et de chaque thème, de l’expérience que tire le visiteur qui prend part à ces interactions, la connaissance des publics pour toucher le plus grand nombre, et bien évidemment la touche créative pour rendre ces activités instructives et innovantes.
Pour découvrir la concrétisation du projet, rendez-vous le 16 mars 2019 à la Maison de l’Archéologie à Dainville ! En attendant, mon nain de jardin et moi-même gardons précieusement le mystère…

Un peu d’eau fraîche et de verdure…
… Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de… Bon, pas toujours de soleil.
C’est au jardin botanique Jean-Marie Pelt, en Lorraine, que j’effectue mon stage de M1. Cet espace de trente-cinq hectares situé en bordure de la ville de Nancy compte parmi les trois plus grands jardins botaniques de France et rassemble environ 12 000 espèces végétales issues du monde entier, des régions alpines aux forêts tropicales en passant bien sûr par la flore locale. Les différents micro-habitats reconstitués au fil des vallons illustrent parfaitement la philosophie de Baloo, car il n’en faut guère plus pour être heureux.
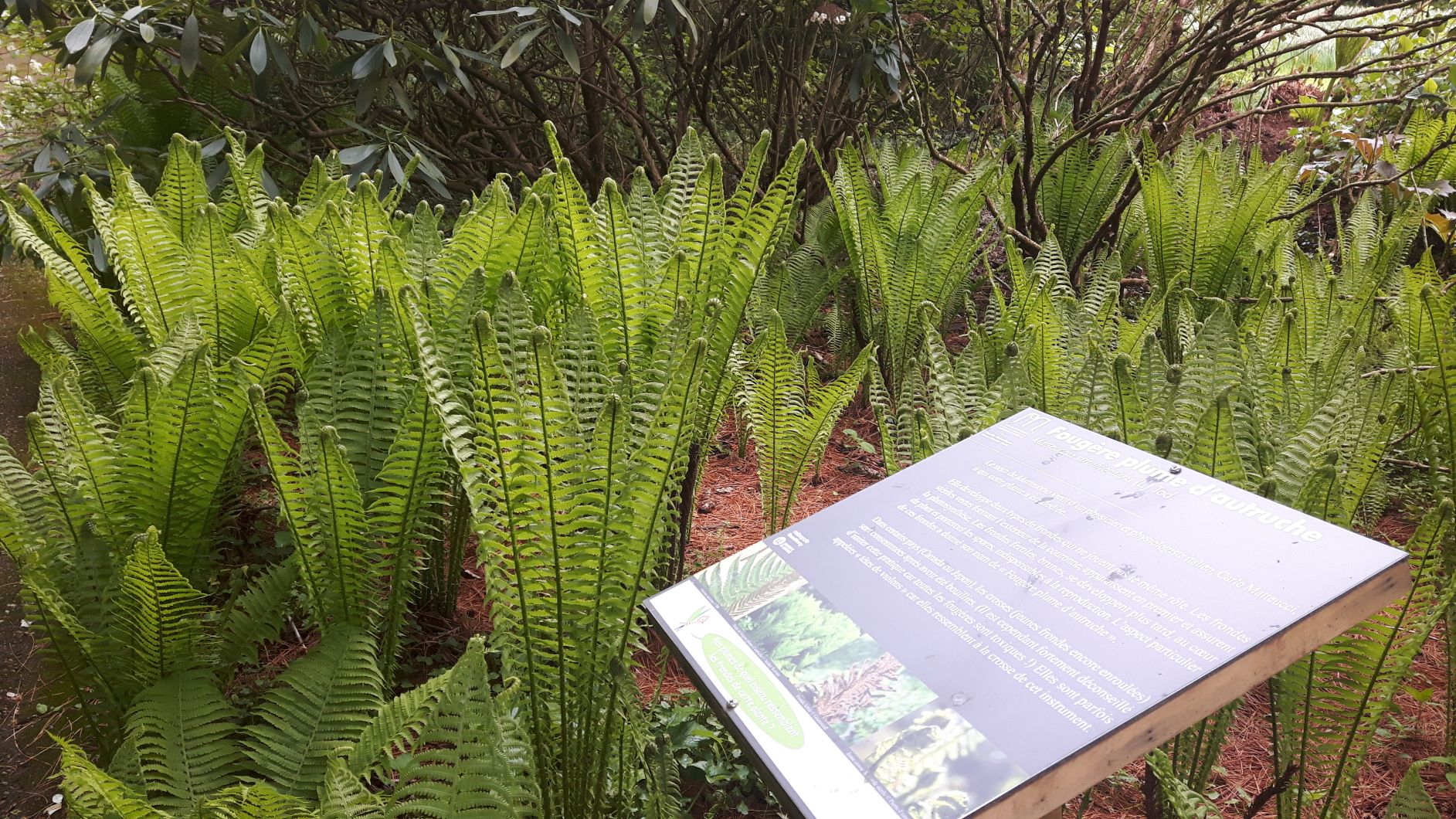
Le panneau pédagogique constitue la principale forme de médiation au sein du jardin – © M.T.
J’occupe ici un poste de stagiaire muséographe. Ma mission (que j’ai acceptée) consiste à repenser entièrement la médiation écrite d’un secteur particulier du jardin, celui des plantes médicinales. Abordant des sujets aussi variés que la phytothérapie, la toxicologie, la sorcellerie ou l’ethnobotanique en général, cette zone souffre actuellement d’un manque d’explications quant aux plantes qui y sont présentées. Elle est par ailleurs en travaux puisqu’un tiers de l’espace fait l’objet d’un réaménagement complet dans l’optique d’accueillir de nouvelles espèces. La première phase de mon travail fut de rédiger le contenu des vingt-trois panneaux pédagogiques qui seront mis en place sur les différents massifs du secteur afin de développer les thématiques propres à chacun. Le format de type panneau, pas forcément très original, implique de redoubler d’inventivité pour proposer des contenus attractifs – d’autant que la botanique est une discipline où le vocabulaire devient rapidement assez technique. Je travaille à partir de thèses en pharmacologie dont le jardin s’est inspiré pour créer la zone des plantes médicinales ; l’enjeu est de rendre accessible à un public néophyte les notions essentielles rassemblées dans ces travaux universitaires pointus. Cet exercice m’a notamment permis de confirmer l’incroyable pouvoir des pictogrammes lorsqu’il s’agit de représenter un sujet avec humour tout en facilitant sa compréhension.

Vue générale du secteur des plantes médicinales et de la zone en travaux – © M.T.
Une particularité de mon stage réside dans l’autonomie dont je dispose : une fois les thèses posées sur le bureau que je partage avec une autre stagiaire en muséographie, on m’a laissé toute latitude pour faire mes propositions. J’ai donc imaginé puis rédigé les vingt-trois panneaux de manière indépendante avant de soumettre le résultat à ma tutrice (directrice-adjointe du jardin). Celle-ci, après avoir proposé quelques retouches puis validé le contenu, s’occupe de l’envoyer à un comité d’enseignants-chercheurs de la Faculté de Pharmacie. Ils se chargeront à distance de vérifier la justesse scientifique et suggérer des corrections éventuelles avant validation finale du contenu, qui sera ensuite transmis à un infographiste interne à l’équipe. Le jardinier responsable du secteur lit également les propositions et apporte son expertise (c’est en effet lui qui connaît le mieux les plantes présentées et leur disposition). Il y a finalement assez peu de contacts directs entre nous, ce qui ne facilite pas toujours l’échange d’idées, mais l’équipe et la direction sont très ouvertes à la nouveauté et font confiance, ce qui incite à proposer des dispositifs originaux. Ces derniers – s’ils parviennent à convaincre – pourront peut-être venir s’ajouter aux panneaux explicatifs. Je place notamment de grands espoirs dans une proposition de jeu sur le thème d’Harry Potter, en lien avec le massif dédié aux plantes de sorcières…
Le jardin botanique n’héberge pas que des plantes : amphibiens, poissons, reptiles, oiseaux et mammifères y côtoient une foule d’invertébrés – © M.T.
Une seconde phase de ma mission sera davantage en lien avec la programmation culturelle puisqu’il s’agira de réfléchir à des animations, conférences et autres interventions en lien avec l’inauguration de la nouvelle muséographie du secteur. Ce sera l’occasion de sortir de ma zone de confort (la rédaction et la conception de contenus) pour m’essayer à un exercice tout à fait différent impliquant de rechercher des intervenants potentiels et prendre contact avec eux. En attendant, j’apprends beaucoup en travaillant sur les plantes médicinales et je profite d’un cadre exceptionnel : le jardin est véritablement immense et se transforme constamment au fil des floraisons. Il héberge une faune variée et des recoins si calmes qu’on en oublie totalement la proximité de la ville : alliance parfaite entre la culture scientifique et l’expérience sensorielle.
M.T.
Le site officiel du jardin botanique : http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-j-m-pelt/
#jardin
#sciences
#botanique
#stage
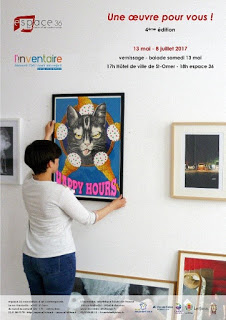
Une oeuvre pour vous ! (avec l'Artothèque)
Le 13 mai, les Audomarois(es) avaient rendez-vous à l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Omer pour découvrir la nouvelle exposition présentée par l’Espace 36, association d’art contemporain. « Une œuvre pour vous ! » est la quatrième édition de cette biennale organisée en partenariat avec l’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France. Le principe ? Les visiteurs ont la possibilité d’emprunter des œuvres d’art, puis de les exposer à leur domicile ou sur leur lieu de travail.
Affiche de l’exposition ©Nicolas Lavoye
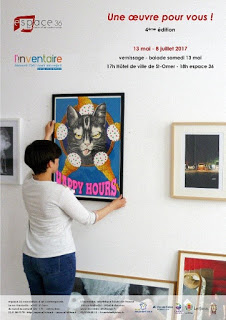 Ce vernissage célébrait les trente ans d’existence de l’Espace 36. Quatre adhérents de l’association ont ouvert leurs portes où étaient exposées des œuvres empruntées à l’Artothèque. Une balade dans la ville de Saint-Omer a conduit des visiteurs à découvrir les intérieurs de ces médiateurs d’un jour qui ont présenté leurs coups de cœur. Mais avant de débuter la visite, une petite présentation de l’Espace 36 s’impose.
Ce vernissage célébrait les trente ans d’existence de l’Espace 36. Quatre adhérents de l’association ont ouvert leurs portes où étaient exposées des œuvres empruntées à l’Artothèque. Une balade dans la ville de Saint-Omer a conduit des visiteurs à découvrir les intérieurs de ces médiateurs d’un jour qui ont présenté leurs coups de cœur. Mais avant de débuter la visite, une petite présentation de l’Espace 36 s’impose.
Depuis 2001, ce centre d’art associatif basé à Saint-Omer a mis en œuvre un projet de création unique dont la base est le soutien envers la création et la sensibilisation à l’art contemporain. Les actions majeures développées par l’association sont la conception d’expositions et le soutien à la diffusion de l’art contemporain, ainsi que l’élaboration d’outils de médiation et l’organisation de visites.
Espace36 – Exposition de Marie Hendricks © Benoît Warzée
L’association assume un rôle d’intermédiaire entre lesartistes et les publics grâce à une collaboration et une concertation auprès de différents acteurs territoriaux. L’Espace 36 met un point d’honneur à sensibiliser les publics qu’il reçoit dans le cadre de ces expositions. Le but étant de leur apporter des outils de compréhension pour les aider à développer leur réflexion personnelle. Une démarche axée sur la médiation participative, qui consiste à permettre à tout type de visiteur de s’ouvrir à ses propres ressentis et sentiments.
 A travers ces différents projets, l’association espère que les participants s’ouvrent à la culture et soient en mesure d’élargir leur raisonnement. La base des relations entre les artistes plasticiens et les publics repose essentiellement sur l’échange ainsi que l’écoute, et s’efforce de rendre les visiteurs acteurs de leur propre culture.
A travers ces différents projets, l’association espère que les participants s’ouvrent à la culture et soient en mesure d’élargir leur raisonnement. La base des relations entre les artistes plasticiens et les publics repose essentiellement sur l’échange ainsi que l’écoute, et s’efforce de rendre les visiteurs acteurs de leur propre culture.
Atelier-Visite avec le Musée de l’Hôtel Sandelin © Benoît Warzée
Venons-en à l’Inventaire. Basée à Hellemmes dans la métropole lilloise, L’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France a été fondée en 2009. Cette association propose aux habitants de la région un service itinérant et solidaire de prêts d’œuvres d’art sur le même principe qu’une bibliothèque. Autrement dit : chacun peut emprunter une à plusieurs œuvres originales par mois, qu’il expose ensuite chez lui. Au-delà d’encourager la présence de l’art au sein de lieux privés et professionnels, cette démarche aide à favoriser l’appropriation de la création contemporaine auprès des adhérents.
L’Inventaire Artothèque ©Clotilde Lacroix
Emprunter à l'Arthothèque
 Riche et diverse, la collection de l’Artothèque s’élève à 1200 œuvres, regroupant estampes, peintures, photographies et sérigraphies réalisées par de jeunes créateurs, ou des artistes reconnus sur la scène régionale et nationale, voire internationale. Cette collection s’enrichit au fil des ans par de nouvelles acquisitions, dans le but de valoriser la multiplicité des techniques artistiques actuelles.
Riche et diverse, la collection de l’Artothèque s’élève à 1200 œuvres, regroupant estampes, peintures, photographies et sérigraphies réalisées par de jeunes créateurs, ou des artistes reconnus sur la scène régionale et nationale, voire internationale. Cette collection s’enrichit au fil des ans par de nouvelles acquisitions, dans le but de valoriser la multiplicité des techniques artistiques actuelles.
Plus de 10 000 prêts ont été enregistrés depuis sa fondation, avec des œuvres qui circulent dans le cadre de projets mis en œuvre avec différents acteurs socio-culturels. D’une part, des expositions organisées dans des galeries d’art, et d’autre part des interventions effectuées au sein d’établissements scolaires. A travers ces actions, ces œuvres voyagent sur le territoire pour aller à la rencontre des publics les plus larges, et souvent peu adeptes de l’art contemporain.
En complément des institutions muséales et autres centres régionaux de diffusion, l’Inventaire soulève la question de la place de l’œuvre d’art dans la sphère privée, au-delà de la simple notion d’acquisition ou de consommation. Ainsi, les publics touchés nouent une relation approfondie à l’œuvre et posent désormais un regard nouveau sur la création contemporaine. En se basant sur des valeurs liées à l’économie sociale et solidaire, cette démarche de transmission amène une réflexion sur la fonctionnalité, et sur la manière de repenser l’économie dans un principe de développement durable.
© Clotilde Lacroix
Retour sur cette balade-vernissage, vécue comme une expérience originale. Le contact privilégié avec des œuvres d’art figure parmi les objectifs de l’Inventaire, qu’il nomme joliment : « intrusions artistiques ». Avec cette volonté de raviver une mécanique du désir, d’amener des particuliers à entretenir une relation décomplexée avec l’art, et plus spécifiquement, de se familiariser à l’art contemporain. « Ça permet de vivre plusieurs semaines avec une œuvre, de la voir différemment, ailleurs que dans un lieu de passage. » indique Ségolène Gabriel, médiatrice culturelle de l’Espace 36¹. Donc, quoi de mieux que de donner l’occasion à des membres de l’association d’exposer des œuvres à leur domicile et d’en ouvrir les portes à des visiteurs lambdas ?
Visiteurs du Vernissage-Balade ©Joanna Labussière
 La force de cette opération participative réside dans le rôle joué par les adhérents qui se sont glissés dans la peau de médiateurs le temps d’une après-midi. Un parcours informel en somme, dans une ambiance détendue, et qui a permis à la plupart de découvrir le patrimoine architectural au domarois. Cette démarche rejoint les fondements de l’Espace 36 en termes de médiation, où l’accueil du public ne se résume pas à expliquer les œuvres aux visiteurs, mais à apporter à ces derniers des clefs de réflexion propre à leurs émotions.
La force de cette opération participative réside dans le rôle joué par les adhérents qui se sont glissés dans la peau de médiateurs le temps d’une après-midi. Un parcours informel en somme, dans une ambiance détendue, et qui a permis à la plupart de découvrir le patrimoine architectural au domarois. Cette démarche rejoint les fondements de l’Espace 36 en termes de médiation, où l’accueil du public ne se résume pas à expliquer les œuvres aux visiteurs, mais à apporter à ces derniers des clefs de réflexion propre à leurs émotions.
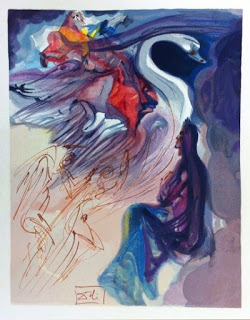 C’est ainsi que Thérèse, sculptrice autodidacte, nous a reçu en premier. Son choix s’est porté sur deux sérigraphies réalisées en 1960 par Salvador Dalí et inspirées du poème « La Divine Comédie » de Dante. D’après elle, ces sérigraphies donnent à voir un autre aspect du travail de Dalí, à l’opposé de ses œuvres surréalistes qui ont fait sa renommée en tant que peintre parmi les plus influents de son siècle.
C’est ainsi que Thérèse, sculptrice autodidacte, nous a reçu en premier. Son choix s’est porté sur deux sérigraphies réalisées en 1960 par Salvador Dalí et inspirées du poème « La Divine Comédie » de Dante. D’après elle, ces sérigraphies donnent à voir un autre aspect du travail de Dalí, à l’opposé de ses œuvres surréalistes qui ont fait sa renommée en tant que peintre parmi les plus influents de son siècle.
La Divine Comédie de Dante #1 et #2 ©Inventaire l’Artothèque
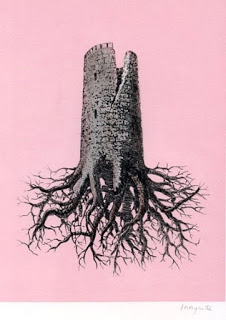 S’ensuivit la découverte d’un second appartement où nous ont accueillis Virgile et Aurélien, membres du Conseil d’Administration des Amis des Musées de Saint-Omer. La visite débuta avec Virgile qui nous présenta sa sélection : une héliogravure de René Magritte datant de 1973. Intitulée « La Folie d’Almayer »,cette œuvre s’inspire du premier roman du même nom de Joseph Conrad, dont le héros, Almayer, un jeune hollandais au destin tragique qui rêvait de partir à la découverte d’un trésor caché par des pirates. Ancien étudiant en gestion et valorisation du patrimoine, Virgile a choisi cette gravure qu’il considère comme étant la métaphore de notre héritage culturel qui constitue le fondement de nos racines.
S’ensuivit la découverte d’un second appartement où nous ont accueillis Virgile et Aurélien, membres du Conseil d’Administration des Amis des Musées de Saint-Omer. La visite débuta avec Virgile qui nous présenta sa sélection : une héliogravure de René Magritte datant de 1973. Intitulée « La Folie d’Almayer »,cette œuvre s’inspire du premier roman du même nom de Joseph Conrad, dont le héros, Almayer, un jeune hollandais au destin tragique qui rêvait de partir à la découverte d’un trésor caché par des pirates. Ancien étudiant en gestion et valorisation du patrimoine, Virgile a choisi cette gravure qu’il considère comme étant la métaphore de notre héritage culturel qui constitue le fondement de nos racines.
« La Folie Almayer » de René Magritte© Inventaire l’Artothèque
Aurélien lui, a sélectionné deux peintures de l’artiste Sylvain Dubrunfaut issues de sa série « Ados 3 » exécutée en 2012. La première représente un adolescent placé de profil, le visage encapuchonné, et aux traits graves. Aurélien a placé cette toile sur une étagère de sa bibliothèque, près de ses romans de vampires qu’il affectionne particulièrement. Selon lui, l’air assombri du jeune garçon s’accordait avec un sujet angoissant tel que celui des vampires. En parallèle, la seconde peinture a été installée à proximité de photos de familles. Notre hôte estimait que cette œuvre, aux couleurs chaudes et marquées par le sourire de l’adolescent avait davantage sa place auprès des photos de ses proches, synonymes de convivialité.
Sanstitre, série Ados 3 de Sylvain Dubrunfaut © Inventaire l’Artothèque
Pour conclure, les visiteurs ont achevé leur balade en se rendant à la maison de Florence, écrivaine audomaroise. Au total, ce sont deux sérigraphies œuvres qu’elle a empruntées auprès de l’Inventaire. L’une réalisée par Honoré, porte le titre « H2O ». Si Florence a décidé de l’exposer à son domicile, c’est parce qu’elle traite d’une thématique, à savoir le réchauffement climatique, qui lui tient particulièrement à cœur. Un sujetd’actualité qui la concerne personnellement, en lien avec ses problèmes de santé.
CO2 de Honoré © Inventaire l’Artothèque
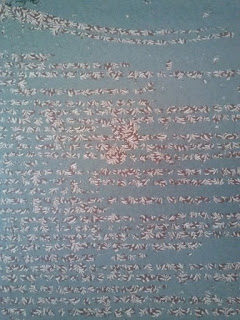 Dans un tout autre style, la seconde sérigraphie sélectionnée par Florence est signée Gérard Duchêne. Datée de 1990, elle s’intitule : « Papier Peint ». Connu pour son emploi des médias imprimés, le style de Duchêne est particulièrement reconnaissable à son travail de la peinture sur papier qui donne naissance à une écriture illisible, mettant ainsi en exergue la matérialité de l’écrit. Accrochée aux murs de sa salle à manger, cette œuvre renvoie aux créations de Florence qu’elle réalise sur des tapisseries.
Dans un tout autre style, la seconde sérigraphie sélectionnée par Florence est signée Gérard Duchêne. Datée de 1990, elle s’intitule : « Papier Peint ». Connu pour son emploi des médias imprimés, le style de Duchêne est particulièrement reconnaissable à son travail de la peinture sur papier qui donne naissance à une écriture illisible, mettant ainsi en exergue la matérialité de l’écrit. Accrochée aux murs de sa salle à manger, cette œuvre renvoie aux créations de Florence qu’elle réalise sur des tapisseries.
Papier peintde Gérard Duchêne,© Inventaire l’Artothèque
Comme expliqué précédemment : quel est l’intérêt pour l’Espace 36 et l’Inventaire de permettre à leurs adhérents de participer à une opération telle que celle-ci ? La particularité de cette manifestation réside bien au-delà du projet d’exposition en lui-même, et du principe de posséder une œuvre originale pour un temps déterminé. Le but premier ne consistait pas à expliquer ces œuvres via le prisme de l’histoire de l’art, ni à imposer un code de lecture définitif.
Au contraire, l’ambition première de ces deux associations est d’une part de faire découvrir des œuvres à travers le regard d’autrui, selon ses émotions, son ressenti et son propre vécu. D’autre part, leur volonté consiste à permettre à ces emprunteurs d’expérimenter une relation davantage intime avec l’art, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Une approche totalement différente qui a également permis de connaître ces personnes sous un angle différent, le tout dans un moment d’échange, d’écoute et de partage.
Vernissage-Balade©Clotilde Lacroix
L’exposition « Une œuvre pour vous ! » est visible jusqu’au 8 juillet 2017 à l’Espace 36, association d’art contemporain de Saint-Omer. Les modalités d’emprunt sont les suivantes : 5€ d’adhésion à l’Inventaire | Petit format : 10€ par œuvre et par mois, et15€ les deux œuvres parmois | Grand format : 20€ par œuvre et par mois. Penser à se munir d’une pièce d’identité et d’une attestation d’assurance habitation.
Joanna Labussière
#Brèvedestage
#Espace36
#Inventairel’Artothèque
#Artcontemporain
Pouren savoir plus sur l’Espace 36 : http://espace36.free.fr/
Plus d’informations sur l’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France : http://linventaire-artotheque.fr/____________________________¹ La Voixdu Nord, A l’Espace 36, empruntez une œuvre d’art pour chez vous, publié le 12 mai 2017, [en ligne] : http://www.lavoixdunord.fr/161574/article/2017-05-12/l-espace-36-empruntez-une-oeuvre-d-art-pour-chez-vous

Une statue à la gloire impériale
Dans le cadre des recherches menées pour l'ouvrage “L'Hôtel des Troupes de montagne. Un Hôtel de commandement du Second Empire. 160 ans d’histoire militaire à Grenoble.” ,je me suis rendue aux archives de la ville de Grenoble avec la conservatrice du musée des Troupes de montagnes. La lecture des échanges épistolaires entre la Ville de Grenoble et le Ministère de la Guerre à permis de retracer l’histoire de la statue équestre de Napoléon Ier ainsi que le rôle des militaires lors de l’inauguration de la statue à la gloire impériale. Voici son parcours qui nous permet de savoir comment, malgré son malmenage, elle peut encore, elle aussi faire vivre le mythe Napoléonien de nos jours.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
Connaissez-vous la remarquable statue de l’Empereur Napoléon Ier trônant dans les alpages de l’Isère ?
La statue de Napoléon Ier, qui se dresse aujourd'hui à Laffrey, n’a pas toujours eu comme beau panorama les montagnes de la Matheysine et la vue sur le lac. Plusieurs questions se posent légitimement sur les raisons et sa date d’arrivée en ce lieu, sur ses origines, son auteur et son commanditaire. Dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage de l’Hôtel des Troupes de montagne : un Hôtel de commandement du Second Empire, 160 ans d'histoire militaire à Grenoble, la découverte de correspondances dans les Archives municipales nous révèle l’envers du décor de son inauguration. C’est grâce aux échanges de lettres écrites entre les autorités militaires et la Ville de Grenoble que nous pouvons savoir aujourd’hui comment et combien cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu sans les moyens de l’Armée. Son incroyable périple a pu ainsi être retracé : du projet de sa commande à son exposition actuelle en passant par la mise en place d’envergure qui fut nécessaire à l’événement de son inauguration.
Les origines de la commande de cette statue prestigieuse
La statue actuelle à Laffrey est l'œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet (1824-1910). Célèbre pour ses sculptures équestres, telle que l’iconique Jeanne d’Arc Place des Pyramides à Paris, il fut l’élève de François Rude. La statue de l’Empereur Napoléon Ier fut commandée sous le Second Empire et réalisée en 1867. Son commanditaire, Napoléon III, neveu du Premier empereur des Français, décida de payer cette statue monumentale avec sa propre cassette personnelle. D’un poids de près de quatre tonnes, en bronze, coulée par le fondeur Charnod, elle fut érigée au centre de la Place de Verdun actuelle, nommée jadis Place d’Armes. Impériale, administrative et prestigieuse, cette nouvelle place n’est pas choisie uniquement pour sa bonne taille (160 m X 140 m), mais surtout pour ce qui est alors, durant le Second Empire, un haut lieu de concentration des pouvoirs. Cette place appelée aussi “Place Napoléon” est bordée au nord par l’Hôtel de commandement des Troupes de montagne actuel, ancien Hôtel de commandement de la 22e division.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, cartes postales, ed. Martinotto frères, XIXe siècle, Pd.4.206.1 & Pd.4.206.2 © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Une statue au service du souvenir impérial
Cette statue de Frémiet commémore la journée décisive qui permit à Napoléon, en route vers Paris, de reprendre le pouvoir. Elle représente la scène de “la Rencontre” du 7 mars 1815, où Napoléon Ier au retour de l'Île d’Elbe, rencontre les troupes royales chargées de l’arrêter aux abords de Grenoble. La scène fait suite au débarquement de l’Empereur, au Golfe-Juan le 1er mars 1815. Napoléon prit alors la route des Alpes, l’actuelle Route Napoléon afin de gagner Paris. La route est jugée plus favorable que celle empruntée par les royalistes de la vallée du Rhône. Il passe par le plateau Matheysin, le 6 mars par Corps, puis La Mure et se dirige vers Grenoble. Le 7 mars, à l’entrée de Laffrey, sur la plaine, un bataillon du 5e de Ligne envoyé par Louis XVIII l’attend pour l'arrêter. Napoléon Ier s’avance, seul sur sa monture caparaçonnée, au-devant des troupes, dans cette plaine désormais nommée la Prairie de la Rencontre. Il prend alors la parole : “Soldats du 5e de Ligne, je suis votre empereur, reconnaissez-moi !”, s’approche à portée de fusil des soldats indécis, entrouvre sa redingote et dit “S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur me voici.” Le 5e de Ligne abaisse les armes. Plus tard Napoléon affirme au général Cambronne “C’est fini. Dans huit jours nous serons à Paris.” Le 20 mars, depuis le Palais des Tuileries, il met en place un Empire doté de deux chambres législatives.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, bronze et plâtre, avant 1868, 30x34x13 cm, MG 1204 © Musée de Grenoble
Une inauguration hautement symbolique :
Si le choix du thème de la sculpture est hautement symbolique, le choix de la date de son inauguration ne l’est pas moins. Le Maire de la Ville de Grenoble, Jean-Thomas Vendre, la fait ériger autour de trois jours de festivité. La foule est considérable pour l’admirer le 17 août 1868, soit deux jours après une fête religieuse importante, celle de l’Assomption le 15 août, mais surtout le jour de la fête de Napoléon. La cérémonie d’inauguration de la statue du 17 août marque l’apothéose de trois jours de fête nationale débutée à la mi-août. Les festivités sont officiellement lancées par Monsieur le Président le 10 août à midi précise.
Le rôle des Troupes en garnison à Grenoble :
Un mois avant l’événement, le Maire de Grenoble demande au général de la 22e division de pouvoir loger les étrangers pour le concours musical de l’inauguration de la statue. Pour cela, 280 à 300 tentes d’officier doivent être mises à disposition de l’Autorité municipale. Ces tentes doivent être rendues à Grenoble dans les magasins de l’État le 19 au plus tard, soit à peine deux jours après la fin des festivités. Les bons rapports entre l’Armée et la ville, contribuant aux bonnes conditions du rayonnement des arts à l’international, sont rendus possibles par des engagements précis. En effet, le maire se porte entièrement caution pour toutes les éventuelles dégradations pouvant survenir au matériel auprès de l’administration militaire.
La charge de Corvée de mise en place et de désinstallation revient à 150 à 200 militaires moyennant contribution. Le Maire considère qu’il est “préférable de faire faire ce travail par des militaires ayant fait campagne que par des ouvriers civils qui n’en auraient nullement l’expérience”. À la demande du Maire de Grenoble, ce sont les militaires, sous ordre du colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, qui ôtent les arbres de la Place d’Armes gênants selon les indications du jardinier en chef. Quelques jours avant l’événement, la ville met en place des orangers en acceptant la suggestion de verdure du colonel. Elle orne la partie du quai Napoléon sur laquelle doivent se placer les autorités et les invités pour assister au feu d’artifice. Ce ne sont pas moins de 450 places qui sont mises à disposition à cet endroit. Le 12 août, deux jours avant l’événement, le Maire s’assure de faire vérifier l’estrade et sa solidité désirable par l’architecte, il serait désastreux que l’estrade n’ait pas une structure assurée.
De pair avec la sécurité, l'enivrement est pensé : le maire, soucieux de l’éclat de la solennité de l’inauguration, fait distribuer par la ville, aux troupes en garnison à Grenoble, des rations supplémentaires d’un litre de vin. Afin de réserver les provisions pour les festivités, les hommes de corvée et leur maréchal-des-logis, pourront se présenter pour prendre livraison chez le marchand local, à cinq heures du matin, Place des Tilleuls, le 17 août. Ces rations extraordinaires de vin sont prévues en comptant l’effectif de corps d’élite de la gendarmerie. Pour le dîner du 17 août, dressé sur la terrasse, le nombre de couverts est fixé à 210. Le restaurateur de la Ville de Grenoble dispose de cinq jours afin de prendre ses dispositions.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier, sur la Place de la Constitution ou Place d’Armes, faisant face à l’Hôtel de la Division, 1868, Pd.4 (613) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Qui est invité ?
Le 12 août, les invitations aux personnes importantes de la ville sont annoncées. Le secrétaire en chef de la Mairie, le receveur municipal, l’architecte, le chef d’octroi, le commandant des pompiers, le receveur de l’hospice, le jardinier en chef, le régisseur de l’usine à gaz, le conservateur du Musée, le conservateur du Muséum, le conservateur de la Bibliothèque, le directeur de l’École professionnelle avec M. l'Aumônier, le directeur du Degré Supérieur, le directeur de l’École chrétienne, le directeur de l’École de sculpture, directeur de l’École de Dessin sont conviés. Les membres du conseil municipal sont invités à la cérémonie solennelle du 15 août. Pour le dîner du 17 août à l’Hôtel de Ville, le Colonel de la 3e de ligne, les membres de la Cour et ses Tribunaux sont conviés. Malheureusement, au grand dam du Maire, le commandant du 13e BCA (bataillon de chasseurs alpins), ne peut assister au banquet offert par la Ville.
Un cortège au rythme des feux d’artifice...
Le feu d’artifice de l’année 1867, avait été reporté par le Ministre de la Guerre. Pour ce tir grandiose du 17 août 1868, la ville de Grenoble concourt à la dépense engendrée. Mais ce sont les plus experts en matière de feu, les artilleurs de la 22e division, qui s’occupent des tirs de canons. Afin de convenir d’un endroit approprié, les autorités avec le colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, décident des lieux de départ de tirs appropriés pour que l’événement se passe en toute sécurité. Les reflets dans l’eau de l’Isère des tirs depuis le pont suspendu et le pont de pierre, nouveau à l'époque, sont parfaitement spectaculaires. Mais, ces deux endroits ne suffisent pas. On installe d’autres pièces de canon sur les quais de l'Île Verte pour encore plus de tirs ! L’Île Verte, particulièrement illuminée par un entrepreneur spécifique pour l’occasion, nécessitera même 50 hommes de corvée, en plus des ouvriers pour la manutention. L’éclat de cette cérémonie est assuré par un déroulé bien réglé autour des tirs de canons. Ainsi, il est prévu que les troupes de garnison doivent passer dès onze heures et demie du matin sur la Place d’Armes avec les sapeurs-pompiers de la ville et ceux des communes voisines, qui se rendent à Grenoble, à cette occasion.
Après les discours officiels, ces troupes opèrent un défilé au-devant de l’estrade occupée par les autorités, c’est-à-dire entre cette estrade et la statue. La cérémonie est annoncée, en grande pompe, par une salve de 101 coups de canon tirés du Fort de la Bastille et les principales portes de la ville. Le soir, un feu d’artifice est tiré sur le pont suspendu par les soins de l’École d’artillerie avec le concours de la ville. Ce feu est tiré à huit heures et demie précises. Il faut deux divisions afin de prendre position avec le matériel ! L’une encadre la rue de Lionne, l’autre se positionne sur la Place de la Simaise. De nouvelles salves sont tirées sur le quai de l’Île verte. Dans les intervalles du feu d’artifice, un détachement de 300 hommes est disséminé sur les hauteurs du fort. Et comme rien n’est assez grandiose à la gloire de l’Empereur, ses hommes simulent une petite guerre et tirent des fusées à étoile de couleur !
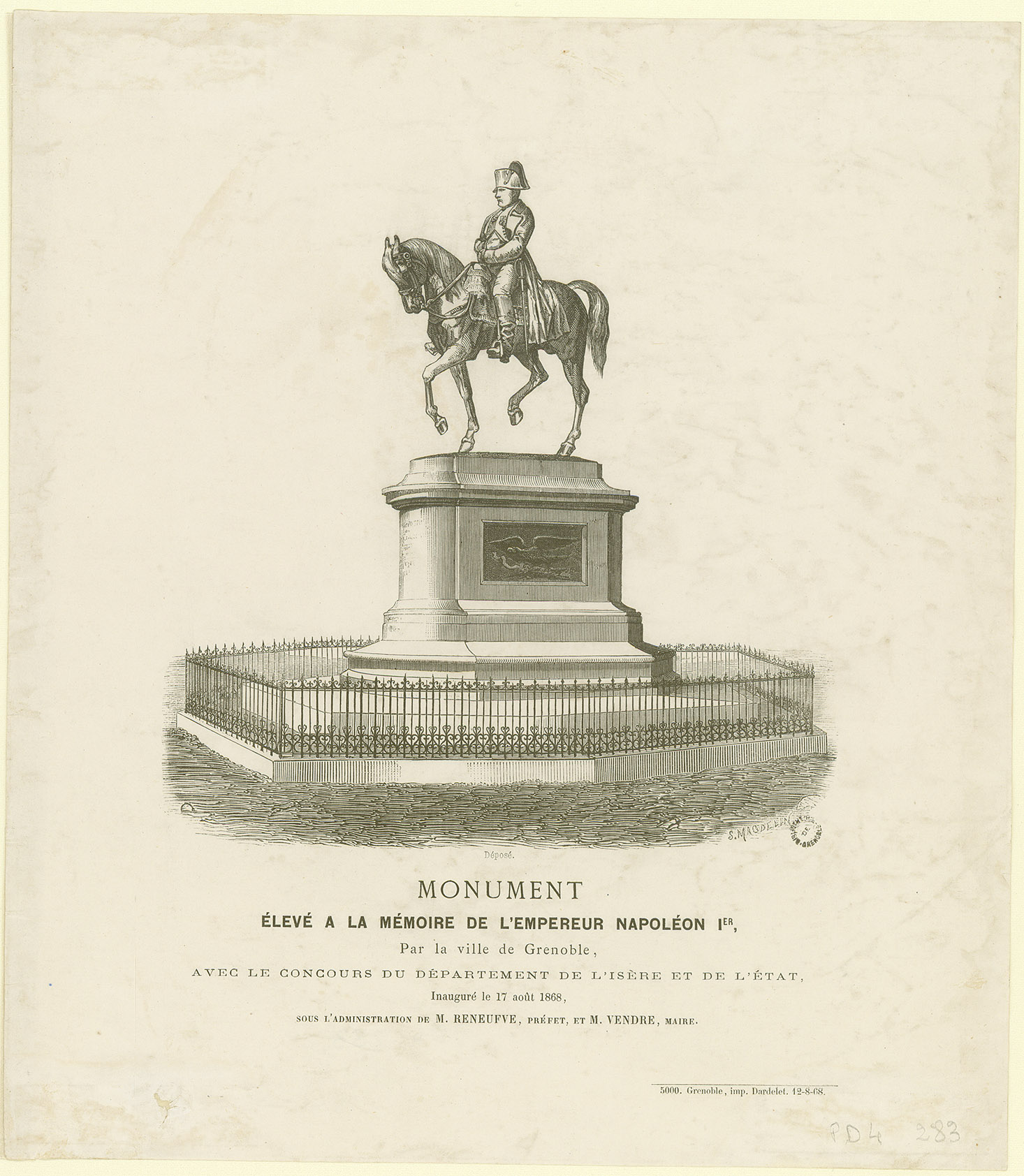
Monument élevé à la mémoire de l'empereur Napoléon Ier, 1868, Pd.4 (283) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
et, surtout, de la musique !
La musique a un rôle central dans l'événement. Qu’elle soit, militaire, religieuse ou artistique, sa diversité donne le ton à chaque moment de la cérémonie. Le 15 août, à dix heures trois quart, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie d’honneur, adossé au péristyle de l’Hôtel de ville, à droite sur la Place Saint-André. Pendant ce temps, Messieurs les Officiers, non pourvu de commandement, se rendent au salon de réception. À dix heures et demie le corps municipal et ces fonctionnaires prennent place en rangs et se dirigent vers l'Hôtel de la préfecture pour y prendre monsieur le Préfet et les autres fonctionnaires municipaux. Le cortège se rend ensuite à l’Hôtel de la Division, le lieu de pouvoir, des militaires par excellence. Puis, les militaires continuent de donner la marche à suivre au cortège en musique.
À quatre heures du soir, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie sur le passage du cortège tout en accompagnant en musique les membres du jury du concours musical jusqu’à la Place Grenette. Le 11 août, le Maire de Grenoble demande à ce que les cours des casernes soient disposées pour les différents concours d’instrumentaux. Pour cela des escaliers sont disposés sur la place. Une médaille est même prévue pour le concours musical, les arts sont reconnus. À cet effet, le Commandant du 13e BCA donne au maire 100 francs pour l’achat de celle-ci. L’exécution de la cantate est assurée par le 47e régiment d’infanterie de Chambéry. Elle est réunie à celle de la musique du 3e de ligne, et à des éléments de localités. Autant de voix et sons martiaux magnifiant l’évènement nécessitent des moyens à la bonne mesure du profit de tous les spectateurs.
Les militaires musiciens sont donc aux bons soins de la ville pour se loger, se nourrir et être indemnisés. Leur transport fait même l’objet d’une demande, le 25 juillet, de gracieuseté à titre de service public spécial selon les appuis favorables et puissants du colonel de la 47e ligne et du général de la 22e division, Adolphe de Monet. La bonté du Ministre de la Guerre accorde cette faveur. Le 12 août, moins d’un mois après la demande, le Lieutenant chef de musique de la 47e de ligne reçoit de la ville, un billet de la banque de 200 francs pour les frais de voyage allers et retours avec une réduction de 40 pourcents pour les militaires qu’il dirige.
La musique militaire est omniprésente durant toutes les festivités. Les membres de la musique du corps de sapeurs-pompiers rejoignent la scène et la musique du 3e régiment de ligne, pour faire entendre alternativement son morceau d’harmonie sur la terrasse du jardin de ville pendant le banquet donné par la ville le 17 août à cinq heures trente du soir. À sept heures trente, le banquet opulent continue au rythme de la musique du 3e de ligne. L’auteur de la musique d’une cantate s’adresse même directement au chef de musique du régiment de la 47e ligne de Chambéry pour l’orchestration de son œuvre, c’est dire la confiance que l’artiste porte aux militaires. Le festival de musique est présidé par le grand compositeur Hector Berlioz. Apprécié pour ses qualités de chef d’orchestre, il est invité par le Maire de Grenoble Jean-Thomas Vendre. L’artiste effectue son dernier voyage à Grenoble, ville de résidence de sa famille, avant son décès six mois plus tard.
Un piquet de quinze hommes est détaché un quart d’heure d’avance pour faire le service religieux à la cathédrale. Le samedi 15 août, à onze heures et demie très précise du matin, à l'issue de l’Office donnée, un hymne latin chrétien, Te Deum, solennel est chanté à l’occasion de la fête de l’Empereur. Afin de bien vouloir assister à la cérémonie, le corps municipal est prié, trois jours avant l’événement, de se réunir à l’Hôtel de ville à dix heures et demie pour se rendre à l’Hôtel de la Préfecture, Place d’Armes. À l'issue du service religieux, le corps municipal est conduit à l‘Hôtel de ville, toujours musique en tête. Immédiatement après le corps de sapeurs-pompiers se rend sur la Place d’Armes où il est passé en revue avec la Troupe de la garnison par M. le général Comte de Monet, commandant de la division Militaire et premier occupant de l’Hôtel de Commandement.
La foule venue acclamer l’Empereur est ravie. Les plus pauvres ne sont pas oubliés : l’administrateur de la Ville leur affecte la somme de 3500 francs conformément à la délibération du Conseil municipal.
Le devenir de la sculpture après l’inauguration de 1868
Pour compléter la sécurité, cette fois en termes d’équipement urbain durable, la confection d’une grille est demandée pour entourer le monument. Dès le 10 juillet, elle est commandée au même architecte choisi pour ce projet de statue. Il avait lui-même choisi les candélabres des socles de pierres posés devant l’entrée principale du monument. Le 20 août, les dernières pierres prennent place, prêtes à recevoir la grille. Elle permet de remplacer la clôture provisoire en planches. Elle est mise en place juste après l’inauguration et une fois le nivellement de la place effectué. Ce dernier exigea dix à douze jours de travail !
Deux ans plus tard, le monument aux grands hommes fut tristement retiré et mutilé lors de la chute du second Empire en 1870, le 4 septembre précisément. Par chance, il est soigneusement conservé dans les réserves du Musée-Bibliothèque. La sculpture, accompagnée de deux bas-reliefs de François Gilbert, fut restaurée à Paris. Depuis 1929, elle a été recontextualisée sur le lieu de passage historique, de Napoléon Ier, nommé “la route napoléonienne" à Laffrey au bord du lac. Elle est installée selon le dessein de l’architecte Louis Fléchère au moment où la Troisième République se réconcilie avec Napoléon Bonaparte incarnant la grandeur de la France pendant et après la Révolution française. Depuis, Napoléon et son cheval surplombent le paysage de la route Napoléonienne en ce lieu fort de sens.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
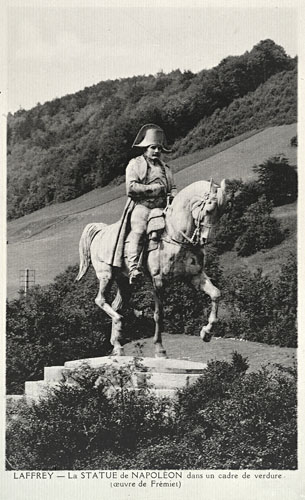
Laffrey - la statue de Napoléon dans un cadre de verdure © Musée d’Orsay, Fonds Devuisson
Charlène Paris
#brève d’apprentissage #sculpture #patrimoine #conservation #gestioncollection #CNAP #histoire-mémoire #patrimoine-société