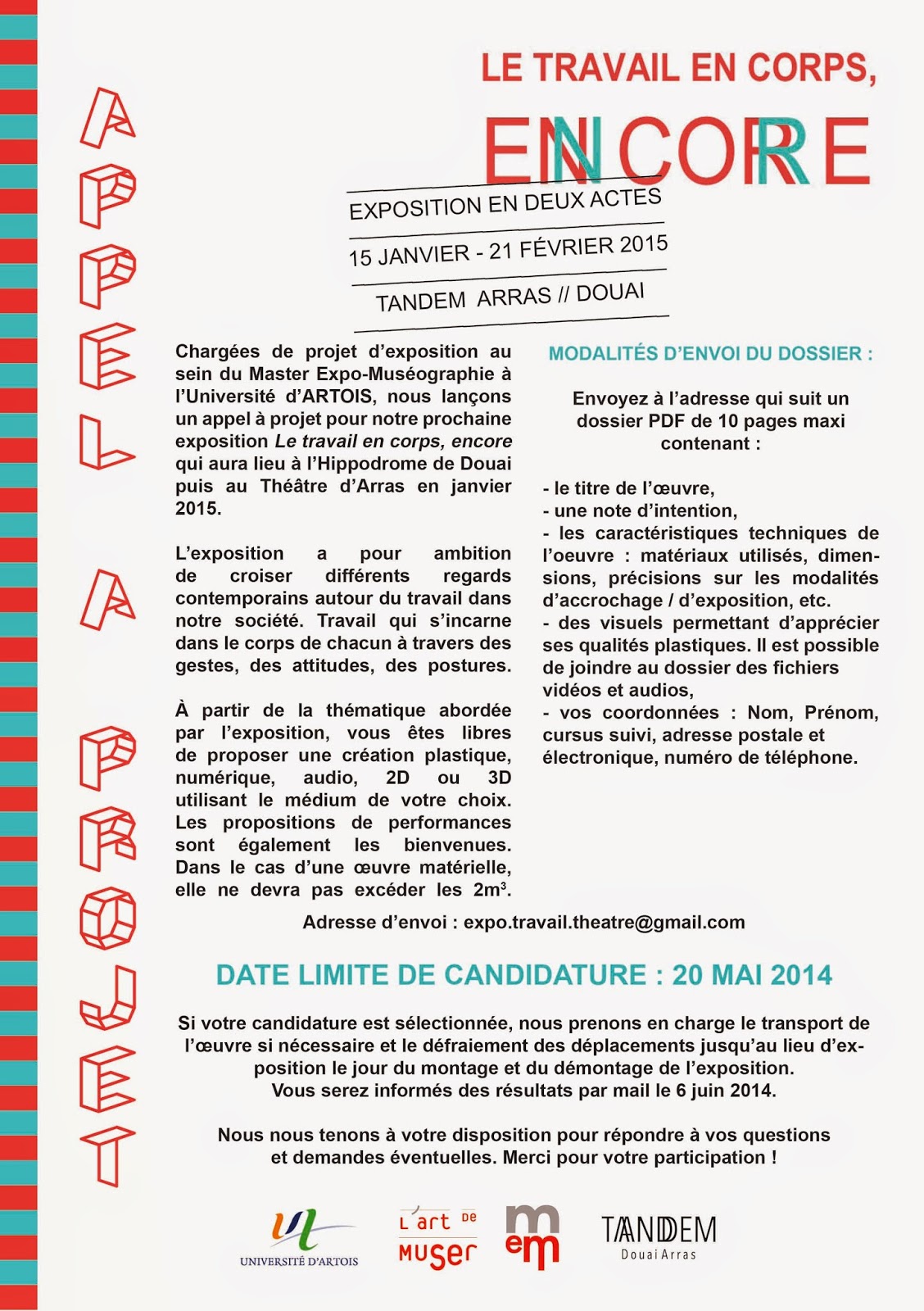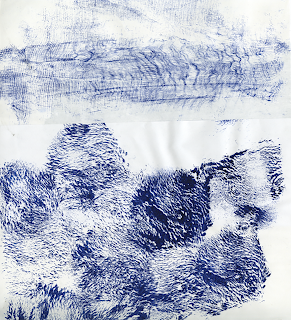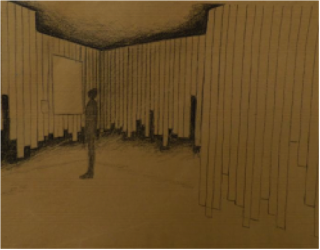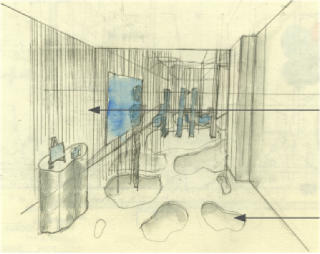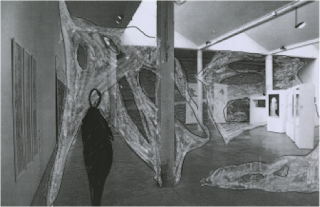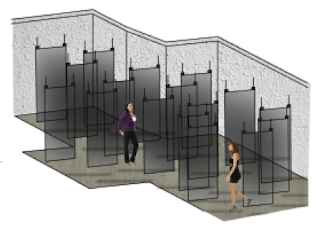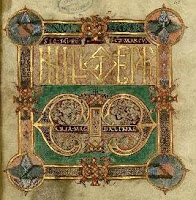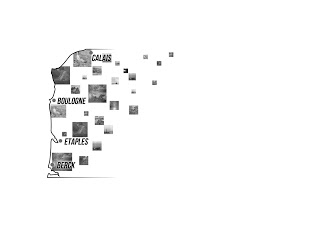Projets des MEM : réalisations - expositions …

"Le travail en corps encore" - Les étudiantes du master s'emparent du Théâtre d'Arras
Tout commence en octobre 2013, lorsque cinq étudiantes de master 1 s’approprient le projet Le travail en corps encore, qui n’avait pas encore de nom avant de les rencontrer.
"Le travail en corps encore" : une immersion dans le Théâtre d’Arras © Sabrina Verove
Tout commence en octobre 2013, lorsque cinq étudiantes de master 1 s’approprient le projet Le travail en corps encore, qui n’avait pas encore de nom avant de les rencontrer. Elles l’ont dorloté jusqu’à lui faire voir le jour. L'éclosion de ce projet est le fruit d’une collaboration entre les étudiantes, l’Art de Muser et le Tandem (le Théâtre d’Arras et l’Hippodrome de Douai) pour une exposition en deux lieux. Nous vous présentons ici l'Acte qui prend place à Arras.
Aux quatre coins des rues d’Arras des affiches vous invitent à venir au théâtre. Vous êtes-vous demandés pourquoi des affiches sont présentes chez le coiffeur, chez le boucher ou encore à la pharmacie ? Et bien, cette exposition touche chaque travailleur et chaque futur travailleur, peu importe leur domaine d’activité.
Six artistes ont répondu à l’appel à projet et se sont questionnés sur le rapport entre le travail et le corps, les séquelles morales et physiques que le travail peut engendrer, le lien entre le travail et le domicile, la vision que chacun a sur certaines activités.
En franchissant les portes du théâtre, le public a pour surprise de découvrir une exposition.
Le parcours est agréable, l’exposition débute dans le hall puis se prolonge dans l’espace bar-détente. Ce partage des espaces la rend attractive.
Effectivement, le parcours est libre et fluide,les œuvres peuvent être associées comme dissociées et ceci dans un sens de visite aléatoire.
Les œuvres trouvent parfaitement leur place dans ce lieu. Les murs blancs et le sol pourpre soulignent les œuvres, leur plasticité et l’esthétisme des gestes, ainsi que le message qu’elles portent.
Cette exposition amène à se questionner, partager des avis, découvrir des artistes. Elle permet aux visiteurs de vivre un moment chaleureux autour d’un thème quotidien.
Le visiteur conclut l’exposition en exprimant les conditions de son corps au travail grâce à trois tampons (une personne heureuse, une personne satisfaite et une personne en colère).
Afin de permettre la découverte des œuvres, les étudiantes, chargées du projet, proposent des visites durant toute la durée de l’exposition : pour le public scolaire ou le public individuel, le public de l’hôpital de jour ainsi que tous les curieux. Chaque personne peut partager ses expériences professionnelles, son ressenti face à ce thème et échanger autour des œuvres. Prêts à en savoir plus sur ces photographies, ces dessins ou ces chaises ?
Commençons par la première œuvre rencontrée : Corps de ballet (2014) de Marion Poussier.
Elle se compose de trois photographies représentant trois femmes, située dans des espaces différents, prenant des postures gracieuses. Leurs corps prennent part à une danse, sont révélés àtravers des gestes qu’elles pratiquent au quotidien. Ces femmes sont agents d’entretien.
Un groupe face aux Corps de Ballet © Sabrina Verove
L’artiste lutte contre les stéréotypes et préjugés envers des métiers bien trop souvent dévalorisés. Ici elle met en lumière ces femmes avec poésie.
Les visiteurs échangent sur le corps et son aspect artistique, sur ce métier indispensable. Ils ont l’occasion de participer à cette recherche gestuelle en prenant un balai et un chiffon et en effectuant des mouvements. Ils répètent ces mouvements sans ces objets. Le corps devient autre, la fonction sensorielle prend le pas sur la fonction utile.

Le travail à l'heure de la technologie © Sabrina Verove
A cette œuvre font écho deux photographies de la série Technomades(2008) de Christophe Beauregard, ou deux personnes sont représentées également sans leur outil de travail. Leurs costumes de bureau et leurs postures amènent immédiatement à deviner que les outils qu’ils ont en mains sont technologiques : un téléphone et peut-être une tablette numérique.
Après avoir quitté le travail, celui-ci peut nous suivre jusqu’à notre domicile par divers moyens. L’artiste questionne ici le pouvoir de la technologie aujourd’hui dans notre vie personnelle.Lisez-vous vos emails une fois les chaussures ôtées à la maison ? Votre téléphone et votre ordinateur professionnels sont-ils toujours à vos côtés ? Le surplus de technologie isole, enferme dans une bulle.
Comme ce thème actuel touche chacun, le public s’exprime facilement sur le sujet, prend conscience de certains actes. Les langues se délient.

La nature au centre de la pensée © Sabrina Verove
Estelle Lebrun apporte sa réflexion sur les pensées qui nous traversent sur le chemin entre notre domicile et notre travail. Sur la trajectoire de paysages, à l’épreuve du dessin (2013/2014) se compose de sept dessins sur papier,en noir et blanc, doux et mystérieux. Ils permettent l’évasion et la libre imagination.
L’artiste observe les paysages qu’elle voit dans le train sur son trajet maison-travail, travail-maison. Elle prend des photographies de bosquets, d’éléments floraux qui bordent la voie de chemin de fer et les adapte en dessin. Ces œuvres sont en mouvements, s’adaptent à la vitesse du train. Ce travail questionne aussi le métier d’artiste et les gestes qu’ils peuvent répéter au quotidien.
À quoi pensez-vous sur le chemin entre votre domicile et votre travail ? Au dossier que vous n’avez pas terminé,à la dernière réunion avec votre patron ou bien détendez-vous en pensant à votre dernier week-end ?
Les visiteurs de l’hôpital de jour ont participé à un atelier en écrivant sur une feuille un mot ou un dessinant ce à quoi ils ont pensé sur la route les menant à l’exposition. Les réponses sont variées,poétiques, humoristiques.
Jean-Louis Accettone intrigue les visiteurs à travers Une expérience éternelle de plus(2007). Ses deux chaises placées contre un mur invitent le public à s’y asseoir.
À première vue à quoi vous fait penser une chaise ? Au repos ? Au travail ? À l’attente ? L’artiste prend en compte ces trois avis. Une chaise permet de flâner, d’attendre confortablement et entraîne des douleurs au travail.
Dès lors qu’une personne s’assoit sur une chaise, une bande sonore démarre. Étrange et envoûtante elle nous parle d’attente, cette attente que nous avons tous vécue, dans un parc, une gare, un restaurant.
L’artiste a choisi la chaise comme un objet quotidien de certains métiers. Le saviez-vous ? En moyenne une personne passe cinq heures assise sur une chaise au cours d’une journée et certaines reproduisent constamment le même geste. De nos jours dans les métiers à la chaîne les postes tournent afin qu’une personne ne répète pas un seul et même geste tout au long de la journée.
Lorsque l'outil de travail devient une oeuvre d'art © Sabrina Verove
Puis le public fait face à deux photographies. Par leur apparence nous pouvons percevoir que les espaces présentés sont des chambres d’aspect accueillant : colorées, décorées et vives.
Que fait-on dans une chambre ? Le public intervient : « On y travaille, on lit des romans, on regarde des films, on se repose, on écoute de la musique etc. » Quel métier ces chambres peuvent représenter ? « Un peintre, un maçon, un agent d’entretien etc. » Une seule image amène plusieurs histoires.
Le doute plane, les personnes qui travaillent dans ces chambres sont absentes. Qui sont-elles et pourquoi ne se dévoilent-elles pas ?
Dans Der Mannergarten (une crèche pour les hommes) (2010-2011) Fabien Marques évoque un métier légal ou illégal selon les pays. C’est le métier de prostituée, où le corps est marchandé, où il est outil de travail.

Dans l'antre d'un métier controversé © Sabrina Verove
Cette exposition, dans un lieu original, est une belle réussite. Les œuvres se répondent et se saisissent du travail sous ses aspects les plus pénibles comme les plus harmonieux. Le public en ressort ravi et voit sous un nouvel angle ce que nous faisons endurer à notre corps au travail.
Curieux d’en savoir plus ? Les étudiantes vous attendent également à l’Hippodrome de Douai !
Lilia Khadri
A découvrir jusqu'au 21 février 2015 au théâtre d'Arras
En savoir plus :- Agenda de l'exposition
# Théâtre
# Travail et corps
# Muséographie
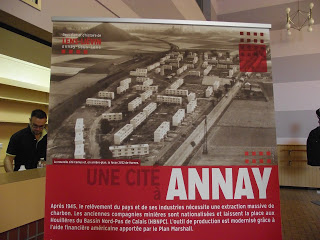
« Vivre en Camus » gravé dans les mémoires
Crédits : K.F
L’exposition « Vivre en Camus » à Annay-sous-Lens donne aux anciens camusards l’occasion de retrouver le voisinage qu’ils ont longtemps aimé côtoyer. Ils s’exclament à la vue d’un ancien ami. Ils rient en regardant les photographies qui leur rappellent assurément des souvenirs chaleureux .
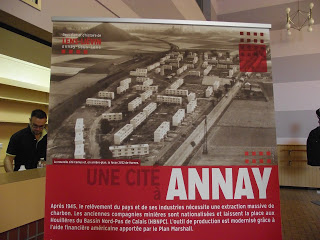
Les Mines sont un univers à part entière, reconnues depuis 2012 patrimoine mondial de l’Unesco, et source d’inspiration pour nos conceptrices d’exposition du Master Expo-Muséographie à l’Université d’Artois. « Vivre en Camus » impulsé par nos professeurs Isabelle Roussel-Gillet et Serge Chaumier, a été mis en œuvre par nos collègues, Mathilde, Lucie, Isabelle et Mylène qui ont fait de ce projet d’exposition un lieu extraordinaire de prise de conscience d’un patrimoine en voie de disparition (avec le soutien de la mairie d’Annay-sous-Lens et le Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin).
Les cités Camus s’écroulent alors que dans le cœur des camusards, elles sont toujours présentes et significatives.
Crédits : K.F

Et au cœur de l’exposition, une salle de projection improvisée offre aux visiteurs l’opportunité de passer la porte de l’un de ces Camus. Accueillis chaleureusement par M. et Mme Monchaux, les visiteurs suivent la visite guidée de la maison où la simplicité de nos hôtes donne à voir le grand cœur des gens du Nord, inimitable, sincère, unique !
Mathilde, Lucie, Isabelle, Mylène, vous avez fait des heureux, je l’ai vu, je l’ai entendu ce public enthousiaste ! C’était magnifique !
Katia Fournier
Appel à candidatures
Appel d'Air : c'est bouleversant.
C’est bientôt l’imminence, c’est bientôt le début, mais aussi la fin. Je viens de sortir de ma salle de classe, j’y ai passé du temps dans un brouhaha productif et joyeux, plongée dans mes pensées, et j’ai de l’acrylique sur mes doigts. J’ai un peu mal aux pieds d’avoir tant marché. Jeudi c’est le lancement, le lancement d’Appel d’Air, la troisième édition de la biennale d’art contemporain d’Arras qui est organisée par les étudiants de mon master. Son thème cette année est le bouleversement. Sens-dessus-dessous, c’est marqué.
C en’est même pas le projet auquel je suis rattachée, mais l’ensemble de ma promotion est mandée pour en organiser la médiation. Avec ma classe donc, nous sommes tous chamboulés : ça fait depuis début février que l’on a des réunions pour l’organiser, depuis une semaine que l’on a réalisé les prototypes en commençant à rigoler, depuis ce matin que nous nous sentons concernés. Bien entendu, trois d’entre nous se sont déjà bien penchées sur le sujet afin de préparer ces réunions en amont devenant médiatrices entre nous et Annaëlle, Joanna, Margot, Julie & Alice, les chargées de production du projet.
 Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C
Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C
Mais d’abord, qu’est ce que la médiation ? La médiation culturelle, on peut la comprendre depuis celle issue du social : on crée un dialogue. Entre l’œuvre et le visiteur si on veut, entre les visiteurs si on sait. J’ai beau en avoir déjà fait, je n’ai pas la prétention de savoir la faire bien, parce que la médiation, elle l’est toujours elle, en débats, en discussions, il n’y a qu’à voir le cours d’hier, ou bien les anecdotes passionnées de Mathilde. La médiation culturelle n’est pas qu’un entre-deux qui lancerait une discussion, elle est aussi porteuse de relation, porteuse de sens. De sens dessus dessous, s’entend. Elle s’élabore et s’adapte, elle essaye d’anticiper les publics quivont être faces à nous dans un premier temps.
En somme, nous ne savons pas précisément qui sera là. On ne peut pas cibler le public passant. Alors on invente : et si on pensait à quelque chose qui interpelle sur le sol ? Et si on partait sur le bleu dénominateur commun des trois éditions ? Et si on cherchait un jeu que tout le monde connaisse ? Julie prend des notes sur le tableau.
Donc il y a cette interrogation, et puis l’émulation. Chaque groupe se forme assez spontanément, on sort du brouillon et des idées, on met cartes sur tables, on construit son idée et on la propose aux autres à la fin. Bethsabée présente le rythme du parcours qui lie les œuvres entre elles. En autonomie, nous sommes nous, avec nos moues réflexives, nos idées auto-stoppées, et ce projet qui finit par prendre forme. Nos tables sont regroupées en espaces distincts de travail. Amaury a un tablier et joue du cutter sur le carton plastifié, Clotilde annote dans du papier, Berivan prépare un pochoir. Chacun se prête au jeu : nos moues de ceux qui voulaient rentrer parce que bon, faim, dissert et compagnie sont quand même les dernières à êtres sorties de la salle parce que attends Maëlle, a t on pensé à ça ?
 Élaboration de prototypes. © J.F.
Élaboration de prototypes. © J.F.
Réalisation des cocottes interpellatrices. © C.D.
Entremêlée à ça, il y a la rencontre avec les œuvres que l’on va devoir présenter. Et derrière ces œuvres, les artistes. En début d’année lors des résidences, certaines d’entre nous ont accepté d’enloger alors que nous découvrions nous-mêmes Arras. Eloïse a dormi sur son matelas gonflable, il y avait quatre artistes qui dormaient chez Justine. Ces personnes, qui viennent des écoles d’art de Cambrai, de Bruxelles ou même du Mans, sont donc venues en octobre découvrir la ville, le postulat de l’édition d’Appel d’Air, pour ensuite construire leurs pièces. Et puis ce matin, certains étaient là pour nous présenter leur travail, en lien avec ce parti-pris : bouleverser Arras et recréer un lien social entretrois quartiers d’une ville fragmentée par une grande ligne ferroviaire, étalée dans la longueur. Cette longueur que nous vivons nous mêmes au quotidien: Julia vit trop loin, et je croise souvent Coralie qui attend son bus.
Je ne vous dirai rien ce soir sur les artistes et sur les œuvres contemporaines qui seront exposées. Bah non, ça serait trop facile. À vous aussi de venir un peu : c’est à Arras du 16 au 18 c’est bleu, c’est entre 11 et 18 heures, c’est dans les rues. Allez un indice : mon premier est sphérique, mon second se tortille, mon troisième se déverse un peu partout dans le monde. Et puis dedans, on y trouve des ponts entre les lieux importants de laville, la participation des habitants et l’invitation à broder. C’est trouble ? C’est tentant ? C’est vendredi !
La médiation, on l’élabore en fonction du lieu où l’on sera. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons marché, beaucoup, pour aller d’un point à l’autre et imaginer ce que seront les visites. Charlène a vérifié, ce matin on avait fait un peu plus de six kilomètres à travers toute la ville sans avoir fini. C’est un corps à corps avec la ville à ce stade, on imagine comment les œuvres se présenteront, une fois leur montage terminé demain soir. On se rend compte des éventuelles questions qui pourront être posées, alors on cherche un peu, on retourne la future visite dans tous les sens. Louison porte les plans que l’on fournira aux visiteurs, parce que oui, penser la médiation, c’est aussi penser l’organisation.
 Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.
Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.
Ponctuation du parcours. © A.L.
Là je suis fatiguée, je suis un peu inquiète. Qu’aurons-nous à dire aux visiteurs ? Ah bah non, attends, me souffle Charlotte, tu sauras quoi dire, il s’agit de créer le dialogue. Alors bien sûr tu n’auras pas rien à dire à tes interlocuteurs, mais le but n’est pas de leur faire un cours magistral, le but reste de les titiller. Et si le débat doit durer trois jours, de vendredi à dimanche, tu sauras le tenir, car on a pensé, ensemble, à tout ce qui était en notre pouvoir.
Reste les impondérables sur lesquels on n’a pas de prise, comme la météo. Le temps qui a l’air de tourner au froid, juste quand on fera de la médiation en extérieur, cool. Emeline sera identifiable à coup sûr avec son écharpe bleue qui recouvre son manteau en hiver. Ce qui est rassurant c’est qu’on ne le fera pas pour rien, car dans la médiation, réside de l’engagement. Bon d’accord rester dans le froid pour créer un dialogue ça n’est pas non plus être un militant, mais c’est quand même le signe d’une volonté de questionner la ville, son sens, sa création, les personnes qui y vivent. Redonner la parole, le geste aux habitants, qu’ils s’approprient, qu’ils prennent conscience que leur ville, ce n’est pas que de de la brique et des voies de circulation, mais que leur ville, ça commence par leur environnement du quotidien, à l’espace dans lequel ils évoluent.
Je conclus, parce qu’il faut que je travaille sur autre chose : nous sommes encore étudiants, ne l’oublions pas, nous avons d’autres travaux à réaliser. Donc face à nous, qui aurons-nous ? Il y aura l’étudiant en musicologie de la fac de l’université d’Artois qui aura vu l’affiche d’Appel d’Air sur l’amphi K, et qui se sera dit "ah bah ouais grave", il y aura la grand-mère qui rentre chez elle et qui tombe sur de la broderie sur les murs et qui sera intriguée, il y aura le maçon qui pensait faire son marché tranquille, et qui verra de loin des hurluberlus se balader avec des bulles de bande dessinée et qui voudrait savoir ce qu’elles auront à dire. Et vous, qu’aurez-vous à nous révéler ?
Coline Cabouret.
#Appeld’Air
#Médiation
#Sens-dessus-dessous
Pour en savoir plus: http://www.biennale-appeldair.fr/

Cléo 3000, le futur d'une muse
Cette année, notre équipe a eu la chance de participer à Museomix au Musée gallo romain de Lyon-Fourvière. A cette occasion votre reporter a pu interviewer un de leurs outils de médiation, venu du futur : Cléo 3000 !
Crédits : Quentin Chevrier
E.B : Bonjour Cléo, pouvez-vous expliquer à nos lecteurs en quoi consiste Museomix?
Cléo 3000 : Bonjour reporter et lecteurs, Museomix est un collectif de créateurs fous, d'innovateurs lancé en 2011. Réunissant la communauté des professionnels des musées, des acteurs de l'innovation et du numérique, ainsi que des amateurs et passionnés de culture. Museomix propose de créer une nouvelle manière de vivre le musée, en développant, sur trois jours des idées et des prototypes, présentés au public le dernier jour. C'est merveilleux que tout cela se déroule sous nos yeux en ce moment. (ndlr : l'interview a eu lieu durant le Museomix 2012 en octobre 2012)
E.B : C'est vrai que c'est impressionnant de voir tant d'idées et de projets fuser ensemble ! Votre arrivée en découle d'ailleurs ..?
Cléo 3000 : C'est exact, l'équipe de médiation en charge de créer des liens entre les prototypes et avec les visiteurs, a décidé de me faire venir du futur, de 3012. Ainsi je peux dévoiler aux générations qui m'ont précédé l'importance de l'innovation qu'ils vivent aujourd'hui à Lyon et ce que cela créera plus tard, moi par exemple ! Le tout premier robot interactif, intelligent, avec des oreilles !
E.B : Alors, merci à tous les participants, qui vous ont permis d'exister dans un lointain futur. Pouvez-vous nous présenter maintenant votre rôle auprès des visiteurs ?
Cléo 3000 : Je suis leur lien avec les médiateurs, les prototypes et les collections du musée. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que je me réveille et que je réponde à vos questions. Je fais en sorte de guider le public, comme Mercure Psychopompe, dieu des romains le faisait avec les âmes et les voyageurs. D'ailleurs toute l'équipe des médiateurs porte une couronne ornée d'ailes dorées, remémorant les attributs de ce dieu, capable de voler. Répartis aux points névralgiques du musée gallo romain de Lyon-Fourvière, les médiateurs accompagnent les visiteurs dans leur démarche d'innovation et les guident à travers les installations. Quelle belle mission !
E.B : Votre époque paraît spectaculaire ! Nos lecteurs et moi-même souhaiterions savoir ce que vous pensez de la notre. Ne sommes-nous pas trop archaïque ?

Cléo 3000 répondant aux questions des visiteurs Crédits : Quentin Chevrier
Cléo 3000 : Je conviens que votre look vestimentaire me déconcerte au plus haut point. Je ne comprends pas comment, cela fonctionne, ni la forme, ni le sens. C'est peut-être moi qui suis archaïque ! A mon époque c'est plus simple, nos tuniques ont l'air conditionné intégré, nous n'avons jamais ni trop chaud ni trop froid et nous portons de la couleur. Pour nous, le gris n'en n'est pas une. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué lors de ce week-end en 2012.
E.B : Peut-on savoir alors ce qui vous a le plus marqué ?
Cléo 3000 : Ce sont les personnes que j'ai rencontré, plus créatives les unes que les autres. Avec une volonté ferme de faire vivre le musée. C'est grâce à des événements comme Museomix, que ces lieux de culture évoluent. Le travail des museomixeurs de cette année est un exemple, parmi tant d'autres, qui nous permet de comprendre que "nouvelle technologie" n'est pas antinomique de "culture" et "mémoire".
E.B : C'est absolument exaltant en effet, merci beaucoup Cléo d'avoir répondu à nos questions.
Cléo 3000 : Ce fut un réel plaisir de satisfaire vos demandes, je suis à votre service. Merci à vous. Et vivement l'édition 3013, la 1003ème !!
Elisa Bellancourt
Informations :Museomix Museomix en Nord
Inscriptions :INSCRIPTION EN LIGNE

Deux expositions à voir dans le Pas-de-Calais
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que l’AssociationL’Art de Muser et les étudiants de la promotion 2013 Marie-Geneviève Bouliard du Master Expo-Muséographie vous annoncent l’ouverture des deux premières expositions menées à bien par deux groupes de la formation.

Vernissage exposition L'Objectif en coulisses
Crédits : Mtdf
L’Objectif en coulisses -
Robert Baronet porte un intérêt pour la représentation photographique des réserves muséales et l’ambiance qui en ressort. Ces lieux souvent confondus avec des « cavernes d’Ali Baba » restent empreints de mystères et de nombreuses histoires… Après avoir parcouru les musées québécois équipé de son appareil photo, il décide de venir en France afin d’effectuer le même travail.
Cinq étudiantes de la formation ont alors organisé la venue etle parcours du photographe à travers une dizaine de musées du Nord-Pas de Calais. Après la prise de contact avec les institutions, la gestion des droits de photographies, elles se sont attelées à la tâche pour trouver un lieu d’exposition ainsi qu’un mode scénographique qui saura mettre en valeur les œuvres créées par Robert Baronet.
Puis, Cécile, Rachel, Aelis, Camille et Aurélie ont su sélectionner parmi l’ensemble des clichés effectués les « portraits photographiques » des réserves de la région susceptibles d’attirer le plusl’attention des visiteurs. Inaugurée le 7 février 2013 à l’Office Culturel d’Arras, l’exposition sera ensuite présentée à l’Université d’Artois à Lens à partir du 7 mars 2013. Les deux expositions présenteront deux scénographies différentes mettant en valeur les photographies pour notre plus grand plaisir. Mais, nous gardons le secret, il vous faudra les découvrir sur place …

Le groupe de M2 à l'origine de l'exposition accompagné de Serge Chaumier et d'Isabelle Roussel-Gillet
Crédits : Mtdf
A partir du 7 mars 2013 à l'Université de Lens
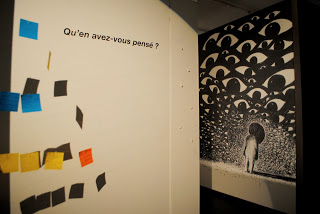
Exposition Épilepsies : Mythes et préjugés
Crédits : Mtdf
Épilepsies : mythes et préjugés –
A la base du projet, juste un mot « épilepsies », proposé par Isabelle Roussel-Gillet en charge d’aider et d’orienter les étudiants de la formation dans leurs projets de groupe, a attisé la curiosité de Zoé, Jody, Camille et Julie. Pendant 18 mois, elles ont rencontré des personnes ayant une épilepsie, des professionnels de la santé (neurologues entre autres), l’Association Epilepsie France à travers l’antenne Nord-Pas de Calais dirigée par Simone Fortier.
Puis, toujours avec une énergie débordante, elles sont allées à la rencontre de structures culturelles de la région pouvant être intéressées pour accueillir leur exposition. C’est finalement le Musée d’Ethnologie Régional de Béthune qui a choisi d’accueillir l’exposition dans la Chapelle Saint-Pry du 16 février 2013 au 9 juin 2013. Après plusieurs mois de recherches intensives sur le sujet, le groupe de projet met en avant leur préprogramme comme une évidence : il faut croiser les regards (scientifiques, historiques, patients et artistiques) pour combattre les préjugés autour de la maladie. Les témoignages artistiques sont au cœur de l’exposition allant des représentations picturales de la maladie, assimilée à de la folie, à des plages de bandes-dessinés personnelles des auteurs David B. et Elodie Durand. En plus, trois artistes ont ajouté leurs touches personnelles au projet à travers des installations contemporaines.

Le groupe d'étudiantes à l'origine de l'exposition Epilepsies
Crédits : Mtdf
Du 16 Février au 9 Juin Chapelle St Pry de Béthune
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf mardi et jours fériés.
L'Art de Muser

Deux films du MEM primés, en prime!
Ce mercredi 23 janvier, le SITEM avait déroulé le tapis rouge : à midi avait lieu la remise des prix du concours Musées(em)portables. Le principe de la compétition est simple : produire avec du matériel non-professionnel un film de trois minutes dans un musée ou un lieu patrimonial. Son but : inviter à une réappropriation du musée par une démarche créative très libre et très simple à mettre en œuvre.
Comme chaque année, les étudiant.es du MEM ont répondu présent.es au défi lancé par Museumexperts. Elles ont réalisé six films au Musée des beaux-arts d'Arras et ont accompagné 14 groupes d'élèves du secondaire, d'étudiant.es ou d'adultes pour la réalisation de leurs propres films dans diverses institutions volontaires des Hauts-de-France. Au total, le master a participé de près ou de loin à l'élaboration de 56 films envoyés aux organisateurs du concours, qui en ont reçu 78 pour cette édition.
Et il faut croire que la quantité n'a pas nui à la qualité pour cette édition puisque deux films réalisés par les étudiantes du MEM ont été primés : La Belle Hélènea obtenu le 1er prix décerné par Museumexperts et MBA Hotel a obtenu le 3e prix. Le jury a choisi de récompenser deux productions de tonalité et de facture très différentes qui ont néanmoins en commun, a précisé le jury, d’assumer un parti-pris, un regard original sur les lieux filmés. MBA Hotels’inscrit dans un tout autre registre : c’est un court-métrage humoristique, une réflexion décalée sur les nouvelles appropriations des musées par le public. La Belle Hélène est un court-métrage poétique, qui propose au spectateur de suivre le quotidien d'Hélène, une femme-muse. La Belle Hélène s’est également vu remettre un prix spécial de l’Association des Conservateurs des Collections publiques de France qui a ainsi voulu distinguer tant ses qualités esthétiques que l’audace de son propos.
Vous vous en voulez d'avoir raté la cérémonie ? Bonne nouvelle : vous pouvez visionner les six films produits par les étudiant.es du MEM ici.
Et bientôt les 6 films lauréats de cette édition sur : http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/videos
C.R.
#SITEM
#Musées(em)portable
#vidéo
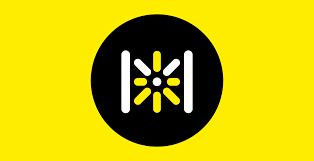
Développer un outil en 3 jours...
La médiation muséale est un travail de longue haleine : établir un axe, le développer, le défendre, le tester, l’intégrer au musée etc. Comment s'imaginer la création d'une dizaine de prototypes d'outils de médiation, en moins de 36 heures ? Le concept Museomix est tout simplement une machine !
En un peu moins de trois jours, environ 150 participants et coachs, (créatifs, développeurs, médiateurs, community manager..) développent un peu plus d'une dizaine de projets de médiation. Chaque équipe s'approprie un musée, des collections, mais surtout avec les nouvelles technologies (mises à leur disposition). Le dernier Museomix s’est déroulé au musée gallo-romains de Lyon Fourvière, les19, 20 et 21 octobre 2012.
De nombreux espaces furent proposés auxparticipants, les incitant alors à s'en approprier et à imaginer une idée porteuse et novatrice.
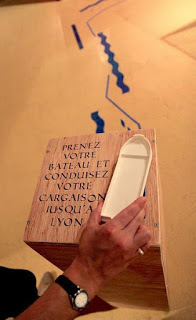
Crédits : Quentin Chevrier
L'année 2013 va être une année novatrice pour Museomix qui se déroulera dans pas un musée mais six ! Dont quatre en France, un au Canada et un en Angleterre. Notre master organise celui qui se déroulera au Louvre-Lens. C'est pourquoi notre petite équipe de M1 a participé activement à l'édition 2012, qui fut pleine de découvertes et de rencontres. J'ai eu la chance d'intégrer l’une des équipes de participants; se fut une course marathonienne afin de mettre en place notre prototype.
Avec mon équipe, nous nous sommes penchés sur la partie du musée qui retranscrit l'importance de Lyon, comme lieu incontournable du commerce méditerranéen (France/ Espagne/ Italie). On y trouve des amphores, des stèles, et mosaïques témoignant de l'activité marchande. Nous avons alors imaginé un voyage interactif et participatif. Ce parcours permettait aux visiteurs de toute âge de découvrir, le commerce du vin à travers ses différentes étapes : de sa production en Espagne à sa consommation à Lyon. Quelques contraintes temporelles et spatiale nous ont été imposés, en effet la médiationne devait pas dépasser une durée de 7 à 8 minutes et nous devions nous adapter à la scénographie de l'exposition temporaire, mise en place au préalable dans le musée.
Le parcours commençait avec l'entrée dans l’espace du commerce en Méditerranée, au milieu des amphores et des inscriptions. Sur une borne repose un petit bateau. Un texte d’accueil invite le visiteur à le saisir et le faire cheminer le long d’un parcours au sol, au milieu des collections, simulant la mer Méditerranée et le Rhône. Arrivé à la première borne, il fallait déposer le bateau sur le dessus et une bande son débutait alors. La voix du Dieu antique Bacchus retentissait et plongeait le visiteur au cœur du quotidien, des enjeux et des aléas du transport maritime. Il le guidait vers les prochaines étapes du voyage : passer d’une borne à l’autre et avancer dans sa découverte.
Pour pouvoir avancer, le voyageur devait réaliser une épreuve, sous forme de manipulation intégrée à la borne. Chaque manipulation le mettait dans la situation d’un marin au cours d’une navigation et l’amenait, par le fait, à s’immerger dans les pratiques de l’époque (Exemple : souffler pour symboliser la navigation à la voile, tirer sur une corde pour comprendre le halage sur le Rhône, verser le contenu des amphores dans un réservoir de stockage, etc.).
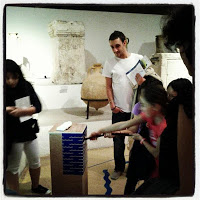
Crédits : Quentin Chevrier
A chaque étape les événements étaient inspirés des objets de la collection qui l’entourait (mosaïques, amphores, sarcophage de charpentier, stèles, dolium…). Le bateau lui servait de fil conducteur, tout au long du parcours entre les bornes et donc retraçait le voyage de Tarragone à Lyon. Il servait également de déclencheur pour la bande son (avec un capteur RFID et Arduimo). Cet outil de médiation a été imaginé pour évoluer avec la mise en place d'un dispositif lumineux. Les objets exposés pourraient s'éclairer au moment où l'histoire les citerait. L'espace serait ainsi moins éclairé et donc plus immersif et le visiteur pourrait plus facilement relier les objets à l'histoire.
Cette approche ludique du commerce en méditerranée, a beaucoup plu au jeune public, car le fait d'intégrer une manipulation physique dans ce dispositif, les questionne et incite leur curiosité.
La création et surtout la mise en place de cet outil ne fût pas facile, en effet à la fin des trois jours il n'était pas totalement opérationnel : quelques petits problèmes techniques, comme la miseen place du dispositif électronique sur les bornes, mais cela reste un prototype.
Néanmoins, cet outil de médiation est en cours de développement au musée, afin de devenir un réel outil de médiation à temps plein.
Agathe Gadenne

Etudes des publics et recherche : Au service du Louvre
Au cours du mois d’octobre, les Master 2 sont partis en visite au Louvre Paris afin de rencontrer l’équipe d’Anne Krebs. Celle-ci dirige le service d’études et de recherche de la Direction de la politique des publics et de l’éducation artistique du musée, le premier dans son genre. Depuis 2002, cette équipe mène des analyses pour approfondir les connaissances sur les publics dans le but de développer une offre culturelle et éducative toujours mieux adaptée aux nouvelles tendances muséales. Au-delà de ce travail principal, nous avons pu découvrir qu’elle mène aussi des études externes en partenariat avec d’autres musées franciliens.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval
Lors de notre rencontre avec une partie de l’équipe, nous avons parlé plus particulièrement de l’organisation des études sur les expositions temporaires en amont de la présentation au public, afin de définir le visuel le plus adapté pour l'affiche. L’objectif de cette action est de rendre la communication de l’évènement la plus efficace possible. Des sessions de groupe avec différents panels de publics sont organisées dans ce cadre. Elles sont animées par un enquêteur dont le rôle est de donner les thèmes de discussion, de stimuler, recadrer, synthétiser et enfin contrôler le temps. Le Louvre part du postulat que le visuel d’une exposition doit savoir parler de la thématique abordée tout en la rendant attractive pour les visiteurs. Ce sont donc les réactions du groupe face aux couleurs, au format et à la typographie qui sont analysées par le service.
Puis nous sommes allées tester le nouveau dispositif de médiation embarquée mis en place dans le Louvre depuis le premier semestre 2012 : la Nintendo DS3D ©. Celui-ci comprend deux écrans qui permettent au visiteur de se situer dans le vaste espace du musée grâce à un système de géolocalisation ainsi que plusieurs parcours en fonction de ses attentes de visite, le tout en proposant le discours d’un audioguide de base. Après avoir passé environs trois heures à tester l’audioguide par nous-même ainsi que d’interroger et d’observer l’utilisation de ce système par les visiteurs, une session de débriefing a été organisée par Anne Krebs et son équipe. Ils ont la mission d’évaluer l’impact de ce nouveau système sur les parcours de visite mais aussi plus généralement sa réception par le public. La session s’est déroulée sous forme de brainstorming mettant en avant nos principales impressions quant à l’utilisation de la Nintendo.
Crédits : MTDF

A partir de toutes les informations et impressions que nous avons données, les membres du service présents nous ont montré quels étaient les faits importants à mettre en avant dans une évaluation d’un dispositif interactif, comme les aspects techniques par exemple.
Cette journée a permis à l’ensemble de la promotion de découvrir concrètement les missions d’un service d’étude des publics ainsi que d’appréhender leurs méthodes de travail. Nous remercions Anne Krebs et son équipe de nous avoir accueilli dans leur locaux et fait partager cette expérience.
Laura Clerc
[1] Voirla liste des études réalisées par le service études et recherche du Louvre

Familles au musée : le Tote Bag du Louvre-Lens
Le 6 novembre 2019 s’est tenu au Louvre-Lens une présentation d’un dispositif famille mis en place grâce à un partenariat réunissant L'École de la deuxième Chance de Liévin (E2C), Le Louvre-Lens et le MuséoLab du Louvre-Lens-Vallée. Y a collaboré le Master Expographie Muséographie pour la phase test. Il s’est agi de créer des outils de médiation inclus dans un tote-bag mis à disposition des familles pour animer leur visite de la galerie du temps *.
Le MuséoLab : un espace de co-construction
Lancé en 2014 par Serge Chaumier, qui en est le responsable scientifique, le MuseoLab prend place dans le bâtiment de Louvre-Lens Vallée. Il a été inauguré fin août 2019. Ce fablab au service de la muséographie permet de travailler en partenariat avec des structures culturelles et de faire découvrir aux publics les outils numériques. Plusieurs projets sont en cours de développement, dont celui décrit ci-dessous.
Une collaboration enrichissante
Louvre-Lens, 10 heures. La présentation du dispositif famille commence. Gautier Verbeke, responsable de la médiation au musée, explique le projet en quelques mots. L’E2C propose à des jeunes de participer à un dispositif construit en partenariat avec le musée et le MuséoLab afin de créer des supports de médiation pour les familles visitant la galerie du temps. Il s’agit de former les jeunes à la maîtrise des machines, en leur faisant fabriquer des outils de médiation et ce faisant de les sensibiliser au contenu du musée. Le projet co-organisé entre l’E2C et les équipes de médiation du musée consiste en une série de six ateliers animés par le FabManager. Le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois (MEM) y est associé pour la phase d’évaluation des usages des outils réalisés. Le soutien de la Fondation Orange a permis de financer le projet. Le film relate en une dizaine de minutes le projet. « Le musée est un outil pour tous » conclut celui-ci.
Le film débute. Nathan Chateau, fabmanager du Louvre-Lens (auquel a succédé aujourd’hui Léo Marius), apprend aux jeunes de l’E2C les bases des outils informatiques. Grâce aux imprimantes 3D et autres découpeuses laser, le kit de médiation prend forme : on découvre un puzzle représentant la galerie du temps et de petits viseurs pour voir l’œuvre autrement. Ces viseurs, créés grâce à l’imprimante 3D, permettent de jouer sur les perspectives de l’œuvre, mais aussi sur la perception que le visiteur en a puisque, selon la forme utilisée - carré, rond ou rectangle - les perspectives changent et les tableaux prennent vie autrement. L’écran s’obscurcit, le film se termine : il est maintenant temps de découvrir le Tote Bag.
Les familles arrivent pour le test. Le dispositif est alors présenté par les jeunes de l’E2C. Julien, de l’école, nous raconte le projet. Le Tote Bag contient un puzzle, les viseurs, mais également des planches de dessin et des indications pour la visite de la galerie du temps. Les familles doivent trouver six œuvres dans la salle et répondre aux questions sur l’œuvre. Le Tote Bag est mis gratuitement à la disposition des familles à leur arrivée. Il est pensé pour la tranche d’âge 3-11 ans et a nécessité 2 mois pour concevoir et réaliser les objets qui le composent. Julien est ravi du résultat : grâce à ce projet, il a appris à utiliser une découpeuse laser et les logiciels numériques. Cette expérience lui a redonné confiance en lui.

Les jeunes de l’E2C présentent le Tote Bag aux étudiantes du MEM. © C.DC
Le but de ce projet, plus que de créer un dispositif famille, est de permettre à des jeunes de s’intégrer dans la vie active, mais aussi culturelle de la région. Ce programme s’inscrit pleinement dans la vision du musée. Le choix de la ville de Lens en 2004 pour délocaliser une partie des œuvres du Louvre s’inscrit dans une politique visant à rendre la culture plus accessible en région. Le bassin minier était donc un choix logique pour y implanter le Louvre-Lens. Le projet conçu avec le Muséolab est un vecteur de cette démocratisation culturelle. Beaucoup des élèves de l’E2C n’étaient jamais allés au Louvre Lens auparavant. Ce projet leur permet de découvrir de nouveaux outils - et autant de possibilités en termes de compétences - mais aussi de s’approprier l’espace muséal.
Il en est de même pour les familles. En effet, bien que les habitants de la région Hauts-de-France constitue le noyau des visiteurs du Louvre-Lens, les locaux ont encore du mal à s’approprier le musée. Le Tote-Bag peut devenir un véritable moteur pour les familles découvrent le musée, un enfant ne venant jamais sans être accompagné d’un adulte.
En avant pour le test !
Les enfants s’impatientent : il est temps d’essayer les Tote Bag ! Ceux-ci sont distribués et les enfants s’élancent vers la galerie du temps. Les étudiantes du master les observent. Après quelques minutes de jeux, elles s’approchent des familles et les questionnent sur la réception du dispositif. Hélène et ses deux garçons observent Une assemblée des mystiques. Le parcours plaît aux enfants, mais certains mots sont parfois compliqués : c’est le cas d’« architecte ». Une autre famille s’approche des œuvres. Timéo, 7 ans, a l’impression de faire une chasse aux trésors. Sa petite sœur de 3 ans, joue avec les viseurs. Son grand-père Gérard estime que le parcours n’est pas adapté à son âge, mais les « loupes », comme il les appelle, sont un formidable moyen de rendre la visite plus attractive. Les deux enfants ont beaucoup aimé le puzzle, coloré et ludique. Gérard apprécie lui aussi le dispositif. Peu attiré par les œuvres d’art, le parcours et les questions lui permettent de s’intéresser à certains aspects des œuvres auxquels il n’aurait pas prêté attention sans le Tote Bag. « Ce serait un bon concept à adapter aux adultes ! » lance-t-il. A bon entendeur…

Les familles testent et s’amusent. © C.DC / J.G
Petit à petit, les familles se dispersent. L’équipe du master se rassemble pour partager ses premières constatations. Le Tote Bag est un bon outil de médiation pour les familles. Le dispositif est varié, et le puzzle est très apprécié. Les fiches du parcours sont pour le moment des feuilles volantes mais, dans une version améliorée, celles-ci seront plastifiées et attachées entre elles. La forme même du sac est quant à elle à redéfinir. Le Tote Bag est tendance, mais pas forcément adapté à la petite taille des enfants. Pourquoi ne pas le remplacer par un sac triangle ou une petite valisette type “lunchbox” ? La place du sac est à redéfinir en fonction de la personne qui le porte : enfant ou accompagnant ?
Midi, la matinée se termine. Un beau travail de collaboration entre plusieurs entités vient de prendre un tournant : une fois le dispositif ajusté, les Tote Bag, au nombre de dix, seront proposés par le personnel d’accueil du musée aux familles visiteuses. Un nouveau cycle de formation commencera avec de nouveaux jeunes participants en janvier prochain
Clémence de Carvalho
*Pour garder l’anonymat des familles, certains noms ont été changés.
Pour aller plus loin :
Les Makers de l’Art, vidéo de présentation du projet conduit par les jeunes de l’E2C. https://www.youtube.com/watch?v=lJZ9lRErN2s
#famille
#louvrelens
#dispositif

File ta bobine à La Manuf'
Le récit d’une aventure humaine et technologique, à renfort d’énergie et de fils
C’est avec un très grand plaisir que j’ai participé à l’édition Museomix Nord 2015. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Museomix est un rassemblement de 3 jours, pendant lesquels des personnes d’horizons divers et variés revisitent un musée en proposant des idées neuves, parfois un peu loufoques, souvent futuristes et généralement participatives et interactives. Le but ? Repenser le musée, le recentrer sur l’expérience du visiteur, en repoussant les barrières technologiques, pour innover et le rendre toujours plus attractif.
Du 6 au 8 novembre, La Manufacture de Roubaix (alias La Manuf’) a accueilli une cinquantaine de museomixeurs dans ses locaux. Ce musée, qui prend place dans une ancienne usine de textile, présente une très belle salle des machines, allant du métier à tisser médiéval (reproduction du XIe siècle) à une machine de la fin des années 1990. Chaque machine est sublimée par un jeu de lumières sur les multiples fils qui se déploient tels des rideaux autour d’une scène. Et les couleurs des bobines donnent parfois à l’ensemble un aspect d’arc-en-ciel.

@Ndgh59
Mais revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bobines. Laissez-moi vous présenter notre équipe des Embobineurs et notre prototype File ta bobine !
Pendant ces trois jours, j’ai fait partie de l’équipe des Embobineurs en tant que communicante, au côté de Céline (coach bien-être et santé), Manon (archiviste méticuleuse), Gautier (graphiste de la mort), Charlotte (médiatrice bricoleuse), Pierre (fabricant menuisier) et Alex (DJ codeur de l’extrême).
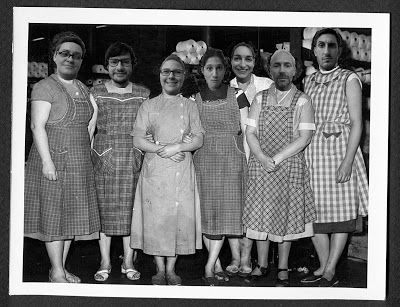
@FileTaBobine
Nous avons eu la volonté de tisser du lien entre le passé et le présent, entre le visiteur actuel du musée et l’ouvrier de l’usine, entre l’Homme et la machine. Pour cela, nous avons choisi de nous installer en début de parcours afin d’emmener le visiteur dès le début de son expérience muséale.
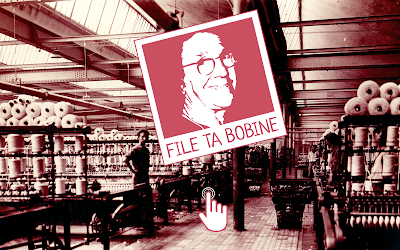
@FileTaBobine
A travers une installation faite de fils et de tissus, notre prototype propose au visiteur de devenir Suzanne l’ouvrière, la petite Philomène, Yahya l’ouvrier immigré, Israël le patron ou le jeune Alfred. Grâce à un écran tactile, chaque visiteur choisit le profil d’un de ces anciens acteurs de l’usine. Il accède ensuite à une photo d’époque.
Grâce à une webcam, son visage vient s’incruster dans celle-ci. Une carte d’ouvrier s’imprime, et donne des informations complémentaires au visiteur : caractéristiques physiques, origine, adresse, année d’embauche, profession, observations du chef du personnel, machine attribuée dans le parcours d’exposition.

@FileTaBobine
Par la suite, le visiteur effectue sa visite avec sa carte d’ouvrier. Il peut alors se confronter à la machine sur laquelle il aurait travaillé s’il avait été ouvrier à l’époque. A la fin de son parcours, s’il le souhaite, le visiteur vient accrocher sa carte d’ouvrier sur l’installation. Il s’insère ainsi dans un tissu de visiteurs actuels du musée et d’anciens acteurs de l’usine.

@FileTaBobine
Et sinon, concrètement, les trois de jours de Museomix, comment ça se passe ?
J1
Après un accueil sympathique, une distribution de tote bag et de badges (dont un magnifiquement tricoté), nous avons eu le droit à une visite guidée de La Manuf’, suivie de la présentation des partenaires : La Piscine de Roubaix, l’Ecomusée de Fourmies, les Archives du Monde du travail de Roubaix, Holusion, Tri-D, et TXRobotic.
Ensuite, sur des thématiques prédéfinies, les museomixeurs inscrivent des mots, des idées grâce à des post-it. Une fois ce grand brainstorming effectué, chacun pose son badge devant la thématique qu’il préfère, et un bingo géant permet de constituer les équipes, qui se compose de 7 personnes : un coach, un expert en contenus, un graphiste, un médiateur, un communiquant, un codeur, et un fabricant.
Le reste de la journée permet de réfléchir et d’échanger en équipe autour de ce sujet. Le temps passe alors très vite. Beaucoup d’idées se succèdent, s’entremêlent. L’équipe s’approprie le sujet, une trame commence à prendre forme, un scénario utilisateur apparait et, ensemble, nous validons notre idée de prototype pour la présenter plus tard en plénière.

@Ndgh59
J2
Le deuxième jour, une fois les rôles précisés, la phase de réalisation commence. Une liste de course est établie pour réaliser notre prototype. Un compte Twitter spécifique devient notre relais de communication, à grand renfort de photos. Une partie de l’équipe se lance dans la fabrication d’une maquette afin de se confronter aux contraintes techniques de la future réalisation.
L’un code, un autre définit l’identité visuelle… pendant qu’un dernier part récolter des informations dans les archives. La rédaction s’initie. Nous discutons, rigolons… La fatigue commence aussi à se faire sentir. Vient ensuite le moment de créer une vidéo pour présenter notre idée le soir en plénière. Après le dîner, certains membres de l’équipe commence à scier, viser et peindre, pendant que les autres continuent à coder, rédiger, photoshopper…
J3
Après quelques heures de sommeil vient le troisième et dernier jour. Un seul mot d’ordre : foncer ! A peine arrivé, chacun saute sur les pinceaux, les ciseaux, l’agrafeuse, la scie sauteuse, la perceuse et plusieurs d’entre nous attaquent le montage et la mise en place de la structure. Pendant ce temps, le codeur et le graphiste continuent leurs travaux respectifs.
La pression monte, l’équipe ne s’arrête pas. En début d’après-midi, nous réalisons un crash test avec les organisateurs et l’équipe du musée. Cela permet de faire le point sur l’accompagnement et la médiation des futurs visiteurs. Le codeur se confronte aux bugs et problèmes techniques de dernières minutes.
Et tout d’un coup, il est déjà 16H et les premiers visiteurs arrivent. Commencent alors les explications, la médiation, les échanges, les derniers réglages… Tout se passe dans la bonne humeur. Nous sommes très contents d’avoir réalisé tout cela en 3 jours, malgré la fatigue ; et les sourires des visiteurs nous le rendent bien.

@MuseomixNord
Comment en savoir plus ?
Je vous invite vivement à consulter les comptes Twitter de chacune des équipes de Museomix Nord pour découvrir tous les prototypes, et je remercie toute l’équipe de @MuseomixNord et de@LaManufRBX pour cette aventure intense, pleine d’énergie, d’idées, de bonbons et d’innovation !
@FileTaBobine @rrroubaix @TextileFutur @MiniJacquard @EnTrame @Industructibles
Nadège Herreman
Vous pourrez aussi par la suite retrouver les fiches de tous les prototypes sur le site de Museomix : http://www.museomix.org/les-prototypes/
#Museomix
#Innovation
#Prototype
.JPG)
L'audit de montée en qualité
Étudiantes en première année du Master Expo-Muséographie, nous avons eul'opportunité de mener des « audits de montée en qualité » pour 5 structures du réseau Proscitec.
Le réseau Proscitecréunit, accompagne et assure la promotion d'une cinquantaine d'acteurs régionaux en patrimoine industriel et mémoire des métiers sur le territoire Nord-Pas de Calais. Parmi eux, on compte par exemple le Musée de Plein Airde Villeneuve d'Ascq, le Centre Historique Minier de Lewarde, ou encore la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais.
Dans un soucis d'accueillir au mieux les visiteurs des sites adhérents au réseau, l'association Proscitec a fait appel au master Expo-Muséographie de l'Université d'Artois pour se prêter au jeu de l'audit dans 5 structures volontaires : Le Musée portuairede la ville de Dunkerque, l'Ecomusée de l'Avesnois, le Musée de la radiode Boeschepe, le Centre de mémoire de la verrerie d'en haut à Aniche et le Musée de la faïence et de la poterie à Ferrière-la-Petite.
Qu'est-ce qu'un « audit de montée en qualité » ?
Précisons d'abord que nous écartons l'acception négative du terme «audit» parfois associée à une restructuration ou au licenciement; nous privilégions le sens d'un accompagnement des structures. La démarche de l'audit consiste à apporter un regard extérieur sur chacune des structures afin de conforter des pistes déjà abordées ou de relever des points à améliorer.
Ce regard extérieur permet de pointer des éléments, voire des détails que les membres des structures ne voient plus au quotidien. L'enjeu de l'audit de montée en qualité est de proposer des pistes d'amélioration qui puissent correspondre au maximum aux envies et aux possibilités de chacune de ces structures. Il existe mille façons de raconter une histoire à partir d'une même collection ; ainsi, chaque musée se verra proposer des pistes de réflexions et des propositions qu'il sera libre de suivre ou non.
Comment réaliser un audit de montée en qualité ?
.JPG)
Une signalétique parfois bancale Crédits : P.W.
D'un point de vue purement méthodologique, voici la manière dont nous avons procédé : tout d'abord, chaque musée audité a été diagnostiqué avec attention. Il est important de connaître le contexte (territorial, historique) et le contenu d'une structure avant de pouvoir mener une analyse. Pour cela, nous avons visité une première fois la structure auditée, nous avons suivi une visite – guidée dans la mesure du possible –, nous avons visité les environs et nous sommes parties à la recherche d'informations pratiques (site internet, panneaux dans l'agglomération, offices de tourisme,...). Après avoir pris connaissance de l'objet de notre étude, nous nous sommes lancées dans la phase de l'auditqui consiste à répondre à une grille de 335 questions.
Une seconde visite a alors été programmée et nous sommes parties à la rencontre des acteurs de ces musées (responsables des structures, bénévoles, agents d'accueil, médiateurs,...). Les questions de cette grille sont regroupées en 11 parties : « avant la visite » ,« outils de communication », « extérieur » ,« entrée dans le musée », « le personnel »,« les collections et leur valorisation », « les visiteurs », « l'offre », « les services », « la sortie », et enfin « le réseau PROSCITEC ». La précision de certaines questions peut aller jusqu'à nécessiter la prise de mesures d'une porte afin de vérifier l'accessibilité des espaces par exemple. La prise de photographies sur place est très importante car souvent, une photographie vaut mieux qu'un long discours pour évoquer des aspects relatifs à la muséographie ou à la signalétique.
A quoi cela peut-il servir ?
A partir des réponses fournies par la grille, nous établissons des constats qui nous permettent ensuite de proposer des « préconisations ». L'audit permet de mettre en avant certains détails qui, mis bout à bout, constituent un ensemble ayant beaucoup d'influence sur le confort de visite. Comme un cartel mal placé, peu lisible, des collections peu valorisées lorsque certains objets sont cachés par d'autres, une signalétique incohérente,... Tant d'éléments qui nécessitent parfois un regard extérieur pour en prendre conscience.

Des expôts en cachent d'autres Crédits : A.H.
Ces constats donnent lieu à des préconisations proposant par exemple de réaliser un guide de visite, de revoir la muséographie d'une pièce, de reformuler des informations sur des outils de communication, de traduire la signalétique en langue étrangère ou de développer une médiation existante.
A partir de certaines préconisations comme « déplacer un cartel », les structures peuvent agir rapidement tandis que d'autres nécessitent plus de temps pour pouvoir être mises en œuvre. A ce sujet, certaines des structures auditées sont actuellement en pleine refonte de leur muséographie : une bonne occasion de mettre en application les recommandations soulevées par l'audit qui est un moyen efficace d'apporter un regard neuf ou de conforter des intuitions.
L'intérêt du réseau ?
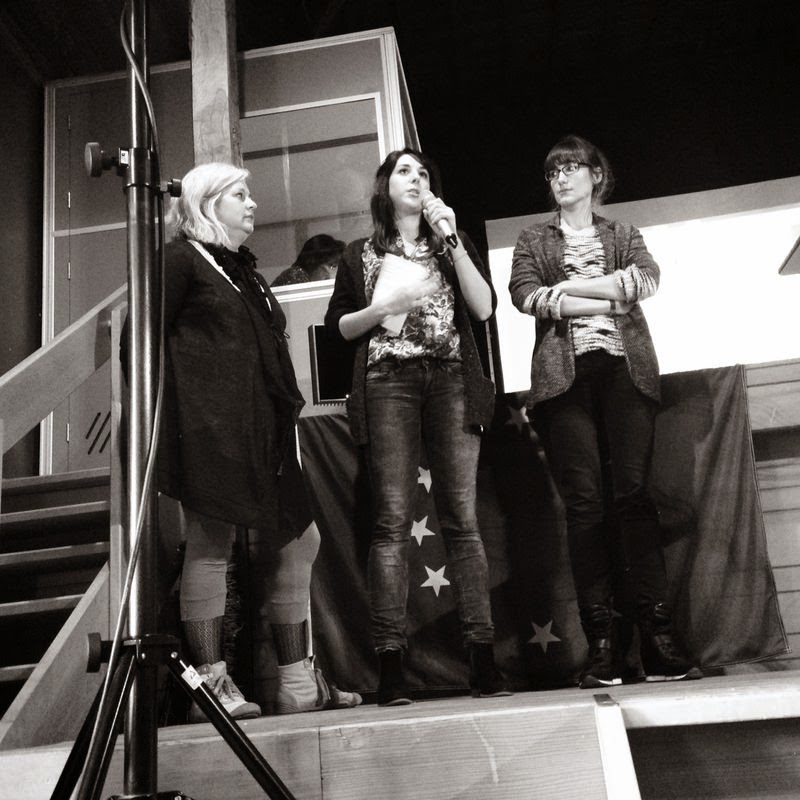
Intervention des MEM au colloque
Crédits : B. P.
L'utilisation de ce même outil qu'est l'audit dans 5 structures différentes a été possible grâce à la mise en réseau. Un des nombreux avantages qu'ont ces structures à s'inscrire dans un réseau est l'utilisation d'outils communs tels que l'audit et l'apport de savoir-faire des différents membres qui sont accompagnés par Proscitec. Cet intérêt, nous avons eu la chance de pouvoir en témoigner lors du colloque organisé par le MEM « Une muséologie alternative? Nouveaux réseaux pour un développement durable des musées de territoire » tenu au HopMuseumde Poperinge les 21 et 22 mars dernier.
A cette occasion, nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Michel Taeckens du réseau Proscitec pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de réaliser cette expérience professionnalisante, le personnel composant les cinq structures auditées, le Musée du Houblon-HopMuseum pour la qualité de son accueil durant cette rencontre, Célia Fleury qui a contribué à mettre en place cette journée et nous a accompagnées dans la phase de diagnostic, et Serge Chaumier, notre responsable de formation grâce à qui nous avons pu saisir cette opportunité.
#AUDIT
#PROSCITEC
#MUSEES
#RESEAUX
L'EAU TEXTILE : une scénographie à plusieurs mains
Dans le cadre du projet tuteuré Artextiles qui nous permet d'élaborer une exposition à la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix en 2017, mes collègues et moi, nous avons la chance de collaborer avec des étudiants en design d'espace de l'ESAAT. Il s'agit de l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile, située à Roubaix. C'est une école de création artistique publique qui fait partie des sept grandes écoles d'arts appliquées de France appartenant à l'Education Nationale.
Cette école a pour vocation de former à la création et à l'innovation dans de multiples milieux professionnels (design, de communication, mode, environnement, espace, produits). Un des objectifs de cette école est notamment de participer à des projets divers qui permettent de mettre en application le savoir-faire des étudiants. L'exposition que nous concevons sur la thématique "Eau et textile" fait partie de ces projets. Sur une idée du master, nous avons pu travailler avec des étudiants en première année de BTS en Design d'Espace sur les concepts scénographiques.
Ce partenariat a débuté dès fin 2015 par la rencontre de deux enseignants, François Decottignies et Julie Daugenet, qui nous ont permis de créer un véritable lien entre le projet et leur formation en organisant des rencontres régulières. Les premières uniquement avec les enseignants ont permis d’exposer le choix de la thématique "Eau et textile", la présentation des premières inspirations artistiques, l'explication des séquences et de l'atmosphère voulue dans chacune d'elle. Par la suite, les enseignants ont rédigé un sujet pour leurs étudiants, ou, disons, traduit notre scénario en un cahier des charges.
En second lieu, après le travail des étudiants en ateliers de 3, nous avons participé aux temps forts de ce partenariat à savoir les oraux de présentation des esquisses puis des projets développés pour chaque séquence. Au final, huit propositions de scénographie aussi différentes qu'audacieuses nous ont été proposées : des structures en bois qui animent la salle des machines de la Manufacture, des vagues de textiles qui envahissent les espaces d'exposition, des parcours immersifs et oppressants ou offrant des respirations....
Nous découvrons, en même temps que les projets, de nouvelles façons de considérer l'espace de la Manufacture, musée à l'identité pourtant si présente. Des questions techniques de matière, de lumière sont abordées et la prise en compte des personnes à mobilité réduite, des unités de passage ou des précautions de sécurité pour chaque projet nous étonne. Lors des présentations finales cette fois le développement de leur idée, nous avons saisi autant les changements dans leurs esquisses et un approfondissement du contenu ou de la technique pour proposer des solutions réalisables et pertinentes par rapport au projet.
Vous pouvez découvrir à travers ces photographies, quelques aperçus des projets :
Exposer notre projet, en discuteret voir les étudiants se l'approprier nous a permis d'avoir un regard critique. Cela concrétise la mise en espace de notre propos tout en mettant en exergue quelques incohérences dans certaines séquences. Notre discours a eu un impact fort dans les réalisations étudiantes mais il en ressort une grande créativité. Cela ne nous donne que davantage envie de concevoir une scénographie à l'image des propositions des étudiants et de poursuivre le partenariat jusqu'à sa réalisation physique ! Nous espérons ainsi que certains des étudiants pourront nous accompagner pendant le montage pour mettre en application leur travail.
Les enjeux de cette collaborationsont donc multiples. Notre exposition propose un discours spécifique, divisé en plusieurs séquences tout en formant un parcours clair et fluide. Afin de mettre en valeur ces aspects, une mise en espace s'impose. Et, pour approcher l'espace dans ses dimensions techniques et esthétiques, s'associer avec l'ESAAT nous a permis de concrétiser notre envie d'avoir des projets de scénographie et de permettre à des étudiants une application concrète de leurs travaux.
Le fait de travailler ensemble permet d'enrichir la réflexion des étudiants et leurs réalisations et nous permettent d'affiner notre parcours et le contenu de nos séquences. Pour notre exposition "Eau et Textile", nous travaillons à la manière de muséographes faisant appel à des scénographes. C'est aussi, à l'échelle étudiante, se confronter aux partenariats et apprendre à le confier à d'autres corps de métiers.
Cela souligne enfin l'idée qu'un master ne doit pas être fermé sur lui-même. Il doit permettre les échanges avec d'autres étudiants, de filières différentes et aux considérations singulières. Travailler dans un esprit collectif, croiser les regards à travers plusieurs disciplines est cohérent avec notre démarche. Cela permet un dynamisme inter-formations, un souffle de modernité ! C'est pourquoi nous souhaitons garder cet esprit de partage tout au long du projet. Nous avons ainsi lancé notre appel à création récemment, n'hésitez pas à le diffuser auprès des artistes que vous connaissez ou toute personne intéressée par le projet !
Plus d'informations sur la page Facebook de l'Art de Muser : https://www.facebook.com/Lart-de-muser-Association-du-Master-Expo-Mus%C3%A9ographie-325462064147699/?fref=ts
L'équipe Artextiles remercie chaleureusement Julie Daugenet et François Decottignies pour leur accueil et leur confiance ainsi que tous les étudiants ayant travaillé sur le projet.
T. Rin
Pour aller plus loin :
La présentation du projet Artextiles : http://formation-exposition-musee.fr/index.php?page=p&p=22
#projetexpo
#partenariats
#ESAAT
#Manufacture
L'odyssée Museomix : une quête vers l'innovation !
Le week-end du 19, 20, 21 octobre 2012 a eu lieu la seconde édition de Museomix, au musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière. Nous avons eu la chance, dans le cadre de notre projet de master, de participer à cette expérience innovante.
©Quentin Chevrier
Pendant trois jours Museomix a investi les lieux, sélectionnés par les organisateurs suite à sa candidature. Cet évènement invite des professionnels et amateurs du monde culturel, artistique et technologique à repenser le musée et les méthodes de médiations par le biais des nouvelles technologies. A chaque équipe de projet de concevoir un prototype. Cette édition a été améliorée sur plusieurs points : une participation active en ligne des internautes et une semaine de présentation des créations au public suivant le dimanche d’ouverture.
Dès leur arrivée, les museomixeurs ont suivi une visite guidée afin de découvrir les différents espaces de remixage. Chacune des dix équipes s’est formée autour d’un thème, constituée au minimum : deux créatifs, un community manager, un développeur, une personne chargée du contenu et un médiateur.
Agathe Gadenne s’est impliquée dans l’équipe qui remixait l’espace du commerce méditerranéen. Après la définition du projet en groupe, la recherche du contenu et du discours, elle s’est appliquée à la conception de scénographie, du graphisme et au suivi web (réalisation du site et participation en ligne).
« En intégrant une équipe, j’ai découvert intensément le conceptMuseomix. J’ai adoré rencontrer et travailler avec des personnes de tous horizons. Ma seule déception est due aux problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de finaliser le prototype. »
Elisa Bellancourt a participé au développement de la médiation à travers la conception de la trame et du parcours des visites. Elle a collaboré à l’écriture de l’introduction de l’évènement et à la mise en place des installations de médiation. Elle a également créé un outil de médiation répondant au nom de Cléo 3000, un robot venu de 3012 expliquant la volonté de Museomix.
«J’ai eu la chance de travailler avec des professionnels créatifs et motivants. Ce qui m’a amusé c’est d’enregistrer l’introduction et le discours de Cléo, et de savoir que ma voix résonne encore dans les lieux. »
.jpg)
©Quentin Chevrier
Camille Françoise s’est associée au pôle médiation en réalisant des visites guidées et une partie de la signalétique du musée. Ses missions ont surtout été d’ordre organisationnelle en participant à l’écriture de l’introduction de l’évènement, à l’installation des outils de médiation et à la diffusion de la communication (badges invités, invitations pour l’ouverture, dossiers de presse).
« C’était une superbe expérience ! Quoi de plus agréable que de voir le musée revivre ? Je suis très heureuse d’avoir pu y participer et y être utile. J’ai rencontré des gens très imaginatifs et sympathiques. Malheureusement c’était trop court ! »
Margaux Geib a, quant à elle, travaillé dans les pôles Tech-shop et Fab-lab, dédiés aux prêts du matériel technologique et au graphisme. Elle a aidé à la conception du programme visiteur et du plan des installations dans le musée.
« Ca a été pour moi une expérience unique qui m’a permis de me réaliser et de m’inscrire au sein d’une équipe d’organisation. Je résumerai ces trois jours enquelques mots : partage, générosité, envie. »
Au terme de cette aventure originale, nous nous sommes enrichies. Notre envie de créer un musée vivant est encore plus forte, tout comme notre volonté de nous investir dans la réalisation de notre projet de master.
Agathe Gadenne, Camille Françoise, Elisa Bellancourt, Margaux Geib
Pour plus d’informations : Museomix - Site officiel
La bière exposée
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord.
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord. Cette boisson ancestrale qu’on dit créée par Dieu comme témoignage de son amour pour l’Homme a fait ses preuves depuis bien longtemps. Comment, à son évocation, ne pas se rappeler une soirée trop arrosée, une rencontre fortuite dans un bar, un artefact ponctuant les retrouvailles amicales voire, pour les plus chanceux, un rafraichissement apprécié à la cantine … ? Ne laissant personne indifférent, son omniprésence traduit son appréciation commune. Dès lors, comment pourrait-elle échapper aux musées ? Si certains l’exposent, l’exercice n’en est pas plus évident du simple fait qu’elle semble familière et proche.
© E. L.
Des angles d’approches fréquents
En effet, le thème même sollicite les souvenirs d’expériences propres, ramène à des moments inédits, partagés ou solitaires, rappelle des réflexions animées ou divagantes. Cela, notamment, en fait naturellement un support privilégié pour l’ethnographie, l’anthropologie ou le traitement du patrimoine immatériel à travers sa consommation. Si dans l’événementiel autour de la bière se succèdent, aussi banalement qu’efficacement, maintes brasseries et dégustations, le musée a lui aussi du mal à s’extirper d’angles d’approches déjà exploités. Mais la bière et son utilisation, englobant mille et une problématiques et autant de secteurs –ivresse, religion, genre, écologie, économie, cosmétique, …-, se voient généralement réduites au prisme de son histoire et fabrication.
A travers lui, une distance s’installe entre le public et ce breuvage qui semble finalement plein de mystère. Ce n’est pas pour refroidir les amateurs qui se montrent alors avides de connaissances et souhaitent les compléter ou parfaire leurs expériences prochaines. Aussi, ce regard sur son évolution et sa mise en œuvre peut être adjoint de découvertes savoureuses en début ou fin de visite, le public étant amené à apprécier l’infime partie d’un panel de bières que l’on sait bien plus nombreuses.
Visitons donc trois musées de la bière.
© E. L.
Un musée européen de la Bière, le Musée de Stenay
Il est intéressant de constater que le Musée européen de la Bière qu’est le musée de Stenay, créé en 1986, propose lui aussi une approche historique, qu’il s’agisse de présenter la fabrication de la bière ou sa communication publicitaire, permettant cependant d’aborder les thématiques de la convivialité, de la femme, des approches sociologiques …, et ce au prix de 5€ par personne. Si cet angle d’attaque est aujourd’hui très répandu, il s’agit peut-être du musée le plus légitime à l’aborder. Cela découle en partie du fait que l’initiative de sa création vient d’un regroupement d’archéologues stenaysien au nom explicite : le « Groupement Archéologique ». Sont alors présentés, au rez-de-chaussée, le bâtiment et son investigation en tant que musée de la bière.
A l’étage, l’exposition débute par un rapide et sensoriel parcours sur ses ingrédients et leur place dans le processus de fabrication. Pour le reste sont présentés ses différentes techniques et matériaux ainsi que leur évolution au cours du temps. Le tout aboutit, en fin de visite, à une exposition temporaire voire une dégustation à la Taverne associée au musée. D’importants et pertinents dispositifs de médiation sont mis en place, témoignage d’une véritable démarche non-négligeable. Le musée s’adresse de manière privilégiée aux scolaires de tous âges en leur proposant des ateliers ludiques sur les constituants tels que les épices, ou encore des ateliers autour de la prévention. Il est à noter que la visite guidée, optionnelle, est un véritable avantage et permet de mieux appréhender les discours du circuit muséal tout en les agrémentant d’informations supplémentaires.
© E. L.
Bière qui mousse amasse foule
Evidemment, de son côté la Belgique peut se targuer d’avoir à son compte de multiples Biermuseums. Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’entendre un belge s’exclamer fièrement « Ah ça, en matière de bière et de chocolat, on a un bel assortiment ! ». Bière et chocolat, un duo à la mode dans les dégustations. Il devient nécessaire de mettre en exergue cette spécificité aux multiples expressions. Malgré tout, l’engouement naturel pour ce breuvage peut-il amener à survoler avec une certaine facilité ? Le Belgian Beer Musuem de Bruxelles peut laisser perplexe. Idéalement situé au bord de la Grande Place, dans un quartier éminemment touristique, il propose un espace très réduit au-delà d’une belle devanture. Celui-ci se divise principalement en deux parties.
La première sert d’espace de dégustation dans lequel règne en maître l’association de brasseurs. La seconde est un espace d’exposition où sont succinctement abordées les questions de fabrication (par le biais de suspensions murales explicatives) et d’histoire et distinctions de bières (par le biais d’une projection filmographique au support écrit en trois langues, dans des tailles de caractère et couleurs différentes pour chaque mot, rendant la lecture périlleuse). L’entrée comprend la dégustation finale de la bière du musée à table, dont les propriétaires ont d’ailleurs du mal à parler, si ce n’est préciser qu’elle est blonde.
L’exposition devient-elle prétexte, sachant que « bière qui mousse amasse foule » ? Qu’en est-il du but non-lucratif des musées ? Si certains se contentent de cette présentation au coût de 5€ (même prix d’entrée que celui du musée de la bière de Stenay …) en profitant pleinement de leur séjour bruxellois, la majorité du public se sent lésée et en garde un goût amer venant accentuer celui du rafraîchissement.
© E. L.
Une vision plus polymorphe
Certains musées, comme le Biermuseum de Bruges, s’écartent cependant de ces chemins tous tracés. Profitant lui aussi d’une position géographique avantageuse en plus d’un thème évocateur, il ne néglige cependant pas son contenu. Il est tout-de-même à noter que le lieu, exploitant plusieurs étages, dispose également d’un bar au-dessous des étages d’exposition. Aussi, s’il est possible de visiter le musée avec (15€ l’entrée comprenant 3 « tastings » de 15cl) ou sans forfait dégustation (9€), il n’est cependant pas nécessaire de faire la visite pour accéder à l’espace comptoir.
Toujours est-il qu’ici, les séquences de l’exposition permanente sont variées et permettent une vision plus riche. Evidemment, la fabrication et les matériaux sont abordés, mais également la place de la femme, le rapport à la nourriture, les distinctions de productions, ainsi que bien d’autres approches. Le parcours est moins limité au niveau des catégories (bien que l’exhaustivité soit inconcevable) en plus d’être particulièrement ludique. Une tablette à réalité augmentée et son casque sont mis à disposition du visiteur pour l’accompagner dans sa visite. Celui-ci doit fixer des expôts pour que des éléments explicatifs s’affichent sur son écran.
Globalement, il peut choisir d’approcher un sujet par le biais de l’image, du son, ou du texte, pouvant même combiner ces trois médias. Vingt petits quizz sont également présents dans le parcours, parfois évidents, parfois plus dissimulés, invitant le public à un véritable jeu basé sur des questions de connaissances incongrues sur le thème de la bière. La densité d’informations, pour une exposition aux intentions d’envergure, a néanmoins tendance à épuiser le visiteur qui peut finir par délaisser son support multimédia et perdre le reste des contenus.
© E. L.
Les expositions permanentes ne sont pas les seules à s’attarder sur ce sujet. Si elles ont tendances à l’approcher bien souvent de la même manière, les expositions temporaires, elles, peuvent prendre de la distance vis-à-vis de ces carcans. Les lectures nouvelles et innovantes y trouvent peut-être plus facilement leurs places. L’exposition temporaire « Bistrot ! De Baudelaire à Picasso », de la Cité du Vin à Bordeaux, présente des œuvres artistiques plutôt que des expôts ethnographiques pour traiter les boissons à travers leurs dimensions sociales, sociétales, anthropologiques, …
A quand une exposition sur la bière qui assume ces croisements ? Le renouvellement initié de regard n’en est encore qu’à ses débuts, et il est à espérer d’autres investigations à l’avenir. Comme celles que va proposer une programmation autour de de la bière réalisée en partenariat entre le Master MEM et le musée de la Chartreuse de Douai par exemple …
Emeline Larroudé
#Bière
#Patrimoineimmatériel
#Belgique
#MuséedelaChartreuse

Les projets d'exposition 2013-2015
Présentation de trois projets tuteurés en cours de réalisation par le master MEM...
Science extraordinaire !

À l'occasion des 150 ans du roman de Jules Verne De la Terre à la Lune, le Palais de l'Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande prépare une exposition temporaire pour septembre 2015.
Dans ce roman, Michel Ardan et ses compagnons décident de voyager dans un projectile géant pour atteindre le sol lunaire. Ce projet fou répond au désir des hommes de s'aventurer sur des terres inconnues, un désir qui ne s'érode pas avec le temps puisqu’aujourd’hui encore il nous anime. L’œuvre de Jules Verne faisait rêver et fait toujours rêver parce qu'elle est toujours d'actualité. Au XIXesiècle, Jules Verne imagine l'Homme capable de poser le pied sur la Lune, une utopie qui devient réalité le 21 juillet 1969.
À l'aube de ce troisième millénaire, on ne regarde plus tant vers la Lune et l'infinité de l'espace que vers de nouveaux territoires à explorer. L'infiniment petit des nanotechnologies ou la robotique s'attachent à révolutionner notre quotidien et à améliorer notre santé. De plus, les progrès de la médecine sont tels que d'ici 2025 des cellules artificielles pourraient régénérer le corps humain et remplacer des tissus ou organes défaillants.
Les utopies scientifiques ont toujours nourri l'imaginaire des hommes quelles que soient les époques. Les années passent, la science avance et les utopies changent : certaines se transforment par les avancées scientifiques, d'autres apparaissent, d'autres disparaissent.
Bien que Jules Verne soit considéré comme un visionnaire, certaines utopies actuelles ne pouvaient être imaginées à son époque. S’il vivait aujourd'hui, quelles inventions feraient partie de son œuvre ? Quelle serait sa vision sur les nouvelles utopies?
Le but de cette exposition est de plonger le visiteur dans ce monde d'utopies et de le faire rêver en lui dévoilant les projets fantastiques que la science permet d'imaginer pour le futur. Le projet s’inscrit dans un environnement dynamique, riche en institutions culturelles et scientifiques soutenues et valorisées grâce au label de “capitale régionale de la culture 2013” de Dunkerque. À travers un parcours transdisciplinaire, interactif et riche en manipulations, la découverte des sciences se veut ludique. Il vise en particulier à sensibiliser un public adolescent, réceptif aux inventions et expériences nouvelles. Les enseignants pourront aussi trouver dans les nombreux thèmes abordés l’occasion d’allier le programme scolaire aux expérimentations scientifiques.
Avec : Capucine Cardot, Cyrielle Danse, Beatrice Piazzi,Thi-My Truong, Pauline Wittmann
LE TRAVAIL EN CORPS, ENCORE...

Fruit du rapprochement amorcé dès 2012 entre l'Hippodrome de Douai et le Théâtre d'Arras, le TANDEM scène nationale Arras-Douai, explore la création contemporaine, proposant spectacles théâtraux et chorégraphiques, formes pluridisciplinaires, arts du cirque, concerts et rencontres tout au long de cette nouvelle saison 2013-14, encore plus accessible grâce au site internet, à la plaquette de présentation et au journal bimestriel communs.
Lieu de fabrique artistique, le TANDEM Arras-Douai soutient les projets d'artistes, notamment ceux du Nord-Pas-de-Calais par des résidences, des coproductions en instaurant des rendez-vous « hors les murs » sur un territoire élargi à une quinzaine de communes en partenariat avec des élus et des responsables associatifs et éducatifs.
En commanditant une exposition sur le thème du travail, le TANDEM poursuit le questionnement déjà amorcé dans sa programmation actuelle sur la société, le politique, la liberté, l'amour et la mémoire, en particulier dans les spectacles RequieMachine, Contractions et Love and Money proposés lors de la saison 2013-2014. Au cours du premier trimestre de l’année 2015, les deux théâtres accueilleront l’exposition « Le travail en corps, encore… » présentée en deux actes consécutifs : l’acte I à Douai puis l’acte II à Arras. La programmation de la future saison 2014-2015 entrera également en résonance avec cette exposition.
À travers les témoignages d'employés, d'ouvriers, de cadres ou d'intermittents et à la croisée des regards d'experts, des cientifiques, de chercheurs ou d'artistes, l'exposition questionne le rapport actuel du corps de l'individu au travail via les gestes, les postures et les attitudes. Par le biais de différentes formes allant de l'œuvre d'art au témoignage, elle met en lumière les effets du travail sur le corps en rappelant à quel point celui-ci est en permanence sollicité. En effet, le travail s'incarne dans notre corps tant dans ses dimensions physiques que psychiques, révélant sa fonction identitaire.
L’exposition se découpe en quatre séquences, réparties équitablement dans les deux lieux. Chacune de ces séquences évoque différentes visions de l’incarnation du travail dans le corps. L’acte I rassemble le corps-outil et le corps intelligent, quant à l’acte II, il réunit les deux autres parties, qui sont le corps éprouvé et le corps transposé. Ce découpage permet d’avoir une vision transversale du travail dans des secteurs différents et vu à travers divers regards, tout en étant assez précis pour faire ressortir un argument particulier par rapport au corps.
Enfin, en vue de s'inscrire dans cette dynamique de rapprochement des deux lieux, l'exposition s'adresse aux publics fréquentant régulièrement les deux scènes, mais vise également un public étudiant afin de développer la connaissance et la fréquentation de ces deux structures associées.
Avec : Sabrina, Marine, Anne, Marie et Cécile
[1] Natacha Thiéry, « Parler, filmer, travailler. La voix, le regard et la main dans les Portraits de Alain Cavalier », Dire le travail. Fiction et témoignage depuis 1980, dir. Stéphane Bikialo et Jean-Paul Engelibert, La Licorne, Presses Universitaires de Rennes, février 2013, pp. 115-129, p. 117.
Dispositifs de médiation pour penser la diversité

Chaque individu est unique. Personne ne possède le même patrimoine génétique, la même vie ou le même environnement culturel. Nos différences peuvent entraîner l'incompréhension, la peur et le rejet de l'Autre. L'être humain a souvent tendance à définir autrui sur la base d'un critère unique : la femme est faible, l'arabe est voleur, le blanc sent le cadavre, le noir court vite....
Ces stéréotypes naissent au cœur de notre quotidien, d'un réseau d'habitudes, de pensées, de gestes qu'il est nécessaire d'interroger. Ne serait-ce pas ce quotidien et ces préjugés que nous devrions regarder autrement, en faisant un pas de coté, pour mieux les redécouvrir et renouveler notre regard ? Comment interroger les stéréotypes qui sont ancrés dans nos sociétés ?
La Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme, créée en 2008, a pour principal objectif de promouvoir la diversité et de lutter contre toute forme de discrimination. Pour cela, elle crée et soutient des projets de sensibilisation notamment à destination du jeune public. Souhaitant pérenniser son action, la Fondation s'allie pour dix années avec Les Petits Débrouillards. Cette association, née au Québec il y a vingt-cinq ans, vise à vulgariser les savoirs scientifiques auprès des publics. De ce partenariat naîtra une exposition itinérante qui circulera en France et en Suisse courant 2015. Cette exposition proposera des supports multiples de médiation en faveur de la diversité et de l'éducation à l'altérité.
A partir d'un état des lieux des connaissances scientifiques, il s'agit de concevoir et de réaliser des dispositifs de médiation. Ces outils s'adresseront à tout type de public en quatre langues (italien, allemand, français et anglais) et devront rester pertinents pendant dix ans. Développer Le vivre ensemble est au cœur de ce projet. Le but de ces dispositifs est de favoriser la connaissance scientifique, la rencontre et l'échange entre les visiteurs au sein d'une ambiance conviviale, ludique et décomplexée.
Nos dispositifs pédagogiques seront conçus en prenant appui sur les connaissances scientifiques actuelles. Le but de nos dispositifs sera de faire prendre conscience de l’impact des stéréotypes sur notre rapport au monde. Nous privilégierions trois publics cibles : les 8-10 ans, les 10-12 ans et les 12-14 ans. Ces âges correspondent à des étapes charnières dans la sociabilisation des individus. La perception de l’Autre n’étant pas encore complètement figée, nos dispositifs auront un plus grand impact sur ces publics cibles. L'expérience sensorielle sera activée par des outils pédagogiques plaçant le corps au centre d'une redéfinition de lui-même : mon corps est mien peut devenir mon corps est autre. Parce que l'humain n'est pas un être figé, dans le temps, l'espace et la société, prendre conscience de l'infinie plasticité des représentations semble un point d'entrée pertinent à l'émergence d'une conscience ouverte et bienveillante à la différence.
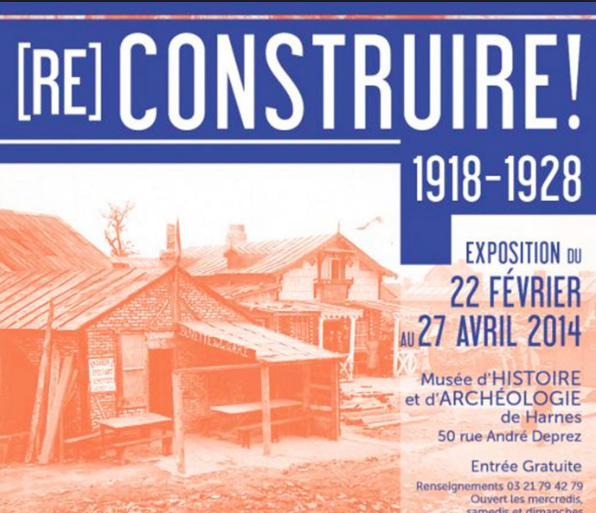
Les projets de mise en exposition 2012-2014
Coordonner Museomix au Louvre-Lens, penser une exposition sur la grande guerre (1918 : Reconstruire !), expliquer l’éco-gestion des eaux à la Ferme des Aigrettes, ou encore proposer un pré-programme pour un site virtuel autour des repas comme facteur de lien social au cours du vingtième siècle à Tourcoing... voici quelques uns des projets tuteurés du master MEM pour cette année...
Ces projets, en cours de réalisation, prendront vie dans quelques mois mais avant cela ; voici un avant propos de deux d'entre eux.
1918 : Reconstruire !

À l'approche du Centenaire de la Grande Guerre, la mairie de Harnes a commandité une exposition pour le musée d'Histoire et d'Archéologie. Afin de fédérer et de s'inscrire dans le réseau des événements, le thème de la reconstruction a été sélectionné par la mairie et l’association « Les Amis du Vieil Harnes ». Il s'agit d'explorer la Reconstruction qui s'étend de 1918 à 1928 plutôt qu'un aspect de la guerre, dans une visée plus positive sans pour autant occulter les atrocités. À travers des documents, affiches, cartes postales ou encore des objets de la vie courante, l'exposition dévoilera les moyens mis en œuvre par les citoyens pour reconstruire. On ne se rend pas toujours compte du rôle qu'a pu avoir la Première Guerre Mondiale dans la construction de la vie moderne et les traces qu'elle a pu laisser dans notre quotidien. C'est le propos de cette exposition.
Les particularités de cette zone, si proche du conflit, sont à la fois exceptionnelles mais aussi représentatives des étapes chronologiques nécessaires à toutes les municipalités ayant subit des dommages dus à ce conflit. Dans un dernier volet, il nous paraît important de rappeler comment on a voulu, dès la fin de la guerre, incarner cette « Der des Ders » par les monuments et institutions mis en place dans ce but. L'exposition s'achève sur les fêtes du succès de la reconstruction et les célébrations de la victoire.
Le Centenaire est l'occasion de célébrer la réouverture du musée de Harnes qui est lui aussi en reconstruction. Cette exposition sera à la fois un moyen pour le musée d'accueillir de nouveau le public scolaire mais aussi de s'ouvrir à une audience plus large sur la communauté d'agglomération Lens-Liévin.
Àla découverte des Wateringues !

La Ferme des Aigrettes est une ancienne ferme flamande rachetée par la mairie de Marck, pour la transformer en un lieu dynamique, pédagogique, de rencontres et d’échanges. Dans ce corps de bâtiment, la Maison de la Nature et de l'Environnement gère plusieurs structures réunies autour d'une volonté commune : sensibiliser à la fragilité de l'environnement et participer à sa protection. Parmi ces différentes structures, l’une d’entre elles sera dédiée aux expositions temporaires. L’exposition sur les Wateringues sera présentée au printemps 2014.
Les Wateringues représentent un système particulier de gestion des eaux sur le polder de la région du Nord-Pas-de-Calais. Celui-ci concerne un territoire compris entre Calais, Saint-Omer et Dunkerque, comprenant une partie du littoral de la Côte d’Opale, et dont la majorité des terres se situent en dessous du niveau de la mer.
Cette exposition sensibilise les habitants à la nécessité d’entretenir ce système de gestion des eaux à différents points de vue. Il s’agit d’abord de favoriser l’appropriation et la transmission, car la plupart des habitants du territoire ne semble pas se rendre compte de l’importance d'un tel système. Il est donc nécessaire que la population prenne conscience des risques encourus en cas de destruction ou d’abandon de la gestion des Wateringues.
L'institut Interdépartemental des Wateringues (IIW) ainsi que l'association Éco-Marck nous aident à comprendre respectivement la gestion à l'échelle régionale et locale de ce système : les ouvrages hydrauliques, les gestes effectués quotidiennement qui participent à son maintien, mais aussi la dépendance aux conditions météorologiques, la gestion des terres et le rôle des agriculteurs. La deuxième partie de l'exposition porte sur un discours environnemental : nous pouvons découvrir la faune et la flore qui vivent dans les Wateringues. Elle s’appuie sur les études que mène le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de Flandre Maritime.
Un point préventif aborde plus spécifiquement les problèmes qui sont traités dans le programme scolaire des enfants de cycle III (CE2, CM1, CM2, premier public visé) : écocitoyenneté, montée du niveau moyen de la mer, réchauffement climatique et biodiversité. Cette exposition s'adresse également à un public familial.
L'objectif de cette exposition est de faire comprendre aux publics l'importance d'un changement de comportement face à ce système de gestion des eaux.
Groupe Marck-Nature : Thibault Léonardis, Mélanie Tournaire, Lucie Vallade, Andrea Vazquez

Les projets des MEM
Pendant deux ans, des groupes de 3 à 5 étudiants de master, travaillent à l’élaboration d’un projet d’exposition inédite, lié ou non à une commande. Les cours de méthodologie et de muséographie trouvent ici leur application concrète. Ces projets confrontent aux enjeux essentiels d’une mise en exposition : comment construire un discours et pour quel enjeu ? Comment s’adresser à quel public ? Comment construire un parcours ? Comment préparer un cahier des charges pour un scénographe ?
Le master 1 est dédié à la conception et le master 2 à la réalisation. En fin de cursus, les commanditaires ou partenaires participent au jury de soutenance des étudiants.
L’Objectif en coulisses : Photographies de Robert Baronet
En 2011, après avoir photographié les coulisses muséales de son pays natal, l’artiste québécois Robert Baronet est venu capturer la richesse de nos réserves dans le Nord-Pas-de-Calais. Portées par l’enthousiasme participatif des institutions de la région, nous dévoilons aujourd’hui ces trésors cachés au travers d’une exposition riche d’images et de sens.
Le travail de l’artiste repose sur la création d’histoires imaginaires inspirées par les objets rencontrés dans les réserves et les dédales administratifs. Ce voyage au sein d’un univers fascinant révèle l’œuvre sous un autre jour, dès lors qu’elle est libérée de son statut d’expôt.
Le photographe saisit des instants en suspend où les objets prennent vie.Il définit ses clichés comme des « tableaux photographiques », compositions personnelles mettant en lumière les rencontres fortuites des œuvres avec leur environnement. Les lieux fonctionnels prennent dès lors un nouveau sens, une nouvelle réalité. L’Objectif en coulissesentraîne le visiteur dans la poésie des photographies.
Cette exposition s’intègre dans un échange culturel franco-québécois de longue date. Elle propose un dialogue entre le Vieux Continent et la Belle Province et s’intéresse à leur patrimoine respectif et commun. L’Objectif en coulissessera ensuite présenté au Québec à l’horizon 2013.
Crédit : Robert Baronet
Une vie artistique insoupçonnée : les manuscrits médiévaux de l’abbaye Saint-Vaast enfin réunis à Arras.
La Bible de Saint-Vaast de la Médiathèque d'Arras est l'un des ouvrages les plus précieux qui aient subsisté des fonds de l’abbaye arrageoise. Écrite et décorée au sein du Scriptorium de Saint-Vaast, elle représente l'un des chefs-d’œuvre de l’art biblique : de l’enluminure à la calligraphie franco-saxonne du VIIIe au XIIe siècle. Dans le cadre de son millénaire, la ville d’Arras se doit de créer l’opportunité exceptionnelle de rassembler les manuscrits qui ont précédé et succédé la confection de cette Bible et dont l’influence a été déterminante à travers l’Europe.
L'exposition intitulée Le patrimoine de Saint-Vaast : d’Arras aux quatre coins du mondeest l'occasion de mettre l'accent sur la pérennité de l'œuvre et la richesse du patrimoine arrageois au-delà des frontières régionales. Les Arrageois découvriront leur patrimoine au sein de l’abbaye Saint-Vaast durant trois mois au cours de l’année 2015. Notre préoccupation étant de toucher un public de tout âge, une présentation ludique et des animations permettront d’aborder l’œuvre avec clarté, notamment avec le système de notation musicale (le neume) initié par Albertus, l’un des moines de l'abbaye de Saint-Vaast qui a également porté l’art de l’enluminure arrageoise à son apogée. D’autres thèmes structureront cette réunion extraordinaire de manuscrits : la vie des moines, les influences et les innovations, la dispersion des manuscrits, l’anonymat des scribes et enlumineurs, la représentation figurative, le symbolisme, la calligraphie et la fabrication du parchemin et des couleurs.
Les vingt-sept manuscrits de l’abbaye se trouvent aujourd’hui disséminés dans onze institutions françaises et étrangères, de New-York à Prague. Cette exposition est donc un évènement de renommée internationale.
La collaboration avec Denis Escudier, chartiste et chercheur au CNRS en musicologie ou encore avec Diane Reilly, auteure canadienne d’une thèse sur le Scriptorium de Saint-Vaast, garantit la qualité scientifique. À cet égard, la médiathèque, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France et la DRAC Nord-Pas-de-Calais, réalise un catalogue franco-anglais de l’exposition afin d’aborder ce sujet de façon complète, d’en assurer la pérennité au-delà des frontières et d’assouvir la soif de connaissances des plus passionnés.
Evangéliaire de l'abbaye de Saint-Vaast, fin IXe s. (BM ms 1045)
Appel d’aiR°, exposition d’art contemporain in situ
Dans le cadre du renouvellement du cœur de la ville d’Arras, le projet appel d'aiR° propose un parcours artistique articulant parking extérieur et souterrain de la Grand' Place.
De septembre 2012 à septembre 2013, la municipalité a prévu des travaux de réhabilitation du parking souterrain de la Grand' Place. À l'occasion de sa réouverture et de son inauguration, le projet appel d'aiR° investira les lieux lors du premier week-end d’octobre 2013. Le temps d’une journée, il convie les publics arrageois, passionnés d’art contemporain, enfants comme simples curieux à porter un nouveau regard sur ces espaces fréquentés au quotidien. Événement de démocratisation culturelle, la manifestation sera ouverte à tous et libre d'entrée. Proposé comme outil de dynamisme territorial, le projet a pour volonté d'augmenter la visibilité culturelle d'Arras, au sein d'une programmation d'art contemporain atypique. En lien avec la politique artistique de l'Université d'Artois, appel d'aiR° est porté par les étudiants du master professionnel expo-muséographie de l’Université d'Artois et leur association L’art de muser.
Ces dernières années, les événements artistiques internationaux Park(ing)Day et I Park Art ont investi des parkings publics devenus, pour une journée, lieux de manifestations artistiques afin de sensibiliser un large public à la place de la nature et de l’art dans les espaces urbains. C’est dans une logique commune à ces deux concepts revendicateurs que le projet appel d’aiR° vient s’inscrire. Cette réappropriation de l’espace public par la réalisation de créations in situ se concentrera sur une thématique choisie, celle de la respiration. Première et indispensable interaction entre le vivant et son milieu, la respiration correspond littéralement à l’ensemble des fonctions qui permettent l’absorption de l’oxygène et le rejet du gaz carbonique chez l’homme, l’animal et les espèces végétales. L'espace urbain semble «dévoyer» aujourd’hui cette fonction primordiale : la ville est emprise de toutes sortes de pollutions sensitives, qu'elles soient visuelles, sonores, auditives ou olfactives. Symbole de ce confinement de l'air et de la concentration des surfaces, le parking souterrain peut être synonyme d’asphyxie. Appel d'aiR° entend apporter un nouveau souffle à Arras et sensibiliser les visiteurs à d'autres formes de respiration dans la ville, les inviter à prendre une bouffée d'air frais et artistique. L'art contemporain amène dans la zone urbaine du parking, rarement considérée comme lieu de vie, une dimension joyeuse et esthétique.
Une zone délimitée du parking présentera les œuvres d’une vingtaine d’artistes émergents et étudiants en écoles d’art de la région Nord-Pas-de-Calais. Détournée de sa principale fonction, elle devient un espace d’expérimentations, de cohésion sociale, un lieu de rencontres et de découvertes artistiques. Enrichie d'une vaste programmation, cette journée mettra en lumière les arts plastiques, performatifs et technologiques. Grâce à des représentations continues, des performeurs feront le lien entre les parkings extérieur et intérieur. C'est dans cette dynamique que les visiteurs seront appelés à suivre cet « appel d'air » accompagnés par des médiateurs. Les deux niveaux offriront la possibilité de découvrir une exposition entre peintures, sculptures, installations, vidéos, compositions sonores… Par ailleurs, cet évènement souhaite interroger la place de l'humain dans son environnement urbain. A cet effet, un laboratoire de bio-art sera présent pour apporter une dimension expérimentale. Le bio-art, tendance avant-gardiste de l'art contemporain, manipule les processus de vie et s'approprie des techniques et des thèmes de réflexion scientifique. Mise en scène créative du vivant, il propose notamment des mutations génétiques qui appellent à la réflexion tout en conservant une dimension fondamentalement esthétique. Les ateliers mis en place renforceront l'approche interactive et éducative de l'événement appel d'aiR °.
La position centrale et historique de la Grand’Place d’Arras offre une avantageuse lisibilité au projet. La sélection de deux espaces, l’un aérien et l’autre souterrain, permet au spectateur une libre déambulation au sein d’une diversité d’ambiances artistiques et d’appropriations des lieux. Appel d'aiR° se veut au service des citoyens, offrant une promenade artistique, source d'une nouvelle effervescence dans la ville.
le projet a son blog
Crédit appel d'aiR° - Lionel Pepin
Vivre en Camus
Depuis leur construction en 1956 dans la cité Maréchal Leclerc, les habitats Camus font partie des paysages d'Annay-sous-Lens. Aujourd'hui, ces logements prolongeant la route départementale n°17 vont disparaître. Pourtant, ils ont longtemps été à la pointe de l'industrie d'Après-Guerre. Leur procédé de fabrication moderne « en kit », élaboré par Raymond Camus répondait aux besoins de reconstruction rapide et économique après la Seconde Guerre mondiale dans une période où la région avait besoin de loger la main d'œuvre des industries minières. Après la Seconde Guerre mondiale, la région avait à l’image du reste de la France, d’importants besoins de logements, y compris pour la main d'œuvre des industries minières. Dans ce contexte, le procédé de fabrication moderne « en kit », élaboré par Raymond Camus constituait une solution innovante répondant aux exigences de rapidité et d’économie de l’époque.
Cette « cité Camus » est devenue un symbole de la vie en communauté. Afin de rendre hommage aux Camus, habitats porteurs d'un riche patrimoine matériel et immatériel, Le Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin, en partenariat avec la mairie d'Annay-sous-Lens et avec la Mission Bassin Minier, organise une exposition que les étudiantes ont nommée « Vivre en Camus ». Cette dernière conjugue des éclairages historiques sur les techniques de construction élaborées par l’architecte Raymond Camus avec des témoignages d’habitants.
L'objectif de l'exposition est de renouer des liens avec cet héritage architectural aujourd'hui méconnu, en développant chez les citoyens locaux une conscience patrimoniale. Cette exposition accompagne un projet de réhabilitation d'un logement Camus témoin en gîte touristique qui profitera de l'impact touristique insufflé par l'arrivée du Louvre à Lens et de la perspective de l’inscription du Bassin minier (Nord-Pas de Calais) au Patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 2012.
Sources : les étudiantes contribuant à ce projet
L’École d’Étaples : la touche étrangère
Ce projet permettra de pallier un problème majeur touchant les collections liées à l’Ecole d’Etaples (1880-1914) qui résulte de l’inaccessibilité de nombreuses œuvres appartenant à des musées étrangers (Australie, Etats-Unis, Angleterre, Pays Scandinaves). En effet, la plupart des protagonistes de cette colonie artistique étant de diverses nationalités, leurs œuvres se trouvent généralement dans les musées de leurs pays respectifs. À cette fin, la tablette tactile « exposera » de manière interactive des visuels de tableaux. Elle sera un outil multimédia complémentaire à la visite de la collection permanente du futur musée en favorisant le croisement des regards entre celle-ci et la « collection interactive ». Il s'agit de plus d'une solution économiquement plus avantageuse que les coûts inférés par des demandes de prêts aux institutions étrangères qui sont de plus en plus susceptibles de faire payer ce service.
La mise à disposition de plusieurs parcours thématiques permettra aux visiteurs de personnaliser leur visite ce qui conduira à une meilleure appropriation du contenu. L’interactivité sera d’autant plus grande que sera également proposée une immersion dans l’esprit de l’époque grâce à la reconstitution fictive d’une des expositions mises en place par la communauté artistique entre 1892 et 1914.
Ce support numérique sera élaboré de manière à proposer une navigation libre et donc à satisfaire un large éventail de publics ce qui est une des préoccupations principales dans le souci de démocratisation culturelle : l’aspect interactif et ludique séduira les jeunes publics, le bilinguisme favorisera l’accès aux amateurs anglo-saxons de cette manière, le rayonnement international de cette école sera mieux appréhendé par l’ensemble des visiteurs et notamment par le public de proximité.
En attendant l’ouverture du musée, cette première tablette tactile à l’initiative du département du Pas-de-Calais pourra être placée dans les « expositions de préfiguration ». Son contenu pourra aussi être mis en ligne afin de sensibiliser un cercle plus large de visiteurs potentiels.
Ainsi, cet outil technologique non seulement complétera la visite de la collection permanente mais aura aussi pour but de proposer une expérience inédite dans les musées du Pas-de-Calais.
Sources : les étudiantes contribuant à ce projet
Épilepsie, mythes et préjugés
Une exposition sur nos propres représentations de l’épilepsie, entre confrontations et interrogations…
L’Épilepsie… Si vous prononcez ce mot au cours d'une conversation, tout le monde semble comprendre. Mais si vous allez un peu plus loin en demandant des précisions, on vous répondra bien souvent : « C’est une maladie… où les gens tombent et tremblent ». Tout le monde croit connaître cette maladie et les formes qu’elle peut prendre et pourtant… Malgré les avancées de la recherche et malgré la généralisation de ce terme à notre époque, comment se fait-il que cette maladie reste si méconnue? Pire même, elle continue de faire peur. Depuis l’antiquité, l'épilepsie n’a cessé d’effrayer les hommes, ils y voyaient des formes de possession diabolique, de folie, d’abandon de l’âme, de « mal » étrange... Ce qu’on ne comprend pas fait peur. On pourrait donc s’attendre à ce que, naturellement, avec les connaissances actuelles de la médecine, cette peur disparaisse, et pourtant…
L’épilepsie est l’une des rares maladies où les préjugés sont plus graves que les symptômes, disait l’épileptologue William Lennox. L'exposition "Epilepsies, mythes et préjugés", amène le visiteur à prendre conscience de ses propres représentations de la maladie à travers sa confrontation avec différents témoignages de l’Histoire et des Arts, de l’Antiquité à nos jours. Elle aborde un thème scientifique sous un regard culturel, sociologique et pluriel afin d'engendrer une réflexion sur nos préjugés.
L’exposition pluridisciplinaire « Épilepsies, mythes et préjugés » ouvrira ses portes en 2013 dans la région Nord-Pas-de-Calais, à la chapelle Saint Pry de la ville de Béthune. En effet, plus de 500 000 personnes sont diagnostiquées épileptiques en France, soit une personne sur 100, et la région, de par sa démographie, est l’une des plus concernées. Ce projet mené dans un cadre universitaire est réalisé en collaboration avec des patients, des professionnels du secteur médical et des associations, afin de sensibiliser le public et de participer à la progression de la compréhension générale et de l’acceptation de cette maladie. L'héritage des témoignages historiques et artistiques prend place aux côtés des questionnements scientifiques, artistiques et tout simplement humains qui ancrent l'épilepsie dans l'actualité. Cette exposition, destinée à un public non initié, cherche à contribuer à la démystification de l'épilepsie. À partir des représentations historiques, d’œuvres représentatives, de productions artistiques, et questionnement scientifiques, ainsi que des œuvres d’artistes contemporains et des témoignages de personnes épileptiques, l'exposition se construira comme un espace dynamique d'expression et de réflexion.
Gageons que cette exposition, destinée à tout public, contribue à la déconstruction de certaines représentations de l'épilepsie.
Sources : les étudiantes contribuant à ce projet

Participer à un Festival des Expositions : MEM pas peur !
Du 14 au 18 octobre 2020, s’est tenu à Arras la seconde édition du Festival des Expositions. Cet évènement, organisé par le Master Expographie-Muséographie vise à présenter les productions personnelles des apprenties en fin de diplôme : les MEM’Works.

Affiche du Festival des exposition, édition 2020
Réalisation : Margaux L.
Mais dis-donc Jamy, c’est quoi un MEM’Work ?
Ce projet permet de pouvoir exprimer son engagement ainsi que de démontrer ses compétences. Les recherches bibliographiques conduisent en premier lieu à la rédaction d’une note d’intention qui définit la ligne directrice du MEM’Work. Elle peut varier en fonction de la maturation du projet. Ensuite, la rédaction d’un programme muséographique est préalable à la réalisation scénographique, qui mobilise des compétences techniques selon la complexité du projet. Les étudiants ont la possibilité d’accéder à un FabLab qui propose des impressions 3D, de la gravure laser sur bois etc. pour réaliser leur production. Situé à la Louvre Lens Vallée, le Muséolab a ouvert ses portes en 2019 et travaille en lien étroit avec le Louvre-Lens et les projets du Master Expographie-Muséographie, ce qui implique une connaissance du monde muséal et des pratiques.

Tiphaine en plein montage de sa brouette au Muséolab, une session bricolage pour
déterminer les mesures des casiers contenant son matériel de médiation scientifique
Photo : Camille Q.
Initialement pensés comme des dispositifs à petits prix et itinérants, les productions doivent être facilement déplaçables par une ou deux personnes afin de limiter les coûts liés au transport.
Le MEM’Work est ainsi un exercice complexe qui allie réflexion et mise en pratique.
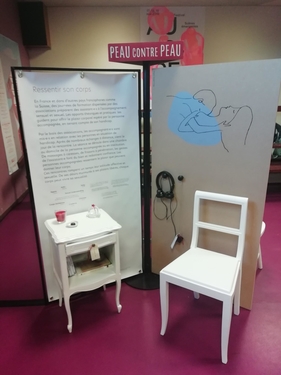
Peau contre peau, un module d’exposition sonore par Lauréline
Photo : Camille R.
Hey Fred, tu savais qu'on les retrouve au Festival des Expositions ?
Depuis 2019, le Festival des Expositions présente les différents travaux des étudiants du Master Expographie-Muséographie. Cette année, la promo Anne Delavaux a présenté les travaux à l’Hôtel de Guînes, dans le centre ville d’Arras, et au service culturel de l’Université d’Artois. La particularité de cette édition a été de se tenir en même temps que la quatrième biennale d’art contemporain “Appel d’Air”, organisée également par des chargées de projet du Master dans le cadre d’un projet tutoré. S’ajoutant aux intéressés, les visiteurs de la biennale à l’Hôtel de Guînes ont ainsi pu découvrir de nombreux travaux du Festival des Expositions.
Les sujets ont été très variés et traduisent des engagements personnels : écologie, questionnements sociétaux… Du mariage blanc (Camille R.) à l’exploitation de la banane (Adélaïde), en passant par la chirurgie esthétique (Armelle), l’empreinte carbonne des avions (Laurence A.), les tueuses en série (Manon), les trophées de chasse (Laurie), les productions prennent diverses formes et répondent à des problématiques soulevées lors des recherches.

Les dessous de la banane, une exposition d’Adélaïde qui questionne la culture du fruit et son lien avec l’histoire (du colonialisme à la pop-culture)
Photo : Camille Q.
Lab’rouette - la vie sous nos pieds proposée par Tiphaine est par exemple un prototype d’expérimentation scientifique, qui vise à inclure le visiteur dans l’expérience. Cette démarche active l’invite à observer, afin de comprendre et de tirer des conclusions par lui-même. La participation a été pensée par plusieurs étudiantes, qui invitent tour à tour les visiteurs à laisser une trace de leur passage. Avec Prolonger la vie. Pour le meilleur et pour le pire !, Laurence L. donne la parole en mettant à disposition des pions écologiques (des haricots rouge) ou des gommettes afin de les laisser s’exprimer sur leur choix concernant le transhumanisme. Le visiteur peut également jouer et s’amuser dans Rustiques de Camille F. avec un “Qui bêêêêh?” à la manière d’un “Qui-est-ce?” pour découvrir les différentes races de moutons.
Dans les expositions Au delà des règles de Camille Q., Un ara au musée de Mélissa et Les cimetières de demain de Cloé, les visiteurs peuvent également donner leur avis en laissant une trace de leur passage. Le visiteur peut confronter son point de vue à celles des participants, ce qui peut prêter à débat.
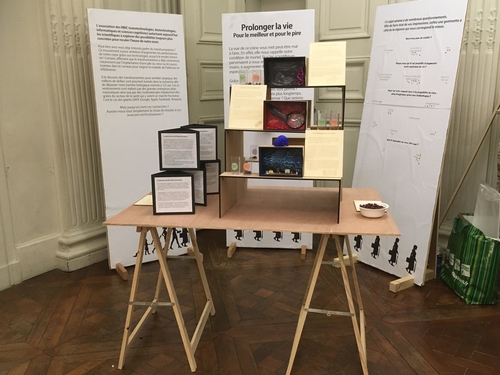
Une exposition qui donne la parole au public : Prolonger la vie. Pour le meilleur et pour le pire ! par Laurence Louis
Photo : Camille R.
Margaux choisi d’impliquer le visiteur gustativement, puisque son exposition Chocolat, plaisir coupable ? dispose de tiroirs, contenants des échantillons de chocolat. Le visiteur en sélectionne un au début de l'expérience et découvre les conséquences de son choix. D’autres expositions impliquent également les sens, comme celle de Judith avec L’épopée des sens. Le visiteur découvre des objets par le toucher, le goût, l’ouïe et l’odorat. Ce dernier sens est également mobilisé dans Avant la viande de Chloé, afin de marquer le visiteur. L’ouïe est sollicitée aussi dans l’exposition Peau contre peau de Lauréline, au travers de témoignages oraux de personnes handicapées subissant des frustrations sexuelle ou d'accompagnants les aidant à les surpasser. Ces travaux sont caractéristiques de la variété des moyens pour impliquer d’autres sens que la vue.

Partie de “Qui bêêêêh?”, un dispositif de l'exposition Rustiques de Camille F.
Photo : Camille R.
La diversité des réalisations réside également dans leur conception initiale. L’exposition Monique la poule tourdumondiste de Marianne a été basée sur l’histoire du breton Guirec Soudée et de sa poule Monique. Ils ont effectué un tour du monde sur un voilier. Après avoir eu les accords nécessaires, Marianne a obtenu des subventions auprès de l’Université d’Artois, du Crous Lille Nord-Pas-de-Calais et de la Délégation Régionale de la Recherche et de la Technologie pour la Fête de la Science, qui lui ont permis de réaliser un véritable travail de muséographe coordonnant des prestataires en scénographie et graphisme. Cette démarche professionnelle lui a permis de valoriser son travail et d’augmenter son réseau. Son exposition va itinérer à la cafétéria du Crous de Béthune pour les prochaines semaines.
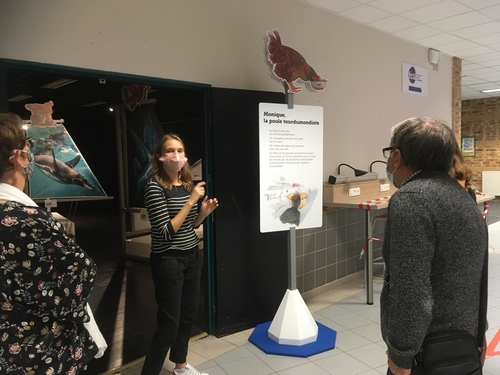
Marianne présente son exposition itinérante : Monique la poule tourdumondiste
Photo : Camille R.
Pour son exposition Habiter autrement, un retour à l’essentiel, Nelly a également effectué un travail d’enquête. Elle présente des modes de vies alternatifs à partir de témoignages et d’une collecte d’objets appartenants aux protagonistes.

Habiter autrement, un retour à l’essentiel proposée par Nelly
Photo : J.A.
Les étudiantes ont présenté leurs travaux aux nouvelles promos de Master 1 et 2. Cette occasion a permis d’échanger autour des sujets et de montrer des exemples de productions aux nouveaux arrivants. L'exercice du MEM'Work, bien qu'à ses prémices, a de beaux jours devant lui et va donner la parole aux (peut-être) futures générations de muséographes issues du Master Expographie-Muséographie.

Montage d’ Au delà des règles, par Camille Q.
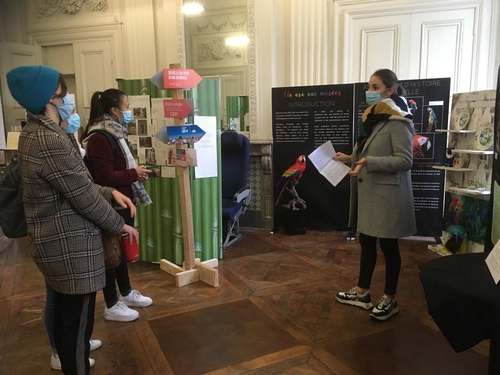
Mélissa, en pleine présentation d’Un ara au musée
Photo : Camille R.
Tu vois, c'était pas si sorcier !
Le Festival des Expositions a marqué, le temps d'une semaine, la passation entre la promotion sortante Anne Delavaux et les nouveaux arrivants dans le Master. L'occasion d'échanger au sujet des MEM'Work, des parcours de chacun mais aussi des perspectives post-diplôme. Un prétexte à la rencontre, à l'échange, à l'inspiration et la clôture d'un cycle universitaire. L'aventure ne s'arrête cependant pas et certaines expositions auront l'occasion d'itinérer. Avant la viande de Chloé sera notamment visible à l'université d'Artois du 25 au 31 janvier 2021 et des rencontres-débats avec quatre visiteurs seront organisées. Marianne est en pour-parler quand à l'itinéraire de son exposition, elle espère la faire circuler dans les bibliothèques départementales des Côtes d'Armor.

Avant la viande,à défaut de passer la viande à la casserole, Chloé nous fait passer à table
Photo : Lauréline L.
Camille Quernée et Nelly Jacquemart
#festivaldesexpositions
#memwork
#promoannedelavaux

Qui a dit que les technologies n'avaient pas leurs places dans un musée ? Projecteur sur un prototype de médiation muséale !
Les preuves sont là, les visiteurs d'uneexposition prennent plus le temps de lire les textes du début de l'exposition qu'à la fin (cf : Noémie Drouguet et André Gob, Muséologie).
L'équipe Troadeus
© Quentin Chevrier
Comment faire alors lorsque les œuvres ne sont pas toutes faciles d'accès sans médiation comme au musée gallo-romain de Lyon Fourvière ? Cette question nous offre deux types de possibilités : un système de médiation avec un guide conférencier (option qui malheureusement reste coûteuse) ou la mise en place de solutions interactives qui absorbent l'attention des visiteurs par d'autres moyens.
Museomix propose de joindre l'utile à l'agréable ! Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas : il s'agit d'un travail collaboratif, un brain-storming culturel et scientifique pour créer des nouvelles médiations au sein des musées grâce aux innovations technologiques. C'est dans cette ébullition d'idées qu'est né le projet de l'équipe Troadeus qui « remixe » la célèbre Table Claudienne.
Elle tient son nom de l'Empereur Claude qui prononça un discours en l'an -48 avant Jésus-Christ dans le but d'intégrer les notables de la Gaule dite Chevelue au sénat romain. Le texte a été retranscrit sur cette imposante table en bronze en mémoire de la générosité de Claude. Cette œuvre, pièce magistrale est pourtant difficile d'accès. En effet, elle est écrite en latin ce qui a priori peut sembler rébarbatif pour le visiteur non-latiniste. L'inscription gravée est lisible mais incompréhensible si le visiteur n'est pas latiniste et le cartel très long. Autrement dit, cette œuvre malgré son apport évident à l'histoire nécessite un type de médiation spécifique pour le public qui, jusqu'à présent, passait devant sans vraiment la comprendre.
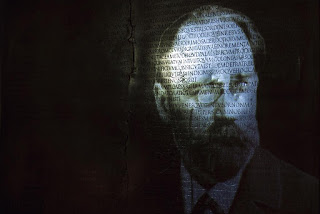
Emile Zola appparissant sur la table claudienne
© Quentin Chevrier
L'équipe Troadeus, composée de sept membres, travaille surun projet commun afin de mettre en valeur cette table avec la mise en place d'un prototype de médiation muséale. Il s'agit d'intégrer le visiteur à une expérience immersive en lien avec le discours politique qui, d'une part est le sujet de la table et qui, d'autre part, peut s'affilier avec les discours politiques d'aujourd'hui.
L'équipe prend le parti de jouer avec la déambulation du spectateur et de créer une interaction entre ce dernier et cette plaque de bronze.
Lorsque le visiteur marche dans le musée, il déambule pour voir les œuvres. La Table Claudienne est placée au bout d'une allée depuis laquelle on perçoit la table depuis une bonne dizaine de mètres. De loin, cette plaque intrigue et suscite un questionnement. Il approche alors et le prototype prend le relais pour attirer le visiteur plus près et provoquer un échange. On entend une voix en latin récitant le texte de Claude et donnant aussi un aspect vivant à cette langue morte.
Chaque pas en direction de la table déclenche dessus (grâce à une kinect située sous le discours en bronze) l'apparition d'une projection d'une figure politique ou historique associée à l'une de ces phrases phares. Martin Luther King se dévoile avec une phrase de son discours « I have a dream » plus il disparaît trois pas plus loin pour laisser poindre Emile Zola, faisant lui-même référence à son engagement politique. Des discours forts sur des thèmes d'intégration, d'altérité issus du19ème et 20ème siècle qui reflètent des problématiques similaires au discours de Claude.
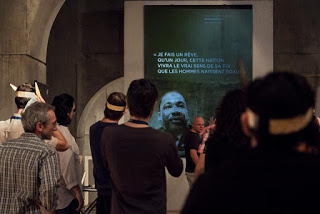
Explication du projet de la Table Claudienne
© QC
D'un point de vue technologique, le tout fonctionne assez simplement, la kinect détecte les mouvements et les positions du visiteur. Elle les transmet ensuite à un programme MAX/MSP (ici réalisé par le développeur du groupe) qui envoie l'ordre au vidéo-projecteur d'envoyer les différentes diapositives en fonction d'où il se trouve. Il s'agit donc d'un prototype qui utilise une technologie combinée assez simple, mais qui demande toutefois de bonnes connaissances en développement informatique. Bien sûr ce prototype neremplace pas la lecture du cartel ou même la présence d'un médiateur mais elle intrigue le visiteur et provoque son arrêt.
Le seul point faible de ce prototype réalisé en 3 jours par l'équipe Troadeus participant à Museomix, c'est que le temps ne leur a pas permis de réaliser un système capable de gérer un groupe de visiteurs. La kinect détectant trop d'informations à la fois venant de différents endroits. Il était difficile pour le prototype de fonctionner normalement à cause de l'afflux massif de personnes venant découvrir toutes ces innovations, afflux qui ne correspond pas à la fréquence de visite normale. Cependant, il faut noter qu'avec un brin de temps supplémentaire, le problème est facile à résoudre.
Ce dispositif devait initialement rester une semaine dans le Musée gallo-romainde Lyon-Fourvière, sera finalement resté près de trois semaines, du fait de son succès.
Un grand merci à Franck Weber, artiste sonore et membre de l'équipe Troadeus, qui a fait face à mon ignorance en matière de développement de programme et qui a pris le temps de répondre à mes questions.
Camille Françoise

Témoignages du bord de mer
Dans le cadre de notre projet tuteuré entre l'Université d'Artois et le Conseil Général du Pas-de-Calais, nous menons une recherche sur la mémoire des marins d'Étaples. En 2016, le département inaugurera un nouveau musée à Étaples, celui des Peintres de la Côte d'Opale. Ce musée, qui présentera essentiellement des tableaux, intégrera également dans son parcours une mise en contexte de cette colonie artistique, en partie établie à Étaples du début du XIX° siècle jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Ces peintres ont abondamment représenté la vie maritime de la ville, les bateaux, les pêcheurs, etc. Pour créer un parallèle entre les sujets évoqués dans les tableaux et la mémoire que les Étaplois en gardent aujourd'hui, nous avons récolté des témoignages de marins et de leurs femmes.
Crédits : Capucine CARDOT Le musée des Peintres de la Côte d'Opale : un lieu de mémoire
Hâtifs préparatifs
Durant plusieurs semaines, nous avons enchaîné coups de fil sur coups de fil afin de prendre rendez-vous avec les habitants d’Étaples. Les allers-retours entre les pages jaunes et l’agenda furent fréquents. Nous avons même passé une journée sur le terrain en décembre pour préparer les quatre journées d’entrevues qui eurent lieu fin janvier. Nous nous sommes également occupées de l'hébergement sur place, du matériel à emporter pour ne pas en perdre une miette : appareils photos et dictaphones.
Le master débarque à Étaples
Après toute cette mise en place de la semaine, nous voilà parties sur les routes sinueuses en direction d’Étaples. Nous ne sommes pas seules, toute la promotion des premières années nous accompagne. Dix-sept filles débarquent donc à Étaples – citéde pécheurscomme nous l’indique un panneau à l’entrée de la ville. Durant toute la semaine, elles nous ont été un support et une aide pour la réalisation des entretiens et leur retranscription. Au total, nous avons interrogé une vingtaine de personnes d’Étaples avec leur aide. Nous avons aussi organisé des visites tout au long de la semaine, après une petite balade sur le port de plaisance nous sommes allées visiter le Musée de la Marine pour voir une mise en contexte et acquérir le vocabulaire du marin : le chalut, le cabrouet, les bateaux à clin sans oublier la coutume du partage ! La visite du dernier atelier de construction de bateaux en bois d’Étaples est venue comme une belle conclusion à cette semaine d’immersion.
Toute l'équipe se réunit autour d'un verre pour fêter la fin de cette semaine
Crédits : Capucine CARDOT
Des rencontres pleines d’humanité
Ces rencontres ont été très riches. Certaines personnes se sontconfiées à nous et nous ont fait partager une partie de leur vie. Parfois même elles nous ont laissé en prêt pour quelques jours les albums de famille et des photos prises à bord des bateaux. Souvent, nous avons partagé des moments forts, des souvenirs d'une vie de marin, pas facile... Nous garderons ces bribes de vie au-delà du cadre de notre projet.
La suite avec impatience
Après la retranscription des entretiens, une importante étape d'analyse nous attend. Celle-ci nous permettra d'émettre des propositions d'intégration des témoignages dans le parcours du futur musée. À suivre donc !
Dans le dernier chantier naval repose le Charles de Foucault
Crédits : Léa PECCOT
Un grand merci...Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accordé un peu de leur temps pour nous rencontrer. À ce titre, nous souhaitons remercier particulièrement Georges BOUCHART, Président des Amis du Musée de la Marine, Jérôme RAMET, du chantier de construction navale traditionnelle, ainsi que Marie-France TETU, pour leur aide et leur disponibilité, avant et pendant notre semaine à Étaples.
Léa PECCOT & Diane WESTPHAL
#projettuteuré
#étaples
#marins

TripAdvisor au Château de Ferney-Voltaire
Le château de Ferney Voltaire a ré-ouvert ses portes en juin 2018, après plus de deux ans de travaux.
L’ancienne demeure de Voltaire a été totalement rénovée et un nouveau parcours de visite a été imaginé, repositionnant l’homme des Lumières au centre de son château, qu’il acquit en 1758.
Voltaire reconstruit ce château à sa guise et aménage également le parc, créant son verger, son potager, ainsi qu’une charmille où il aime se promener. Il fait de sa demeure un lieu intense de vie sociale et littéraire. Il y continue son combat contre l'intolérance et écrit quelques 6000 lettres, le Dictionnaire Philosophique, le Traité sur la Tolérance, des tragédies... Il donne des représentations théâtrales au château et reçoit des hôtes venus de toute l'Europe des Lumières. Voltaire s’affiche également comme le bienfaiteur, le patriarche de Ferney, créant de l’emploi en développant notamment l’industrie des montres de Ferney.
A la mort de Voltaire, le château a eu une succession de propriétaires qui ont tour à tour permis de conserver l’âme du maître des lieux, en modifiant pourtant plus ou moins la distribution des pièces : La chambre de Voltaire change de place et devient un véritable lieu de mémoire, la cloison tombe entre la salle à manger et la bibliothèque. L'État acquiert finalement ce lieu en 1999.
A la manière d’une page trip advisor, voici des avis de personnes célèbres, majoritairement contemporaines à Voltaire suite à leur visite du lieu et leur rencontre avec Voltaire. Des parties de ces propos ont bien été écrites par les personnes en question. Nous les avons extraits de leur contexte, à la manière d'opinion d'internautes.
Château de Ferney Voltaire




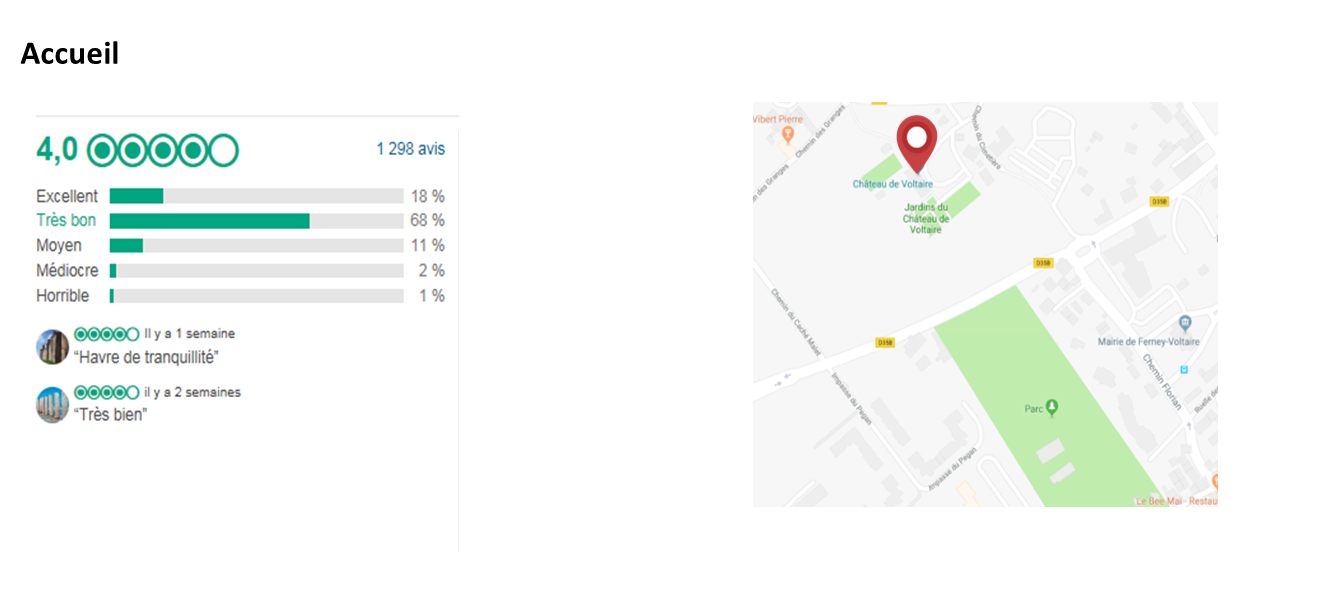
Infos pratiques
Le château est ouvert de 10h à 17h tous les jours, et de 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre. Dernier accès 45 minutes avant la fermeture.
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
Accès en Bus par les lignes Y et F, arrêt Ferney mairie
Accès en voiture : parking municipal à 5minutes à pieds
Avis
Madame de Genlis :
Je suis de passage à Ferney en 1776. Je n’apprécie pas beaucoup le personnage, et je trouve ces écrits de fort mauvais goût. J’avoue m’être finalement laissé charmer par l’homme.
Il organisa une promenade en voiture. Il fit mettre ses chevaux, et nous montâmes dans une berline, lui, sa nièce, madame de Saint Julien et moi. C’est un homme qui aime son jardin, domaine. Il nous mena dans le village pour y voir les maisons qu'il a bâties et les établissements bienfaisants qu'il a formés. Il est plus grand là que dans ses livres, on y voit là sa bonté ! On ne peut se persuader que la même main qui écrivit tant d'impiétés, de faussetés et de méchancetés, ait fait des choses si nobles, si sages et si utiles pour son village, qu’il aime montrer à ses invités et dont il parle simplement avec bonhomie. Il vous instruit de tout ce qu'il a fait, et cependant il n'a nullement l'air de s'en vanter (je ne connais personne qui pût en faire autant).
En rentrant au château la conversation a été fort animée. On parlait avec intérêt de ce qu'on avait vu. Malgré un très fort niveau sonore au repas et l’impression que monsieur de Voltaire est toujours en colère contre ses gens, le moment fut très plaisant e je ne suis partie qu'à la nuit. Monsieur m'a proposé de rester jusqu'au lendemain après dîner, mais j'ai voulu retourner à Genève.
 Amélie Suard, juin 1775 :
Amélie Suard, juin 1775 :
En juin 1775, j’obtiens enfin le but de mes désirs et de mon voyage à Genève, je rencontre Monsieur de Voltaire, que j’admire tant. Quel personnage, quel homme, quelle demeure !
Jamais les transports de sainte Thérèse n’ont pu surpasser ceux que m'a fait éprouver la vue de ce grand homme ! Il me semblait que j'étais en présence d'un dieu ! Rencontrer enfin celui longtemps chéri, adoré ! Enfin il m’était donné de pouvoir lui montrer toute ma reconnaissance et tout mon respect. Quel honneur pour moi qu’il accepta de me recevoir chez lui, qu’il me laissa partager sa demeure, son quotidien. Quel bonheur que de goûter les produits de son potager, de son verger, et son bon vin (car Monsieur possède de nombreuses vignes), je suis conquise !
 Edward Gibbon :
Edward Gibbon :
Je vais chez Voltaire en voisin à l’été 1763. J’assiste à l’une de ses performances théâtrales. Mais je reste un peu mitigée. La pièce jouée était pourtant ma préférée : L'Orphelin de la Chine. Voltaire incarnait lui-même Gengis mais il m'est apparu comme un comédien vociférant et manquant de naturel.
Peut-être ai-je aussi été trop frappé par l'absurdité de la scène : Voltaire, 70 ans, sous les traits d'un conquérant mongo. Perturbant…
 Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Je suis allé à Ferney en 1770, j’y avais emmené avec moi le jeune Condorcet. J’ai trouvé Voltaire si plein d’activité et d’esprit qu’on serait tenté de le croire immortel ! Il fait dans son canton plus de bien que n’en ont jamais fait les évêques d’Annecy depuis François de Sales.
C’est toujours un honneur pour moi que de le tenir informé des affaires de la capitale. J’ai séjourné longuement aux Délices, sa précédente demeure à Génève, mais on sent qu’il a fait de sa demeure à Ferney son véritable havre de paix, qu’il s’y est installé en patriarche de son village et qu’il gère ses affaires à sa guise, tel un homme libre, âgé mais apaisé.
 Condorcet :
Condorcet :
Je n’ai que 27 ans lorsque Jean Le Rond me fait l’honneur de m’amener avec lui voir son ami Monsieur de Voltaire.
C’est un privilège pour moi que de rencontrer ce vieil homme si lettré, si brillant, véritable symbole de notre époque. Je me sens alors si jeune et vierge de tous savoirs ! Mon cœur bat la chamade lorsque j’aperçois le grand homme. Je me sens alors si petit, qui suis-je donc face à lui ? Mais il m’approche avec la plus grande considération et le plus grand respect. Il me considère comme un égal et dit de moi que je serai le continuateur de l’œuvre commune par-delà de sa propre mort.
Je n’oubliai jamais ses paroles, je n’oubliai jamais cette intense rencontre.
 Boswell :
Boswell :
Je suis anglais, élève d’Adam Smith, je suis très intéressé par les grands hommes. Je suis passé à Ferney en 1764.
C’est pour moi un château enchanté, tenu par un magicien, qui me fit l’honneur d’apparaitre peu avant le diner. Quel homme savoureux, quel homme brillant ! Voltaire m'a ravi avec ses nombreux traits d'esprit. Je le fis parler anglais. Lorsqu'il parle notre langue, il est animé d'une âme tout à fait britannique, c’est admirable. Et Il a de l'humour. Il est tout à fait extravagant.
J’ai passé une merveilleuse soirée au château de Ferney Voltaire, que je suis loin d’oublier, et que j’ai hâte de partager avec mes compatriotes anglais à mon retour.
 Princesse Daschkov :
Princesse Daschkov :
Monsieur de Voltaire nous a longuement promené à travers ses terres. Il nous fit découvrir le joli village de Ferney, dont il contribua vivement au développement. Fatiguée par cette longue ballade, je suggérai de rentrer, mais il décida de nous amener dans les appartements de sa nièce Madame Denis. Nous discutons un peu avec la dame en tête à tête mais très vite son oncle nous rejoint pour le souper. Je fus surpris du caractère très simple de sa nièce, qui contraste avec l’extravagance de monsieur.
Lorsque nous primes congés, Voltaire demanda à me revoir lors de mon séjour à Genève. Je lui demandai alors la permission de venir le voir certains matins afin d’apprécier sa compagnie dans son cabinet ou son jardin. Une permission qu’il m’accorda sans réserve. C’est avec grand plaisir que je retournai plusieurs fois dans ce château au si joli jardin.
 Madame d’Epinay :
Madame d’Epinay :
Je pars pour Genève en 1758, j’y séjourne jusqu’en 1759.
J’ai toujours été un peu réservée à l’égard de Voltaire, je ne saurais vraiment dire pourquoi mais le personnage ne m’attire pas confiance.
Cependant, à mon arrivée chez Voltaire, ce déjà vieil homme semble très aimable, plus gai que ce que j’imaginais, et même assez extravagant. Un ton de familiarité s’installe assez vite entre nous. Il m’a fait tout plein de déclarations les plus plaisantes du monde. Un hôte d’excellente compagnie, à la demeure très plaisante.
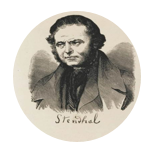 Stendhal :
Stendhal :
Je n’ai pas eu la chance d’être un contemporain de Voltaire, mais en me rendant chez lui une trentaine d’années après sa mort, j’ai tout de même eu l’impression de m’approcher au plus près de ce grand homme.
A Ferney, on m'a répété le conte suivant : Voltaire, en homme d'esprit, voulait tout faire par lui-même; il avait tracé avec sa plume le plan du château qu'il faisait bâtir. Il avait indiqué les murs d'un trait; mais quand on fut au premier étage, toutes les pièces parurent petites, et on s'aperçut que, dans le plan, Voltaire avait oublié l'épaisseur des murs. Mon grand-père, était allé cinq fois à Ferney. Il m’avait conté ses rencontres avec Voltaire.
Lors de ma visite, tout semblait comme je l’avais imaginé d’après les récits de mon grand-père. Sa chambre était encore parfaitement dans l’état où il la laissa en partant pour Paris peu avant sa mort : tenture de taffetas bleu passé, portraits du roi de Prusse, de Madame du Châtelet, de Lekain, une belle demeure, remplie d’âme. Ses livres étaient remplis d'une infinité de petites marques en papier de trois lignes de large et six pouces de long: elles portaient un mot. Quand Voltaire voulait un fait, il grimpait au haut de l'échelle de sa bibliothèque, et lisait rapidement les mots de toutes les marques d'un volume.
J.S.
#Ferney-Voltaire,
#château
#Voltaire
#CMN
#Centre des Monuments Nationaux,
#Patrimoine
.JPG)
Une semaine au Québec
Lors de notre projet d'étude, qui était d'organiser Museomix au Louvre-Lens en novembre 2013 - nous avons été amenées à diverses rencontres. Tout d'abord en participant à l'édition 2012 au musée gallo-romain de Lyon Fourvière, et grâce à l'accord France-Canada, à nous rendre au Québec pour une évaluation commune de l'événement Museomix 2013.
.JPG)
Québec
Crédits : Margaux Geib L.
Le 14 février dernier, l'équipe a ainsi décollé vers de nouvelles contrées nord-américaines pour une semaine au Québec !
Après 7 heures de vol et une arrivée sous 35cm de neige, nous voici dans la magnifique ville de Montréal. La semaine s'est vite organisée selon les différentes présentations du projet prévues et selon les rencontres sur sites, dans divers musées.
Samedi, après un brunch dans le fameux quartier de St Viateur, suivi de la visite au musée d'histoire McCord pour un petit groupe et du site de la Biosphère pour l’autre. Nous nous sommes retrouvés au musée de Pointe-à-Callière, le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, pour une rencontre avec le muséographe réflechissant au projet d'agrandissement du musée, Raymond Montpetit.
Le dimanche nous avons visité le musée des Beaux-arts de Montréal, et notamment son exposition « La BD s'expose au musée »,qui invite des bédéistes à choisir une œuvre (ou plus) du musée afin de réaliser une planche pour l'exposition. Puis départ en bus pour la mythique ville de Québec.

Exposition "La BD s'expose au musée"
Crédits : Margaux Geib L.
Lundi et mardi, rendez-vous au musée de la Civilisation pour échanger avec l'équipe de Museomix Québec et pour mener à bien notre mission d’évaluation. Nous avons ainsi réalisé un bilan des deux événements, pour mettre en avant les points forts et les points faibles mais aussi soumettre des améliorations ou changements pour les prochaines éditions. Nous avons profité de cette rencontre pour visiter le musée et de ses très belles expositions (« C'est notre histoire», « Jeux vidéos », « Haïti in extremis ») ; mais aussi aller à la découverte de la ville et même faire un tour de patinoire …
+copie.jpg)
Musée de la civilisation, réunion Museomix et visite du musée (Exposition "Haïti, in extremis")
Crédits : Margaux Geib L.
Mercredi, retour à Montréal pour une présentation de Museomix à l'UQAM (Université du Québec à Montréal), devant les étudiants en muséologie de Jennifer Carter, susceptibles de s'intégrer à l'organisation de l'édition 2014. L'occasion de leur présenter un autre projet initié par des étudiants « FestiOmuse» : une rencontre entre étudiants de formations similaires afin de réfléchir ensemble sur les problématiques liées aux musées.
.JPG)
Présentation Museomix à l'UQAM
Crédits : Margaux Geib L.
Jeudi, notre voyage arrive déjà à son terme. Une visite du musée commémoratif de l’Holocauste puis le temps d’apprécierla vue sur la ville depuis le Mont Royal, et nous voici de retour à l'aéroport.

Montréal
Crédits : Margaux Geib L.
Cette semaine intense nous a permis d'avoir un aperçu de la vie québécoise (nous avons logé chez l’habitant) ainsi que de sa richesse culturelle. La rencontre avec l'équipe de Museomix Québec fût, pour nous, l'occasion de clôturer cette belle expérience de Museomix 2013. A l’heure où nous signons cet article, l’association Museomix Nord vient d’être créée.
A suivre …
Agathe Gadenne, Camille Françoise, Elisa Bellancourt, Margaux Geib Lapinte
Musée des beaux arts de Montréal