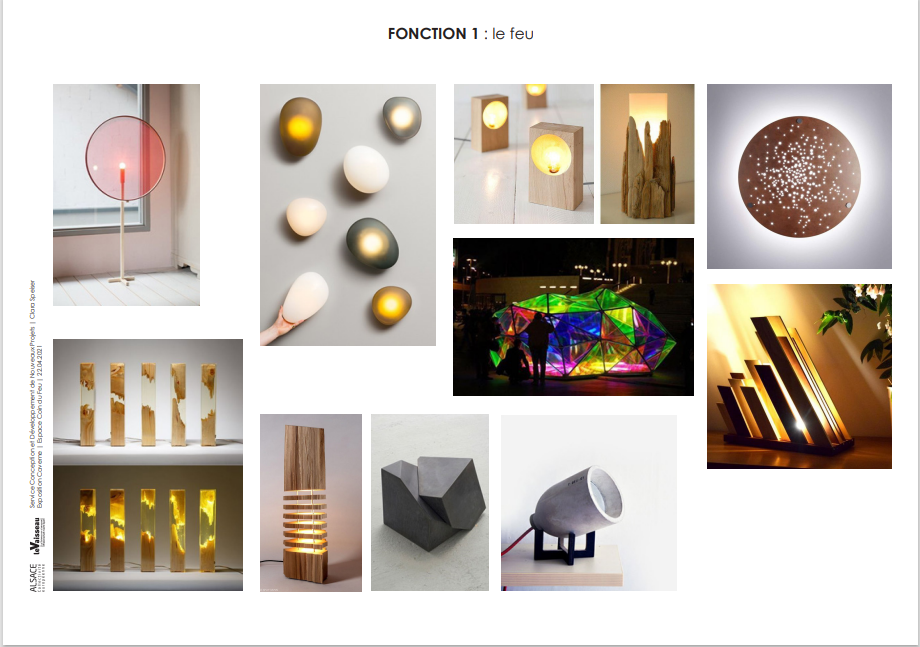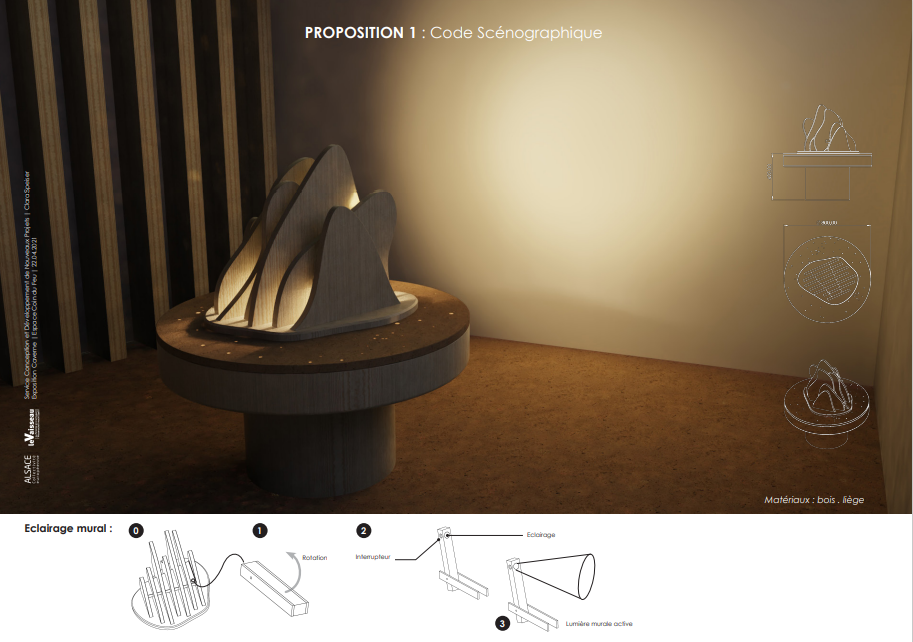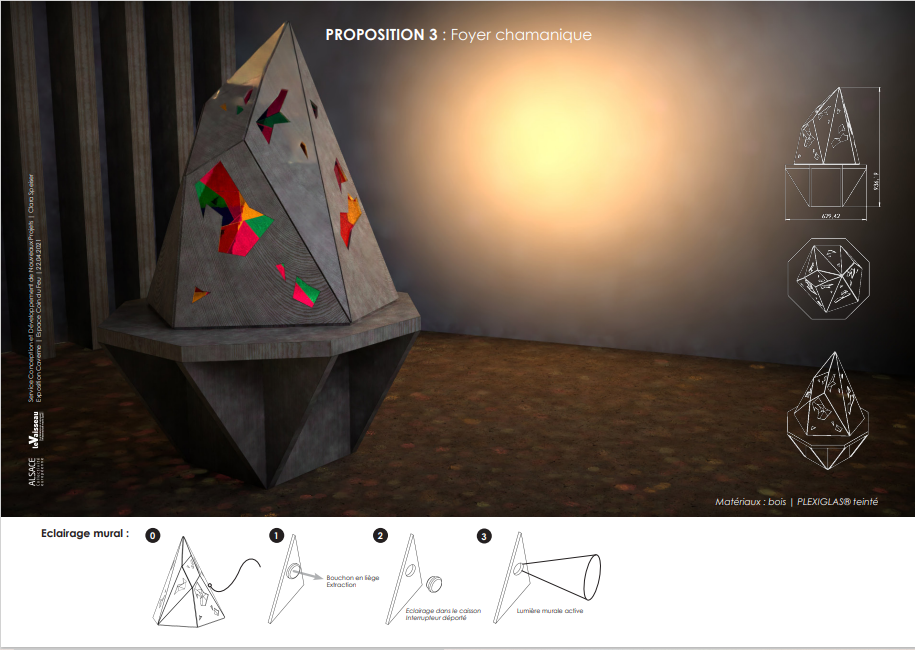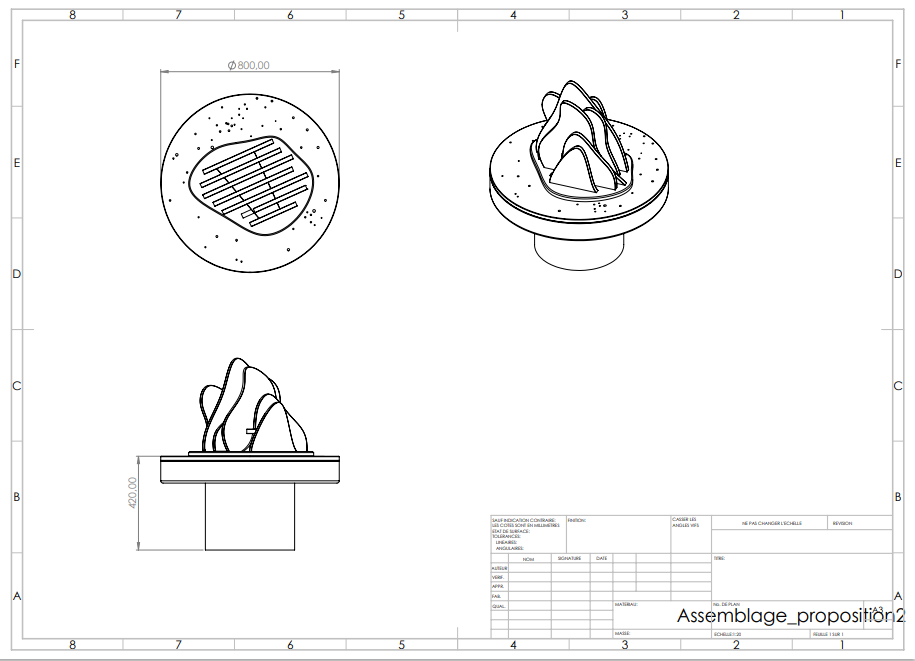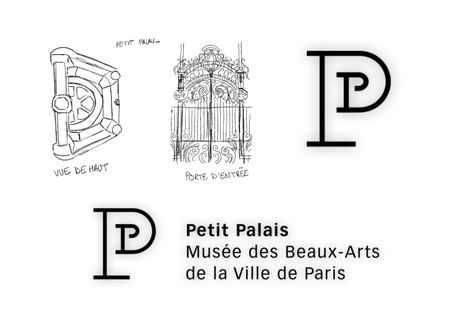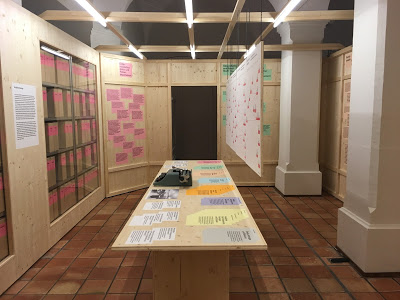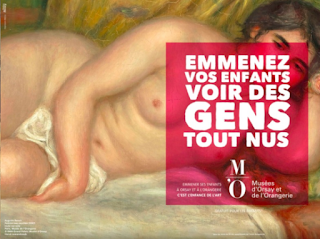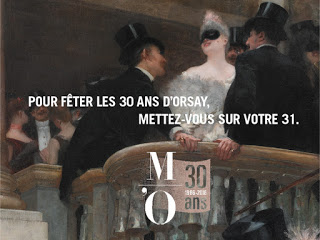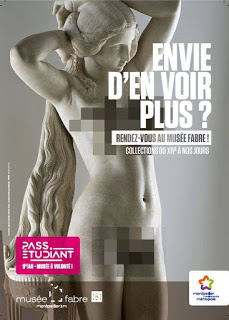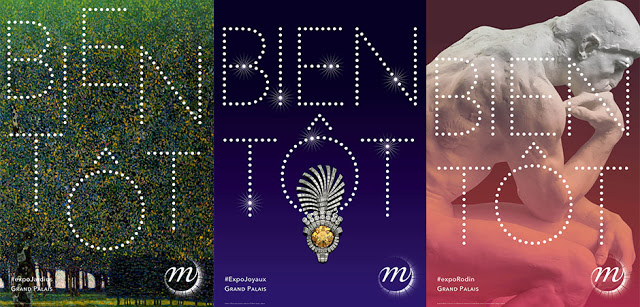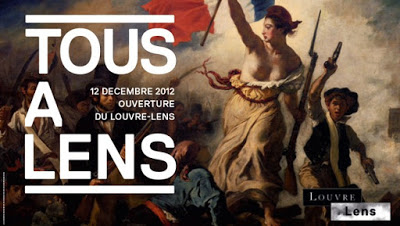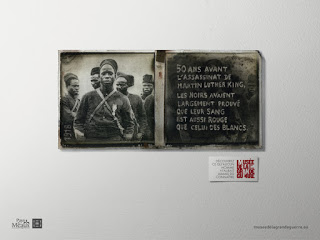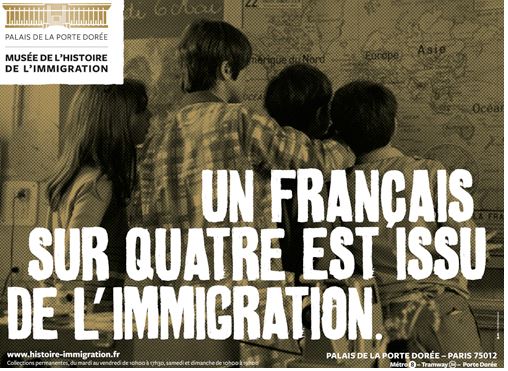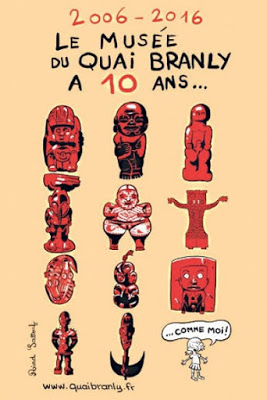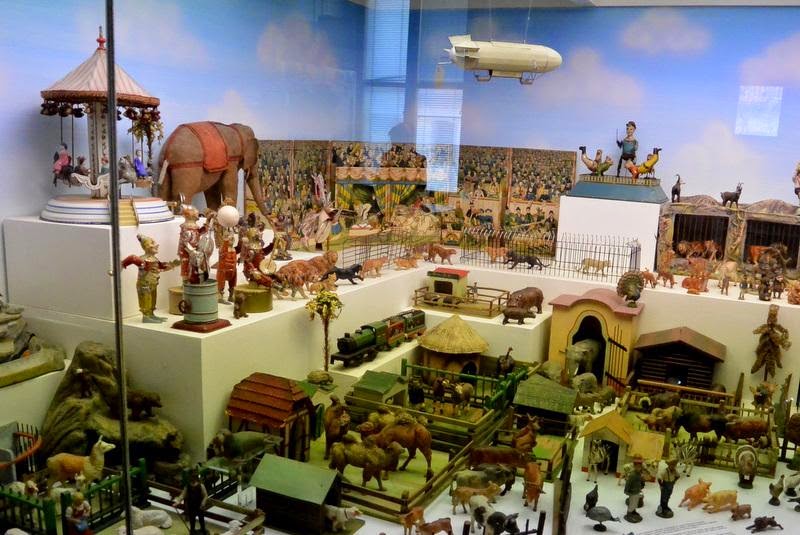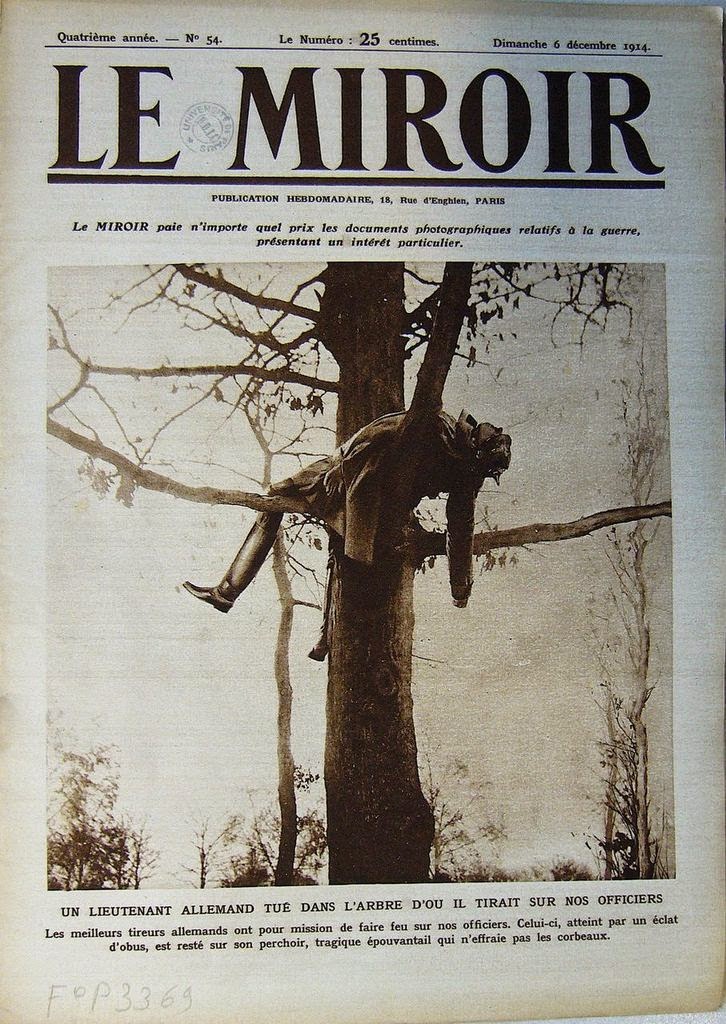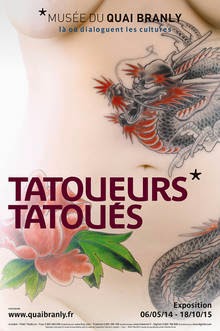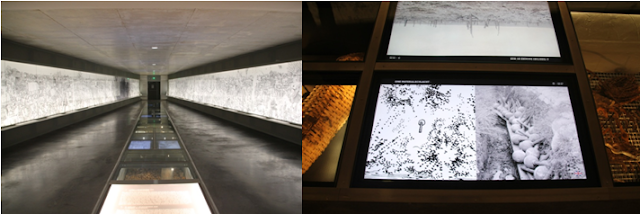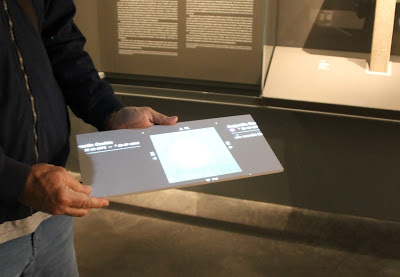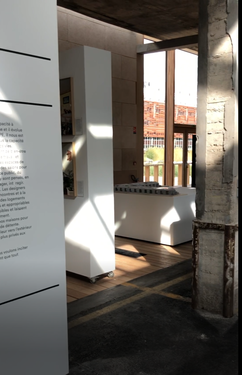Design - Graphisme
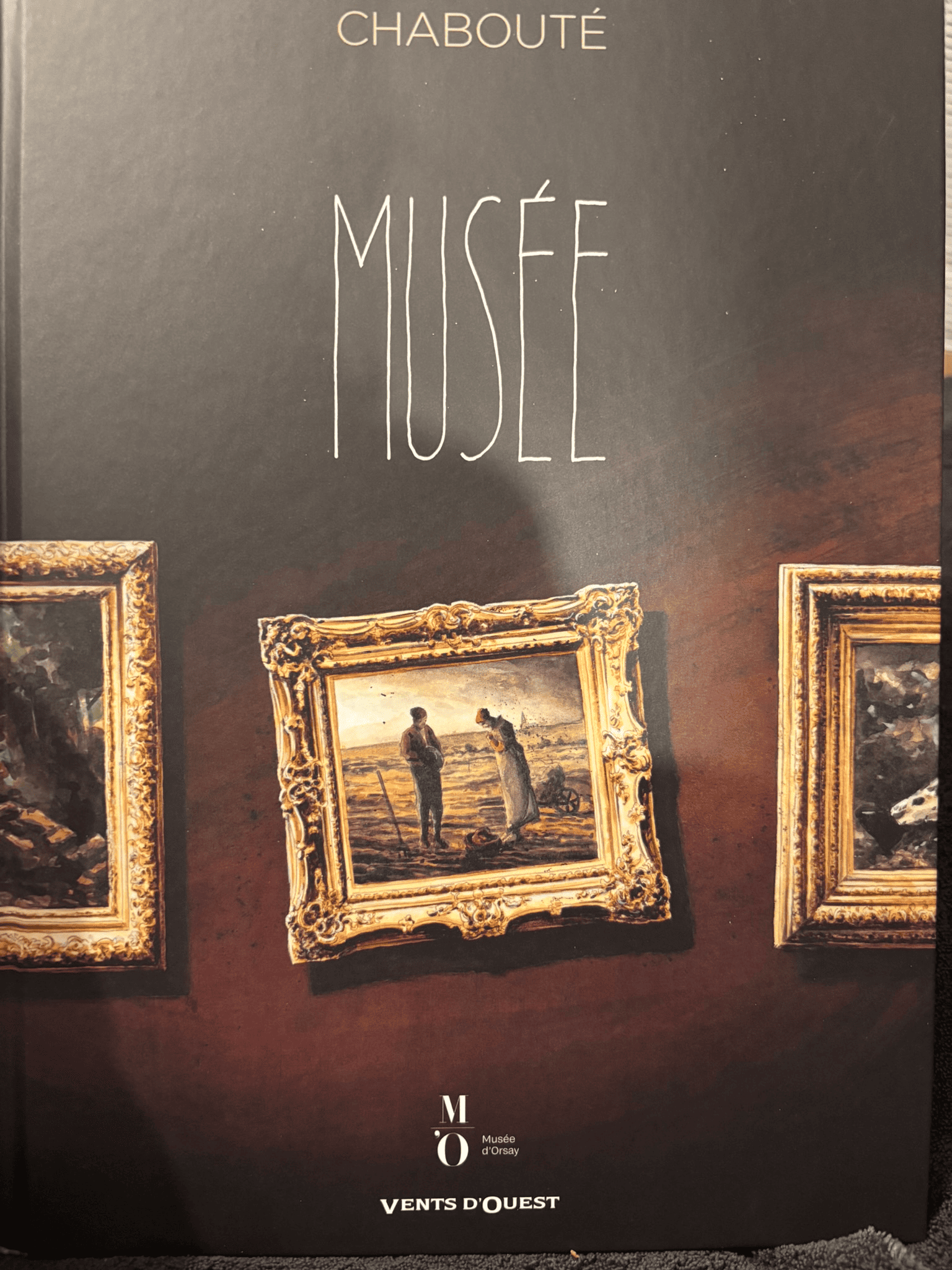
À quoi pensent les œuvres du musée d’Orsay ?
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passait lorsqu’un musée se vide de ses visiteurs ? Plongez dans l’univers en noir et blanc de Christophe Chabouté et de la vie nocturne des œuvres d’Orsay. Les œuvres ont aussi des choses à raconter.
Édité par le label Vents d’Ouest du groupe Glénat, en 2023, Christophe Chabouté invite le lecteur à visiter les riches collections dans les différentes galeries de l’ancienne gare d’Orsay. Plongez dans le quotidien des œuvres d’art ! Tout comme le réalisateur Shawn Levy, dans la série de films La Nuit au musée (voir article sur le sujet : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1208-la-nuit-au-musee-ou-la-solution-miracle), qui redonne vie aux collections du Museum d’histoire naturelle de New York, l’auteur de cette BD fait de même avec les collections d’art d’Orsay. Cette BD graphique est entièrement en noir et blanc, et majoritairement sans dialogue, destinée à être contemplative des différentes situations entre les visiteurs et les œuvres d’art.
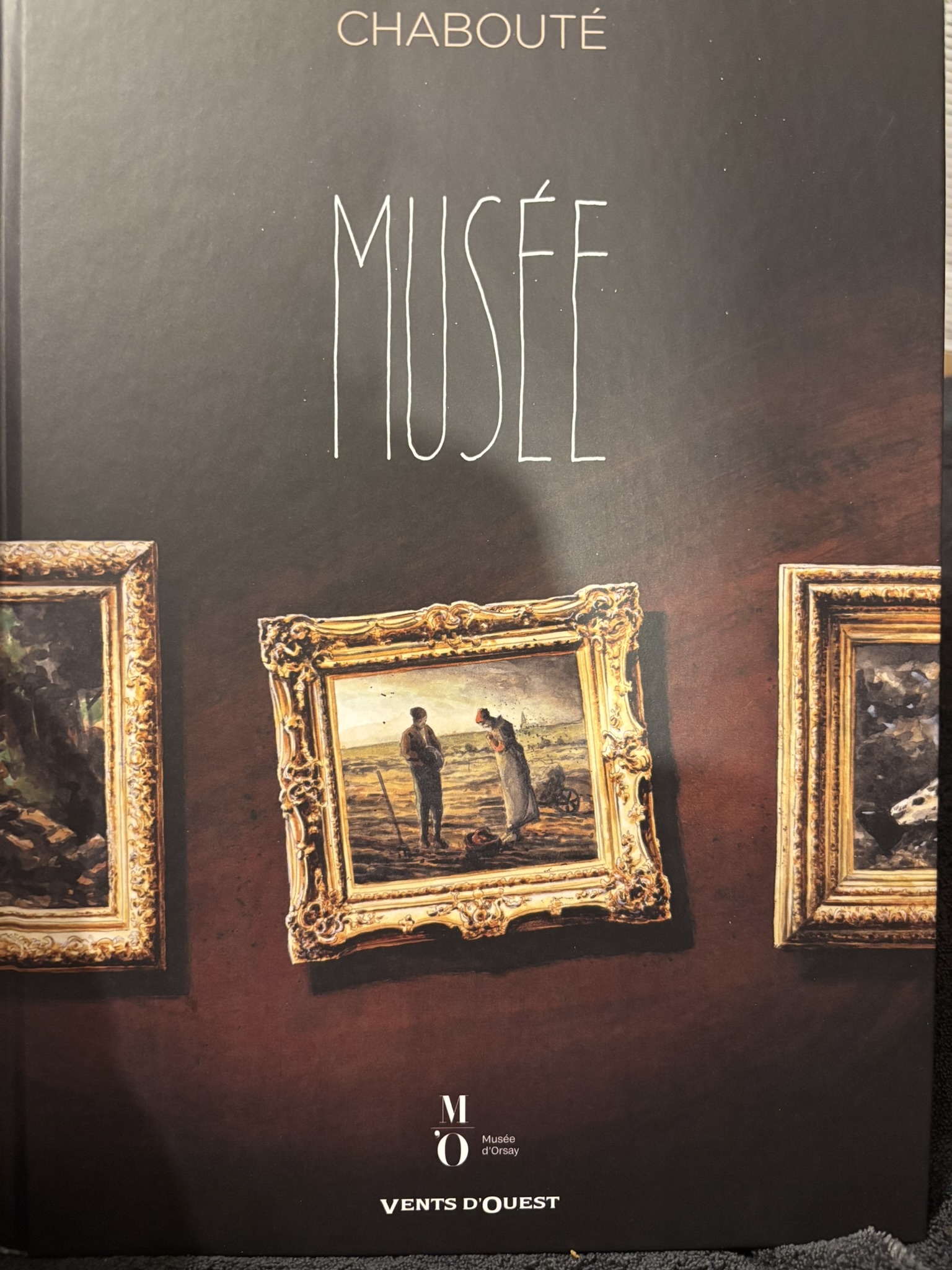 Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix
Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix
Le choix des œuvres par Christophe Chabouté a été simple selon lui : ce sont toutes les œuvres qu’il préfère à Orsay comme Les parlementairesde Daumier, Pompon l’ours, Héraklès, Anacréon, La Liseuse, Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, Persée, Le Prince Impérial et le chien Néro, le portrait de Berthe Morisot, ou encore le Gladiateur du monument à Gérôme. Pourquoi étaient-elles ses préférées ? Parce qu’il parvenait à leur trouver un rôle et une fonction lorsqu’il les observait.
Une double narration
Le lecteur fait face à une double narration. D’une part, la journée, le musée est principalement vu par les différents types de visiteurs qui se succèdent au fil des pages. En tant que visiteurs, nous n’observons pas tous de la même façon les œuvres. Nous les découvrons différemment. L’auteur de la BD présente quelques scènes amusantes, comme celle où deux dames discutent de la façon de cuire des asperges devant le tableau de Manet L’asperge (p. 71-72). Mais des scènes aussi douces et émouvantes, avec une petite fille qui fait visiter le musée à son grand-père aveugle. Elle choisit de lui faire « écouter les tableaux » pour les lui décrire (p. 87 à 99). Nous avons tous une sensibilité différente face à une œuvre, il est possible de lui donner une interprétation avec nos propres mots ! Pas besoin d’être un fin connaisseur pour admirer une œuvre d’art, ou de discourir avec langage soutenu ! Une double page (p. 52 et 53) en est le parfait exemple : un homme décrit un paysage en utilisant une vague de mots complexes pour la décrire tout en triturant sa barbe, à ses côtés une dame décrit le tableau ainsi « Cette douceur… ce calme…cette sérénité…on entend le doux et léger frottement de l’herbe contre les robes ». L’homme accueille ces paroles en silence. La description émotionnelle l’emporte sur le discours pompeux et élitiste. Une autre scène se renouvelle au sein de la BD, quand le lecteur prend la place d’un tableau et peut observer les réactions des visiteurs lorsqu’ils l’observent : rire, dispute, pudeur…Quel est ce tableau qui intrigue ? La réponse est à la fin de la BD : L’origine du monde de Courbet. D’autre part, la narration se poursuit la nuit avec les œuvres d’art qui décident d’évoquer certaines scènes vues au cours de la journée, comme celle d’un homme non-voyant touchant une œuvre, probablement le grand-père de la petite fille. Ou encore les parlementaires de Daumier qui font des commérages sur les amourettes de Louis un surveillant du musée d’Orsay.
En figurant le surveillant, Christophe Chabouté permet aux lecteurs de découvrir les coulisses du musée avant son ouverture : dépoussiérage, déplacement ou dépôt d’une œuvre. Des métiers qui peuvent être invisibles aux yeux des visiteurs mais essentiels à l’entretien de nos œuvres préférées !
Plongez dans la vie intime des œuvres !
Figées dans l’espace et le temps, elles sont destinées à observer chaque visiteur les contempler et les critiquer. Lorsque la nuit tombe et que le musée se vide de ses visiteurs, les œuvres se mettent à vivre leur propre vie. Elles aussi ont une âme, des envies de découvertes, des émotions, après tout ne sont-elles pas le reflet de ce que l’artiste souhaitait faire transparaître ? « On en profite, on savoure. On vit. » (Extrait d’une discussion entre deux sculptures sur la question : pourquoi leur est-il possible de bouger ? p. 111)
Christian Chabouté souhaite montrer que les œuvres aussi ont des choses à raconter et leur propre sentiment et histoire. L’Héraklès Archer de Bourdelle se questionne et est intrigué par les toilettes, chaque nuit, il cherche leur mode d’emploi. Il analyse les lavabos, les sèche-mains et la chasse d’eau. Même immobiles la journée, les œuvres sont attentives aux discussions des visiteurs, ces dernières influent leurs actions la nuit et leurs discussions. La Liseuse d’Henri Fantin-Latour et Anacréon d’Eugène Guillaume, amoureux, se lamentent chaque nuit sur leur éloignement en journée. La nuit, les tableaux se vident. Berthe Morisot passe ses nuits à observer un homme promener son chien, un amour à sens unique ? À la fin de la BD, cet homme observe son portrait et acheter une reproduction par la suite. Qui a dit qu’il était impossible d’avoir un coup de foudre pour un portrait ? Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, et Persée passent leur temps à s’interroger sur la vie humaine et les agissements des visiteurs.
Questionner le visiteur au musée ?
Par ses décalages et variation de points de vue, l’auteur permet de questionner également l’utilisation des téléphones portables au sein des musées, présentant de nombreuses planches où les humains regardent à peine les œuvres et les prennent seulement en photo. Les œuvres ne comprennent pas et se demandent pourquoi les humains leur tendent ces objets rectangulaires (p. 123). On ne regarde plus, on accumule des photos d’œuvres dans le téléphone, comme pour passer à la prochaine œuvre, ainsi cette scène où une femme presse son mari alors qu’il contemple une œuvre en lui disant « De toute façon, je l’ai pris en photo. Tu pourras la regarder à l’hôtel ce soir » (p. 70-71). Notre volonté d’aller trop vite et d’utiliser la technologie à tout moment, ne détruit-elle pas notre expérience de visite ?
Le surveillant est un autre personnage à part entière. Lorsque nous nous baladons dans un musée, nous observons les œuvres, le lieu, mais voyons-nous les agents qui font vivre le musée ? Un questionnement possible après une confidence déposée auprès d’une statue : « Il m’a dit : tu as de la chance, toi…Tout le monde te regarde, te dessine, te contemple…Nous, on n’existe pas. On est transparents, on fait partie du décor… Invisibles… ». L’art évince les gardiens, peut-être les humains de façon plus large, mais les œuvres leur redonnent toute leur importance, en devenant leur interlocuteur.
En lisant cette bande dessinée, vous redécouvrirez les musées autrement ! Et lors de votre prochaine visite, demandez-vous comment les œuvres vous voient-elles ? Que ressentez-vous ?
Laurie Dereix
« Musée » Par Christophe Chabouté. Editions Vents d’Ouest (23€) – Paru le 19 avril 2023
#ArtGraphique #BD #Musée d’Orsay

Barbie, la poupée controversée
Barbie Fashion, Joseph Condé © photo A. Erard
C’est avec un regard curieux et loin de mes a priori sur la poupée Barbie que je décide de mettre des mots sur mon expérience. Si certains dénoncent le modèle féminin de la Barbie, c’était une toute autre vision que nous proposait l’exposition Barbie au Musée des Arts décoratifs de Paris de mars à septembre 2016. Exposition ayant été conçue par Anne Monier (conservatrice du département des jouets), assistée d’Aurore BAYLE-LOUDET, et scénographiée par Nathalie Crinière. Depuis les années 60, Barbie s’est imposée comme une figure phare, une icône pour la jeunesse, qui fascine aujourd’hui toutes les générations.
Et quelle bonne surprise que de pouvoir se replonger dans son univers féerique le temps d’une visite ! Les adeptes n’avaient qu’à bien se tenir car c’est une réelle redécouverte qui nous attendait dans ce « Barbieland ». Strass, froufrous et paillettes étaient au rendez-vous, mais qui connaissait réellement sa gigantesque famille, son évolution physique au fil des décennies, sans parler de sa carrière fluctuante digne des plus grandes figures de ce monde ? « À travers ses tenues, nous dessinons ses carrières, les étapes de sa vie, et plus largement toute l’histoire de Barbie » disait Robert Best, directeur en chef du design de Barbie. La poupée a inspiré les plus grands artistes et l’exposition leur rend hommage.

Barbie Karl Lagerfeld © photo A. Erard
Je démarre donc cette visite sans a priori sur l’image idéalisée par la société Mattel, de la femme moderne qui a souvent fait parler d’elle. L’exposition prend tout son sens en ce qu’elle nous présente la Barbie dans un parcours de vie des plus complets. La maison Mattel est mise en lumière à plusieurs reprises, on retrouve notamment ses ateliers de fabrication en version miniature qui évoquent la conception du jouet qui sera bientôt idolâtré.
Décor de l'atelier Mattel © photo A. Erard
Des Barbie en veux-tu ? En voici en voilà ! C’est un défilé de Barbies auquel nous assistions, pour cette figure de mode qui a inspiré les plus grands, tels Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Agnès B, Cacharel ou encore Christian Louboutin. Chacun habille la Barbie à son image ou bien la représente une icône de la mode. On ne cherche donc pas à toucher un public exclusivement jeune ou féminin mais également les amateurs de mode et toute personne curieuse de l’évolution de la poupée dans son aspect historique et dans les modes qu’elle a représentées au fil des décennies.
Car la Barbie a connu de multiples changements physiques, c’est un jouet en constante évolution. Longtemps critiquée, elle arbore fièrement ses nouvelles formes et ses couleurs de peaux. 14 visages, 23 couleurs de cheveux, 8 couleurs de peau, une diversité qui ne satisfera que partiellement les plus sceptiques et même 4. Certes, un certain canon esthétique demeure. Dans la salle dédiée à l’évolution du jouet, je ne peux m’empêcher de sourire en voyant la transformation du mécanisme de la Barbie dont les articulations s’assouplissent au fil du temps pour la rendre de plus en plus maniable. Barbie s’inscrit donc dans une évolution historique riche en rebondissements, et c’est certainement l’aspect socio-culturel du jouet qui est mis en avant dans cette exposition. On constate notamment l’évolution des rôles joués par Barbie au fil du temps, si la première Barbie incarnait le phénomène « girly », Mattel a lancé la production de barbies exerçant des métiers initialement appréhendés par les hommes (cosmonaute, footballeuse, présidente …). En ce sens, elle représente l’image de la femme indépendante dans un monde qui ne serait idéalement pas dominé par l’homme. Robert Best disait que « Barbie doit être représentative de son époque mais surtout nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout d’un jouet pour enfants. » Je m’attache alors à comprendre l’enjeu d’un tel phénomène dans l’époque dans laquelle elle s’inscrit. Dois-je comprendre que la poupée serait une inspiration plus qu’un modèle à imiter ? En nous laissant penser cela, le créateur cherche sûrement à camoufler l’image initiale qu’il a cherché à transmettre au travers de ses poupées, soit la superficialité d’un jouet et de son image. Je peux néanmoins m’amuser de la voir déclinée dans plus de 150 tenues représentant le même nombre de métiers qu’elle a pu exercer au cours de sa vie.
La visite se déroule le sourire aux lèvres. Nul besoin d’une ambiance des plus silencieuses, car Barbie c’est avant tout le jeu et la joie de vivre. J’entends en fond sonore la chanson « Barbie Girl », musique ayant traversé des booms générationnelles. Une salle est consacrée au jouet, à ses aventures et ses publicités télévisées. Je déambule le long de ces écrans qui passent en boucle les images de la poupée animée, et qui nous rappellent que le phénomène va au-delà de la simple représentation physique du personnage.
Salle des vêtements © photo A. Erard
Afin de contenter les plus adeptes de mode, l’exposition nous plonge dans une nouvelle salle dédiée à la garde-robe de Barbie. Une déclinaison d’habits, un arc-en-ciel de couleurs et des centaines de vêtements et accessoires miniatures sont fixés aux murs de cet espace de transition. Créativité et diversité sont au rendez-vous dans ce dressing que l’on voudrait avoir chez soi.
Je poursuis ma visite en entrant dans une salle consacrée à l’entourage de Barbie, un arbre généalogique sans fin, des amis que l’on ne compte plus, une famille représentative de la prétendue famille américaine « modèle » et bien sûr ses conquêtes amoureuses. L’arbre généalogique nous présente ces personnages fixés aux murs pour faciliter sa lecture, ce qui s’avère plutôt nécessaire vu le nombre de membres dans son entourage proche.
La visite se termine sur une déclinaison de plusieurs Barbies réalisées par des étudiants en Ecole de design textile. Ces représentations démontrent l’inspiration irrémédiable de la poupée, qui voyage à travers les temps, marque les esprits et s’impose à la manière d’un mythe universel. Elles donnent à voir le potentiel de futurs créateurs et clôturent la balade sur une touche de créativité.
L’exposition Barbie aura-t-elle réussi à convaincre les plus sceptiques de l’univers de la poupée ? La muséographie aura-t-elle participé à une surenchère de critiques sur le caractère superficiel de la Barbie ou aura-t-elle épousé des mouvements de société ou de la mode ?
Anna Erard
#barbie
#artsdécoratifs

De fil en aiguille…On tisse des matières
« Le Chant du monde » dans un des monuments hospitaliers du XIIème siècle le mieux conservé de France…cela a de quoi attirer et intriguer ! Cependant, aussi hypnotisée par cette appellation poétique que j’étais, ce n’est pas que pour cette collection de tapisseries de Jean Lurçat qu’il faut se rendre au musée du même nom à Angers, et ce jusqu’au 28 mai 2012.
Lorsque l’on nous donne notre ticket pour visiter l’exposition « 1_2_3 Sculptures de Fibres », on ne s’attend pas à trouver des œuvres d’une autre dimension. 1_2_3, pour trois artistes, trois femmes qui manient le textile et les aiguilles de manière originale, mélangeant la fibre à divers matériaux et la travaillant de façon peu banale. Alors, bien que ce ne soit pas mon domaine de prédilection, je me lance !

1_ Simone Pheulpin : un monde de plis
 En montant les escaliers pour accéder à la première salle, une délicieuse odeur de végétaux vient nous chatouiller les narines.Bizarre…n’étais-je pas partie pour une exposition textile ? On commence par l’espace réservé à Marie-Noëlle Fontan, qui associe ses fibres à du végétal de toutes sortes. Véritable virtuose de l’aguille, de la précision et de l’assemblage, l’artiste nous fait oublier les limites entre les deux matériaux.Que ce soit sous la forme de tipis, de tentures ou d’objets, le tissu se mêle et s’entremêle aux baguettes de bois, feuilles, fleurs, de sorte qu’on ne distingue plus vraiment quoi est quoi. Les murs sont recouverts de grandes tentures qui associent les deux, participant à l’immersion du visiteur. Je suis dans une forêt de tissus ! … Avec des plantes quand même…et du bois !… Déroutant !
En montant les escaliers pour accéder à la première salle, une délicieuse odeur de végétaux vient nous chatouiller les narines.Bizarre…n’étais-je pas partie pour une exposition textile ? On commence par l’espace réservé à Marie-Noëlle Fontan, qui associe ses fibres à du végétal de toutes sortes. Véritable virtuose de l’aguille, de la précision et de l’assemblage, l’artiste nous fait oublier les limites entre les deux matériaux.Que ce soit sous la forme de tipis, de tentures ou d’objets, le tissu se mêle et s’entremêle aux baguettes de bois, feuilles, fleurs, de sorte qu’on ne distingue plus vraiment quoi est quoi. Les murs sont recouverts de grandes tentures qui associent les deux, participant à l’immersion du visiteur. Je suis dans une forêt de tissus ! … Avec des plantes quand même…et du bois !… Déroutant !
Au détour d’un mur, l’artiste s’improvise infirmière végétale. On peut en effet admirer des feuilles séchées, abîmées et malmenées par le temps, et dont les trous on été remplacés par des morceaux de fils et de tissus. Ou comment panser et rabibocher les plaies de ces pauvres feuilles, de manière artistique.Ingénieux ! D’autant que celles-ci, plaquées sur le mur, sont disposées de sorte qu’on ne peut voir le stratagème de l’artiste, les « points de sutures », mais seulement s’émerveiller du résultat et de la technique aussi légère et fragile que le support.
Le tout laisse une impression d’harmonie, de douceur, de surréalisme, accentuant peut-être le choc que j’ai eu en passant dans la prochaine salle…


© Facebook des musées d’Angers (Simone Pheulpin)
2_ Un travail énigmatique
 En pénétrant dans l’espace réservé à Simone Pheulpin, je reste quelque peu perplexe… De forêt végétale je passe à plâtres et coquillage ? Je relis le titre de l’exposition… « 1_2_3 sculptures de fibres » … Je m’approche alors d’un gros coquillage à l’aspect calcaire et, comme le permet l’absence de mise à distance des œuvres, me penche pour l’observer. Incroyable ! Apparaissent alors à mes yeux une multitude de plis et de bandelettes de coton mis en volume ! Je suis bluffée, l’artiste arrive ici à changer complètement l’aspect du tissu, à repenser la matière, grâce à une maîtrise textile et à un jeu de lumière très ingénieux. Je me prends alors à admirer la salle entière, faites de sculptures et de tableaux muraux, et savoure l’effet tantôt calcaire, tantôt coquille, tantôt cocon, mousse ou plâtre, tout en sachant que je vais découvrir avec plaisir, en m’approchant, la réalité de la matière utilisée : le coton. Reproduisant à merveille les fissures qui semblent parcourir un relief de terre, un fossile de Praire, ou encore un coup donné dans une plaque de plâtre craquelée, la maîtrise des plis de tissu est déroutante ! Sorties d’un autre monde, d’une autre texture, les œuvres de tailles et formes variées surprennent dans notre dimension et se font un devoir de convertir la nature en tissu.
En pénétrant dans l’espace réservé à Simone Pheulpin, je reste quelque peu perplexe… De forêt végétale je passe à plâtres et coquillage ? Je relis le titre de l’exposition… « 1_2_3 sculptures de fibres » … Je m’approche alors d’un gros coquillage à l’aspect calcaire et, comme le permet l’absence de mise à distance des œuvres, me penche pour l’observer. Incroyable ! Apparaissent alors à mes yeux une multitude de plis et de bandelettes de coton mis en volume ! Je suis bluffée, l’artiste arrive ici à changer complètement l’aspect du tissu, à repenser la matière, grâce à une maîtrise textile et à un jeu de lumière très ingénieux. Je me prends alors à admirer la salle entière, faites de sculptures et de tableaux muraux, et savoure l’effet tantôt calcaire, tantôt coquille, tantôt cocon, mousse ou plâtre, tout en sachant que je vais découvrir avec plaisir, en m’approchant, la réalité de la matière utilisée : le coton. Reproduisant à merveille les fissures qui semblent parcourir un relief de terre, un fossile de Praire, ou encore un coup donné dans une plaque de plâtre craquelée, la maîtrise des plis de tissu est déroutante ! Sorties d’un autre monde, d’une autre texture, les œuvres de tailles et formes variées surprennent dans notre dimension et se font un devoir de convertir la nature en tissu.
Cependant la visite n’est pas finie et je me détache avec regret de ma contemplation de cette technique et de son résultat, pour m’immiscer dans le monde de la dernière artiste …
3_ Une patience infinie
 A défaut de recevoir John Galliano [1], le musée me permet d’entrer dans le monde de Jill Galliéni. Un monde poudré, sucré et burlesque. Un monde de poupées, de chiffons et de couleurs, car l’aide à la visite m’apprend que l’artiste manie l’aiguille comme une virtuose. Perchées sur des socles rosés, de petites et délicates danseuses, légères comme du papier, sculptées à l’aide de colle et pliage,côtoient les poupées en chiffon à taille humaine. Assemblages de pièces et de textures différentes, mariage de couleurs, l’ambiance avec ces géantes de tissu en est surprenante. D’abord agressée par les différents motifs, les formes arrêtées, les courbes cassées et la quelque peu dérangeante et apparente maladresse des poupées et de leur fabrication, et regrettant déjà mon incroyable découverte de la salle précédente, je prends un instant pour contempler l’ensemble de la salle… Pour me voir s’offrir alors à mes yeux un incroyable ballet. En effet, si on prend le temps de s’installer à un coin de l’espace pour la regarder dans son ensemble, on peut voir alors des mouvements, une grâce et un mélange des gestes, des couleurs et des formes s’harmoniser. Une multitude de petites danseuses répondent aux géantes en les entourant, telle une figure de pas classiques ! Je ne suis pas experte en ballet, et je ne prétendrais pas avoir eu devant les yeux le Lac des Cygnes [2], mais l’effet, accentué par les socles roses pâles, est des plus agréables ! On a soudainement l’impression d’évoluer dans un monde étrange, qui fonctionne sans nous, et dans lequel on se sentirait mal à l’aise de rester.
A défaut de recevoir John Galliano [1], le musée me permet d’entrer dans le monde de Jill Galliéni. Un monde poudré, sucré et burlesque. Un monde de poupées, de chiffons et de couleurs, car l’aide à la visite m’apprend que l’artiste manie l’aiguille comme une virtuose. Perchées sur des socles rosés, de petites et délicates danseuses, légères comme du papier, sculptées à l’aide de colle et pliage,côtoient les poupées en chiffon à taille humaine. Assemblages de pièces et de textures différentes, mariage de couleurs, l’ambiance avec ces géantes de tissu en est surprenante. D’abord agressée par les différents motifs, les formes arrêtées, les courbes cassées et la quelque peu dérangeante et apparente maladresse des poupées et de leur fabrication, et regrettant déjà mon incroyable découverte de la salle précédente, je prends un instant pour contempler l’ensemble de la salle… Pour me voir s’offrir alors à mes yeux un incroyable ballet. En effet, si on prend le temps de s’installer à un coin de l’espace pour la regarder dans son ensemble, on peut voir alors des mouvements, une grâce et un mélange des gestes, des couleurs et des formes s’harmoniser. Une multitude de petites danseuses répondent aux géantes en les entourant, telle une figure de pas classiques ! Je ne suis pas experte en ballet, et je ne prétendrais pas avoir eu devant les yeux le Lac des Cygnes [2], mais l’effet, accentué par les socles roses pâles, est des plus agréables ! On a soudainement l’impression d’évoluer dans un monde étrange, qui fonctionne sans nous, et dans lequel on se sentirait mal à l’aise de rester.
Avec pour unique lien le travail du tissu, les œuvres des trois artistes évoluent dans des espaces attribués et cloisonnés. Une scénographie épurée et classique invite le visiteur à contempler les objets sobrement posés sur des socles,suspendus ou accrochés aux murs. Avec pour seuls aides à la visite un fascicule distribué à l’accueil, et des cartels avec les noms des œuvres, on nous laisse totalement libre et juge d’interprétation.
 Au final, je ressors de cette exposition le cœur gonflé et les yeux qui pétillent ! Une grande surprise que nous offre là « 1_2_3 Sculptures de Fibres », à laquelle le musée Jean Lurçat, plutôt classique, nous avait peu habitués ! Comme quoi, on peut rentrer dans un lieu avec tous les préjugés du monde pourvoir une exposition, et bien quand celle-ci est bonne, on s’incline et dit« Chapeau Mesdames » !
Au final, je ressors de cette exposition le cœur gonflé et les yeux qui pétillent ! Une grande surprise que nous offre là « 1_2_3 Sculptures de Fibres », à laquelle le musée Jean Lurçat, plutôt classique, nous avait peu habitués ! Comme quoi, on peut rentrer dans un lieu avec tous les préjugés du monde pourvoir une exposition, et bien quand celle-ci est bonne, on s’incline et dit« Chapeau Mesdames » !
Julie Minetto
[1] Célèbre créateur britannique de Haute-couture, figure notamment de la maison Dior
[2] Ballet de Piotr Tchaïkovski (1840-1893), célèbre compositeur russe

Des expos recyclées
La production d’expositions et leur recyclage figurent au cœur des préoccupations alliant musées et développement durable. À Paris, le Viaduc des Arts accueille les Ateliers Chutes Libres et l’agence de design et d’architecture intérieure Premices and co. Ces deux structures sont formées par une seule équipe particulièrement soucieuse de l’économie circulaire. Rencontre avec Jérémie Triaire, designer scénographe et co- fondateur.
Pourriez-vous nous décrire ce lieu ?
Les Ateliers Chutes Libres ont été portés par l’agence Premices and co fondée en 2012 avec Camille Chardayre et Amandine Langlois suite à une formation à l’École Boulle et une résidence d’un an à l’incubateur des Ateliers de Paris.
Les premiers ateliers ont eu lieu dans le cadre de l’exposition Matière Grise conçue par Encore Heureux Architectes au Pavillon de l’Arsenal. Nous y proposions des sessions de valorisation de chutes de bois, ateliers qui se sont prolongés après l’exposition et que nous avons ensuite proposé à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.
Par la suite, nous avons souhaité occuper un lieu permettant de stocker les matériaux récupérés et d’accueillir des publics pour des ateliers. Nous sommes installés au Viaduc des Arts depuis plus d’un an.
Quels sont vos matériaux et d’où proviennent-ils ?
Ce sont surtout des chutes de bois que nous collectons exclusivement auprès d’entreprises, dont le Pavillon de l’Arsenal et le Théâtre du Châtelet. Ces chutes sont de nature variée. Pour les expositions, le pin et le bouleau sont majoritairement utilisés.
Nous récupérons aussi de petits dépôts de cuirs, de tissus ou de sangles, qui proviennent de la Réserve des Arts et que nous utilisons pour concevoir des accessoires lors des ateliers.
Comment est organisé ce lieu ?
Par pôles. Au rez-de-chaussée, un lieu dédié à l’assemblage et à la finition, composé de grandes tables, de perceuses, de visseuses et d’une quincaillerie. Au sous-sol, un espace insonorisé qui accueille des machines de découpe comme une scie sauteuse et des scies circulaires sur table. À l’étage, nos bureaux.
Comment répartissez-vous votre agenda entre les ateliers et l’agence ?
Notre temps est généralement divisé en deux. Parfois, les projets des ateliers et de l’agence peuvent aussi se rejoindre. Par exemple, via Premices and co, nous avons travaillé sur un projet d’aménagement de bureaux et décidé d’utiliser les Ateliers Chutes Libres pour accueillir nos clients et leur proposer de concevoir certains meubles, ainsi qu’un logo à installer dans leurs bureaux.

Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn
Quelles activités proposez-vous aux publics ?
Différents formats d’ateliers, de 2 à 4 heures, à la fin desquels les participants repartent avec leur création : une table, une lampe, une chaise ou encore une petite étagère. Pendant la réalisation, nous les sensibilisons à la provenance des matériaux et à la notion de récupération. Au sein-même des ateliers, nous tentons de générer le moins de chutes de matériaux possible.
Comment avez-vous financé ces ateliers ?
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) nous a octroyé un soutien financier. Par ailleurs, nos ateliers sont payants pour les participants, qui ont accès au lieu, aux matériaux, aux machines et consommables, ainsi qu’aux conseils des encadrants.
Avez-vous de futurs projets ?
Nous souhaiterions proposer des ateliers plus individualisés, ainsi que des formats plus courts, qui permettraient aux participants de repartir avec de plus petits objets.
Aussi, pour le moment, le prix auquel proposons nos ateliers attire un public plutôt privilégié, en partie car le lieu coûte cher à la location. Nous recherchons donc des aides pour pouvoir en proposer à moindre coût et sommes aussi ouverts à des partenariats. Par le passé, nous avions notamment collaboré avec Paris Habitat et proposé des ateliers gratuits dans les espaces communs d’un immeuble.
Signalétique Nuit Blanche 2016 © Premices&Co
Pourriez-vous nous présenter certaines réalisations de l’agence ?
Chaque projet implique des contraintes différentes et donc des solutions différentes. De manière générale, nous allons toujours tenter d’avoir un impact moindre, en sélectionnant certains types de matériaux, en privilégiant le local, en réemployant du matériel ou en privilégiant la location à l’achat.
Par exemple, dernièrement, nous avons conçu l’accueil de la Mairie de Paris où figurait initialement un tribunal. Le mobilier originel étant de bonne qualité, nous avons proposé de le conserver en partie pour concevoir la banque d’accueil. Cela ne s’est pas prémédité à l’avance, mais s’est décidé en voyant les meubles existants, conçus dans un beau bois.
Pour la scénographie d’une petite exposition dans un kiosque entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, portant sur les travaux en cours dans ces deux lieux, nous avons utilisé des projecteurs inutilisés du Théâtre du Châtelet et des échafaudages de chantier, qui ont ensuite retrouvé leur fonction première.

La maison du chantier, Exposition Figures Marquantes, réalisation Jean-François Aimé et Premices&co © Benjamin Verlomme
Et pour la signalétique de Nuit Blanche 2016, nous avons réemployé des caisses de transport d’œuvres d’art, que créent parfois les musées pour un usage unique et qui étaient destinées à être jetées, afin de s’en servir comme balises repères le long de la Seine. Faciles à repérer et utiles pour protéger les programmes du vent et de la pluie.
Avez-vous été confrontés à une problématique de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le recyclage de la scénographie d’une exposition ?
C’est un point qui pose vraiment problème. Nous n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre d’un concours, pour lequel nous proposions de réemployer le mobilier existant et n’avons pas été retenus. Bien que cela se comprenne et soit lié à une peur du recours, il devrait exister des solutions, comme grouper des marchés de scénographie pour plusieurs expositions, ou de façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord.
Propos recueillis par Laurence Amsalem
#economiecirculaire
#developpementdurable
#atelierschuteslibres
https://atelierschuteslibres.com/
Image de vignette et image d'introduction : Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Éco-conception et réutilisation du mobilier d'exposition, ou écrire des histoires originales avec des phrases analogues…
Montage Tano Lops
- Développer la sobriété (en matériaux et consommation), en lien avec les artistes, des scénographies et spectacles,
- Produire des matériels scénographiques démontables pour faciliter la réutilisation ou le recyclage des éléments, et éviter d’avoir un principe constructif à usage unique,
- Promouvoir l’approvisionnement en matériels d’occasions, nécessitant en amont d’identifier les lieux où se procurer en biens de réemploi. Il faut aussi utiliser des matériaux intégrant une part de matière recyclée.
- Une incertitude sur leur qualité de réaction au feu au regard de l’absence de documentation ;
- Une incertitude sur le maintien des performances évaluées dans le cadre des essais réalisés lors de leur mise initiale sur le marché pour leur nouvel emploi, selon la durée de vie précédente et les éventuelles modifications subies.

Espace d’exposition temporaire, Palais des Beaux-Arts de Lille

Jacques Averna, Les Régies, crédit : Jacques Averna
Tano Lops-Maitte
POUR EN SAVOIR PLUS :
- Réemploi des éléments de scénographie et règlementation ERP : le défi juridique du secteur de la culture, Elisabeth Gelot : https://skovavocats.fr/reemploi-elements-scenographie-et-reglementation-erp/
- Association Les Augures : https://lesaugures.com/L-association
- Définir des modes de production écoresponsables dans les différents secteurs : l’éco-production et le réemploi dans les décors et la scénographie, Ministère de la Culture :
- https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/transition-ecologique/definir-des-modes-de-production-ecoresponsables-dans-les-differents-secteurs-l-eco-production-et-le-reemploi-dans-les-decors-et-la-scenographie
- Retour sur l’exposition « Matière grise – matériaux, réemploi, architecture », Ville de Nice :
- https://cultivez-vous.nice.fr/exposition/forum-durbanisme-et-darchitecture/retour-sur-lexposition-matiere-grise-materiaux-reemploi-architecture/
- La Forêt magique, une exposition écologique pensée comme une ode à la forêt ! https://www.grandpalais.fr/fr/article/la-foret-magique-une-exposition-ecologique-pensee-comme-une-ode-la-foret#:~:text=à%20la%20forêt%20!-,La%20Forêt%20magique%2C%20une%20exposition%20écologique%20pensée,une%20ode%20à%20la%20forêt%20!&text=Nous%20plonger%20au%20coeur%20de,jusqu'au%2019%20septembre%202022%20!
- PDF RESTITUTION DU WORKSHOP, CONSTRUIRE LA DURABILITÉ DE NOS MUSÉES, Ville de Lille https://pba.lille.fr/content/download/6162/71025/file/WORKSHOP_Programme+complet.PDF
- DOSSIER TECHNIQUE DE STANDARDISATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCORS DU COLLECTIF 17H25 : https://www.uniondesscenographes.fr/documentation/eco-conception/dossier-technique-de-standardisation-delements-de-decors-du-collectif-17h25/
[1] The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition Francis Haskell
[2] Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées Métropolitains-Rouen Normandie
[3] Éco-conception : effort de conception portant sur l’ensemble de la chaîne de production d’une exposition (commissariat, scénographie physique et digitale, communication, action et accueil du public, édition, outils numériques) visant à réduire son impact environnemental et à maximiser son impact social en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des matériaux mobilisés.
[4] Article R*123-5 - Code de la construction et de l'habitation : Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
[5] Adeline Rispal, Architecte scénographe (Ateliers Adeline Rispal), Présidente d’XPO, Fédération des Concepteurs d’Expositions
#réemploi #scénographie #création

Exposer ce qui ne se voit pas : « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris
L'exposition « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris explore l'évolution de l'intimité en Occident, du XVIIIᵉ siècle à nos jours, à travers plus de 470 œuvres et objets. Présentée du 15 octobre 2024 au 30 mars 2025, elle est co-organisée par Christine Macel, conseillère scientifique et artistique du musée ainsi que par Fulvio Irace, historien de l'art et du design.
La scénographie, conçue par l'architecte italien Italo Rota, débutait par un trou de serrure géant, symbolisant l'entrée dans l’exploration de l'intimité. Le parcours est structuré en douze thèmes répartis dans un enchaînement de quatorze salles, abordant des sujets tels que la frontière entre espace public et privé, la fluidité des genres, l'identité, la promiscuité et la surveillance.
L'exposition présente peintures, photographies et pièces de design emblématiques mais encore une diversité d'objets quotidiens moins valorisés dans les musées, tels que des bidets, miroirs, carafes, etc. Elle retrace la transformation des espaces intimes, depuis les chambres à coucher du XVIII ème siècle jusqu'aux lits connectés contemporains, illustrant comment les évolutions sociales et technologiques ont façonné notre rapport à l'intimité. L'exposition souligne également le rôle crucial des femmes dans la redéfinition de l'intimité, en s'affranchissant des rôles domestiques traditionnels qui leur étaient attribués. Enfin, elle aborde la manière dont les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont bouleversé les frontières entre vie privée et vie publique, posant la question de la privatisation de l'intime et des nouvelles vulnérabilités engendrées.
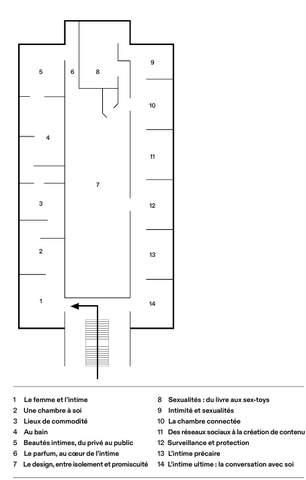
Plan de l'exposition © E.V.
À travers une progression spatiale et thématique, l'exposition interroge la domestication des pulsions, la surveillance, le rôle du design et la précarisation de l'intime : le parcours débute dans le salon, un lieu où se croisent à la fois la vie familiale et la sociabilité. Avec l'avènement de la bourgeoisie au XIXème siècle, le contrôle social et les normes de pudeur redéfinissent les usages domestiques. La progression du parcours conduit vers des espaces plus privés. Cette distinction entre espaces publics et privés s'affirme : la maison devient un espace réglementé, où chaque pièce a une fonction déterminée. La chambre, autrefois privilège aristocratique, devient un espace distinct pour chaque individu dans l'habitat bourgeois du XIXème siècle. La création de la « chambre à soi », concept popularisé par l'écrivaine britannique Virginia Woolf dans son essai publié en 1929, notamment pour les jeunes filles et les adolescent∙e∙s, marque un tournant dans la structuration de l'espace domestique. Aujourd'hui, la chambre est à la fois un refuge et un espace connecté, transformé par la technologie en lieu de travail, de loisirs et d'exposition de soi.

Le tableau « Le Sommeil », d’Edouard Vuillard (1862) mis en parallèle à un lit du XX ème siècle © E.V.
Puis de la chambre, direction la salle de bain, dédiée au soin du corps. Cette pièce, qui se répand progressivement dans les maisons au cours du XXème siècle, pose la question du rapport entre intime et injonctions sociales. Se maquiller, se parfumer, utiliser des soins esthétiques sont-ils des actes individuels ou résultent-ils d'une pression extérieure ? Les objets exposés, du rouge à lèvres d'apparat aux masques LED contemporains, illustrent la normalisation et la popularisation des pratiques cosmétiques. Les parfums, pouvant être sentis grâce à un dispositif olfactif, sont des créations entre proximité et diffusion, une autre manifestation de la dualité entre expression de soi et interaction avec autrui.

Masques LED en vitrine © E.V.
S’en suit un large espace qui présente la manière dont le design intérieur façonne le rapport à l'intime et à la collectivité. À travers une sélection de mobiliers et de concepts architecturaux, elle questionne l'évolution des espaces domestiques entre convivialité et repli sur soi. Dans les intérieurs du passé, les contraintes économiques, les défis liés au chauffage et les dynamiques familiales et sociales favorisaient une intimité partagée et une vie collective. Les lits clos bretons, par exemple, permettaient de conserver la chaleur et d'offrir un espace de sommeil commun, tandis que les tatamis japonais structuraient des pièces polyvalentes où les membres de la famille cohabitaient étroitement. En revanche, durant les années 1970-1980, influencés par le postmodernisme, les designers tendent à privilégier la séparation et l'individualisation des espaces, reflétant une évolution vers une plus grande valorisation de la vie privée et de l'autonomie individuelle, liée à une demande croissante de personnalisation de la part des jeunes générations de consommateurs. Des meubles cocons aux canapés-œufs, les designers explorent aujourd’hui de nouvelles formes d’isolement volontaire. Ces tendances reflètent des mutations sociales profondes, entre désir d’intimité et crainte de l’enfermement, et questionnent notre manière d’habiter l’espace domestique dans un monde de plus en plus connecté, fortement impacté par la crise sanitaire.

Salle 7 : « Le design, entre isolement et promiscuité » © E.V.
L’espace suivant, déconseillé aux plus jeunes, aborde la question des sexualités, longtemps réglementées et censurées. Si le XVIIIème siècle libertin tolère les images érotiques dans un cadre masculin, le XIXème siècle bourgeois opère un retour à la moralisation et à la répression des sexualités « déviantes ». La reconnaissance du plaisir féminin, la révolution sexuelle et l'émergence massive des sex-toys à partir des années 1960-1970 marquent une rupture, bien que les objets du désir restent soumis aux normes du genre. L'exposition montre comment les designers du XXIème siècle réinventent ces objets pour répondre aux besoins d'une diversité de sexualités, en dépassant les conceptions hétéronormées.

Salle 12 : « Surveillance et protection » © E.V.
Cependant, l’arrivée du numérique a bouleversé la notion de sexualité et avec elle, celle de l'intimité. Autrefois espace d'introspection, elle est aujourd'hui mise en scène sur les réseaux sociaux, les téléréalités, où se construisent des identités publiques souvent paradoxales. Les témoignages de plusieurs créateur∙ice∙s de contenu, confronté∙e∙s à une exposition permanente volontaire de leur existence, interroge la distinction entre présence virtuelle et réalité intime. Dans une pièce couverte de caméras de tous types, les dynamiques d'autosurveillance et de construction de soi à travers les technologies numériques sont mises en évidence. Les dispositifs de reconnaissance faciale, de géolocalisation et les bases de données définissent de nouvelles frontières entre sphères publique et privée. En contrepoint, quelques stratégies de résistance sont présentées, du masquage numérique à l'anonymat militant, qui cherchent à rétablir un certain contrôle sur les données personnelles.
L'exposition s'achève sur une réflexion sur la privation d'intimité en situation de précarité. L'absence d'un espace à soi, qu'il s'agisse des sans-abris, des migrants ou des prisonniers, met en évidence le lien fondamental entre intimité et dignité. Les dispositifs architecturaux présentés, comme un banc inspiré de l’architecture hostile au milieu de la pièce, tentent d'y répondre en offrant des solutions adaptées aux populations vulnérables : la création d’une fragile illusion d’intime. Si l'intimité physique et sociale est fluctuante, l'exposition rappelle en dernier lieu qu'il subsiste un « intime ultime », celui de la pensée et de l'imaginaire. L'écriture, de la pratique du journal intime aux blogs contemporains, témoigne de cette irréductibilité de l'espace personnel. Les visiteur∙ice∙s étaient ainsi invité∙e∙s à répondre dans un journal partagé à la question « Qu’est-ce que l’intime ? », pouvant faire le choix de laisser un indice de leur identité ou non. Ces journaux seront conservés dans les archives de l’exposition, gardant la mémoire de ces réponses intimes.
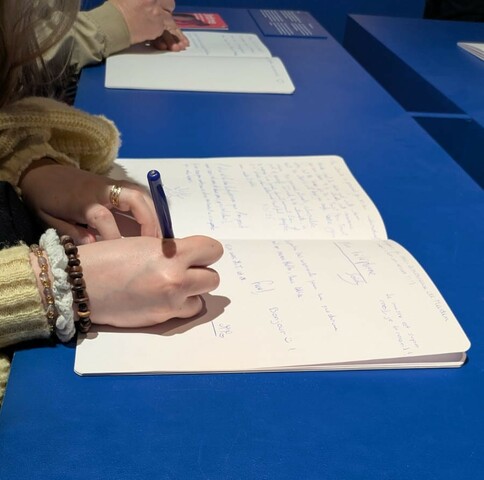
Les visiteur∙ice∙s se prennent au jeu et écrivent dans les journaux pour répondre à la question « Qu'est-ce que lintime ? » © E.V.
En 2025, alors que l'intimité est sans cesse mise à l'épreuve par la surveillance, la marchandisation et l'exposition médiatique, cette part inaliénable de soi constitue un refuge. Ainsi, l'exposition interroge non seulement les mutations de l'intime, mais aussi les moyens de le préserver, en explorant la tension constante entre dévoilement et protection, entre individualité et construction sociale.
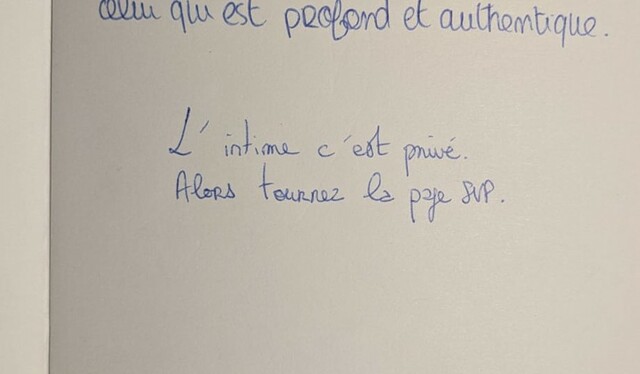
Une amusante réponse © E.V.
Éléa Vanderstock
|
#L'Intime #MuséeArtsDécos #ConstructionSociale |
Knock Outsider Komiks
Des bandes dessinées créées à partir du textile, impressions 3D, photographies, monotypes, gravures, abstractions, vidéos d'animation… ? C’est par ici !
Knock Outsider Komiks, un projet de La « S » Grand Atelier qui lie la BD à la création outsider¹, crée à la demande du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, est maintenant exposé au Art et marges musée à Bruxelles².
Installation des gravures sur bois et du court-métrage d’animation Après la mort, après la vie, un projet de mixité entre Adolpho Avril & Olivier Deprez © L.M.
Le Art et marges musée, musée d'art brut et art outsider, est consacré à la conservation, à la recherche et à la diffusion des créations en dehors du circuit traditionnel artistique, questionnant l’art et ses frontières. Une partie importante de sa collection s’est constituée auprès d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental, dont La «S » Grand Atelier.
Situé à Vielsalm dans les Ardennes belges, La «S » est un laboratoire de recherche artistique qui accueille des artistes atteints d'une déficience mentale et des artistes non-déficients qui viennent en résidence. En sortant du discours de la « sanctuarisation » de l'art brut/outsider, au lieu d'isoler les individus en marge de toute sorte d'influences extérieures, le but de La « S » est justement le contraire. Loin de toute considération compassionnelle, positionnement emphatique de la structure, elle se singularise par sa volonté d'intégration, de rendre possible des rencontres et d’interagir avec tous les champs de l’art actuel. Dans cette perspective, à partir des résidences où artistes handicapés ou non échangent,expérimentent et créent ensemble, naissent des projets complètement étonnants et singuliers, notamment dans la BD.
La bande dessinée a connu des évolutions radicales ces dernières années sous l'impulsion des maisons d'éditions indépendantes ou alternatives, dont Frémok fait partie. Thierry Van Hasselt est l'un de ses fondateurs et également co-commissaire de Knock Outsider Komiks. Selon lui, « le Frémok envisage la bande dessinée d'une manière plus large. Pas une espèce de langage avec des règles définies, mais plutôt un terrain d'exploration, un terrain de jeu, un milieu en expansion qui essaie toujours de recréer les limites et les frontières de la BD, qui s'intéresse à la mixer avec d'autres domaines, à la faire sortir de ses cadres habituels. »
Anne-Françoise Rouche, directrice de La « S », avait trouvé des similitudes entre le travail des artistes de la structure et celui de Frémok. En réunissant l'aspiration de La « S » de s'ouvrir vers l'extérieur et vers le développement de la bande dessinée alternative, et la perpétuelle recherche des nouvelles formes de la part du Frémok, leur connexion était inévitable, sur un terrain qui n'était pas encore exploré.
Les cases de BD redessinées et agrandies par Jean Leclercq © L.M.
La bande dessinée et l'art outsider : une rencontre improbable ?
Selon Erwin Dejasse, également co-commissaire de Knock Outsider Komiks et historien de l’art, sous un premier regard l’articulation entre bande dessinée et art brut semble un lien improbable : « A priori, tout oppose la bande dessinée et les créations brutes ou outsider. La première est souvent présentée comme un langage dont la pratique exige la maîtrise d’un ensemble de codes voire d’un vocabulaire et d’une grammaire. Les secondes, au contraire, semblent se définir par leur totale absence de règles. »
La BD comprend tout ce qui est narratif et anecdotique. L'anecdotique est également présent dans l'art brut/outsider. La dimension narrative, en revanche, reste moins évidente lorsqu'une forte caractéristique dans les outsiders est notamment l'hermétisme. Le défi était donc de voir ce qui pourrait se passer si on mettait en relation les artistes de La « S », qui étaient plasticiens et qui travaillaient cette grande liberté graphique, et ceux du Frémok, qui ont l'habitude de manipuler narration et récit.
Thierry Van Hasselt témoigne de cette expérience : « À La « S » on pensait au départ du projet qu'on allait nous (le Frémok) ramener cette dimension narrative et construire du récit avec le matériel graphique qui amenait les artistes handicapés. Pourtant ça a été tout à fait une autre chose qui s'est passée. Leur poésie et leur manière d'être, de s'exprimer et de raconter des choses a complètement contaminé le travail narratif. Et ce que nous a complètement transformé lors de ce projet c'était justement quel type de narration cette rencontre nous permettrait d'explorer et de découvrir. Et donc nous aussi avons appris à raconter autrement en travaillant dans ce projet de mixité et cela nous a permis de mettre en place d'autres types de dispositifs narratifs. Sur Knock Outsider Komiksla narration était vraiment générée à quatre mains. »
Créations textiles, photographies et le «ciné-roman » Barbara dans les bois, un projet de mixité entre Barbara Massart& Nicolas Clément © L.M.
Erwin Dejasse complète : « Knock Outsider Komiks montre des artistes qui vont être à la fois plus qu'au limite de la bande dessinée. On peut se questionner si une création est de la BD et parfois la première réponse est non, même s'il y a des éléments en commun. Mais on sent qu'il y a un état d'esprit similaire, il y a des choses qui dialoguent. On ne s'arrête pas de poser des questions entre les limites de la BD et de l'art outsider, mais autant pour cette exposition il fallait se laisser aller, de faire au feeling. Donc on montre une photographie de ce qui a été produit à La « S » au long de ces années de résidence, plutôt orientée vers quelque chose qui touche à la BD. Mais on ne va pas arrêter de déborder ce domaine pour autant qu'il n'y aie pas une définition de bande dessinée que ne puisse être débordée des frontières instituées. »
Knock Outsider Komiks dans les murs du Art et marges musée
À Angoulême, La « S » a mis en place une exposition de qualité qui a connu énormément de succès. Néanmoins, la courte durée du festival - 4 jours - a laissé une envie d'aller plus loin et de rendre Knock Outsider Komiks accessible à un plus large public. Anne-Françoise Rouche a donc proposé à la direction du Art et marges musée, collaborateur de longue date, de l'exposer dans ses murs pou rune deuxième édition, quelque peu différente.
Tatiana Veress, directrice du Art et marges musée, s'est montrée enthousiaste du projet : « Il y a cet aspect collaboratif qui correspond à la philosophie du musée depuis ses débuts, de faire des expositions qui présentent à la fois des artistes outsiders et des artistes insiders sans le besoin de préciser que l'artiste est in ou que l'artiste est out. »
Exposer Knock Outsider Komiks au Art et marges musée correspond également à l'envie de présenter des dialogues entre l'art outsider et les différents domaines de l'art en ne se limitant pas aux arts plastiques, mais de pouvoir toucher le cinéma, la musique, la photographie... et la bande dessinée fait partie de cette ouverture.
Sur le mur à gauche, les monotypes de Pascal Cornélis. À droite, Comix Covers, de Pascal Leyder © L.M.
Par ailleurs, faire venir cette exposition à Bruxelles est très important car la Belgique porte une identité particulière par rapport à l'histoire, à la reconnaissance et au constant développement de la bande dessinée. La BD est très présente dans la culture belge avec des grands éditeurs, des structures, des librairies spécialisées, un Musée de la BD, des personnages partout sur les murs des villes... Tous ces aspects font que dès qu'on parle de BD en Belgique, on rencontre une réceptivité singulière.
Tatiana Veress précise : « On présente la bande dessinée, mais c'est un "uppercut aux catégories instituées". Donc le visiteur qui vient en se disant "je vais visiter une exposition de bande dessinée" sera forcément déstabilisé. Et c'est cet aspect de déstabilisation qui est intéressant. Il y a des œuvres qui sont très proches de la BD, qui recréent ses cadres, par exemple, mais déjà avec des codes un peu différents, une certaine liberté naïve. Sinon il y a des choses qui sont apriori fort éloignées de la BD, où on est dans des œuvres très abstraites. Dans ce cas, c'est plutôt le principe sériel, l'accumulation et la séquence qui évoquent l'idée de la narration existante aussi dans la BD contemporaine. Donc on est plus proche d'un univers plus alternatif qui présente une nouvelle génération de bande dessinée. Et en même temps on a encore un regard en marge parce que dans l'exposition on intègre des artistes qui ne viennent pas du monde de la BD et qui ne viennent pas non plus du monde de l'art officiel.
Et à chaque fois qu'on travaille avec une thématique particulière c'est l'occasion de toucher des nouveaux publics. La possibilité d'aller à la rencontre d'un public plus amateur de bande dessinée qui pourrait découvrir l'art brut, qui ne la connaissait pas auparavant, cela joue en faveur de notre objectif de faire connaître ces artistes et l'art brut de façon plus large. »
Ateliers Créatifs pour les publics
Le Art et marges musée possède également un espace ouvert au public dédié à l'Atelier Créatif où les visiteurs sont invités à s'exprimer d'après ce qu'ils ont regardé et ressenti dans l'exposition. Dans le cadre de Knock Outsider Komiks, le sujet abordé par l'atelier concerne la narration et les différentes techniques graphiques.
« Lorsque l'exposition met en avance des projets menés en collaboration, l'idée est de construire une histoire ensemble, à plusieurs mains et à plusieurs techniques. Dans l'atelier on trouve des grandes feuilles de papier accrochés sur les cimaises avec des cases pré-dessinées où chacun peut apporter sa contribution plastique dans ce qui deviendra une narration, ou pas. En tout cas, qui aura une allure de planche de bande dessinée. », affirme Sarah Kokot, responsable des publics du Art et marges musée. « Et dans ce qui concerne l'activité prévue pour les enfants, l'idée est d'aborder la gravure et comment elle est faite. Il y aura des créations à partir des décalques en feuilles de carbone et du monotype à la gouache. »
L'Atelier Créatif du Art et marges musée pour l'exposition Knock Outsider Komiks © L.M.
Rencontres autour de l’exposition
Afin d'élargir le débat sur la bande dessinée et l'art outsider, le Art et marges musée, La « S » Grand Atelier et l'ISELP (Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique) organisent encore des conférences et des visites guidés autour de Knock Outsider Komiks.
Art Brut et bande dessinée : influences, convergences et sympathies sera une conférence présentée par Erwin Dejasseet Voyage à FranDisco une conférence-performance réalisée par Marcel Schmitz (artiste de La « S ») et Thierry Van Hasselt sur leur projet de mixité homonyme³.
Luana Medeiros
#BandeDessinée
#BDalternative
#ArtOutsider
¹ L’art outsider désigne la création en dehors du circuit traditionnel de l’art. Elle englobe des créateurs marginaux, des autodidactes, souvent provenant d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental ou du milieu psychiatrique.
² Infos pratiques Knock Outsider Komiks
Exposition du 29 septembre 2017 au 28 janvier2018
Art et marges musée
Rue Haute 314, Bruxelles
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.Fermeture les lundis et les jours fériés officiels.
³Infos pratiques des rencontres
Jeudi 9 novembre 2017
A L’iselp, 18h30-19h45 : Conférences d’Erwin Dejasse, Marcel Schmitt et Thierry Van Hasselt.
Au Art et marges musée, 20h15 : Visite guidée de l’exposition en compagnie des commissaires.Plus d'informations:
http://www.lasgrandatelier.be/
Remerciements à Erwin Dejasse, Sarah Kokot,Thierry Van Hasselt et Tatiana Veress qui ont été interviewés afin de collaborer sur cet article.
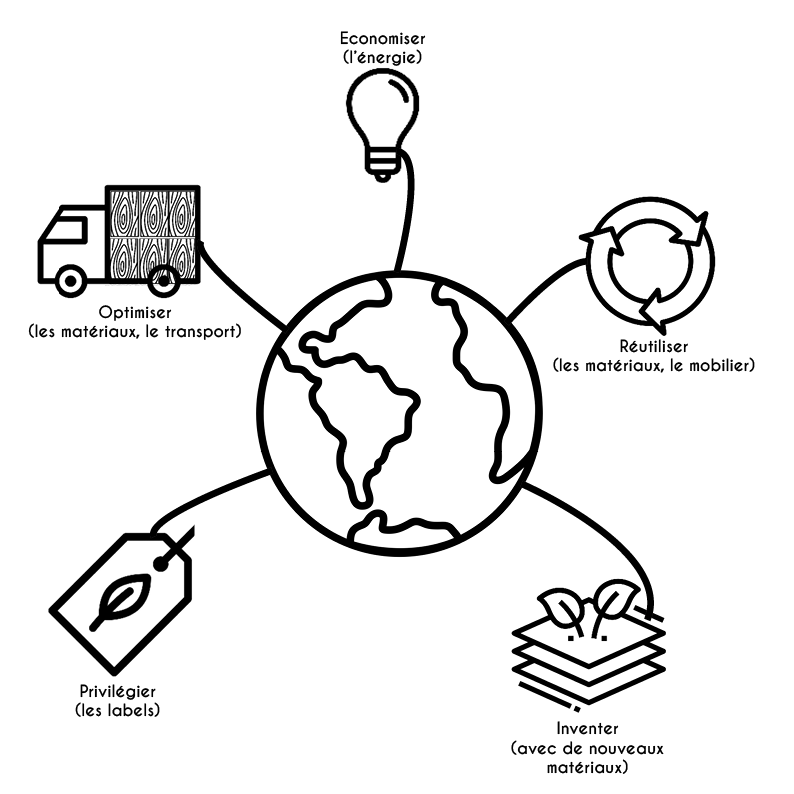
L'avenir écologique de la scénographie d'exposition - post Covid
“Sans doute faut-il redessiner notre manière d'habiter le monde. On ne peut plus continuer sur la lancée actuelle, même en usant de prouesses technologiques. On ne peut plus autant se déplacer. On ne peut plus autant renouveler. On ne peut plus autant gaspiller. On ne peut plus autant tuer. Nous n'avons pas vraiment d'autres choix que d'accepter cette évidence.”
Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité -
édition Michel Lafon, 2019
À l’heure où j’écris, je devrais être en stage, à imaginer des scénographies pour des expositions et des musées.
Sauf que je suis sur ma terrasse, en train de relire Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité”d’Aurélien Barrau, paru en 2019. En pleine crise du coronavirus, le pays est à l’arrêt et la nature reprend quelque peu ses droits.
Je fais des efforts dans mon quotidien, j’ai choisi un métier qui pourtant pollue : construire pour l'éphémère, être outil de spectaculaire, utiliser des matériaux nocifs et autres substances chimiques. Bien sûr ce n’est rien comparé aux industries du textile et agro-alimentaire, mais quand cet outil est censé éduquer et être au service du visiteur, je remets en question son utilité. Comme j’ai le temps de réfléchir, je me suis interrogée sur les solutions alternatives qui existent ou qui existeront peut-être après cette crise, celles qui ne sont pas enseignées en école en Design, en espérant qu’il y ait une prise de conscience d’un point de vu global.
Créer revient-il à polluer ? Quels sont les différents impacts d’une exposition ?
La scénographie tient une place centrale dans une exposition. Je ne le dis pas parce que je suis une fervente défenseure de ce métier mais parce qu'elle permet de donner vie au travail de muséographie dans un espace. Mais elle a aussi une place centrale dans l’impact écologique qu’aura le projet.
Voici le trajet d’une planche de contreplaqué issu du système classique : la matière première, le bois donc, et extrait, généralement dans des “plantations” cultivées à cet effet. Puis le bois est transformé pour lui donner sa forme de planche, pour cela on utilise de l'énergie. Ensuite, la planche et ses consœurs sont acheminées dans des camions vers le lieu de chantier, ce qui provoque des émissions de gaz à effet de serre. Cette planche n’est généralement pas à nu, on la revêtue par la suite de peinture, de colle… qui sont des produits toxiques. Enfin, une fois l’exposition assemblée, le lieu doit être prêt pour accueillir le public et mettre en avant le propos, on utilise à nouveau de l’énergie pour chauffer et éclairer l’espace.
Bien sûr cela n’est pas que l'apanage de la scénographie. Mais avec l’accroissement des expositions temporaires, d’une durée variable de 3 à 6 mois, le coût écologique est important.
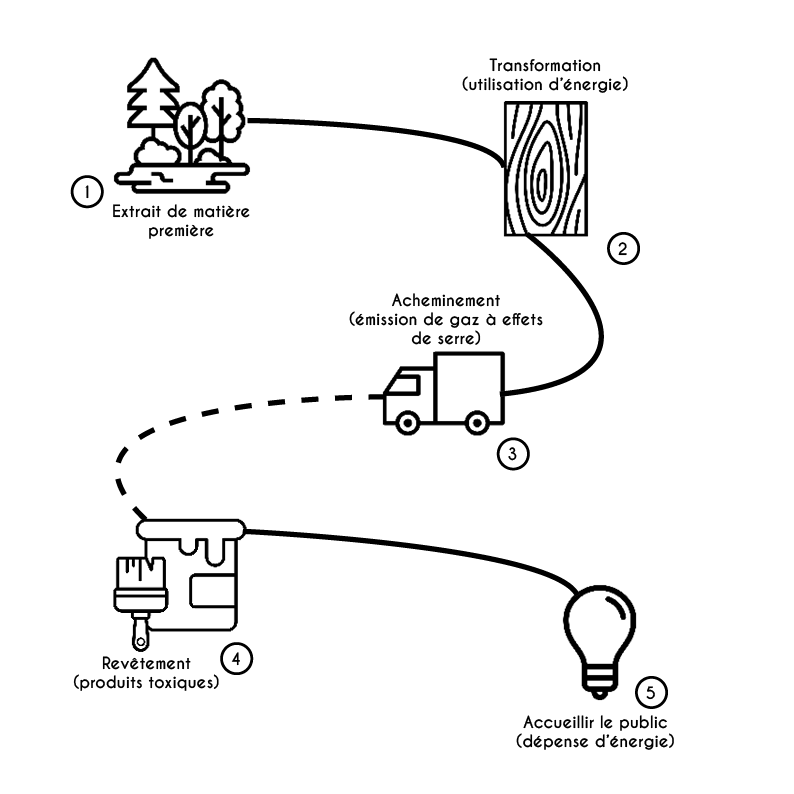
Illustration ©JD
Les lignes bougent
Il faut tout d’abord préciser que les enjeux soulevés par le développement durable sont fondamentaux et liés à l’avenir de notre société.
Le problème donc avec l’éphémère c’est son coût écologique important sur une courte durée et le gâchis de matériaux. A moins de rentabiliser un maximum l’exposition et de la faire voyager sur une longue période, ce qui pose aussi des soucis de transport et de Co2.
La BNF a publié en 2011 un guide de scénographie et développement durable, appelé Projet Coal. Même si il date de bientôt dix ans, il est encore aujourd'hui extrêmement d’actualité et offre des solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact écologique sur notre environnement. Parmi celles-ci, il est préconisé d'optimiser les matériaux et l'énergie dès la phase conception du projet, de privilégier les labels et des encres sans solvants pour l’impression. Cela est déjà ancré dans le processus de création scénographique, l’optimisation à un rôle important d’un point de vue économique.
Il est maintenant possible d’utiliser des matériaux alternatifs, tel que le carton, le tyvek, ou des matériaux recyclés. Un concept créé il y a quelques années dans l’événementiel s’est développé dans la scénographie d’expositions temporaires: la scénographie en palettes L’une des premières expositions réalisées par le Master MEM en 2013, L’Objectif en coulisses, faisait usage de palettes comme éléments scénographiques. Le dernier exemple en date est l’exposition Liaisons vitalesau Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, conçue entièrement en palettes louées à des entreprises spécialisées, puis récupérées pour servir un autre projet. Certaines agences de designer ont même fondé leurs principes de création sur le recyclage.

Exposition Ionesco, mobilier scénographique en carton ©BNF

Exposition Liaisons vitales, Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, © La voix du nord
Le sujet de l’exposition a aussi son rôle dans l’éco-conception de l’exposition. Certains sujets se prêtent mieux au développement durable, et plus d’efforts sont faits de la part des organisateurs en ce sens. Les musées de sciences et muséums sont généralement les plus concernés et ceux qui choisissent une démarche écologique dans chaque projet, sans doute car leurs expositions font souvent l’objet de scénographies plus variées.
Repenser la fin de vie d’une exposition
Là où ça coince (mais ça commence à bouger !), c’est au moment du démontage de l’exposition et de la fin de vie du mobilier scénographique. Ce processus est très rarement pris en compte dès la conception du projet, pourtant il est tout aussi important que l’ensemble des choix faits précédemment. Actuellement, le mobilier est soit entreposé, soit mis à recycler (si cela est possible). Or si on s'appuie sur les principes du zéro déchet Refuse, Reduce, Reuse, Recycle ( refuser, réduire, réutiliser, recycler,), la réutilisation est à privilégier, et le recyclage arrive en bout de chaîne. Pourquoi réutilise-t-on si peu le mobilier scénographique ? Parce que l’œuvre appartient à son auteur, et qu’une clause dans le droit à la propriété intellectuelle interdit la réutilisation du mobilier. Mais la plus grosse difficulté reste le stockage de ces mobiliers.
Pourtant certains musées ont instauré la réutilisation dans leur cycle de conception d’exposition. Le MNHN le fait déjà, et lorsque ce n’est pas possible, propose son mobilier à la Réserve des Arts, une recyclerie qui distribue ensuite ces mobiliers aux étudiants en art.
Il serait urgent de rendre systématique le réemploi de certains éléments scénographiques, en l'imposant dans le cas des marchés publics, et ainsi de mettre à disposition une liste de matériel disponible. Cela implique aussi de repenser la scénographie non pas comme une seule exploitation mais pour un cycle d’expositions.
Pourquoi ne pas proposer une banque de mobiliers scénographiques, et de rémunérer des groupements pour les gérer, tels que l’association des scénographes? Ou dans un réseau de musées ?
Les initiatives viennent aussi des designer, pour voir au-delà des principes de l’éco-conception, à l’image des Rad!cales, qui s’adressent aux professionnels de la création et à leurs partenaires. Ils militent pour un design radical et responsable face à l’urgence climatique et sociétale, en mettant en communs les ressources de chacun.
Less is more
Peut-être serait-il temps de repenser le système de création d’une exposition ? Le principe de location est intéressant pour ce qui est de rentabiliser une scénographie et de prolonger sa durée de vie. Des institutions comme le Mémorial de la Shoah ou l’Institut du monde arabe ont un service d’itinérance mais les expositions ont la forme simple de panneaux. Les centres de cultures scientifique, techniques et industriels sont plus ambitieux et proposent des expositions à la location adaptées à l’espace à disposition, à l’image du MNHN ou d’Universcience.

Exposition Viral présenté au Forum des sciences de Lille, produit par Ciencia Viva et Pavilhão do Conhecimento avec Universcience et Heureka ©JD
Mais cela reste très minoritaire. Pourquoi ne pas penser moins mais mieux ? Less is more, célèbre maxime de Mies Van Der Rohe, qui était architecte et designer.
En prenant exemple sur la Suède et son Riksutställningar ( en gros: un établissement public pour concevoir des expositions itinérantes), il serait possible de créer un groupement de musées pour concevoir des expositions itinérantes. Chaque année, des moyens seraient concentrés sur une exposition importante, au lieu de plusieurs petites expositions, pendant que les anciennes expositions seraient rentabilisées dans différents musées appartenant au groupement.
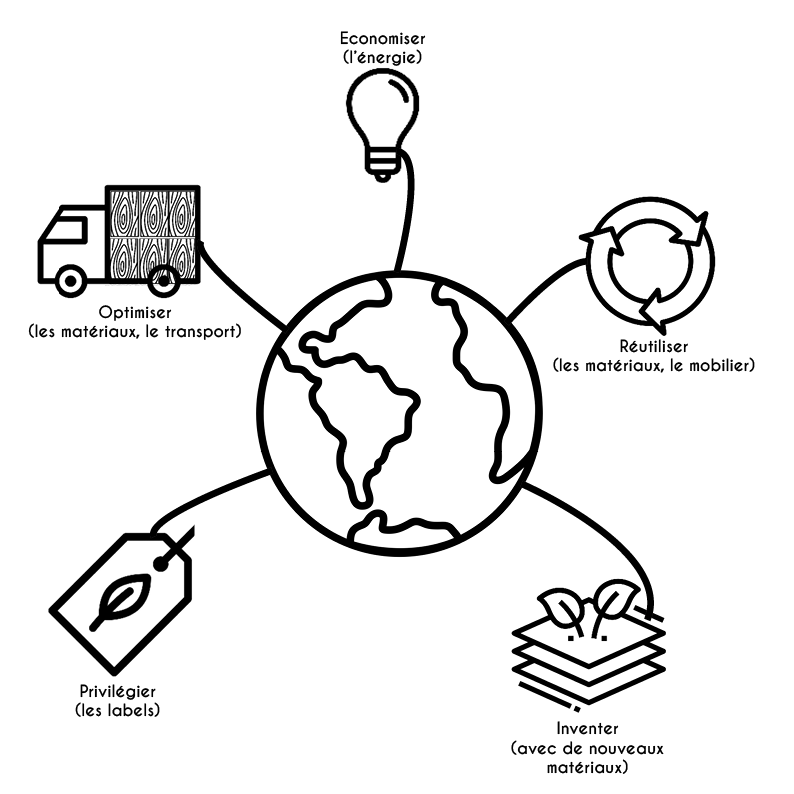
Illustration ©JD
Et si tout disparaissait ?
Et si, dans une vision pessimiste et post-apocalyptique, on imaginait très probable la disparition des expositions, des lieux publics. Avec la crise économique qui se profile, ou sera la priorité de financement ? Comment va évoluer notre système ? Opter pour plus de numérique ?
Tout reste encore très flou, mais l’ICOM et l’OCDE se sont penchés sur le sujet, je vous invite à lire le résumé ici si ce n'est déjà fait.
Juliette Dorn
#scénographie
#écoconception
#les rad!cales
Pour aller plus loin : http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf
http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf
Manifeste Les Rad!cales
https://mcusercontent.com/28599b64a04cac8ef53cd3c68/files/ae5908c4-83da-4c22-ae7d-3714f258244f/LES_RAD_CALES.pdf

L'exposition du futur ?

L’église Saint-Pierre du site Le Corbusier, ©JD
L’idée d’une exposition qui explore le futur
…et c’est réussi !

Le jardin des attachements, ©JD
Mais, faire une expo, c’est écolo ?

Atelier « retissez la ville » où les visiteurs brodent sur des photos de l’ère industrielle les aménagements qui permettraient un futur enviable, ©JD

Les casiers de piscine et le support de cartes postales achetés sur Leboncoin, ©JD
Mais la responsabilité environnementale d’une exposition ne passe pas uniquement par la scénographie. Le catalogue de l’exposition par exemple se constitue uniquement de six feuilles A3, glissées dans une enveloppe kraft qui a été sérigraphiée à la main par l’équipe. Chacune de ces feuilles est née d’une réflexion entre un graphiste qui a réalisé le recto, et un écrivain novice (architecte, habitant, enfant, mais aussi le nouvel acheteur du catalogue) qui occupe le verso grâce à ses mots. Chaque binôme a traité l’un des six thèmes, ce qui permet aux visiteurs d’avoir une vision encore différente que celles qu’il a pu lire ou entendre dans l’exposition.
En savoir plus :

L'infiniment petit désormais à portée de mains
Vous aviez un doute sur la vivacité des fourmis, leur organisation, leur taille, leur nombre, leur mode de vie, leur reproduction, leur alimentation … ? L’exposition Mille Milliards de Fourmis du Palais de la découverte saura vous répondre. Elle a été inaugurée le 15 octobre 2013 et fermera ses portes le 24 août 2014.
Qui n’a jamais mis d’anti-fourmi au bord d’une fenêtre ou jouer les aventuriers explorateurs en faisant un chemin de confiture à la fraise à la belle saison ? Nous sommes toujours subjugués par le monde du petit, de l’inconnu. Plus qu’une simple exposition sur les fourmis, le Palais de la découverte rend accessible ce monde si petit et pourtant si grand, si familier et pourtant si méconnu.

Fourmis découpant une orange pour aller nourrir
les larves de la fourmilièreObservées à travers une loupe.
Crédits : Léa PECCOT
Des fourmis vivantes sont présentées tout au long del’exposition. Des fourmilières entières sont recrées. Pourtant les concepteurs sont allés plus loin. L’exposition se veut accessible à tous les publics. Les textes sont courts, les termes simples et bien expliqués. Les caractères sont grossis, les films sont traduits en Langue des Signes Françaises, les modules sont adaptés à la hauteur d’un fauteuil roulant. Accessibilité, donc.
Le public déficient visuel est sans doute le plus difficile à conquérir quand il s’agit d’observation. De nombreux schémas et maquettes tactiles rendent palpable le monde des fourmis au public déficient visuel. Pource qui est des textes, le choix opéré est celui du braille. Il peut être discuté et discutable. En effet, la proportion de personnes atteintes de cécité lisant le braille est plus que fine, elle avoisine à peine 1,3 % [1] et les personnes atteintes de cécité au cours de leur vie ont plus de difficultés à apprendre ce procédé de lecture. C’est donc une faible part de la population qui est concernée et pourtant c’est un choix très judicieux, bien que coûteux. On peut certes se poser la question de savoir pourquoi privilégier autant un public si peu nombreux. Si peu de personnes lisent le braille, on observe toutefois dans l’exposition que nombreux sont les visiteurs, voyants, qui le remarquent et le touchent. Les voyants perçoivent très bien que le site où ils se trouvent est réfléchi et adapté. Là, est toute la question de l’accessibilité au public déficient visuel. Ce public peut être accompagné de personnes voyantes pour une visite partagée.
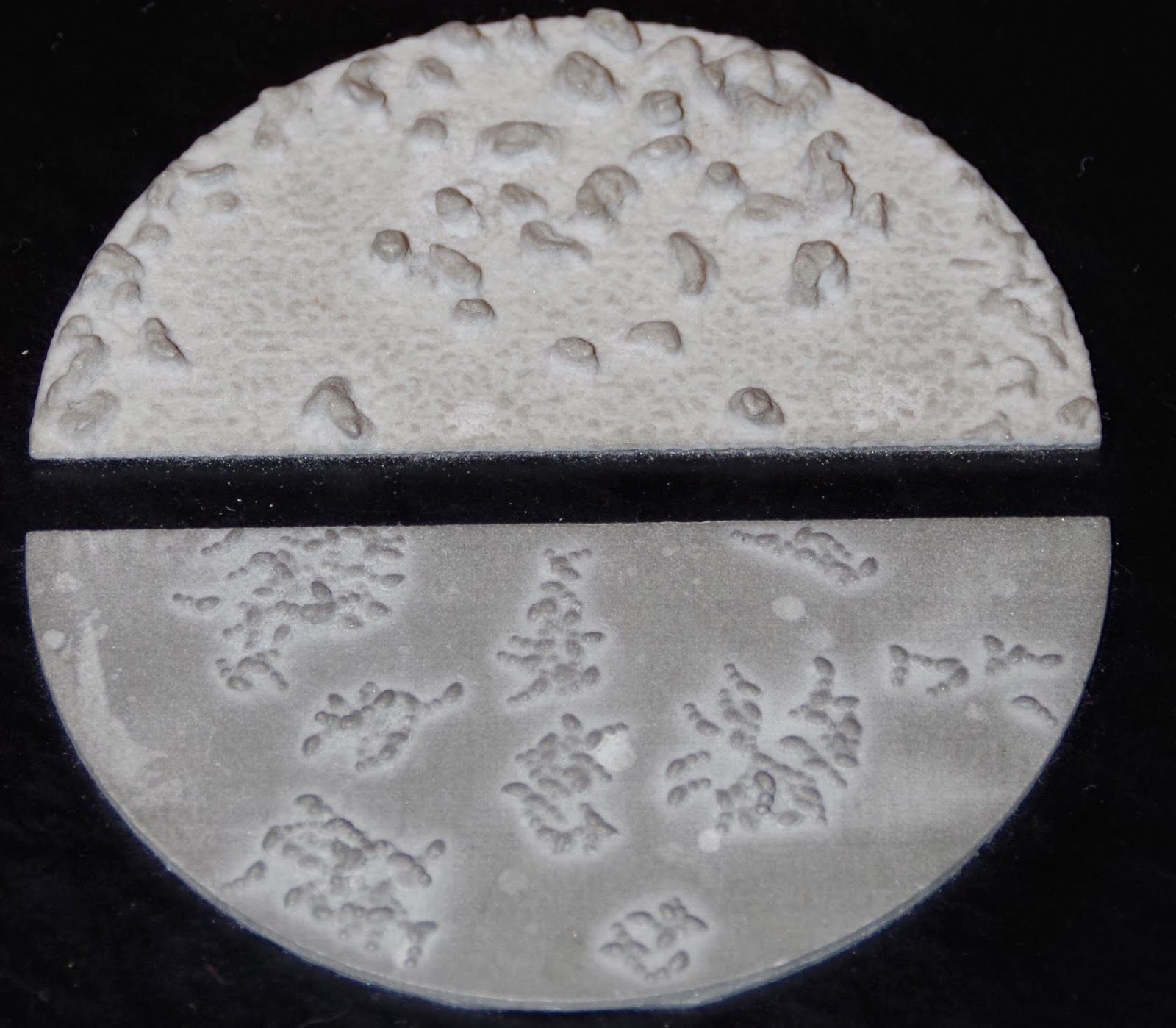
Reproduction tactile de lieux dans la fourmilière :
le nidet le dépotoir.
Crédits : Léa PECCOT
L’accent est donc mis sur le braille et plus largement sur le tactile. C’est encore une fois une réflexion en amont qui a conduit à ce résultat. Cette incorporation du tactile dans l’exposition est nécessaire pour le public déficient visuel et utile pour tous les autres. Des maquettes de toutes tailles et genres sont présentes dans cette exposition. Il en va de la reproduction d’une larve agrandie plusieurs dizaines de fois à la représentation des organisations d’orientation qu’utilisent les fourmis. Ce ne sont donc pas uniquement des éléments morphologiques qui sont traduits en tactile mais aussi des concepts à intégrer. C’est, il me semble ce qui fait toute la richesse et l’ingéniosité de cette exposition.
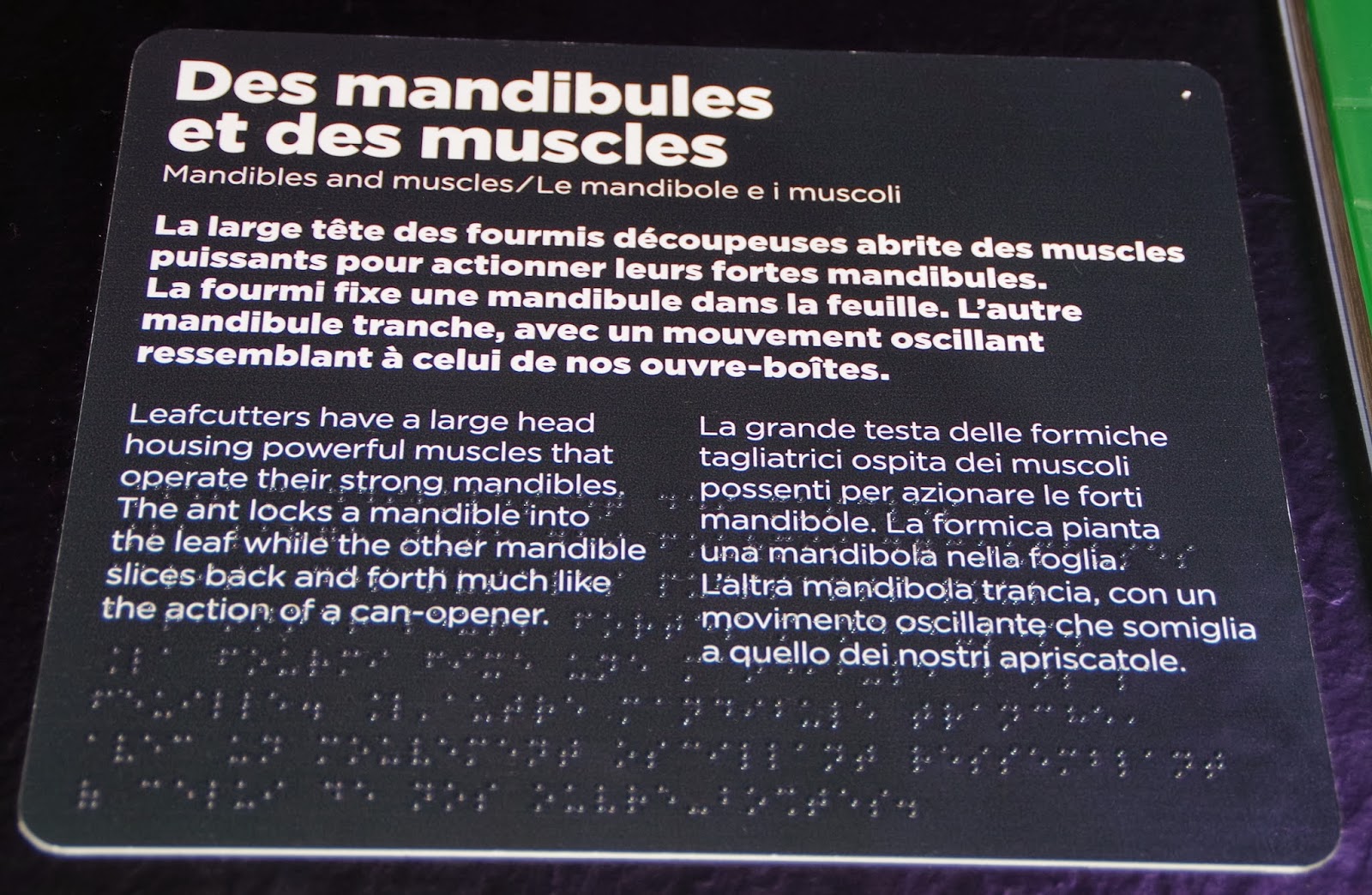
Texte en français, anglais, italien et braille.
Crédits : Léa PECCOT
Cette exposition avant tout accessible au public déficient visuel, auditif ou encore à mobilité réduite est d’autant plus riche pour les autres publics qu’ils soient jeunes, familiaux ou âgés. Tout le monde y trouve son compte et ressort agréablement surpris par les capacités de ces fourmis. Car si l’accessibilité formelle est surtout mise en avant, le contenu aussi a été travaillé. Les textes sont très abordables. Bien que leur taille soit réduite, les informations sont claires et simples et les termes sont définis. Il y a donc eu un grand travail de recherche pour arriver à ce résultat.
A l’aune des restrictions budgétaires et d’obligations législatives en matière d’accessibilité, on constate que le Palais de la découverte avec ses milliers de milliards de fourmis réussit ce que l’on considère aujourd’hui comme un exploit mais, qui, bientôt, sera la norme.
Léa Peccot
Exposition temporaire au Palais de la découverte : 15/10/13 au 24/08/14
Présentation de l'exposition par la commissaire, Nathalie Puzenat
Article presse : RFI, Christophe Carmarans
#fourmis
#accessibilité
#PalaisdelaDécouverte
#exposition
[1] « 1 %environ des déficients visuels (22 000 personnes) ont appris le braille, dontmoins de la moitié (9 000 personnes) le pratiquent pour la lecture et moins dela moitié également (9 000 personnes) pour l'écriture. »

La Bioinspiration dans les musées : quand l'art et la nature s'unissent
"Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur."
Cette citation de Léonard de Vinci résonne avec force dans le contexte actuel, où l’interaction entre la nature, l’architecture et les modes de fonctionnement deviennent une source d’inspiration pour l’art, la science, et même la préservation de nos écosystèmes.
De plus en plus, les musées adoptent cette approche, non seulement pour enrichir leur esthétique, mais aussi pour intégrer une dimension écologique essentielle dans la conservation des œuvres et la gestion de leurs infrastructures. La bioinspiration est une approche novatrice qui consiste à puiser dans les stratégies de la nature pour repenser nos façons de créer et de protéger l'environnement.
Une nouvelle vision artistique et architecturale
La bioinspiration fait référence à un processus créatif fondé sur l’observation des systèmes vivants – des micro-organismes aux écosystèmes entiers. Elle consiste à s’inspirer des solutions que la nature a développées au fil du temps pour résoudre des problèmes, dans le but d’innover dans divers domaines, y compris la muséographie.
Si la nature a toujours été une source d’inspiration pour les artistes et les scientifiques, elle a été largement délaissée pendant la révolution industrielle, lorsque les progrès
technologiques ont conduit à l’idée que la nature était imparfaite et ne pouvait plus être un modèle fiable. Pourtant, au XXIe siècle, nous redécouvrons l’importance de l’observation de la nature pour stimuler la créativité.
Les musées contemporains incarnent parfaitement cette alliance. Certains choisissent des emplacements insolites et éloignés des centres urbains, où la nature est non seulement un cadre de vie mais aussi une source d'inspiration.
Des musées biomimétiques dont l'architecture s’inspire de la nature
De nombreux musées contemporains intègrent des éléments biomimétiques dans leur conception, allant du simple esthétisme à une démarche éco-responsable. Ces espaces créent une atmosphère propice à l’immersion, à la contemplation et à l’introspection.
Le Musée Fabre à Tokyo, au Japon, a une architecture qui rappelle la tête d’un insecte, symbolisant ainsi l’interconnexion de la nature et de l’art. De même, le Musée des Confluences à Lyon adopte une forme évoquant un nuage, et est un autre exemple de l’utilisation du biomimétisme dans l’architecture muséale. Ces musées invitent les visiteurs à réfléchir aux possibles échanges entre différents éléments architecturaux et naturels, sans pour autant s’inspirer de leur écosystème.
La préservation d’un écosystème : la bioinspiration comme démarche écoresponsable
Les musées adoptent de plus en plus la bioinspiration pour intégrer des solutions écologiques dans leur architecture et la gestion de leurs ressources. Inspirés par la nature, ils imitent des processus naturels pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir la durabilité. Ces pratiques incluent l’utilisation de matériaux locaux, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’intégration de végétation pour réguler les températures et l'humidité. Voici quelques exemples :
Le Musée du Quai Branly à Paris présente par exemple 800 m² de murs végétaux conçus par Patrick Blanc. Composés de 15 000 plantes, ils régulent naturellement la température et l'humidité tout en favorisant la biodiversité urbaine. C’est également le cas du Centre de Conservation du Louvre à Liévin, qui préserve ses collections en ayant recours à un toit végétalisé qui stabilise le taux d’hygrométrie.

© Musée du Quai Branly, Photigule
De même, l'ArtScience Museum de Singapour, avec sa forme inspirée de la fleur de lotus, récupère l'eau de pluie qui est ensuite recyclée et réutilisée par le musée grâce à un système de cascade, et optimise la diffusion de la lumière.
Alliant mimétisme et renforcement, le Musée Ordos, situé dans la ville du même nom en Mongolie-Intérieure en Chine, utilise des panneaux métalliques pour se protéger des fréquentes tempêtes de sable et des vents froids d’hiver. Il s'adapte ainsi à son environnement désertique en tentant de s’y fondre grâce à son architecture aux allures de dunes ou de galet. Cette démarche se remarque autant qu’elle se questionne : le bâtiment relève-il vraiment du mimétisme, ou ne vise-t-il qu’un effet spectaculaire malgré son intégration au paysage ?

© Musée Ordos, Chine, Popolon Architects : Ma Yansong, Yosuke Hayano, Dang Qun from MAD Architects
Impulsé par le Muséum National d’Histoire naturelle, le projet Bioinspire-museum soutient et valorise cette pratique dans l’ensemble des activités du musée, tout en permettant l’émergence des matériaux de demain inspirés du vivant. L’accent est mis sur la bonne compréhension de la biologie, nécessaire au succès du projet.
Ces projets montrent que la bioinspiration peut permettre aux musées de renforcer leur engagement en faveur de l’écologie, mais aussi de créer des espaces plus durables et résilients face aux défis environnementaux actuels.
Et si la bioinspiration influençait la conservation préventive ?
La bio-inspiration offre également des pistes intéressantes pour une conservation préventive plus respectueuse de l’environnement. Il n’est pas rare que des œuvres soient face à des risques de moisissures ou de craquèlement dus à une mauvaise gestion du taux d’humidité de leur lieu de conservation. Le Musée des Beaux-arts de Brest voit ses portes fermées pour plusieurs années à la suite de moisissures sur 18 de ses 190 tableaux exposés. Il est obligé de réaliser de lourds travaux de réhabilitation voire même de reconstruction totale du bâtiment.
Le toit végétalisé du Centre de Conservation du Louvre à Liévin permet par exemple d’anticiper ce genre d’incidents en aidant naturellement et efficacement à la régulation du taux d’humidité et de la température intérieure.
Parfois même lorsque ce n’est pas prévu, la nature vient en aide à certains instituts : au Portugal, des chauves-souris ont été mises à contribution pour protéger les collections de bibliothèques, en régulant les populations d’insectes nuisibles de manière naturelle et sans produits chimiques. Bien entendu, leur présence implique une protection toute particulière des objets.
Ainsi, l’innovation et la nature peuvent tenter de se conjuguer pour préserver nos patrimoines tout en prenant en compte l’environnement. Mais ces bâtiments sont-ils capables de se fondre dans leur environnement de par leur taille ? Leur aspect reste industriel et leur impact écologique important.
Un modèle durable
Bien entendu, la bioinspiration ne se limite pas aux musées. Elle est un levier pour repenser les villes de demain. À l’horizon 2050, près de 80 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Il devient donc essentiel de repenser les villes comme des écosystèmes durables, capables de s’adapter aux changements climatiques et aux défis environnementaux. En tirant parti des principes du biomimétisme, il est possible de concevoir des bâtiments qui consomment moins d’énergie, qui recyclent les ressources et qui offrent des espaces de vie harmonieux avec la nature.
Ainsi, lorsque nous parcourons les expositions de ces lieux inspirés du vivant, nous ne faisons pas que contempler des œuvres. Nous vivons une expérience qui se veut immersive où l’art et la nature ne font plus qu’un, nous invitant à repenser notre rapport à l’environnement et à la préservation de notre planète. Mais l’est-elle réellement ?
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
- La bioinspiration expliquée par le Muséum National d’Histoire Naturelle : Biomimétisme : Quand la Nature nous inspire | MNHN
- Le projet Bioinspire-Muséum : https://www.mnhn.fr/fr/bioinspire-museum
- Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture : Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture - Design-Mat
Expositions en lien avec cette thématique :
- “Bio-inspirée” au Musée des Sciences et de l’Industrie (exposition permanente depuis septembre 2020) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/bio-inspiree/lexposition
- “Mimèsis. Un design vivant au Centre Pompidou-Metz (exposition temporaire :06/2022 - 06/2023) : Mimesis. Un design vivant
#Bioinspiration #Conservation #Ecoresponsabilité #Architecture

La rencontre du design et de la culture (scientifique)
Mettant les publics au cœur de ses préoccupations, les institutions culturelles cherchent sans cesse de nouvelles façons d’améliorer leur expérience de visite. Pour ce faire, le recrutement de professionnel.le.s aux parcours et compétences diverses est souvent envisagés. Ces politiques d’embauche témoignent d’une volonté d’apport de polyvalence et de transversalité dans les équipes.
Dans cet esprit, Le Vaisseau, un centre culturel et scientifique dédié aux enfants de 3 à 12 ans, à Strasbourg, a accueilli depuis mars dernier, Clara Speiser, une designeuse produit. A travers un entretien, je vous invite à découvrir son regard neuf et transversal.
Peux-tu te présenter ?
« Je m'appelle Clara Speiser, j'ai 26 ans, je suis designeuse d'objet, et actuellement, j'exerce cette fonction au Vaisseau ! »
Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?
« Mon DUT en science des matériaux m’a appris les différentes familles de matériaux, le verre, la céramique, les métaux, les polymères naturels et les polymères synthétiques et les composites. C'était fascinant ! J'y ai découvert pour chacun les propriétés microscopiques, macroscopiques. C’est, pour résumer, tout ce qui les caractérise et les procédés de fabrication qui leurs sont affiliés.
A ce stade de mon parcours, j'ai voulu apprendre à mettre en forme ces matériaux qui occupent notre quotidien. J'ai souhaité, moi aussi, leur donner corps et les faire vivre en tant qu'objet. Je suis donc partie en licence professionnelle à l'école de design de Nantes Atlantique pour me former au design d'objets.
Dans cette année charnière pour mon orientation, j'ai rencontré des enseignant.es/designers qui m'ont appris à créer des objets en accord avec un brief client. A travers une série de questions, ils m’ont appris à insuffler des valeurs à un objet, à effectuer un travail de recherche créatif pour donner un sens à l'objet. L'utilisateur est-il un enfant ? Un.e sportif.ve? Un.e retraité.e ? Dans quel lieu va être utilisé l'objet ? Sous l'eau ? En pleine nature ? À l'hôpital ? Dans une cuisine ?
Quelle valeur veut-on que l'objet dégage ? Veut-on qu'il soit robuste, ludique, minimaliste, honnête, futuriste, biomimétique, délicat, durable, élégant, dynamique, ....?
J’ai ainsi appris à m’interroger et définir les nombreuses caractéristiques que possèdera l’objet que je réalise : ses lignes, les matériaux utilisés, leurs aspects de surface, les couleurs choisies et sur quels éléments de l'objet, les mécanismes apparents ou non, les vis visibles et même exagérées, les formes arrondies ou anguleuses, des formes bombées ou très fines, des contours amplifiés, etc.
Je pense qu'à l'issue de cette licence, j'en étais là en termes de design d'objet. J'étais capable de mettre en place une démarche créative pour dessiner un objet pertinent pour un utilisateur et un contexte d'utilisation.
J'ai eu besoin d'aller plus loin, et d'approfondir le design. C’est pourquoi j’ai intégré une Ecole d’Ingénieur à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et leur formation « Ergonomie design et ingénierie mécanique ».
Cela m’a permis d’obtenir la double casquette ingénieur/designer.
J'ai appris à me servir de plusieurs logiciels de conception 3d, tels que Solidworks, Rhinocéros et Catia V5. J'ai pu me perfectionner sur ce dernier pendant ces 3 années d'études à un niveau avancé.
Durant cette formation, je me suis également formée aux méthodes et outils pour l'ergonomie et l'éco-conception qui sont des domaines transversaux du design d'objet.
Enfin, j’ai pu découvrir de nouvelles méthodes de créativité, de design thinking tout en m’exerçant au dessin, au maquettage et au prototypage.
Je terminerai là-dessus en précisant que lorsque je conçois un objet, mon objectif est toujours l'utilisateur et l'expérience qu'il va pouvoir vivre à travers l'objet. »
Que fais-tu au Vaisseau ?
« Au Vaisseau, je conçois les éléments d'exposition interactifs pour les enfants autrement appelé les manipes. Pour moi, le demandeur, c'est le muséographe. Il veut une exposition qui va raconter une histoire avec les objets interactifs pour véhiculer telle notion.
Suite à sa demande, je réalise des objets fonctionnels, et en adéquation avec la durée de vie de l'exposition qu’elle soit temporaire ou permanente. Pour cela, je dessine, croque, maquette, prototype avec des imprimantes 3d, une découpeuse laser.
Puis je passe par la phase de modélisation en 3D sur le logiciel Solidworks que j'implémente dans l'espace avec le logiciel SketchUp.
D’un projet à l’autre, je n'ai pas toujours les mêmes contraintes. Parfois, les manipes seront réalisées dans l'atelier de fabrication du Vaisseau, parfois, leur fabrication sera externalisée. L'une ou l'autre option dépendent toujours d'un unique facteur : le budget !
Ces contraintes de départ sont importantes car elles vont énormément impacter la direction artistique que vont prendre les objets.
Pour une exposition à 100% réalisée en interne, les formes des objets dépendront :
- des machines que l'on possède en interne et des matériaux qui leurs sont affiliés (principalement des plaques de bois)
- des compétences et des techniques des techniciens
- du délai du projet, donc du temps imparti pour la réalisation

Des prototypes de manipes pour l’exposition La Caverne © M.D
Je cherche le plus souvent à trouver des procédés de fabrication réalisables en interne. Et parfois, je suis amenée à aider à la fabrication finale. Je peins, visse, ponce, fabrique des moules en impression 3d et des contre moules en silicone entre-autre.
Dans cette configuration de création de manipe, je suis limitée en termes de moyens, de machines et de matériaux. Mais aussi contradictoire que cela puisse paraître, j'ai aussi plus de liberté dans mon expression artistique.
Je m'explique : Dans le cadre d'une exposition à plus gros budget, on peut faire des marchés de scénographie. À partir de là, la direction artistique sera entre les mains de la scénographie. J'aurai alors une posture beaucoup plus conciliante où je serai entre les choix de la scénographie et les faisabilités techniques des fabricants/manipeurs (donc les personnes qui branchent, programment, soudent, fabriquent le produit fini).
Je me trouve alors à la direction de conception des éléments de l'exposition.
Ainsi, j'intègre dans mon dessin 3D les codes formels et graphiques de la scénographie pour être en accord avec l'univers à naître. Et de l'autre côté, j'intègre dans mes volumes les contraintes du manipeur, c’est-à-dire les passages de câbles, les zones d'accès technique.
Malgré toutes ces contraintes auquel je dois concéder, je suis aussi garante de mes propres choix, que je défends : l'usage et ce que vont faire les enfants avec les objets. Un choix d'usages et des scénarii d'utilisation que j'ai d'ailleurs co-construits avec le(s) muséographe(s) du projet. »
Que penses-tu que le design produit peut apporter comme valeur ajoutée à un centre de sciences comme le Vaisseau ou aux institutions culturelles en général ?
« L'utilisateur est au cœur de la conception. En cela, le design s'assure que le parcours utilisateur sera positif.
En tant que designeuse, je pense aux postures, aux tranches d'âges et leurs tailles associées, aux sens mis en jeux pendant l'utilisation, sons, vue, toucher, l'odorat (ce qui me pousse à fuir les matières qui sentent le chimique, le "neuf" !).
Je pense aussi à l'approche : un jeu de résolution un peu complexe devra être détaillé et rassurant pour guider l'enfant vers la solution. Un jeu qui laisse une grande place à l'imagination de l'enfant devra être très suggestif, presque effacé (ex : il suffit d'un canapé et de quelques oreillers pour qu'un enfant créé une île au milieu d'une étendue de lave).
Le design c'est l'usage, c'est se mettre à la place de l'utilisateur pour lui faire vivre une expérience positive. »
Venue renforcée l’équipe du service de Conception et Développement de Projets, Clara vient répondre à l’un des objectifs : la conception des manipes en interne. Soucieuse de proposer un usage adapté aux enfants, elle assure une conception viable des manipes améliorant ainsi l’expérience de visite des publics.
Focus sur une manipe : De la demande au processus de conception à la phase de réalisation
Dans le cadre de la toute nouvelle exposition permanente Caverne, portant sur les couleurs dans la lumière et les illusions d’optique, Clara a eu l’occasion de mettre en pratique tout son processus de création. En effet, toutes les manipes de cet espace ont été entièrement réalisées en interne. Nous allons ici nous intéresser à l’espace « Coin du feu » dans lequel Clara a conçu et réalisé le « feu ». Ce dispositif lumineux vient dessiner l’ambiance de cet espace autour duquel on peut se rassembler en tribu (une famille, un groupe de visiteur.euses en « langage Vaisseau »). Il devient ponctuellement un espace de médiation que les animateur.rices peuvent s’approprier en profitant du dispositif de Clara, qui cache un rétroprojecteur, pour réaliser un théâtre d’ombres.
La réalisation de ce dispositif peut se diviser en plusieurs étapes
1. La demande
Cette « étape 0 » permet de comprendre les besoins, ici en l’occurrence des muséographes en charge du projet qui vont co-rédiger le cahier des charges qui est la base de travail de la designeuse.
2. La phase de recherche
Elle comprend une phase exploratoire à travers des planches d’inspiration et du sketching. Elles vont concerner l'usage et les scénarii, les postures qui sont envisageables, et aussi les matières.
L’idée, à ce moment du projet, est de ne pas se restreindre, et de se laisser aller à la créativité, aucune idée n'est encore à écarter.
Planche d’inspiration pour le dispositif © C.S
3. La phase convergente (cf le design thinking)
Le manque de temps à cette étape du projet ne permet plus d’explorer les différentes pistes pour des questions évidentes de plannings. Il est donc temps de passer en phase convergente et de resserrer ses idées. Pour cela, il faut formuler des concepts, 4 maximum.
Ils sont matérialisés par une architecture produit, donc une forme non définitive, qui suggère l'intention, mais dont le scénario est plus détaillé qu’en phase recherche.
À ce stade, le détail formel et graphique des concepts peut en réalité être plus ou moins avancé. Plus avancé si par exemple le demandeur est très précis sur ce qu'iel désire, ou si la designeuse est libre dans la direction artistique que doit prendre le projet. Moins avancé si la forme se construit en ping-pong avec les scénographes, qui est à la direction artistique, ou bien encore si le produit va subir beaucoup d'évolutions techniques en fonction des prototypes réalisés.
Les trois propositions pour le feu de l’exposition Caverne © C.S
4. Le choix
Vient finalement l’heure de présenter ses concepts au demandeur.euse.s qui choisiront le plus pertinents selon le projet. Il est parfois possible que ce soit un concept « bis » issu de deux propositions combinées ensemble.
5. La vérification de la viabilité
Il faut ensuite réaliser des maquettes et/ou des prototypes.
A coup de cartons récupérés, de cutter et de colle, la designeuse conçoit des maquettes. Ce sont des objets statiques dont on se sert pour valider des dimensions et des postures. Il est parfois possible d’utiliser la découpe laser pour des formes difficiles à découper au cutter. Le but, à cette phase du projet, est de limiter au maximum les matières coûteuses et plus « précieuses » que le carton usagé (bois et plastique entre autres).
Quant aux prototypes, ils sont là pour valider des fonctions, qu'elles soient mécaniques ou électroniques. L’utilisation de matières plus coûteuses et de procédés plus précis permet ainsi de rester fidèle aux jeux de mécaniques.

Test des rendus lumière du prototype. © M.D
6. Définition de l’architecture produit détaillé
Les conclusions des maquettes et des prototypes vont permettre de définir l'architecture produit détaillée, puis de modéliser l'objet en 3D dans sa version finale.
Architecture produit du dispositif du « feu » © C.S
7. Les plans techniques
On termine par la réalisation de plans techniques pour la fabrication. Dans le cas de Clara, certains plans iront pour l'atelier du Vaisseau et d'autres pour des éléments sous-traités ne pouvant être réalisés en interne.
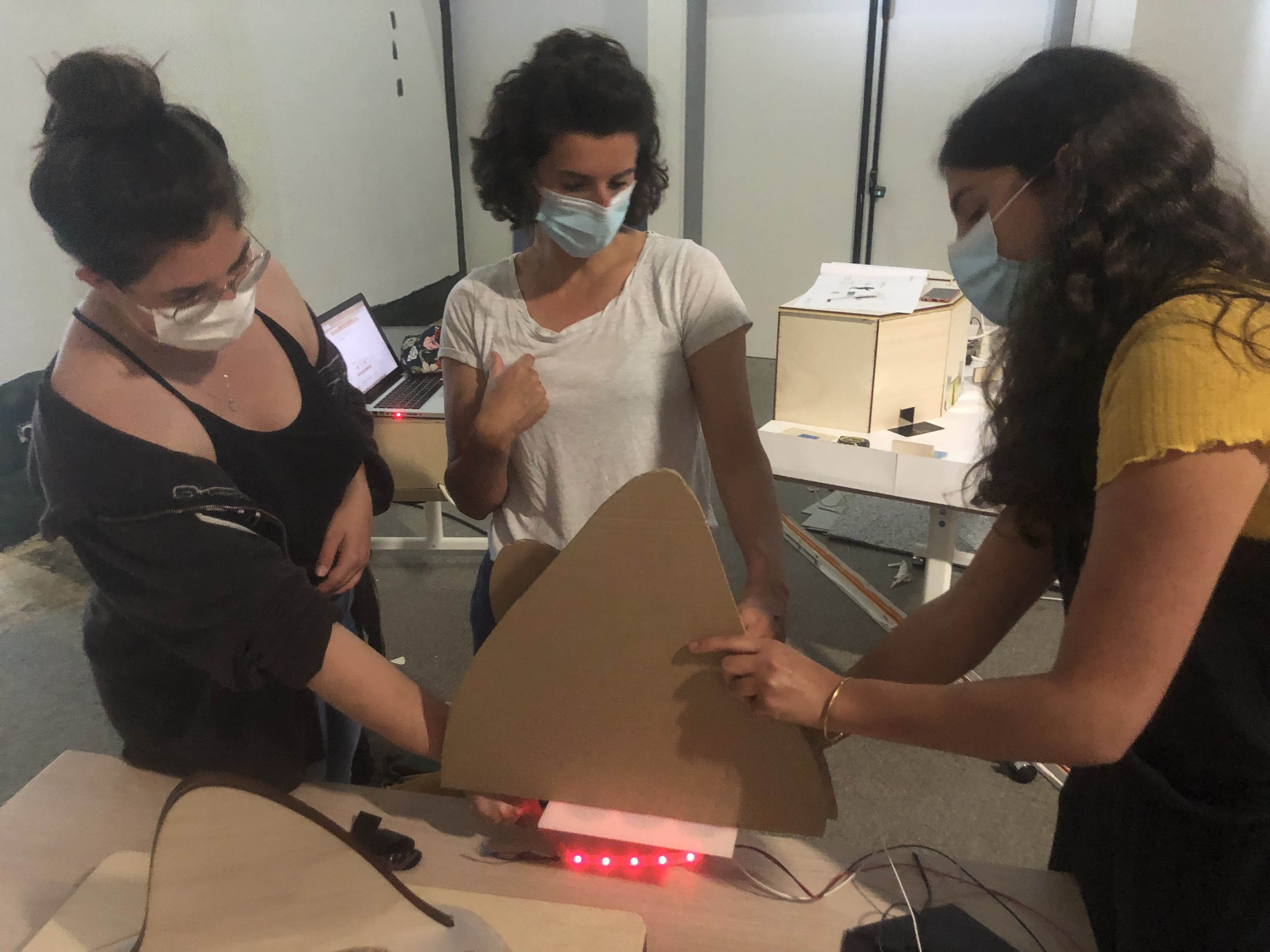
Tests et échanges sur le rendu avec la scénographe et la muséographe. © M.D
De gauche à droite : Margot Coïc, muséograhe, Céline Daub, scénographe et Clara Speiser, designeuse produit.

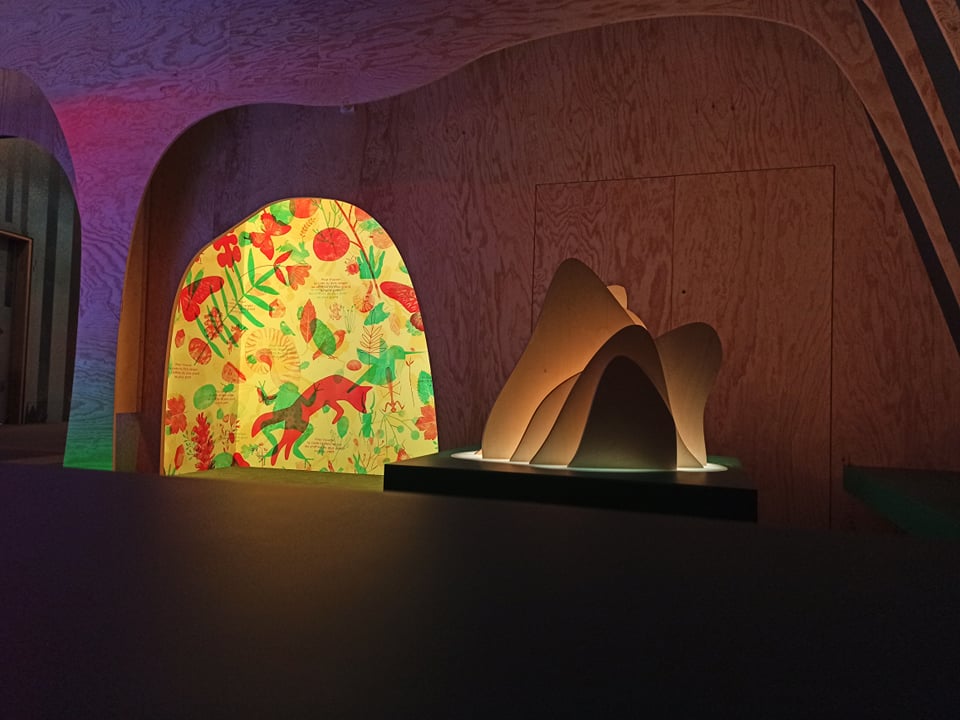
Le coin du feu dans le nouvel espace d’exposition La Caverne © M.D
#Design
#CentredeSciences
#Manipes

Le City-trip immobile au Pavillon de l’Arsenal La nouvelle maquette numérique
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité? Le city-trip immobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal.
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité ? Le city-tripimmobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal. Ré-ouvert le 14décembre 2011, la nouvelle exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal, lieu chargé d’exposer l’histoire urbanistique et architecturale de la capitale, intègre une gigantesque maquette numérique « Paris, métropole 2020 », créée par le Pavillon en partenariat avec Google et JC Decaux.
Ce projet de 37m² règne en maître des lieux dans le hall. Aménagé sous la forme d’un patio et centré par rapport à la mezzanine, il cohabite parfaitement avec l’architecture des lieux. Au total, ce sont 4 pupitres tactiles multipoints, 17 ordinateurs, 48 écrans LCD basse consommation, donc 48 Google Earth synchronisés, cent millions de pixels et mille mètres de câbles, qui rassemblent 1300 projets en 2D ou en 3D. Absolument impressionnant, ce dispositif haute technologie, conçu sur le principe cartographique du logiciel Google Earth, procure une expérience interactive unique, ludique et pédagogique. Sur le site internet, vous pouvez admirer la vidéo de l’installation de la maquette. En une minute quarante-cinq, celle-ci montre en accéléré les quelques jours de montage et la complexité du matériel utilisé, nécessitant de s’armer de techniciens expérimentés et d’informaticiens ingénieux.
Ce projet multimédia permet au Pavillon de l’Arsenal de dépasser les limites géographiques de l’ancienne maquette en carton, précédemment à cet emplacement, qui ne reprenait que le centre « construit » de Paris. Actuellement, ce sont plus de 12 000 km² du territoire métropolitain que l’on survole d’un doigt, de 15m à 50km d’altitude, permettant de traverser « les grands territoires de projets en mutation, les nouveaux ou futurs réseaux de transport et les architectures emblématiques de la ville de demain ou déjà en construction dans la métropole parisienne ». L’utopie n’est pas de mise, l’ensemble ne reprend que les projets déjà pourvu d’un permis de construire.
Cette première mondiale donne donc la possibilité unique de présenter simultanément l’existantet le futur d’une agglomération sur Google Earth, pour découvriraujourd’hui les quartiers de demain : voir en 3D les projets de la Philharmonie, des Halles, la fondation Louis Vuitton pour la Création, … . Au travers d’une “navigation libre ou thématique”, elle propose des visites guidées (bientôt disponibles), thématiques – architecture, urbanisme, transports- ou par recherche libre. Facilement manipulable et étonnamment fluide, il faut cependant prendre le temps de comprendre son fonctionnement car le doigté n’est ni celui du MACbook, ni celui connu de Google Earth. Le zoom, l’inclinaison, et la rotation nécessite une dextérité particulière comme de retourner chaque fois en bas de l’écran pour utiliser les flèches et icônes de l’option en question.
Cet outil, permettant bien des surprises, paraît cependant encore bien incomplet. Les principaux bâtiments et monuments y sont déjà modélisés (de la même façon qu’une bonne partie des villes de New-York et de San Francisco l’ont été faites), mais beaucoup de travail attend encore la communauté d’internautes de Google Earth pour lui assurer un ensemble harmonieux et cohérent. Fort heureusement, il a été conçu pour être « constamment et simplement complété et actualisé » car c’est bien un outil commun aux acteurs qui façonnent notre lieu de vie. Terrible challengede rassembler tous les projets d'architecture et d'urbanisme en cours d'élaboration pour donner une pré-vision complètement unifiée.
Ses concepteurs ont la volonté que cet outil soit « accessible à tous, jeunes, étudiants, parisiens et franciliens, professionnels français ou étrangers ». Il ne l’est cependant pas totalement car, certainement par soucis de pureté, il manque de clarté : les noms des rues et des arrondissements ne sont malheureusement pas indiqués, ce qui ne rend pas évident l’orientation. Les fiches techniques sont elles aussi bien inégales dans leurs informations. On trouve parfois une date, parfois une photo, parfois un texte informatif sur le projet, mais bien souvent, elles sont en attente de traitement.
L’application « Paris, métropole 2020 » sera bientôt téléchargeable pour vivre cette expérience chez soi, bien installé dans son divan. La question qui se pose est : qu’offre-t-elle de plus au Pavillon de l’Arsenal ? Sa force première est bel et bien les différents points de vue qu’offre son emplacement. Sa taille monumentale en fait aussi l’élément agréable qui permet de s'accouder à la balustrade de lamezzanine pour se laisser guider par un autre utilisateur, qui mène la barque un étage plus bas.
Cette innovation technologique questionne, comme bien d’autres, l’utilité qu’offrent de tels outils. Pour le moment, ce sont surtout les fantasmes de la transposition des supports qu’elle révèle, s'avérant des limites plutôt qu'un avantage. Le manque de contenu induit cette envie technophile d’attirer, de surcroit avec des grands partenaires tels que Google et JC Decaux. Cette technologie avant-gardiste devrait avant tout être conçue comme un élément de médiation permettant une meilleure accessibilité au contenu. Ne serait-est pas nécessaire d’y amener le jeu pour que les plus petits découvrent et apprennent eux aussi en s’amusant ? Des animations ou diverses vidéos lui permettraient d’acquérir l’ensemble des possibilités et des opportunités du multimédia, complémentaires à l’exposition permanente, réalisée de panneaux traditionnels et exposée sur les murs du Pavillon de l’Arsenal.
Clara Louppe
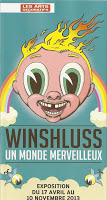
Le monde merveilleux de Winshluss
Exposition temporaire du 17 avril au 10 novembre 2013 dans la Galerie des Jouets du Musée des Arts Décoratifs
WinshlussUn monde merveilleux. Voilà un titre d'exposition prometteur.Un titre qui fait rêver et qui laisse au visiteur le loisir de s'imaginer ce que peut être pour lui un monde merveilleux. Maisson monde merveilleux sera forcément bien différent de celui qu'il va découvrir dans la Galerie des Jouets du Musée des Arts Décoratifs car ce qu'il va découvrir c'est le monde merveilleux de Winshluss et l'on ne peut se faire une idée de la teinte de son monde et de toute l'ironie du titre de l'exposition à moins de connaître son œuvre.
Winshluss, alias Vincent Paronnaud, est un artiste puisant ses sources d'inspiration dans le monde de l'enfance. On retrouve dans ses œuvres de nombreuses figures de la culture populaire par exemple dans son film d'animation Persépolis,primé du Prix spécial du jury du Festival de Cannes en 2007, ou dans sa bande-dessinée Pinocchio,primée du Fauve d'Or (Prix du meilleur album) au Festival international de la bande-dessinée d'Angoulême en 2009. Cependant ses inspirations et emprunts sont toujours traités et détournés au service d'un discours grinçant, cynique, voire même macabre, tout en étant humoristique. On retrouve inévitablement ces deux aspects dans l'exposition Winshluss Un monde merveilleuxqui nous (re)plonge dans l'univers particulier de l'artiste et dans une réflexion sur la société dans laquelle nous vivons.
Un monde haut en couleur ?
Brochure de l'exposition Winshluss Un monde merveilleux Crédit photographique : C. D.
Avant de franchir les portes qui le conduiront dans l'exposition, le visiteur dispose de trois éléments qui peuvent lui permettre d'imaginer le monde dans lequel il va être transporté : le titre, la brochure et le cartel de présentation de l'exposition.D'abord le titre de l'exposition : Winshluss Un monde merveilleux. Une exposition qui serait donc haute en couleurs ? Un monde plein de gaîté, de paillettes, d'éblouissement ? Un monde de rêve ?
Dans l'esprit du visiteur c'est une première entrée dans l'exposition. Consciemment ou non le titre introduit dans l'esprit du visiteur une certaine attente plus ou moins guidée si le visiteur connaît l'univers de l'artiste. Puis la brochure de l'exposition : fond bleu, arc-en-ciel, petits nuages moutonnant, du jaune, du rose et un personnage tout droit sorti d'un univers de bande-dessinée. Mais un personnage à qui il manque une dent et dont les cheveux sont remplacés par des flammes. Étrange. Enfin le cartel de présentation de l'exposition situé avant les portes qui mènent dans l'exposition.
Un cartel dont la dernière phrase n'est pas sans susciter de nouvelles attentes et interrogations chez le visiteur : « Un monde merveilleux nous plonge dans des histoires qui, comme les contes, nous émerveillent tout en montrant la face cachée – et parfois noire – du monde ». Un monde merveilleux donc ? Peut-être pas tant que cela... Pour le savoir il faut pousser les lourdes portes noires de l'entrée de la Galerie des Jouets. Immersion.
La découverte d'un monde
La Petite Fille aux Allumettes
Crédit photographie :
Musée des Arts Décoratifs
Barbapatomic
Crédit photographique : Musée des Arts Décoratifs
Curieux de découvrir ce qu'elles renferment, on pousse les portes de la Galerie des Jouets. À peine a-t-on franchi le pas de la porte que l'on s'immerge totalement dans le monde de Winshluss. Est-on surpris ? Peut-être. Ce n'est pas un monde haut en couleurs, du moins pas seulement. Les cimaises sont noires. Le sol est noir. Mais les œuvres [jouets, sculptures, planches et dessins originaux, posters, affiches, revues, fanzines et dessins animés] sont toutes en couleur.
Des couleurs éclatantes. Du rose, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rouge. Les œuvres sont mises en valeur par un éclairage parfaitement maîtrisé et par le contraste avec le noir des trois salles qui les fait d'autant plus ressortir. Ce noir n'est pas sans faire écho à la noirceur du monde dont nous parlait le cartel de présentation de l'exposition. Un noir qui cache, qui camoufle, qui permet de mettre en lumière ce qu'on nous présente mais qui masque ce qu'on ne nous présente pas. À la première impression visuelle succède une impression sonore ou peut-être précède t-elle l'impression visuelle en fonction de l'attention première du visiteur.
Deux sons l'accueillent : une douce mélodie nous rappelant notre enfance et un brouhaha guerrier. Ces deux sons ne se mêlent pas mais se suivent l'un l'autre si bien que le visiteur, lorsqu'il entre, est accueilli par l'un ou l'autre des deux sons ce qui lui fait aborder l'exposition différemment. Ou il est accueilli en douceur par une mélodie rassurante auquel cas il porte instinctivement son regard sur le rose du Barbapatomic[premier diorama de l'exposition]. Ou il est plongé dans un tumulte guerrier qui lui fait porter son regard plutôt sur l'armée qui se bat contre le Barbapatomic. Certains visiteurs sont donc immédiatement confrontés à la dureté du monde dépeinte tout au long de l'exposition alors que d'autres y sont amenés plus en douceur, mais resteront de ce fait peut-être influencés par cette douce mélodie, tout comme certains enfants restent influencés parle monde de leur enfance parce qu'on leur a présenté de cette façon.
Une scénographie au service d'un discours
Lorsque l'on sort de la Galerie des Jouets, on sort d'un univers, et tout paraît vide parce que l'on n'est plus en présence de l'atmosphère créé dans les trois salles de l'exposition si bien que l'on a envie de revenir sur nos pas. On ressent ce changement d'atmosphère car la scénographie est en phase avec le discours. Le lien entre les deux est net : la scénographie devient une partie du discours.
Le visiteur s'immisce d'autant plus dans le monde de Winshluss puisqu'il regarde les œuvres en étant porté par la scénographie qui l'aide à comprendre les messages de l'exposition car elle met en lumière les œuvres et l'oblige à les regarder, les interroger, les analyser, les comprendre. Comprendre que le monde de Winshluss n'est pas Un monde merveilleux comme le suggérait le titre de l'exposition, mais un monde que l'on veut nous faire croire merveilleux alors qu'il ne l'est pas. Il n'y a pas seulement du noir sur les cimaises mais aussi dans les œuvres, sous les couleurs, et si l'on met en lumière les œuvres ce n'est que pour mieux faire ressortir leur noirceur. Et que se cache t-il sous la noirceur des cimaises ? Un peu de couleur ?
C. D.
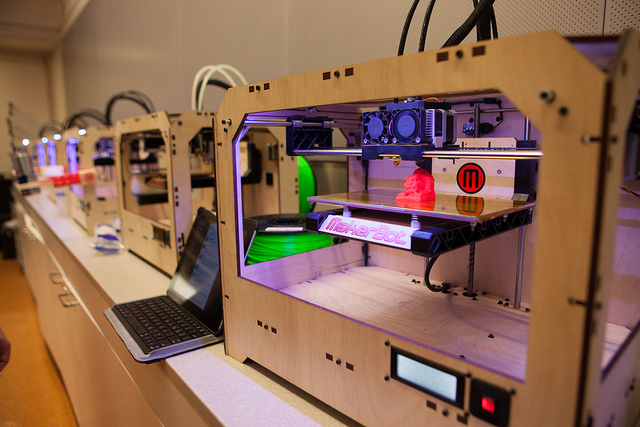
Les fablabs : la créativité à portée de main
Avez-vous déjà entendu parler des fablabs ? Si ce n’est pas le cas, il est temps d’y remédier ! Votre cerveau grouille d’idées mais il vous manque le matériel et les compétences pour les prototyper ? Découvrons ensemble un aperçu des multiples possibilités qu’offrent ces ateliers créatifs, autant pour les bidouilleurs curieux que pour les entrepreneurs et les institutions culturelles.
Un fablab, qu’est-ce que c’est ?
Peut-être l’aurez-vous deviné, le terme fablab est la contraction du mot anglais fabrication laboratory. L’histoire commence en 2001 aux Etats-Unis sur l’initiative d’un professeur du Massachussetts Institute of Technology avant de se développer partout dans le monde quelques années plus tard. En France, c’est en 2009 à Toulouse que s’implante l’un des premiers fablab, appelé Artilect.
La volonté est de permettre à chacun de tester rapidement des idées, d’expérimenter et de fabriquer soi-même des objets à partir de machines que l’on ne pourrait pas se payer individuellement. Pour ce faire, ces laboratoires disposent tous d’un matériel de base : une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, une découpeuse laser et une fraiseuse numérique CNC. Certains développent des spécialités comme l’artisanat textile, la biologie, l’aéronautique, les drones, etc.
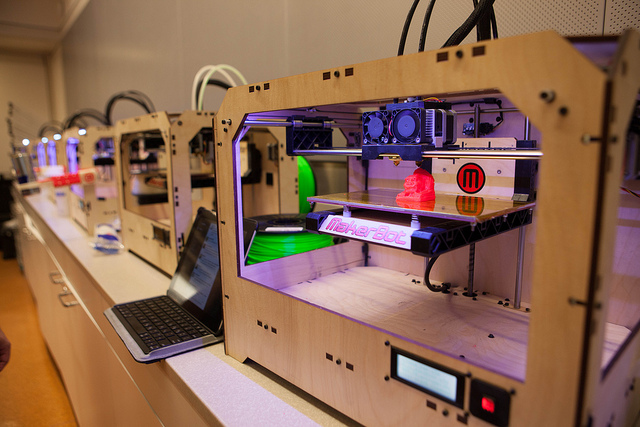
Imprimantes 3D au fablab de Pérouse, image téléchargée sur https://www.tommasobori.it le 15/11/2019
On y prône également l’entraide et le partage des compétences. Travailler dans un espace collectif, c’est aussi rencontrer des personnes d’horizons différents, stimuler sa créativité et faire évoluer son savoir et savoir-faire. Un accompagnement personnalisé est aussi tout à fait possible pour développer un projet.
Que peut-on y fabriquer ?
Autant d’objets que votre imagination et le matériel le permet ! À partir d’un fichier informatique, créez un meuble, une pièce de remplacement pour votre machine à laver, une maquette d’architecture, un moule, un circuit imprimé, un jeu de société, un robot ou encore une prothèse articulée. Sont aussi à votre disposition des open sources, c’est-à-dire des plans d’objets réalisés par d’autres utilisateurs partout dans le monde pour les reproduire soi-même dans n’importe quel fablab. Une fois l’idée testée, la production en série se fera cependant en dehors du fablab.
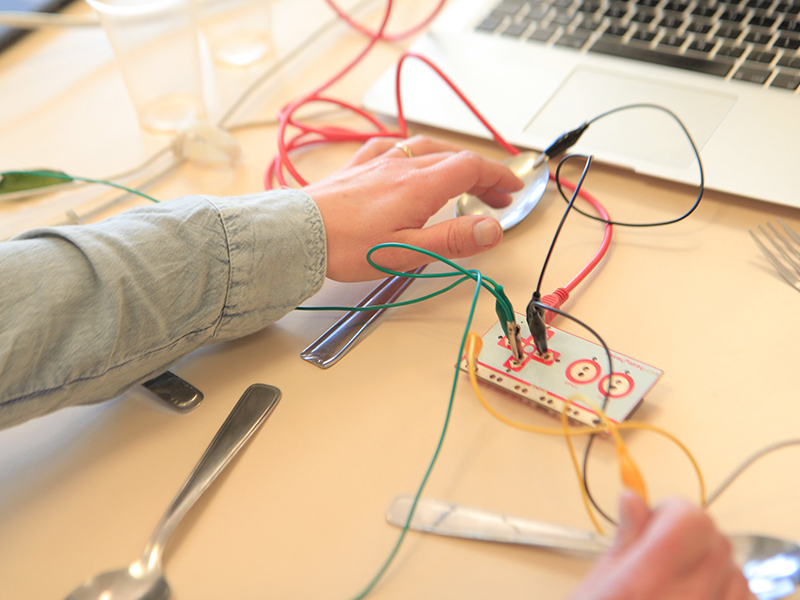
Un Piano Graphique MakeyMakey créé à La Fabulerie, un des fablabs de Marseille, image téléchargée sur https://lafabulerie.com/ le 15/11/2019
Que peut-on y faire ?
Outre tester le matériel et fabriquer des objets, les fablabs proposent généralement d’autres activités. On peut notamment participer à diverses formations, wokshops, afterworks… Ils peuvent également se rendre mobiles et être impliqués dans des événements ponctuels : fête de la science, salons de robotique et de jeux vidéo, Muséomix, etc.
À qui s’adressent-ils ?
Du grand-père bricoleur en passant par un étudiant, un artiste, un designer, un informaticien, ou un bidouilleur du dimanche, tous les âges et métiers y sont représentés ! Les start-up et jeunes entrepreneurs fréquentent particulièrement ces lieux pour passer plus rapidement du concept au prototypage d’une idée.
À quel prix ?
Quel intérêt pour les musées et le secteur culturel ?
Trop souvent en manque de moyens, les musées et autres structures culturelles peuvent trouver dans les fablabs l’opportunité de faire parler leur créativité ! Pourquoi ne pas y tester le prototypage de manips, de dispositifs de médiation, de mobilier d’exposition, de techniques de conditionnement ou d’applications numériques ?
Certains musées possèdent d’ailleurs leur propre fablab, on parle alors de muséolabs.
Peut-être avez-vous entendu parler de la Louvre Lens Valley ? Cet espace situé à deux pas du Louvre Lens fut inauguré en août dernier. Il accompagne principalement les jeunes entrepreneurs au développement de projets concrets par le biais de la culture avec le musée du Louvre Lens comme terrain d’inspiration et d’expérimentation. Elle accueille aussi d’autres publics, comme des élèves de l’École de la 2e chance d’Artois qui ont participé au projet « Makers de l’Art ». Au sein du fablab, ils ont conçu et fabriqué un kit d’aide à la visite pour les visiteurs du Louvre Lens (voir article détaillé sur le sujet ici).

Exemple d’un prototype fabriqué par les élèves de l’école de la seconde chance pour le projet « Makers de l’art » © Laurence Louis
Citons également le Carrefour Numérique ², le fablab de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris où il est possible de participer à des ateliers pour apprendre à se servir d’outils de fabrication numérique en compagnie de médiateurs, de répondre à des appels à projets, de découvrir de nombreuses ressources partagées, d’assister à des conférences ou tout simplement de franchir les portes gratuitement pour voir ce qu’il s’y passe et échanger avec les « makers ».
Au tiers lieu Le Multiple à Toulouse, le décor de l’exposition photographique LIFE ON MARS – DAVID BOWIE a entièrement été réalisée dans un fablab, ce qui aura permis de la mettre sur pied en moins de trois mois grâce aux multiples compétences, partenaires et ressources matérielles mises en communs.
Au muséolab du centre Erasme près de Lyon, on collabore avec les musées pour imaginer les expositions de demain. Pour le musée Barthélémy-Thimonnier d'Amplepuis, ils ont imaginé une mappemonde immersive et interactive reliée à l’application Google Earth où le public peut se promener dans divers endroits du monde, notamment dans un igloo lors d’une exposition sur les inuits.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres ! Vous aussi cela vous donne des idées ? Alors n’hésitez pas à découvrir le fablab le plus proche en parcourant une carte interactive du monde entier sur https://www.makery.info/labs-map/, vous serez surpris de l’ampleur du phénomène !
Laurence Louis

Les logos, ces grands bavards !
Couleur, forme, taille, symbole... Chaque trait est travaillé dans ces petits dessins que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Les logos, que cherchent-ils à nous dire ?
Les logos, ces grands bavards !
En 2019, les Catacombes de Paris font appel à l’agence “scéno/graphiste” Mo-To pour effectuer une refonte graphique, et en particulier pour créer leur nouveau logo. Le résultat est remarquable d’ingéniosité et de cohérence. Une occasion de nous pencher sur le logotype, comme outil de communication des lieux culturels, mais encore...
Le CNRTL définit le logo ainsi : “Initiales, mots, graphiques qui singularisent une marque. Le logotype (ou logo) doit permettre de reconnaître au premier coup d'œil, une entreprise ou un produit : c'est une « traduction visuelle » de l'image de marque.”
Les musées et autres lieux d’exposition sont-ils des entreprises ? Ont-ils des images de marque ? Des raisons d’adopter cet outil marketing ?
Le logo est aujourd’hui un outil généralisé et n’est plus seulement l’affaire d’entreprise ou de produit, il est un outil de communication pour promouvoir toute entité proposant différents services. C’est par exemple le cas des logos dits “personnels”, parfois nouvelle forme de signature, créés le plus souvent à partir du nom et du domaine de compétence d’une personne. Dans ce cas, il s’agit moins d’un outil marketing que communicationnel. De même, certaines entités telles que les associations, y compris politiques, ont recours au logo mais n’ont pas pour objectif de dégager un bénéfice économique. Parfois, le logo s’inscrit dans la continuité d’une histoire de symboles, et même d’effigies. C’est le cas par exemple de Marianne, figure allégorique de la République Française, qui constitue aujourd’hui la base de son logo, présent sur tous les sites du gouvernement.
Le logo est une image stylisée, porteuse d’un message et d’une identité visuelle déterminée. Pour les musées, il exprime une prise de position sur l’image de l’institution et met en avant une identité, une intention pour la structure et ses visiteurs. Voyons ce que nous racontent les logos sur quelques-uns de ces musées.
Quand l’histoire de la structure est mise à l’honneur
Parfois, l’Histoire d’une structure joue un rôle central dans son identité, et le contenu qu’elle diffuse.
C’est par exemple le cas du Fresnoy de Tourcoing. Autrefois salle de bal, cinéma, salle de patinage à roulette, brasseries, piscine puis manège d’équitation... Le Fresnoy était un complexe de divertissement populaire, un lieu d’expression et de diffusion artistique qui a connu un succès remarquable de 1905 à 1984. Plus tard, le Fresnoy est choisi pour accueillir le projet de création d’un studio-école transdisciplinaire d’art contemporain, porté par Alain Fleischer, actuel directeur du studio. C’est ainsi qu’à partir de 1991, l’architecte Bernard Tschumi se voit confier la charge du chantier de réhabilitation du bâtiment. Il imagine un toit recouvrant l’ensemble des anciens bâtiments, et crée ainsi une sorte de hangar, qui enveloppe le Fresnoy d’antan. Cette superposition, reconstruction moderne sans destruction de la bâtisse originelle, est un choix constituant l’identité du Fresnoy. En 2012, le studio Dépli Design réalise le nouveau logo de la structure, et se base sur cette relation architecture/histoire. Ainsi, le studio construit une icône du bâtiment et de cette superposition particulière. Les formes géométriques sont minimalistes et la colorimétrie choisie est le noir et blanc, typo en écho aux représentations communes sur l’art contemporain.
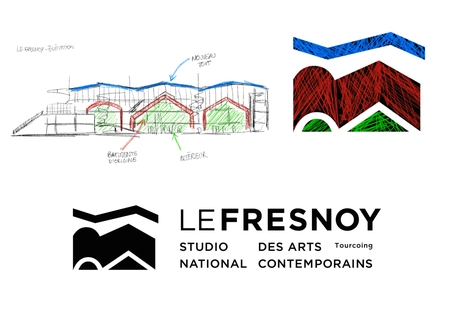
Crédits : Logo – Le Fresnoy / Croquis – Lisa Barris
Quand le logo est un portrait...
Il n’est donc pas rare que le logo d’une structure soit une icône, c’est à dire une analogie, en rapport de ressemblance. Ce peut être le cas sans qu’existe de rapport avec l’histoire d’un bâtiment préexistant.
C’est le cas du logotype du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, qui représente la structure et l’esthétique si particulière du bâtiment. En effet, celui-ci est constitué de multiples paliers entièrement modulables. Pour que cela soit possible, les architectes Piano, Rogers et Franchini ont “rejeté” les circulations de personnes et de fluides à la périphérie du bâtiment, ainsi que la structure porteuse et les gaines techniques. C’est pour ces raisons que le Centre Pompidou a cette forme remarquable. Quant au logo, il a été créé par le graphiste Jean Widmer dans la fin des années 1970, en même temps que le bâtiment lui-même. En fait, Widmer l’a dessiné avant même que le chantier ne soit terminé. L’idée, novatrice à l’époque, de doter le Centre d’un logotype était inscrit dans le projet originel de création de la structure, et il a été conçu en collaboration avec les architectes. Au même titre que la composition du bâtiment, le logo devait représenter la mission du Centre ; donner de la place à l’art contemporain, promouvoir l’unité dans la diversité. C’est ainsi qu’on peut y voir les 6 paliers constituant la structure, tous reliés par l’escalator, appelé communément la “chenille”.
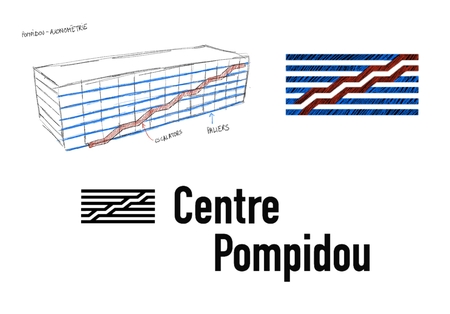
Crédits : Logo – Centre Pompidou / Croquis – Lisa Barris
… de famille
Au-delà d’être l’expression d’une identité propre à une structure, le logotype peut aussi s’inscrire dans un rapport de filiation. C’est par exemple le cas de celui du Pompidou-Metz, construit sur le même principe que celui du Centre Pompidou. En effet, on y voit la forme extérieure du bâtiment, ainsi que les espaces de circulation des personnes, à savoir les escaliers. A Metz, le logo est construit sur la base d’une vue en plan de la bâtisse, tandis que pour le Centre Pompidou il s’agit de l’élévation de la façade ouest. On retrouve aussi le code couleur - riche - des logos de structures d’art contemporain ; le noir et blanc.
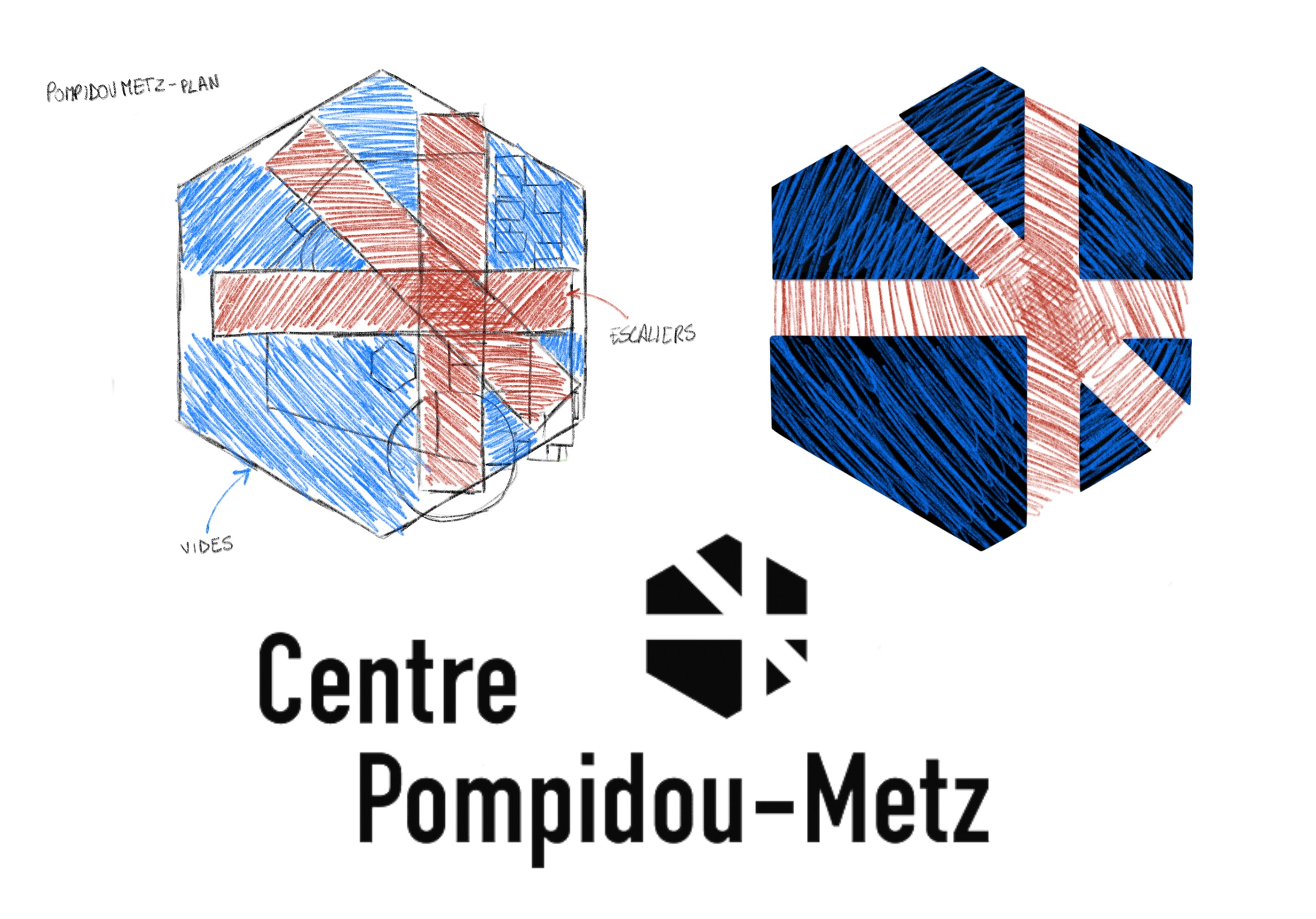
Crédits : Logo – Centre Pompidou-Metz / Croquis – Lisa Barris
Quand le logo pose le cadre
Nous l’avons vu, le logotype est un support qui communique un élément de l’identité des musées. Parfois, ce qui est mis en avant, c’est la structure en tant que symbole.
Si l’on prend l’exemple du Petit Palais, on voit que l’accent est mis sur le cadre. Qu’il dépende de la situation géographique du bâtiment, ou de l’ambiance qu’on y trouvera. Sorte de photo d’identité, on choisit ici de transmettre des informations sur le contenu et le monde à découvrir dans ce musée de Beaux-Arts. Ainsi, le Petit Palais délivre au travers du logo créé par Philippe Apeloig, une certaine image de marque. Celle-ci se base tout d’abord sur l’idée que le Petit Palais est un musée profondément parisien ; partie de l’ensemble constitué par le Grand Palais et le pont Alexandre III, créé à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, composé de peintures et sculptures réalisées à la gloire de Paris, abritant à ces débuts les collections de la ville...etc. La situation géographique du Petit Palais a toute son importance dans l’identité du musée. Le logo est construit sur la base d’un lettrage, c’est à dire une disposition de lettres, constitué de deux “P” pour “Petit Palais” (pourquoi pas une référence au P de Paris ?). Le jeu d’emboitage crée un logo visuellement très lisible, mais aussi riche de sens, qui place le musée dans un espace géographique et symbolique. On y lit d’autre part une référence au jardin du Petit Palais, en demi-cercle. Enfin, le choix de dessiner les lettres avec des empattements (ou “serif” en anglais), ainsi que la graisse de celles-ci (c’est à dire l’épaisseur), rappellent une esthétique classique des Beaux-Arts, à base d’ornements et de symétrie, ainsi que les ferronneries typiques du musée.
Crédits : Logo – Le Petit Palais / Croquis – Lisa Barris
Un logo réussi ?
On le voit, l’utilisation du logo par les lieux de culture paraît pertinente pour plusieurs raisons, et en particulier pour toucher des publics, les emmener à pousser les portes du musée. Quant aux institutions mondialement connues et reconnues, symboles de la Culture, ont-elles encore besoin de motiver l’intérêt des visiteurs ?
Si pour le Petit Palais, l’utilisation des initiales inscrit le logo dans une tradition de support de marque, c’est encore plus vrai pour Le Louvre, dont le logo, créé par Pierre Bernard dans les années 1990, répond à tous les codes marketing classiques. Si l’on revient à la définition qui nous est donnée par le CNRTL, le logotype doit “permettre de reconnaître au premier coup d'œil” l’entité qui l’utilise. Quoi de mieux donc, que d’utiliser le nom de celle-ci ? En théorie, il permet à lui seul de promouvoir la structure ou l’entreprise. Une écriture simple et distinguée, en blanc sur fond presque noir, le logo du Louvre n’est pas sans rappeler ceux des grandes marques de luxe telles que Dior, Prada, Dolce&Gabbana et compagnie. Le tout sur un fond sombre, photo en négatif du ciel nuageux de Paris, comme pour y placer le Louvre en hauteur, référence à la vue depuis les dessous de la fameuse pyramide. Ajouté à cela la typographie visible sur le bâtiment, nommée après son créateur Robert Granjon, graveur et fondeur officiel de la couronne sous le roi Henri II. Le Louvre se veut donc être un symbole de la Culture et de l’élégance “à la française”.
Crédits : Logo – Le Louvre
Un logo réussi !
Pour finir, rappelons que le logotype s’inscrit généralement dans une identité visuelle globale, appelée charte graphique, qui réunit le logo, la typographie, les règles de mise en page, la colorimétrie et tout ce que constitue les supports de communication d’une structure. Ainsi, lorsqu’un musée cherche à travailler son image, il paraît pertinent d’effectuer une refonte graphique.
Ce fut donc le cas des Catacombes de Paris en 2019, l’objectif étant d’en moderniser et dynamiser l’image. Le studio Mo-To a donc créé un logo reprenant le C des Catacombes, en y insérant de petites formes géométriques, le tout formant un crâne, objet iconique de l’ossuaire. En continuité, le nom “Les Catacombes de Paris” semble donner un corps à cette tête, et n’est pas sans rappeler les murs des galeries. La famille typographique créée par Thomas Bouville existe en trois graisses distinctes (épaisseur de la lettre), et répond à différents besoins éditoriaux tels que les styles dédiés aux titres, sous-titres, textes courants...etc. La typographie est ainsi faite que l’empattement est identique d’un style à l’autre malgré la graisse perdue ; c’est une référence à la chair quittant l’os au cours de la décomposition. [Concernant les règles de composition et la colorimétrie choisie, voir la section “pour aller plus loin”]. Ainsi, cette charte graphique nous donne un bel aperçu de l’outil qu’elle constitue. Ici, Mo-To a su moderniser l’identité visuelle des Catacombes, et mettre fidèlement en avant leur contenu, malgré sa dimension sombre et plutôt glauque. De ce fait, la communication est explicite mais grand public, et traduit l’ambiance, le contenu, l’histoire, l’architecture et le cadre qui caractérisent les Catacombes.
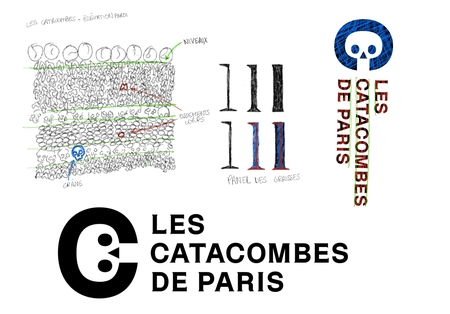
Crédits : Logo – Les Catacombes de Paris / Croquis – Lisa Barris
Tous ces exemples constituent un infime échantillon de ce que représente le logo pour les institutions. Au travers des tendances et des besoins, le logo varie du tout au tout et nous prenons ici une photographie de ce que l’on peut observer à l’heure actuelle. L’intérêt porté à l’identité graphique des structures est grandissant, et constituera probablement un axe privilégié de progrès pour celles-ci. Rappelons aussi que les exemples pris ici sont limités à de grandes institutions, qui ont les moyens financiers d’externaliser la création de ces logos, en faisant appel à des agences spécialisées. C’est pour cette raison qu’on se permet ici de les lire, de les juger, car ils sont le fruit du travail de professionnels, qui connaissent le poids des images.
Lisa Barris
Pour aller plus loin...
- Le Fresnoy - Les recherches graphiques :
Dépli Design : https://depli-ds.com/index/fiche/id/93/categorie/1/lang/fr - Le Centre Pompidou – Histoire du logo :
“40 ans après, le secret d’un logo devenu mythique”: https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/40-ans-apres-les-secrets-dun-logo-devenu-mythique - Louvre - Les créateurs du logo :
Un article sur Pierre Bernard, père du logo : https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/pierre-bernard-grapus-graphiste-utilite-publique - L’Atelier de création graphique : http://www.acgparis.com/index.php?id=54
- Article qui retrace l’histoire de l’identité graphique du Louvre : https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/le-musee-du-louvre-doit-etre-le-musee-par-excellence/
- Les Catacombes de Paris - La charte graphique
Le site de Mo-To : http://www.mo-to.fr/les-catacombes-de-paris
Article très détaillé publié par Graphéine : https://www.grapheine.com/actulogo/le-logo-mortel-des-catacombes-de-paris - Bonus - logo et défiscalisation/le mécénat en compétence :
https://www.grapheine.com/actulogo/le-petit-palais-qui-ressuscitait-les-logos-morts
#logo #musée #décryptage

Libérez les Graphzines !
Deux crayons posés sur la table de l’exposition «Graphzines», depuis le vernissage, racontent le déroulement de l’exposition et de tout ce qu’ils ont vu et vécu, de leurs mines aiguisées.
© photos personnelles
 L’exposition Graphzines fait partie du thema proposé par le LaM, introduite à la fin du parcours de l’exposition principale « L’Autre de l’Art ». Elle s’est poursuivie à la bibliothèque universitaire de Lille 3 et présente, du 14 octobre au 17 décembre 2014, une exposition sur l’univers des graphzines. Le collectif Cagibi, qui a mis en scène cette exposition, a installé une œuvre interactive « Cubi » réalisée en Août 2014 afin de laisser libre expression au visiteur. Ce cube inspiré de celui de Yoshimoto inventé en 1971 est constitué de 8 petits cubes dont les faces peuvent s’assembler et se désassembler selon de multiples combinaisons,pour faire naître des dessins coordonnés. Pour cette installation, des stylos ont été déposés sur la table et mis à disposition des visiteurs ; parmi eux deux stylos célèbres, «Mondrian de Carré d’Arche » et « Charlie Pro Marker ». Nous avons pu enregistrer une de leur conversation datant du 7 décembre 2014aux environs de 14h ; quelques semaines après l’exposition, nous vous proposons une retranscription.
L’exposition Graphzines fait partie du thema proposé par le LaM, introduite à la fin du parcours de l’exposition principale « L’Autre de l’Art ». Elle s’est poursuivie à la bibliothèque universitaire de Lille 3 et présente, du 14 octobre au 17 décembre 2014, une exposition sur l’univers des graphzines. Le collectif Cagibi, qui a mis en scène cette exposition, a installé une œuvre interactive « Cubi » réalisée en Août 2014 afin de laisser libre expression au visiteur. Ce cube inspiré de celui de Yoshimoto inventé en 1971 est constitué de 8 petits cubes dont les faces peuvent s’assembler et se désassembler selon de multiples combinaisons,pour faire naître des dessins coordonnés. Pour cette installation, des stylos ont été déposés sur la table et mis à disposition des visiteurs ; parmi eux deux stylos célèbres, «Mondrian de Carré d’Arche » et « Charlie Pro Marker ». Nous avons pu enregistrer une de leur conversation datant du 7 décembre 2014aux environs de 14h ; quelques semaines après l’exposition, nous vous proposons une retranscription.
Ces deux crayons discutent de l’exposition et des dessins dont ils ont été les acteurs :
Leur conversation a débuté depuis un moment ; « Mondrian de Carré d’Arche » de sa voix suave et inquiète, explique son incompréhension face à l’exposition :
- …non seulement nous ne sommes pas dans une institution muséale reconnue et le peu de moyen mis en œuvre nous confine dans ce petit espace exiguë, mais, en plus, nous sommes relayés dans ce coin sombre. Je souffre.
© photos personnelles

Charlie Pro Marker tente d’apaiser les inquiétudes de son ami)
- Arrête de te plaindre et ouvre les yeux ; on ne voit que nous dans ce hall pâle et lisse, les étudiants s’arrêtent dans cette exposition, s’interrogent et s’attardent. Oui, l’espace est petit et, pour tout t’avouer ce tapis noir au sol me frustre un peu, mais ici, une vraie atmosphère a été créée. La mise en scène est originale, une réelle immersion est proposée dans l’univers, peu connu et décalé, des graphzines.
- Les graphzines parlons–en ! Qu‘est ce que c’est que ces gribouillages saturés ? Impossible de distinguer les œuvres de leurs supports. Il n’y a pas de parcours, pas de flèches, pas de séquences, les gens sont perdus ici, perdus !
- Mais, mon ami, c’est justement ça les graphzines. Les artistes eux même ne veulent pas définir leur travail, ils dessinent sans normes, sans règles ni contraintes, mais avec un seul mot d’ordre : une liberté d’expression totale. Polémique ou poétique, toujours un peu satirique, leurs auteurs apportent un regard nouveau sur nos quotidiens, le monde qui nous entoure et nos sociétés.
- Mais comment veux-tu que je comprenne tout cela ? Rien n’est indiqué, les œuvres, si nous pouvons les nommer ainsi, ne sont pas toutes référencées. Par exemple, celles suspendues par une ficelle colorée, palpables par toutes ces mains moites, et exposées au danger de tous ces microbes humains, d’où viennent-elles ? Tu sais bien toi Charlie Pro Marker, lorsqu’une main étale notre encre encore fraiche anéantissant ainsi la ligne parfaite, le tracé subjectif du dessinateur… Haaaaaa j’en frissonne encore…
 - Mais justement ! C’est ça l’esprit des graphzines : une création spontanée et sans limites. Ils sont issus de bandes dessinées alternatives, qui ne sont pas éditées par des maisons d’édition. D’ailleurs certaines œuvres exposées seront même vendues à des prix très accessibles à la fin de cette exposition ! Photocopiée ou sérigraphiée, c’est ce qui fait l’originalité de chacune, quant aux traces, tant pis, rien ne vaut un libre accès à l’art !
- Mais justement ! C’est ça l’esprit des graphzines : une création spontanée et sans limites. Ils sont issus de bandes dessinées alternatives, qui ne sont pas éditées par des maisons d’édition. D’ailleurs certaines œuvres exposées seront même vendues à des prix très accessibles à la fin de cette exposition ! Photocopiée ou sérigraphiée, c’est ce qui fait l’originalité de chacune, quant aux traces, tant pis, rien ne vaut un libre accès à l’art !
- T’appelles ça de l’art toi ? Personnellement vu les dessins que j’ai vécu ces derniers jours, sur ce maudit cube, je suis loin d’y accéder ou même d’y participer…(Mondrian, éprouvé et ému cherche alors ses mots) …Je pense que je développe le «complexe du blanco», c’est ce qu’on dit dans lemilieu des beaux arts, en parlant de nos confrères sacrifiés au nom de la liberté d’expression et condamnés à dessiner des ignominies sur les tables des lycées.
 - Qu’entends-tu par « ignominies » ? On m’a utilisé pour faire un dessin engagé hier et énormément de messages étudiants ont pu être inscrits au cours de cette exposition. Par nous et sur ce cube s’inscrit l’humour, l’amour, la révolte, des revendications politiques. L’absurde et la pertinence d’un message ne sont pas toujours antinomiques. Laisse-moi te raconter mes expériences passées. (La mine souriante et espiègle Pro Charlie commence son récit). J’en ai dessiné des conneries d’ados révoltés et insouciants. Avant d’être ici, j’ai été longuement utilisé par la main d’un dessinateur de journal satirique. C’est là la force du dessin et de notre travail, faire émerger des messages profonds à travers une liberté totale. Je me souviens de ces réunions en salle de rédaction desquelles je sortais épuisé et vidé d’avoir noirci des pages pour mettre en lumière des idées. Ils ne censuraient aucun symbole et la force émanant du dessin achevé était parfois imprévisible. C’est dans ce sens, que j’apprécie d’être ici, de prôner la liberté d’expression et la non-censure dans un lieu institutionnel et universitaire. L’étudiant qui dessinait, à travers toi, hier, sera peut – être un de ces agitateurs de demain. Laissons les dessiner partout, tout le temps, sur les murs, les tables, les chaises, au stylo et à la craie, de façon absurde, bête, féroce, révoltée : de ces bites naîtront des discours.
- Qu’entends-tu par « ignominies » ? On m’a utilisé pour faire un dessin engagé hier et énormément de messages étudiants ont pu être inscrits au cours de cette exposition. Par nous et sur ce cube s’inscrit l’humour, l’amour, la révolte, des revendications politiques. L’absurde et la pertinence d’un message ne sont pas toujours antinomiques. Laisse-moi te raconter mes expériences passées. (La mine souriante et espiègle Pro Charlie commence son récit). J’en ai dessiné des conneries d’ados révoltés et insouciants. Avant d’être ici, j’ai été longuement utilisé par la main d’un dessinateur de journal satirique. C’est là la force du dessin et de notre travail, faire émerger des messages profonds à travers une liberté totale. Je me souviens de ces réunions en salle de rédaction desquelles je sortais épuisé et vidé d’avoir noirci des pages pour mettre en lumière des idées. Ils ne censuraient aucun symbole et la force émanant du dessin achevé était parfois imprévisible. C’est dans ce sens, que j’apprécie d’être ici, de prôner la liberté d’expression et la non-censure dans un lieu institutionnel et universitaire. L’étudiant qui dessinait, à travers toi, hier, sera peut – être un de ces agitateurs de demain. Laissons les dessiner partout, tout le temps, sur les murs, les tables, les chaises, au stylo et à la craie, de façon absurde, bête, féroce, révoltée : de ces bites naîtront des discours.
- Alors, allons-y, je te suis Charlie. »
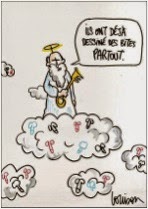
Dessin fait par Louison le 8 janvier 2015 suite aux attentats contre « Charlie Hebdo »
©lanouvelleedition.fr
Cléa Raousset et Margot Delobelle
#graphzine #liberté #expression
Magnet Basel : exposer des dossiers d'archives, comment et pourquoi ?
Le thème universel de la migration appliqué au territoire des trois frontières.
En abordant les migrations, les musées s’approprient un thème très présent dans l’actualité. Ceux de Bâle et ses alentours (y compris transfrontaliers) ont fait le choix de montrer comment la thématique a été et est présente sur leur territoire grâce aux archives de la police bâloise des étrangers.
La série d’expositions Magnet Baseltraitait de la zone frontalière des trois pays (Suisse, Allemagne, France). Les différentes expositions ont pris place entre avril et octobre 2017 dans quatre lieux suisses et un allemand. Leur lien avec leurs territoires se retrouve dans leurs thèmes : celle sur les jeunes allemandes qui allaient être employées de maison à Bâle était au Musée des trois-frontière à Lörrach (Allemagne). Magnet Baselétait donc bien reliée à son territoire, ce qui permettait au public de se sentir plus concerné. Malheureusement elle ne pouvait être comprise que par des germanophones, écartant le public francophone de la zone, faute de traduction.
La carte surle site internet de Magnet Basel montre les lieuxd’expositions par des numéros et les histoires par des triangles noirs. (Source : http://www.magnetbasel.ch/)
L’élaboration des expositions
Le projet a été lancé par les archives du canton de Bâle-ville qui ont choisi des dossiers. La sélection s’est faite au sein du fonds de la police des étrangers de Bâle (1917-1970), sur des critères d’intérêt et de légalité, les expositions montrent la très grande diversité des trajectoires de vie de ce fonds. Légalement pour que les dossiers puissent être présentés toutes les personnes mentionnées doivent avoir donné leur accord ou être mortes depuis plus de 10 ans. Dans certains dossiers des zones ont été noircies puisqu’elles ne tombent dans aucunes des deux catégories suivantes. Des éléments plus actuels ne faisant pas partie du fonds d’archive ont également été incorporés dans certaines expositions.
À partir de cette volonté et de ces recherches l’exposition a été conçue entièrement en externe (muséographie, scénographie, graphisme) et en collaboration avec des illustrateurs.
Une source, plusieurs approches
Tout l’enjeu est d’exposer les dossiers choisis de manière compréhensible et cohérente. L’articulation des différents dossiers fait sens à deux niveaux, à l’intérieur de chaque exposition thématique, et les expositions ensemble.
Plusieurs procédés sont utilisés pour exposer les données, avec entrées et des degrés d’implications divers. Deux manières de faire se distinguent : rassembler pour proposer une vision globale, et explorer les différentes histoires de vie en voyant chaque dossier séparément.
Au Museum für Wohnkultur(Musée de l’habitat) dans l’exposition« Bewilligt. geduldet. Abgewiesen » (« Accordé. Toléré. Renvoyé »), une manière de faire correspond une salle. Cette exposition englobe toutes les thématiques de MagnetBasel et montre la très grande diversité des histoires présentes dans le fonds d’archive de la police des étrangers, en s’intéressant à comment et pourquoi les étrangers à Bâle ont pu rester ou au contraire du partir.
La première salle présente chaque dossier et son histoire individuellement. Celles-ci sont illustrées sur des panneaux, disposés tout autour de la salle, qui constituent le premier niveau d’entrée dans l’exposition. Ils accrochent l’œil du visiteur dès son entrée et l’entrainent dans l’histoire grâce à l’illustration. Pour inviter à s’approcher les panneaux commencent avec une accroche, telle que :
« Pourquoi la fuite à Bâle de l’apprenti boulanger Arnold Wochenmark et de Johanna Braunschweig, une domestique, malgré tous les soucis mène en 1945 à une fin heureuse »
La première salle © S.G.
On peut vraiment prendre plaisir à lire ces récits mis en lumière par le dessin. La diversité des illustrateurs enrichis beaucoup ce médium en proposant plusieurs visions et sensibilités artistiques. Les objets liés rendent palpables ces histoires, et on peut facilement imaginer qu’ils permettent au jeune public de s’intéresser à l’exposition. Les visiteurs sont libres d’approfondir, ou non, grâce à la reproduction des dossiers sur une table centrale, et à un rétroprojecteur en libre service pour projeter certains documents des dossiers.
La deuxième salle au contraire rassemble les informations des dossiers, présentées de manière graphique.
Un premier panneau avant d’entrer véritablement dans la salle, remet l’exposition dans ses contextes historiques, avec pour chaque type d’événement une couleur. Il met en regard les événements historiques, internationaux, nationaux, locaux et économiques ayanteu un impact sur les migrations entre 1900 et 1970. Pour l’année1968 par exemple sont marqués : en gris pour Bâle les premières femmes au parlement cantonal, et en rose pour l’international le Printemps de Prague.
Un procédé similaire sert à faire apparaître des typologies de documents ou mentions dans les dossiers, triées par organisme ayant fourni ledocument. Cela fait apparaître des îlots colorés sur les murs de la salle et éclaire sur le rôle de chaque acteur, tels que l’agence pour le travail, les employeurs, la sécurité sociale, les consulats, la police etc.
Au milieu se trouve une table avec des informations complémentaires et une machine à écrire évoquant les bureaux sur lesquels les dossiers ont été constitués.
La deuxième salle © S.G.
Exposer les archives
L’exposition porte sur l’histoire et les histoires de migrations dans la région, mais à travers ce thème c’est aussi l’institution et le fonctionnement des archives qui sont montrées aux publics.
La scénographie évoque les archives dans l’exposition par le mobilier en en reprenant les codes pour la grande table de consultation de la première salle notamment. Leur matérialité est au centre de l’exposition grâce à la vitrine remplie de cartons d’archives qui sert de cloison entre les deux salles d’exposition.
Plus que de simplement voir le visiteur peut expérimenter les archives, les dossiers reproduits sur la grande table de consultation l’invitentà les consulter et à devenir « chercheur ». Cette pratique lui permet de se familiariser avec l’institution, et en tant que citoyen d’en comprendre mieux l’utilité.
Pour les germanophones qui souhaiteraient creuser le sujet, le blog des archives de la ville de Bâle a publié une série d’articles su rles recherches autour de l’exposition. http://blog.staatsarchiv-bs.ch/forscherinseln-magnet-basel/
Bethsabée Goudal

#Archives
#Migrations
#3frontières

Musées dans le métro
Doukevienlafiche ? Mais que vois-je ? Dans les couloirs du métro, Orsay a ressorti ses affiches, créée par l’agence Madame Bovary en octobre 2015.
Elles n’annoncent pas une nouvelle exposition, un événement, non elles incitent les citadins à revenir user leurs savates dans l’ancienne gare. Plus, elles appellent les parents à venir éduquer leur progéniture. Le musée, lieu d’éducation et de délectation. C’est le meilleur moyen de fidéliser un public, montrer dès l’enfance que le musée n’est pas (plus ?) un lieu poussiéreux et ennuyeux (enfin, pas tous), un lieu non scolaire (quoique les visites de primaires tendent bien souvent à n’en faire qu’une extension de l’école, où l’on y suit les mêmes règles : s’asseoir et écouter, lever le doigt, ne pas parler, ne pas courir, ne pas rire…), un lieu où l’on s’amuse.
Mais assez sournoisement, ces slogans confortent les théories de Bourdieu :« Toute la tradition culturelle des pays de vieille tradition s’exprime en effet dans un rapport traditionnel à la culture qui ne peut se constituer dans sa modalité propre, avec la complicité des institutions chargées d’organiser le culte de la culture, que dans le cas où le principe de la dévotion culturelle a été inculquée, dès la prime enfance, par des incitations et les sanctions de la tradition familiale.[1] » La tradition familiale, déterminisme social de la fréquentation des lieux culturels.J’ignore si des études ont été menées pour évaluer la portée de cette campagne publicitaire, mais la fréquentation du musée a-t-elle vu déferler des vagues de familles primo-visiteurs ? N’était-ce qu’une piqûre de rappel pour les nouveaux parents (anciens enfants visiteurs, de fait), qui déjà fréquentent régulièrement les musées ?
Il y a quelques semaines, les trente années du musée d’Orsay ont été fêtées par la floraison de plusieurs nouvelles affiches aux slogans alléchants : mettez vous sur votre 31 et Aucune tenue n’est exigée (ou presque). Robe de soirée ou nu artistique, on n’est pas loin du Venez comme vous êtes d’une certaine chaîne de malbouffe institutionnalisée… mais le message sonne étrangement faux lorsque le musée est éclaboussé à la même période par plusieurs sorties manu militari de classes de banlieue et de familles défavorisées[2] qui viennent contredire le message d’ouverture baba cool si lyriquement annoncé. Sans même parler de l’artiste Déborah de Roberti, expulsée par deux fois du musée pour s’être allongée nue[3] devant L’Origine du monde et l’Olympia.
Les opérations de comm’ cherchent à attirer de nouveaux publics, moins enclins à passer leurs après-midi pluvieuses devant des Kandinsky ou des cathares grecs. La mise en place d’une carte pass étudiant au musée Fabre de Montpellier a été l’occasion de lancer à la rentrée de septembre une opération de séduction pour le public étudiant. Ces deux visuels diffusés uniquement en ligne jouent sur la même corde décalée que le musée d’Orsay, le musée étant aussi un lieu des premières sensations émoustillées (moi même...).
L’idée venant du musée a été soumise à une agence. Celle-ci a réalisé une petite étude du public et proposé plusieurs pistes, soumises à la Métropole dont dépend le musée avant validation. La diffusion sur les réseaux étudiants, universitaires, ou via les réseaux sociaux a ses limites, sans compter la pudibonderie aberrante de Facebook qui a censuré ces deux floutages au motif de caractère tendancieux. (Cette opération de censure d’œuvres au nom de la peau dévoilée, de ce sein que la bienséance ne saurait voir et qui vise au systématisme – on ne compte plus les photos de fontaines baroques, tableaux et sculptures centenaires interdites de séjour sur le sol pas palpable d’internet– n’est pas sans évoquer l’emballage des indécentes statues antiques du Musée du Capitole afin de protéger les chastes pupilles du président iranien en janvier 2016.) Fort heureusement, après quelques semaines de blocage, ces affiches ont tout de même pu être lancées à la conquête du réseau. Il demeure cependant que ces affiches restent très discrètes et peu diffusées hors du public ciblé directement (étudiants montpelliérains), ce qui est dommage pour une campagne publicitaire.
Orsay n’a cependant pas le monopole des affiches du métropolitain. On y croise les placards annonçant de sexpositions temporaires. À venir : le Grand Palais a lancé une campagne avec un seul mot, une seule promesse : « Bientôt ». Nulle date ni titre. Le sujet n’étant précisé que sous l’excuse d’un # en petites lettres en bas. Si on reconnaît vite le Penseur, le tableau de Klimt ne touche qu’un public averti, quant à la parure indienne…
Les couloirs nous allèchent avec des expositions en cours ou presque terminées, les affiches alors dotées d’un bandeau « derniers jours » ou « prolongation », collé de biais tel une écharpe d’élu, sous entendu : « dépêchez vous de venir, mais attention il y aura du monde ! ».
Les musées en quête de publicité
Le Château de Versailles n’est pas en reste et envahit lui aussi la lumière blafarde des couloirs métropolitains pour y ouvrir des fenêtres de couleur et de soleil. Jouant, comme Orsay sur une série d’affiches avec pour leitmotiv une expression anaphorique suivie de l’emploi de l’impératif, qui n’est pas anodin et est loin d’être une nouveauté dans le domaine de la publicité, avant les variations de fin.
Un certain modèle de publicité pour musée se démarque ces dernières années. Miser sur l’humour, sur la tentation ou le besoin de vacances, bref sur le côté décontracté des institutions muséales. Se désolidariser de la poussière des salles glauques d’un vieux Louvre. Briser les barrières psychologiques dressées devant la pompe de ces lieux, nouvelle aux yeux de ceux qui ne sont pas habitués à en arpenter les allées.
L’ouverture de l’antenne de Lens jouait déjà sur cette corde (cas intéressant de publicité périssable puisque l’œuvre de Delacroix est retourné après un an d’exposition dans les galeries de peinture française du Louvre-Paris).
En fouillant un peu les archives publicitaires, on peut trouver des publicités totalement à l’opposé de cette vision, insistant sur le contenu de façon plus sérieuse, froide, distante, et sans doute plus rebutant : en 2012, le Musée de la Grande Guerre, à Meaux et la Cité de l’Immigration, à Paris, ont fait une proposition particulièrement austère, alors même que l’ouverture d’un nouveau musée ou la réouverture après une période de travaux est l’occasion de donner une identité particulière au musée et le ton de son discours. La sentence péremptoire à haute vertu pédagogique, associée à une photo ancienne noir et blanc éloignant encore davantage l’institution de la vision d’un musée moderne, vivant et dynamique et surtout comme lieu d’éducation non scolaire. Comment attirer ainsi un public peu enclin à franchir les portes imposantes d’un musée ?
Affiche du Musée de la Grande Guerre, à Meaux (2012)
Si une deuxième affiche de la Cité de l’Immigration plaçait « Ton grand-père dans un musée. » (notons la formule sans verbe, presque une apostrophe, presque une insulte délicieusement absurde), elle ne fait qu’insister sur le musée nostalgique plein de vieux albums de famille et de vieilleries poussiéreuses mais sans doute est-ce une fibre qui attire un public familial urbain, nostalgique d’un c’était mieux avant et du pittoresque des anciens métiers.
Plus récemment, en 2016, année anniversaire de nombreux musées parisiens, en particulier des dix bougies du Quai Branly (pardon, du désormais baptisé Musée du Quai Branly – Jacques Chirac), occasion d’inviter le dessinateur Riad Sattouf à réaliser l’affiche dont les traits de Bande dessinées ne sont pas sans évoquer le fétiche à l’Oreille Cassée et la pop-culture voguant sur l’esthétique de l’archéologie et des cultures non occidentales. Le médium utilisé, le personnage qui vient compléter la série (après le grand-père, voilà le gamin sous vitrine), interpellent un public plus jeune, visent même directement les enfants, contrairement à la campagne d’Orsay qui s’adresse aux parents (encore que…).
Que de raisons de se rendre au musée ! S’instruire et s’amuser, voir « des sales gosses » ou des bijoux de famille, des antiquités ou son aïeul… Encore faut-il que les musées tiennent leurs promesses.
Jérôme Politi
#affichedemusée
#sinstruirensamusant
#métro
Merci à Marion Boutellier, Chargée des publics au Musée Fabre, pour avoir répondu à mes questions.
[1] Bourdieu Pierre et Darbel Alain, L’Amour de l’art, Les éditions de Minuit, 1969, p. 65-66
[2] http://www.sudouest.fr/2016/12/09/des-eleves-de-banlieue-chasses-du-musee-d-orsay-leur-prof-s-indigne-sur-facebook-3013559-4699.php
et
[3] http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/17/nue-musee-orsay-paris-exhibitionnisme_n_9003114.html
Oh couleurs ! : le design revisité par leur prisme
Le musée des arts décoratifs et du design (MADD) de Bordeaux présente cet automne 2017 une exposition sur les couleurs, intitulée Oh Couleurs !
Ⓒ S. Goudal
À partir d’un thème qui paraît très simple les concepteurs de l’exposition déroulent, dans les nouveaux espaces d’exposition du musée, « l’ancienne prison », et le parcours permanent, tout un ensemble de thématiques telles que « le rouge par Michel Pastoureau » ou « le processus de colorisation par capillarité ». Fidèle aux arts « appliqués » que convoquent les objets de design, l’exposition tient à la fois des arts et de l’industrie, sans oublier l’évocation de différents territoires qu’ils soient locaux ou plus lointains. Ainsi des œuvres d’art sont également exposées et les artistes à plusieurs reprises évoqués, avec « la couleur comme matériau Donald Judd » par exemple.
Ⓒ S. Goudal
La scénographie joue un rôle important et se sert des espaces de l’ancienne prison puis du parcours permanent. En effet les bâtiments du musée ont une histoire riche et sont très marqués, identifiables. L’Hôtel de Lalande est un ancien hôtel particulier qui fut au cours de son histoire, marqué par la révolution, changea à plusieurs reprises de propriétaires, puis acquis par la Ville pour héberger fin XIXe siècle les services de la police et des mœurs. Dans la nouvelle extension, « l’ancienne prison », l’architecture permet d’alterner grand et petits espaces et crée ainsi des boîtes thématiques dans les cellules autour de créations ou de couleurs à l’image de « l’irisation », « le jaune du Sud », et les Tuperwares avec « la couleur du plastique ». Beaucoup d’espaces se focalisent sur un designer associé à des produits ou à un thème, bien qu’il y ait d’autres cas de figures comme la couleur des drapeaux. Tout concourt ici, les espaces exceptionnels, les objets, la scénographie, à rendre l’exposition très photogénique, notamment pour les réseaux sociaux tels qu’Instagram.
Ⓒ S. Goudal
Pour construire l’exposition les commissaires ont mis en place de nombreuses productions voire commandes spécifiques. Un espace est dédié aux « couleurs de Bordeaux Irma Bloom » où un papier peint symbolisant les couleurs de la ville a été spécialement créé pour l’exposition. Une carte blanche est également donnée au designer Pierre Charpin. Enfin grâce à une collaboration avec des éditeurs de design des objets vont nous étonner !
C’est en regardant une série que j’ai vu une pièce de design, repérée auparavant dans une exposition, elle me plaisait beaucoup mais j’ignorais son nom. J’ai posté un message avec une capture d’écran sur Twitter et à mon grand étonnement un des musées de Bordeaux m’a répondu : la pièce est justement présenté au MADD dans l’exposition Oh Couleurs ! Lors de ma première visite je découvre Living Tower de Verner Panton (1969) présenté dans une pièce, « L’usage de la couleur par Verner Panton » dédiée à ce designer et son travail symptomatique pour le restaurant Varna à Aarhus (Danemark). L’objet est non seulement bel et bien là mais il est également possible d’expérimenter ce mobilier ! Le visiteur peut, après avoir enlevé ses chaussures, pénétrer dans cet univers et s’asseoir sur les fauteuils, « grimper » dans le Living Tower et véritablement profiter quelques instants de ces objets de design. C’est une belle surprise réservée aux visiteurs ! Cette expérimentation semble très appréciée des publics, et notamment du jeune public, d’où de nombreuses photographies. Les conditions de présentation, reconstituant un univers complet, la dimension exceptionnelle du Living Tower permettent vraiment au visiteur d’entrer dans une « bulle » et peut-être de se sentir comme invité dans cette pièce.
Ⓒ S. Goudal
Une grande attention à la participation et à l’expérimentation des publics anime l’exposition : l’atelier pour les enfants, « Josef Albers et l’enseignement des couleurs », utilisé aussi bien par les enfants que les adultes. L’exposition fait également appel à la réalité virtuelle autour du travail de Paule Marot sur les couleurs des voitures à la Régie Renault. Ainsi entre les objets, la scénographie et les dispositifs, chaque boîte thématique est singulière tout en faisant partie d’un plus grand ensemble. On peut parfois avoir l’impression que manquent des liens entre les cellules, peut-être une des limites de cette exposition, à moins de la vivre comme une exploration de différents univers, un parcours non-linéaire.
Le problème qui peut se poser alors est le partage de l’espace et de ces activités. Après avoir visité l’exposition à plusieurs reprises, il est arrivé que l’espace du Living Tower soit approprié pendant un temps assez long par quelques personnes…
L’exposition échappe ainsi de façon innovante au « simplisme » de la thématique et propose à travers des dispositifs renouvelés un contenu de fond dépassant l’aspect « joli » des couleurs.
Salambô Goudal
#design
#expérimentation
#scénographie
Pour en savoir plus :
Exposition du 29 juin au 5 novembre 2017, prolongée jusqu’au 3 décembre. http://www.madd-bordeaux.fr/les-expositions/oh-couleurs
Tous les titres de thématiques sont repris du plan de l’exposition.

Quelle signalétique pour le musée ?
Quand je rentre dans un musée, j’observe la cohérence et la position de la signalétique, afin d’instantanément visualiser mon parcours de visite. Pourtant au fil de mes nombreuses visites muséales je me suis perdue plus d’une fois et/ou ai été frustrée d’avoir raté une section de l’exposition. Je me suis donc penchée sur cet élément graphique indispensable, qui se doit d’être à la fois discret mais suffisamment visible pour être efficace.
Un système de signes à part entière
La signalétique se définit comme un système de signes identifiés dans un espace précis, présentant des repères scriptovisuels (langage qui présente à la fois des mots et des images) permettant un double niveau d’interprétation d’informations synthétisées. Pour résumer, la signalétique permet de faire passer un maximum d’informations à l’aide d’un minimum de signes1. Ces derniers prennent la forme de mots, de couleurs, de formes graphiques, composant un ensemble d’éléments visuels, qui, pour permettre une bonne compréhension, sont étroitement liés entre eux.
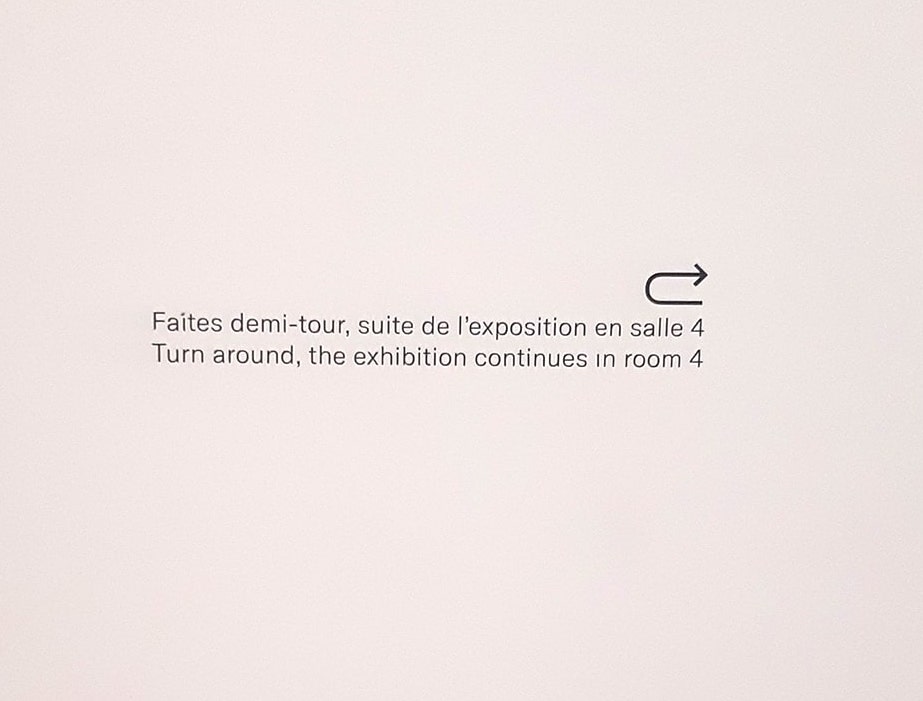
Exemple de signalétique directionnelle : Musée Picasso - Paris © Tiffany Corrieri

Exemple de signalétique directionnelle : Palais des Beaux-Arts de Lille - Lille © Tiffany Corrieri
Le champ de la signalétique est large et se retrouve partout. Pour autant il diffère d’un lieu à un autre ; la signalétique urbaine et routière ne remplit pas les mêmes fonctions et usages qu’une signalétique patrimoniale. En effet le musée s’identifie comme un espace chargé de sens, propre à une période historique, à un artiste ou une collection dont il est nécessaire de connaître les codes pour l'apprécier, et dans lequel le visiteur se retrouve suite à une intention, un projet, qui est décidé sur son temps libre et dont l’exploitation des connaissances peut-être nul par la suite. Cette signalétique accompagne, structure et prend en charge les déplacements des visiteurs dans l’organisation des parcours de visite, tout en assurant leur sécurité. C’est pourquoi il est important que ces derniers identifient distinctement ce qui est de l’ordre des services et de la circulation et ce qui touche à la visite et aux contenus.
Ainsi il existe plusieurs types de signalétique qui répondent chacune à un besoin spécifique.
La signalétique directionnelle pour diriger le visiteur
Également appelée signalétique orientationnelle, elle aide le visiteur à se repérer et à se diriger dans un parcours et un environnement précis, et ce sans difficultés. Elle illustre ce trajet par un balisage composé de repères facilement repérables mais suffisamment discrets pour ne pas jouer sur le confort et la qualité de visite. La signalétique directionnelle permet ainsi de rassurer le public dans son parcours, et « [..] d’éviter la frustration ou la peur de mal faire qui sont latentes chez beaucoup de visiteurs de bonne volonté2 » qui vont, d’après les études de S.Bitgood, très rarement retourner sur leurs pas après avoir emprunté un mauvais chemin.
Pour que cette signalétique soit efficace, il est nécessaire de mesurer la densité et l’emplacement des repères signalétiques, qui se doivent d’être déchiffrés de loin. Il faut donc trouver un juste milieu entre le trop de signes qui perd en efficacité et peut être confondu avec des informations secondaires, et le pas assez qui rompt le parcours du visiteur et le décourage.
Répondant à une orientation universelle, la signalétique directionnelle est aussi réfléchie en terme d’accessibilité, avec par exemple des bandes podotactiles qui permettent aux visiteurs malvoyants de se repérer au sol en les guidant vers les panneaux et œuvres accessibles, et en facilitant le passage d’une pièce à une autre.
La signalétique conceptuelle pour anticiper la visite
Elle prend la forme d'une anticipation, d’une visualisation du parcours de visite de la part du visiteur. Étant donné que ce dernier a un projet et un temps déjà réfléchi en amont lors de son arrivée dans un environnement muséal ou patrimonial, la signalétique conceptuelle lui permet de vérifier la pertinence de ses choix et/ou de les moduler par la suite, en fonction de l’offre proposée.
Les dispositifs de signalétiques conceptuelles les plus communs prennent la forme de cartes, plans, maquettes, listes ou menus qui apportent une vue d'ensemble, et schématisent les espaces à explorer en permettant de repérer les offres dites «vedettes» dans l’ensemble de la structure. Ainsi l’espace est plus facilement mémorisable et appréhendé, notamment quand des éléments concrets, facilement identifiables et favorisant l’interprétation d’éléments plus abstraits et symboliques, sont mis en avant, tel que la reproduction d’un chef-d'œuvre.
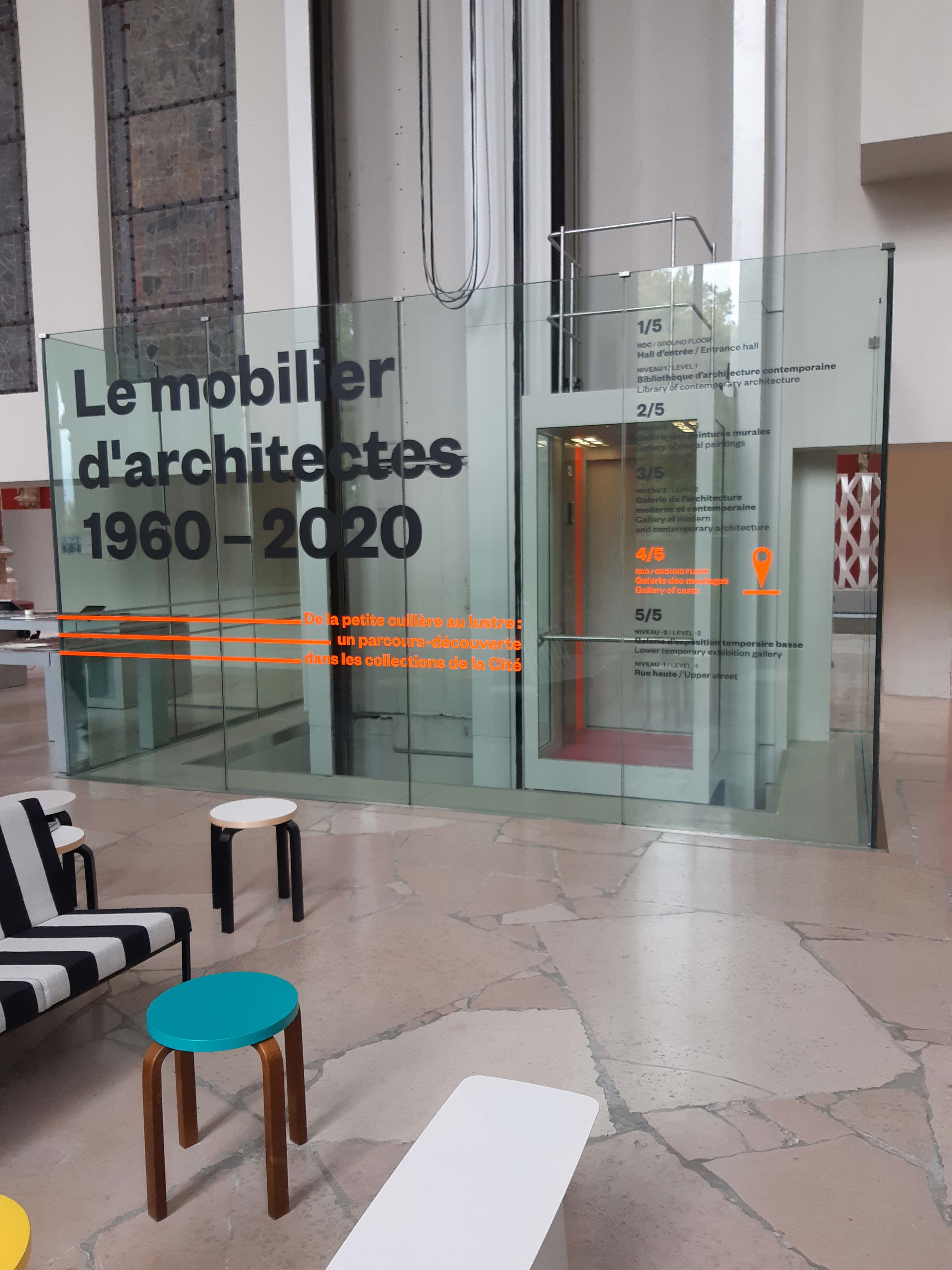
Exemple de signalétique conceptuelle mettant en avant le plan de l’exposition Le mobilier d’architectes 1960-2020 à la Cité de l’architecture et du patrimoine - Paris © Tiffany Corrieri
Que ce soit au sein d’une signalétique directionnelle ou conceptuelle, les pictogrammes et signes sont prépondérants car ils constituent un langage universel. Toutefois, ils répondent à des normes de compréhension auxquelles il est nécessaire de réfléchir. À l’instar du graphisme du pictogramme qui doit être suffisamment clair et monosémique (avoir un seul sens) afin d’être compris sans effort de réflexion, ou du regroupement d’informations en un même espace pour une meilleure lisibilité et visibilité. Enfin la typographie est également un domaine qu’il est important de réfléchir, notamment au travers de la taille et du style des caractères qui doivent être lisibles à bonne distance.
S’accorder avec l’identité du lieu
C’est dans les années 80 que l’intérêt porté à la signalétique apparaît dans le monde muséal. On s’intéresse au nouveau lien musée-visiteur et à la réception du patrimoine, tout en inscrivant ce système de signes dans le champ d’expression du graphisme. Ce domaine ne se présente plus seulement comme une fonctionnalité mais aussi comme un moyen d'expression, notamment dans les années 2000.
La signalétique devient donc un terrain de jeu pour le graphisme se devant d’être en cohérence avec l’esprit du lieu et son identité, afin d’être à la fois lisible et visible par le visiteur, tout en étant discrète. La signalétique de l’institution peut aussi influencer l’espace public ou l’ensemble du bâtiment afin de mettre en avant l’identité de ces derniers. La signalétique urbaine de la ville de Metz, qui, après l’implantation du Centre Pompidou Metz, reprend le design graphique du Musée, ainsi que la Bibliothèque Malraux à Strasbourg, illustrent bien cette influence.

Identité graphique de la Bibliothèque Malraux, réalisée par l’agence Intégral Ruedi Baur, qui reprend le graphisme de la signalétique intérieure - Strasbourg ©Tiffany Corrieri
Néanmoins l’évolution de l’identité muséale, de la société et du bâtiment, qui demande à la signalétique de s’adapter, d’être modulable, n’est pas aisée car elle implique des budgets importants.
Comme le présente l’ouvrage Graphisme en France (2013), bien qu’identifiée comme un «dispositif d’accessibilité universelle, chaque signalétique est confrontée à l'impossibilité de prendre en considération l’ensemble des usagers et de leur particularités cognitives, motrices ou culturelles.». Et ce malgré l’essor de considération du public au cœur des préoccupations des institutions et la nécessité de prendre en compte différents handicaps, qui a été mis en avant par la loi handicap de 2005.
Analyser le bâtiment et les flux
La mise en place d’une signalétique est loin d’être anodine, c’est un projet réfléchi et anticipé. Si cette dernière prend place au sein d’un projet de bâtiment, alors l’appel d’offre s’intègre à celui des architectes. Sinon les flux des visiteurs sont analysés dans un premier temps, puis anticipés au travers de projections, pour permettre la meilleure circulation possible au public.
Néanmoins, bien qu’il soit indispensable que cette signalétique soit envisagée en amont, il arrive encore souvent qu’elle ne soit pensée qu’une fois le bâtiment quasiment fini, ou à la fin, par le graphiste qui est sollicité tardivement.
Par ailleurs, la signalétique est confrontée aux problèmes de temps. La graphiste Eva Kubinyi, dans Graphisme en France (2013), précise «que même pérenne [la signalétique] a une durée de vie comptée». En effet, elle dépend des politiques des décisionnaires, de la fonctionnalité du lieu étant donné que les flux et usages changent avec le temps, et de la pérennité des matériaux qui sont plus ou moins durables. Il est donc important pour le graphiste de prendre en compte ces différents points, et c’est pourquoi il s’associe souvent à un designer qui va le conseiller.
Ainsi, donner les clés de visite au visiteur pour que celui-ci détienne une expérience muséale agréable et complète, en proposant une orientation rassurante et optimale, permet d’éviter la frustration et la perte d’attention de chacun.
1 La signalétique sur le lieu d'accueil : Être lu sans être vu, Gilles Février dans Culture et musées, 1994. Disponible sur : https://www.persee.fr/docAsPDF/pumus_1164-5385_1994_num_4_1_1257.pdf
2 Du panneau à la signalétique : lecture et médiations réciproques dans les musées, Daniel Jacobi et Yves Jeanneret dans Culture et musées : la muséologie 20 ans de recherches, 2013. Disponible sur : https://journals.openedition.org/culturemusees/708#tocto1n2
3 Expositions et parcours de visites accessibles, Ministère de la Culture et de la Communication
Pour en savoir plus :
Expositions et parcours de visite, du Ministère de la Culture et de la Communication
L’ouvrage Graphisme en France 2013 : La signalétique, points de vues des graphistes, du CNAP est téléchargeable en ligne
Du panneau à la signalétique : lecture et médiations réciproques dans les musées, Daniel Jacobi et Yves Jeanneret
La signalétique sur le lieu d’accueil : Être lu sans être vu, Gilles Février dans Culture & Musées
La signalétique patrimoniale. Principes et mise en oeuvre, Daniel Jacobi et Maryline Le Roy, compte-rendu de Caroline Buffoni dans Culture & Musées
Problems in Visitor Orientation and Circulation, Stephen Bitgood
La signalétique, entre fonction et expression, L’hebdo du Quotidien de l’Art, octobre 2020
Ruedi Baur, fondateur de l’agence Intégral Ruedi Baur, designer qui a créé de nombreuses signalétiques à l’instar de celle du Centre Pompidou Paris et celle de la ville de Metz après l’implantation du Centre Pompidou Metz
#signaletique #graphisme #reflexion

Rêver comme un enfant au musée du Jouet de Prague !
Lors de mon séjour dans la fabuleuse ville de Prague, j'ai eu l'occasion de pénétrer dans le Musée du Jouet. Une devanture si simple qu'il est facile de passer devant sans y prêter attention. Qui imaginerait découvrir un musée du jouet dans l'enceinte du grand Château de Prague, qui plus est dans l'ancienne chambre des Comptes ?
Une des salles sobres du musée, Crédits : Lilia Khadri
Je me trouvais là, surprise. Je décidais donc d'entrer jeter un œil, intriguée, mon âme d'enfant me rattrapant au galop.
Ce n'est que plus tard que j'appris que ce musée comprend la deuxième exposition permanente mondiale de jouets.
Il contient des œuvres datant de la Grèce Antique, jusqu'à la création de la Barbie.
Ce musée peut réveiller les souvenirs de tous les visiteurs, de chaque âge, de chaque origine.
Venez avec moi, le temps d'une petite visite...
Au premier étage la collection permanente du musée est présentée à travers sept salles. La signalétique est complètement inexistante ce qui m'a amenée à traverser le musée en sens inverse ! Un comble pour une future professionnelle des musées me direz-vous ! Ceci dit cela fut un avantage, puisque je pris le temps de refaire le tour de l'étage, malgré un planning très chargé dans cette ville romane et baroque.
En apparence, le musée paraît peu soigné, plutôt d'aspect précaire. La République Tchèque est un pays qui traverse de lourdes difficultés économiques ce qui explique le non ravalement des façades des monuments de la ville et la scénographie brute du musée. Cette simplicité rend le musée touchant et convivial, comme si je découvrais des jouets dans une ancienne demeure.
Cette collection est unique au monde, variée et précieuse. J'y découvre des jouets aux multiples aspects, très plaisants ou bien intriguants. Certaines vitrines représentent des scénettes qui nous content des histoires et l'Histoire ! Des scénettes contiennent au moins 100 personnages, les détails sont minutieux.
Captivée, j'imagine ces histoires prendre vie : l'arche de Noé, les batailles indiennes, les guerres du 20ème siècle, l'intérieur des maisons bourgeoises, le développement de tous les types de transports et l'industrialisation, la création des zoos.
Des scènes miniatures : ici, le zoo, Crédits : Lilia Khadri
D'autres vitrines représentent des lieux de la vie quotidienne : des cafés, des gares, des villes, des ports, des chantiers de construction. On se croirait presque à la place des passants. Parmi tous ces personnages originaux et inconnus nous en découvrons que nous avons ont pu croiser dans nos lectures de jeunesse tels que Blanche-Neige, Donald et Superman.
Les vitrines sont thématiques (les poupées, les robots, les peluches, etc.) ce qui permet de bien comprendre l'évolution des techniques de création de ces jouets par section.
Les matériaux sont de nature très variée passant du bois au fer, de la porcelaine à l'étain. Cet artisanat est remarquable de par les détails, les finitions, la façon dont les jouets ont été construits.
Au deuxième étage, est présentée une exposition permanenteen l'honneur des cinquante ans de la poupée Barbie. Cette exposition est intéressante, malgré des cartels uniquement en tchèque...
En entrant dans une exposition sur la poupée Barbie, modèle fantasmé et controversé, il est possible d'avoir certains doutes quant au contenu muséal.
Mais cette exposition a convenu à mes attentes. En effet ce n'est pas un simple étalage de poupées clones mais une présentation de l'évolution de la représentation de la femme et aussi de l'homme dans la société occidentale. J'y découvre alors les premières barbies, un seul modèle avec des mensurations dites parfaites bien que clichées et inventées. Ce type de femme, blonde aux longues jambes était recherché dans le cinéma comme dans la publicité.
La femme dite idéale, Crédits : Lilia Khadri
Au fil du parcours, les modèles varient, principalement au niveau de la couleur des yeux ou des cheveux, jusqu'à présenter une barbie noire et une barbie en fauteuil roulant. Cependant toutes gardent les mêmes mensurations, aucune barbie petite ou avec plus de formes n'a été créée.
Ces poupées formatées montrent et alimentent le poids de l'apparence physique normée au sein de nos sociétés, ce qui entraîne d'ailleurs des complexes, des maladies psychiques et physiques chez certaines filles.
Un autre aspect instructif de cette exposition est relatif aux vêtements de ces poupées qui permettent de découvrir la mode vestimentaire de chaque époque. Certaines robes seraient dignes de grands couturiers.
Les vedettes en piste, Crédits : Lilia Khadri
Puis je fais face à un musée Grévin à la taille des poupées rassemblant des génies comme Einstein, des comédiens comme James Dean, Marilyn Monroe et Elisabeth Taylor, des chanteurs comme Elvis Presley et Mickael Jackson. Cette collection a été créée par le commissaire de l'exposition dans un but ludique, pour amuser le visiteur et expliquer que les barbies furent déclinées afin de promouvoir les icônes de ces décennies.
Ce n'est pas la porte à côté, mais s'il vous arrive de passer par Prague, vous irez alors dans l'incontournable château de Prague, qui vous emmènera au musée du jouet. Amusez-vous, rajeunissez, racontez vous des histoires !
Lilia Khadri
# Prague
# Jouets
# Musée

Signes de la Grande Guerre
Parmi les nombreuses expositions que nous propose le festival Chaumont Design Graphique, en voici une qui nous parle de la Grande Guerre. Cette époque a donné lieu à une production graphique de grande importance. L’affiche, un des principaux médias avec la presse écrite, est au diapason du conflit ; placards officiels annonçant interdits et restrictions ou affiches illustrées appelant à l’emprunt ou au secours aux familles réfugiées.
En effet, ce qui se dégage nettement de cette muséographie, c’est « l’intensité ». Le parti pris de Michel Wlassikoff, commissaire d’exposition, est la présentation massive de documents précis, éclairés et rythmés par la scénographie de manière à dégager un climat, une ambiance visuelle exprimant un sens général et propice à l’attention. La scénographie est conçue selon un dédale labyrinthique, rappelant celui des tranchées.
Les cimaises elle-même sont en relief, présentant une cavité pour symboliquement signifier le fossé, le trou d’obus mais aussi la séparation des vies au Front et à « l’arrière », pour permettre deux niveaux de lecture… Le visiteur est happé dans cette tourmente, son œil est attiré par les couleurs vives des affiches de propagande, par des textes accrocheurs et provocateurs. Dans ce parcours muséographique et scénographique, les documents sont liés et n'auraient eu aucun sens à eux tout seul.
Les documents choisis sont distribués par chapitres et sont tous porteurs d'un sens précis dans l'ensemble ainsi constitué. Il se dégage un sens fort de leur positionnement et de leur association. Chaque chapitre possède des liens évidents avec celui qui le précède et celui qui le suit, et sa cohérence dépend de la cohérence de leur ensemble. Le commissaire veut donc signifier le conflit avec un agencement précis des documents pour en extraire au mieux le sens global.
Crédits: Tt
Crédits: Tt
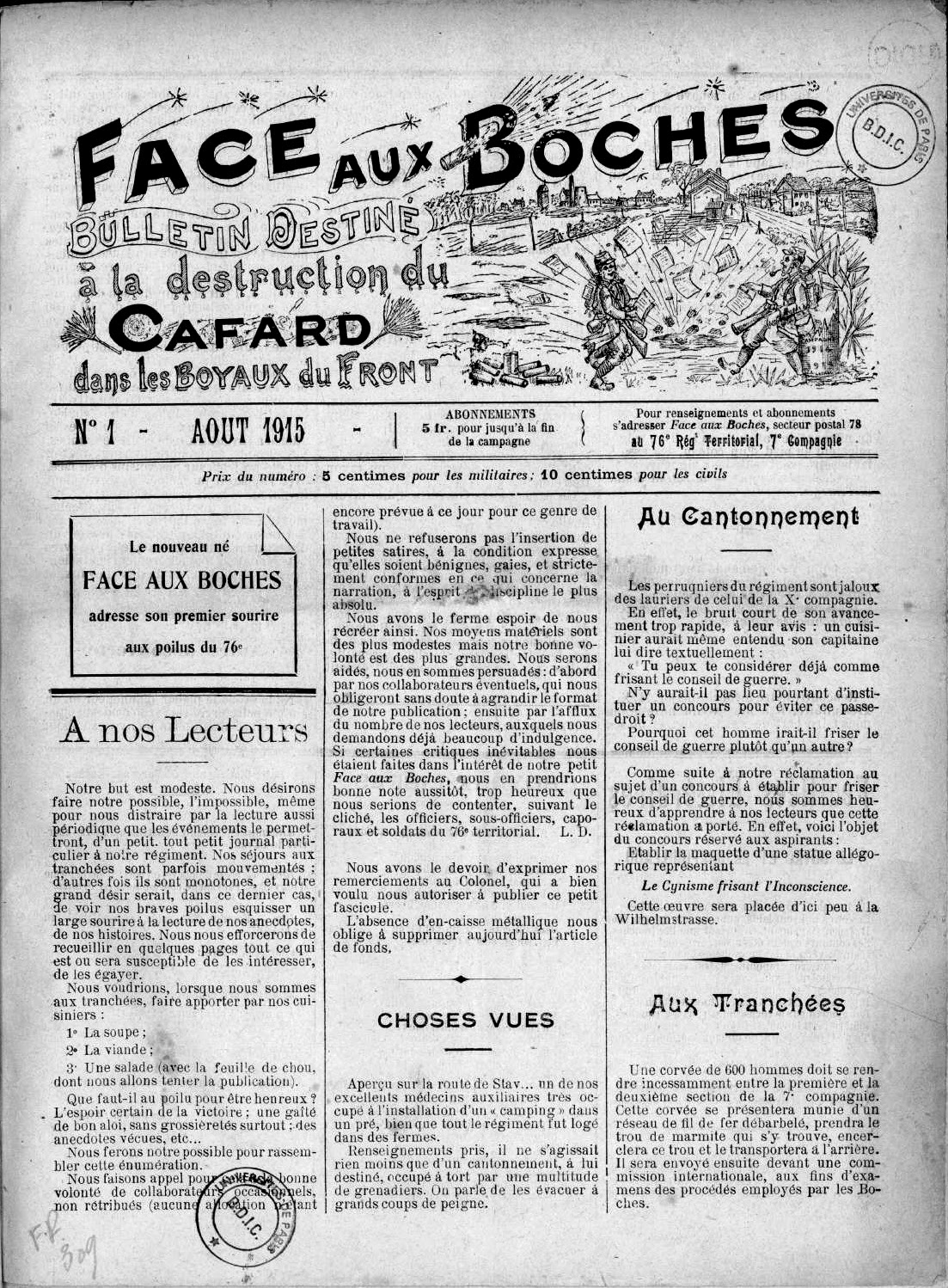
L'exposition s'attache à présenter par ailleurs les publications des avant-gardes pour manifester un contraste avec la communication de masse et déterminer la part de leurs avancées ou de leurs reculs durant la guerre. Cette présentation est axée sur les avant-gardes futuriste, cubo-futuriste, vorticiste, dada, de Stijl. Celle-ci est de portée internationale, à la différence de la communication de masse essentiellement centrée sur la France. On y découvre aussi des documents comme les premières parutions en France des revues Le Mot, de PaulIribe, L'Élan, d'Amédée Ozenfant, Sicd'Albert-Birot ou Nord-Sud de Pierre Reverdy, qui toutes naissent pendant la guerre et accueillent les avant-gardes.
Thi-My Truong
#Grande Guerre# Muséographie
# Affiches
Pour aller plus loin :
Sous la peau là où dialoguent les cultures
« Everyonein the world has an attitude toward tattooing. No one is indifferent to it ». Bakatyin Tucker 1981: 47[1]
Me sachant à Paris et passionnée par les tatouages, Alice, ma chère amie transalpine, chercheuse infatigable d’expositions et d’événements dans le monde entier, m’avertit : « tu ne peux pas rater Tatoueurs, Tatoués !»
Intriguée, je vais voir tout de suite le site du Quai Branly où, il y a un peu plus d’un mois, malgré l’absence d’informations détaillées sur l’exposition, j’y trouvai, triomphante, une reproduction de l’affiche.
L'affiche de l'exposition Tatouers, Tatoués |© Musée du Quai Branly
Je me dis, toujours le même cliché : c’est le corps d’une femme qui est représenté, nue, à l’exception des parties non tatouées puisque de toute façon elles ne nous disent rien de plus sur ce corps. Tout ce qui parle aux yeux est là, dans sa partie centrale – justement celle qui est représentée – celle qui montre la peau marquée par deux des sujets classiques les plus légendaires : un dragon et une fleur de pivoine.
Une semaine après l’inauguration de l’exposition, sceptique depuis ma découverte de l’affiche, je me dirige vers la mezzanine ouest du musée où dialoguent les cultures.
C’est l’arrivée des beaux jours à Paris, les manches des chemises retroussées et les chevilles découvertes laissent entrevoir les corps des visiteurs touchés profondément par la question : il y a beaucoup de tatoués, et parmi eux peut-être même des professionnels du milieu.
Bien que l’exposition s’adresse évidemment à tout le monde, c’est eux dont elle parle, c’est eux qu’elle montre : les tatoueurs, les tatoués, et tous ceux qui, au fil du temps et dans différentes parties du monde ont été happés par ce phénomène, ont écrit son histoire et déterminé sa complexité actuelle, l’amenant à assumer ces contours et nuances pour lesquels nous le connaissons aujourd’hui.
Depuis longtemps, si de nombreux anthropologues s’interrogent sur les origines du tatouage et des psychologues cherchent les motivations profondes qui conduisent à prendre la décision de marquer sa propre peau, ce n’est que plus récemment que, dans denombreux pays, les médecins se sont intéressés à ce phénomène, veillant à ce que les normes de salubrité dans lesquelles la pratique est effectuée soient respectées.
Mais tous les aspects et les questions soulevés par l’encre sous la peau n’ont pas encore été mis en évidence. Un exemple ? Sa valeur artistique. A ce propos il y a encore beaucoup à dire et Tatoueurs, Tatoués vise précisément cet objectif, aller un peu plus loin, sonder cet aspect trop souvent pris pour acquis – le tatouage est une pratique artistique – qui le rend invisible aux yeux des critiques potentiels et des chercheurs du secteur artistique.
Pourarriver à aborder le sujet du tatouage contemporain comme une forme d’art, Anne et Julien – commissaires de l’exposition, ainsi que fondateurs de la revue HEY! Modern, art and pop culture – ont fait un pas en arrière juste et nécessaire se montrant des vrais connaisseurs en la matière.
L'un des 13 volumes de jambe, de buste et de bras en silicone réalisés par des maîtres de l’art contemporainedu tatouage | © Musée du Quai Branly
Le voyage sous la peau commence par un cadre historique du phénomène. Le visiteur est pris par la main, mais on le laisse libre de s’arrêter, d’une station à l’autre, où son intérêt est sollicité... Et il y en a vraiment pour tous les goûts ! En effet, il y a plus de 300 œuvres exposées – dont une trentaine spécialement conçues pour l’occasion – qui caractérisent, avec leur spécificité, les cinq riches sections dans lesquelles l’exposition est divisée.
Mais reprenons du début.
C’est par une carte des peuples tatoués à travers le monde que commence le voyage-aperçu des fonctions principales qui ont été attribuées, au cours de l’histoire, à ce signe sous la peau, aussi bien ailleursqu’en Occident.
Indicateur du rôle social, lié à la sphère du religieux ou impliqué dans les dynamiques de la mystique, les significations et les rôles historiquement attribués au tatouage dans les sociétés soi-disant « primitives » sont représentés, entre autres, par un manuscrit original du XIXe siècle appartenu à un tatoueur birman et par quelques bandes de peau humaine tatouée au Laos, qui, dans la même période ont rempli leur fonction essentiellement magico-religieuse.
Une toute autre histoire, ensuite, est celle du tatouage en Occident, une histoire de marginalité et d’exercice du pouvoir sur des corps « faibles » : de l’antiquité classique jusqu’au XIXe siècle, avec de rares exceptions, le tatouage était en fait considéré comme le « signe de Caïn », une expression de la brutalité primitive ou bien le signe infâme sur les peaux des prisonniers, des esclaves, des détenus, des prostituées et des sujets marginaux en général.
Les témoins de cette partie de son histoire sont les corps tatoués des femmes arméniennes qui ont réussi à s’échapper du génocide dans les années vingt, mais aussi ceux qui sont accusés par l’anthropologie positiviste de Lacassagne et de Lombroso de contenir en eux-mêmes la déviance dont les tatouages n’auraient été que l’expression.
A la fin Du global au marginal – la première étape de notre voyage – le ton devient plus léger : le public est transporté dans la dimension passionnante des side shows d’hier où, grâce à un film réalisé spécialement pour l’occasion, les étalages de corps à la frontière entre l’horrible et le merveilleux sont habilement rapprochés du tournage de plusieurs performances des conventions de tatouage contemporaines qui se révèlent n’être que leurs héritiers.
Les bases sont posées, le visiteur est familier avec le sujet, le chemin peut enfin prendre une tournure artistique, le propos même de l’exposition. A partir d’Un art en mouvement, en effet, l’accent est mis sur l’aspect artistique du tatouage, basé sur un critère principalement géographique, proposant une rétrospective de toutes les zones géographiques considérées emblématiques à cet égard.
Place donc aux foyers créatifs : le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe, qui avec leurs caractéristiques stylistiques, les noms des grands maîtres et une longue liste de dates clé, ont contribué à la diffusion de la pratique et à son élévation au statut d’art.
Peau neuve : renaissance du tatouage traditionnel – nous sommes arrivés à la troisième station – qui se tourne vers les régions de la Nouvelle-Zélande, Samoa, la Polynésie, Bornéo et encore l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.
A ce moment là une question légitime se pose : quel est le critère de cette association ? Ce qui réunit ces domaines est la révolution qui a renversé leurs styles traditionnels. Ces derniers, à la suite des contacts avec l’autre et les échanges avec le monde extérieur, ont subi des modifications importantes et ont émergé sous une forme nouvelle, la forme hybride des nos jours.
Nouveauté et contemporanéité sont les sujets dont traitent les deux dernières sections, celles qui parlent le plus aux yeux des visiteurs : Nouveaux territoires du monde et Nouveaux encrages.
Dans l’avant-dernière partie ce sont les nouvelles écoles de tatouage en Chine et celles liées au tatouage latino et chicano qui sont les protagonistes : exemples emblématiques du mélange de codes, ces écoles offrent des résultats atypiques, fruits des influences de l’iconographie populaire traditionnelle et d’images tirées de la vie quotidienne.
Le voyage se termine sur huit photographies,[2] accompagnées du film Mainstream Mode, qui interrogent le public sur le mode inédit d’expression de nombreux artistes-tatoueurs contemporains.
Ne vous inquiétez pas, ce n’est que le voyage de cette exposition qui se termine ! Le Quai Branly ne s’arrête pas là et, à partir de Tatoueurs, Tatoués, crée plus d’occasions de pénétrer sous la peau.
Il faut voir la boutique du musée qui propose un large éventail de titres : non seulement le catalogue de l’exposition mais des textes rares à côté des dernières sorties éditoriales.
En outre, sept spectacles sont prévus, à partir du 31 mai, pour accompagner le public dans l’épopée du tatouage du XVe siècle à nos jours.[3]
Je sors seule de la mezzanine ouest du musée Branly, le scepticisme avec lequel j’avais franchi le seuil deux heures avant s’est évaporé là, à une des stations du voyage, ne demeure qu’une interrogation persistante : le tatouage est-il ou n’est-il pas de l’art ?
Ne suivez pas ce scepticisme, ou vous serez probablement déçus.
Tatoueurs, Tatoués en fait, se pense bien plus subtilement au-delà du réductionnisme de la relation question - réponse. S’il ne vous fournit pas une seule réponse définitive, en fait, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas de réponse définitive quant à l’épineuse question. Cette exposition est d’autant plus remarquable qu’elle ouvre une voie jusqu’ici peu empruntée, devenant ainsi l’endroit idéal où s’interroger.
Rodée aux expositions surle tatouage, je suis particulièrement satisfaite de celle-ci, je sors intriguée et intéressée, et tourne mon regard à nouveau vers l’encre sous ma peau.
Beatrice Piazzi
#QuaiBranly #tatouage
#art
#corps
[1] TUCKER, M.(1981), “Tattoo: the state of the art”. Dans Artforum International Magazine, New York, pp. 42-47.
[2] La relation entre tatouage et photographie a été questionnée récemment par le magazine en ligne Our age isthir13en | http://www.ourageis13.com/dossiers/semaine-du-19-05-14-tatouages-histoires-et-regards/
[3] La programmation Autour de l’exposition est disponible en ligne |
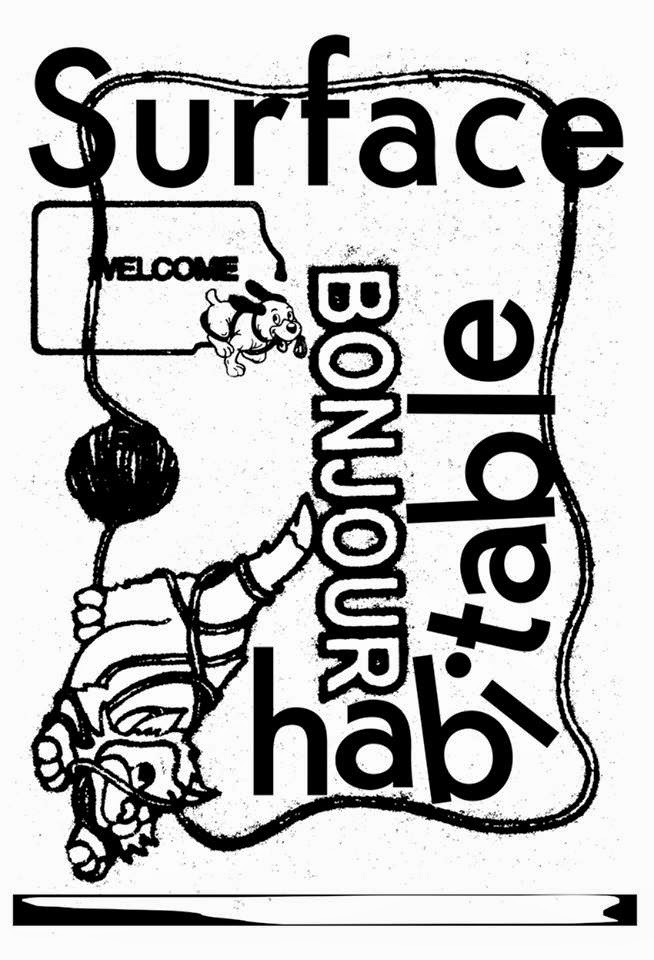
Surface Habitable, une médiation aux multiples pistes
Chaumont Design Graphique est un événement international incontournable dans le milieu du graphisme. Depuis 25 ans, le festival propose des expositions phares autour desquelles s’articulent tables rondes, conférences, workshops, ateliers participatifs jeune public, salon d’édition, soirées afin de permettre des temps de rencontre entre graphistes professionnels et festivaliers.
Du 17 mai au 9 juin, le festival propose 7 expositions toutes reparties dans différents lieux de la ville. Pour chaque exposition, une médiation écrite et/ou orale est proposée au public. La médiation écrite peut prendre différentes formes, soit sous forme de journal, de publication ou encore de livret à destination du jeune festivalier, en fonction des types de public touchés.
La médiation que j’ai réalisée fût celle sur Surface Habitable. Cette exposition questionne la place du graphisme dans notre quotidien. Comment s’immisce-il dans notre vie et pourquoi on ne le remarque pas ? Le graphisme est partout autour de nous et ne se cantonne pas uniquement au support affiche…
Le concept
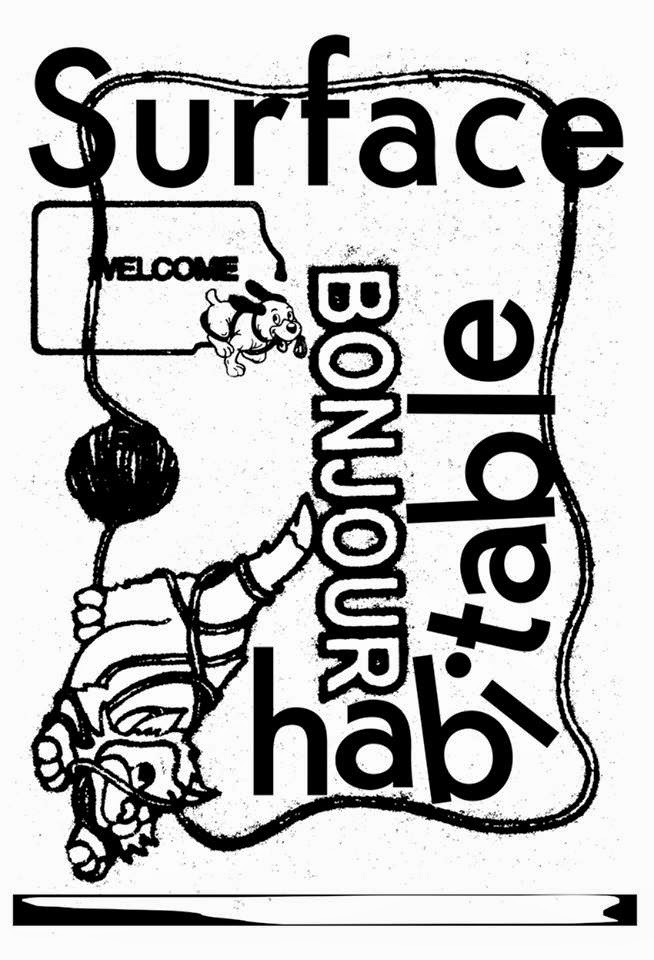
© Chaumont Design Graphique
Comment ont-ils choisi les objets exposés ? Surface Habitable a missionné six référents, un pour chaque domaine graphique. Ces référents ont envoyé une sélection d’objets à exposer en ayant un discours autour de leur discipline. Pour exemple, Loraine Further, sélectionnée pour la partie édition et coordinatrice du prix Fernand Baudin, a effectué sa sélection autour du livre. Une sélection poussant son propos autour de l’écosystème éditorial, de son concept à sa lecture en passant par son impression et sa diffusion. Dans sa proposition, les croisements de disciplines s’opèrent car l’édition recoupe la typographie qui est l’essence même de ce domaine. Voilà, à nouveau des pistes de médiation à creuser.
Après le concept, la médiation

© Dimitri Mallet
Afin d’être au plus près du propos de l’exposition et du graphiste Mathias Schweizer, la première visite fut réalisée par la personne en charge de la coordination du projet qui l’a suivi et monté du début jusqu’à la fin, collaborant finement avec le graphiste et le scénographe. Une fois la visite terminée, mon travail fut de rendre le propos accessible à tous.

© Dimitri Mallet
L’attente du public, son comportement sont des indices qu’il faut prendre en compte en amont de la visite. Mieux appréhendée par le public, une médiation orale reste efficace dès lors qu’on sait sans cesse s’adapter à lui, alors chaque médiation est différente. D’autant qu’être à l’écoute des demandes et rester attentive aux questions du visiteur demeure essentiel à la bonne réalisation d’une visite.
Marie Despres
# graphisme
# quotidien
# médiation

Thiepval, un nouveau musée pour commémorer le centenaire des batailles de la Somme de 1916
Thiepval est une étape essentielle du circuit du souvenir des batailles de la Somme. En 1932, le Mémorial britannique est érigé sur les champs de bataille. Les noms des plus de 70 000 disparus britanniques et sud-africains y sont gravés. Un centre d’interprétation ouvre ses portes en 2004. Sous l’impulsion d’Hervé François, directeur de l’Historial de Péronne, le musée de Thiepval est inauguré en juin 2016 à l’occasion du centenaire. Le musée aborde l’impact de la guerre sur la Somme, à la fois sur le front mais aussi à l’arrière. Situé sur un lieu porteur d’une charge symbolique forte, le musée de Thiepval propose des choix originaux en termes de muséographie, de médiation et de contenu.
« Les batailles de la Somme ne se résument pas à de simples lignes sur une carte »
Le choix d’une approche globale des batailles de la Somme, qui ne se concentre pas uniquement sur le front, est intéressant. L’ensemble des sites du circuit du souvenir évoque essentiellement les stratégies militaires, les faits d’arme, les actes héroïques ou encore les pertes humaines. Les Britanniques sont très représentés alors que les Allemands très peu. A Thiepval, l’idée de parler de l’ensemble des belligérants s’inscrit dans la ligne de l’Historial de Péronne. Les récits des Allemands, des Français et des Britanniques se croisent dans les salles consacrées au deuil et à l’invention des « as » de l’aviation. Parler des hommes avant de parler des soldats, des vainqueurs et des vaincus, est nécessaire. En effet, aussi absurde que cela puisse paraître, les tabous concernant la place accordée aux Allemands dans les lieux de mémoire sont encore présents dans certains esprits.
Dans la continuité, le musée aborde dans une salle très émouvante la question du deuil. Familles et civils sont présentés comme témoins et acteurs de la guerre, ce qui est rarement le cas sur les autres sites du circuit du souvenir. Le deuil permet de croiser plusieurs points de vue, celui des disparus, des familles et des autorités. Les objets deviennent reliques et dévoilent, derrière chaque nom, une histoire collective.
© M. D.
« L’effort consenti par les sociétés dans la guerre continue d’interroger »
La fresque de Joe Sacco pour illustrer l’offensive du 1er juillet 1916 est un choix muséographique plus que judicieux. L’immersion est totale dans cette journée symbolique, la plus meurtrière pour l’armée britannique. Aux murs, l’immense fresque est reproduite sur des parois en verre. Au centre de la salle, dans des fosses, des objets retrouvés à Thiepval ou issus des collections de l’Historial de Péronne sont exposés comme témoins matériels des scènes représentées sur la fresque. C’est véritablement un dialogue qui s’installe entre les objets et les images, entre l’interprétation actuelle de l’offensive à travers l’œuvre d’un contemporain et les objets retrouvés, témoins du passé. Le dialogue entre passé et présent est omniprésent et ouvre plusieurs portes au champ de réflexion.
© M. D.
La fresque de Joe Sacco est aussi un outil médiation. Sous chaque scène, une explication est inscrite sur un panneau. Chacun peut lire, interpréter les images seules ou en lien avec les informations ainsi données. La fresque permet une véritable démocratisation du contenu scientifique et évite ainsi toute reconstitution douteuse avec mannequins en cire et autres inventions inesthétiques.
« Parfois quand il y a trop de textes, trop d’images, trop d’informations données tout de suite, finalement ça devient étouffant et on ne retient plus rien. » Emilie Simon, chargée de muséographie
Le visuel est un élément essentiel de la médiation du musée. Ecrans diffusant images et films d’archives, vidéos montrant les lignes de front ou reconstitutions 3D sont présents dans presque toutes les étapes du parcours. Un dispositif a particulièrement attiré mon intention. Dans la salle consacrée au deuil, une installation interactive projette au sol les photos et l’histoire de dizaines de soldats. Le visiteur est invité à prendre une planche blanche et à la placer sous le projecteur pour suivre les parcours qui défilent des missing. Le dispositif laisse une grande liberté de choix et d’action. Ainsi l’ensemble de l’espace est utilisé sans surcharger les parois murales. Mais dans la pratique, le visiteur utilise peu ce dispositif car les planches et le schéma explicatif, placés dans un recoin, manquent de visibilité.
© M. D.
Le musée a délibérément choisi de ne pas utiliser de dispositifs de médiation tactiles. Le parcours fonctionne très bien sans car la visite est autonome. Il y a énormément de visuels, de vidéos pour démocratiser et développer le propos.
Le musée de Thiepval s’ancre dans les problématiques du musée du XXIème siècle. C’est un musée engagé à travers un parti pris universel, une volonté de confronter les points de vue de l’ensemble des belligérants et de ne pas se limiter à une vision manichéenne de la guerre. Mais le musée pourrait aller encore plus loin et interroger davantage l’engagement des femmes dans les batailles de la Somme. Elles sont présentes en tant que mères, sœurs, filles d’hommes disparus au front. Elles sont présentes en tant que victimes de la guerre dans la cartographie consacrée aux civils. Les femmes ne sont pas ici considérées comme actrices mais comme spectatrices de la guerre. Et pourtant interroger leur engagement, en tant qu’infirmière, en tant qu’ouvrière, serait enfin leur reconnaître une participation active dans les batailles de la Somme. Cette participation, vecteur d’émancipation, est souvent effacée par une approche essentiellement tournée vers les soldats, vers les hommes, vers la ligne de front.
M. D.
#Thiepval
#Somme100
#MuséeduXXIesiècle
http://www.historial.org/Champs-de-bataille-de-la-Somme/Musee-a-Thiepval

To Go, l'exposition à emporter
Avez-vous déjà emporté toute une collection d’expositions avec vous ?
Afin de compléter votre expérience de séjour en Suède, le Musée Suédois du design, vous propose depuis mars 2020, de visiter le pays à l’aide de différents objets représentatifs du design suédois, tirés de l'exposition To Go, que l’on peut toucher, manipuler et surtout expérimenter. Impulsée par Visit Sweden, elle s’inscrit comme la première exposition mondiale à emporter.
Une expérience totale
Le musée veut casser les codes traditionnels des pratiques muséales en ne se satisfaisant pas seulement d’observer, mais également en permettant d’agir, afin d’offrir aux visiteurs une expérience complète vis à vis des objets exposés. Cette dernière permet ainsi de découvrir le travail de designers régionaux et la culture locale tout en voyageant dans le pays. Comme cela le musée démontre qu’une expérience muséale et immersive est aussi possible hors les murs.
Le principe est simple : après avoir réservé et récupéré votre sac à dos de marque Sandqvist dans un des quatre lieux d’intérêt disponibles, pouvant être un office de tourisme ou bien même un centre de design, vous pouvez partir à la découverte de la ville de votre choix à l’aide d’une collection d’objets représentatifs de l’industrie créative suédoise. Ces derniers ont été sélectionnés par différents commissaires du pays, tous spécialisés dans le design, à l’instar de Linnéa Therese Dimitriou, une artiste, créatrice freelance et directrice artistique de Sliperiet, le campus d’art d’Umeå.
Cette dimension expérimentale s’inscrit dans la nature du design suédois qui, d’après le musée, est fait pour être utilisé et ressenti, afin de percevoir tout son intérêt pratique et esthétique. Elle s’adresse davantage aux passionnés qui veulent s’approprier et mettre en pratique le design scandinave, tout en découvrant les richesses culturelles de la Suède sous différentes manières.
Une sélection d’objets en fonction de sa destination
Cette expérience est en réalité décomposée en une série de 4 expositions associées à de grandes villes, permettant de mettre en avant les quatre coins du pays suédois. On peut donc y retrouver l’est avec Stockholm, le nord avec Umeå, le sud avec Malmö et l’ouest avec Göteborg. Chaque exposition, imaginée par un ou plusieurs commissaires à la fois, détient son propre sac à dos avec ses propres objets permettant de découvrir les différentes facettes paysagères et architecturales, touristiques ou sociales de chacune des villes.

Collection d’objets à emporter de l’exposition To Go – est, source : © Johan Width, Swedish Design Museum
Sur le site internet, les expositions sont accompagnées de recommandations personnelles des commissaires, tel un itinéraire exhaustif à faire à pieds, en vélo ou en transports en commun, sur les endroits à visiter et choses à faire dans la région afin de profiter pleinement de l’expérience de design des objets proposés.
Par ailleurs, chaque histoire des collections et leur utilité est présentée sur le musée virtuel. Leur format et nature sont différents. Ainsi nous retrouvons l’art textile avec des serviettes ou bonnet, la céramique avec de la vaisselle, la bureautique avec des stylos et carnets mais aussi des appareils technologiques et innovants tel qu’un casque de vélo. Par conséquent vous pourrez écouter les meilleurs groupes de musique suédois avec le casque audio Jays, tout en vous baladant dans Göteborg.

Casque Jays qu’il est possible d’emporter avec soi pour la découverte de Göteborg dans le cadre de l’exposition To Go – ouest, source : © Johan Width, Swedish Design Museum
Une exposition innovante mais limitée
La médiation et l’essence de cette exposition et sa collection s’inscrit pleinement dans une dimension innovante et originale, permettant au visiteur de vivre une expérience peu commune par rapport aux expositions plus traditionnelles, et qui rappelle l’exposition “Take me (I’m yours)” située à la Monnaie de Paris en 2015. La participation et l’appropriation sont pleinement soulignées mais il peut être difficile de trouver le lien, autre que matériel, entre les objets et les destinations pour certaines personnes. En quoi l’objet conseillé, tel qu’une tasse, approfondit-il l’expérience de visite du pays ? Une connaissance et un appétit pour le domaine du design aide assurément à s’identifier et s’approprier les usages de ces objets. Par conséquent l’expérience de visite reste subjective et des bases en design sont nécessaires en amont pour profiter correctement de cette exposition.
De plus To Go retrouve aussi ses limites dans son accessibilité physique, car certes accessible pendant toute une semaine, la série de sac à dos est limitée et la demande très forte, ce qui amène vite à un épuisement de stock. De fait il est nécessaire de réserver au moins 3 mois en avance pour bénéficier de l’exposition. Toutefois la gratuité de prêt de la collection permet une accessibilité financièrement universelle.
Le parti-pris d’un musée purement virtuel
Le Swedish Design Museum est le premier musée virtuel sur le design suédois mais aussi le premier museum du design qui aborde à la fois les thèmes de l’architecture, du design et de la mode. C’est un musée uniquement virtuel ; il ne détient pas de collection physique, ni de lieu d’accueil dans le but de permettre au plus grand nombre d’accéder au design suédois.
L’innovation du Musée suédois du design se retrouve aussi dans ses expositions précédentes dans lesquelles il présentait des expériences de visites originales comme au travers de The home viewing exhibitions où le musée invitait les visiteurs à découvrir le design suédois, par le biais de véritables visites immobilières de propriétés privées, et qui sont aujourd’hui également accessibles depuis le site internet.
Tiffany Corrieri
#Design
#Suède
#Innovation
Image intro de l’article : Okra collection, exemple d’objets à emporter de l’exposition To Go – sud, source : © Johan Width, Swedish Design Museum

Trop classe !
Depuis le 25 septembre, la MAIF Social Club présente une nouvelle exposition à vivre sur la thématique de l’apprentissage et de la transmission : Trop classe !
MAIF Social Club, késako ?
Commençons par présenter ce lieu atypique qui a ouvert rue de Turenne dans le 3ème arrondissement de Paris en novembre 2016 et qui s’inscrit dans la politique de mécénat culturel mise en place par la Maif depuis de nombreuses années.
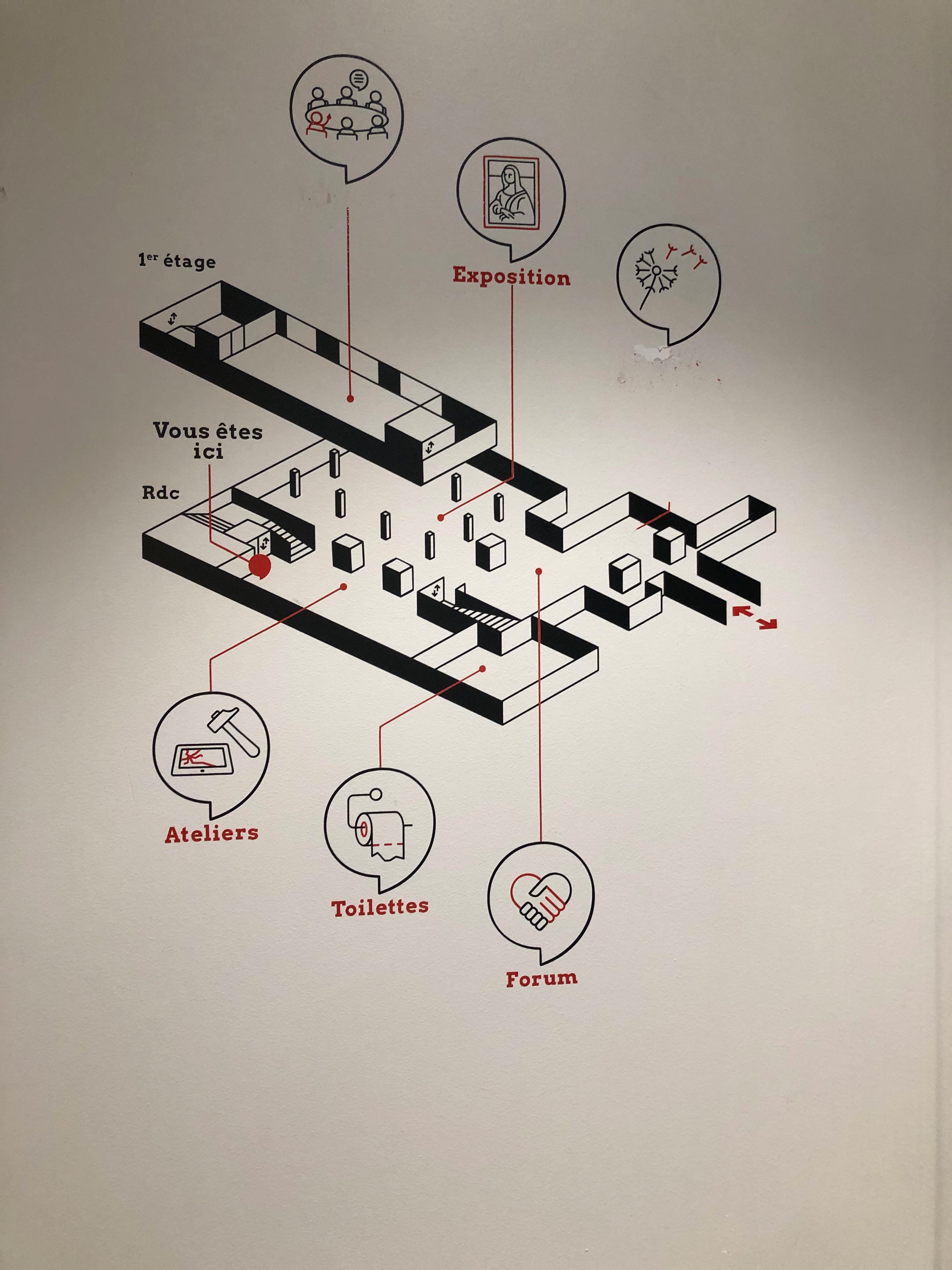
Plan de la Maif Social club © AG
L’espace s’ouvre sur le “forum” (voir photo ci-dessus) composé d’une zone d’accueil, d’un café et d’une petite boutique qui propose à la vente des gourdes et autre artillerie zéro déchet dans l’air du temps. Juste derrière se trouve un espace d’exposition, tandis qu’à gauche une aire modulable dotée d’une bibliothèque en accès libre est composée de tables et chaises à destination des usagers qui souhaitent travailler, seuls ou en groupe. Cet espace accueille également les ateliers prévus dans la programmation. Enfin, à l’étage, une salle est disponible à la location pour les entreprises lorsqu’elle n’est pas utilisée pour des conférences.
Depuis son ouverture, le design a évolué et la bibliothèque s’est considérablement enrichie avec tout un coin dédié à la littérature jeunesse adapté aux enfants (consultation sur place uniquement mais en accès libre). Le fonds a été constitué de manière thématique : écologie, habitat, urbanisme, sociologie, jardinage, innovation… en accord avec la vocation et l’identité du lieu.
L’endroit est calme, propice au travail, mais aussi aux échanges, à la discussion, à la dé tente, bref à la con-vi-via-li-té, concept à la mode dans l’éco-système culturel mais relativement difficile à trouver, notamment dans les musées traditionnels.
Dans l’ensemble, la Maif social club réunit pas mal de concepts très tendances en ce moment : expérimentation, innovation, enjeux sociaux, convivialité, taille humaine, transgénérationnel etc.
La Maif social club propose deux expositions thématiques et transdisciplinaires par an, appelées « permanentes » sur le site internet, quoique le terme semi-permanent semblerait plus adapté. La Maif social club s’inscrit dans une tendance générale de ralentissement des expositions, à l’inverse de la boulimie que les institutions pouvaient avoir il y a de ça quelques années. Ces expositions sont gratuites et une programmation dense et cohérente leur sont associée.
“Trop classe !”
L’exposition présentée en cette rentrée 2020 bouleversée par la crise du covid-19, a pour thématique la transmission. L’un des objectifs affichés de l’exposition est “d’appréhender l’école autrement” et de proposer une réflexion autour de la circulation des savoirs et de la question de l’apprentissage. Cette thématique n’a rien d’étonnant quand on sait que l’acronyme MAIF signifie Mutuelle Assurance des Instituteurs de France.
Le texte d’introduction rappelle qu’à l’échelle mondiale 263 millions de jeunes ne peuvent pas aller à l’école puis nous questionne sur ce qu’est l’apprentissage en France aujourd’hui où “la théorie de la reproduction sociale déconstruit l’idéal méritocratique”.
De prime abord, elle semble assez “enfantine”, des pièces de bois trainent au sol, des poufs placés en escaliers sont surmontés de tablettes pour jouer et au fond une grande fresque en tableau ardoise est recouverte de dessins d’enfants faits à la craie.
“Exposition à pratiquer”, elle propose une succession d’expériences corporelles qui sont au tant de “places” réparties dans l’espace : place pour faire, place pour jouer, place pour naviguer, place pour parler, place pour matières grises, place pour rêver, place pour s’insurger et enfin fenêtre sur cour.
Ces différentes places forment un univers “commun” mis à disposition des usagers, petits ou grands.

Vue de l’exposition Trop classe ! © AG
La dizaine d’œuvres présentées proviennent de jeunes créateur·rice·s, et ont été créées entre 2013 et 2020. Parmi elles, certaines ont été produites pour l’exposition à l’instar de la fresque de l’artiste Bonnefrite sur laquelle les visiteurs sont invités à dessiner et s’exprimer librement. Le soutien à la création contemporaine fait partie des missions de la Maif Social club. Certains artistes exposés participent à la programmation en animant des ateliers.
Pensée comme une aire de jeu, chaque élément est adapté aux enfants. Une échelle sécurisée leur permet de dessiner sur la fresque de Bonnefrite. Les bibliothèques en liège sont pensées pour éviter les collisions. Les tablettes numériques à disposition sont emballées dans une coque protectrice fort élégante pour prévenir les chutes.
Une place particulière est faite au numérique dans cette exposition avec les jeux proposés en libre accès sur les tablettes, les questions soulevés par l’œuvre de Filipe Vilas-Boas et enfin le Mobilab et sa Fabmanageuse. Il s’agit de montrer que le numérique et les outils informatiques peuvent être mis au service de l’éducation et du développement de la curiosité chez les enfants grâce à des applications numériques ludiques proposées par la Souris Grise. Même si évidemment l’usage des écrans doit être encadré comme le montre le reportage d’Arte Génération écran, génération malade ?

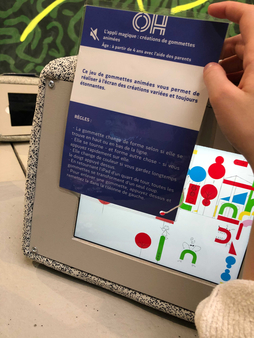
Tablette de l’exposition Trop Classe ! © AG
J’ai beaucoup aimé cette exposition et je ne peux que conseiller de suivre une visite guidée. La place que j’ai préférée est celle intitulée “Fenêtre sur cour” qui présente quatre vidéos abordant l’enfance réalisés par Valérie Mréjen et Mohammed El Khatib. Dans La Peau de l’Ours, les artistes donnent la parole aux enfants en leur posant des questions liées au langage et aux expressions. Dans Quatrième, des adolescents en internat sont interrogés un par un sur leurs rêves, leurs appréhensions, leurs modèles etc. La vidéo La dispute présente des enfants entre 8 et 10 ans qui parlent des disputes de leur parents, de l’arrivée de la séparation puis du divorce. La parole lucide des enfants m’a rappelé le podcast Entre de Louie Média qui aborde les mêmes thématiques de transmission et de passage d’un âge à un autre. Ces films sont très émouvants de par le cadrage (plan fixe sur les visages), la liberté de ton des enfants et adolescents interrogés, et les thématiques, parfois difficiles, abordées sans filtre. Ces films méritent que le visiteur s’y arrête quelque temps et se plonge dans ces récits tantôt joyeux, tantôt graves où les mots des enfants sont mis en valeur comme le seraient des mots d’adultes.

Vue de la place « Fenêtre sur cours » de l’exposition Trop classe ! © AG
L’exposition est modeste, mais dans un sens positif, c’est à dire qu’elle est simple, à taille humaine. Un·e visiteur·euse lambda a le temps en une heure de visite de s’arrêter sur chaque œuvre, avec la possibilité d’approfondir celles qu’il ou elle désire, en se faisant accompagner ou non par les médiateur·ice·s présent·e·s.
Le lieu reçoit gratuitement des groupes de scolaire sur demande, de la maternelle aux études supérieures.
Un livret de visite pour les 6-12 ans est disponible et propose des jeux en lien avec les œuvres de l’exposition. Il peut éventuellement servir aux enseignant·e·s.
La Maif propose également des visites accompagnées à destination des adultes. Gratuites sur inscription, elles durent environ une heure et permettent d’appréhender différemment les œuvres présentées, que les adultes sont invités à découvrir par la pratique et l’expérimentation.
AG
#MaifSocialClub
#Tropclasse
#exposition

Verlaine à Mons ou comment exposer un geste passionnel ?
Si la littérature fait couler beaucoup d’encre, elleest aussi capable parfois de donner corps à un récit vivant dans un lieu d’exposition. A mi-chemin entre roman policier, théâtre et poésie « Verlaine –cellule 252 Turbulences poétiques » semble bien être une exposition sur une figure littéraire comme on en attendait depuis longtemps. Sujet peu exploité par les commissaires hors les maisons d’écrivains et la BNF, le littéraire et le genre poétique s’accordent une place de choix pour l’événement culturel de l’année « Mons 2015, capitale européenne de la culture ». Avec Verlaine en tête d’affiche, la ville de Mons rend hommage à son plus célèbre détenu...
Exposition "Verlaine - Cellule 252 Turbulences Poétiques"

Portrait de Paul Verlaine de profil par Jehan Rictus, dessin; 1895 © Bibliothèque Royale de Belgique
Quand un musée consacré aux beaux-arts s’empare d’un des épisodes les plus célèbres de la littérature française.
Exposer le littéraire ?
La forme biographique apparaît, au premier abord, par nature incompatible avec le format exposition qui s’attache à démontrer, argumenter, révéler et justifier le parti-pris d’un discours. Exposer le littéraire est une démarche délicate qui consisterait donc à extraire une quintessence de l’œuvre et de la vie de l’écrivain. En ce sens, l’exposition de Mons tend à donner au public une « idée » plutôt que de se tenir à une «connaissance » de l’esprit verlainien. Si l’exposition vise à retracer les liens étroits qu’il a tissés avec la Belgique, le cœur du propos vise surtout à mettre à nu la passion déchirante entre Verlaine et Rimbaud. Point de départ d’un récit à tension dramatique où est mise en scène une destinée humaine : celle d’un poète luttant entre Éros et Thanatos. En soi, un beau geste muséal des commissaires.
La symbolique du geste meurtrier, pré-texte d’un destin littéraire à expographier
Plus qu’un objet en soi, le revolver, c’est la symbolique du geste du tir qui prend tout son sens et constitue le cœur du récit de l’exposition. Par cette articulation du discours, on se positionne nécessairement dans un avant et un après. Comment rendre lisible spatialement et esthétiquement cette histoire ? Digne d’une enquête policière sans qu’elle y ressemble pour autant, l’exposition met en exergue comme toile de fond le décor d’une dispute à l’origine d’une relation passionnelle meurtrière avec comme pièce à conviction le fameux revolver Lefaucheux ; objet de collection retrouvé à l’occasion pour l’événement.
Exposé dans une vitrine bien close, il repose telle une relique dans la 3ème section du parcours. Même si le traitement scénographique tend à fétichiser le revolver, on peut être satisfait que la muséographisation de cette dispute ne soit pas passée par des reconstitutions vidéos montrant la scène du crime rejouée par des acteurs ! Ce « geste » marque de son empreinte notre esprit, mais cet épisode ne se veut pas exclusif, nous sommes invités après une présentation biographique de Verlaine à traverser sa vie tumultueuse partagée entre écriture, passion, folie, errance, déchéance et résurrection.
Le revolver Lefaucheux de Paul Verlaine, vers 1870 © Coll. Privée
L’écrit démultiplié sous toutes ses formes
Tout au long du parcours proposé, l’écriture occupe une grande place dans l’espace. Ici les mots retrouvent leur plénitude expressive et émotionnelle dans une scénographie rythmée savamment travaillée, privilégiant des installations textuelles visuelles et sonores. L’écrit et la poésie se trouvent magnifiés quels que soient le support utilisé et l’endroit où ils sont inscrits et positionnés : citations et épistoles sur les murs, frise chronologique, mots aimantés sur des tableaux magnétiques, manuscrits inédits dans les vitrines (lettres échangées entre les deux poètes), documents numérisés intégrés dans des tablettes tactiles… sans oublier les petits poèmes imprimés à emporter chez soi … l’écrit a une plasticité, ici déclinée.
Quand l’écrit suggère l’oralité
Exposer des vers : la poésie verlainienne est là pour nous rappeler la puissance langagière de ce genre littéraire. En lisant tous ces fragments de poèmes sur le mur, le visiteur seul ou accompagné peut à loisir se les répéter à voix haute : l’exposition permet l’oralité. De ce point de vue, exposer l’écrit devient un sujet passionnant. Tel peut être notre curiosité satisfaite en (re)découvrant les épistoles de Verlaine comme on aurait pu le faire avec l’argot de Céline! Muséographier le littéraire revient donc à exposer une langue grâce à sa retranscription spatiale.
A travers toutes ces composantes textuelles réunies dans l’espace d’exposition, ressort l’esprit plus que la figure littéraire du poète. Nous pouvons nous rendre compte ainsi d’une puissance créative à l’œuvre en train d’éclore. Mettre en espace la poésie et tous ces sentiments connexes, c’est donner une certaine idée de la représentativité du monde de Verlaine. En sortant de cette exposition, l’effet souhaité désiré est de se trouver plus proche du poète en partageant sa sensibilité. C’est ainsi que l’on échappe à une vision trop fétichiste du personnage.
Anamorphose de Paul Verlaine
La section « épilogue » constitue le dernier tempsfort de l’exposition : la figure de Verlaine se décompose en anamorphose pour laisser place à ses écrits. Et le public est convié à prolonger la plume de Verlaine en recomposant les poèmes.
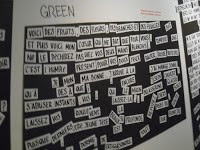 Section 11 "De la poésie avant toute chose" © Sandra Pain
Section 11 "De la poésie avant toute chose" © Sandra Pain
Les grands hommes partent mais les écrits restent
...Et le travail d’écriture continue hors-les-murs du musée en investissant façades et sols des rues de la ville. Sur une longueur de 10 km, le visiteur peut s’offrir une lecture urbaine méditative et cela en revenant tant qu’il le souhaite sur ses pas pour savourer une dernière fois...ici, la beauté d’un vers bien placé, ou là, la résonance d’une syllabe bien trouvée.
Ce projet baptisé “La Phrase”, a mobilisé sur le terrain pendant un an, une équipe de graphistes et de documentalistes. Jour après jour, ils ont peint et calligraphié avec soin sur le sol ces milliers de lettres. Belle métaphore de l’errance et de la liberté qui relève d’une prouesse expocitégraphique.
Sandra Pain
Pour aller plus loin :
www.mons2015.eu/fr/paul-verlaine-à-mons
http://www.latribunedelart.com/exposition-verlaine-cellule-no-2-turbulences-poétiques
# Verlaine
# Rimbaud
# Poésie
Visite à la loupe
Vous avez certainement tous remarqué de très petits objets dans les musées. Vous avez également certainement constaté que ce ne sont pas ceux envers lesquels nous sommes les plus attentifs. Entre se perdre dans la contemplation d’un tableau ou d’une pièce, le choix est souvent vite fait. Cela tient certainement du fait que les moyens ne sont pas mis en œuvre dans les musées pour pouvoir apprécier ces petits objets. Et pourtant ces derniers sont tout aussi intéressants que les autres, ils sont simplement plus difficiles à appréhender du fait de leur petite taille. J’ai donc été curieuse d’aller découvrir l’exposition Archi-timbrée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, une exposition qui présente cinquante timbres au milieu des œuvres monumentales des collections permanentes du Musée des Monuments français… Me demandant comment serait mis en valeur l’un des plus petits supports existant en allant voir cette exposition, j’ai trouvé des réponses.
Le livret d’accompagnement à la visite
Si vous allez sur la page de l’exposition du site internet vous verrez qu’elle mentionne un« catalogue offert ». C’est en fait un livret d’accompagnement à la visite qui est essentiel pour profiter de l’exposition : non seulement il présente l’exposition, mais il comporte un plan ainsi que des fiches sur certains expôts que vous trouverez dans le parcours. Cet outil d’aide à la visite dont je vais évoquer les atouts fait entièrement partie de l’exposition.
Le repérage des timbres
Vue d’un support de présentation de timbre devantune maquette © C.D.
Ma première questionen entrant dans l’exposition était « est-ce que je vais facilement trouver ces timbres ? ». Parce qu’il faut savoir que la galerie des moulages présente 350 estampages en plâtre et 60 maquettes d’architecture et de charpente ; que la galerie des peintures murales et des vitraux compte une centaine de copies de peintures murales emblématiques ; et que la galerie d’architecture moderne et contemporaine expose une centaine de maquettes, éléments de bâtiments, dessins et photographies. Alors imaginer cinquante timbres au milieu de tout cela, ce n’est pas évident. Ça relève même de la chasse au trésor. Pourtant, plus de peur que de mal, il s’avère que dès le début du parcours on les repère très bien !
Chaque timbre est présenté sur un support proche du format A4 de la forme d’un timbre. Ce support tient sur quatre pieds blancs ou est directement posé sur le mobilier d’exposition. Pour être certain de le repérer, une pastille jaune et bleue avec un numéro est posée au sol devant l’œuvre à laquelle le timbre fait écho. Ces numéros se retrouvent également au début du livret d’accompagnement à la visite (atout 1). Ce-dernier propose effectivement un plan de repérage juste après l’introduction à l’exposition. Trois pages présentent les trois galeries du musée avec l’emplacement précis des différents timbres du parcours. Avec tout cela, impossible de passer à côté d’un des timbres !
La lisibilité des timbres
Vue d’un support de présentation de timbre de près avec utilisation de la loupe © C.D.
Une fois les timbres repérés, encore faut-il pouvoir les observer. Pour cela, rien de tel qu’une bonne vieille loupe. Chaque support de timbre comporte une loupe que le visiteur peut manier librement. Elle permet d’apercevoir des détails autrement difficiles à appréhender. Pour compléter cette observation le livret d’accompagnement à la visite contient une représentation en taille réelle de trente-six timbres du parcours (atout 2). Libre à chacun d’en observer les détails au plus près. Pour vérifier si le visiteur a bien observé les timbres de l’exposition, un jeu multimédia est proposé en fin de parcours. Il se joue à deux, chaque joueur devant relever des défis comme retrouver les morceaux manquants de plusieurs timbres, ou encore trouver les particularités communes d’une série de timbre. De quoi réactiver notre mémoire, ce qui n’est jamais inutile.
Le lien entre les timbres et les collections permanentes
Comment le lien est-il fait entre les timbres présentés sur leur support et les œuvres de la collection permanente du musée ? Le lien est signalé physiquement par les pastilles au sol puisque les supports sont placés de sorte que l’observation de l’expôt se fasse le plus confortablement possible. Si l’expôt à observer est une sculpture monumentale, le support est éloigné de plusieurs mètres afin de pouvoir l’embrasser du regard. Si l’expôt à mettre en relation avec le timbre est une maquette, le support est placé à proximité directe, voire sur le mobilier d’exposition.
Cette réflexion sur le positionnement des supports aide le visiteur à orienter son regard et à apprécier le lien entre les timbres et les expôts. Le lien se fait donc évidemment aussi par la représentation qui illustre le timbre. Chaque timbre dialogue avec l’expôt par cette représentation imagée. Le lien est parfois évident car la représentation du timbre est un gros plan d’une œuvre monumentale. Il est parfois moins perceptible quand un timbre représente un monument et que l’expôt ne figure qu’une partie de ce monument qu’il faut alors retrouver dans le timbre (d’où l’utilité de la loupe).
La recherche a alors un côté ludique appréciable. Le timbre peut également représenter un personnage qui a eu un rôle majeur dans l’histoire d’un monument dont une partie est exposée. Les liens se font ainsi de multiples façons ce qui crée un rythme de visite assez dynamique. Enfin, pour comprendre la pertinence de la mise en regard d’un timbre et d’un expôt, il faut se reporter au livret d’accompagnement à la visite (atout 3). Ce dernier développe du contenu pour dix-huit des timbres présentés. Chacun a une double page sur laquelle on retrouve la représentation du timbre et de l’expôt, des documents tels des maquettes de timbre, des photographies ou encore des bons à tirer, ainsi qu’un texte permettant d’expliquer les raisons historiques, commémoratives et touristiques du choix de la représentation de tel ou tel monument sur le timbre.
Au final, ma curiosité a été satisfaite au cours de cette visite. Du point de vue du professionnel, elle permet de réfléchir aux outils mobilisables pour la mise en valeur des petits objets dans les expositions. Du point de vue du visiteur, elle permet de regarder différemment le timbre, un support qui fait partie de notre quotidien mais que l’on regarde finalement assez peu. Bref, chacun y trouve son compte et risque (heureusement) de ne plus porter la même attention aux petits objets qu’il croisera dans les musées.
C.D.
Exposition Archi-timbrée – Voyage philatélique dans l’architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine, du 15 avril au 21 septembre 2015.
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/25791-archi-timbree.html
http://www.citechaillot.fr/data/expositions_bc521/fiche/24557/cp_architimbree_8c041.pdf
#Exposition
#Timbre
#Architecture

Visiter et Habiter la maison POC
J’attendais avec impatience l’arrivée de la World Design Capital à Lille, annoncée dès 2017 et prévue pour 2020 et j’ai découvert l’une des expositions en septembre. Cette première sortie culturelle (officielle) depuis le (premier) déconfinement m’a transportée vers bien des émotions.
Le Design sur le devant de la scène
Ainsi, à travers le titre de World Design Capital, l’organisation récompense tous les deux ans une ville pour l’affiliation du design à sa politique économique sociale et culturelle.
Elle a pu disposer de quelques années pour mettre en place une programmation culturelle autour du Design. Ainsi, depuis cet été, la Métropole a vu fleurir des expositions et événements promouvant les solutions proposées pour améliorer nos modes de vies et, à plus grande échelle, le monde, démontrant ainsi l’impact positif du design dans notre société.
La World Design Capital à Lille
En 2018, un vaste appel à l’expérimentation par le design est lancé. Collectifs, entreprises, associations, lieux culturels ont pu proposer des objets, des services et idées en collaboration avec des designers ayant pour objectif commun d’améliorer la vie en société. Cet appel à projets a reçu plus de 600 idées. De la modeste ébauche au projet abouti, ils sont organisés en six maisons thématiques dans la Métropole Lilloise : Habiter (Gare Saint Sauveur, Lille), Prendre soin (Maison Folies de Wazemmes), Ville collaborative (à la Madeleine), Economie circulaire (Monastère des Clarisses, Roubaix), Action publique (au Biotope à Lille) et Mobilité (Lille).
Une exposition qui affecte nos sentiments
L’espace d’exposition étreint par la lumière naturelle © M.D.

Une scénographie et des projets qui invite à s’attarder et habiter les lieux © M.D.
Ce questionnement autour de l’habitat évolue doucement vers les espaces publics, lieux également fréquentés et habités. Alice Cabaret, fondatrice de l’agence collaborative de prospective urbaine The Street Society, porte une attention particulière à la démarcation croissante entre habitat et espace public et mène une réflexion sur une revalorisation de l’espace urbain pour “habiter collectivement la ville”. Pour tendre vers une ville domestique, elle propose de revaloriser les seuils de transition qui existent entre la propriété et l’espace public comme les balcons, cours, paliers. Ces micro-espaces à haut potentiel d’habitabilité, qui ont démontré, pendant le confinement, leur caractère convivial dû à la proximité qu’ils engagent, peuvent, pour Alice Cabaret, devenir des “antichambres urbaines” aux fonctions multiples.

Une scénographie signé Atelier Smagghe pour la Maison POC Habiter © M.D.
Une heureuse expérience de visite
Avec du recul, le contexte actuel a fortement joué sur mon expérience de visite et sur ce que j’en retiens. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose, toute visite est différente et celle-ci a su me rappeler mon appétence pour le design et mon besoin de vivre avec passion et sensibilité.
M.D.
#Design
#Lille
#World Design Capital
Bibliographie/ webographie
Communiqué de presse de la ministre de la Culture, 23 Octobre 2017, Paris
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Design-mode/Actualites-design/Lille-Capitale-Mondiale-du-Design-en-2020
Site de la Word Design Organisation
https://wdo.org/programmes/wdc/
Moniez Laurie, « Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design pour 2020 », 14 Octobre 2017, LeMonde.fr
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/14/lille-metropole-capitale-mondiale-du-design-pour-2020_5201053_3234.html
Site Design is capital.com
-sur les POC
https://www.designiscapital.com/les-poc
-Le projet
https://www.designiscapital.com/projet
-Maison POC Habiter
https://www.designiscapital.com/maisons-poc/habiter
Site WAAO -Centre d’architecture et d’urbanisme, sur la maison POC Habiter