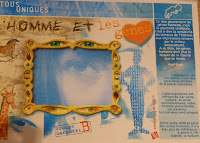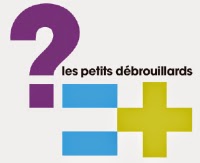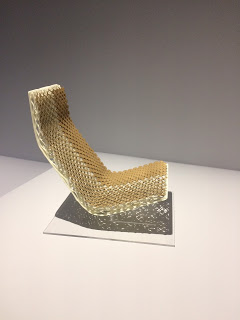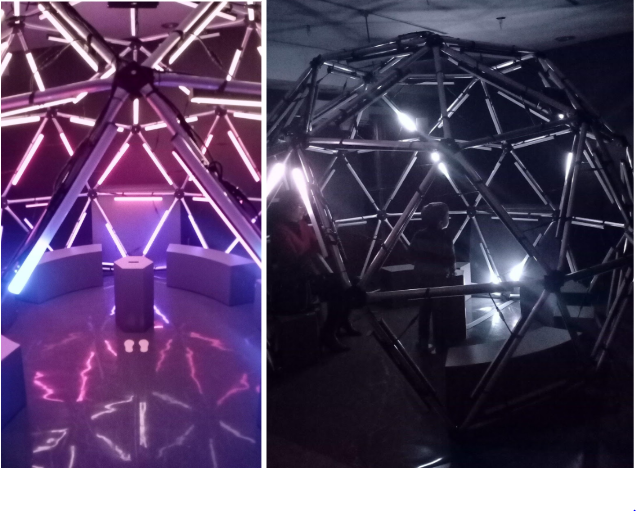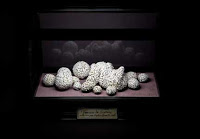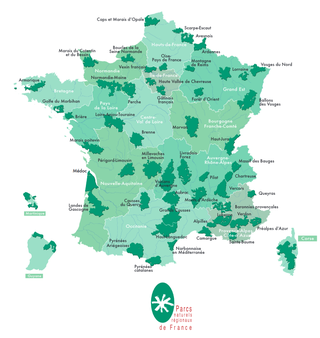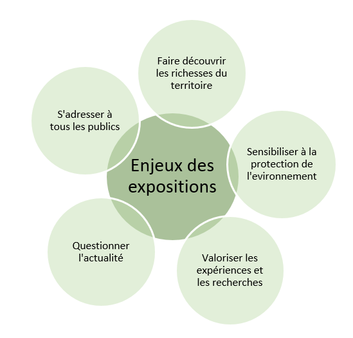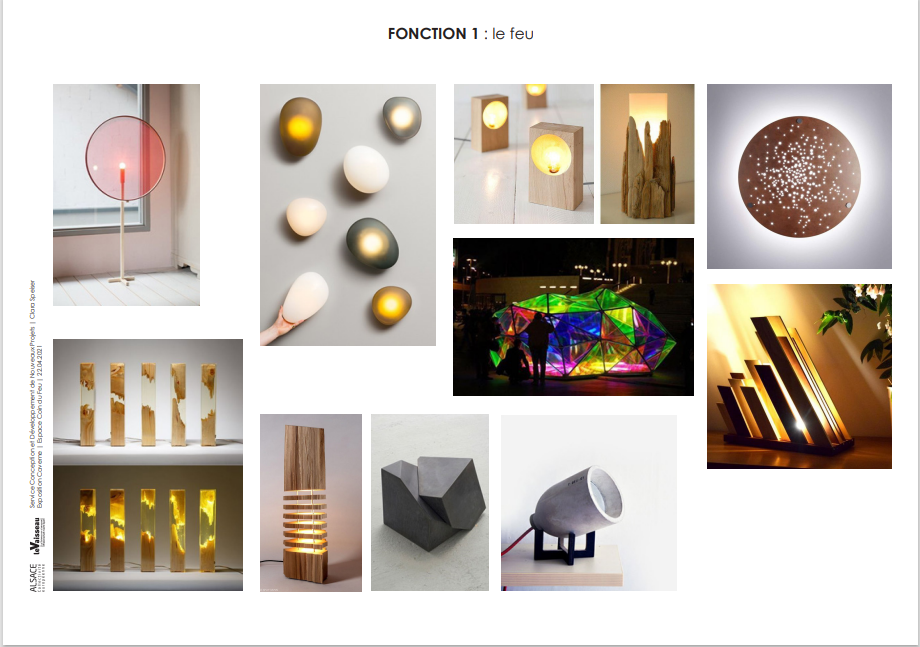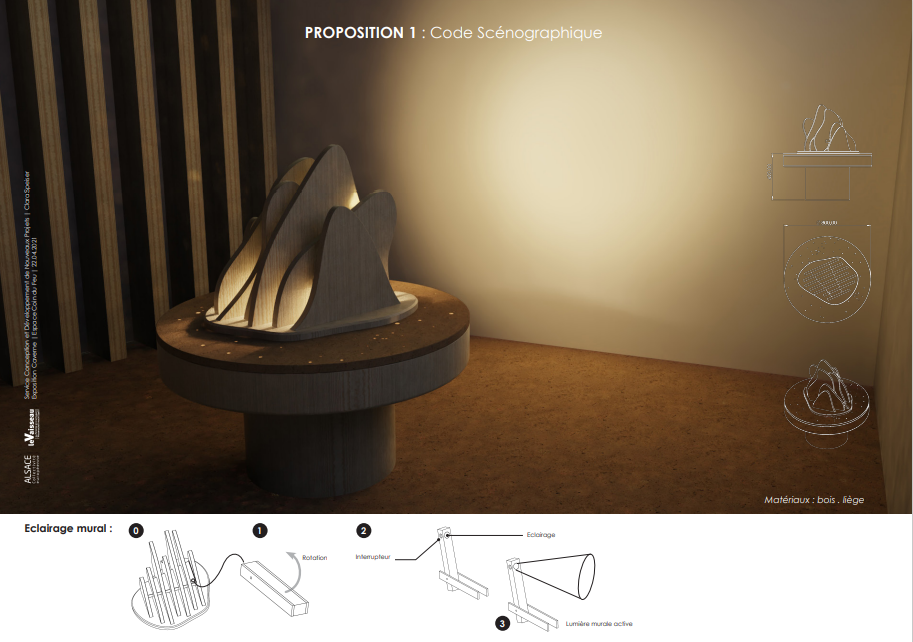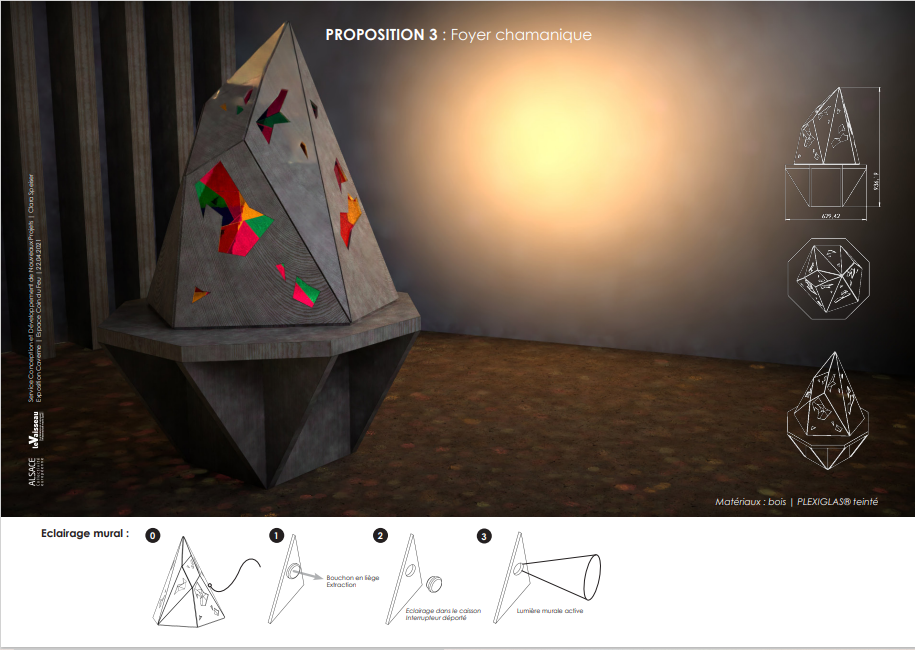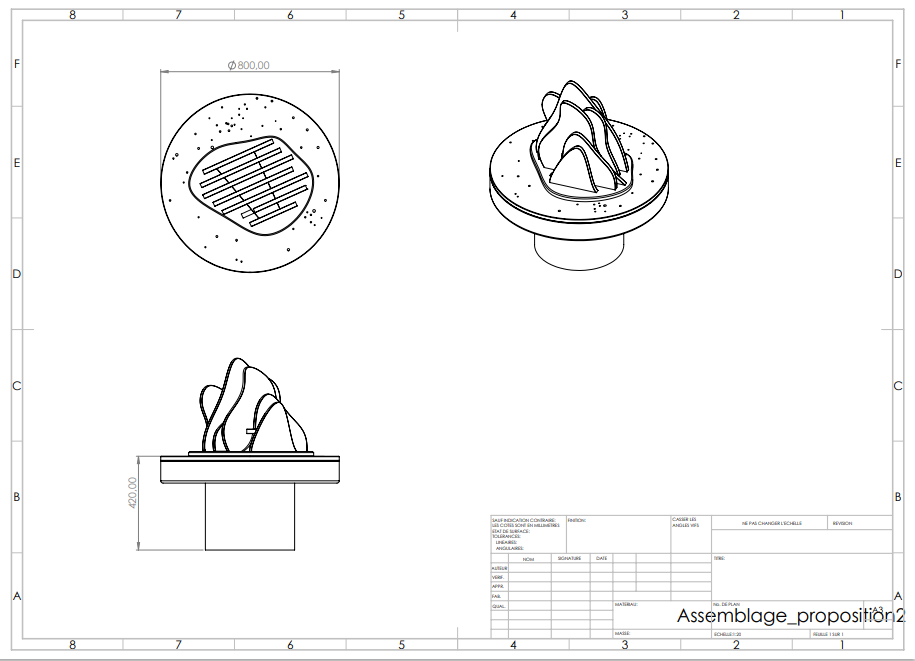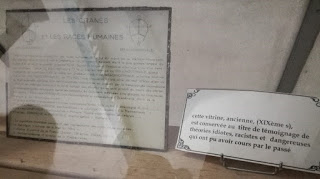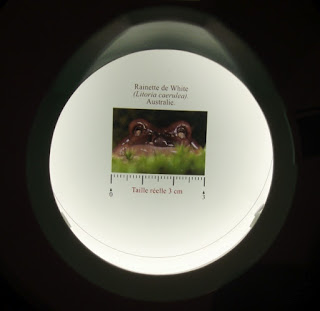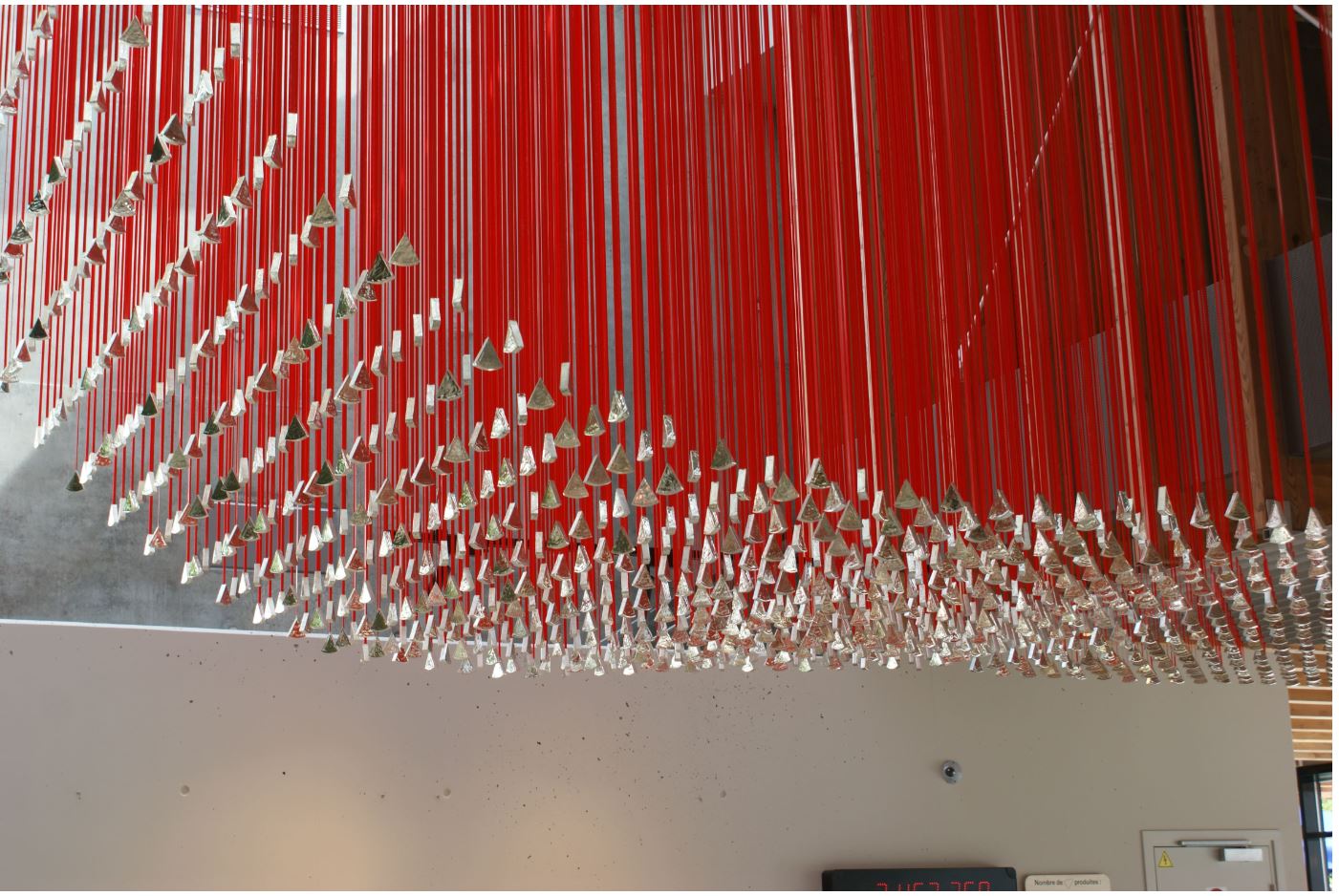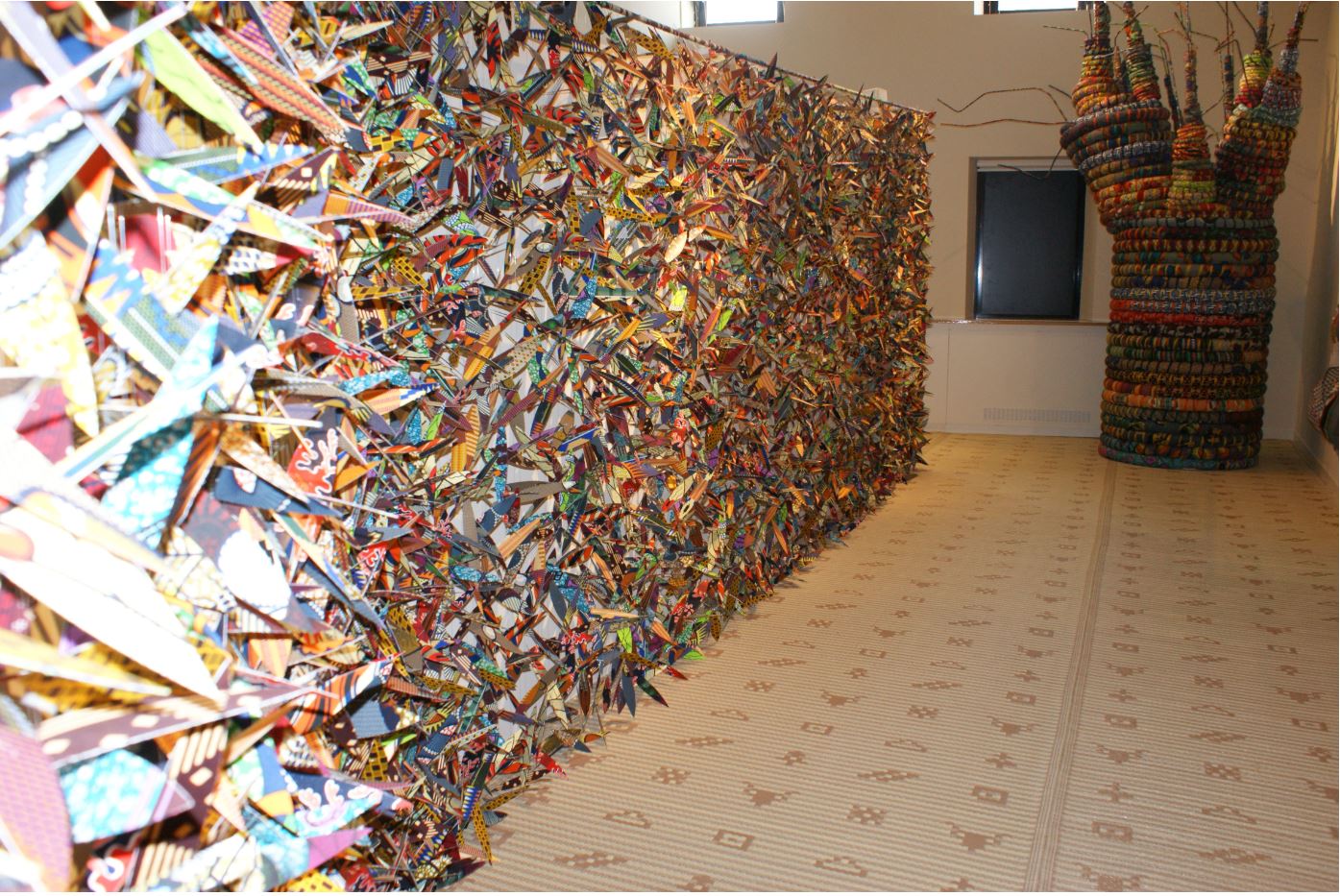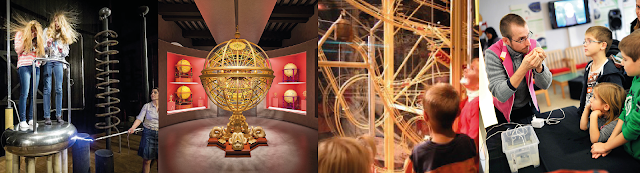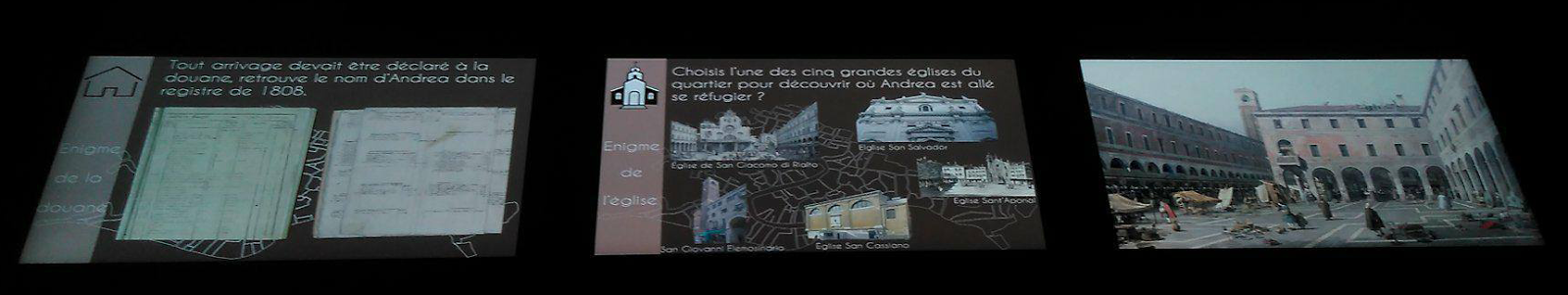Sciences et techniques

« Tous à plume », une exposition au muséum de Bordeaux
L’association APEX collabore avec le muséum d’histoire naturelle de Bordeaux pour l’exposition « Tous à plumes ! »
Une exposition portant sur nos amis volants
Le musée d’histoire naturelle de Bordeaux vous ouvre ses portes avec une nouvelle exposition temporaire du 6 avril au 5 novembre 2023. Cette exposition porte sur des êtres que nous côtoyons au quotidien auxquels nous ne faisons plus attention : nos amis à plumes, les oiseaux. Ils volent, chantent, sautillent, se frayent des chemins entre les passants, se reproduisent, ce sont les êtres « les plus visibles de la vie sauvage ». L’exposition met en avant leur diversité à la fois physique par leur plumage, leur couleur, leur corpulence mais également auditive avec la multiplicité de leurs chants. Leur comportement est donné à voir et à expérimenter : comment ils volent, se nourrissent, créent leur nid… Entre immersion et expérimentation, vous êtes conviés à découvrir la vie des oiseaux.
Une scénographie immersive et participative
La scénographie de l’exposition débute par une immersion dans une pièce sombre étoilée. La lueur des petits points de lumière dévoile une forêt sur les pans de mur. Le visiteur est plongé dans la nature où l’ouïe est conviée afin d’apprécier les chants d’oiseaux. Ce premier espace introductif est limité à une dizaine personnes toutes les deux minutes environ et permet d’entrer en relation avec ce qui se poursuit par quelques minutes d’écoute.
La suite de visite se poursuit, aucun parcours n’est déterminé, le visiteur est libre de sa promenade. Différents dispositifs que nous pourrions qualifier de stations ou de modules présentent chacun un court texte en français et en anglais sur kakémono de part et d’autre d’un dispositif à manipuler, toucher, observer… Ces dispositifs convoquent plusieurs sens du visiteur et lui apporte une expérience. Chaque station est distincte et apporte des connaissances sur un élément à la fois : par exemple, des stations tels que « Plumage », « Becs », « Matériaux de nids », « Œufs » ou encore « Empreintes ».

Station thématique au cours du parcours ©M.C
Deux espaces circulaires ont été conçus au centre de la salle. Dans un, les visiteurs, par binôme, expérimentent par le toucher. Celui à l’extérieur touche des reproductions en plastique d’espèces présentées tout au long du parcours et est invité à les deviner. À l’intérieur, le deuxième visiteur possède la représentation en plastique, le nom de l’espèce ainsi qu’un dessin de celle-ci et infirme ou confirme l’intuition de celui à l'extérieur. Dans la seconde, le visiteur, seul, est invité à activer des vieilles machines telles qu’un folioscope ou encore un praxinoscope. Ces machines viennent dévoiler un vol, un envol d’oiseau…

Espaces circulaires de l’exposition ©M.C
Un troisième espace de forme rectangulaire est présent au centre de la salle. Il s’apparente à un observatoire où le calme règne. Les visiteurs s’assoient sur des tabourets pliables afin d’écouter les chants de quatre espèces d’oiseaux.

Observatoire au calme ©M.C
À la fin de l’exposition, sur des arbres, différents oiseaux sont posés ou suspendus comme en plein vol. Un autre se vêt d’un ensemble de nichoirs de différentes espèces. Cet espace dévoile les surnoms d’oiseaux, la multitude de chants et il est également dédié à l’évocation des associations naturalistes et des gestes à adopter auprès des oiseaux.

Arbres et nichoirs ©M.C
Cette exposition a été conçue pour un public large, les primo-visiteurs comme les amateurs. Par les courts textes sur kakémonos, les primo-visiteurs peuvent s’informer en peu de temps sur l’ensemble des thématiques traitées en quelques mois. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des bornes, adoptant la physionomie de nichoirs qui se fondent dans le décor, permettent d’en apprendre davantage grâce à un écran, le visiteur peut pointer une thématique pour en savoir plus.
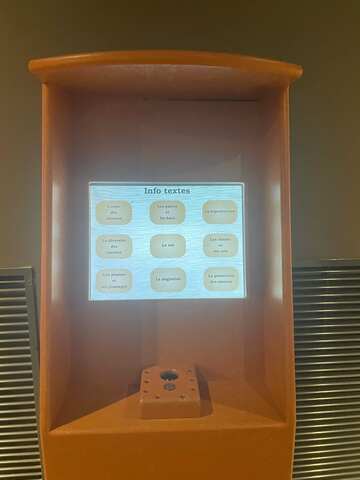
Borne « Pour en savoir plus… » ©M.C
Cette exposition participative et expérimentale rend le visiteur acteur de sa visite et pas seulement spectateur. Il expérimente par le toucher, la vue ainsi que l’ouïe sont conviés pour participer et appréhender l’ensemble des caractéristiques des oiseaux. Cette exposition s’accompagne d’oiseaux naturalisés présents dans les réserves du muséum tout au long du parcours.
Un espace conçu pour les 3-6 ans
Un dernier espace, « Boules de plumes » est conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, il se compose de différents modules afin d’éveiller les sens des plus petits. Là encore, l’espace se veut multi-sensoriel et expérimental. Les enfants sont invités à retrouver les sons des chants de plusieurs espèces par l’activation des outils mis à disposition. Ils sont également conviés à imiter les oiseaux dans les nichoirs par le biais d’une petite cabane accessible qu’aux petits.

Dispositif de l’espace Boules de plumes dédié aux enfants ©M.C
Un guide des bonnes pratiques à conserver
Un livret intitulé « « Comment aider les oiseaux ? » Dans le cadre de l’exposition « Tous à plumes ! » est mis à disposition au visiteur afin de le ramener à la maison. Il permet de laisser une trace de l’exposition au visiteur mais également de donner des conseils sur le nourrissage, les précautions à suivre lorsqu’un oiseau est blessé, les risques pour les oiseaux tels que les baies vitrées, les tontes de haies ou encore les chats. Les nichoirs sont aussi convoqués avec un schéma pour construire son propre nichoir « boite aux lettres ». L’exposition continue en dehors de celle-ci et incite les visiteurs au bricolage pour fabriquer leur nichoir personnel pour accueillir les oiseaux ! En dernière page est indiquée une liste de sites internet pour aller plus loin sur les différents points présentés.
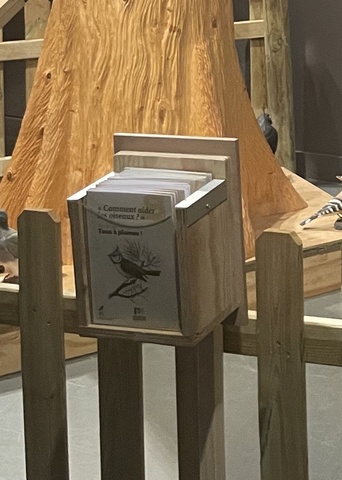
Présentoir des livrets à ramener à la maison ©M.C
Une réalisation de l’association APEX en partenariat avec le Muséum de Bordeaux
Cette exposition a été conçue par Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun de l’association APEX en partenariat avec le muséum de Bordeaux. APEX est une association créée en 1995 se questionnant sur les visiteurs acteurs. Elle travaille sur l’immersion et la participation pour une réelle expérimentation du visiteur afin de le faire réfléchir sur le sujet exposé. Selon eux, « c’est bien au travers de nos 5 sens que nous explorons, apprenons, ressentons, imaginons… ». Ils prônent une vision de l’exposition, en effervescence depuis quelques années, qui est de convier l’ensemble de nos sens afin de nous faire réfléchir, c’est par notre expérimentation que nous apprenons davantage que par la lecture et l’observation. Ces méthodes sont en essor depuis quelque temps, non sans rappeler les méthodes d’éducation scolaire telles que Montessori !
Une exposition multi-sensorielle et expérimentale à découvrir du 6 avril au 5 novembre 2023 au musée d’Histoire Naturelle de Bordeaux !
Maryline Catherine
Pour en savoir plus :
- Muséum de Bordeaux : https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/expositions/tous-a-plumes
- Association APEX : https://apex-expo.be/apex/
#muséumBordeaux #AssociationAPEX #oiseaux

Enfants-Parents, souriez, vos gènes sont étudiés !
La Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le XIXè arrondissement de Paris, propose depuis mai 2002, une exposition sur : « L'Homme et les gènes ».Pour la concevoir, le musée a fait appel au généticien Axel Kahn, spécialiste en biochimie et chercheur à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médical (INSERM). Son objectif dans cette exposition est de montrer les mécanismes de l'évolution et en particulier celui de l'homme.
A la découverte du corps humain
Cette exposition permanente est divisée en quatre parties. Dans un premier temps, le visiteur est invité à découvrir l'histoire de l'évolution et de la vie. Il sera alors prêt à plonger dans l'exploration des gènes humains pour comprendre leur rôle. Ensuite, il pourra étudier le génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes chez une personne. Pour terminer ce voyage génétique, le visiteur rentrera au cœur du débat actuel sur la recherche. Voulez-vous participer à un futur débat citoyen ? Alors, venez donner votre point de vue sur les tests génétiques !
Savez-vous lire les gènes ?
A la fin de la deuxième partie de l'exposition, le visiteur est convié à explorer et à décrypter le rôle des gènes grâce à un outil de médiation : « le photomaton de l'expression génétique et culturelle ». A la fois ludique et pédagogique, les petits comme les grands se prêtent volontiers au jeu.
Crédits : L.P
Il ne s'agit pas d'un simple photomaton classique. Celui-ci est contrôlé par un ordinateur tandis qu'une imprimante et plusieurs écrans lui sont rattachés. Quand le visiteur met en marche la machine à l'aide d'une souris, une voix lui explique le rôle des gènes : chaque individu est unique, personne n'a le même patrimoine génétique, la même vie ou le même environnement culturel. Le but de cette machine consiste à photographier une partie du visage de l'utilisateur (ses yeux, sa tête, son nez...) afin que le défilé de la diversité débute.
Après ce tirage de portrait, la voix lui demande de sélectionner son groupe sanguin (A, B ou O), pour lui expliquer qu'il y a deux sortes de gènes transmis : des gènes visibles et invisibles, ce qui rend l'individu unique alors qu'il y a juste 0,1% de différence entre chaque individu. Subtile la nature ! Rien n'est définitif dans nos gènes car ils peuvent être modifiés par notre culture, notre environnement, notre histoire personnelle ou encore nos passions.
Derrière le photomaton, plusieurs écrans montrent les différentes photographies prises par les visiteurs mais seulement dans un ordre précis. Chaque photographie est alignée en fonction du même groupe sanguin des visiteurs.
Crédits : L.P
Ludivine Perard
Plus d'infos :Cité des Sciences et de l'IndustrieL'exposition : L'Homme et les gènes

Félins au Muséum d’Histoire naturelle de Paris : chat vaut le coup !
Jusqu’au 7 janvier 2024, le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris accueille une exposition qui ravira les amateurs de chats de toutes tailles : Félins
Un mur de félinsaccueillant les visiteurs dans la première salle de l’exposition ©M.B
De la déesse Bastet au paquet de croquettes : une exposition transversale
L’ambition de Félins? Aller à la rencontre des félins, ces animaux qui nous fascinent, et dont l’imaginaire collectif s’est emparé depuis longtemps, avec plus ou moins de véracité. Bien que prenant place dans un muséum d’histoire naturelle, l’exposition tend à la transversalité entre différents domaines.
Les deux premières séquences « Fascinants félins » et « De parfaits prédateurs ? » sont dédiés à un propos scientifique sur les félins. De nombreuses thématiques y sont abordées : les 5 sens, le pelage, l’anatomie, la chasse, l’alimentation, le sommeil ou l’éduction des petits. Pourtant, l’exposition n’est jamais indigeste. Les textes, très pédagogiques, sont courts, clairs et vont droit au but.

«Tendre l’oreille», une partie sur l’ouïe des félins dans la séquence «De parfaits prédateurs?» ©A.S
Succédant à ces séquences scientifiques, l’exposition propose d’emmener le sujet vers d’autres domaines liés aux sciences humaines. La troisième partie, « Des félins et des hommes », présente un panorama de la perception des félins dans différentes cultures sur les 5 continents. Les valeurs et les pouvoirs qu’on le prête diffèrent, mais les félins sont partout, dans les symboles de royauté, les cultes et les mythologies, honorés lors de fêtes ou déifiés… Le muséum bénéficie ici de nombreux prêts de musées parisiens (peintures, sculptures, objets d’ethnologie) pour illustrer l’omniprésence des félins de tout poil dans les cultures autour du monde.

La vitrine dédiée à l’antiquité égyptienne dans la séquence «Des félins & des hommes» ©M.B
La visite se termine par la séquence « Apprivoisés ou domestiqués » qui retrace l’histoire de la domestication du chat, la seule espèce féline à avoir été domestiquée durablement par l’homme. L’exposition revient sur les relations ambivalentes entre le chat et les hommes à travers l’histoire, tantôt symbole de chance en Asie et créature diabolique dans l’Europe médiévale. Un mur de photographies et de témoignages met en scène de façon émouvante l’importance de ces petites boules de poils dans la vie de personnalités publiques, de Edgar Allan Poe à Patti Smith. Des contenus sur le comportement du chat domestique et son impact sur la biodiversité viennent clore cette rencontre avec les félins.

Accrochage sur la diabolisation du chat en Europe et contenus sur la biodiversité ©A.S
On peut regretter que cette dernière partie de l’exposition paraisse un peu expéditive au regard des séquences sur la science et les liens entre les félins et les humains. La pièce dédiée est bien plus petite que l’espace vaste et aéré des séquences précédentes. L’accrochage assez dense d’oeuvres et de photographies sur le chat domestique donne l’impression d’avoir privilégié le nombre d’objets à voir sur la transmission d’une information. Malgré tout, cela ne change rien à la qualité et la clarté des contenus présents dans cette partie, identique à ceux du reste de l’exposition.
Ne pas donner sa langue au chat : une exposition ludique et accessible
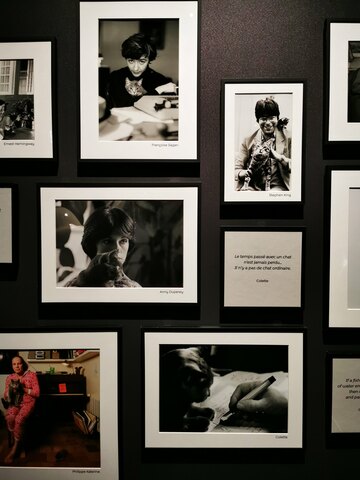
Accrochage de photographies sur des personnalités publiques et leur chat ©A.S
Félinsest ludique, pédagogique et facile d’accès. Malgré un sujet vaste et transversal, l’exposition réussit à être toujours accessible et agréable à visiter. Le ton est léger (on salue notamment les titres de chaque texte, plein d’humour), les textes, assez succincts, sont d’une grande clarté, en cherchant l’efficacité pour transmettre l’idée clé.

Exemple de textes dans la séquence «De parfaits prédateurs?» ©A.S
Des schémas, maquette à toucher, et, bien entendu, les nombreuses manipes présentes dans chaque séquence de l’exposition participent pleinement de cette recherche de pédagogie.
Tous ces dispositifs approfondissent le contenu donné par le texte, mais permettent aussi de se confronter « physiquement » à des fonctionnements différents des nôtres : des maquettes montrent les différences entre les crânes et les systèmes digestifs félins et humains, ou la manipe « Faire ses gammes » qui permet de tester le champ auditif de notre ouïe par rapport à d’autres animaux. L’exposition se veut accessible au plus grand nombre avec des textes en braille, des couleurs contrastées ou des bornes disposant d’une audiodescription ou de LSF.

Dispositifs présents dans l’exposition: Faire ses gammes, des maquettes d’intestins et des schémas comparatifs de la dentition ©A.S
Une scénographie spectaculaire
Après une descente dans un escalier sombre, l’exposition s’ouvre de façon poétique sur un tête-un-tête avec un lion, que l’on surprend en train de s’abreuver dans un lac. La première salle, « Fascinants félins », continue d’impressionner le visiteur avec un gradin où nous accueillent des dizaines de félins, du petit chat rougeâtre aux majestueux lions et tigres.

Le groupe de félins à l’entrée de l’exposition ©A.S
L’exposition joue beaucoup de mises en scène impactantes. Dans la partie suivante, « De parfaits prédateurs », des naturalisations mettent en scène les félins en chasse, dans une scénographie spectaculaire, soulignée par des jeux d’ombres et de lumière. Cette grande salle est aussi enrichie d’audiovisuels projetés sur les murs, montrant des scènes de chasses ou des moments de jeux entre de jeunes félins. Plus loin, des squelettes d’animaux décomposent les mouvements (saut, chute) pour illustrer l’anatomie des félins en action. L’utilisation de squelettes dynamiques existe dans d’autres muséums, comme à Toulouse, par exemple, où l’on trouve des squelettes d’animaux, mais aussi d’humains, avec notamment un cheval et son cavalier.
Les vidéos, tout comme les mises en scène de squelettes et d’animaux naturalisés en mettent « plein la vue » et magnifient les stars de cette exposition. Les naturalisations, emblèmes des muséums, ne sont jamais présentées gratuitement. Elles sont au service de la scénographie ou de la muséographie, pour illustrer, surprendre et émerveiller.

Scène d’un guépard en pleine chasse et squelettes dynamiques d’une chute ©M.B et A.S
Impressionnante par sa scénographie, riche et didactique, Félinsvaut le détour, si vous n’avez pas d’autres chats à fouetter !
Myrrha Bouly
Pour aller plus loin
- Exposition présentée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris du 22 mars 2023 au 7 janvier 2024.
- Page de l’exposition sur le site : https://www.mnhn.fr/fr/expo-felins
#exposition #science #animaux
La conception participative de l'exposition Terra Data
En octobre 2015, M. Bruno Maquart, nouveau président de la Cité des sciences et de l’industrie nommé 3 mois auparavant, demande à l’équipe de muséographes en charge de la future exposition « TERRA DATA » d’intégrer le public à son processus de conception. L’équipe de concepteurs est alors en train définir le préprogramme muséographique ; elle planifie, pour 5 mois plus tard¹, un débat participatif organisé pour le grand public.
Un groupe de participants © J-P. Attal / EPPDCSI
Cette consultation publique très en amont, en phase de définition des contenus de l’exposition, a-t-elle modifiée les intentions des concepteurs ? En quoi cette méthode innovante a-t-elle bouleversé les usages et la perception du media exposition par les citoyens ?
Pour cette expérience inédite, la Cité des sciences et de l’industrie a sollicité un cabinet de conseil en stratégie et en ingénierie de la concertation publique, le cabinet Res publica. Souvent utilisées dans des débats concernant des questions de vie locale, les méthodes consultatives visent habituellement à trouver un consensus entre deux parties ; les élus et les citoyens, par exemple. Dans le cas de notre exposition culturelle, la démarche consultative a eu pour objectif de mieux comprendre quels rapports les citoyens entretiennent avec le terme Big Data et quelles sont les attentes qu’ils peuvent formuler dans un contexte technologique et économique en mutation. Il s’est agi plutôt d’évaluer des niveaux de connaissances et d’identifier des questionnements récurrents afin d’adapter le futur contenu de l’exposition aux besoins du public.
Dans ce but, le cabinet de conseil Res publica a collaboré étroitement avec l’équipe projet. Fort de son expérience, il a guidé l’équipe projet dans la formulation des questions qui devaient faire émerger un matériau répondant aux objectifs fixés (que nous détaillons ci-dessus). Du point de vue organisationnel, le cabinet de conseil a préconisé un plan de communication et d’invitation destiné à récolter des inscriptions de participants volontaires. En outre, il a fait bénéficié l’équipe-projet de son expérience en matière d’optimisation des ressources (temps, personnes) : répartition des groupes, timing de réflexion / échange / synthèse / restitution, mise en scène spatiale, etc.
Après la diffusion d’un appel à participation par voie d’affichage dans les lieux publics de la Cité des sciences, via les réseaux sociaux et par e-mailing auprès des fichiers d’abonnés de la Cité des sciences, cent-quarante-sept inscriptions ont été enregistrées².
Le jour J, samedi 26 mars 2016 (week-end de Pâques !), soixante-dix personnes se sont présentées et ont été regroupées par huit autour de tables rondes. Le débat, animé par Res Publica assisté de l’équipe projet, s’est déroulé en plusieurs séquences entre 14h30 et 17h30. Les modalités d’interrogation ont été de trois ordres : trois questions individuelles auxquelles il fallait répondre par écrit, en début de séance et que l’on remettait entre les mains de l’organisateur. Ensuite, une série de questions thématiques (une thématique différente à chaque table) à laquelle on répondait d’abord individuellement par écrit puis que l’on partageait avec ses compagnons de table.
Ceci était le point de départ des échanges d’opinions, dans un ordre libre, avec pour seule contrainte de produire une synthèse des différentes réflexions de groupe, dans leur diversité autant que dans leur consensus. Chaque table désigne alors un représentant chargé de lire à voix haute la synthèse des réponses collectives de sa table. Enfin, les participants ont été invités à prendre la parole, s’ils le souhaitent, pour insister sur un élément, poser une question, formuler une recommandation.

Le badge distribué à chaque participant © V. Marta
À l’issue de cette journée, quels ont été les apports du projet aux vues de son coût financier ?
Premièrement, cette concertation publique a mis en lumière un intérêt réel de la part du public pour les contenus liés au Big data. L’investissement intellectuel de tous les participants, l’enthousiasme des comportements ont montré que le public souhaitait faire partie du débat et se situer dans leur rapport aux données. Cela a encouragé l’équipe-projet à préparer une exposition manifestement très attendue.
Deuxièmement, les sujets discutés correspondaient à ceux qui sont alors prévus dans le pré-programme de l’exposition : données (personnelles et publiques) ; protection, partage, collecte, interconnexions, traitements, usages ; algorithmes : définitions et applications ; lois ; objets connectés et santé ; éducation et informatique ; formation. Cela a donc conforté les co-commissaires dans leurs parti-pris éditoriaux. Et ce, d’autant que le public présent était à parité homme-femme et toutes les tranches d’âges et de sensibilités se trouvaient représentées. Les avis étaient assez variés et ambivalents (progrès/vigilance), différentes tranches d’âges et professions étaient représentées. Ce panel constituait donc un échantillon fiable des publics fréquentant les expositions.

Des débats animés © V. Marta
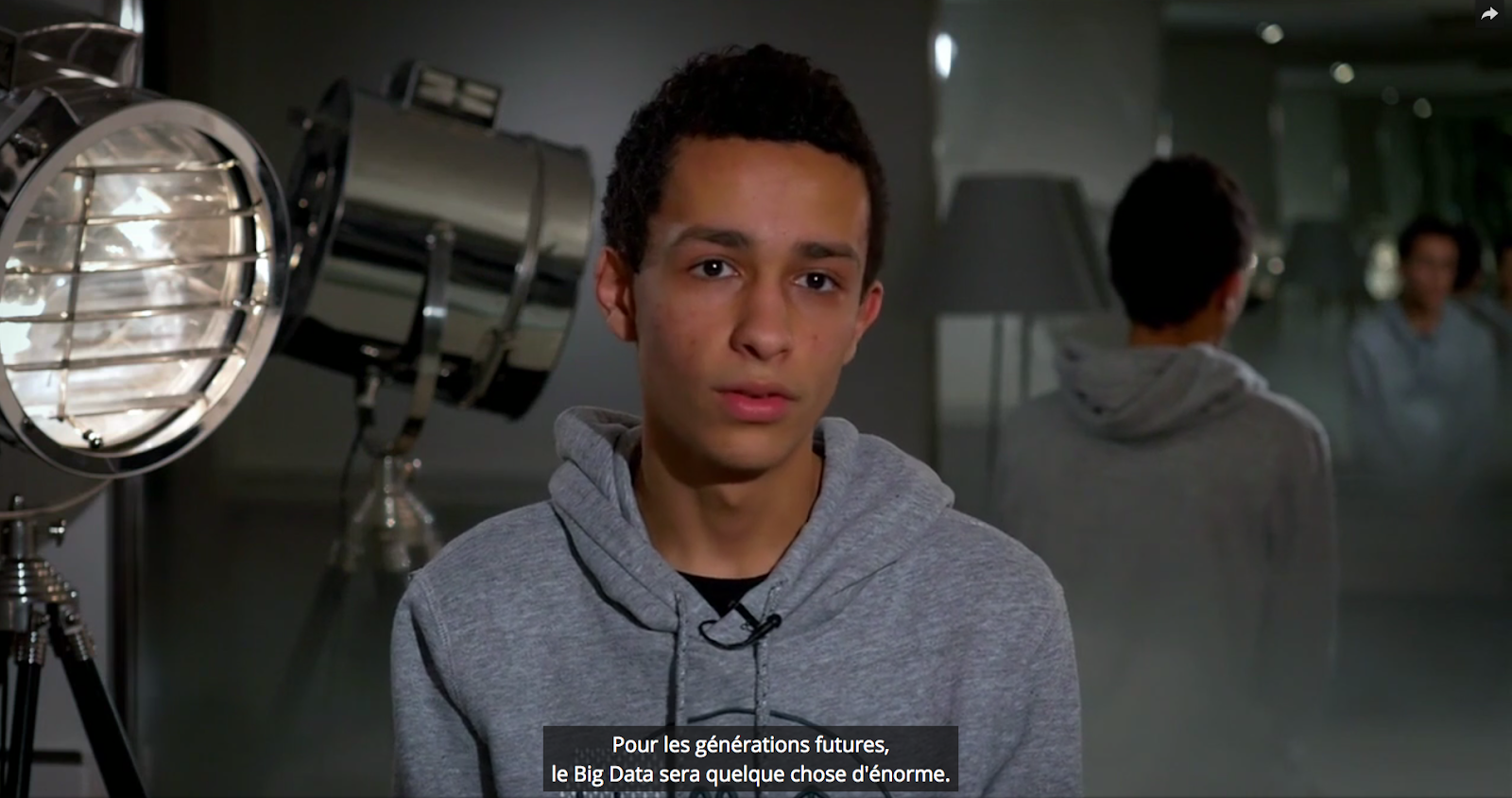
L’âge des participants allait de 17 ans à 82 ans ! © V. Marta
Concernant les participants qui s’étaient déplacés spécialement pour cet atelier, ils ont largement apprécié la méthodologie employée par Res publica. Un grand nombre d’entre eux ont manifesté une grande joie de rencontrer d’autres personnes physiquement pour discuter de sujets de société. En outre, le fait que cela se déroule dans une institution comme la Cité de sciences semblait renforcer leur sentiment d’être « des citoyens importants », au cœur de la cité matérialisée par le lieu : une institution publique prestigieuse. À cet égard, l’inclusion du public au tout début de la création d’une exposition est perçue dans le même temps, comme un honneur et comme une désacralisation du musée, qui, une fois n’est pas coutume, se met à l’écoute de ses visiteurs.
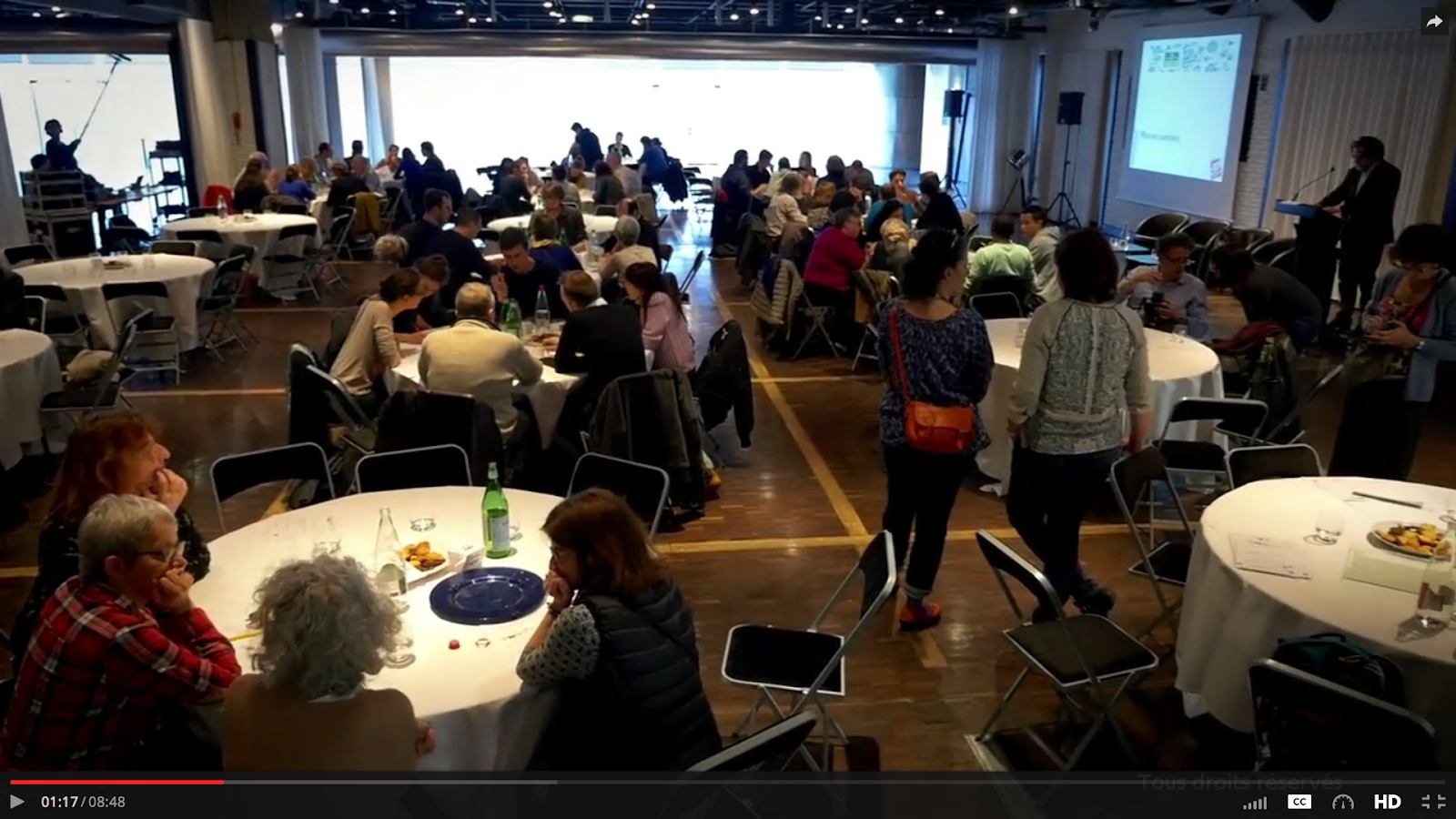
Le plan de salle ; des tables rondes de 8 personnes ne se connaissant pas © V. Marta
En conclusion, la réorientation du propos de l’exposition suite à cette journée n’a pas été radicale, comme l’ajout d’un nouveau thème, par exemple. Néanmoins, la richesse des questions et la variété des réponses qui y ont été apportés ont été un complément intéressant à la phase de recherches académiques menée par l’équipe de conception (documentation, encontre d’experts). Selon moi, il s’agit de s’imprégner d’un autre savoir, moins académique ; celui de la doxa. L’opinion publique, même si elle manque par définition de l’objectivité scientifique mise en valeur à la Cité des sciences, présente l’avantage de mesurer les sensibilités, les représentations, qu’elles soient justes ou irrationnelles, pour mieux y faire écho dans l’exposition. Bref, cette rencontre entre les citoyens et l’institution permet d’ajouter une dimension humaine à la future exposition. Ainsi, à l’issue de cette journée, il a été décidé de placer en fin de parcours de l’exposition, près de la sortie, un audiovisuel de 8 minutes livrant certains extraits de ces discussions citoyennes pour que chaque visiteur puisse y trouver un miroir de ses propres interrogations.
Véronique Marta
#Conceptionparticipative
#TerraData
#CSI
¹ L’après-midi de concertation du public s’est tenu, à la Cité des sciences et de l’industrie, le 26 mars 2016.
² L’inscription s’est faite via internet (site internet Universcience et renvoi sur le site J’enparle de Res publica).
Pour en savoir plus :
Cabinet Res Publica
http://www.respublica-conseil.fr/#/
Exposition Terra data - Nos vies à l’ère du numérique
À visiter à la Cité des sciences et de l’industrie
Du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/terra-data/
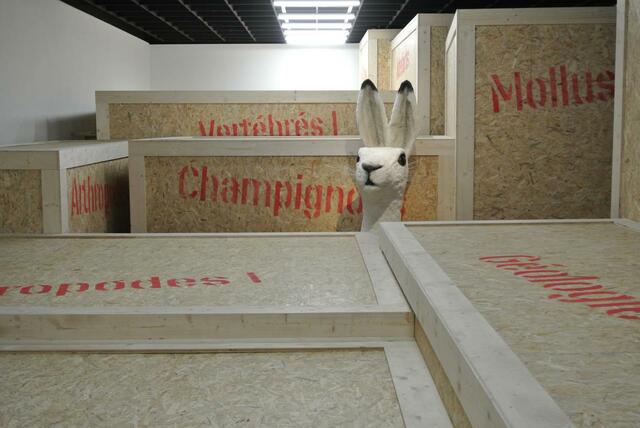
« Emballe-Moi » ou l’histoire d’un déménagement
Les musées de Neuchâtel doivent déplacer leurs collections dans de nouvelles réserves communes dans les prochains mois. Le Musée d’Histoire Naturelle dévoile les coulisses de ce projet dans l’exposition « Emballe-moi ».
Entrée du Musée d’Histoire Naturelle. Photographie : M.L.
Les musées de Neuchâtel doivent déplacer l’ensemble de leurs collections non exposées dans des réserves communes à tous les musées de la ville. Cette dernière souhaite créer un pôle muséal de conservation afin de stocker les objets dans les meilleures conditions possibles. Les réserves sont les lieux de dépôt des objets qui ne sont pas exposés : comme l’explique Brice Matthieu, c’est « un lieu de stockage, de transit et de travail », qui doit donc respecter les normes de conservation tout en étant fonctionnel pour permettre au personnel du musée ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses de travailler dans de bonnes conditions. Il explique également que depuis les années 2000, nombreux sont les musées qui repensent leurs espaces de réserves, en France, au Pays-Bas, en Angleterre et en Suisse. Bien penser les réserves fait partie du domaine de la conservation préventive, que l’ICOM-CC (Comité pour la Conservation) définit de la manière suivante : « L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. » La conservation préventive vise donc à conserver le mieux possible et à stabiliser au maximum les objets qui appartiennent aux collections. Les principaux facteurs pouvant impacter une collection sont les suivants : le climat, les nuisibles, la lumière, les polluants, les vibrations et la poussière.
Les bâtiments anciens dans lesquels sont actuellement installées les collections ne permettent pas de garantir de bonnes conditions de conservation, notamment au niveau de la régulation de l’humidité et de la température mais aussi de la sécurité globale. Par exemple au Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN), beaucoup de spécimens sont conservés en alcool dans les collections. Or en cas d’incendie, cela pourrait être dangereux tant pour les collections que pour les personnes qui les fréquentent. Des bâtiments sont aussi loués pour servir de réserves mais les conditions restent inadéquates. La location est onéreuse, des inondations ont eu lieu entre 2014 et 2019 et les réserves sont près de dépôt de meubles ou de nourriture ce qui favorise les infestations d’insectes, proliférations de moisissures… L’ensemble des réserves est aussi surchargé, ce qui les rend peu praticables.
Les nouvelles réserves sont installées à Serrières, une ville située juste à côté de Neuchâtel. Elles regrouperont les collections du MHNN, du Musée d’Ethnologie de Neuchâtel, du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel et du Jardin botanique. Le complexe d’une surface totale de 5676m2 est réparti sur trois niveaux, dont deux installés en sous-sol, ce qui facilite le respect des normes de conservation. Plus d’un million de pièces vont être déplacées lors du déménagement.
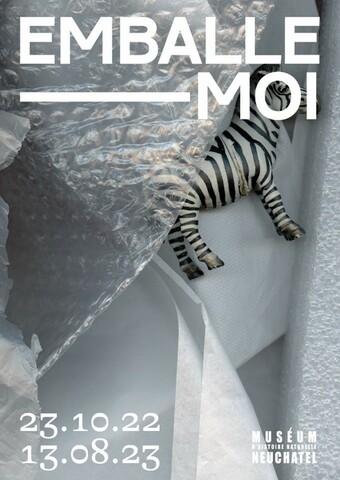
Affiche de l’exposition Emballe-moi © Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel
Dans ce contexte spécifique du chantier des collections, le MHNN a voulu mettre en valeur et montrer au grand public en quoi consistait les principes du conditionnement avec l’exposition « Emballe-Moi ». Toujours avec humour, l’équipe du MHNN lève le voile sur les coulisses du fonctionnement d’un musée. Les différents corps de métier sont expliqués, tout comme les étapes de conditionnement d’un objet.
Présenter les collections
L’exposition présente dans un premier temps un état des lieux des collections : mollusques, pierres, insectes, mammifères, etc, et indique quel pourcentage de la collection est présentée dans la pièce (par exemple, dans l’espace consacré à la géologie « Cœur de pierre », le texte de salle nous informe que seulement 0,008 % de la collection est exposée, ce qui permet de réaliser l’ampleur de ce qui est conservé en réserve). Pour chaque pièce, une ambiance sonore en lien avec les éléments est diffusée : toujours dans la salle géologique, on écoute des sons rocheux et métalliques alors que la salle consacrée aux coraux nous donne l’impression d’être plongé.es dans une ambiance sous marine mystérieuse. Dans chaque salle, sont expliquées les différentes méthodes de conservation et leur évolution au cours du temps : pour la conservation des insectes par exemple, ils pouvaient être piqués sur des épingles, en « papillote » c’est à dire dans des enveloppes de papier pour protéger les ailes des papillons par exemple, dans l’alcool ce qui permet de stabiliser les spécimens en les gardant hydratés et en préservant leur forme ou bien montés sur des « paillettes », des petits morceaux de cartons, pour les spécimens trop petits ou trop fragiles. Les plantes étaient plutôt séchées dans des herbiers ou lyophilisées : retirer toute l’eau supprime le risque de moisissure tout en gardant la forme intacte.
Vitrine qui présente le conditionnement en papillote. Photographie : M.L.
Toutes les méthodes sont expliquées par des cartels à la fois précis et très clairs. Une pièce du parcours présente aussi l’importance des archives qui constituent une part non négligeable des collections : 25 mètres linéaires d’archives, 9600 diapositives et 5,5 téraoctets de données. Intitulée « Souvenirs, souvenirs », cette pièce permet d’insister sur l’importance de conserver les objets mais aussi toutes informations qui s’y rattachent : provenance, condition de la donation, fonction originale. Un objet « sans histoire » et sur lequel on ne sait rien perd en valeur scientifique. Ainsi, malgré les difficultés à lire la graphie ancienne d’un.e scientifique, archéologue ou d’un.e passionné.e d’art et d’histoire, ces indications écrites parfois à la hâte au revers des prospectus de l’époque sont à conserver précieusement. Après avoir présenté les collections, l’exposition explique l’utilité et la nécessité de conserver autant d’objets, en expliquant les différentes valeurs qui leur sont attribuées : scientifique, artistique, historique, de rareté, financière, associative (un objet qu’on associe à une personne célèbre par exemple), pédagogique et commémorative.

Elément de scénographie expliquant la valeur financière des objets. Photographie : M.L.
Emballement : Mode d’emploi
Dans un deuxième temps, le parcours présente le projet de déménagement et explique les différentes actions qu’il faut mettre en œuvre pour le réaliser, avec la thématique principale : comment « emballe » - t-on des objets ? Dans une grande pièce qui ressemble à un atelier de travail des réserves, l’exposition présente la réalisation de châssis, de grands cadres en bois qui permettent de transporter les spécimens imposants ainsi que la fabrication de boîtes en carton de conservation, dans lesquelles va être emballée la majorité de la collection. Les matériaux utilisés pour les conditionnements sont aussi présentés, en insistant sur leur stabilité car si ces matériaux se dégradent, ils pourraient abîmer l’élément qu’ils conservent. Les étapes précédant l’emballage sont aussi expliquées, comme le dépoussiérage des spécimens conservés depuis des dizaines d’années dans les réserves, d’autant plus important qu’il permet de surveiller l’état, de vérifier qu’il n’y a pas d’infestation de ravageurs et d’éliminer la poussière qui contient des substances toxiques utilisées auparavant pour repousser les insectes notamment. Tout du long de la pièce, des vidéos jouent avec les codes de la culture télévisuelle et d’internet très contemporain : un « tuto » pour réaliser un châssis, une émission « Nouveau look, nouvelle vie de bocal » qui présente le relooking d’un spécimen conservé dans un bocal d’alcool ou bien un « unboxing » d’une boîte de conservation.

Le spectacle du zèbre. Photographie : M.L.
L’humour est un des atouts majeurs de l’exposition car il permet de faire passer beaucoup d’informations de manière claire et ludique. Les nombreux jeux de mots dès le titre de l’exposition mais aussi dans les titres des salles (« Sortir de sa coquille » pour l’espace consacré aux mollusques, « Je t’ai dans la peau » dans la salle des vertébrés mammifères ou encore dans la dernière pièce de l’exposition) permettent de désacraliser l’espace du musée afin de le rendre plus accessible. La dernière pièce, qui reprend les codes scénographiques d’un théâtre avec sa scène, son parterre de sièges pour les spectateurs et spectatrices et ses coulisses présentent les différents métiers et rôles dans le musée : la restauratrice, à ne pas confondre avec la « restauratrice » qui prépare les plats pour le restaurant du musée, le taxidermiste conduit en taxi par une chouette ou encore les conservateurs, à ne pas confondre avec les mauvais conservateurs qu’on met dans trop d’aliments industriels (vidéo disponible en ligne) !
Les « coulisses » du musée. Photographie : M.L.
Exemple d’une vitrine dans la salle consacrée à la géologie. Photographie : M.L.
Emballe-moi est une exposition vraiment réussie parce qu’elle présente un projet de déménagement complexe de manière très pédagogique : elle « dépoussière » l’image guindée et parfois ennuyeuse que peuvent avoir certains musées grâce à l’humour, l’autodérision mais aussi la poésie qui se dégage de l’atmosphère générale de l’exposition dont la scénographie, qui alterne entre ambition épurée et référence décalée, aide vraiment à porter le propos. Elle intègre un public très large grâce à ses textes clairs et ses références à la pop culture, que ce soit des émissions de télévisions, des publicités ou des formats courants sur les chaînes Youtube. Les visiteurs et visiteuses sont invité.es à prendre part à ce déménagement, en assistant en direct chaque mercredi au travail des conservatrices-restauratrices ou en participant à un atelier d’emballage, qui reprend le déroulement classique du conditionnement (constat d’état, dépoussiérer, concevoir la boîte de transport…). C’est une exposition accessible tant pour le public novice qui découvre avec plaisir les « coulisses », les espaces cachés auxquels il est difficile d’avoir accès habituellement, sinon pour les personnes plus spécialistes et les professionnel.les qui peuvent néanmoins redécouvrir sous un nouveau jour ce qui leur est familier.
Exemple de scénographie dans la salle présentant le conditionnement. Photographie : M.L.
Marine Laboureau
Pour en savoir plus :
- DAYNES-DIALLO Sophie, VASSAL Hélène (dir.), Manuel de régie des œuvres : gérer, conserver et exposer les collections, Paris, La documentation française, 2022.
- Conseil communal, Rapport concernant une demande de crédit pour la création d’un pôle muséal de conservation à Tivoli Nord (Neuchâtel) :
- https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/votre_commune/cg_rapports_objets /2023_Rapport_concernant_une_demande_de_credit_pour_la_creation_d_un_Pole_museal_de_cons ervation_a_Tivoli_Nord.pdf
- Présentation de l’exposition sur le site internet du MHNN : https://www.museum neuchatel.ch/expositions/exposition-temporaire-emballe-moi/
#conservation #chantier des collections #réserves #Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

« La santé d’abord », une exposition à effets secondaires à la Stapferhaus
Le 10 novembre 2024, la Stapferhaus ouvrait sa nouvelle exposition « Hauptsache gesund » autrement dit « La Santé d’abord ». Au cœur de la ville de Lenzbourg en Suisse allemande, ce musée est un lieu de dialogue et de réflexion sur les grandes questions de notre époque par une approche muséographique singulière. Comment traiter, dans un espace muséal, un sujet aussi vaste et complexe : sociétal, politique et intime que celui de la santé ?
Le musée comme grande scène ludique de réflexion
Fondée en 1960 par Pro Argovia, Pro Helvetia, le canton d’Argovie et la ville de Lenzbourg, la Stapferhaus était à l’origine un collectif organisant des réunions et des débats dans le château de la ville suisse. Ce n’est que 30 ans après sa création que la Stapferhaus organise sa première exposition : « Anne Frank et nous ». Dirigée par Hans Ulrich Glarner, elle questionnait le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale.
Depuis 2018, le musée dispose de ses propres locaux. Ce bâtiment face à la gare de Lenzbourg, est conçu pour être modulable et évolutif. D’extérieur c’est une grande boîte noire, mais ses murs, ses sols et ses escaliers sont mobiles, permettant d’adapter l’édifice au contenu, aux modèles de médiation et au public. Au travers de grandes expositions temporaires, la Stapferhaus interroge de grands sujets intemporels ou de notre époque, tels que le temps, l'argent ou la vérité. Ce lieu se veut un espace de rencontre et d'échange, où chacun, quel que soit son âge ou son expertise, peut explorer et dialoguer autour des enjeux contemporains. L’institution a d’ailleurs une approche participative, puisque pour chaque projet d’exposition elle prend le pouls de la population suisse, en interrogeant les institutions scolaires ou culturelles à proximité.
Le fonctionnement intrinsèque de ce musée de société est particulier. Environ tous les deux ans, le bâtiment est entièrement adapté à une nouvelle exposition. Toute la Stapferhaus se met aux couleurs de la thématique : le site internet, la carte de la cafétéria, la boutique, etc. C’est ainsi que depuis quelques mois, une nouvelle exposition habite les murs de la Stapferhaus : « La santé d’abord. Une exposition à effets secondaires ». Programmée jusqu’au 26 octobre 2025, cette nouvelle proposition interroge notre rapport contemporain à la santé, devenue l’une des grandes promesses de notre époque. Au fil d’un parcours poétique, social et scientifique, les visiteurs sont invités à réfléchir aux multiples facettes de la santé : de la quête du bien-être à la gestion de la maladie, en passant par les responsabilités individuelles et collectives, ainsi que les implications économiques du système de soins. Le circuit se structure autour de six étapes, mimant la logique d’un parcours de soin : la salle d’attente, l’examen, le diagnostic, le traitement, l’urgence et la sortie.
Entrer par la poésie et l’intime
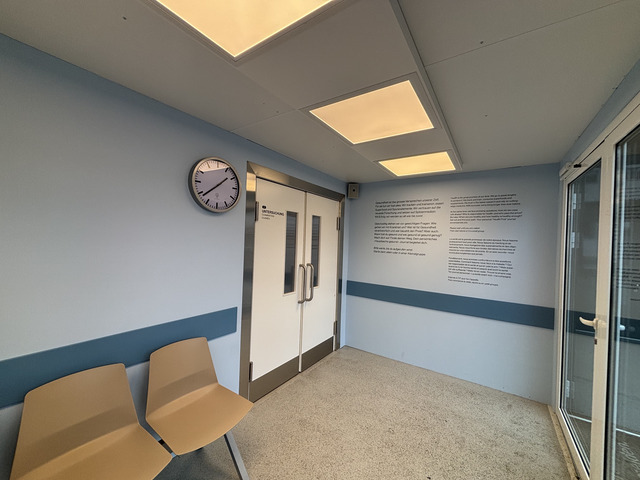
La salle d’attente, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
L’exposition conçue par Sibylle Lichtensteiger et Sonja EnzMuni s’amorce déjà dès l’extérieur du bâtiment : le visiteur pénètre dans une salle d’attente reconstituée. Loin de passer inaperçue, cette structure vitrée, en excroissance de l’imposant bâtiment sombre, capte le regard des passants et intrigue autant qu’elle invite à entrer. Muni de son petit « journal personnel » pour l’accompagner le long de sa visite, il prend place dans ce décor familier où une horloge bat lentement, toutes les deux secondes, instillant cette temporalité ralentie, presque oppressante, qui précède les rendez-vous médicaux. Lorsqu’une annonce vocale l’invite à rentrer, le visiteur quitte le sas et entame son parcours de visite par l’examen. Écouter ses battements cardiaques, tester son odorat et son souffle ou faire un rapide bilan émotionnel… Le long de ce couloir voilé, le visiteur prend un temps pour soi. Une incursion poétique et physique avant de pénétrer dans la salle de diagnostic.
Le diagnostic, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot
Libre de déambuler dans la vaste salle aux lumières tamisées, le visiteur est invité à écouter une série de témoignages, assis face à différents malades. À hauteur de regard, il constate, au fil des récits, la diversité des parcours médicaux, du vécu de l’annonce du diagnostic à la gestion du quotidien. Les voix sont multiples, tous âges, genres et origines confondus, et livrent des expériences poignantes, engagées et parfois surprenantes. Cette même salle permet un bref historique des progrès de la médecine, en mettant en lien des objets historiques de soins et des capsules vidéo animées retraçant la découverte de maladies communes telles que la dépression, la maladie d’Alzheimer ou l’endométriose. Suite à cette incursion dans les réalités personnelles, empiriques et diversifiées de la maladie, le visiteur se dirige vers la salle de traitement.
Se perdre dans dans le supermarché de la santé et explorer les possibles
Comment soigne-t-on aujourd’hui ? Dans la plus vaste salle de l’exposition, cette question sert de fil rouge à un parcours interactif où les traitements, les pratiques de soin, et les méthodes pour se maintenir en bonne santé sont abordés dans toute leur diversité. L’espace, structuré comme les rayons d’un supermarché, permet au visiteur de circuler d’un univers à l’autre selon une logique à la fois limpide et floue. Chaque section est mise en scène avec un décor évocateur, facilitant la compréhension du propos.
Les traitements, le supermarché de la santé, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
La visite débute dans l’arrière-boutique d’une pharmacie, où chaque tiroir se centre sur un médicament emblématique : son usage, ses effets et les débats scientifiques passés ou actuels. Plus loin, un bloc opératoire projette des vidéos non-censurées d’interventions chirurgicales courantes (extraction de dents de sagesse, trépanation, mastectomie, etc.). Une manipe adjacente invite le visiteur à se glisser dans la peau d’un chirurgien, réalisant un geste de précision sous la pression du chronomètre. Le défi révèle toute la difficulté et la rigueur de ce métier aussi familier qu’étranger. L'exploration se poursuit dans des dispositifs qui mettent le corps à contribution, comme cette barre de traction à laquelle il faut se suspendre pour voir s’afficher le texte vantant les bienfaits de l’activité physique. Dans d’autres « rayons » de ce supermarché, des objets de soin (respirateur, dialyseur, couveuse, etc.) sont mis en regard avec des récits de patients. Ces témoignages humains dépassent le statut de ces simples machines en leur attribuant des vécus réels. Ainsi, à côté d’un cartel évoquant le coma vécu par un patient anonyme, des écouteurs diffusent les musiques qui tournaient durant son séjour à l’hôpital.
Les traitements, santé mentale et art thérapie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
Cette grande salle accorde également une place centrale à celles et ceux qui prennent soin : aides-soignants, pompiers, ou même un robot conversationnel en maison de retraite, soulignant que le monde médical repose avant tout sur les relations humaines. Il ne s’agit pas ici de proposer un panorama des métiers de la santé, mais de mettre en lumière les liens humains inhérents aux pratiques de soin. En parallèle des thérapies médicales usuelles, l’exposition met en scène des pratiques alternatives que l’on mobilise dans cette « course à la bonne santé ». Une reconstitution d’un véritable supermarché passe en revue les régimes alimentaires en vogue : sans gluten, végan, riche en protéines… et décortique leurs origines, leurs buts et fondements scientifiques (quand il y en a !).
D'autres installations mettent en lumière l'importance des liens sociaux, et du « prendre soin » : un bureau pour écrire un courrier à un proche, une peluche géante qui délivre un message bienveillant lorsqu’on la serre dans ses bras, ou encore un « sas de décompression » où l’on ne pénètre qu’une fois débarrassé de son téléphone. Comme une bulle méditative, le visiteur est invité à prendre le temps et à déconnecter. Dans cette même quête du bien-être physique et intérieur, un espace massage (avec sièges massants et des outils d’auto-massage en bois) offre une pause relaxante pour reprendre son souffle dans ce long parcours d’exposition. Le fond de la salle est consacré intégralement à la psyché. Les murs ornés d’œuvres d’art-thérapie créent une échappée artistique autour de la santé mentale. Dans cet espace, un jeu de cartes conversationnel incite les visiteurs à dialoguer avec leur prochain, ami ou inconnu, à briser la glace et à se confier. Ce dernier espace rappelle, là encore, que la santé est une affaire de corps, d’esprit et de lien avec les autres.
Au cœur du « supermarché de la santé », une estrade attire l’attention : celle des urgences. Dans cette salle d’hôpital aux tons bleutés, le visiteur adopte la posture d’un interne, debout face à un brancard, observateur privilégié du malade examiné : le système hospitalier suisse. C’est ici seulement que l’exposition traite du système de santé du pays, et pas n’importe comment : par le prisme de sa crise. Autour du lit, une nuée d’écrans diffuse des interviews d’hospitaliers, de chercheurs et de responsables institutionnels qui livrent un état des lieux. Qui est responsable ? Qui paie, et à quel prix ? Comment s’organise concrètement l’hôpital aujourd’hui ? Ce dispositif ouvre une incursion politique, au cœur d’un sujet jusqu’ici traité essentiellement par l’humain et le médical. Il rappelle que la santé d’un pays est le reflet de ses politiques de santé publique.
Sortir par la poésie et la douceur
Pour clore le parcours, le visiteur emprunte un large couloir, un écho au premier traversé en entrant dans l’exposition. Ici, les murs sont tapissés d’oreillers et de banquettes molletonnées, dans une palette de couleurs douces et chaleureuses. Quelques phrases brodées sur la literie délivrent des messages bienveillants, invitant au lâcher-prise et à la douceur.
La sortie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
Par endroits, des témoignages audio de soignants viennent ponctuer ce dernier espace. Ils partagent des expériences professionnelles sur la vie et la mort, ces deux passages inévitables, qui sont ici abordés sans tabou, avec humanité. L’un d’eux, par exemple, donne la parole à une infirmière en soins palliatifs racontant comment elle a accompagné un patient dans ses derniers instants, comment la vie a quitté la pièce progressivement. A côté, le témoignage d’une maïeuticienne décrit les premiers cris d’un nouveau-né en salle de naissance. Puis, au bout du couloir, sur le dernier mur, un message essentiel vient refermer l’expérience : « Prends soin de toi. »
Loraine ODOT
#santé, #interactif, #sujetdesociété
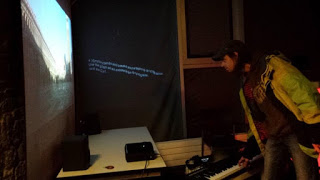
A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate
Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?
L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.
Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.
Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.
Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »
Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent
Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.
Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.
J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !
Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.
Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !


Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent
C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.
Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».
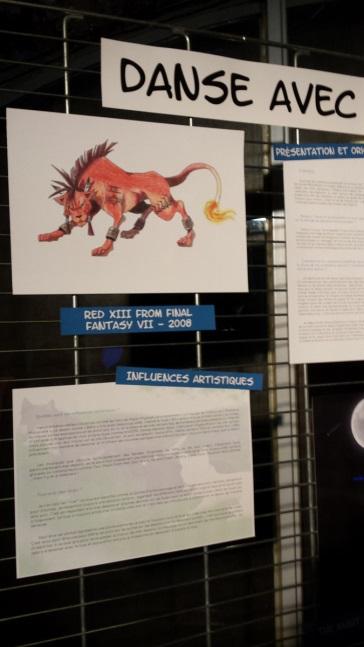
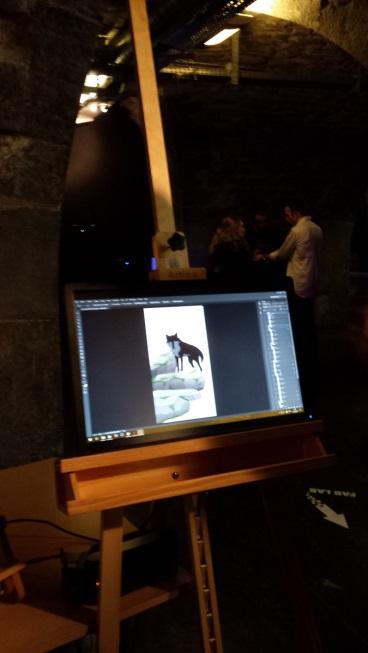
Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent
Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !
Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.
Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]

Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent
Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…
En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.
Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.
Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent
Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.
Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.
Hélène Prigent
Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/
La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.
#promenadesonore
#labo
#experimental
*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :
1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…
2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique
3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate
Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.

Associer ses publics à la programmation culturelle ?
Retour d’expérience sur la démarche participative menée pendant la fermeture du Musée Zoologique de Strasbourg.
Comment maintenir un lien avec son public quand les portes d’un musée sont fermées ? Comment associer son public à la vie d’un musée et comment le faire sans sur-promettre ? En 2019, le Musée Zoologique de Strasbourg fermait ses portes pour une rénovation d’envergure. Plutôt que de laisser cette parenthèse couper le lien avec ses visiteurs, le musée a choisi de lancer une démarche participative centrée sur la programmation culturelle du futur musée. Une démarche ambitieuse sur trois ans qui offre aujourd’hui un retour d’expérience précieux pour toutes les structures culturelles.
La fermeture du musée : un cadre clair pour une ambition assumée
La rénovation du musée, fermé depuis 2019, est un chantier co-porté par la Ville et l’Université de Strasbourg qui visait à moderniser les espaces, repenser le parcours de visite et inscrire l’institution dans une approche sensible aux enjeux contemporains de la biodiversité. Mais ces travaux ont soulevé une interrogation primordiale : que faire pendant cette longue période sans public ? Des actions hors les murs étaient prévues mais elles concernaient essentiellement les publics scolaires. C’est à l’initiative de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec la direction de la Participation citoyenne, qu’a émergé une proposition plus large : concevoir une véritable démarche participative. Le projet architectural et muséographique ainsi que les expositions prévues pour la réouverture étant achevés, il s’agit de ne pas simuler un pouvoir décisionnel illusoire, mais d’engager une consultation sincère qui soit prise en compte. Le choix est donc fait : la démarche participative porte sur la future programmation culturelle. C'est en effet, un des seuls champs encore modulables à ce stade du projet, et celui où les apports des habitants peuvent être concrètement intégrés pour une mise en œuvre réaliste de la participation. L'idée est de créer un temps ritualisé pour penser, avec les habitants, les types d’activités, formats de médiation, manières d’habiter le musée qui composeront la programmation culturelle du futur musée.
La démarche est portée par Maïlys Liautard (Chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg, référente intermusées et hors les murs) et Joanne Hughes (chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg et référente pour le Musée Zoologique). Le cap, dès le départ, est de faire du musée un équipement culturel de proximité, en s’adressant à des habitants représentatifs de la diversité sociale et culturelle du territoire. Pour cela, elles ont été accompagnées par les structures Artizest, spécialiste de la participation citoyenne et de la méthodologie collaborative, et Mêtis une association proposant notamment des services de conseil et de recherche en muséologie pour une démarche articulant co-élaboration, évaluation et inclusion.
Une démarche structurée en trois temps
L’intelligence de cette démarche repose sur sa construction itérative, avec des évaluations intégrées à chaque étape, permettant d’enrichir progressivement le processus sans jamais le figer. « Il n’y avait rien de prédéfini. Ce sont les réponses au questionnaire, les échanges, les tests, qui ont permis de faire évoluer la démarche à chaque étape » explique Joanne Hughes. Chaque phase est accompagnée d’une auto-évaluation qualitative et d’outils de retour d’expérience, notamment des questionnaires de satisfaction, des entretiens post-ateliers et des grilles d’observation permettant d’évaluer le vécu des participants, l’atteinte des objectifs et l’efficience des dispositifs testés. Cette rigueur méthodologique s’est révélée indispensable pour garantir l’agilité et l'efficacité du dispositif.
Trois grandes phases ont rythmé l’expérimentation entre 2022 et 2025 :
- Phase 1 : sonder les représentations et les envies
À l’automne 2022, un questionnaire grand public (papier et en ligne) a recueilli 666 réponses, apportant une première cartographie des pratiques culturelles, attentes, freins et suggestions. Cette phase a permis d’identifier des profils récurrents, mais aussi des angles morts tels que des publics peu habitués des musées mais curieux, par exemple.
- Phase 2 : croiser les regards, ajuster les hypothèses
Au printemps et à l’automne 2023, l’équipe engage une phase qualitative. Cinq petit groupes de discussion sont constitués à partir des profils identifiés lors de la phase précédente : familles du quartier (9 parents et 8 enfants), 12 étudiants, 7 spécialistes, 7 usagers du CSC La Parenthèse et 6 personnes en situation de handicap mental. En parallèle, des stands mobiles sont tenus lors d’événements locaux (environ 480 personnes rencontrées, dont 150 enfants). Les méthodes employées sont adaptées aux publics : outils FALC, supports visuels, jeux de positionnement, etc. Cette phase permet d’affiner les besoins, de recueillir des ressentis, mais surtout de confronter les
propositions à leurs usages concrets.
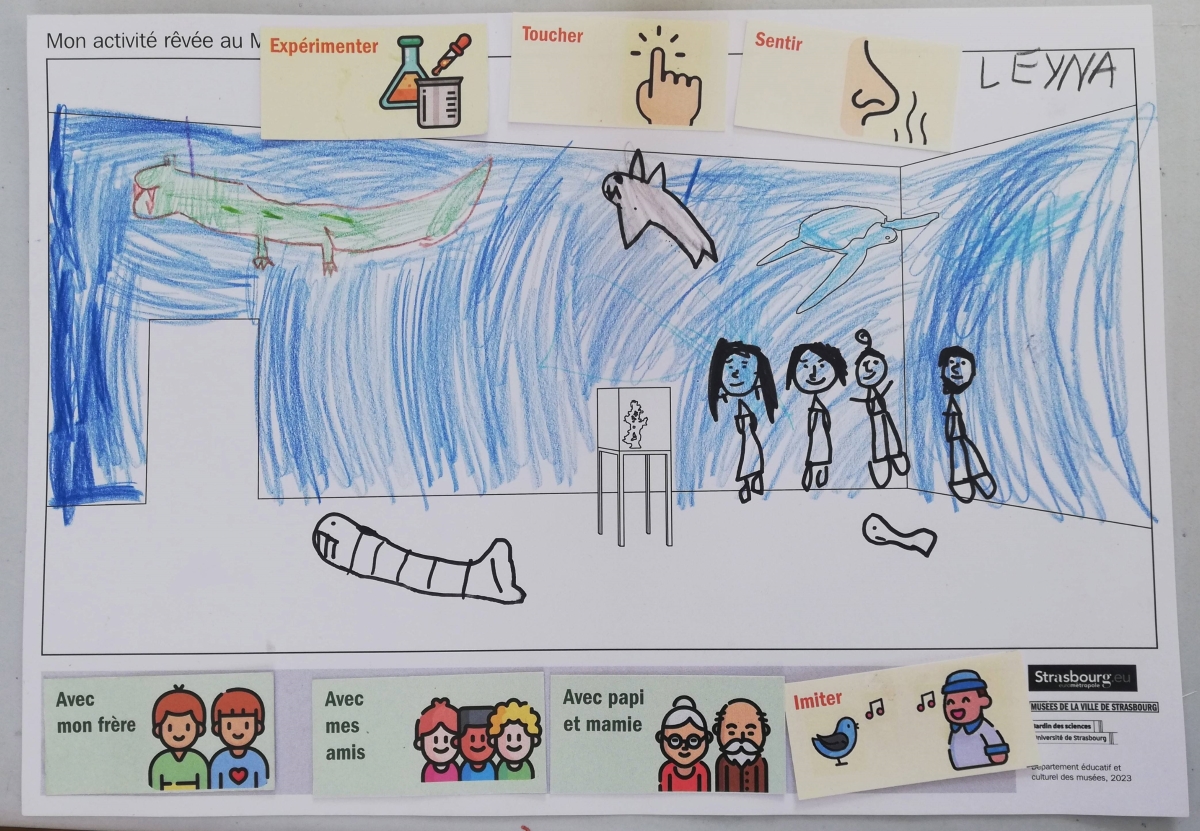
Dessin issu de l’atelier « Mon activité rêvée » © Musée Zoologique de Strasbourg
- Phase 3 : concevoir collectivement des formats à expérimenter
À partir des enseignements précédents, quatre ateliers de co-création sont proposés en 2024. Le choix est fait de revenir vers des groupes de la phase 2 qui sont les publics moins habitués et moins entendus dans la consultation au musée et déjà identifiés comme prioritaires : famille CSC et étudiant. Ces rencontres réunissent 63 participants ou deux formats d’activités sont alors co-imaginés : le mur participatif (porté par les étudiants, conçu comme un dispositif express de vote et de réaction visuelle à chaud), et le crash-test citoyen (pensé avec les familles). Parmi les suggestions explorées, celle d’un café des voisins émerge comme un possible format à activer plus tard.
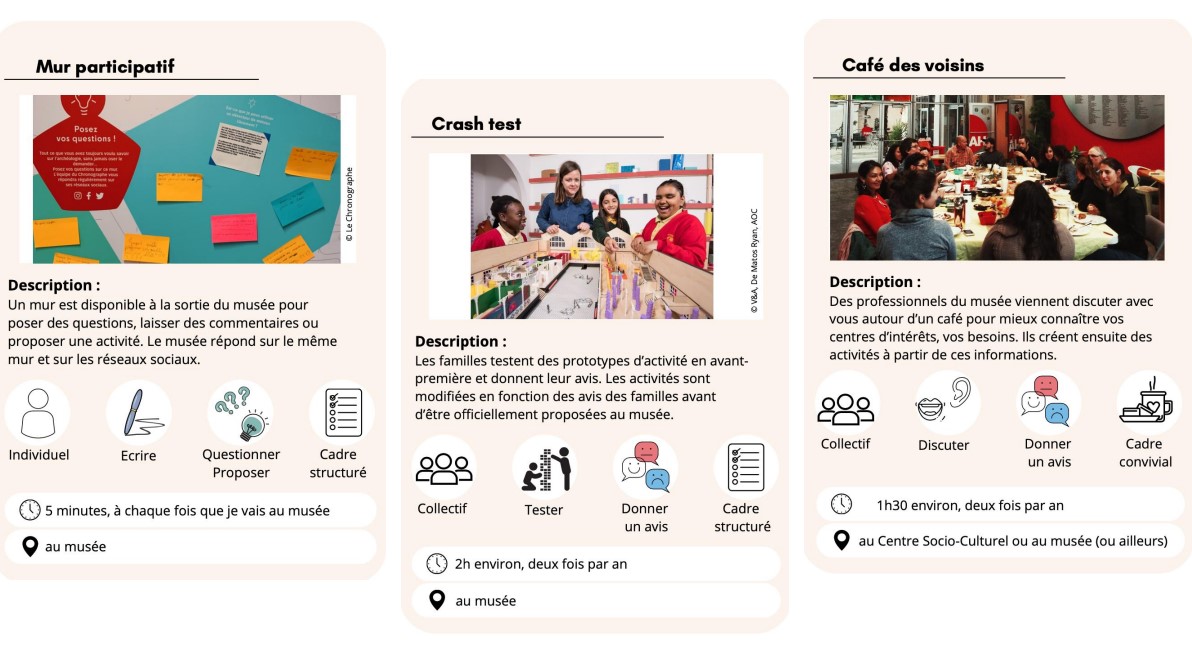
Visuels des cartes © Alexia Jacques-Casanova _ Artizest
Les deux dispositifs sont testés en conditions réelles à la rentrée 2024. Des questionnaires de retour sont exploités, les formats ajustés. Certains sont conservés, d’autres réévalués. Cette phase parachève une démarche d’écoute continue et d’ajustement permanent.
Les valeurs de fond : clarté, sincérité, adaptabilité
Trois grands principes structurent cette démarche :
D'abord un cadrage clair. Le périmètre est toujours explicitement défini : il ne s’agit pas de voter les scénographies ni de commenter les collections, mais de participer à l’élaboration des activités culturelles futures. Ce cadrage strict permet d'éviter la frustration, permet un engagement sincère, et favorise la lisibilité de la démarche.
Mais aussi un cadre relationnel éthique et cohérent. Les participants sont mobilisés en tant que personnes concernées, pas comme représentants de catégories. On les invite à parler en leur nom, pas pour d’autres. Les équipes ont aussi pris soin de questionner les propositions plutôt que de les valider systématiquement afin de décoder les besoins implicites. Joanne Hughes nous donne par exemple le cas suivant : « On a eu un enfant qui a laissé un post-it sur le mur d’expression indiquant son rêve de pouvoir « ressusciter les animaux » présentés au musée, vœu derrière lequel on peut interpréter une sensibilité pour la question des espèces disparues et/ou pour la question du
positionnement éthique du musée et de la provenance des collections, auxquelles on pourra chercher à apporter des réponses (alors qu’on n’a bien sûr pas la possibilité de réaliser littéralement ce rêve) ; de la même manière, lorsqu’un autre enfant écrit vouloir « caresser les animaux dans la vitrine », à défaut de pouvoir faire toucher les collections patrimoniales fragiles, on peut imaginer proposer des activités multisensorielles en ayant recours à du matériel pédagogique, des échantillons de peaux, etc. »
Enfin une adaptabilité constante. La force du processus réside dans sa capacité à s’ajuster. Aucun format n’est figé. Le processus accepte les détours, les réajustements. Il repose sur une posture de test, d’écoute, et de réaction.
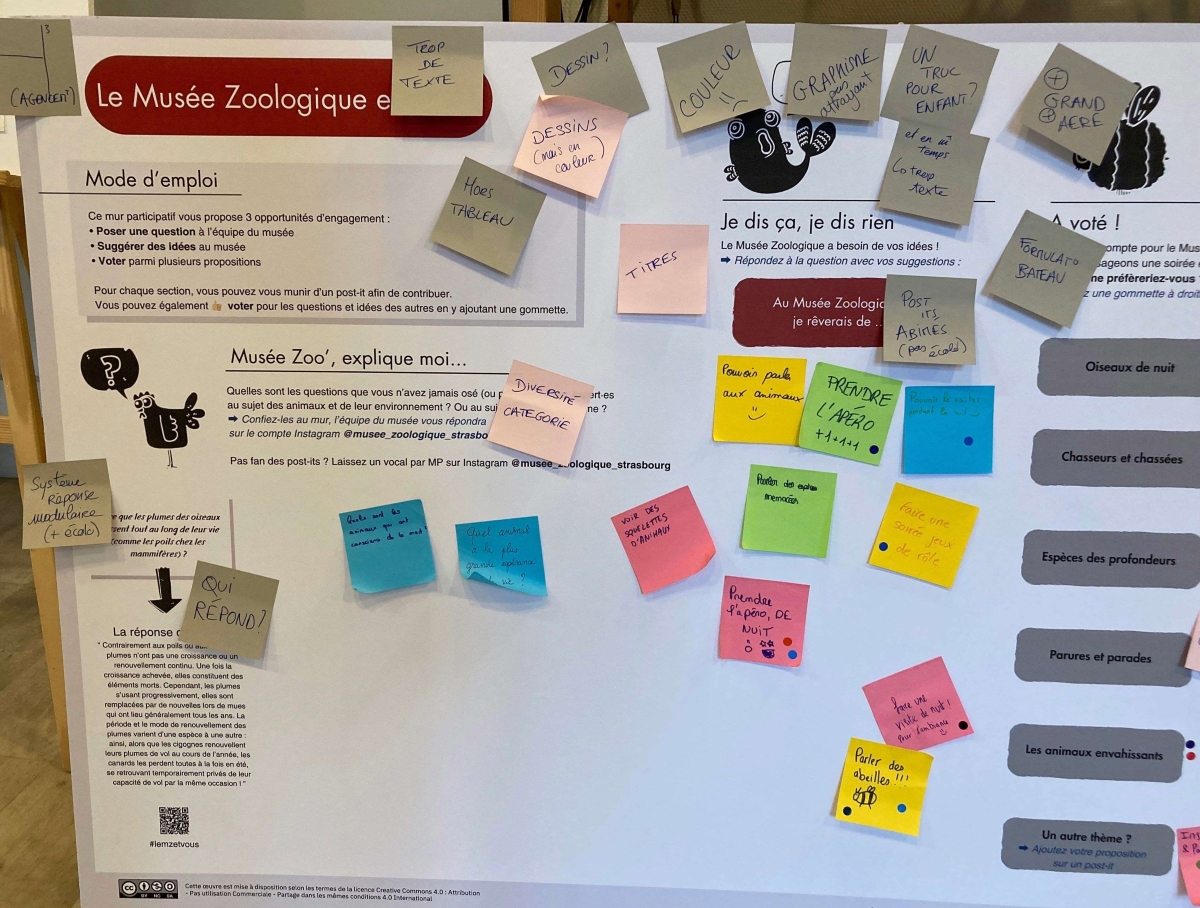
Atelier étudiants, Octobre 2024 © Maïlys Liautard.
Et maintenant ? Ce que la démarche transforme
Aujourd’hui, cette démarche constitue un socle. Pas un modèle à reproduire tel quel, mais un cadre de travail, une manière de poser des questions, de penser la programmation autrement. Pour Joanne Hughes, elle est devenue une "boussole professionnelle". « On ne peut pas faire du participatif en continu. Mais on peut garder en tête une logique d’écoute, d’interrogation, dans chaque choix qu’on fait. ».
Grâce à ces ateliers et aux multiples rencontres un lien de confiance est créé qui permet à un « répertoire » de participants de naître. Ce lien déjà tissé reste activable en fonction des besoins car il y a la volonté de recontacter ponctuellement les personnes ayant participés à la démarche pour des test d’atelier ou de visite par exemple. Ce vivier souple, construit dans le temps, est aussi pensé pour être renouvelé ce qui permet une continuité sans épuisement.
Et ailleurs ? Pour une approche réaliste et transposable
Trois ans, c’est long. Mais les principes expérimentés ici sont adaptables à des temporalités plus courtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation ne s’improvise pas : elle se construit, elle s’ancre dans le temps, et elle se pense avec méthode. La démarche du Musée Zoologique démontre qu’il ne s’agit pas d’une question de moyens, mais d’une posture : une volonté institutionnelle claire, une rigueur méthodologique, et une capacité à ajuster le cap selon les réalités du terrain.
Elle montre qu’une démarche participative est possible, réaliste et féconde, à condition de :
- Poser un cadre clair sur ce qui est ouvert à discussion,
- Incarner la démarche : qu’elle ait un visage, un lien humain,
- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,
- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,
- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,
- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,
- Intégrer l’évaluation continue de la démarche dans la logique même du projet.
La participation n’est pas une méthode toute faite. C’est un investissement sur plusieurs plans : humain, méthodologique, professionnel. C’est investir dans une équipe, du temps, des financements, mais comme tout ce que l’on cultive : ce que l’on sème aujourd’hui se récolte demain. Déjà, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de rester en lien avec le musée après sa réouverture, et certains formats testés comme le crash test et le mur participatif sont d’ores et déjà intégrés dans la programmation à venir c'est une preuve concrète d’une continuité entre consultation et mise en œuvre.
Le mérite de la démarche est de ne pas avoir cédé à la tentation du « participatif performatif » qui n'est pas pris en compte et finit par décevoir. Le Musée Zoologique a proposé une méthodologie solide, située, humaine, et pensée pour durer. Un cap, des limites, une rigueur et une sincérité dans la démarche qui en fait, pour d’autres structures culturelles, un exemple à suivre et à adapter !
Lorraine KLEIN
Toutes les citations proviennent de propos recueillis dans le cadre d'entretiens réalisés le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025 au Musée Zoologique. Remerciements à l’équipe du Musée Zoologique de Strasbourg et du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg. Plus particulièrement à Samuel Cordier, Joanne Hughes ainsi qu'à Maïlys Liautard.
Pour en savoir plus : https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/406076015
#DémarcheParticipative #ProgrammationCulturelle #Public

Au temps des faluns, visite d’exposition à 15 millions d’années
Une remontée dans le temps
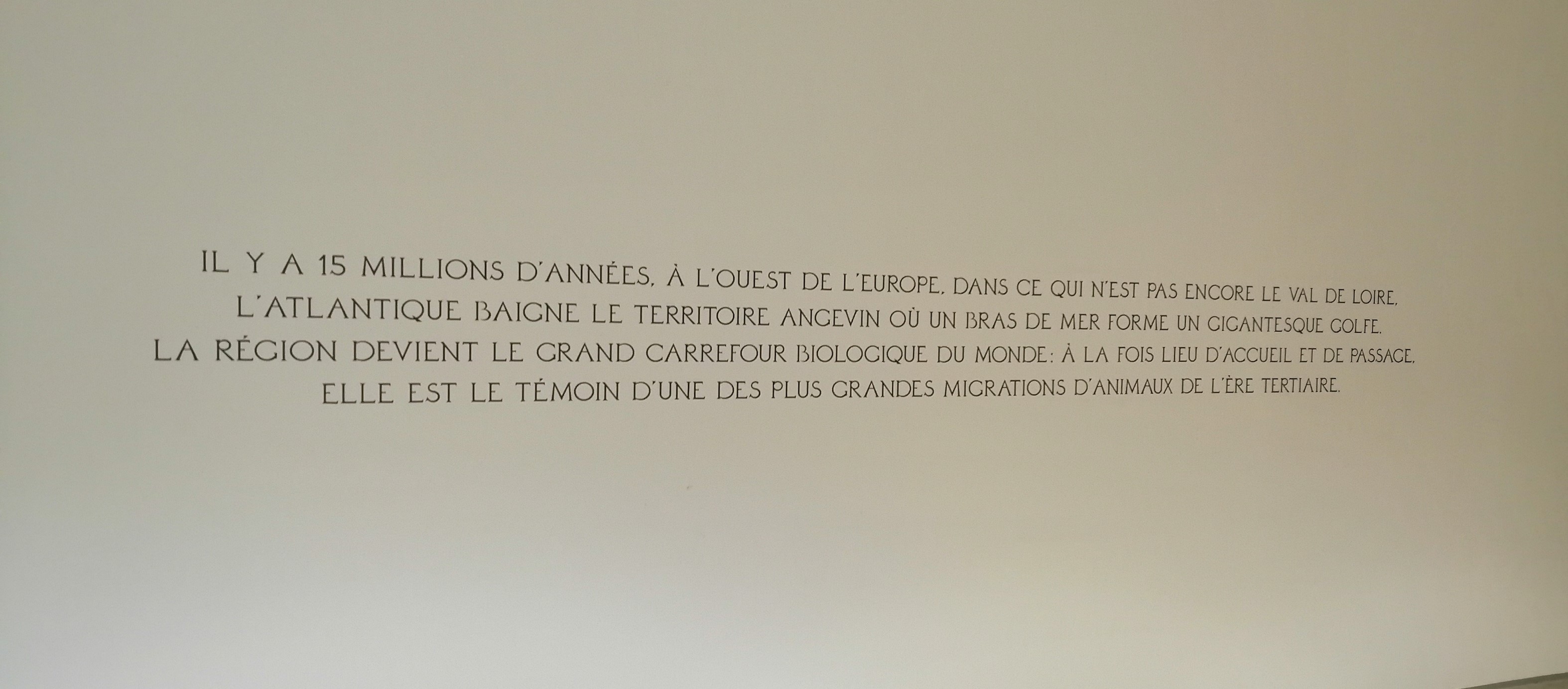
Vue de l’entrée de l’exposition Au temps des faluns ©GM

Vue de l’exposition – @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
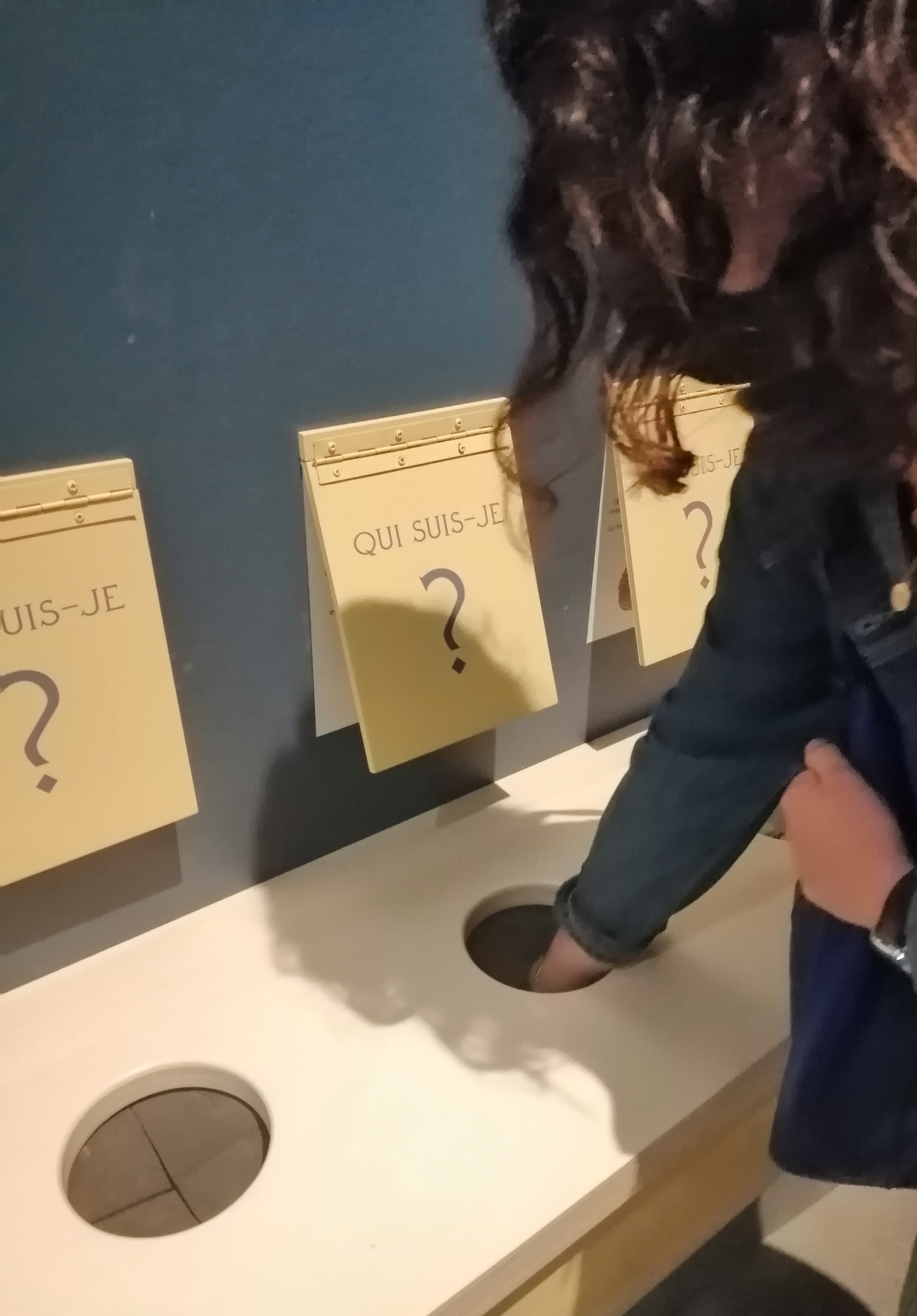
Dispositif tactile [vue de l’exposition Au temps des faluns] – ©GM
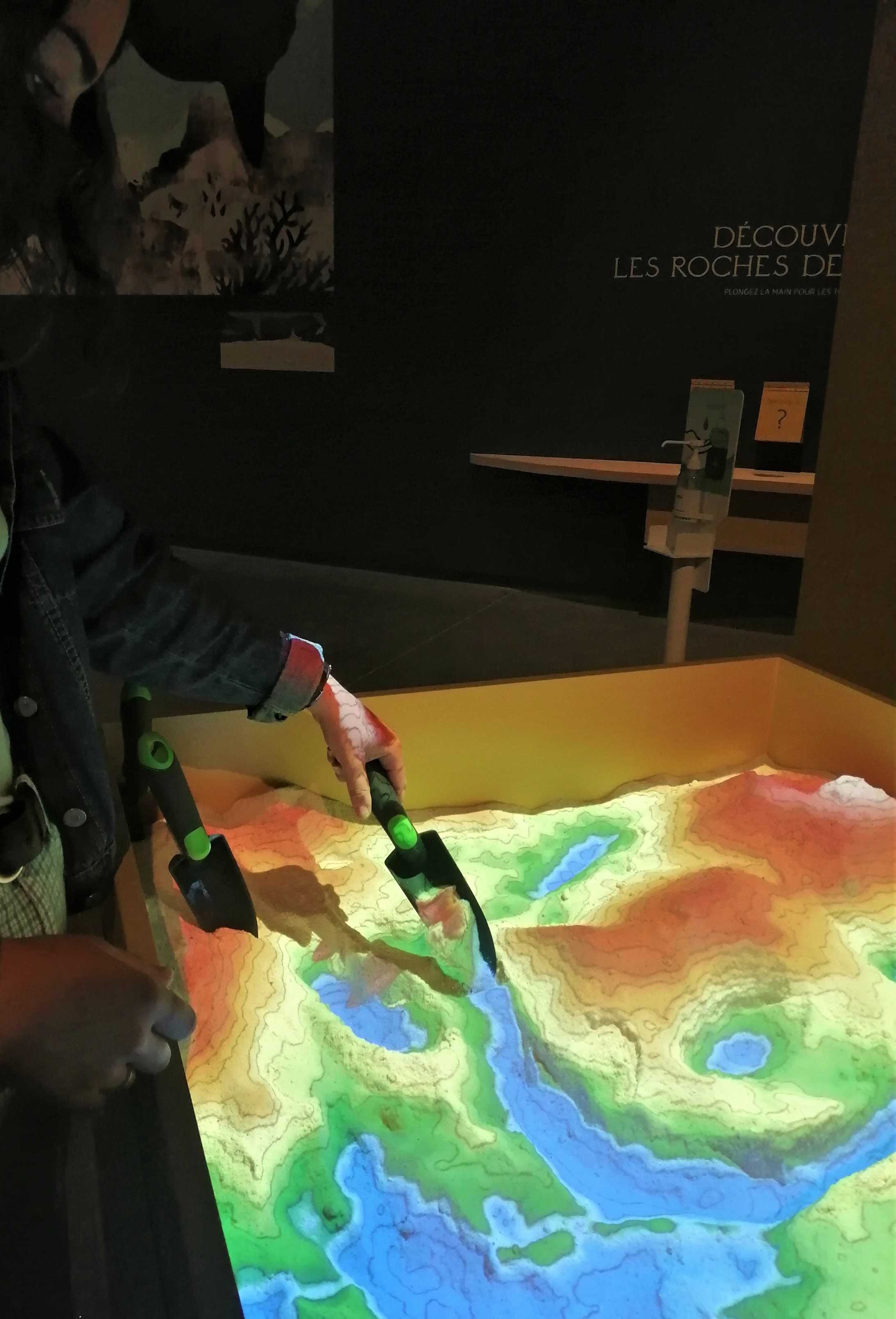
Bac à sable à réalité augmentée [vue de l’exposition Au temps des faluns] - ©GM

« Le monde marin », vue de l’exposition au temps des faluns @GM
Après avoir déambulé autour de ces deux îlots en longueur, où le regard est invité à se poser à la fois sur l’infiniment petit – un microscope permet d’observer des bryozaires ! – et le plus grand – la reconstitution inédite du Deinotherium fait son effet – nous terminons par les deux séquences en bout de plateau.

Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
Ces séquences sont disposées autour de ce qui semble de loin être un grand bac à sable sur estrade. Il s’agit de plus près d’un dispositif de médiation in situ proposant de s’essayer aux fouilles archéologiques dans les faluns. Nous avons quitté le Miocène et revenons vers des périodes plus contemporaines.
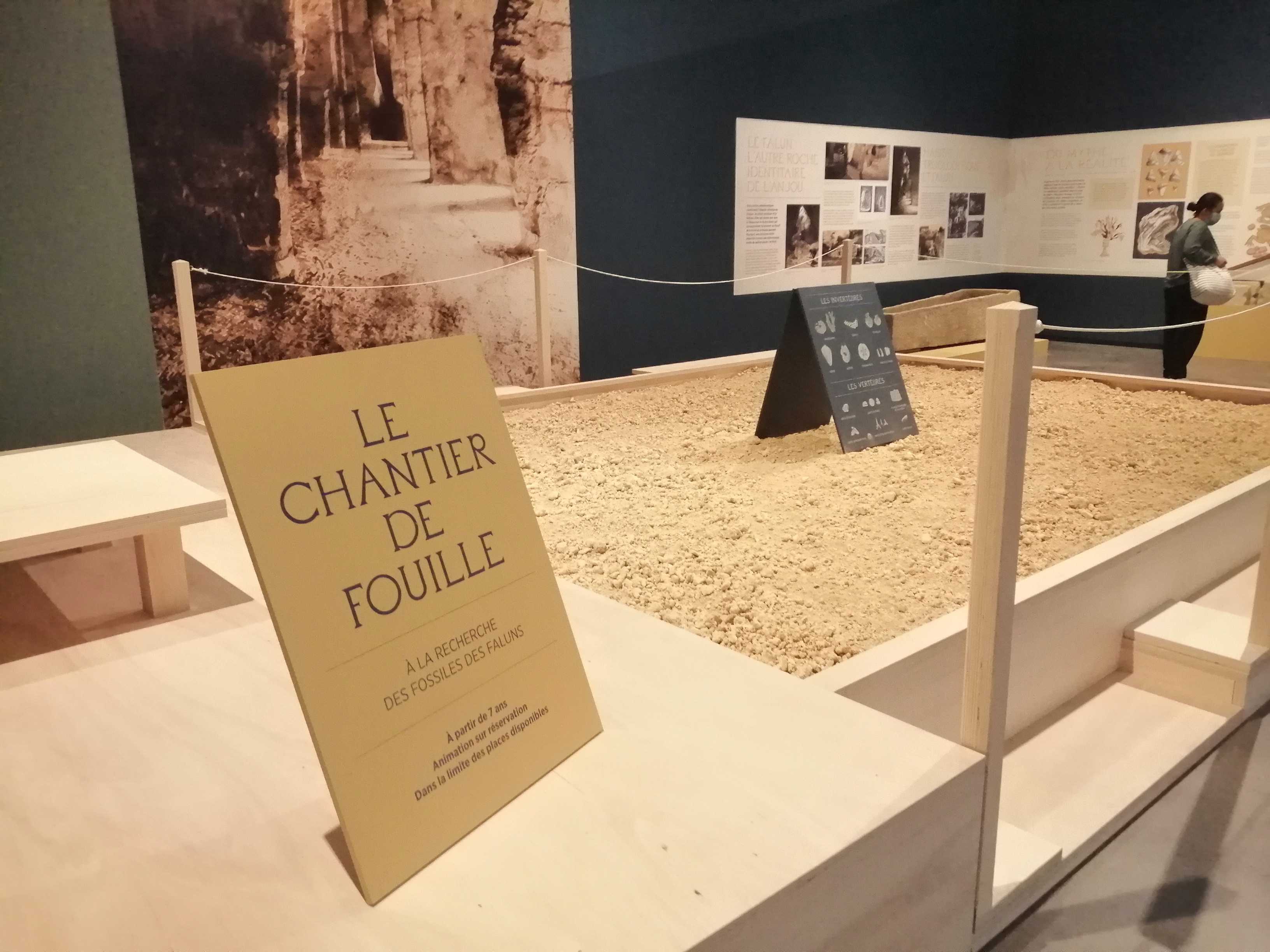
Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
La séquence 5 propose donc un regard plus patrimonial, intitulé « le falun, l’autre roche sédimentaire de l’Anjou » on y découvre sa répartition géographique, ses usages et son exploitation mais aussi les mythes qui l’entourent – notamment les légendes liées à l’abondance des dents de requins qui y sont trouvées ! Une maquette accompagne la séquence et permet d’observer ces différents aspects en un ensemble, elle présente notamment les fameuses caves cathédrales de Doué-en-Anjou.
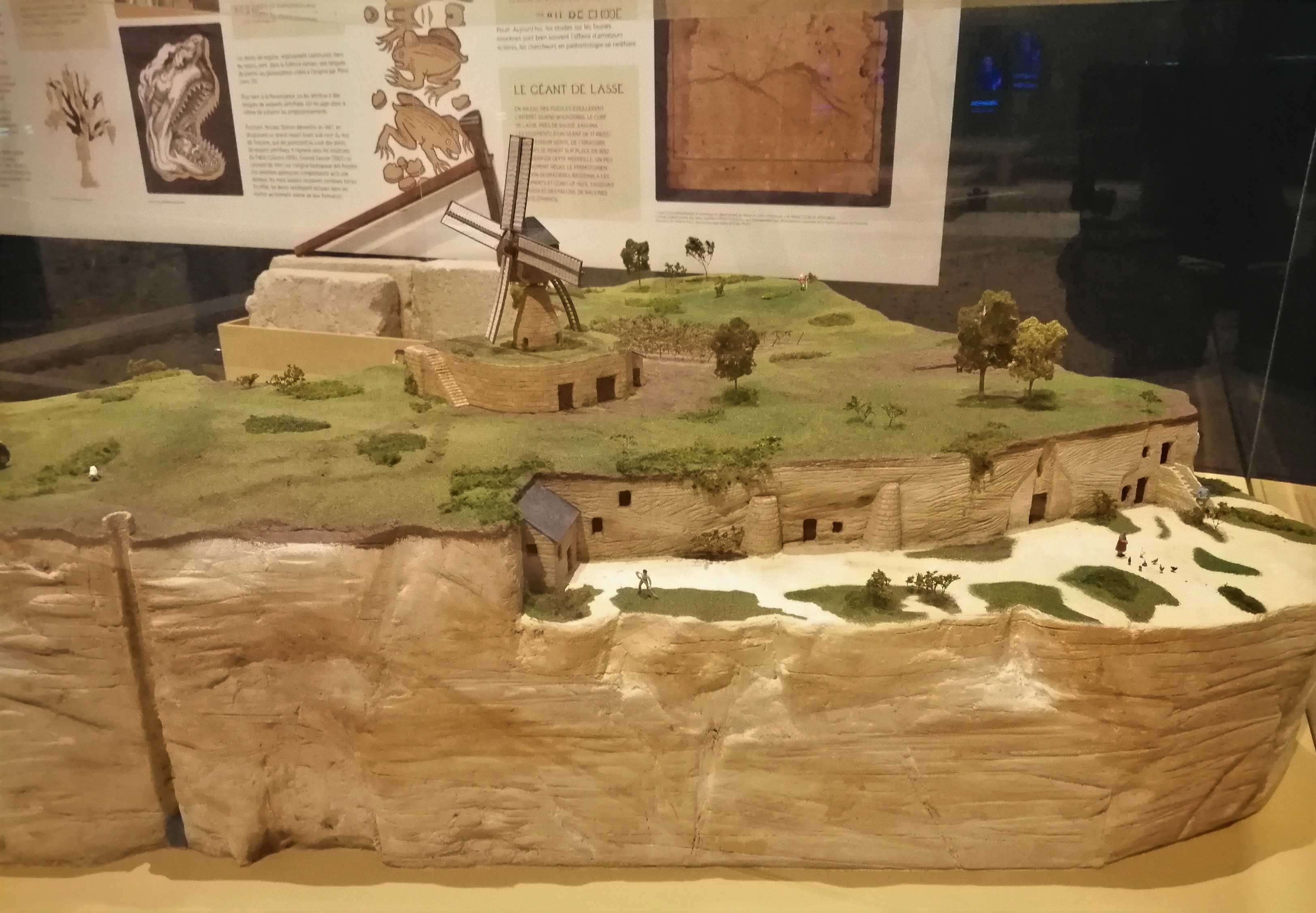
Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
La dernière séquence, intitulée « les regards sur les faluns », se veut plus intime : si des scientifiques abordent leurs recherches, d’autres professionnelles évoquent leur rapport à la roche. Une table tactile offre une bibliothèque numérique où l’on peut choisir à loisir les entretiens que l’on souhaite voir et aussi un « making-off » du montage de l’exposition qui met en valeur les métiers mobilisés.
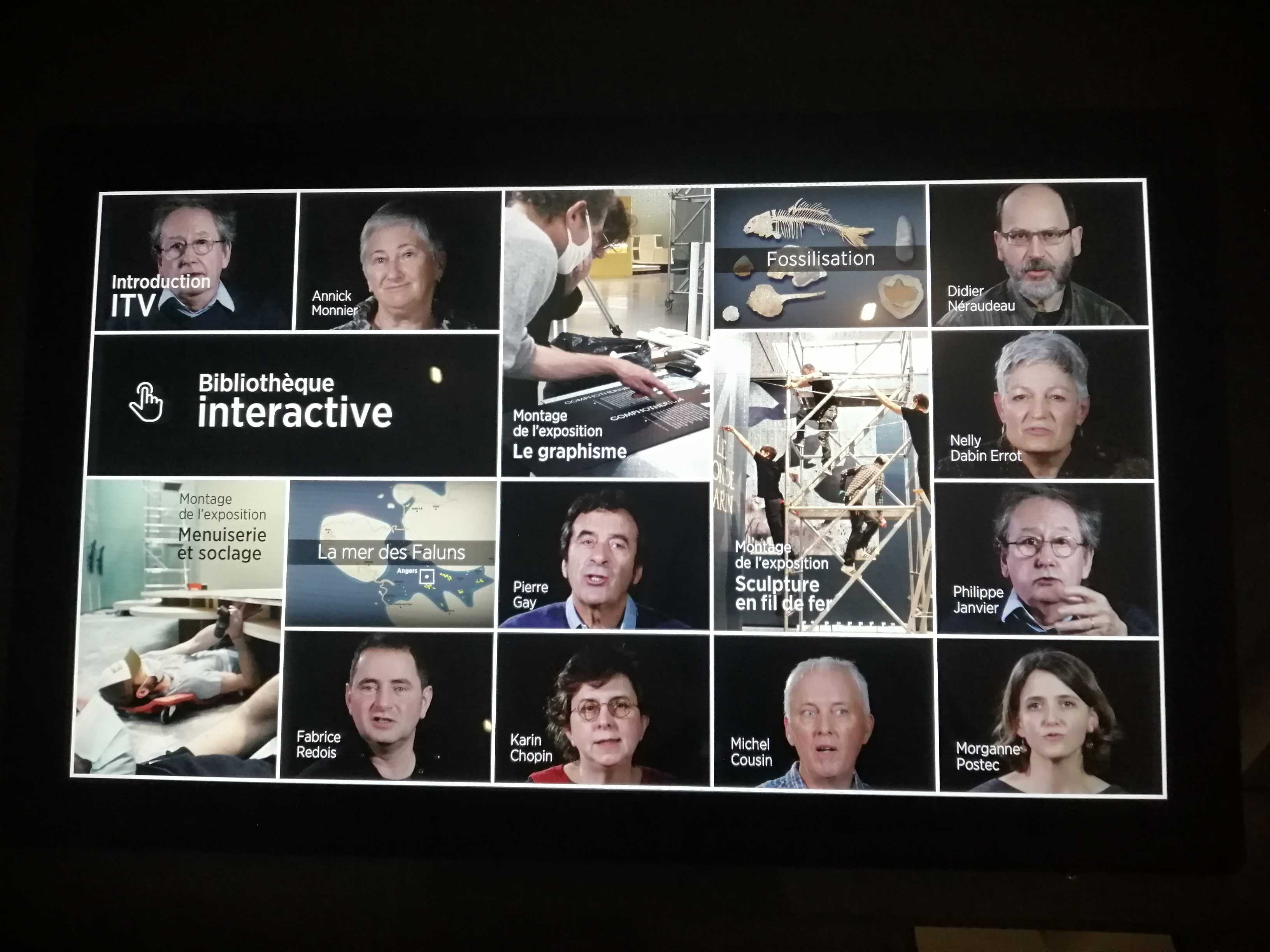
Vue de la bibliothèque interactive – Au temps des faluns ©GM
« Au temps des faluns » est une exposition grand public et pédagogique. La scénographie fluide à la lumière agréable (auxquelles les photographies ci-présentes ne rendent pas hommage) permet de suivre le parcours dans le sens numéroté ou plus librement sans pour autant perdre le message d’ensemble. Les expôts de provenances variées étayent le propos autant qu’ils peuvent intriguer ou émerveiller. Certains niveaux de lecture peuvent satisfaire les visiteuses ou visiteurs aux connaissances scientifiques plus poussées tout en restant accessibles à tous les publics.
Les dispositifs de médiation (numériques ou de manipulations) équilibrent l’ensemble et permettent une position plus active dans le parcours.
Je regrette seulement le manque de propos sur la paléobotanique ou la flore de la région au Miocène ou bien une mise en perspective Sciences et Arts que l’on pourrait attendre pour une exposition scientifique dans un musée d’arts.
L’exposition se prolonge également dans le site troglodyte des Perrières à Doué en Anjou avec une installation son et lumières intitulée « Le Mystère des Faluns ».
Bien plus qu’un caillou qui s’effrite, le falun est un témoin d’un temps pas si lointain à l’échelle de la Terre dont des fragments nous sont présentés au Musée des Beaux-Arts d’Angers jusqu’au 20 février 2022 !
GM
Pour en savoir plus :
- http://www.musees.angers.fr/expositions/au-temps-des-faluns/index.html
- https://le-mystere-des-faluns.com/exposition-au-temps-des-faluns/
#Faluns#Angers#Sciences

Avec les Petits Débrouillards, embarquement immédiat vers la science
Etudiants et étudiantes en première et deuxième année du Master Muséographie-Expographie, nous avons eu l'occasion cette année 2014 de rencontrer de grands professionnels de la culture scientifique qui nous ont exposé leur fonctionnement et leur démarche.
Né au Québec en 1984, l'association les Petits Débrouillards vise à vulgariser la culture scientifique et technique par le biais d'activités destinés aux enfants. Présente partout en France, son antenne nationale se situe en Île-de-France et plusieurs antennes sont en région.
Former le citoyen à la culture scientifique
Les intervenants nous ont expliqué l'objectif de leur association : faire découvrir la science aux jeunes, tout en s'amusant. Il s'agit de donner le goût à la culture scientifique et de favoriser la curiosité des petits et des grands. Dans le dialogue qui s'établit alors, le respect de l'autre est fondamental pour permettre de nombreux échanges et débats entre l'enfant et l'animateur mais aussi entre les jeunes eux-mêmes.
Les différentes animations sont d'abord prévues pour des enfants de 7 à 12 ans mais elles visent finalement tous les publics. Les membres des Petits Débrouillards font des activités régulières toute l'année avec les jeunes en allant dans les écoles et les centres de loisirs. Ils amènent la science aux jeunes pour leur donner envie de se déplacer ensuite vers les institutions scientifiques.
Ils conçoivent trois types d'outils pédagogiques : des expositions itinérantes sous forme de panneaux, des mallettes pédagogiques avec des fiches parcours et des activités à réaliser ainsi que des livrets pédagogiques et des fiches d'activités.
Une démarche innovante
Je vous propose une petite expérience qu'ils nous ont fait partager lors de cette journée enrichissante.
Prenez une feuille de papier que vous divisez en trois verticalement. La première feuille consiste à un pliage. Chiffonner la deuxième feuille de sorte à faire une boule de papier et laisser la dernière feuille intacte.
Monter sur une chaise, laissez tomber les feuilles une par une et observez.
On constate que la première feuille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La boule tombe selon une ligne droite et la feuille non modifiée fait un simple zig-zag.Vous venez de mener une expérience sur la gravité.
Comme vous venez de le découvrir, la démarche des Petits Débrouillards consiste à favoriser le questionnement par le biais de l'observation. Cette démarche se veut expérimentale puisqu'elle se réfère au geste de la personne menant l'expérience. Pour l'association, la science ne doit pas se préoccuper du Pourquoi immédiatement mais plutôt commencer par aborder le Comment, concret et observable. Par exemple, si nous ne savons pas pourquoi la feuille de papier tombe, nous savons comment elle tombe. Dans la médiation, l'importance est d'apprendre à poser des questions. Les réponses ne sont pas le cœur du problème, elles viennent ensuite.
Les enjeux fondamentaux desPetits Débrouillards
-
L'engagement et la participation des jeunes sont l'un des enjeux de l'association. Il s'agit de sensibiliser les jeunes aux préoccupations sociales et environnementales, à l'actualité scientifique, à travers la mise en place d'actions et de projets. Ces actions doivent permettre aux jeunes d'acquérir une base scientifique. Par exemple, chaque année, l'association met en place le Festival des Explorateurs où plus de 400 projets sont créés et animés par des jeunes. Ouvert au grand public, cet événement a pour but de valoriser la culture scientifique et technique du territoire.
-
Le développement durable est l'une des préoccupations majeures des Petits Débrouillards. Des outils pédagogiques et des expositions sont créés sur cette thématique pour sensibiliser les jeunes sur les problèmes actuels liés à la planète telles que la disparition des espèces animales et végétales ou la pollution de l'air, de l'eau et de la terre.
-
La solidarité entre les jeunes est une base importante pour avoir la notion d'échange et de partage dans la vie de tous les jours. Par exemple, des actions de médiation sont spécialement créées dans le cadre de cohésion sociale pour mettre l'insertion des jeunes dans la vie active. Ils apportent un soutien à l'enfant par la pratique des sciences.
-
L'association souhaite lier sciences et sociétés pour permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société au sein des problèmes actuels pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, et les inciter, pourquoi pas, à participer à des débats et à agir.
Un événement débarque chez vous
Développé et conçu par les Petits Débrouillards, en partenariat avec C'est Pas Sorcier et France Télévisions, le Science Tourvient chez vous, de mai à décembre 2014, en Franche-Compté, en Ile-de-France, dans le Centre, en Bourgogne, en Corse, en Midi-Pyrénées, dans le Languedoc-Roussillon, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pays-de-la-Loire et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Plusieurs camions équipés d'outils pédagogiques et d'expositions itinérantes viennent vous rendre visite. Avec des médiateurs scientifiques, les jeunes peuvent mener des expériences scientifiques et découvrir le monde des sciences et des techniques. Pourquoi ne pas aller à la rencontre de ces camions ?
Ludivine Perard
©Les PetitsDébrouillards
Adresse de l'Antenne Nationale :
La Halle aux Cuirs
2 rue de la Clôture
75930 Paris Cedex 19
Tél : 01 40 05 75 57 Fax 0140 05 79 21
Pour en savoir plus :
- Le site internet de l'association
- Informations sur les étapes du "Science Tour"
#science#jeunesse#expérience
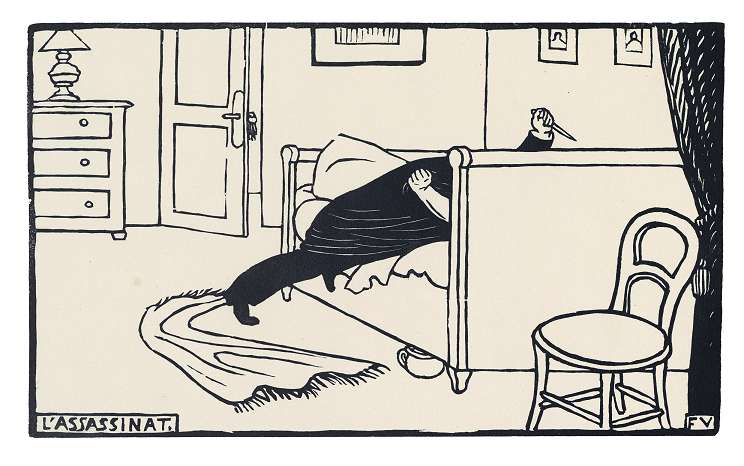
Cap sur le musée de la Préfecture de police
Nombreuses sont les personnes fascinées par le crime. Preuve en est les innombrables séries criminelles à succès tel Mindhunter de David Fincher, sortie en 2017 sur la plateforme Netflix. C’est une adaptation à l’écran de l’essai1 rédigé par le premier « profiler » de l’histoire. Le spectateur est invité à entrer dans la tête de célèbres tueurs en série à l’apparence étrangement ordinaire. Cet attrait du public se double d’une fascination grandissante pour les méthodes d’enquête utilisées dans les résolution des affaires criminelles. L’intérêt est réel, que ce soit pour le crime ou pour la chose policière.
Rien de neuf sous les tropiques me direz vous. En effet, les faits divers existent depuis toujours, même si c’est au 19ème siècle qu’ils prennent leur forme définitive. Ils seront moteur dans l’essor de la presse populaire autrement dite presse à grand tirage. Durant cet âge d’or du fait divers criminel, les journalistes se mettent à participer aux enquêtes, et à en dévoiler les coulisses dans les pages des journaux. Pour faire clair, « la télévision n’a pas attendu le fait divers pour devenir un média populaire » 2.
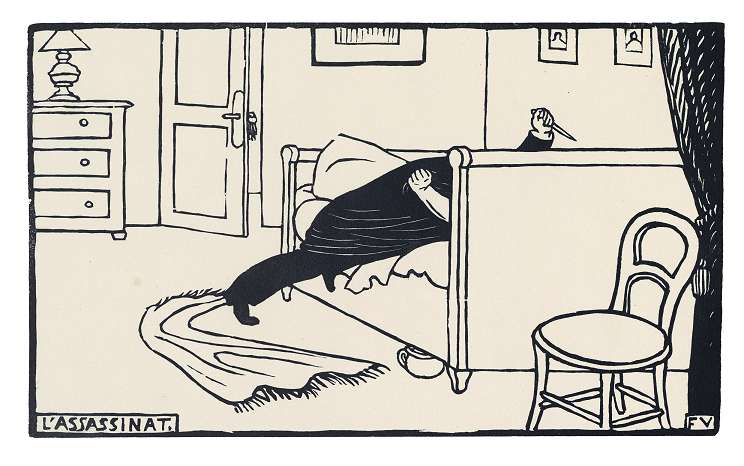
Félix Vallotton, L'Assassinat, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie © BnF, Dist. Rmn-Grand Palais / image BnF
Mais pourquoi les faits-divers nous fascinent-ils autant?
Une première question se pose : mais pourquoi sommes-nous tant fascinés par le crime ? Comment expliquer cet attachement morbide ? Au-delà des anecdotes scabreuses, au-delà de la mise en fiction du crime, s’intéresser aux forfaits et à leurs auteurs, permet de saisir certains biais de la condition humaine. En effet, les faits divers fonctionnent comme des miroirs déformants permettant de déceler certaines anomalies des époques auxquelles ils se produisent. De plus, ils correspondent à une certaine production sociale dans la mesure où ils dévoilent et soulèvent des failles, des tabous et des crispations. L’une des raisons qui poussent les hommes à s’intéresser aux faits divers c’est que ce sont toujours leurs semblables qui sont au coeur de ces affaires, qu’ils soient à la place de la victime ou du bourreau. Ce fort potentiel d’identification (consciente ou non) contribue au succès du fait divers : « Si des gens ordinaires peuvent tomber dans la barbarie, la barbarie ne laisse jamais indifférents les citoyens ordinaires » (Daniel Zagury, La Barbarie des hommes ordinaires. Ces criminels qui pourraient être nous). Il y a bien évidemment un petit peu de curiosité malsaine mais rien d’anormal donc, tant que la fascination ne vire pas à l’admiration.
Maintenant que vous êtes rassurés quant à votre « normalité » toute subjective et que vous pouvez assumer votre passion en toute décomplexion, vous aimeriez bien en profiter. Pourquoi ne pas s’aventurer dans un musée du crime pour tenter d’approfondir le sujet ? Cette proposition tombe à pic car vous commenciez à vous ennuyer. Vous avez déjà visionné toutes les séries télévisées et documentaires, écoutés toutes les émissions Hondelatte raconte sur Europe1, même les Enquêtes impossibles de Pierre Bellemare y sont passées c’est pour dire. Pour votre plus grand bonheur, il existe des musées au charme suranné qui donnent à voir (et à comprendre ?) des activités criminelles, qu’elles soient célèbres ou ordinaires. Sacré programme !
Exposer le crime : le cas du musée de la Préfecture de Police de Paris
Il existe une multitude de musées exposant le crime à travers le globe. Certains sont simplement glauques à l’instar des musées de la torture qui pullulent un peu partout, toujours sur le même modèle ; d’autres sont instructifs, pédagogiques, virtuels comme le génial Criminocorpus ou même fictifs comme le « Black Museum » présenté dans la série à succès Black Mirror (S04E06).
Partons à la découverte du Musée de la Préfecture de Police de Paris. Il a été créé en 1909 par le Préfet Louis Jean-Baptise Lépine (1846 - 1933) également à l’origine de la brigade criminelle. Les premières collections du musée ont été constituées à partir de pièces réunies pour l’exposition universelle de 1900. Depuis, elles ont été enrichies et complétées grâce à des dons, des saisies et des acquisitions.
La police a autorité pour conserver ces éléments qui prennent des formes très diversifiés : photographies de scènes de crime, portraits anthropométriques de criminels, coupures de presse, armes, uniformes, faux et contrefaçons etc. Le parcours muséographique intègre de nombreux documents d’archives qui proviennent du fonds géré par la préfecture de Police. Il y a également des pièces accumulé par Gustave Macé, policier devenu chef de la Sûreté en 1877, tout au long de sa carrière. Il récupérait chez des brocanteurs des pièces ayant servi à des criminels afin de les retirer du marché et d’éviter qu’elles ne soient acheté par la pègre. Il est d’ailleurs à l’origine d’un « musée criminel » qui prend la forme d’un ouvrage (consultable gratuitement sur Gallica) présentant tantôt des objets utilisés par les malfrats, tantôt les instruments et équipements des policiers pour les attraper. Il est particulièrement intéressant de savoir comment la collection s’est constituée, mais avoir des informations supplémentaires sur le pourquoi du comment telle pièce a été patrimonialisée plutôt qu’une autre serait bienvenu.
Aujourd’hui, le musée bien qu’atypique par le sujet demeure classique dans la forme. Comme de nombreux musée de la police et / ou du crime, il se rapproche d’un cabinet de curiosité, impression renforcée par l’accumulation d’objets dans d’anciennes vitrines (qui sont par ailleurs très belles). Selon les chercheuses Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon, « Cela confère à nombre de ces musées une dimension globalement artisanale, ce qui les fait ressembler à une sorte de « brocante du crime ». » 3
Le but poursuivi par le musée de la Préfecture de Police est de raconter « l’histoire d’une institution qui, d’une police polycéphale à la Lieutenance de Police, a su s’adapter aux évolutions de la société et de l’espace urbain. »4. Ainsi, tous les objets servent à mettre en avant l’histoire de la police, ses réussites et son efficacité dans la résolution d’affaires et la gestion du crime. Le musée montre également l’histoire d’une profession à partir de 1667, date de l’institutionnalisation de la police. Le musée s’articule autour de cinq thématiques fonctionnant indépendamment les unes des autres mais formant un tout cohérent :
- Histoire de la police parisienne ;
- Crimes et châtiments ;
- Paris en guerre ;
- Métiers de la préfecture de Police ;
- Police technique et scientifique.
La partie sur l’histoire de la police parisienne m’a un peu ennuyée car elle est très factuelle et les expôts sont principalement des documents d’archives manuscrits ainsi que des uniformes montés sur des bonhommes en cire, rien de très sexy. Les autres sont intéressantes mais assez inégales dans leur traitement.
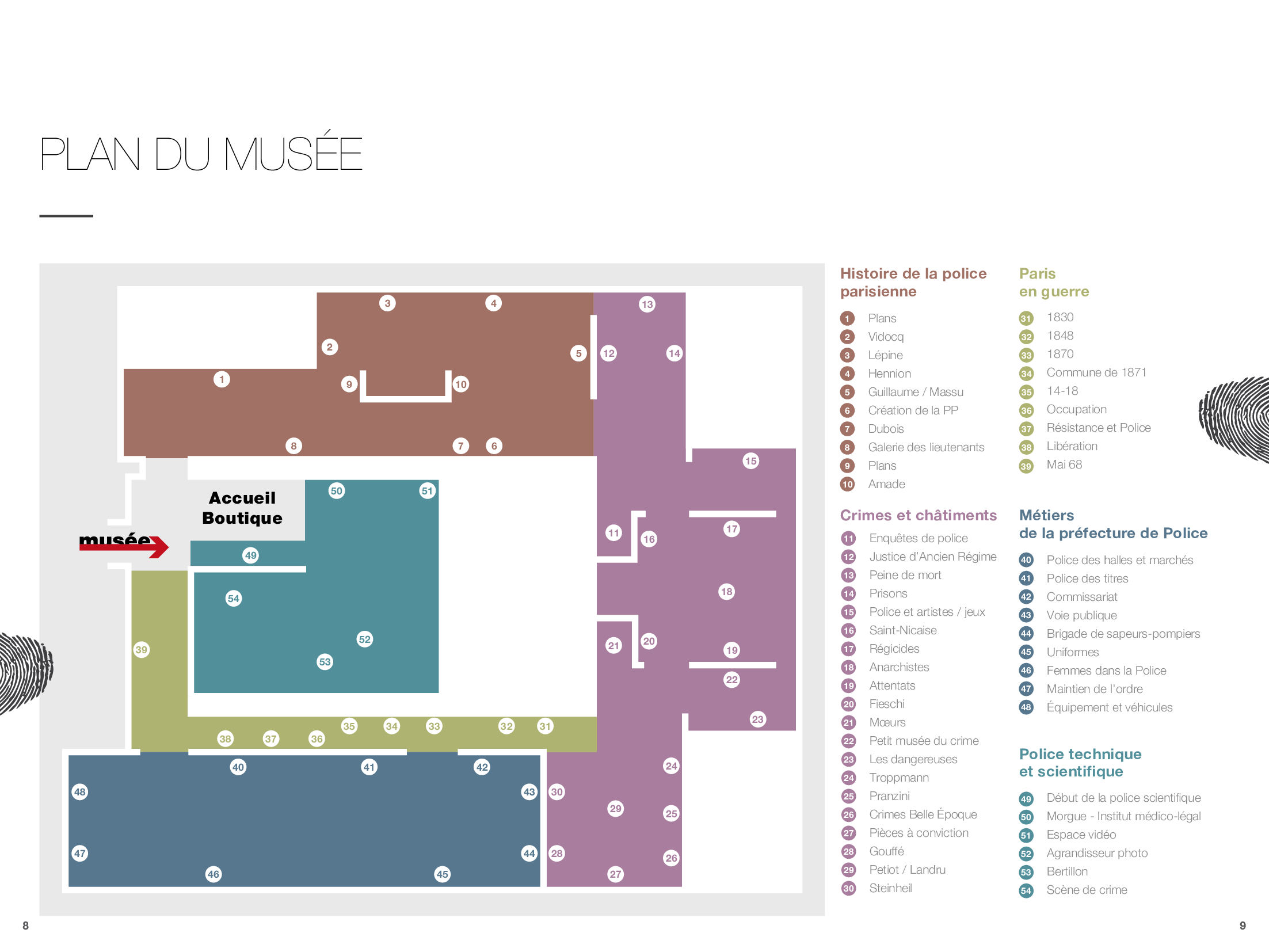
Plan de l'espace © Musée de la Préfecture de police
Une section conséquente de la muséographie est consacrée aux notions de Crimes et châtiments. L’accent est mis sur des assassins célèbres des 19ème et 20ème siècles. Ce choix semble pertinent lorsque l’on sait qu’à la fin du 19ème siècle, une conception particulière du crime et des criminels, majoritairement scientifique se développe. Par ailleurs, toutes les grandes thématiques sont abordées : la justice d’Ancien régime initiée par la royauté ; les régicides, événements traumatiques et fascinants toujours sévèrement punis ; les empoisonnements multiples et notamment la célèbre affaire des poisons (1666 - 1682 sous le règne de Louis XIV) ; les crimes dits « passionnels » ; les escroqueries en tout genre ; apachisme et délinquance dans les faubourgs.
Bien sûr, toutes ces histoires encore bien présentes dans l’imaginaire collectif possèdent leurs protagonistes. Ainsi, le musée de la Préfecture de Paris axe sa muséographie sur des grands noms du crime ou du banditisme.
Vous pourrez admirer deux faux d’un même Vlaminck - pourtant bien différents - saisis par la police judiciaire parisienne. Ils avaient été commandés par le célèbre vendeur d’art Fernand Legros.
Le parcours, en plus des textes de salle, est ponctué de petits encarts « Le saviez-vous ? » qui apprennent aux visiteurs des anecdotes aussi étranges que passionnantes dont voici un exemple :
« Les bandes de garçons bouchers qui travaillent à La Villette utilisent des os de moutons pour renforcer leurs coups. L’inspecteur Rongeat en fait péniblement l’expérience alors qu’il tente d’interpeller un certain Landrillon. À l’issue de leur affrontement, il semble être indemne, hormis des contusions. En fait, il meurt d’une péritonite deux semaines plus tard, due aux chocs infligés par la partie saillante de l’os. »
Des vitrines remplies d’objets insolites et bizarrement ingénieux viennent illustrer ces propos. Vous y trouverez toute sorte de poings américains, des bagues portés par les apaches servant à l’occasion des bagarres, un poignard en forme d’éventail replié et même un pistolet déguisé en radio.
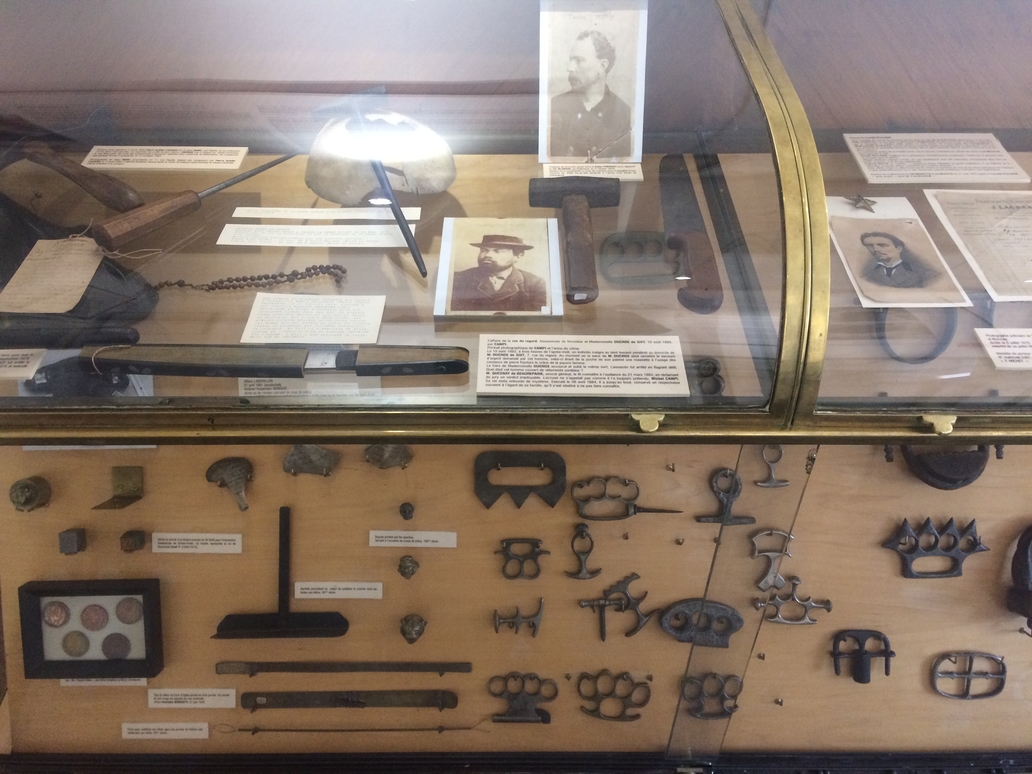

Vitrine et pistolet radio © A.G
Un panneau est consacré aux « Dangereuses ». Ah, les femmes et le crime, toute une histoire ! D’après le texte, il existe trois typologies de femmes dangereuses et chacune a sa figure de proue : « Les espionnes » avec Mata Hari en porte étendard ; « Les fatales [...] qui utilise(nt) (leurs) charmes pour faciliter le crime, voire le commettre » illustrées par Casque d’Or, la favorite des Apaches des faubourgs ; et enfin « Les vénéneuses » comme la marquise de Brinvilliers, actrice principale de l’affaire des poisons de 1666. Bien que ce séquençage soit quelque peu caricatural et reflète une vision fantasmée de la femme criminelle, les informations divulguées sont intéressantes.
En revanche, je regrette que nul part, la spécificité des crimes commis à l’encontre des femmes ne soit mentionnée. Les crimes à caractère sexuel, les violences conjugales, les féminicides sont passés sous silence. De manière générale, la place de la femme y est très marginale même lorsqu’il s’agit de parler des femmes policières dans la partie consacrée aux « Métiers de la préfecture de Police ».
Sans pour autant que le discours soit promotionnel, il n’y a pas de distanciation critique dans le propos. « Pour l’essentiel, les musées de la police font entendre le discours d’une institution sur sa propre histoire, regard déterminé par une approche positiviste. Construit au singulier et sans réelle distance, ce type de discours incorpore rarement les lectures critiques de l’histoire policière, notamment du point de vue de la répression des épisodes de contestation sociale qui, s’ils sont évoqués, rendent peu compte de l’usage de la force par la police. » (Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon). Cela est notamment flagrant dans le traitement des événements de Mai 68. Le musée n’est pas destiné à la remise en cause, mais contrairement à d’autres musées du crime, l’approche choisie n’est ni sensationnaliste ni spectaculaire.
En fin de parcours est présentée dans une petite section la police technique et scientifique. Alphonse Bertillon crée en 1882 un système de mensurations anthropométriques qui pose les bases de l’identification judiciaire, permettant de classer les criminels pour identifier les récidivistes. Les fiches étaient classées selon trois ordres de grandeur, en fonction de l’ossature de la personne : « Les mesures retenues furent la taille, la longueur de la tête, la largeur de la tête, l’envergure des bras, le buste (hauteur de l’homme assis), la longueur de l’oreille droite, la longueur du médius gauche, la longueur de la coudée gauche et la longueur du pied gauche » (source : cartel développé consacré à Bertillon). À la fin du 19ème siècle, Alphonse Bertillon est considéré comme un génie, son système est progressivement adopté dans le monde entier. Une seule chose m’interpelle dans cette section c’est l’absence du nom de Cesare Lombroso, considéré comme le père de l’anthropologie criminelle. Il a écrit en 1876 L’homme criminel. Même dans la brochure il est fait mention « d’une théorie alors populaire qui établissait un lien entre apparence physique et propension au crime » alors que Alphonse Bertillon et plus tard Alexandre Lacassagne se sont directement inspirés des travaux des criminologues italiens et particulièrement de Cesare Lombroso. Le traitement est donc volontairement et uniquement territorial. Selon les chercheuses Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon, la défense d’une identité nationale ou locale est une des caractéristiques des musées de la police à travers le monde5.
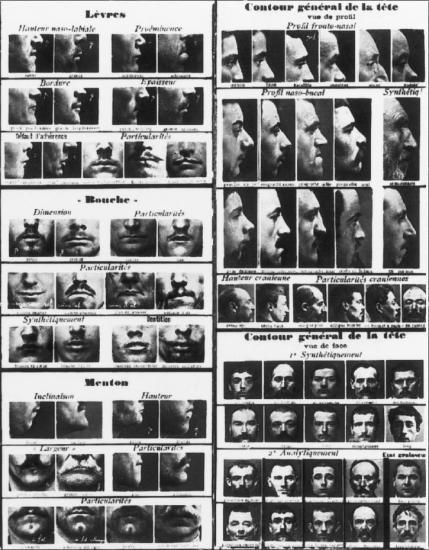
Portraits bertillonages © Pinterest
Les enjeux de la patrimonialisation du crime
Le musée de la police se revendique dans sa brochure comme « un musée du crime ». Or, ces deux types d’institutions, proches par les thèmes traités, ne répondent pas exactement aux mêmes problématiques, même si leur définition s’entrecoupent et qu’il est parfois difficile de les distinguer. Les musées du crime et de la police ont comme point commun d’être peu médiatique. Il y a très peu de musées de la police en France contrairement à d’autres pays comme les États-Unis. D’ailleurs funfact (ou non) mais l’État américain comptant le plus de musées de la police n’est autre que le Texas, avec notamment deux musées estampillés Texas Rangers.
Souvent, ces musées sont destinés à un public restreint à l’instar du fameux Crime Museum de Londres qui n’ouvre quasiment pas ses portes au public. Il a été créé dans un but pédagogique et accueille seulement des étudiants et des professionnels de la police. D’octobre 2015 à avril 2016, le musée qui se situe à Scotland Yard dévoilait sa sombre collection d’objets le temps d’une exposition temporaire au Museum of London, qui rencontra un franc succès. C’est bien la preuve que ces institutions rencontrent un public, des étudiants, des professionnels mais également des chercheurs, des visiteurs individuels. Certaines de ces structures accueillent même des enfants, c’est le cas du musée de la préfecture de Police de Paris où tout un pan de mur est consacré à l’exposition de dessins d’enfants représentant la police au travail. On peut tout de même se poser la question de comment sont abordées ces thématiques auprès du jeune public.

Dessins d'enfants © A.G
Les enjeux soulevés par la patrimonialisation du crime et des lieux policiers semblent peu émouvoir le grand public. Par ailleurs, peu de recherches sont réalisées sur la mise en exposition des objets liés à l’histoire du crime. Les musées de la police comme les musées du crime sont peu étudiés. Il existe une plateforme scientifique en ligne dédiée à l’histoire de la justice, des crimes et des peines. Le site internet Criminocorpus.org propose un Musée de la justice, une revue ainsi qu’un blog d’actualité. Marc Renneville son créateur milite pour l’ouverture d’un musée de la Justice et de la Sécurité qui centraliserait toutes les collections liées à ces thématiques au 36, quai des Orfèvres sur l’île Saint Louis.
Armelle Girard
Notes:
1. John Douglas et Mark Olshaker, Dans la tête d’un profileur, Michel Lafon, 461 pages.
2. Sécail, Claire. « L'essor du fait divers criminel à la télévision française (1950-2010) »,L'information psychiatrique, vol. volume 88, no. 1, 2012, pp. 51-59.
3. Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon. « La police au musée : une perspective comparative »,Déviance et Société, vol. vol. 42, no. 4, 2018, pp. 663-685.
4. Citation extraite de la brochure du musée.
5.Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon. « La police au musée : une perspective comparative », Déviance et Société, vol. vol. 42, no. 4, 2018, pp. 663-685.
Informations :
Musée de la Préfecture de Police
4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75 005 Paris
Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10 Bus : 24, 47, 63, 86, 87
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et le troisième samedi de chaque mois de 10h30 à 17h30.
L’accès au musée est gratuit.
Liste non exhaustive de structures semblables :
- Museo Lombroso di antropologia criminale (Turin)
- Museo Criminologico (Roma)
- Musée de la Gendarmerie Nationale (Melun)
- Black Museum, Metropolitan Police’s Crime Museum (Londres)
Liste non exhaustive d’expositions passées sur cette thématique :
- Crimes et Châtiments, 16 mars - 27 juin 2010, Musée d’Orsay
- Crim’expo : la science enquête, 10 février 2009 - 3 janvier 2010, Cité des sciences et de l'Industrie
- Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux années soixante, 28 septembre - 26 décembre 2011, Archives Nationales et version disponible en ligne sur Criminocorpus
#Crimes&Châtiments
#Police
#Frissons

Carnuta : à nous deux vieille branche !
Ah les expositions parisiennes toutes plus alléchantes les unes que les autres ! Mais si on se mettait au vert ? Direction la Sarthe et plus précisément Jupilles, commune d'un peu plus de 500 habitants où l'on découvre un centre d'interprétation de l'homme et de la forêt.
©http://www.caue-sarthe.com
Il prend la suite du musée du bois installé dans le foyer rural de Jupilles fermé depuis 2006. Plus communément appelé Carnuta, le centre d'interprétation s'implante en 2010 dans le bourg du village, non loin de la forêt domaniale de Bercé.
Surpris par cette architecture sinueuse, véritable enveloppe végétale semblable à l'écorce d'un arbre, nous n'avons d'autre alternative que d'entrer ! Une exposition temporaire intitulée "D'âme nature, exposition hommage à Michel Marc" prend place au rez de chaussée. J'entends une petite voix "mais qui est Michel Marc?" Un local mondialement reconnu pour sa pratique de la photographie naturaliste. Michel Marc révèle la diversité des habitants naturels de la forêt. A travers des clichés, des reconstitutions de laboratoires photographiques et témoignages, la petite équipe du centre d'interprétation a su rendre hommage à cet enchanteur de la richesse floristique et faunistique de la forêt de Bercé. Attiré par des ambiances sonores, pas question de nous reposer sur nos lauriers, découvrons l'espace d'exposition permanente crée par l'agence Abaque !
Crédits : Rachel Létang
Face à une représentation symbolique de la forêt, nous assistons à un dialogue entre trois arbres. Si l'arbrisseau attend avec impatience le printemps pour grandir, le vieux chêne ronchon déplore que les cloportes commencent déjà à lui chatouiller l'écorce ! Hormis l'amusement et la poésie qui se dégage de ce dialogue, ce dispositif permet d'annoncer toutes les thématiques à venir. Nous traversons la forêt en découvrant conjointement différentes espèces d'arbres et de résidents. Ce n'est pas une simple présentation du patrimoine naturel de la forêt mais un discours agrémenté de photographie et d'informations botaniques qui tend à nous faire comprendre l’interdépendance des arbres et des animaux.
Après le concret, place au fantastique! La forêt est envisagée comme un espace où la magie règne. Le visiteur est alors sollicité par des dispositifs sensoriels. Toucher, voir, sentir permettent de s'imprégner de l'univers de la forêt et ouvrent au conte et à la rêverie. Dommage qu'il faille se plier en quatre pour atteindre ces trappes. Nous regrettons que tous les éléments sensoriels de cet espace soit trop bas, comme si le ludique n'appartenait qu'au tout petit !
Poursuivons notre visite au sein d'un espace consacré à l'exploitation de la forêt. Dans notre vision naïve de la nature, l'homme n'intervient pas ! Pourtant, il concourt au bon équilibre de la forêt. Les missions des agents de l'Office National des Forêts sont présentées à travers des portraits photographiques et des témoignages. On suit également le parcours du bois depuis l'arbre jusqu'à la vente du bois scié. Un film vient retracer l'historique de l'exploitation de la forêt.
On découvre enfin pourquoi le centre d'interprétation s'appelle Carnuta ! La forêt de Bercé est l'un des vestiges de la forêt des Carnutes, peuple Gaulois, qui a été morcelée pendant la conquête romaine. Photos d'archives, vues du ciel permettent de comprendre la singularité de la forêt de Bercé d'un point de vue naturel, économique et social. Plus technique, nous pénétrons enfin dans l'atelier du bois. Grâce à des vidéos que l'on regarde sur ordinateurs et que l'on écoute grâce aux douchettes, on découvre les différents métiers comme le sabotier, le tonnelier et autres savoir-faire liés au bois.
Afin de déterminer quel outil est utilisé au sein des différentes étapes de fabrication, les outils sont à la portée du visiteur dans de grands tiroirs. Afin de renvoyer sur le territoire, Carnuta propose de nombreuses animations, notamment en forêt de Bercé. Comme ils aiment le dire, "vous allez être scié".
Rachel Létang
Carte blanche à l'impression 3D au Centre Pompidou
On trouve rarement une exposition de ce type dans un musée d’art moderne. Avec Imprimer le monde, le Centre Pompidou adopte une approche semblable à celle des centres d’interprétation. Ce n’est pas tant la proposition d’une exposition thématique - rentrée depuis longtemps dans les habitudes du musée - qui surprend, mais la formalisation d’une réflexion sur un sujet qui dépasse les questions plastiques et politiques pour toucher également les domaines techniques, industriels et scientifiques.
L’exposition présente des objets partiellement ou intégralement conçus et fabriqués grâce aux technologies désignées sous le nom générique d’impression 3D. Lorsque l’on pénètre dans les lieux, leur variété est saisissante.
Stranger Visions, Heather Dewey, 2012 ©ND
Gestation numérique, fabrication automatisée
Les concepteurs donnent dès les premiers mètres la définition de l’impression 3D, également désignée sous le terme de « fabrication additive » et se proposent de retracer son « archéologie ». Une grande frise chronologique, ponctuée d’objets sous vitrine, replace cette invention dans une histoire beaucoup plus ancienne. Aux origines, deux inventions de la seconde moitié du XIXe siècle : la photogravure et les cartes topographiques, qui donnent une vision du relief par « couches ».
Le point commun réunissant ces artefacts est la conception assistée par ordinateur, la modélisation 3D, qui permet ensuite de configurer une machine, « l’imprimante » pour fabriquer, par traçage, dans l’espace, sous forme d’aller-retour, les dépôts de matière, composant finalement le résultat solide. Derrière ce terme, en filigrane, se retrouve donc l’image du robot et de l’intelligence artificielle, mis à contribution d’une production sérielle.
L’exposition réinterroge le statut de l’objet artisanal et artistique. Elle montre le travail des designers et des artisans qui allient la maîtrise de compétences scientifiques (codage, création d’algorithme) ou d’ingénierie (mise au point des machines prenant en charge la fabrication) à leur démarche de plasticien. La conséquence directe de ces pratiques est l’avènement d’œuvres ou d’objets artisanaux reproductibles, sans que le concours de la main humaine ne soit nécessaire à l’étape de fabrication. L’objet, fondé sur le principe de la reproductibilité, acquiert alors une dimension industrielle.
Open source et démarche collaborative
Passé par l’étape de la programmation numérique, le concepteur accouche d’un mode d’emploi en même temps que la machine réalise physiquement l’objet. Conséquence : la réplication de l’objet est possible à partir d’un fichier source. Héritière des idées de « démocratie technique », diffusés autour de la création de fablabs, hackerspaces et markerspace, l’impression 3D s’inscrit dans une dynamique favorisant l’accès en open source des données, autrement dit, la reproduction de l’objet et sa modification par d’autres concepteurs. L’exposition questionne également les usages pernicieux qui peuvent être faits de ce modèle de partage, et présente, par exemple, la première arme imprimée en 3D, dont le fichier numérique source fut diffusé et téléchargé près de 100 000 fois en 2013 avant son interdiction par l’Etat américain.
Outre la libre circulation des fichiers destinés à l’impression, l’exposition montre à plusieurs reprises des situations de créations collectives autour de projets de fabrication additive. Plusieurs objets présentés sont accompagnés d’une vidéo retraçant la genèse et les principales étapes de leur élaboration. Par exemple, on suit la collaboration de graphistes, de développeurs numériques et d’imprimeurs dans leur entreprise de conception et de fabrication d’une typographie produite en résine par impression 3D, utilisées dans une fonte traditionnelle.
A23D,3D-printed letterpress Font, New North Press, A2-Type et Chalk Studios, 2014, © N.D.
Vulgarisation ardue
Si elle montre la fantastique palette des matériaux (résines extrêmement légères, céramique d’argile, titane…), des textures et des tailles des objets imprimés en 3D, on regrette cependant que l’exposition ne lève davantage le mystère derrière la fabrication technique de ces objets.
GrowthTable Titanium, 2016, Mathias Bengtsson, © N.D.
Shapes ofSweden for Volvo, 2015, Lilian van Daal, © N.D.
Bien que les vidéos associées aux objets présentent les étapes de leur élaboration, les techniques et les technologies restent d’une certaine manière abstraites, puisqu’elles n’ont pas été soumises à l’épreuve de l’expérimentation par le visiteur. C’est certainement la limite de cette exposition. La présence de dispositifs d’interprétation -multimédias, manipulations - en complément des audiovisuels, aurait été appréciable pour tenter d’aborder concrètement les dimensions techniques de l’impression 3D : les questions d’algorithme, la gestion et la transformation de la matière première dans la machine, les spécificités techniques des technologies dont les noms restent énigmatiques (stéréolithographie, dépôt de matière fondue, filtrage sélectif par laser, laminage par dépôt sélectif…).
Par ailleurs, si elle soulève des questions sociétales et éthiques en évoquant la démarche de certains artistes (par exemple, la reproduction de monuments détruits en Syrie comme « réparation » de l’histoire ou la recréation de visages à partir de matériaux génétiques collectés dans des lieux publics pour interroger la « surveillance génétique »), l’exposition n’approfondit pas les enjeux scientifiques et évoque certains résultats sans les contextualiser ou les mettre en perspective. Elle expose ainsi des prothèses médicales et évoque la création du premier vaisseau sanguin imprimé en 3D, sans questionner la reproduction d’éléments bio-artificiels comme substituts du vivant, laissant le visiteur perplexe sur la faisabilité du processus et les enjeux éthique des usages.
Work in progress
Cette exposition fait entrer la pratique de l’impression 3D, pour ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, dans une histoire déjà en marche. Elle provoque en cela une impression de vertige. Où étais-je pendant que designers, scientifiques, architectes, plasticiens, typographes, s’appropriaient un mode de conception et de fabrication tout droit sorti d’un roman de Philippe K. Dick ?
Dans L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, le neurologue Oliver Sacks, dépeint le cas clinique d’un jeune homme, frappé de troubles de mémoire terribles, resté « bloqué » dans les années 1940 : lorsque le médecin lui montre une image de la terre vue depuis la lune, il ne peut y croire et lui répond : « vous plaisantez docteur ! Il aurait fallu apporter un appareil photo là-haut ! ». La nouvelle exposition du centre Pompidou donne le sentiment d’être dans la peau de ce patient : si l’on se pensait confronté à un avenir à peine imaginable, il faut accepter que celui-ci est déjà en cours !
N.D.
#CentrePompidou
#nouvellestechnologies
#design
Imprimer le monde, Galerie 4 Centre Pompidou,
5 mars 2017-19 juin 2017
Le site de l’exposition https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEo9Br4/rAo9oKd

Communiquer à la Cité des Enfants
La Cité des Enfants de Paris-La Villette est un espace conçu spécialement pour les enfants mais aussi pour leurs familles. Divisée en deux, une partie est dédiée aux 2-7 ans et une autre aux 5-12 ans. Cet article repose sur une des thématiques de la Cité des 5-12 ans, la communication, outil indispensable au développement de l’enfant.
Communiquer, c’est entrer en relation et échanger avec les autres ; une aptitude importante pour pouvoir vivre avec eux. La communication repose sous des mots, des gestes mais aussi des images grâce au téléphone, à internet, à la télévision et à la radio mais elle passe aussi par le langage et l’écriture. De plus, la maîtrise du langage est fondamentale pour structurer la pensée.
Fan de manipulations et d’outils pédagogiques, je me suis prise au jeu et je vous communique mon expérience.
Vivre Ensemble jusqu’au bout de la planète
Dans cet îlot, l’enfant est invité à voyager et à découvrir le monde et les différentes cultures de la planète grâce au langage et notamment à trois outils.

"Les "bonjour" du monde", © Ludivine Perard
● « Écris en chinois » et « Écris en arabe » : après avoir observé le tracé d’un mot, l’enfant s’entraîne à le reproduire trait par trait avec le doigt en s’aidant d’un modèle sur un écran tactile. L’enfant écrit “maison” en chinois ou en arabe et en apprend plus sur ces deux alphabets.
L’enfant entre ainsi en contact avec deux sociétés différentes et y découvre la richesse culturelle. Ces outils permettent de provoquer un plaisir esthétique lié à l’écriture et de comprendre qu’apprendre une langue demande du temps.
Jouer avec les mots
Dans une autre partie de cet îlot, l’enfant apprend à raisonner et à trier, classer, hiérarchiser des informations pour se poser les bonnes questions comme pour un quiz ou des devinettes.
● « Le quiz des mots » : ce jeu est équipé d’un écran de télévision et de quatre postes avec des boutons A, B, C. Il se joue soit tout seul ou soit à plusieurs. L’objectif est de découvrir ce que signifient plusieurs expressions données par deux protagonistes, un chat et un cochon. La France regorge d’expressions « à dormir debout » mais que signifient-elles ? A votre avis, que signifie avoir le coup de foudre ?
o A : Recevoir la foudre sur la tête
o B : Frapper du poing aussi fort que la foudre
o C : Tomber fou amoureux au premier regard
Alors vous avez trouvé ? Et oui, c’était la réponse C.
Ainsi à la manière des quiz télévisés, l’enfant découvre le sens des expressions.

"Qui suis-je", © Ludivine Perard
Communiquer avec autrui
L’enfant apprend aussi à communiquer autrement qu’avec les nouvelles technologies – en chuchotant, en langue des signes, en dialoguant – pour comprendre et se faire comprendre auprès des autres.

"Parle avec les mains", © Ludivine Perard
● « Se coordonner » : les joueurs doivent ici faire monter à deux une boule le long d’un plan incliné percé de trous à éviter. Cette boule est posée sur une petite nacelle suspendue par deux ficelles de chaque côté. Chaque joueur doit tirer l’une des deux ficelles. Ils doivent communiquer pour se coordonner et arriver à monter ensemble la boule au sommet. Ce dispositif est doublé en recto/verso pour permettre à plusieurs joueurs d’y participer. Cet outil a pour but d’apprendre à l’enfant à communiquer avec l’autre pour se mettre d’accord sur la réussite d’une tâche. Il lui apprend également du vocabulaire dans le champ lexical de la spatialisation et met les joueurs dans une situation ludique où l’enfant gagne avec l’autre.
 ● « Les tubes à paroles » : ce dispositif est composé de cinq grands tubes colorés qui servent à communiquer à distance, deux par deux. Le même tuyau sert à la fois à écouter et à parler avec son interlocuteur. L’objectif est de trouver un rythme commun pour réussir à communiquer car pour entendre et comprendre son interlocuteur, il faut alterner parole et écoute, et parler chacun son tour tout en chuchotant.
● « Les tubes à paroles » : ce dispositif est composé de cinq grands tubes colorés qui servent à communiquer à distance, deux par deux. Le même tuyau sert à la fois à écouter et à parler avec son interlocuteur. L’objectif est de trouver un rythme commun pour réussir à communiquer car pour entendre et comprendre son interlocuteur, il faut alterner parole et écoute, et parler chacun son tour tout en chuchotant.
"Les tubes à paroles", © Ludivine Perard
● « Paroles et paraboles » : deux grandes paraboles se font face dans cet espace, une à chaque bout de la pièce. Dans ce jeu, il n’est pas nécessaire d’hurler pour se faire entendre, il suffit à l’enfant de chuchoter pour que son interlocuteur l’entende. Un pavillon enforme de parabole permet de concentrer la voix pour la transmettre sur une longue distance. L’enfant expérimente la transmission du son dans l’espace et ainsi identifie mieux les rôles d’émetteur et de récepteur dans un message. Il y découvre même les propriétés d’une parabole et comprend comment celle-ci concentre une onde sonore.
Un dernier message
Si vous voulez en savoir plus sur la communication, n’attendez pas et emmenez vos enfants à la Cité des Enfants !
Ludivine Perard
Pour en savoir plus :
Adresse :
Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris01 40 05 70 00
#sciences#enfants#outils

Corps et en corps: l'enfant visiteur au Petit forum!
Le Forum départemental des Sciences, à Villeneuve d’Ascq, accueille sa nouvelle exposition-création « Corps et en corps » dans son espace dédié aux 2-7 ans le Petit forum. Exposition sur le corps, le mouvement, la danse… Alors prêts à bouger ? Mais au fait, comment ça bouge un corps ? Peut-on contrôler ses mouvements, voire composer avec ? L’exposition « Corps et en corps » invite les enfants visiteurs à prendre conscience de leurs corps et de leurs mouvements : un premier pas vers la danse.
Entrée dans une ambiance sombre, la lumière et les sons des modules d’exposition dansent dans l’espace, des ombres se créent : le mouvement est déjà présent.
Suivons le petit Théo : à lui de bouger, de mettre son corps en mouvement !
Viens danser avec moi !
“Le chef d’orchestre” © C.D.
“Viens danser avec moi !” © C.D.
« Chaussette ! Chaussette ! Chaussette, chaussette, chaussette ! ». Le regard se pose sur un écran à taille humaine, des danseurs s’y succèdent et invitent Théo à imiter leurs mouvements, leurs corps. Les indications sont simples et imagées : « chaussette » = descendre ses mains vers ses chevilles, comme pour enfiler des chaussettes. Pas de musique, les voix et respirations des danseurs donnent le rythme. Ce premier module sur l'imitation du mouvement dansé permet au petit Théo de reproduire des gestes et commencer à prendre conscience de son corps.
Miroir virtuel
“Le miroir virtuel” © C.D.
« Je t’envoie une balle, rattrape là ! ». « Miroir miroir, dis-moi qui envoie le plus de balles ? ». Est-ce vraiment moi, ce reflet « virtuel » ? Grand écran, les corps se transforment. L’image des corps devant cet écran miroir n’est pas habituelle. Les corps sont filaires, colorés, pixelisés. Surprise : quand les corps se mettent en mouvement des reflets virtuels projettent des ronds de lumière. Ces ronds deviennent un jeu pour Théo et ses amis : bouger réellement pour s’amuser à se lancer des balles virtuellement. Théo comprend que les mouvements de son corps peuvent provoquer des choses : une interprétation (ici les ronds de lumières deviennent des balles), un souvenir, une émotion...
Ombres imaginaires
“Les ombres imaginaires” © C.D.
« Oh les grandes oreilles ! ». « Quel est ton animal totem ? ». Le petit Théo découvre son ombre chinoise, ou plutôt ombre animale. En se plaçant devant un spectre de lumière, l'ombre de Théo est habillée d’oreilles de lapin, de bois de cerf, de cornes de taureau… L'ombre en mouvement déclenche l'imaginaire. Les corps se mettent alors à bouger comme l’animal qui est représenté. On peut s'inspirer de tout pour bouger et créer un univers, les petits rats de l’opéra aiment les sauts de chat ! Théo lui saute comme un lapin. Toujours dans l’imitation mais cette fois sans modèle, juste d’après son observation antérieure de l’animal.
Chef d’orchestre
“Le chef d’orchestre” © C.D.
Bruits dignes de R2D2. Sons, couleurs, lumière : c’est tout un monde de mouvements sous ce dôme. Théo place sa main au-dessus d’un socle qui capte les mouvements de sa main, et uniquement sa main. La main vers le haut c’est un son de plus en plus aigu et des lumières vertes. En allant de gauche à droite les sons sont futuristes et les lumières jaunes et bleues suivent les mouvements de la main dans le dôme. Il y a beaucoup de possibilités pour déclencher des sons, couleurs et lumières. Théo peut composer avec ses mouvements tel un chef d’orchestre pour mettre en mouvement son petit univers sous ce dôme.
L'exposition « Corps et en corps » est visible au Forum départemental des Sciences à Villeneuve d'Ascq jusqu'au 8 mars 2020.
Exposition-création conçue et réalisée par le Forum départemental des Sciences (conception scientifique) et la Compagnie Les Blouses Bleues (conception artistique).
Plus d'information sur :http://www.forumdepartementaldessciences.fr/exposition-petit/corps-et-en-corps/
C.D.
#enfants
#sciences
#exposition
Cure de jouvence pour le musée de l'Institut Pasteur
“Savoir s'étonner à propos est le premier pas fait sur la route de la découverte.” Louis Pasteur
S’étonner ? C’est ce qui s’est passé lorsque je suis rentrée dans le nouveau musée de l’Institut Pasteur de Lille, sujet portant très éloigné de mes goûts en matière de musée, j’ai été accrochée au propos grâce à la scénographie et à la médiation numérique.
Dans les anciens appartements du professeur Albert Calmette nous entrons dans l’histoire de Lille et de la découverte des vaccins. A l’origine : une épidémie de diphtérie se répandant dans le quartier de St Sauveur en 1894, le maire de Lille débordée par le phénomène entend parler du sérum antidiphtérique crée par Pasteur à Paris. Le maire décide donc d’y aller pour demander de l’aide, résultat ? La création de l’Institut Pasteur de Lille avec à sa tête le docteur Albert Calmette.
Pièce principale du musée © Site internet
La nouvelle scénographie du musée a été réalisée par Les yeux d’Argos à la clé, une ambiance chaleureuse et notamment de nouveaux dispositifs multimédia afin de mieux appréhender les maladies, les virus et leurs vaccins.
Les dispositifs de médiation se présentent sous forme d’objets du XIXème siècle : tableaux, miroir à main…etc. Ils permettent par exemple sur les tableaux d’avoir accès à une petite vidéo animée présentant la vie du Professeur Calmette en noir et blanc, animation créée à partir de photos d’époques. Cette méthode permet de vulgariser la compréhension de la création des différents remèdes ou vaccins de l’époque et de pouvoir s’adresser à un public d’enfants ou d’adolescents grâce à quelques touches d’humour.
Autres systèmes mis en place pour rendre le visiteur acteur de sa visite : les combinés téléphoniques qui permettent d’écouter un petit discours sur la pasteurisation et comme un magicien à travers sa boule de cristal de regarder les images qui apparaissent au fond d’un ballon à fond plat en verre.
Dispositif audio © MP
Comme la science se comprend en pratiquant, des tablettes interactives sous forme de miroirs ont été mises en place : les visiteurs déplacent leur tablettes face aux photos accrochées sur le mur et jouent à différents petits jeux autour des bactéries pour permettre aux plus jeunes de comprendre où se trouvent les microbes et mettre en application les conseils de Pasteur.
Tablette numérique © MP
Les yeux d’Argos ont donc mis en place ici une scénographie à la fois participative et contemporaine en mélangeant des expôts de l’époque comme les premières souches de tuberculose (vaccins BCG découvert par Calmette et Guérin), le mobilier d’origine et des dispositifs multimédia.
Enfin une dernière pièce cachée par un rideau présente une scénographie beaucoup plus contemporaine sur les outils et les recherches actuelles de l’institut Pasteur sensibilisant le public notamment aux enjeux de la maladie d’Alzheimer.
La nouvelle version du musée de l’institut pasteur de Lille présente un regard neuf sur la vie, le combat du docteur Calmette et du docteur Pasteur. La science est vulgarisée, mise à la portée de tous, sujet apprécié des expositions ; elle a le vent en poupe. Le regain d’intérêt pour Louis Pasteur se manifeste et par la réouverture de ce musée et par une prochaine exposition au Palais de la découverte qui lui sera consacrée en 2018. Levez de rideau le 12 décembre 2017 !
M. P.
#médiation#scénographie#interactive
Pour en savoir plus :
Dans la peau d'un astronaute
Cet après-midi, nous nous sommes lancées à la conquête de l'espace. N'étant pas de grandes scientifiques, il nous a été conseillé de stimuler nos neurones à la Cité de l'Espace à Toulouse.
Reproduction de la fusée Ariane 5 dans le parc de la Cité de l’Espace, © N. V.
Autant vous dire que nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre... Allions-nous assister à un remake de "C'est pas sorcier" ? Pas vraiment ! Le site internet de la Cité de l’Espace nous promet déjà un beau voyage, chacune des informations invite le visiteur à vivre une expérience inédite. « L’espace comme si vous y étiez », « découvrir la cité », « partir à la découverte de l’espace et des merveilles de l’Univers n’a jamais été aussi faciles », « vivez l’expérience », autant de promesses qui ont éveillé une grande curiosité et l’envie de découvrir ce lieu si particulier.
Une invitation à l’émerveillement certainement, mais pas seulement. En ce lieu inattendu, le visiteur est maître de son expérience, il vit sa visite de la même façon qu’un astronaute s’investit dans une conquête spatiale. La muséographie du site y est par ailleurs propice. Le propos de la Cité de l’Espace est d’envoyer le visiteur dans cet environnement qu’il ne connaît pas, bien qu’il en ait peut-être souvent rêvé. Ainsi, le corps est mis en mouvement, le visiteur devient acteur, ses gestes engendrent une réflexion autour de divers aspects scientifiques. C’est grâce à des manips que ce lieu prend vie et qu’il immerge le visiteur dans un environnement qui lui était jusqu’alors inconnu. Nous avons rapidement compris que la place du visiteur était au cœur de la réflexion des créateurs de la Cité de l’Espace et que celui-ci se prend au jeu des manips et de la découverte dès lors qu’il veut tirer bénéfice de cette expérience.
Manip sous forme de rangements © N. V.
Replacer ce lieu dans son contexte semble nécessaire pour comprendre les enjeux et les motivations qui ont engendré sa création. Toulouse, berceau de l’aéronautique et de l’espace, à la pointe du secteur de la recherche, celui de l’innovation et de l’industrie aérospatiale ; quel meilleur lieu pour y implanter la Cité de l’Espace ? Le projet a donc été lancé par la ville rose en 1997, avec l’objectif de construire un parc à thème scientifique orienté vers l’espace et la conquête spatiale. Et c’est certainement cet engouement pour l’aventure, et surtout le partage de savoirs scientifiques qui a poussé l’équipe du musée à faire du lieu l’un des sites touristiques incontournables de Toulouse. Nous avons d’ailleurs constaté ce phénomène dès l’entrée du parc, avec une légère appréhension quant à la tournure que pourrait prendre notre visite.
Beaucoup d’éléments tiennent d’une inspiration venue de l’univers du parc d’attraction. A commencer par le nom, « la Cité de l’Espace » qui nous pousserait presque à nous imaginer dans le nouveau volet de la saga Star Wars. Une musique futuriste nous suit dans notre visite. Le tarif est relativement élevé, 25 euros, soit le prix d’une entrée dans certains parcs. Malgré ce tarif, le public est très familial. Il s’agit à l’évidence d’un public ciblé par les membres de la Cité de l’Espace, qui ont souhaité créer un espace enfant, ouvert en 2006. Peu nous importait, curieuses, nous avons décidé d’y aller coûte que coûte. Nous avons rapidement déchanté face à certaines activités, qui, bien qu’étant attrayantes nous auraient fait perdre un long moment dans la queue de visiteurs. Là encore, la dimension d’animation que prend la visite ferait penser à un parc d’attraction. Sans compter la boutique du site qui nous invite à acheter une infinité de gadgets et parfois même des produits régionaux !
Produits régionaux dans la boutique du musée © N. V.
Arrêtons de « rouméguer », comme diraient nos amis toulousains ! La Cité de l’Espace, c’est avant tout un projet qui place l’expérience de visite et la découverte du monde spatiale au cœur de la réflexion. Le jeu est bel est bien au service d’un apprentissage et d’une immersion. Là encore, il ne dépend que du visiteur d’accéder à cette dimension bien plus enrichissante.
Parlons-en d’ailleurs. Nous avons été agréablement surprises par la qualité des manips, qui ne se contentent pas de nous faire faire des acrobaties parfois déroutantes, mais dévoilent en réalité un contenu et un discours enrichissants. Nous les avons quasiment toutes faites, et nous avons retenu beaucoup d’anecdotes, des faits, et d’autres informations. De fait, le visiteur doit réellement jouer le jeu pour entrer dans l’immersion totale ; c’est une forme de pacte tacite qui semet en place dès l’entrée du site. Les manips sont instinctives et bien expliquées, utiles à condition bien sûr que le visiteur les expérimente. Nous apprenons et voyageons donc grâce à notre implication.
Maintenant que nous vous avons bien mis l'eau à la bouche, entrons plus précisément dans le vif du sujet. Comment faire du visiteur un explorateur ? Nous en avons fait l’expérience ! Rappelons tout d'abord que le musée ne dispose que de très peu d'objets de collections. Seuls quelques fragments (lunaires par exemple) sont présentés, avec les codes traditionnels de la mise en valeur des objets précieux (vitrines, loupes pour observer les détails, cartels, etc.).
Toutefois, comme pour tous les musées scientifiques, la plupart des expositions sont constituées de contenus audiovisuels et de manips. Bon nombre d'entre elles appellent le visiteur à changer sa posture, à se mouvoir. En nous allongeant dans une pièce qui a perturbé nos sens, ou en regardant la télévision à l'envers, nous n'avons pas eu simplement l'impression de nous comporter comme de grands enfants : nous avons expérimenté la désorientation que l'on peut ressentir dans l'espace, en apesanteur. Nos sens sont en émois, la tête tourne légèrement... L'immersion sensorielle est véritablement au service d'un contenu scientifique.
Salle avec perspective renversée et télévision à regarder la tête en bas, © N. V.
Et il en va de même pour les différents jeux proposés. Seul ou en équipe (par deux essentiellement), des dispositifs ludiques proposent des défis à relever. Certains restent de l'ordre de l'amusement : dans la salle consacrée à la lune par exemple, nous devons piloter une jeep sur la lune à l'aide d'un joystick afin de rejoindre notre base. Il s’agit d’un dispositif très intuitif. Mise à part la possibilité d'explorer la topographie de la lune, aucun véritable contenu scientifique ne nous est donné. Ce type d'installations permet toutefois d'apporter une respiration entre plusieurs jeux ou manips qui demandent toute l'attention et la réflexion des visiteurs.
Dans les différentes missions sont proposées - retrouver le signal d’un satellite par exemple - les dimensions tant interactives que ludiques, collaboratives et réflexives sont grandement appréciables. Au fur et à mesure de la visite, nous nous sommes rendues compte que nous devenions exigeantes vis-à-vis de la qualité des manips : celles qui sont un peu moins originales finissent par ne plus attirer notre attention. On ne se “contente” plus de regarder une vidéo passivement. La Cité de l'Espace a donc placé la barre très haut !
Quoi de plus efficace pour rendre le visiteur acteur que de l'amener à se mettre en scène ? Nous avons pu sauter sur la Lune ! En nous allongeant sur un dispositif sur roulettes et en poussant sur nos jambes, la projection de notre image sur un décor lunaire donnait l'impression que nous faisions des bonds dans l'espace ! Nous nous sommes glissées dans la peau d'une présentatrice météo ! L'une de nous a lu un prompteur en montrant la carte de France, pendant que l'autre a tenu le rôle du caméraman. A notre grande surprise, notre « performance » a ensuite été projetée sur un écran à l'extérieur de la cabine de tournage. Le temps d'un instant, nous sommes devenues astronaute, présentatrice ou caméraman, et nous avons beaucoup apprécié nous laisser prendre à ce jeu de rôle.
Saut sur la Lune et Diffusion de l’enregistrement d’une présentation de la météo réalisé dans un studio mis à disposition des visiteurs, © N. V.
En règle générale, la scénographie et le graphisme participent à l'immersion en faisant oublier au visiteur le monde réel pour entrer dans un univers nouveau créé de toutes pièces. Ici, la scénographie est assez neutre : le gris métallique, certaines portes rappelant l'univers de Star Wars, etc. Quelques éléments plus “créatifs” rythment toutefois l’espace : c’est le cas par exemple des nuages en tissu sur lesquels étaient projetés des lumières de couleurs différentes, au sein de l’espace “météo”. La charte graphique est très cohérente, et, étant donné la multiplicité des éléments qui attirent l’œil du visiteur (vidéos, manips,etc.), le choix de cette scénographie est simple et efficace.
Nuages colorés dans la salle de la météo, © A. E.
Comme le sous-entend le nom de « parc à thème scientifique », toute une partie de la visite se poursuit dans un parc. Nous étions ravies de pouvoir ainsi profiter du soleil du Sud-Ouest. Le cadre agréable du parc et le format de la promenade n'empêchent en rien le sérieux de la démarche. Du contenu scientifique est à notre disposition dans toute la partie extérieure. Par exemple, le « parcours des planètes » nous apporte, par l'intermédiaire de bornes, des informations sur les différentes planètes de notre système solaire. Mieux encore, l'espacement entre ces bornes correspond – à échelle humaine – à celui qu'il y a entre les différentes planètes ! Nous avons également pu découvrir la station MIR. Des mannequins astronautes sens dessus-dessous nous ont accompagnées au cours de cette visite ! Immersion donc cette fois au sein d'un modèle d'essai de la célèbre station spatiale russe.
Début du “Parcours des planètes” dans le parc de la Cité de l’espace, © N.V.
La volonté de la Cité de l'Espace est donc bien de faire passer un bon moment aux familles, en mettant le jeu et l’animation au service de la pédagogie. Nous avons même pu devenir l'aiguille d'un cadran solaire, et connaître l'heure sans même avoir à sortir notre téléphone portable ! Ce qui est bien utile, car nous avons eu l'impression que le temps s'arrêtait : la visite est vraiment passée vite… Un voyage donc qui a joué avec le temps… et surtout avec l’espace !
Anna E. et Noémie V.
#Citédelespace
#Toulouse
#Astronomie
#Immersion
#Manips

De la mémoire au patrimoine : les collections agricoles de la Ville de La Courneuve
La Ville de La Courneuve, située en Seine-Saint-Denis dans la très proche banlieue de l’agglomération parisienne, a engagé depuis 2019 un chantier des collections conséquent. Détentrice d’une collection agricole de plusieurs milliers d’objets issue d’un écomusée fermé depuis les années 1990, elle explore des utilisations patrimoniales non muséales pour ces dernières.
Image d’introduction : Vue de la ville de La Courneuve dans les années 1960 © Ville de La Courneuve
Raconter l’histoire du territoire
A l’aube des années 1980, la Ville de La Courneuve engage un processus de reconnaissance et de sauvegarde du patrimoine local. La constitution de ce dernier est l’occasion, pour la municipalité, de proposer une offre culturelle aux habitants mais également de mettre au point un récit de l’histoire locale dépassant les difficultés frappant le territoire, entre désindustrialisation et dégradation des immeubles de la Cité des 4 000 Logements bâtie au début des années 1960.
Ce processus se développe autour de trois thématiques : l’archéologie, le patrimoine bâti et le patrimoine rural, ce dernier témoignant des activités agricoles qui ont fait la gloire du territoire.Au milieu du XIXe siècle, La Courneuve fait, en effet, partie des trois centres principaux pourvoyant la ville de Paris en cultures maraîchères. Situé en plein cœur de la Plaine des Vertus, l’activité agricole se poursuit jusque dans les années 1960 avant de céder la place à l’urbanisation.
C’est ainsi qu’en 1981 une exposition sur l’histoire rurale du territoire est organisée à l’Hôtel de Ville afin de commémorer cet héritage. A la suite de cet évènement, des agriculteurs apportent à la direction des affaires culturelles de la Ville des objets en rapport avec leurs activités professionnelles, ce qui pousse les équipes à engranger la constitution d’une véritable collection ethnographique. En 1983, un « musée des cultures légumières » voit le jour au 11, rue de l’Abreuvoir, une ancienne maison maraichère. Ce musée se transforme progressivement en écomusée où contempler les espaces intérieurs et extérieurs d’une maison de cultivateurs avec ses mobiliers, ses outils, mais aussi des tombereaux et tarares. Cette installation, complétée par le jardin cultivé, crée un îlot de ruralité au cœur de la Ville.

Cour intérieure du musée des cultures légumières au début des années 1990 © Ville de La Courneuve
C’est l’Association Banlieue Nord, mise en place sous l’égide du Maire en 1983, qui est chargée de la gestion du musée et la valorisation de ce patrimoine courneuvien particulier. Ses membres sont notamment chargés de développer des recherches ethnologiques sur ce sujet, ce qui se traduit par un important travail de collecte de témoignages, d’archives et d’éléments patrimoniaux relatifs à l’histoire agricole courneuvienne et, plus largement, régionale, dans une approche comparative et pluridisciplinaire. Le musée rencontre, en 1992 et 1995, un certain succès, notamment auprès des publics scolaires. La mise en place du « Marché au musée », qui se tient deux fois par an sur le site, permet la découverte du musée par un public plus large.
Une impasse muséale
Le musée ferme en 1995, officiellement pour des raisons de sécurité dues au bâtiment. L’arrêt des activités muséales entraîne paradoxalement un accroissement des collections qui sont mises en réserve dans une friche industrielle, dans des conditions de conservation discutables et qui comprennent au début des années 2000 entre 6 000 et 8 000 objets. Dix ans plus tard, une nouvelle estimation indique 25 à 45 000 items. Ce volume finit par constituer une impasse, tout projet de conservation et de valorisation se trouvant contraint par cet excès d’objets.
En 2002, un audit commandé à l’entreprise Option Culture préconise la (re)création d’un structure muséale, portée par d’autres collectivités et dédiée au patrimoine rural régional. Pourtant, le Département et la Région s’opposent à ce projet, et la Ville se voit contrainte de rassembler seule les moyens humains et financiers pour concevoir un projet patrimonial cohérent, mais l’absence de lieu d’exposition limite le champ des possibles. Dès lors, il est décidé que la monstration des collections se fera hors-les-murs, et que la politique de valorisation des collections se fera par des prêts et dépôts auprès de partenaires issus ou non du champ patrimonial, à l’occasion d’expositions réalisées avec l’exposition Savez-vous planter les choux, réalisée au Parc de Bagatelle avec la Ville de Paris en 2012.

Vue de l’exposition Savez-vous planter les choux ?tenue au Parc de Bagatelles en 2012 © Ville de La Courneuve
La nécessité de libérer l’espace accueillant les collections pousse la municipalité à entériner un déménagement des collections en direction du sous-sol du Centre Culturel de la Ville. Le site présente en effet des conditions de conservation préventive satisfaisantes (température et hygrométrie stables) mais ne permet pas d’accueillir l’intégralité des collections. En 2018, la mise en place d’un chantier de déménagement est actée par la Ville, articulée à un chantier de tri. Une méthodologie est définie avec Fleur Foucher, conservatrice-restauratrice spécialisée en conservation préventive. Les éléments dont la conservation devient impossible en raison de leur état général (infestation par des insectes xylophages, corrosion, présence de champignons, etc.) sont éliminés. Cette approche sanitaire est complétée par une réduction du volume des ensembles récurrents (cagettes, sacs en toile de jute, vannerie etc.). Ce tri interroge la valeur patrimoniale de chaque objet, sa singularité, son lien avec le territoire ou son articulation avec un ensemble d’objets, un donateur-témoin, etc.

Chantier des collections en 2019, au sein de l’ancienne halle industrielle © Ville de La Courneuve
Finalement, le chantier mobilise pendant quatre mois une équipe de six spécialistes en conservation-restauration et six techniciens d’art ainsi que le chargé de projet de la Ville. Il aboutit à un inventaire de 2079 lignes d’inventaire pour un ensemble de 3575 items allant du véhicule hippomobile ou motorisé aux cloches à salades. Une restitution est réalisée en février 2020 lors du colloque annuel de l’APrévU (Association des Préventeurs Universitaires) au Mobilier National.
De nouvelles réserves pour un nouveau projet patrimonial
Mais ce chantier des collections est aussi et surtout le moyen d’envisager, au sein de la Ville, une refonte du projet patrimonial et culturel à partir d’une collection resserrée et dont la conservation est dorénavant soutenable. Le Conseil municipal valide ainsi le principe d’une « banque d’objets patrimoniaux » dans les sous-sols du Centre Culturel Jean Houdremont, prêtables à l’occasion de projets patrimoniaux mais aussi de projets de médiation au sens large. Un partenariat est notamment noué avec la Ferme ouverte de Saint-Denis, voisine du territoire et gérée par les Fermes de Gally dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Saint-Denis. Cette structure vise à faire découvrir l’agriculture d’hier, aujourd’hui et demain aux publics, et dispose d’un espace muséographique intérieur et extérieur dans lequel les collections courneuviennes sont désormais visibles par les publics de façon permanente.

Vue d’une des salles de la Ferme de Gally, où sont exposées les collections courneuviennes © Lucile Garcia Lopez
La préparation du chantier d’implantation des réserves dans les sous-sols du Centre culturel est en cours. Il s’agit désormais d’installer en 2022 et 2023 du mobilier de rangement permettant de déconditionner les collections, actuellement stockées dans des caisses en plastique et sur palettes. A partir de la fin 2022, ces réserves permettraient un travail de valorisation auprès des acteurs concernés par ces thématiques. L’intérêt de plusieurs institutions patrimoniales nationales (Institut national du patrimoine, Centre national des arts et métiers, MuCEM) et la conduite de certains projets en lien avec les collections, sont autant d’éléments témoignant de l’attachement à ces collections, susceptibles d’être mobilisées dans différents projets.Enfin ce chantier s'inscrit dans une logique plus globale incluant également les maisons maraîchères du 9 et du 11, rue de l’Abreuvoir, dont les espaces cultivables pourraient être mis à la disposition du public dans le cadre de médiations dédiées au patrimoine agricole.
Ainsi, sur ce territoire où les espaces agricoles ont disparu, les collections de La Courneuve pourraient constituer un vecteur de la transmission d’une histoire locale aux nouvelles populations courneuviennes, originaires du monde entier. A l’aune de problématiques écologiques et urbaines toujours plus pressantes, le patrimoine rural se ferait ainsi tisseur de lien social, en capacité de mobiliser les habitants du territoire dans une démarche collective autour des questionnements sur nos modèles alimentaires et économiques contemporains.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Site de la Ville de La Courneuve
- Mikaël Petitjean, « Quel projet pour quels objets ? », e-Phaïstos, IX-2 | 2021
#Patrimoine #Collections #Ethnologie

Des cailloux au musée ?
Passionnée de géologie, je m'interroge sur la capacité des expositions à partager mon enthousiasme pour les cailloux, véritables mines de savoirs.
La géologie est la science qui étudie la Terre, à la fois matériaux, phénomènes et histoire depuis sa formation il y a environ 4,6 milliards d’années. Tout autour de nous est sous-tendu par un contexte géologique, aucun environnement n’y échappe. Cette science est divisée en plusieurs disciplines, dont la pétrographie (étude des roches), la volcanologie (étude des volcans), la géochimie (étude du comportement chimique des éléments), la tectonique (étude des déformations de la partie superficielle de la Terre) ou encore la paléontologie (étude des fossiles). Les dinosaures font rêver petits et grands, ici, je vais peu parler des expositions de paléontologie !
La géologie n’est pas toujours facile d’approche. Elle nécessite souvent de nombreux prérequis, en mathématique, en chimie, en physique et parfois en biologie. Et cette difficulté d’accès se fait ressentir jusque dans les expositions. Dans les parcours permanents, beaucoup d’institutions exposent les cailloux sous vitrine, accompagnés de notions scientifiques complexes : les visiteurs observent des jolis cailloux. Il n’y a peu, voire pas d’interactif ni de vulgarisation ou de mise en contexte. Comme si ces roches et minéraux inertes n’avaient ni passé, ni présent, ni futur. Ces salles permanentes ont, pour certaines, été faites par et pour des géologues, comme le musée minéralogique de Strasbourg ou musée de Minéralogie Mines ParisTech.

Et si les expositions et la géologie ne sont tout simplement pas compatibles ?
Je me demande pourquoi la géologie intéresse aussi peu, outre sa complexité. Une évidence : un caillou ça ne bouge pas. Beaucoup de géologues pense que la principale raison est là et Patrick De Wever le résume très bien dans sa MiniConf Géole n°6 - P. De Wever - Faire aimer les histoires racontées par les cailloux.
Il semble que pour rendre attractif cette science, il faut savoir la vulgariser et être capable de faire bouger les cailloux, en somme, raconter des histoires, les rendre vivants. De mon point de vue, j’ajoute qu’une exposition de géologie doit être tactile, avoir de l’humour et remettre dans le contexte : la géologie est partout autour de nous, elle nous concerne tous. Cette recette ne relève pas d’une véritable mission impossible car les exemples ne manquent pas.
Le Naturalis Biodiversity Center à Leiden (Pays-Bas) est un centre scientifique particulièrement intéressant notamment pour son exposition permanente « Earth ». Elle expose les conséquences des mouvements des plaques tectoniques. Sur fond de voyage autour du monde, la scénographie est innovante et immersive : une salle est coupée en 4 zones géographiques, Hawaii avec ses volcans, le Japon avec ses tremblements de terre, le Brésil avec une carrière et l’Islande avec son rift continental.
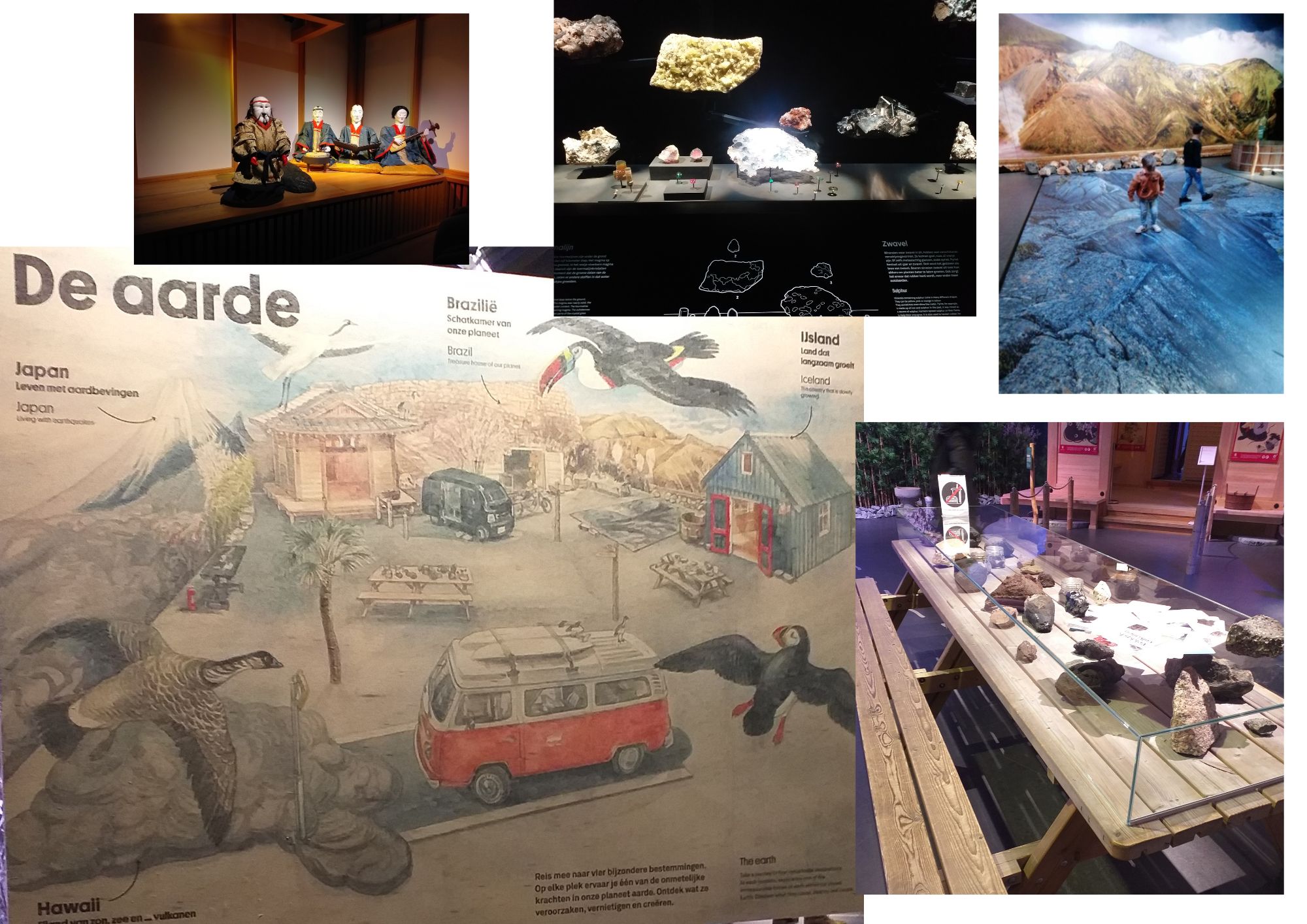
Photos de l’exposition permanente « Earth » du Naturalis Biodiversity Center à Leiden (Pays-Bas) dont un plan illustré de la salle. ©MT
Côté muséographie, le public apprend en manipulant. Il a la possibilité d’assister à une pièce de théâtre humoristique, de monter sur une plateforme reproduisant les sensations d’un tremblement de terre, de toucher des roches volcaniques assis à une table de pique-nique, d’admirer des minéraux sous un superbe éclairage dans une grotte plongée dans le noir. Il existe aussi des animations avec un médiateur, liste non exhaustive.
Autre exemple : le début de l’exposition permanente « Le grand récit de l’Univers » de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris est consacré à la géologie. Malgré une scénographie vieillissante et quelques médiations cassées ou désactivées, les manipulations et l’espace sont bien pensés. Un dispositif a retenu mon attention : quand le visiteur touche le caillou, il commence à raconter son histoire et sa formation, simple et efficace.

Dispositif « parole de basalte » à la Cité de Science et de l’Industrie de Paris, dans l’exposition permanente « le grand récit de l’Univers ». ©MT
Petit détour par une exposition de paléontologie au Tellus Science Museum de Cartersville en Georgia (Etats-Unis) : le visiteur est invité à toucher une roche, à côté un cartel Touch this if you dare ! then lift (touche-moi si tu l’oses ! puis soulève). Quand le visiteur soulève, il apprend qu’il vient de toucher un coprolithe, un caca fossilisé !
Un dernier exemple me permet d’évoquer un sujet important en géologie : le terrain. Pour comprendre la Terre, il faut l’observer et aller dehors. Et c’est ce que propose l’Association Ally Action 2000, où j’ai pu animer l’atelier de recherche de minéraux dans la mine de la Rodde. Le visiteur se glisse dans la peau d’un géologue et, à l’aide d’outils, va observer et essayer d’identifier des minéraux. Petits et grands prennent un grand plaisir à découvrir les cailloux sous un nouveau jour !

Atelier de recherche de minéraux dans la mine de la Rodde par l’Association Action Ally 2000 ©Aurane LUCAS
Comme nos exemples le montrent, si les bons outils sont utilisés, je suis persuadée que la géologie est accessible au plus grand nombre. Cette science nous concerne tous puisque nous marchons sur la Terre, sur des cailloux. Dans nos téléphones (lithium), nos voitures (silice), nos maisons (le béton et les vitres sont composés de sable), notre quotidien (dans notre alimentation, le fer, le calcium …), la géologie est partout et indispensable. Et les expositions ont leur rôle à jouer dans la vulgarisation de la géologie !
Mélanie Terrière
#géologie #exposition #cailloux

Entre lac, montagne… et glace ?
Comment ne pas ressentir l’attirance magnétique d’une visite au musée, lors des journées pluvieuses dont Mai a le secret ?
Et c’est bien de magnétisme dont il s’agit à Neuchâtel, puisque le Muséum d’histoire naturelle présente l’exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au mois d’août 2019. Alors hâtez-vous, avant qu’elle ne disparaisse au profit de la chaleur de l’été.
L’exposition « iceberg »
Cette exposition temporaire est construite à juste titre comme un iceberg, puisqu’elle invite le visiteur à acquérir les connaissances de base sur les pôles Nord et Sud, notamment ses saisons, ses paysages et sa faune… (D’ailleurs, savez-vous qui de l’ours polaire ou du manchot vit au pôle Nord ? [Réponse à la fin de l’article]) Mais le plus intéressant est bien sûr de découvrir la partie immergée et parfois effrayante de cet iceberg, ayant trait au climat et à la fonte des glaces.
Le sujet est saisi en croisant la biologie, l’ethnologie, l’astronomie, la climatologie, la photographie… Et bien sûr la glaciologie puisque l’exposition a pour parrain Claude Lorius, explorateur et glaciologue des pôles dont les voyages en Antarctique ont inspiré la conception de Pôles.
Une seconde figure notoire, Luc Jacquet, nous propose une immersion dans cet univers glacial, grâce à ses prises de vues époustouflantes. Ce cinéaste documentariste est connu pour son film La Marche de l’Empereur sorti en 2005. Il invite le visiteur à plonger dans le quotidien des manchots au travers d’une projection qui fait littéralement froid dans le dos. « Comment ces oiseaux parviennent-ils à survivre dans ce froid extrême ? » est la question que tout un chacun se pose. Les températures pouvant chuter jusqu’à -50 degrés, les manchots ont développé une technique dite de la « tortue ». Usant de leur chaleur corporelle, ils forment une carapace dense de corps qui les protègent du froid. La température intérieure de la tortue polaire pouvant atteindre les +40 degrés, les manchots ont donc même souvent… trop chauds ! Pour y remédier, ils échangent régulièrement les rôles, exposant tour à tour leur dos au froid.

Ardemment glacial – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel © Luc Jacquet
Homo frigoris
Les capacités extraordinaires des manchots, bœufs musqués, phoques et autres espèces de la faune locale qui survivent dans des conditions extrêmes ont grandement inspiré l’animal que nous sommes, Homo sapiens, à faire de même. A bord d’un cargo chargé de ravitailler les villages côtiers, on découvre les conditions de vie des Inuits, très loin des clichés. Ils se fournissent en bibliothèque Billy chez Ikea, alimentent leur story Instagram, et promènent leurs bambins, pas très différemment de nous finalement. Les photographies exposées de l’ethnologue Philippe Geslin apportent un regard frais et contemporain sur ces populations.

Roues et neige © Philippe Geslin
Tout au long de notre pérégrination, l’immersion est de mise. La scénographie épurée suggère les étendues désertes des pôles et les sons et bruits d’ambiance nous rappellent qu’il y a néanmoins de la vie. Au milieu du vent glacé qui fouette l’air, des manchots braient et accompagnent notre avancée. Cette attention portée à l’auditif est une agréable surprise lorsque certaines expositions relèguent trop facilement les bruits au rang d’accessoire, voire de nuisance. Un petit jeu plus visuel contribue aussi à l’expérience du visiteur puisqu’il peut incarner un Inuit vêtu d’une panoplie en peaux, ou un scientifique dans sa tenue molletonnée orange, au moyen d’une caméra à détection de mouvement. Les photos peuvent ensuite être retrouvées sur le site du Muséum, une bonne idée de souvenir à retrouver chez soi !

Deux scientifiques en anorak orange – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
Outre l’aspect récréatif, ce jeu nous apprend qu’en plus des populations locales, il ne faut pas oublier que les scientifiques séjournent aussi aux pôles. Cela ne signifie pas qu’ils cohabitent pour autant. Les Inuits vivent au pôle Nord, dans la région arctique et les scientifiques mènent leurs recherches sur les deux pôles, y compris en Antarctique, au pôle Sud, continent le plus froid et venteux de la Terre, où il n’y a pas de populations établies. C’est dans cette région hostile que les scientifiques réalisent l’extraction de carottes de glace. Au fil des siècles, et consécutif aux chutes de neiges successives, des couches de glace se forment au sol. Plus la carotte est longue, plus l’on remonte le temps et il est possible d’obtenir des informations sur les conditions climatiques et les composés chimiques de l’air dans le passé. Claude Lorius est le précurseur de ce champ d’étude puisque c’est en 1965, en observant les bulles d’air emprisonnées dans les glaçons de son whisky, qu’il a émis l’hypothèse qu’elles contenaient des informations sur le taux de méthane et de dioxyde de carbone des siècles passés. A partir des données récoltées, il est possible de comparer les taux de CO² en ppm (partie par millions) du dernier millénaire. La tension monte, le thermomètre aussi. Alors que pendant 1000 ans, le taux était stabilisé autour de 280 ppm, la révolution industrielle a vu une brusque augmentation du taux atteignant les 408 ppm, ce qui représente une hausse de la température de 1°C.
Maintenant ou jamais
L’exposition prend alors un tournant beaucoup plus sérieux et nous emmène dans une salle à l’atmosphère si pesante qu’elle ferait fuir un climato-sceptique. Le tic-tac de l’horloge se fait oppressant et de plus en plus rapide, les lumières clignotent, autant de signes annonciateurs de l’effondrement. L’emphase est mise sur le temps, et l’on comprend qu’il est compté. L’Homme peut se targuer d’exercer des pressions si fortes sur l’environnement qu’il a fait rentrer l’humanité dans une nouvelle ère qui porte son nom : l’Anthropocène. Elle se caractérise par l’impact des activités humaines sur la planète, constituant une véritable force globale à l’origine de catastrophes naturelles, de l’extinction de centaines de milliers d’espèces et de l’épuisement des ressources.
« C’est une triste chose de penser que la nature parle
mais que le genre humain ne l’écoute pas. » Victor Hugo
On trouve dans les interstices des murs quelques regains d’espoir ; baisse de la consommation de viande en Suède, plusieurs millions de tonnes de matériaux recyclés en France, création de smartphones éthiques et écologiques. Mais l’imminence d’une catastrophe écologique sans précédent reste un sujet un peu délicat, et le ton employé est déterminant. Le second degré est un choix audacieux qui fonctionne ici très bien. Le faire-part de décès de la glace permet de lui dire un dernier adieu, ses maigres restes reposant dans une boite en velours. La vidéo du cornet de glace fondu diffusé sur l’écran n’est pas sans provoquer du dégoût chez les visiteurs ou un sourire navré lorsqu’ils comprennent la métaphore.

Feu la glace – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
La dernière salle enfin donne la parole aux citoyens grâce à une grande campagne lancée par le musée à son réseau.
« Les glaces de l’Antarctique, qui ont conservé dans leurs strates la mémoire de l’environnement de notre planète au fil des millénaires, nous envoient un message d’alerte : les conditions de vie se détériorent et toucheront de plein fouet nos enfants et leurs descendants. Ainsi, les glaces portent en elles l’histoire de notre climat et donc notre destin. Les Pôles sont un des biens les plus précieux que la nature nous ait légués. Notre devoir est de préserver cet héritage. »
A partir de cette citation de Claude Lorius, une centaine de personnes ont été invitées à réagir et envoyer leurs témoignages sous la forme de leur choix. Ainsi, textes, photographies, dessins et vidéos constituent le manifeste poignant de l’humanité aux Pôles.
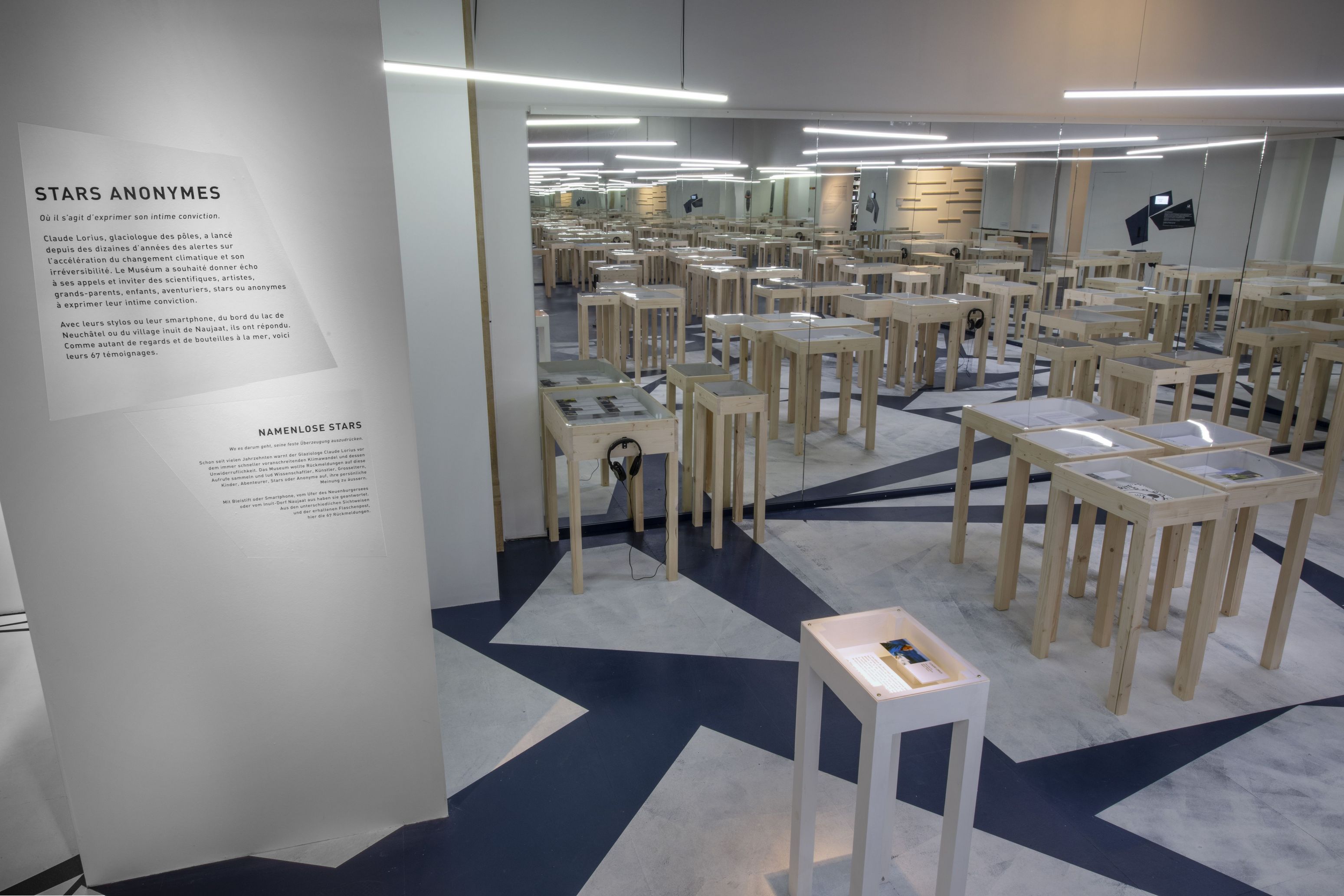
Stars anonymes – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
Ne finissez pas la visite sans faire l’expérience de l’installation sonore immersive de Luc Jacquet, dont on ressort troublé, effrayé ou carrément en pleurs. Plongé dans le noir, sans autre sens que l’ouïe, vous allez vivre la rupture fracassante d’un glacier comme si vous y étiez…
C’est ainsi que l’exposition se conclut et le visiteur attentif pourra remarquer avant sa sortie la projection d’un ours polaire sur un tissu blanc. N’est-ce pas là le drapeau brandi appelant à une trêve ?
(Et pssst ! L’ours polaire vit au Nord et les manchots au Sud.)
Laurie Crozet

Espèces d'Ours !
« Espèces d’Ours » est l’exposition actuelle du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, ouverte jusqu’en juin 2017. Elle est adaptée de l’exposition « Ours, mythes et réalités » réalisée par le Muséum de Toulouse en 2013 et 2014. De par son thème et sa muséographie elle est susceptible d’attirer un vaste public. Cette exposition plonge le visiteur dans le monde des ours et permet d’en apprendre plus sur eux et sur leurs relations avec les hommes à travers les différentes époques. Elle sensibilise également les publics sur le danger d’extinction de certaines de ces espèces.
Vue du plateau central © Océane Caby
La première information qu’obtient rapidement le visiteur c’est qu’il existe huit espèces différentes d’ours, ce qui décloisonnent les représentations populaires dès le début du parcours en nous présentant des spécimens bien moins connus que l’ours brun ou l’ours blanc. Une rotonde accueille ainsi le public avec les huit espèces d’ours existantes naturalisées devant des images de leurs habitats naturels.
Le parcours de l’exposition est composé de cinq espaces portant chacun sur une thématique précise. Le premier présente les ours, leurs habitats naturels et leurscaractéristiques physiques à l’aide de manipulations. Le visiteur poursuit ensuite en découvrant les origines des ours modernes et leurs ancêtres. Le troisième espace, plus sociologique, évoque les rapports entre les hommes et les ours selon les époques. Vient ensuite la question de l’avenir des ours. Enfin l’exposition se termine sur un espace plus restreint que les précédents où le muséum dévoile à travers des photos, des œuvres et des spécimens naturalisés, des célèbres ours des collections du musée datant du XIXème et du XXème siècle. A la sortie de cette exposition temporaire, des plans « Parc’Ours » sont mis à la disposition des publics, les invitant ainsi à prolonger la visite à travers le Jardin des Plantes pour découvrir d’autres représentations d’ours.
La force de cette exposition est son aspect ludique. A travers le parcours beaucoup de manipulations, d’audiovisuels et de numériques sont à la disposition des visiteurs. De nombreux enfants se trouvent parmi eux et leur curiosité est assouvie grâce à tous ces dispositifs qui permettent de vivre l’expérience de visite autrement. Cependant pour un public plus averti, la question du contenu scientifique se pose. En effet, au vu de visiteurs de plus en plus en demande d’expériences au travers des expositions, les textes ne sont-ils pas trop simplifiés au profit des dispositifs multimédias ? Ce parti pris de rendre l’exposition la plus ludique possible a sans doute pour but d’attirer un jeune public et un public familial, et le pari est très certainement réussi, mais on peut alors se demander si cette volonté de divertir ne prend pas l’ascendant sur la dimension cognitive originelle d’une exposition.
De nombreuses vidéos jalonnent le parcours et offrent au visiteur un support différent que celui des textes pour obtenir des connaissances. Le documentaire « Le dessous des cartes - Des ours et des hommes » permet de faire une parenthèse pour réfléchir aux problèmes que rencontrent les ours au contact de notre espèce. Cette vidéo est d’ailleurs présentée dans un espace spécifique pour séparer les publics de l’exposition, le temps du visionnage.
Les dispositifs interactifs illustrent le discours de l’exposition en mettant à contribution le visiteur. Ainsi lorsque le phénomène d’hibernation est expliqué dans la première partie du parcours, le visiteur a la possibilité de ressentir la chaleur produite par le corps de la marmotte et de l’ours avant et pendant l’hibernation. Il n’y a qu’à poser sa main sur les empreintes pour sentir la variation de chaleur de ces animaux.
Dans la partie consacrée aux relations entre les hommes et les ours, deux dispositifs retiennent l’attentions des publics. La première est un écran tactile représentant une zone de fouilles. Le visiteur est invité à frotter l’écran avec son doigt pour trouver dans le sol fictif des ossements d’ours. Une fois la fouille terminée, il est possible d’avoir plus d’informations sur ces « découvertes » avec ce même écran tactile. La seconde manipulation est en interaction avec le mur d’art pariétal. Des représentations d’ours sont visibles sur certains panneaux mais pour d’autres il faut utiliser une lampe mise à disposition afin d’éclairer des zones où les traits des gravures ont été usés par le temps. Grâce à l’éclairage de la lampe l’image de l’ours réapparait.
Exemple de manipulation sur le mur pariétal © Océane Caby
L’exposition « Espèce d’Ours ! » est finalement très complète. Le visiteur peut interagir à la fois avec des objets, des multimédias, des manipulations, des textes ou encore des schémas tout en observant des animaux naturalisés.
Le caractère ludique se décline à travers des dispositifs de manipulations, l’utilisation de l’audiovisuel, la scénographie et le parcours de l’exposition, la hiérarchie claire des textes ou encore l’éclairage. Tous ces éléments font de la visite une expérience dynamique qui interpelle les publics.
#Ours
#Muséumd'HistoireNaturelle
#Ludique
Pour en savoir plus :
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/especes-ours
Exposition itinérante du Museum de Toulouse :

Expo Jurassic World : Science ou fiction?
La Cité du Cinéma, à Saint-Denis en région parisienne, a accueilli en 2018 l’exposition événement Jurassic World dans le cadre de la sortie du second opus intitulé Fallen Kingdom. Ce parcours immersif jalonné de dinosaures mécaniques monumentaux proposait au visiteur de déambuler dans des décors inspirés de la mythique saga cinématographique, qui compte actuellement cinq opus divisés en deux « sous-séries », Jurassic Park et Jurassic World. L’une des particularités de cette exposition était de décliner un thème issu de l’industrie du divertissement mainstream mais avec une forte composante scientifique et l’objectif de transmettre des connaissances au public.
Peut-on alors considérer Jurassic World comme une exposition scientifique en dépit de son caractère hollywoodien ?

Dinosaure mécanique et tunnel de passage vers une salle de médiation - © M.T.

L’expo joue sur la ressemblance de concept entre Jurassic World et les parcs zoologiques - © M.T.
« En marketing, le mainstream (courant principal en anglais) désigne le marché grand public, la tendance majeure de consommation. Le mainstream recouvre la plus grande partie de la demande et s’adresse donc au plus grand nombre de consommateurs potentiels.
C’est un phénomène de masse, qui peut être amené par l’actualité, la mode, les médias, les relais d’influence (stars, journalistes, blogueurs, youtubeurs). »
(Source : www.journaldunet.fr)
La franchise regroupant les sagas Jurassic Park et Jurassic World constitue l’un des exemples les plus connus de cette culture de masse. Sorti en 1993, le premier opus réalisé par Steven Spielberg avait révolutionné la façon de montrer les dinosaures au cinéma, en s’appuyant sur des données scientifiques récentes qui contredisaient totalement l’image que le public se faisait en général de ces espèces disparues. La vision improbable d’un tyrannosaure à la stature verticale avec une queue traînant par terre laissait place à un animal beaucoup plus réaliste (et donc plus apte à effrayer des spectateurs moins facilement impressionnables qu’autrefois). Cette alliance réussie entre cinéma et science ne s’est néanmoins pas toujours vérifiée, et force est de constater que de nombreuses invraisemblances subsistent dans le scénario des différents films. Ces dernières ont notamment été analysées dans le cadre de la sortie du premier opus de Jurassic World (en 2015) par le magazine Sciences & Avenir1.
Faut-il pour autant reléguer le mainstream au rang de « sous-culture » tout juste bonne à offrir du divertissement sans proposer aucune médiation ? Utiliser des films, des romans, BD ou jeux-vidéos célèbres comme support de transmission de connaissances est certes un exercice délicat : cela nécessite de passer au crible leur contenu afin de repérer d’éventuelles erreurs et distinguer les détails relevant d’une réalité scientifique (ou historique) de ceux purement inventés pour les besoins de l’intrigue. Mais si ce travail de vérification est effectué avec rigueur et que l’exposition qui en découle établit des limites claires entre réalité et fiction, permettant ainsi au visiteur de faire la part des choses, alors le mainstream devient un formidable outil de médiation.
Il attire en effet un public plus large que les expositions purement scientifiques et constitue donc une « porte d’entrée » accessible pour des personnes n’ayant pas l’habitude de s’intéresser à ce type de sujet. Car la science, même vulgarisée, revêt pour beaucoup un aspect intimidant ou rebutant pouvant s’expliquer par un certain nombre de facteurs : mauvais souvenirs d’école, sentiment d’échec face à des notions incomprises, croyance selon laquelle cette discipline serait réservée à une élite d’intellos pas très glamour… Tandis qu’une saga telle que Jurassic Park (ou World) peut être appréciée par tous, sans distinction de rang social, d’âge ou de niveau d’études. C’est là l’un des principaux atouts du mainstream : il abolit l’effet de compartimentation que créent les expositions « spécialisées » et s’adresse à tous les publics – à l’exception peut-être des élites intellectuelles, qui ont parfois tendance à mépriser cette culture de masse car elle se permet de prendre des libertés avec la réalité et affiche sans fard ses objectifs lucratifs (quitte à ne pas faire dans la dentelle). Il n’est d’ailleurs pas besoin d’analyser longuement la question pour comprendre que Jurassic World avait pour principal objectif de faire la promotion du film Fallen Kingdom, sorti en France un mois après l’ouverture de l’exposition.

Version anglophone de la salle InGen - © Encore Productions
Outre les enjeux marketing qui pèsent sur ce type d’événement et peuvent influencer la muséographie, des problèmes de confusion surviennent lorsque la frontière entre imaginaire et réalité n’est pas assez bien mise en évidence. Les visiteurs non-initiés peuvent alors retenir des informations erronées et se forger de fausses croyances. La question est particulièrement épineuse dans le cas de la science-fiction, où tout est fait pour rendre vraisemblable une histoire en vérité impossible. Ainsi, la reconstitution de la salle InGen nous laisserait presque croire que l’on peut véritablement ressusciter des dinosaures grâce à un moustique extrait d’un morceau d’ambre – technique dont rêveraient sans doute les paléontologues mais qui dans la pratique demeure tout à fait irréalisable. L’anatomie des espèces présentées pose également question : nous avons ici affaire à des animaux génétiquement modifiés dont l’apparence est parfois assez éloignée du « modèle initial », mais cette information n’est pas toujours clairement précisée ; certains dinosaures sont présentés comme fidèlement inspirés de la réalité même lorsque ce n’est pas le cas.
On notera néanmoins que malgré cette « zone de flou », Jurassic World propose des outils de médiation intéressants – voire ingénieux, tels les panneaux pédagogiques qui décomposent les noms à rallonge de certains dinosaures de manière à en faciliter la lecture et la prononciation. Le fait de pouvoir manipuler des moulages d’ossements fossilisés inclut par ailleurs une dimension tactile appréciable. Quant à la fameuse salle InGen, elle contient des informations pertinentes sur la géologie et la génétique. Ajoutons à cela une scénographie efficace grâce aux décors immersifs, aux nombreux effets sonores et visuels, et aux dinosaures mécaniques particulièrement bien réalisés.
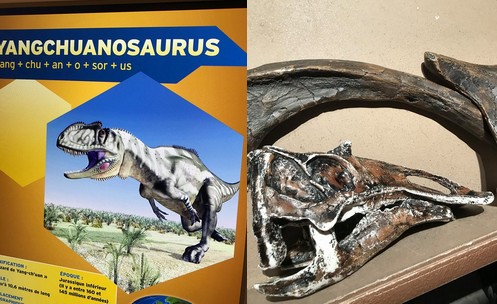
Exemple d’un panneau pédagogique et de moulages à manipuler - © M.T.
En conclusion, Jurassic World ne saurait être qualifiée d’exposition scientifique en raison d’un manque de clarté dans la distinction entre fiction et réalité (ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle fut présentée à la Cité du Cinéma, et non au Palais de la Découverte ou au Muséum d’Histoire Naturelle). Elle crée cependant une passerelle entre science et culture populaire – passerelle qui pourrait peut-être à terme contribuer à réconcilier une partie du public avec les musées.
M.T.
Pour aller plus loin :
#mainstream
#jurassicworld
#culturepop
#sciencefiction

Exposer le vivant : entre attraction et curiosité
L'attrait du vivant
Le vivant est indéniablement un atout pour les musées et les centres de science qui en exposent. L’exposition temporaire Venenum, un monde empoisonné (Musée des Confluences) présentait par exemple entre autres 64 spécimens de 12 espèces venimeuses et vénéneuses pour appuyer son propos. Il s’agissait d’une première pour le musée, qui n’avait encore jamais exposé de spécimens vivants, car les spécimens naturalisés que possède le musée sont en trop mauvais état. Mais il s’agissait de démythifier des animaux fantasmés, et l’équipe connaissait aussi et surtout la force d’attraction du vivant. Il n’y a qu’à regarder les chiffres : à sa clôture, l’exposition Venenum, un monde empoisonné était l’exposition la plus visitée du musée, avec 600 000 entrées enregistrées. Le succès est aussi bien quantitatif que qualitatif. Une enquête a été menée en interne par le service de l’évaluation et des études du musée en mêlant entretiens avec les visiteurs et observations dans l’exposition. Les résultats démontrent que le vivant est effectivement un produit d’appel, mais qu’il ne fait pas écran à l’acquisition de connaissances. Les agents de surveillance, quant à eux, ont été valorisés : formés pour gérer les pensionnaires vivants de l’exposition, ils se sont retrouvés plus d’une fois en situation de médiateurs.

Des grenouilles qui fascinent : voilà tout l’intérêt du vivant dans l’exposition Venenum, un monde empoisonné. ©AFP – La Croix
Comme les reptiles, des insectes aussi communs que les fourmis peuvent déplacer les foules : à la fin des années 1980, Luc Gomel – ingénieur agronome de formation et actuel directeur du parc zoologique de Lunaret - a monté une exposition sur les fourmis, où six fourmilières était présentées. L’exposition, qui ne devait tourner que quelques mois dans la région toulonnaise, a finalement itinéré une quinzaine d’années dans une vingtaine d’endroits en France, en Suisse et en Belgique. Le Palais de la Découverte a également loué l’exposition, qui a été la plus fréquentée du site, après Autour des dinosaures, datant de 2015.
Cet attrait pour l’animal vivant ne se dément pas, et devient même un argument pour augmenter la fréquentation de certains espaces. Le Muséum-Aquarium de Nancy propose ainsi un espace doté d’aquariums contenant des espèces exotiques et locales, ainsi qu’une galerie de zoologie plus classique à l’étage. Dans les années 1970 le musée, ne contenant auparavant que des expôts classiques de muséum, décide de faire un grand tri et transformer la moitié de ses espaces en aquariums, réduisant d’autant son espace de présentation pour les spécimens naturalisés. Ce succès ne se dément pas. Il n’y a qu’à se balader dans le musée pour se rendre compte de l’attrait : les espaces dotés d’aquariums sont pleins en période de vacances scolaires, tandis que la galerie de zoologie connait une fréquentation plus classique. Dans la programmation annuelle, les aquariums sont tout autant mis en avant que les spécimens naturalisés. La page Facebook du musée relaie quant à elle aujourd’hui encore des articles relatant les poissons les plus connus du muséum.

Sur les réseaux sociaux comme dans le musée, les poissons sont à l’honneur. ©C.dC - MAN
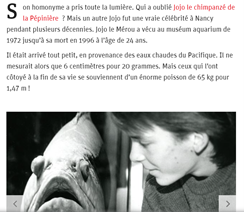
Même la presse locale se passionne pour eux. ©C.dC – L’Est républicain
Exposer des animaux vivants dans un musée se fait depuis des décennies et le succès ne se dément pas. Pour des raisons évidentes, les animaux présentés se résument souvent à des spécimens de taille modeste (comme les insectes et les arthropodes) et qui sont relativement faciles à entretenir (il est plus facile de s’occuper de poissons et de reptiles que de grands mammifères). Pourtant, l’arachnophobie et la peur des serpents sont la plupart du temps classées comme les peurs les plus communes dans le monde occidental. Cette relation d’attraction-répulsion joue aussi dans l’attrait que peuvent provoquer ces espaces. Les musées et les centres de sciences peuvent alors travailler sur ces a priori pour changer l’image de ces animaux. De nombreux centres proposent ainsi des médiations où les animaux sont sortis de leurs espaces pour être présentés au plus près du public. Le musée d’histoire naturelle de Lille sort régulièrement les phasmes de leurs vitrines pour les présenter aux plus jeunes et à leurs parents. Sous la surveillance du médiateur, le visiteur peut, s’il le souhaite, porter l’insecte sur sa main, tandis que le médiateur lui en apprend plus sur l’animal. Ces présentations sont très régulièrement couronnées de succès et font du moment un souvenir important pour le visiteur. De la même manière, le musée d’histoire naturelle et vivarium de Tournai a proposé en 2019 un stage alliant danse contemporaine et découverte des insectes. Au musée, les enfants ont pu ainsi toucher et porter des insectes. L’opération a été un franc succès : le côté tactile de la médiation est un véritable atout, mais cela apparente également le musée au parc zoologique*, qui s’en rapproche déjà avec les différentes autorisations que le musée doit posséder pour gérer les animaux.
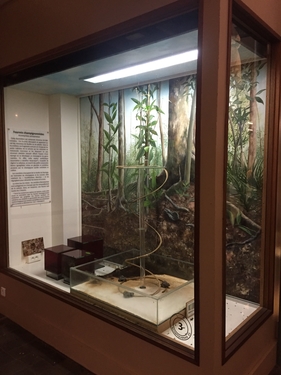
La vitrine des fourmis champignonnistes du musée d’histoire naturelle de Lille, qui fait souvent de l’ombre à ses congénères naturalisés ©C.dC
Plus encore, les centres spécialisés font de ces a priori le véritable fer de lance de leur discours. « Développer des attitudes positives à l’égard des insectes » fait partie des missions principales de l’Insectarium de Montréal, qui explique sur sa page Internet :
« À l’instar des autres institutions d’Espace pour la vie, l’Insectarium souhaite accompagner l’humain pour mieux vivre la nature, tout particulièrement pour reconsidérer sa relation aux insectes.
En plus de présenter l’extraordinaire diversité de formes et de comportements des insectes, le musée met en lumière leurs rôles essentiels dans l’équilibre écologique de la planète et, par extension, leur importance pour le devenir des humains.
[…] Pour changer durablement le regard des humains envers les insectes, l’Insectarium mise sur des approches intimistes, expérientielles et riches en émotions. »
Cette démarche s’inscrit dans une mission plus large que se donnent les muséums et les centres de sciences. Le fait d’exposer des animaux vivants est l’opportunité aujourd’hui de porter un discours sur la biodiversité et de sensibiliser le public à ces questions. L’animal vivant est une porte d’entrée pour aborder ces problématiques, qui deviennent concrètes à l’aune de ces présentations. Elles sont alors un tremplin vers des actions de plus grande ampleur. En ce sens, l’insectarium de Montréal produit de nombreuses missions avec ses publics pour la sauvegarde de l’environnement. Il propose au public des missions de sciences participatives, comme Les sentinelles de Nunavik, ou encore La nature près de chez vous. Un onglet complet est dédié à ces missions sur le site internet de l’Insectarium. Dans la même veine, le Vivarium du Moulin (Lauthenbach) travaille avec le public sur la réhabilitation des insectes locaux. Créé en 1991 sur le modèle de l’Insectarium de Montréal, le Vivarium du moulin se donne pour mission d’être le médiateur entre les scientifiques et le public. :
« Les insectes ont souvent mauvaise réputation. Pourtant ils jouent un rôle indispensable dans l’équilibre écologique. Afin de leur redonner la place qu’ils méritent, un jardin aux insectes spécialement aménagé à leur intention a été conçu au pied de la roue à aubes. Dès le printemps, empruntez le sentier de découvertes jalonné de refuges à insectes : mare, tas de vieux bois, haie champêtre, talus ensoleillé, compost, prairire fleurie, etc. Autant de micro-habitats facilement reproductibles dans votre jardin et qui offrent le gîte et le couvert à un cortège d’insectes dont la richesse vous étonnera ! »

L’Insectarium de Montréal présente à la fois des spécimens naturalisés et vivants. ©Claude Lafond
Exposer le vivant est sans aucun doute un atout pour les musées et les centres de sciences, qui accroissent ainsi leur fréquentation. Mais les animaux peuvent également être le support de discours de sensibilisation comme un première étape pour soulever les a priori négatifs qui les entourent. Néanmoins, conserver du vivant dans un espace aussi contrôlé qu’un musée n’est pas chose aisée.
Un atout contraignant : l’exemple de Venenum, un monde empoisonné
Bien qu’étant un produit d’appel phare pour les musées qui possèdent du vivant, les législations qui entourent son exposition sont complexes et importantes. L’exposition Venenum, un monde empoisonné au musée des Confluences en est un bon exemple. L’exposition présentant des espèces venimeuses et vénéneuses, le musée a été soumis à une réglementation très lourde administrativement. Celui-ci a dû produire un dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de 130 pages pour la Direction Générale de la Protection et des Populations (DDPP). Pour toute la durée de l’exposition, le musée a été soumis à la même règlementation que les parcs zoologiques et les aquariums. Cela présente de nombreuses contraintes : nettoyage des eaux usées, pas de nuisances sonores et olfactives, gestion des déchets à la suite du décès d’un animal… La liste est longue. Le musée s’est entouré de deux capacitaires, qui l’ont aidé à préparer le dossier et à gérer les animaux durant la totalité de l’exposition. La venue d’animaux vivants a également demandé la formation du personnel d’accueil et de surveillance, et la mise en place de protocoles pour envisager tous les incidents. Enfin, le musée a dû se doter de protocoles de sécurité stricts, comme du double vitrage pour les terrariums et l’équipement des salles de travail avec les animaux de digicodes et de serrures à clé. Un message d’avertissement au début de l’exposition ainsi que des stickers sur les vitrines ont enfin été mis en place à destination du public pour les prévenir et leur expliquer la position à adopter face aux animaux. Pendant l’exposition, le musée a également été contrôlé deux fois par la DDPP pour vérifier dans quelles conditions étaient exposés les animaux.
Malgré tous ces efforts, l’exposition reste une source de tension. Le personnel est toujours sur le qui-vive, et le musée a connu une fausse alerte : un serpent s’étant échappé de son terrarium. Le personnel a alors enclenché une procédure lourde, faisant évacuer l’exposition et avec l’intervention d’un des capacitaires pour retrouver l’animal.
L’exemple de l’exposition du musée des Confluences présente les principales difficultés face auxquelles les musées peuvent se retrouver confrontés s’ils décident d’exposer du vivant. Mais plus encore, cela demande une véritable logistique. Qui nourrit les animaux ? Comment expliquer l’achat de grillons sur les lignes de comptes d’un musée ? Quelle formation et quels recrutements à long terme pour assurer le bien-être des animaux ? Quel statut pour ces animaux ?
Exposer le vivant reste donc une situation contraignante pour les musées, qui doivent bien réfléchir avant de se lancer dans ce type de projet. Dans le cas des musées de sciences, les animaux exposés sont le plus souvent passifs, et présentés à des fins contemplatives. Mais les muséums et autres centres de sciences ne sont pas les seuls à présenter le vivant. L’art contemporain se sert régulièrement d’animaux, ce qui pose d’autres contraintes.
Le cas du vivant dans l'art contemporain
L’exposition d’animaux dans le cas d’œuvres d’art contemporaines posent tout d’abord les mêmes contraintes que dans les musées de sciences. Le musée doit assurer le bien-être de l’animal en suivant les mêmes protocoles stricts. Le musée d’art de Nantes a présenté quatre œuvres utilisant des animaux ces vingt dernières années. Parmi elles, l’œuvre de Laurent Tixador, Potager, en 2018 sur le parvis du musée. L’œuvre utilise le modèle de l’aquaponie pour questionner les nouveaux modes de production. Il fallait donc acheter des poissons pour activer l’œuvre. Exposée six mois, l’œuvre a présenté quelques difficultés, notamment pour le nourrissage des poissons et l’ajout d’eau. De même, le parvis étant en plein soleil, il a fallu refroidir l’espace pour le bien-être des poissons. A la fin du projet, les équipes, d’accueil, au départ réticentes, ont jugé la présentation trop longue au vu de l’entretien que demande l’œuvre. De même, à la fin de la présentation de ce type d’œuvre, que faire des animaux ? Dans le cas de Potager, le musée avait préparé une convention avec les services de la ville pour que les poissons rouges soient disposés dans la mare d’un parc municipale à la fin de l’exposition.

Potager de Laurent Tixador, sur le parvis du musée d’arts de Nantes. ©Laurent Tixador

©Musée d’arts de Nantes / C. Clos et M. Roynard
La question du bien-être animal enfin, est souvent reproché à l’art contemporain. Dans le cas du musée d’art de Nantes, la conservatrice a reçu plusieurs lettres attestant du mécontentement de visiteurs face à Potager, mais aussi à l’œuvre d’Aki Inomata Why Not Hand Over a « Shelter » to Hermit Crabs ?, qui présentait des bernard-l’hermites possédant des coquillages reproduisant des villes, créés grâce à une imprimante 3D. Les lettres fustigeaient les œuvres, en reprochant au musée l’utilisation d’animaux, mais aussi de plastique dans le cas de l’œuvre d’Aki Inomata. Ici, la conservatrice a tout de suite répondu à ces lettres pour expliquer le parti pris du musée d’accepter ce genre d’œuvre d’art. Mais il arrive que les protestations soient telles que le musée retire les œuvres en question. C’est ce qui s’est passé au Guggenheim Museum de New-York. Dans le cadre de son exposition Art and China after 1989: Theater of the World présentée en 2017, le musée a fait face à des menaces de violences qui l’ont contrainte à retirer Theater of the world (Un théâtre miniature où serpents, reptiles et insectes devaient cohabiter, laissant clairement entrevoir le destin funeste de certains animaux présents), Dogs that Cannot Touch Each Other (une vidéo où des pitbulls sont attachés à un tapis roulant et ne peuvent pas se jeter l’un sur l’autre pour se battre) et A Case Study of Transference (une vidéo où des porcs s’accouplent devant les spectateurs). Ces trois œuvres remettant en cause le bien-être animal dans leur forme, ont essuyé de vives critiques.

Why Not Hand Over a Shelter to Hermit Crabs ? , Aki Inomata. ©Musée d’arts de Nantes / C.Clos
La réflexion autour du bien-être animal est une question qui n’est pas prête de disparaître. En 2002, le MAM souhaitait acheter l’œuvre de Marcel Broodthaers Ne dites pas que je ne l’ai pas dit, mettant en scène un perroquet en cage et un magnétophone répétant constamment la même phrase, de sorte que le perroquet finisse par l’apprendre et la répéter inlassablement. Bien que le musée ait reçu l’autorisation de la part des élus et de la ville pour l’achat, la vente ne s’est finalement pas faite, car le musée fit face à trop de véhémence de la part d’élus de l’opposition et d’associations en faveur des animaux.
Le vivant est donc un véritable atout pour un musée, même s’il présente des contraintes certaines pour l’espace dans lequel il est exposé. Le public est généralement ravi de cet apport dans un musée, mais le bien-être animal est un facteur à ne pas oublier. Ainsi, si les animaux présentés dans les centres de sciences ne font généralement pas d’émules, des présentations trop poussives dans le cadre de l’art contemporain peuvent facilement déclencher de vives réactions.
Clémence de CARVALHO
#museum
#vivant
#animal
*Pour approfondir le rapprochement entre parc zoologique et parc d’attraction, un autre article du blog est disponible :
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2092-les-zoos-vont-ils-se-transformer-en-parcs-d-attractions
Pour en savoir plus :
- Journée d’étude de l’association des élèves-conservateurs de l’INP : Plus vif que mort ! L’animal en patrimoine, le 16/04/2019
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/Plus-vif-que-mort-!-L-animal-en-patrimoine

Fortuny, un Espagnol à Venise ?
Du 4 octobre 2017 au 7 janvier 2018, se tient l'exposition Fortuny, un espagnol à Venise au Musée de la mode de la ville de Paris dans le palais Galliera.
© Brenda Seck
Du 4 octobre 2017 au 7 janvier 2018, se tient l'exposition Fortuny, un espagnol à Venise au Musée de la mode de la ville de Paris dans le palais Galliera. Elle clôt un cycle sur l'Espagne dont font aussi partie les expositions Balenciaga, l'oeuvre au noir et Costumes espagnols, entre ombre et lumière.
Mariano Fortuny (1871-1949) est qualifié de « magicien », et pour cause, il est à la fois photographe, peintre, graveur, collectionneur, scénographe pour le théâtre et inventeur de techniques utiles à son travail de couturier. Sur ce dernier point, une part de mystère flotte car on ne sait toujours pas reproduire les plissés de la robe Delphos, par exemple, à qui Fortuny SRL rend hommage dans la robe rose (voir photo).
Le titre de l'exposition, Fortuny, un espagnol à Venise et le cycle sur l'Espagne lancé par le musée laissent-ils à penser que je vais apprendre comment vivait Fortuny en Espagne ? Est-ce qu'on va me donner à voir son voyage, son déplacement jusqu'à Venise, en passant par Paris et son contact avec la ville et ses habitants ? Je me doute que cette exposition est plus ambitieuse : le site internet du Musée la présente plutôt comme une rétrospective.
Fortuny à Venise
Dans la première pièce, une présentation générale de Mariano Fortuny nous montre son lien de sang avec la peinture, ses travaux en scénographie et en gravure qui expliquent son attrait pour la lumière. Sont également exposés ici, sa collection de peintures et de tissus anciens, venus de Byzance notamment, ainsi que son lieu de vie par le biais de photographies. L'une d'elle en particulier représente l'intérieur du Palais Orfei-Pesaro, à Venise où l'artiste s'établit. Des tissus lourds à gros motifs sont aux murs, sur lesquelles sont disposés des tableaux, des objets de collections et des meubles viennent parfaire ce décor pompeux, d'influence orientale.
Je perçois comment la scénographie reprend cette atmosphère : des photographies et même des tenues, disposées à la verticale à la manière de tableaux, sont accrochés sur des murs bleus imitant ça et là des tissus orientaux. La scénographie permet ici de contextualiser, de donner l'esprit d'un lieu et de la personne qui a vécu à l'intérieur. Dans la partie suivante, dédiée à l'influence de la Grèce, les robes semblent d'ailleurs être dans des armoires vitrées. Enfin, un somptueux canapé au bout de la pièce attend le visiteur qui peut vivre une immersion chez Fortuny, en écoutant un peu de musique classique diffusée dans les casques. Cette contextualisation bienvenue n’était guère annoncée par la sobriété de l'affiche qui, mettait en valeur le côté atemporel des robes de Fortuny.

© Brenda Seck
Des tenues sacralisées
La tendance, ces dernières années, est d'exposer les tenues sans vitre. Cette technique, risquée pour la conservation de la plupart des pièces, a cependant l'avantage d'être plus proche du public. Ici, ce n'est pas le parti-pris choisi bien que les principes d'exposition des vêtements soit très divers (mannequiné, plié, sur cintre, à plat à l'horizontale ou à la verticale comme on l'a vu plus haut) et on a cherché, au contraire, pour les pièces majeures de Fortuny, à les sacraliser. Elles sont alors sur un haut piédestal. Cela présente l'avantage que n'ont pas toutes les expositions présentant des costumes, d'avoir des cartels à hauteur des yeux ce qui évite de se baisser.
Ce point de vue en contre-plongée permet également de mieux comprendre l'importance de la lumière dans le travail de Fortuny. Les différentes matières, influences byzantines, plis et impressions à base de poudres métalliques sur velours sont ainsi mis en valeur mais que de reflets dans les vitres ! Le site de Galliera parle « d'atmosphère miroitante » et, après avoir essayé de prendre des photos dans tous les angles de vue, je comprends tout à fait l'idée.

© Brenda Seck
Une rétrospective ?
Le génie technique de Fortuny est donc bien mis en valeur, le côté atemporel des robes aussi avec des photos et des vidéos montrant la célèbre robe Delphos crée en 1909 et portée jusque dans les années 1960, sans compter les hommages faits par les grands couturiers de nos jours. Le voyage est évoqué par les influences de Fortuny (Grèce classique, Renaissance, Orient) et sa renommée, notamment auprès de grandes clientes parisiennes comme la comtesse Greffülhe.
« (…) on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de (la fabrication des étoffes merveilleuses de Venise) et qu'avant quelques années les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles dans des brocarts aussi magnifiques que ceux que Venise ornait, pour ses patriciennes, avec des dessins d'Orient. »
Propos de Elstir, dans À l'ombre des jeunes filles en fleur, Marcel Proust
L'Espagne n'est pas du tout mise à l'honneur, à part dans le titre de l'exposition. Les origines de Fortuny sont un prétexte pour le faire entrer dans la programmation du palais. Soit, mais pourquoi l'avoir mis dans le titre ? L'exposition montre les occupations et les travaux de Fortuny, ainsi que là où il vivait, mais sa personnalité n'est, finalement, pas vraiment mise en avant et l’exposition n’évite pas quelques digressions sur la tendance générale à l'antique du début du XXème siècle et tout une pièce consacrée à Babani, un couturier avec qui l'atelier de Fortuny a collaboré, comme il l'a fait pour Paul Poiret.
Malgré ces quelques points, j'ai passé un bon moment dans l'exposition. Les costumes sublimés et l'atmosphère très esthétique m'ont permis d'être immergée dans le monde de Fortuny. Les principaux enjeux de son atelier ont été assimilés avec plaisir.
Louison Roussel
#ExpoFortuny
#palaisgalliera
Pour en savoir plus :
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/fortuny-un-espagnol-venise

L'extraordinaire voyage au Musée de la Chasse et la Nature
Je vais vous conter un voyage merveilleux. L’inattendue, la déroutante, l’improbable épopée d’une visite au Musée de la Chasse et de la Nature. Caché au détour d’une rue pavée lutécienne, un hôtel particulier du XVIIe siècle abrite l’univers incroyable du Musée de la Chasse et de la Nature.
Si un jour, muni de votre boussole, vous parvenez à pénétrer dans le musée par sa lourde porte,laissez-moi vous prévenir… Le Musée de la Chasse et de la Naturene ressemble pas à ce que vous imaginez.Ce que vous y trouverez ne ressemble à aucun autre lieu.
Vue d’ambiance, Musée de la Chasse et de la Nature © A.H.
Après avoir gravi les vastes marches de l’hôtel, c’est par la Salle du sanglier que je pénètre dans le musée. Visiblement maître des lieux, l’animal, de son air peu commode, nous reçoit. Parquet d’origine, tapisseries moyenâgeuses aux scènes de chasses, boiseries d’antan, lourds rideaux de velours et mobilier daté, je découvre une à une les mystérieuses salles du musée.
Tantôt vastes, puis sombres et étriqués, les différents espaces donnent à découvrir autant d’univers qu’il y a de pièces. Dehors, il fait nuit. Le calme environnant laisse place à des sursauts provoqués par la rencontre impromptue avec un loup qui s’était caché derrière une vitrine, ou par un tête-à-tête indésiré avec une chimère diabolique.
Fumées de licorne,
Sophie Lecomte, 2006
© Sophie Lecomte
Un léger cliquetis aquatique m’amène à me diriger vers une ouverture reculée. Après un bref instant d’hésitation – pour ne pas dire d’appréhension –, j’ose m’aventurer dans ce sombre recoin. Oh ! Me voici dans le Cabinet de la Licorne. « QUOI ?! Les licornes existent vraiment ? » Comme il est amusant de constater que le musée est parvenu à insuffler en moi ne serait-ce qu’une demi-seconde le doute quant à l’existence des licornes. Une douce lumière nimbe un corps chimérique figé en apesanteur dans une vitrine. Puis le cabinet m’amène à découvrir une multitude de reliques et d’objets associés à l’animal fantastique. Déposés dans de ravissantes vitrines, de fragiles œufs de licorne et des archives de journaux viennent attester l’existence de l’animal.
Un autre animal anime notre imaginaire collectif depuis des siècles. Le loup. Ses yeux brillent dans la pénombre de la pièce. Cet autre cabinet propose aux curieux de découvrir l’animal sous tous les angles. Un meuble à tiroirs, vitrines et panneaux amovibles regorge de curiosités qui nécessitent de tirer, ouvrir, soulever pour être découvertes. A l’intérieur des panneaux coulissants, des dessins contemporains aux représentations de loup. Derrière un battant amovible, deux petits souliers de céramique glaçurée rouge mettent au jour la férocité du prédateur du Chaperon Rouge. Dans un premier tiroir, la louve romaine : monnaie utilisée au IVe siècle. Dans le second,la fable de La Fontaine : Le loup et la cigogne. Dans le troisième, du caca de loup. Au moment d’ouvrir le plus grand tiroir, des limaces d’appréhension parcourent mon estomac. « Que vais-je découvrir dans celui-ci ? »,me dis-je. Une énorme masse sombre et informe me fait refermer le tiroir aussitôt. Sa fermeture brutale provoque le tremblement du « collier de chien pour la chasse au loup » exposé dans la vitrine juste au-dessus.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? » ©A.H.
Dans les autres salles, disséminées ça-et-là parmi les marcassins naturalisés et les tableaux de chasse à courre, se dressent de fabuleuses créatures sans queue ni tête. Des plumes aux reflets profonds et chatoyants sont assemblées en des formes organiques. Vivantes ? Endormies ? Que cachent ces corps oniriques et ondulants ?
« Qu’est-ce que c’est que ça ? » demande une visiteuse à l’agent de surveillance en pointant du doigt l’une d’entre-elles,disposée entre deux canards col-vert. Ça, ce sont les sculptures chimériques de Kate MccQwire. Emprisonnées dans leur écrin de verre, elles semblent endormies.Découverts à la Galerie Particulière il y a quelques années, ces êtres imaginaires me font totalement succomber. Leur exposition au sein du Musée de la Chasse et de la Nature leur confère une dimension dramatique autant que poétique dans un lieu qui ne cesse d’interroger notre rapport à l’animal, à la mort et au lien puissant qui unit l’homme à la Nature.

Kate MccGwire au Musée de la Chasse et de la Nature, © A.H.
Un nombre insoupçonné d’autres merveilles est dissimulé dans le Muséequi marie avec excellence diverses typologies d’objet sans ne jamais ni les classer, ni les hiérarchiser ; mais c’est à vous désormais d’aller les découvrir. Ouvrez l’œil !
Bon voyage.
Anne Hauguel
Musée de la Chasse et de la Nature
62, rue des Archives 75003 Paris
L’exposition Kate MccGwire au Musée de la Chasse et de la Nature est désormais terminée, mais le musée a l’habitude de faire intervenir des artistes contemporains pour dialoguer avec les collections. Les expositions temporaires y sont nombreuses et fréquentes. Chaque intervention artistique donne lieu à un don au musée, constituant progressivement un fonds d’arts contemporain. L’offre du Musée de la Chasse et de la Nature est variée (conférences, concerts, projections, nocturnes les mercredis jusqu’à 21h,…)
En ce moment, retrouvez y l’artiste Julien Salaud qui expose jusqu’au 15 juinau musée.
Pour ensavoir plus : http://www.chassenature.org/
-KateMccGwire
-Sophie LeComte
http://www.lecomtesophie.org/index.html
-Julien Salaud
http://blog.julien-salaud.info/
#Expositions#MuséedelaChasseetdelaNature#ArtContemporain

L'infiniment petit désormais à portée de mains
Vous aviez un doute sur la vivacité des fourmis, leur organisation, leur taille, leur nombre, leur mode de vie, leur reproduction, leur alimentation … ? L’exposition Mille Milliards de Fourmis du Palais de la découverte saura vous répondre. Elle a été inaugurée le 15 octobre 2013 et fermera ses portes le 24 août 2014.
Qui n’a jamais mis d’anti-fourmi au bord d’une fenêtre ou jouer les aventuriers explorateurs en faisant un chemin de confiture à la fraise à la belle saison ? Nous sommes toujours subjugués par le monde du petit, de l’inconnu. Plus qu’une simple exposition sur les fourmis, le Palais de la découverte rend accessible ce monde si petit et pourtant si grand, si familier et pourtant si méconnu.

Fourmis découpant une orange pour aller nourrir
les larves de la fourmilièreObservées à travers une loupe.
Crédits : Léa PECCOT
Des fourmis vivantes sont présentées tout au long del’exposition. Des fourmilières entières sont recrées. Pourtant les concepteurs sont allés plus loin. L’exposition se veut accessible à tous les publics. Les textes sont courts, les termes simples et bien expliqués. Les caractères sont grossis, les films sont traduits en Langue des Signes Françaises, les modules sont adaptés à la hauteur d’un fauteuil roulant. Accessibilité, donc.
Le public déficient visuel est sans doute le plus difficile à conquérir quand il s’agit d’observation. De nombreux schémas et maquettes tactiles rendent palpable le monde des fourmis au public déficient visuel. Pource qui est des textes, le choix opéré est celui du braille. Il peut être discuté et discutable. En effet, la proportion de personnes atteintes de cécité lisant le braille est plus que fine, elle avoisine à peine 1,3 % [1] et les personnes atteintes de cécité au cours de leur vie ont plus de difficultés à apprendre ce procédé de lecture. C’est donc une faible part de la population qui est concernée et pourtant c’est un choix très judicieux, bien que coûteux. On peut certes se poser la question de savoir pourquoi privilégier autant un public si peu nombreux. Si peu de personnes lisent le braille, on observe toutefois dans l’exposition que nombreux sont les visiteurs, voyants, qui le remarquent et le touchent. Les voyants perçoivent très bien que le site où ils se trouvent est réfléchi et adapté. Là, est toute la question de l’accessibilité au public déficient visuel. Ce public peut être accompagné de personnes voyantes pour une visite partagée.
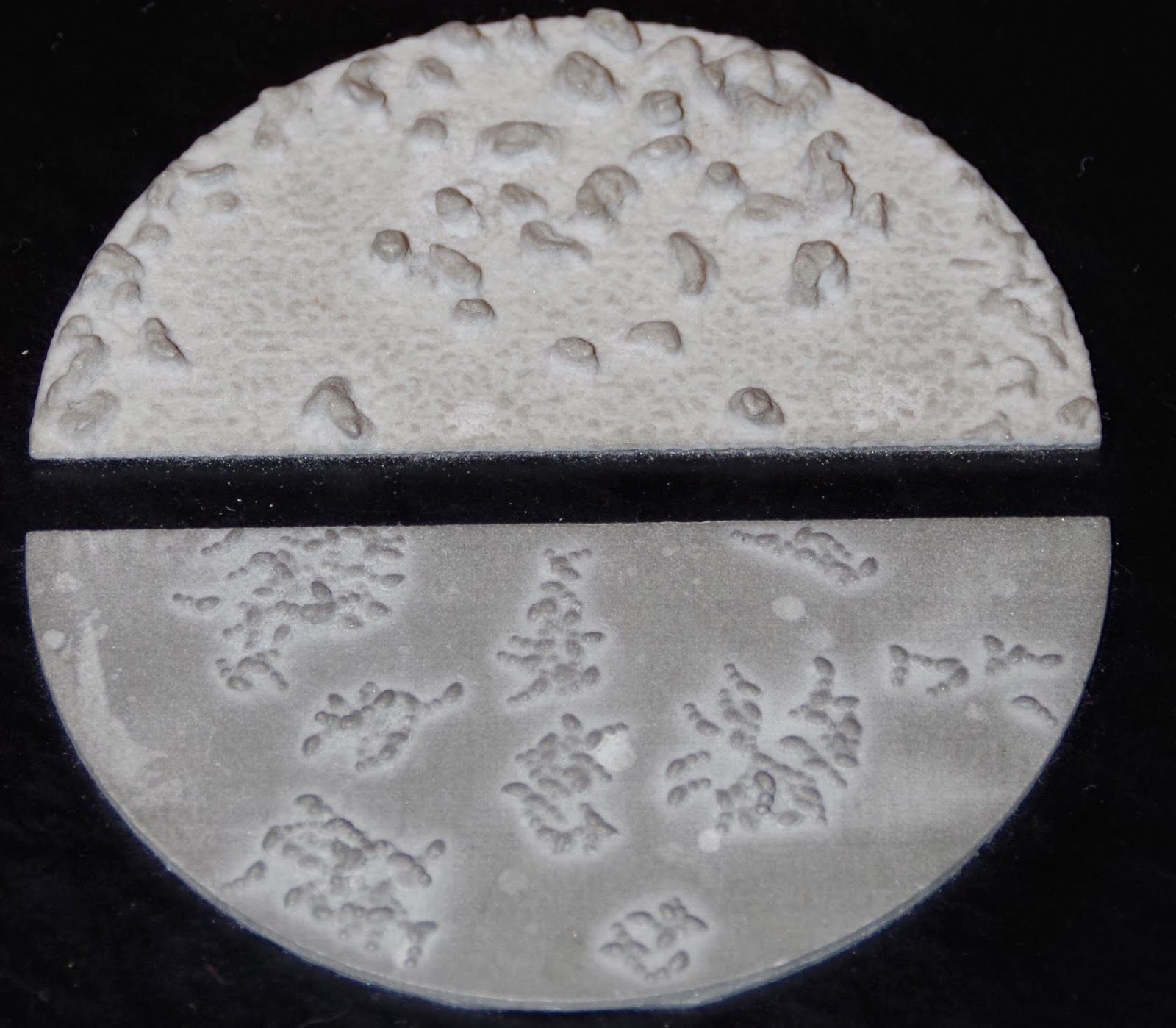
Reproduction tactile de lieux dans la fourmilière :
le nidet le dépotoir.
Crédits : Léa PECCOT
L’accent est donc mis sur le braille et plus largement sur le tactile. C’est encore une fois une réflexion en amont qui a conduit à ce résultat. Cette incorporation du tactile dans l’exposition est nécessaire pour le public déficient visuel et utile pour tous les autres. Des maquettes de toutes tailles et genres sont présentes dans cette exposition. Il en va de la reproduction d’une larve agrandie plusieurs dizaines de fois à la représentation des organisations d’orientation qu’utilisent les fourmis. Ce ne sont donc pas uniquement des éléments morphologiques qui sont traduits en tactile mais aussi des concepts à intégrer. C’est, il me semble ce qui fait toute la richesse et l’ingéniosité de cette exposition.
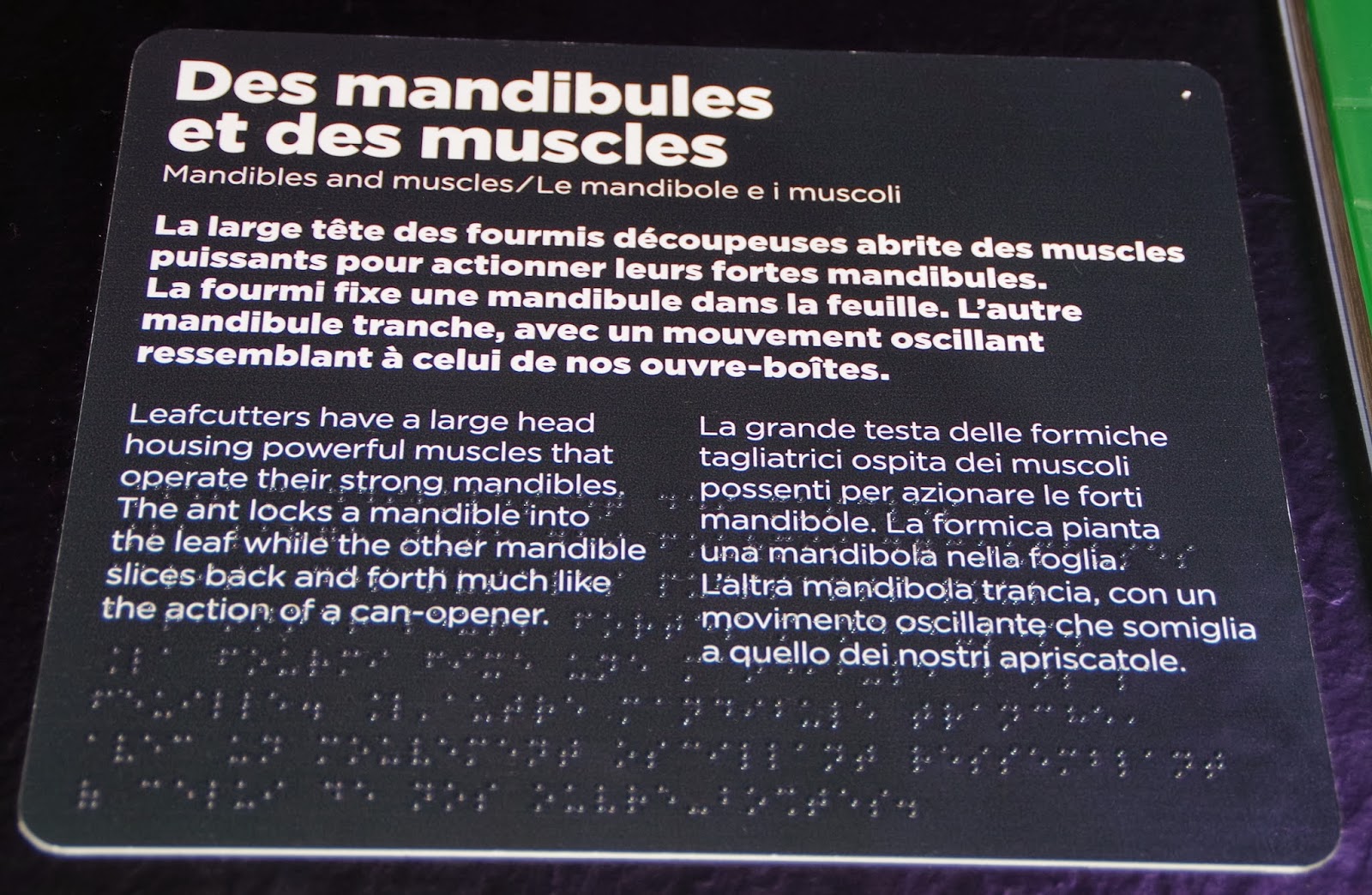
Texte en français, anglais, italien et braille.
Crédits : Léa PECCOT
Cette exposition avant tout accessible au public déficient visuel, auditif ou encore à mobilité réduite est d’autant plus riche pour les autres publics qu’ils soient jeunes, familiaux ou âgés. Tout le monde y trouve son compte et ressort agréablement surpris par les capacités de ces fourmis. Car si l’accessibilité formelle est surtout mise en avant, le contenu aussi a été travaillé. Les textes sont très abordables. Bien que leur taille soit réduite, les informations sont claires et simples et les termes sont définis. Il y a donc eu un grand travail de recherche pour arriver à ce résultat.
A l’aune des restrictions budgétaires et d’obligations législatives en matière d’accessibilité, on constate que le Palais de la découverte avec ses milliers de milliards de fourmis réussit ce que l’on considère aujourd’hui comme un exploit mais, qui, bientôt, sera la norme.
Léa Peccot
Exposition temporaire au Palais de la découverte : 15/10/13 au 24/08/14
Présentation de l'exposition par la commissaire, Nathalie Puzenat
Article presse : RFI, Christophe Carmarans
#fourmis
#accessibilité
#PalaisdelaDécouverte
#exposition
[1] « 1 %environ des déficients visuels (22 000 personnes) ont appris le braille, dontmoins de la moitié (9 000 personnes) le pratiquent pour la lecture et moins dela moitié également (9 000 personnes) pour l'écriture. »

L’itinérance : une force de diffusion
Mobilisée depuis le XIXe siècle, l’itinérance s’est aujourd’hui intensifiée comme outil indispensable pour la diffusion d’une exposition sur le territoire régional, national voire international.
Produite par une même institution ou coproduite entre plusieurs acteurs, réalisée en interne ou externalisée, elle nécessite, comme tout outil, une gestion de projet particulière propre à chaque structure.
Image d'introdution : ©Tiffany Corrieri
Le Forum départemental des Sciences (FDS), Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel où je réalise mon apprentissage, privilégie l’itinérance et réalise des outils depuis 1984. À ce jour, une cinquantaine d’outils, dont 30 créations originales parfois déclinées en plusieurs exemplaires afin de pallier les demandes d’un même produit, composent le catalogue. Je vous propose un bref état des lieux des spécificités des expositions et outils itinérants, grâce aux échanges que j’ai eu avec Catherine Ulicska, coordinatrice de projet itinérance au Forum départemental des Sciences.
Pourquoi choisir l’itinérance ?
Développer le musée et diffuser ses savoirs hors les murs pour toucher un public plus large et éloigné géographiquement et culturellement, sont des points essentiels pour la promotion d’une exposition. Ainsi la force de diffusion permet d’identifier plusieurs intérêts :
Avoir une portée plus grande sur le territoire quand la situation géographique de certaines institutions est trop lointaine. Ces dernières ne peuvent pas se déplacer jusqu’au musée faute de moyens, de temps ou de ressources humaines. Par ailleurs, aller vers le public et proposer ses outils dans des structures, c’est aussi faire tomber les barrières du transport.
L’itinérance des expositions affirme donc la mission de diffusion de culture scientifique au sein du territoire, en exprimant son savoir-faire en termes de médiation et d’ingénierie culturelle. De par son historique, le FDS peut se positionner comme une référence en termes de conseils en gestion et réalisation de projet, pour les acteurs qui auraient envie de tenter l’expérience. Ces partages et retours pratiques sont une des missions du poste dédié à l’itinérance.

Le planétarium itinérant est très sollicité. Il permet de diffuser le savoir scientifique et faire découvrir l’astronomie sur l’ensemble du territoire. © Forum départemental des Sciences
Proposer une mise à disposition pour les institutions éducatives de la région s’inscrivant dans l’offre de service public, lors de réalisation de dispositifs. Au Forum départemental des Sciences, les emprunteurs qui participent à Science Collège Nord ou l’Appel à projets peuvent bénéficier de la gratuité des outils. Ainsi écoles maternelles, primaires, collèges ou médiathèques peuvent gratuitement accueillir une exposition et un ou plusieurs outils.
Néanmoins, au FDS, à chaque sortie, prêt ou location, le transport, montage et démontage restent à la charge de l’emprunteur.
Apporter une seconde vie à l’exposition après son implantation et ainsi renforcer ou renouveler la programmation sur une thématique spécifique. Le FDS renouvelle sa programmation par la location d’une exposition tous les ans, portant sur une thématique de saison. Il reste cependant plus compliqué de trouver des expositions à destination des tout-petits (3-6 ans) en location.
En plus de ces aspects sociaux, des critères économiques sont évidemment prépondérants: faire itinérer une exposition peut amortir les coûts de production en intéressant des institutions et un public plus larges, et ainsi dégager quelques recettes. Pour autant, cette intention s’applique davantage aux producteurs privés, que je ne vais pas développer ici, puisque je limite mon propos aux institutions publiques.
Quelle gestion de projet ?
Puisque les expositions itinérantes demandent une gestion de projet mobilisée par une équipe dédiée, des institutions bénéficient aujourd’hui d’un poste ou des missions dédiées à l’itinérance, au vu de la professionnalisation du secteur de production d’exposition.
Anticiper et réfléchir aux critères d’itinérance en amont, lors de la réflexion du projet, sont des points clés pour ce type d’exposition. Le manque de vigilance au préalable peut apporter des modifications bien lourdes et onéreuses à effectuer par la suite.
Intégrer une équipe diversifiée pour penser le projet en termes de co-design, et gérer le cycle de vie du projet permet d’identifier les difficultés pouvant être rencontrées et de souligner les points de vigilance à intégrer. Au Forum départemental des Sciences l’équipe se constitue d’un.e chef.fe de projet, d’un référent technique, d’une coordinatrice itinérance, d’un.e médiateur.trice, et éventuellement d’une référent accueil. Outre l’équipe projet, les prestataires doivent aussi être conscients des critères de réalisation; au FDS la chargée d’itinérance insiste sur la durée de vie prévue à minima de 10 ans des expositions auprès des prestataires, afin qu’ils privilégient des matériaux durables.
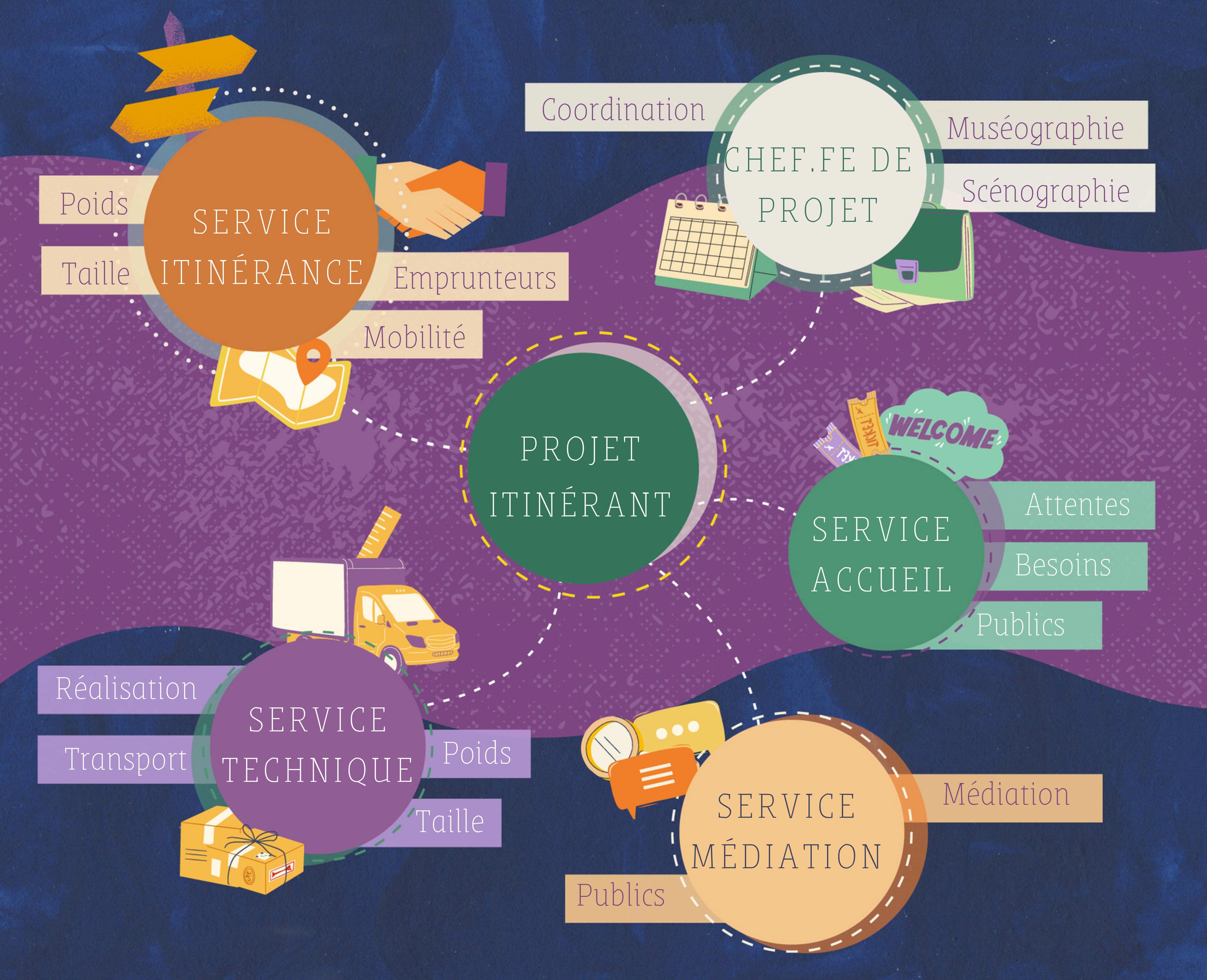
La réalisation d’un projet ou outil itinérant demande une transversalité des différents services de l’institution. ©Tiffany Corrieri
Une exposition itinérante demande donc une mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières importantes.
Enfin dans la durée de vie de l’exposition, les retours emprunteurs, premiers confrontés aux critères de location de l’exposition, sont à prendre en compte car ils permettent de réaliser un bilan sur le fond et la forme de cette dernière, et éventuellement de réaliser des modifications.
Quelle évolution du poste de coordinatrice de projet d’itinérance ?
«Le poste de Chargé.e de l’itinérance au FDS consiste en la promotion, la prospection, l'évaluation des expositions sur le territoire, et la coordination entre services afin que les mises à disposition se déroulent au mieux. Il s’agit également de participer à l’animation des réseaux des emprunteurs et futurs emprunteurs, en place depuis longtemps et agrandie par des mises en relation, pour parfois aboutir à des co-productions dans lesquelles chaque entité se complète.
L’évolution du poste en interne porte sur la gestion de relation client (CRM) via un logiciel dédié, les besoins en termes de communication étroitement liés à la promotion, la consultation pour de nouveaux projets d’exposition ou d’animations à venir. Puis, d’un point de vue externe, il s'agit de mettre en place des dispositifs d’intégration des réseaux emprunteurs, de mettre en relation des acteurs culturels entre eux avec des moyens complémentaires».
Carte d’identité technique d’une exposition ou outil itinérant
Afin de mieux répondre aux besoins d’itinérance, certains points sont à prendre en compte dès la réflexion du projet. Néanmoins ces derniers dépendent de l’objectif de réalisation de l’exposition et des moyens.
Une taille et un poids mesuré : l’exposition ne doit pas être trop encombrante pour pouvoir être accueillie dans un maximum d’institutions, particulièrement pour les petites entités qui détiennent un espace restreint pour accueillir l’exposition (médiathèques, écoles). Comme cela, la logistique (transport, montage/démontage, maintenance) reste accessible financièrement et techniquement. Ainsi, au FDS les expositions pour le Petit Forum, à destination des 2-7 ans, occupent moins de 100m2.

De grands modules avec de hauts montants en aluminium composent l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran. Ici un fond vert de 12 mètres 30 de long. © Forum départemental des Sciences
Certaines institutions proposent une déclinaison de l’exposition en plus petit format à l’instar du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris avec ses grandes expositions déclinées en Petit forme, en exposition panneaux.
La prise en compte du poids et de la taille s’applique aussi à l’emballage dont les dimensions vont influencer sur le stockage des caisses.
Néanmoins, le parti-pris existe d’assumer une taille plus importante des modules, comme avec l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran réalisée par la Cité des Sciences qui va être accueillie par le FDS en octobre 2022, et demande la mobilisation de 3 semi-remorques.

L’exposition L’Homme est-il un grand singe ? est composée de bâches qu’on peut enrouler et de montants en aluminium, facilement démontables qui permettent un transport facile.
© Forum départemental des Sciences
Un mobilier stable : le mobilier de l’exposition doit être résistant, notamment les manipulations, à l’épreuve des enfants. Les normes incendies sont aussi un point à réfléchir en amont. Ce mobilier doit pouvoir être facilement déplaçable et résistant pour ne pas être remplacé tous les ans.
Un montage et démontage facile : l’institution hôte (comme les écoles, ou les petites collectivités) peut ne pas avoir le matériel nécessaire pour le déplacement ou le montage de l’exposition. Par leurs poids et taille, les modules se doivent d’être pratiques et intuitifs à monter. Au FDS, les expositions du Petit Forum (2-7 ans) sont réfléchies en termes de praticité pour un montage et démontage sans encombres pour les emprunteurs; certains modules ne demandent pas d’assemblage et sont livrés sans besoins de montage.

Préparation du montage de l’exposition Mon Dodo © Forum départemental des Sciences
Le service associé à l’exposition : certains musées ou centres de sciences proposent un service clé en mains avec une prestation prête à l’emploi portant sur des animations ou spectacles associés à l’exposition louée, comme à la Cité de l’Espace à Toulouse, ou par le déplacement d’un animateur en camionnette pour animer des ateliers sur place comme avec Le colporteur des Sciences au Pavillon des sciences à Montbéliard.
La plupart du temps la médiation et l’animation d’outils itinérants est réalisée par des médiateurs.trices de l’institution hôte, qui, mené.es par des guides d’animations, se réapproprient le sujet de l’exposition pour l’adapter à la thématique mise en avant par leur établissement.
Profils d’emprunteurs diversifiés
Les emprunteurs d’une exposition itinérante sont divers et les conditions d’emprunt propres à chaque structure proposant le contenu. Il peut exister des forfaits comprenant certains critères qui définissent si le transport, le montage et/ou la médiation sont compris dans le prix de location.
Les emprunteurs peuvent être issus du service public, tel que les écoles, médiathèques et bibliothèques, les musées, les bâtiments administratifs ou touristiques (mairies, office de tourisme), et les associations. Il peut également être question d'une société privée identifiée dans le domaine artistique et scientifique ou non, comme des sièges d'entreprises, des gares, aéroports ou centres commerciaux. Il est aussi possible pour des particuliers de louer des expositions ou outils itinérants.

Vue d’ensemble des outils itinérants empruntés par la ville d’Ostricourt. Les modules sont présentés dans la salle des fêtes de la ville. © Tiffany Corrieri
Certains établissements sont fidèles à la location d’expositions d’une même institution et créent ainsi un réseau au fil des années. Les loueurs sont toujours demandeurs, d’où l'importance de créer de nouvelles expositions à un rythme régulier qui peut être difficile à tenir lors de restrictions budgétaires, et de prendre en compte leurs retours.
Quelle vie après avoir fait le tour de France ?
Afin de savoir quelles expositions ou outils pourraient être améliorés, mis à jour ou jetés, un état des lieux annuel est réalisé avec la direction, en suivant des critères d’évaluation spécifiques. Initialement, le FDS s’appuyait sur le seul fait de faire itinérer l’exposition au maximum 10 ans. Néanmoins les demandes et le renouvellement difficile des offres ne permettent pas de proposer des créations originales, afin de faire tourner la programmation et de remplir le catalogue, en remplaçant les précédentes.
L’obsolescence est le critère le plus favorisé pour trier les expositions et outils du catalogue et définir leur fin de vie ou non. En effet, certaines conceptions pédagogiques du FDS, de par leur ancienneté, présentent une obsolescence technique par l’utilisation de CD, de diapositives ou de clés USB qui ne correspondent plus aux normes et pratiques couramment utilisées.
Ainsi, les outils itinérants sont passés sous le crible de l’évaluation financière, du réinvestissement humain, du renouvellement des droits à l’image et du traitement du sujet qui peut devenir obsolète. Les évaluations post-location permettent de rester à jour sur l’impact de l’exposition en termes de contenu, scénographie, de maintenance etc, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs lors de la prochaine création.
Quand un mobilier est marqué comme obsolète, le matériel est parfois récupéré et réutilisé, ce qui n’est plus exploitable est jeté. D’autres fois l’exposition peut avoir une seconde vie via une vente ou une donation.
Je remercie Catherine Ulicska pour sa disponibilité et son expertise.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
- Méliné Kéloglanian, «Le marché de l’exposition itinérante internationale, ses acteurs et sa filière », La Lettre de l’OCIM 178 | 2018.
- Catalogue des outils itinérants pour la médiation scientifiques et techniques en Hauts-de-France, édition 2020.
- Les expositions itinérantes : guide à l’usage des gestionnaires de tournées, Société des Musées du Quebec.
#itinerance #technique #ingenierie
La bière exposée
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord.
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord. Cette boisson ancestrale qu’on dit créée par Dieu comme témoignage de son amour pour l’Homme a fait ses preuves depuis bien longtemps. Comment, à son évocation, ne pas se rappeler une soirée trop arrosée, une rencontre fortuite dans un bar, un artefact ponctuant les retrouvailles amicales voire, pour les plus chanceux, un rafraichissement apprécié à la cantine … ? Ne laissant personne indifférent, son omniprésence traduit son appréciation commune. Dès lors, comment pourrait-elle échapper aux musées ? Si certains l’exposent, l’exercice n’en est pas plus évident du simple fait qu’elle semble familière et proche.
© E. L.
Des angles d’approches fréquents
En effet, le thème même sollicite les souvenirs d’expériences propres, ramène à des moments inédits, partagés ou solitaires, rappelle des réflexions animées ou divagantes. Cela, notamment, en fait naturellement un support privilégié pour l’ethnographie, l’anthropologie ou le traitement du patrimoine immatériel à travers sa consommation. Si dans l’événementiel autour de la bière se succèdent, aussi banalement qu’efficacement, maintes brasseries et dégustations, le musée a lui aussi du mal à s’extirper d’angles d’approches déjà exploités. Mais la bière et son utilisation, englobant mille et une problématiques et autant de secteurs –ivresse, religion, genre, écologie, économie, cosmétique, …-, se voient généralement réduites au prisme de son histoire et fabrication.
A travers lui, une distance s’installe entre le public et ce breuvage qui semble finalement plein de mystère. Ce n’est pas pour refroidir les amateurs qui se montrent alors avides de connaissances et souhaitent les compléter ou parfaire leurs expériences prochaines. Aussi, ce regard sur son évolution et sa mise en œuvre peut être adjoint de découvertes savoureuses en début ou fin de visite, le public étant amené à apprécier l’infime partie d’un panel de bières que l’on sait bien plus nombreuses.
Visitons donc trois musées de la bière.
© E. L.
Un musée européen de la Bière, le Musée de Stenay
Il est intéressant de constater que le Musée européen de la Bière qu’est le musée de Stenay, créé en 1986, propose lui aussi une approche historique, qu’il s’agisse de présenter la fabrication de la bière ou sa communication publicitaire, permettant cependant d’aborder les thématiques de la convivialité, de la femme, des approches sociologiques …, et ce au prix de 5€ par personne. Si cet angle d’attaque est aujourd’hui très répandu, il s’agit peut-être du musée le plus légitime à l’aborder. Cela découle en partie du fait que l’initiative de sa création vient d’un regroupement d’archéologues stenaysien au nom explicite : le « Groupement Archéologique ». Sont alors présentés, au rez-de-chaussée, le bâtiment et son investigation en tant que musée de la bière.
A l’étage, l’exposition débute par un rapide et sensoriel parcours sur ses ingrédients et leur place dans le processus de fabrication. Pour le reste sont présentés ses différentes techniques et matériaux ainsi que leur évolution au cours du temps. Le tout aboutit, en fin de visite, à une exposition temporaire voire une dégustation à la Taverne associée au musée. D’importants et pertinents dispositifs de médiation sont mis en place, témoignage d’une véritable démarche non-négligeable. Le musée s’adresse de manière privilégiée aux scolaires de tous âges en leur proposant des ateliers ludiques sur les constituants tels que les épices, ou encore des ateliers autour de la prévention. Il est à noter que la visite guidée, optionnelle, est un véritable avantage et permet de mieux appréhender les discours du circuit muséal tout en les agrémentant d’informations supplémentaires.
© E. L.
Bière qui mousse amasse foule
Evidemment, de son côté la Belgique peut se targuer d’avoir à son compte de multiples Biermuseums. Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’entendre un belge s’exclamer fièrement « Ah ça, en matière de bière et de chocolat, on a un bel assortiment ! ». Bière et chocolat, un duo à la mode dans les dégustations. Il devient nécessaire de mettre en exergue cette spécificité aux multiples expressions. Malgré tout, l’engouement naturel pour ce breuvage peut-il amener à survoler avec une certaine facilité ? Le Belgian Beer Musuem de Bruxelles peut laisser perplexe. Idéalement situé au bord de la Grande Place, dans un quartier éminemment touristique, il propose un espace très réduit au-delà d’une belle devanture. Celui-ci se divise principalement en deux parties.
La première sert d’espace de dégustation dans lequel règne en maître l’association de brasseurs. La seconde est un espace d’exposition où sont succinctement abordées les questions de fabrication (par le biais de suspensions murales explicatives) et d’histoire et distinctions de bières (par le biais d’une projection filmographique au support écrit en trois langues, dans des tailles de caractère et couleurs différentes pour chaque mot, rendant la lecture périlleuse). L’entrée comprend la dégustation finale de la bière du musée à table, dont les propriétaires ont d’ailleurs du mal à parler, si ce n’est préciser qu’elle est blonde.
L’exposition devient-elle prétexte, sachant que « bière qui mousse amasse foule » ? Qu’en est-il du but non-lucratif des musées ? Si certains se contentent de cette présentation au coût de 5€ (même prix d’entrée que celui du musée de la bière de Stenay …) en profitant pleinement de leur séjour bruxellois, la majorité du public se sent lésée et en garde un goût amer venant accentuer celui du rafraîchissement.
© E. L.
Une vision plus polymorphe
Certains musées, comme le Biermuseum de Bruges, s’écartent cependant de ces chemins tous tracés. Profitant lui aussi d’une position géographique avantageuse en plus d’un thème évocateur, il ne néglige cependant pas son contenu. Il est tout-de-même à noter que le lieu, exploitant plusieurs étages, dispose également d’un bar au-dessous des étages d’exposition. Aussi, s’il est possible de visiter le musée avec (15€ l’entrée comprenant 3 « tastings » de 15cl) ou sans forfait dégustation (9€), il n’est cependant pas nécessaire de faire la visite pour accéder à l’espace comptoir.
Toujours est-il qu’ici, les séquences de l’exposition permanente sont variées et permettent une vision plus riche. Evidemment, la fabrication et les matériaux sont abordés, mais également la place de la femme, le rapport à la nourriture, les distinctions de productions, ainsi que bien d’autres approches. Le parcours est moins limité au niveau des catégories (bien que l’exhaustivité soit inconcevable) en plus d’être particulièrement ludique. Une tablette à réalité augmentée et son casque sont mis à disposition du visiteur pour l’accompagner dans sa visite. Celui-ci doit fixer des expôts pour que des éléments explicatifs s’affichent sur son écran.
Globalement, il peut choisir d’approcher un sujet par le biais de l’image, du son, ou du texte, pouvant même combiner ces trois médias. Vingt petits quizz sont également présents dans le parcours, parfois évidents, parfois plus dissimulés, invitant le public à un véritable jeu basé sur des questions de connaissances incongrues sur le thème de la bière. La densité d’informations, pour une exposition aux intentions d’envergure, a néanmoins tendance à épuiser le visiteur qui peut finir par délaisser son support multimédia et perdre le reste des contenus.
© E. L.
Les expositions permanentes ne sont pas les seules à s’attarder sur ce sujet. Si elles ont tendances à l’approcher bien souvent de la même manière, les expositions temporaires, elles, peuvent prendre de la distance vis-à-vis de ces carcans. Les lectures nouvelles et innovantes y trouvent peut-être plus facilement leurs places. L’exposition temporaire « Bistrot ! De Baudelaire à Picasso », de la Cité du Vin à Bordeaux, présente des œuvres artistiques plutôt que des expôts ethnographiques pour traiter les boissons à travers leurs dimensions sociales, sociétales, anthropologiques, …
A quand une exposition sur la bière qui assume ces croisements ? Le renouvellement initié de regard n’en est encore qu’à ses débuts, et il est à espérer d’autres investigations à l’avenir. Comme celles que va proposer une programmation autour de de la bière réalisée en partenariat entre le Master MEM et le musée de la Chartreuse de Douai par exemple …
Emeline Larroudé
#Bière
#Patrimoineimmatériel
#Belgique
#MuséedelaChartreuse

La biodiversité exposée
Qu'est-ce qu'un parc régional ?
Carte des 54 Parcs © Fédération de Parcs naturels régionaux de France
D’après l’article R333-1 du Code de l’Environnement, les Parcs naturels régionaux ont pour missions :
- De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
- De contribuer à l'aménagement du territoire ;
- De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Les missions des Parcs et leurs objectifs
- Un enjeu d’image et de représentation : une porte ouverte sur le territoire
- Un enjeu de transmission de messages auprès des publics
- Un enjeu d’intégration et de reconnaissance
Les expositions des parcs et leurs enjeux
Plusieurs enjeux sont au cœur de leurs projets d’expositions :
Des expositions pour tous les publics
Le public familial est assez présent, notamment l’été. L’exposition « En quête de patrimoine » présentée l’été 2019 reprenait la forme ludique d’une enquête pour résoudre le meurtre d’une historienne. En farfouillant dans sa bibliothèque, les visiteurs découvraient les trésors patrimoniaux du parc : demeures seigneuriales, moulins à vent, fours à chanvre, maisons troglodytes…

Exposition « En quête de patrimoine », Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine, 2019 © LL
A la découverte des richesse du parc

Exposition « Des arbres et des cartes », Maison du PNR Marais du Cotentin et du Bessin, 2016 © Maison du PNR Marais du Cotentin et du Bessin
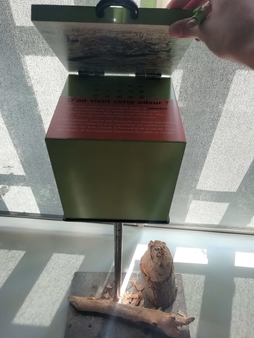
Dispositif olfactif des sécrétions du castor, Exposition permanente Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine © LL
La préservation de l'environnement, première mission des PNR

Exposition « La cistude à l’étude », Maison du PNR de la Brenne, 2019, Illustration de Benoît Perrotin © CL
Les problématiques envronnementales au coeur de la conception d'exposition

Affiche « Vivre dans le Parc en 2050 » © PNR Marais du Cotentin et du Bessin
(1) Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/quest-ce-quun-parc-naturel-regional-definition>
(2) Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, [En ligne] <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/carte_54_pnr_26022020.pdf>
(3) Maison du Parc Loire-Anjou-Touraine, centre de ressources, [En ligne], mis à jour le 10.02.12, <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/experience/maison-du-parc>
(4)
La maison du Parc de la Brenne <https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/la-maison-du-parc>
L.L
Pour en savoir plus : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/decouvertes/la-maison-du-parc
Maison du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin : https://parc-cotentin-bessin.fr/maison-du-parc
Maison du PNR du Perche : http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc
Maison du PNR de la Brenne : https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/la-maison-du-parc
Maison du PNR Normandie-Maine : https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/la-maison-du-parc-geoparc.html

La biosphère de Montréal
« C’est quoi cette grosse boule ? »
J’étais tranquillement en train de rêvasser dans le bus de 7h30 pour Montréal quand ma voisine de derrière poussa cette exclamation. J’ai aussitôt cherché des yeux l’objet de son interrogation : une sphère à l’architecture très expositions d’envergure m’interpella. J’appris plus tard que ce dôme géodésique accueillait le pavillon américain lors de l’exposition universelle de 1967.
J’étais intriguée par cette structure atypique, se trouvant au centre du parc Jean Drapeau, petit îlot de nature au cœur de Montréal. Je décidais donc de prendre le bateau pour me rendre sur la péninsule, et observer de plus près ce bâtiment.
L’ombre du dôme pouvait presque me couvrir lorsque je lus le panneau : Biosphère. Musée de l’environnement. En venant à Montréal, pressée par le temps et férue de musées de société, je ne m’étais intéressée qu’au célébrissime Musée des Beaux-Arts, ainsi qu’au Musée McCord. J’étais loin de me douter que le dôme abritait un musée depuis 1995.

La Biosphère ©Océane De Souza
Je pénétrais dans la biosphère et ses différents étages consacrés à l’environnement et la sensibilisation aux différents enjeux écologiques.
Le musée est divisé en plusieurs salles avec des « expositions » différentes. Cet enchainement de contenus très complet peut se montrer fatigant, car il nécessite beaucoup d’attention. L’avantage, mais aussi l’inconvénient de cette fragmentation des thématiques est qu’il est aisé de se concentrer uniquement sur les sujets nous attirant le plus.
Je décidais par manque de temps de ne pas écouter le spectacle immersif introductif : Façonner l’avenir, permettant de se plonger dans le contexte. Je passais immédiatement à la première exposition dont l’ambiance laboratoire m’attirait comme une poutine pleine de fromage.
Ce premier espace nommé écolab, aborde la pollution. Le dispositif est intéressant, car il invite le visiteur à se glisser dans la peau d’un scientifique et à expérimenter dans un laboratoire pour valider une hypothèse. Il doit en l’état de ses connaissances, choisir quelle pollution est la plus nocive pour l’Homme entre celle de l’aire et celle de l’eau. Accompagné d’une feuille de route, il pratique en autonomie1 des expériences et des analyses de documents et échantillons lui permettant de valider ou infirmer son postulat de départ.
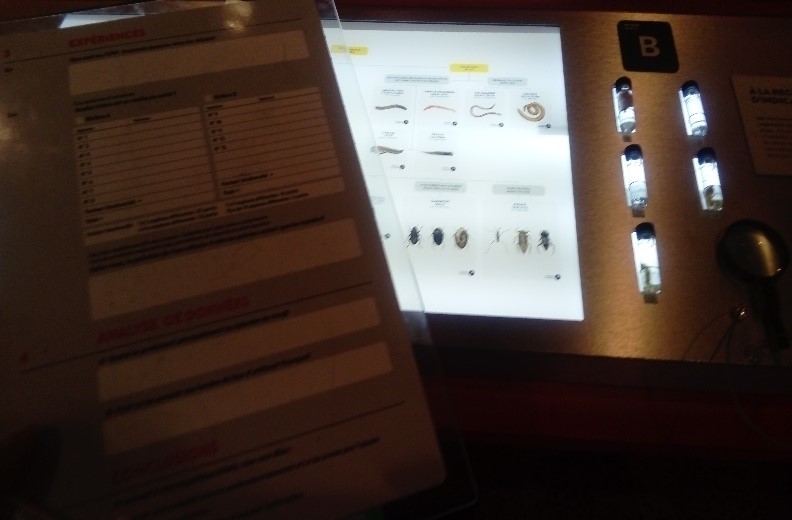
Guide de recherche et table d’analyse ©Océane De Souza
Les expositions : Ceci n'est pas un parapluie et Qu’est-ce que ça change ? sont plus théoriques. Elles expliquent les phénomènes météorologiques et climatiques, ainsi que la manière dont les humains dérèglent ces manifestations naturelles. Ces expositions moins abordables que la première se distinguent par une scénographie plus artistique, très belle et très immersive.
Le message est particulièrement transmis par des vidéos de scientifique et experts qui amènent le visiteur à comprendre les enjeux climatiques et météorologiques. On y comprend entre autres que le dérèglement climatique n’est pas une « Fake news ».
J’ai adoré les expositions : Énergies renouvelables : L’heure des choix et Planète MTL. Dans ces espaces des jeux et des manipulations montrent que des solutions sont possibles pour réduire son impact écologique. Il est même proposé de se positionner sur une action quotidienne à mener : depuis ma visite je fais attention à mes déchets de cuisine. C’est une des forces de la biosphère que de proposer des solutions aux problèmes qu’elle explique. Parmi les jeux il est possible d’incarner un organisateur de festival devant jongler entre différents éléments afin de réussir son évènement tout en respectant l’environnement. Ces espaces abordent énormément d’exemples concrets dans le monde, le message est optimiste !
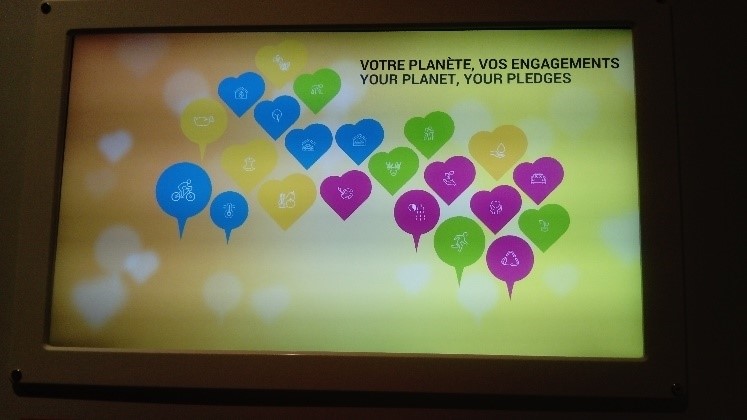
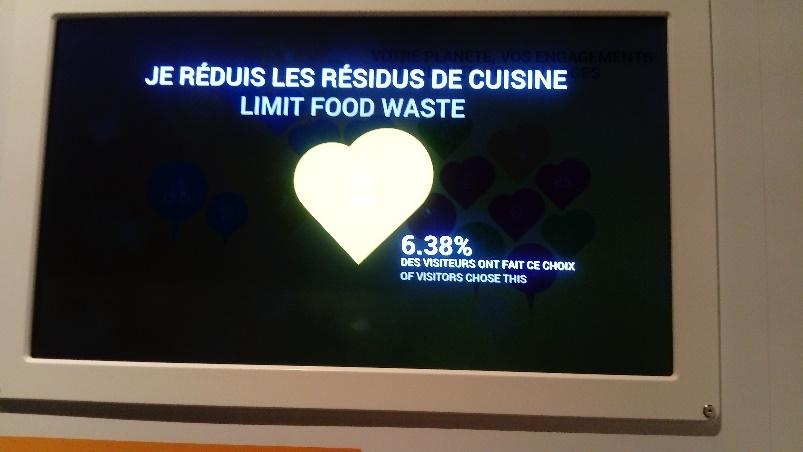
Initiatives prise à la fin de l’exposition © Océane De Souza
La biosphère n’est évidemment pas parfaite. Il est difficile de trouver des informations complètes sur internet, elle est peu visible dans Montréal en dehors de son architecture impressionnante. En outre ce manque de signalisation est récurrent au sein des expositions, il n’est pas toujours facile de comprendre comment se rendre aux étages ou comment fonctionne les jeux. Néanmoins la biosphère sensibilise à l’écologie de manière dynamique, sans être anxiogène. En dehors de ses expositions, l’énergie de la biosphère et le traitement de ses déchets se font dans le respect de la nature. Elle réussit donc le pari d’allier fond et forme.
Cette « grosse boule » est l’écrin d’une pépite muséographique.
Océane De Souza
1 Des médiateurs surveillent la salle et aident les visiteurs en demande.
#écologie
#canada
#musée
Site du musée : http://www.parcjeandrapeau.com/fr/biosphere-musee-de-environnement-montreal/

La conception scénographique à la Cité des Sciences et de l’Industrie
La conception des scénographies à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) se compose de plusieurs contraintes qui rendent accessibles les expositions au plus grand nombre et de valoriser le travail des équipes sur plusieurs années.
Éléments de travail pour l’exposition Danser ©MC
La Cité des Sciences et de l’Industrie en quelques chiffres
La Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI) est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Elle possède une offre culturelle riche avec cinq expositions temporaires environ et une dizaine d’expositions permanentes. Son offre est tout public avec deux cités des enfants (2-7 ans et 5/12 ans). Son nombre de visiteurs à l’année atteint presque les 1 993 000 visiteurs.
Pour atteindre ce nombre, de nombreux corps de métiers sont mobilisés afin de faire fructifier les expositions : des muséographes, des personnes chargées de la communication, du mécénat et bien d’autres. Il s’agit dans cet article de mettre en lumière le travail des architectes-scénographes de la CSI.
Le scénographe d’exposition face aux impératifs des ERP (Établissements Recevant du Public)
Pour toute exposition, il est obligatoire de rendre accessible au plus grand nombre. Cette nécessité favorise le confort de l’ensemble des visiteurs.
Les expositions doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : personnes en fauteuil roulant, avec des enfants, des poussettes… Pour cela, le scénographe travaille avec des unités de passage. Une unité de passage correspond à 90cm. Pour rendre accessible l’exposition, il est nécessaire d’avoir un parcours du début à la fin de l’exposition d’au minimum deux unités de passages soit 1,40m. Si, dans une exposition, les visiteurs sont amenés à revenir sur leur pas, il est nécessaire de laisser un espace d’1,50m afin de permettre au fauteuil roulant de faire demi-tour.
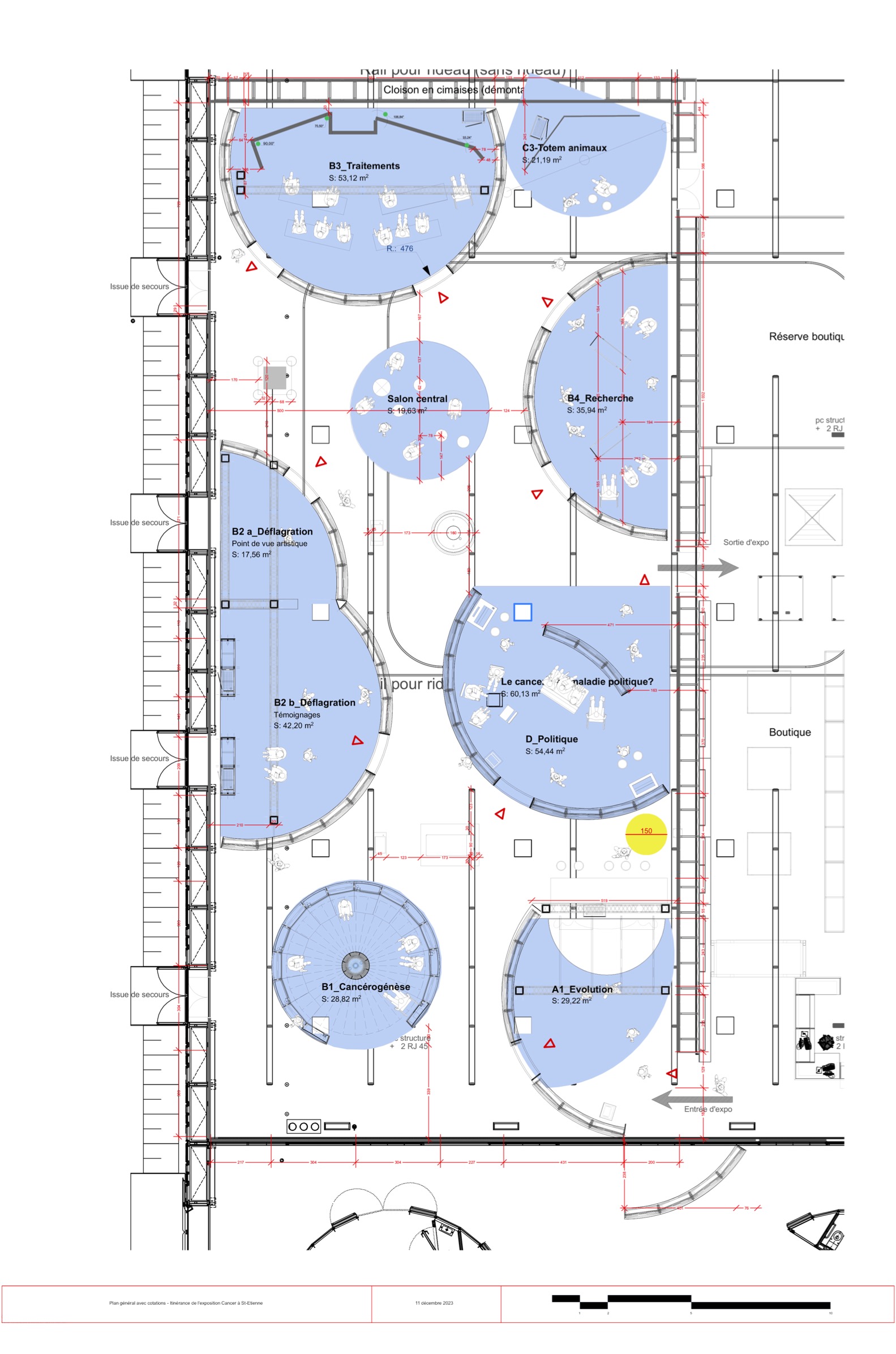
Plan de l’exposition Cancer pour l’itinérance à la Cité du design de St-Etienne @MC
Qui dit ERP dit sécurité! De nombreuses contraintes voient le jour afin de répondre aux exigences : des matériaux classé feu, aux traitements de surface en passant par le traitement de matériaux transparents avec des indications au sol ou tout autre signalétique originale. Ou encore les parois « miroir » qui doivent être légèrement floués pour limiter les risques de collisions.
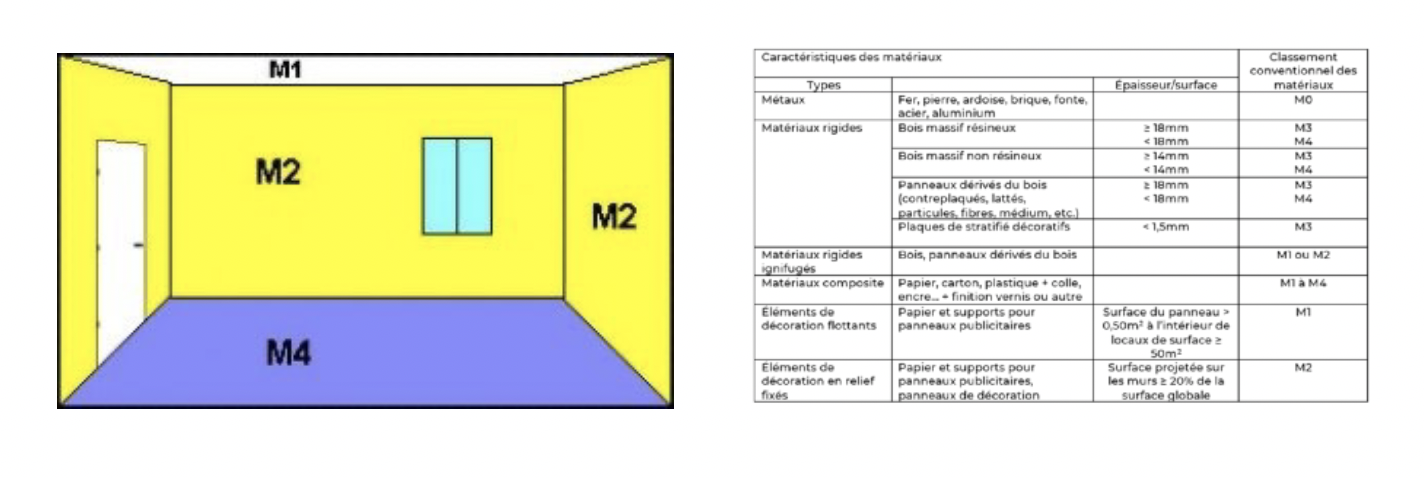
Classement feu dans les espaces d ‘exposition ©Bruno Exemples de matériau avec leur classement feu, 2021 © POPAI
Pour pallier ces réglementations, la CSI fait appel au bureau de contrôle « Veritas » qui donne leur avis et des préconisations sur la sécurité. Le dernier mot revient au responsable unique de sécurité, nommé le RUS, qui engage sa responsabilité morale dans les choix effectués.
Le scénographe d’exposition face aux volontés de l’institution
L’ensemble des expositions conçues pour la CSI sont pensées pour être itinérantes et être accueillies par d’autres institutions en France et/ou à l’étranger en fonction de l’exposition. Elles peuvent itinérer entièrement ou dans une version réduite pendant plus ou moins 10 ans, mais peuvent également être démantelées au bout de 3/4 ans si elles ne trouvent pas le succès escompté. L’itinérance est très variable en fonction des expositions, des potentiels acheteurs…
Au vu de l’augmentation des coûts des matériaux depuis la pandémie, la CSI conçoit ses projets différemment. Le budget d’exposition restant identique, les concepteurs s’ouvrentà de nouveaux matériaux mais également au ré-emploi et/ou à la réutilisation de matériaux d’exposition précédente.
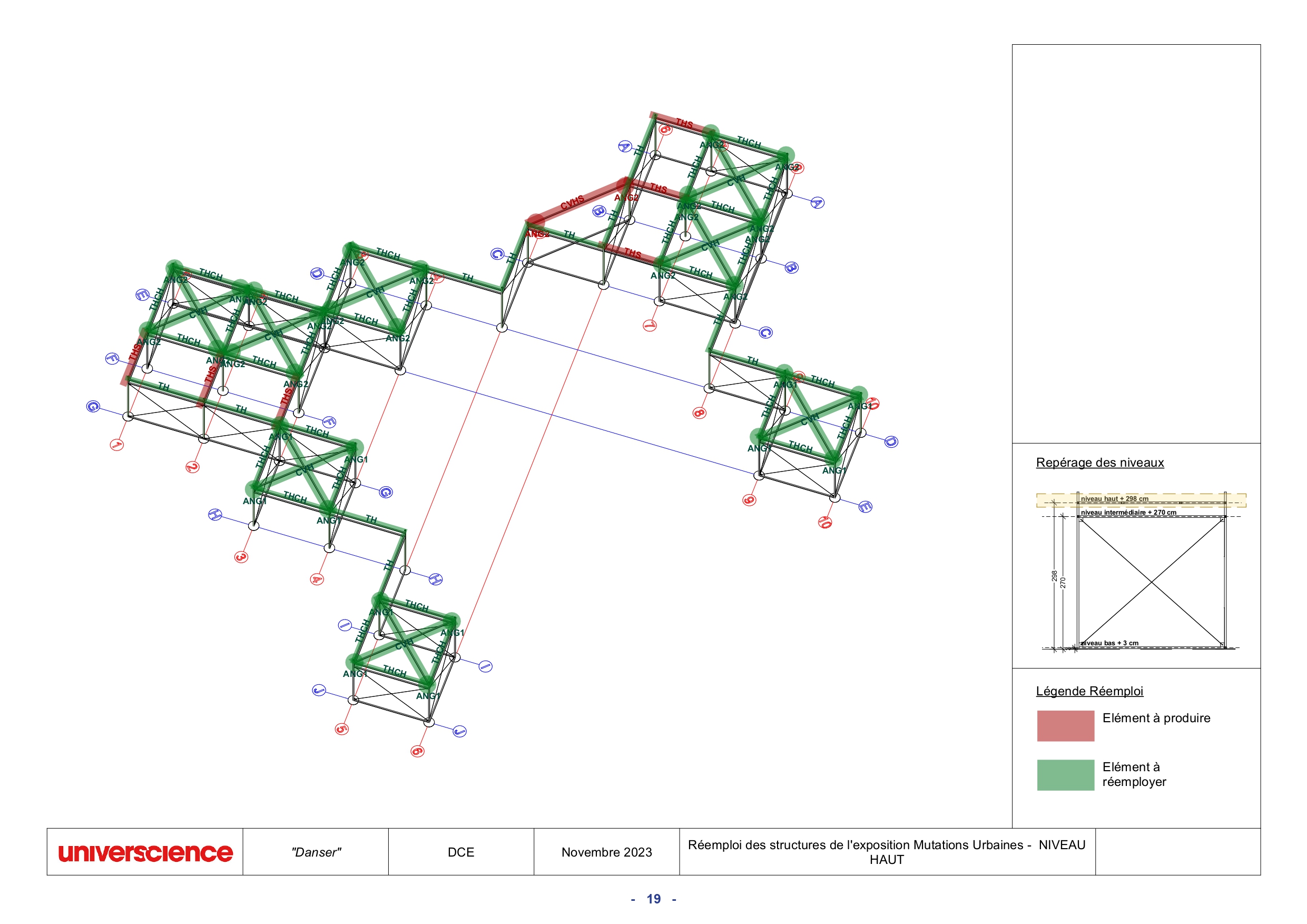
Extrait du DCE de l’exposition Danser @Clara Bombled-Marcandella
Le réemploi est à l’heure actuelle variable en fonction du projet mais la CSI tend à insuffler un pourcentage de réemploi ou de réutilisation dans les expositions aux alentours de 80%.
L’itinérance, une vraie volonté à prendre en compte
Quatre grands principes sont à suivre lorsque nous parlons d’exposition itinérante à la CSI. Vous trouverez à la fin de l’article un document plus détaillé de l’ensemble des principes évoqués ci-dessous.
Tout d’abord, l’exposition doit être modulable. Pour chaque lieu d’accueil, il est nécessaire de prendre en compte ses contraintes architecturales, d’éclairage et de sécurité. Plus l’exposition sera modulable, plus l’exposition sera adaptable à différents lieux. Ceci favorise l’accueil de l’exposition dans divers lieux qui peuvent être très différents.
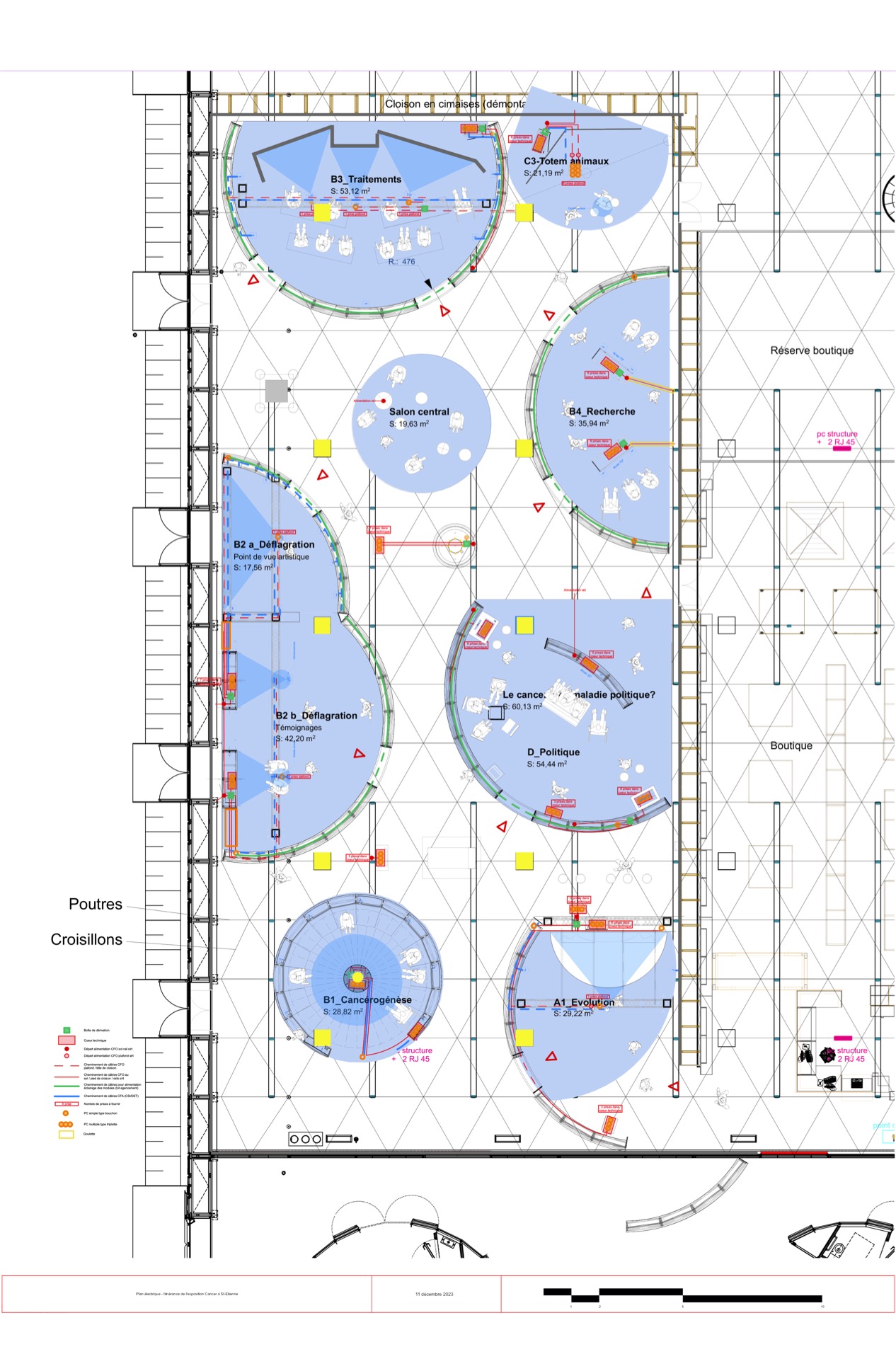
Plan électrique de l’exposition Cancer à la Cité du design de Saint-Etienne, les carrés jaunes représentent des grilles de ventilation présentes au sol et le point jaune l’ancrage du dôme sur le grill technique de l’espace d’accueil @MC
Le deuxième grand principe est la durabilité. Une exposition itinérante est sujette à plusieurs montages et démontages. Il est primordial de concevoir l’exposition avec des matériaux durables, robustes et/ou facilement remplaçables.
Le troisième est la légèreté. Ce principe facilite à la fois le transport, les montages et les démontages des expositions par les équipes.
Le quatrième est l’adaptabilité. Afin de favoriser un accueil par plusieurs institutions, les expositions itinérantes peuvent être pensées avec une version réduite. Un travail est également réalisé auprès des graphistes et des personnes en charge de l’audio-visuelle et du multimédia pour adapter les langues si l’exposition a l’opportunité d’itinérer hors France.
Un dernier élément à ne pas négliger est le transport. Pour faciliter le transport, de l’acheminement du camion à l’espace d’exposition, de nombreuses contraintes viennent s’ajouter, notamment les dimensions des éléments afin d’être le plus efficient possible et favoriser les déplacements au sein du lieu d’accueil.
L’itinérance, une volonté qui limite l’utilisation d’éléments offerts par la Cité des Sciences et de l’Industrie
Le bâtiment de la CSI offre une grande hauteur sous-plafond avec la présence d’un grill technique qui permet de s’accrocher pour l’éclairage et l’audio-visuel notamment. Des cimaises ont également été conçues spécialement pour la CSI, appelées cimaises Sirt. Ce sont des cimaises auto-portantes modulables qui permettent une diversité de possibilités.

Photographie de l’exposition Banquet à la CSI avec le grill technique @E-Laurent-EPPDCSI
Cependant, lorsque qu’une exposition est conçue pour être itinérante, les concepteurs ne peuvent pas utiliser le grill technique ou les cimaises Sirt. Celles-ci peuvent être utilisées seulement pour les parties de l’exposition qui n’itinèrent pas, comme le grill technique. Le grill technique est remplacé par des structures tridimensionnelles Stacco ou Prolite, par exemple, pour répondre aux besoins des éclairagistes et du multimédia.
L’itinérance, une opportunité pour la Cité des Sciences et de l’Industrie
L’itinérance est un réel bénéfice pour la CSI. Elle fait rayonner l’établissement en France et à l’étranger, augmente sa notoriété et valorise le travail des concepteurs sur plusieurs années.
Elle permet d’amortir les coûts de production d’expositions pour les structures d’accueil et de diminuer l’impact environnemental, un transport routier étant moins impactant que la production d'une exposition.
Vous pouvez retrouver l’exposition Danser à la CSI de juillet 2024 jusqu’à juin 2026 et l’exposition Cancer à la Cité du design de St-Etienne jusqu’au 13 juillet 2024.
Nos remerciements à Clara Bombled-Marcandella, architecte-scénographe, et Stéphane Savard, chef de service logistique à la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Maryline Catherine
Pour aller plus loin :
#itinérance #conception #exposition

La gouverneure du roi des Français sur Instagram
Les réseaux sociaux, et Internet en général, sont une merveilleuse mine de contenus accessibles du bout des doigts, dont l’approche peut être la vulgarisation scientifique, qu’ont choisi Charlie Danger, Docteur Nozman, ou encore… Stéphanie Félicité du Crest, comtesse de Genlis.
@felicitedegenlis
Madame de Genlis a tout l’air d’une Instagrammeuse comme les autres : biographie soignée et ponctuée d’emojis, un feed* harmonieux et du contenu scientifique. Les stories* ne sont pas en reste, puisqu’on y trouve régulièrement des tutos pour petits et grands pour fabriquer sa maquette d’une fortification Vauban ou son globe terrestre en papier. Un petit détail différencie pourtant Félicité de Genlis : elle est légèrement au-dessus de la moyenne d’âge de ses collègues, à 275 ans.
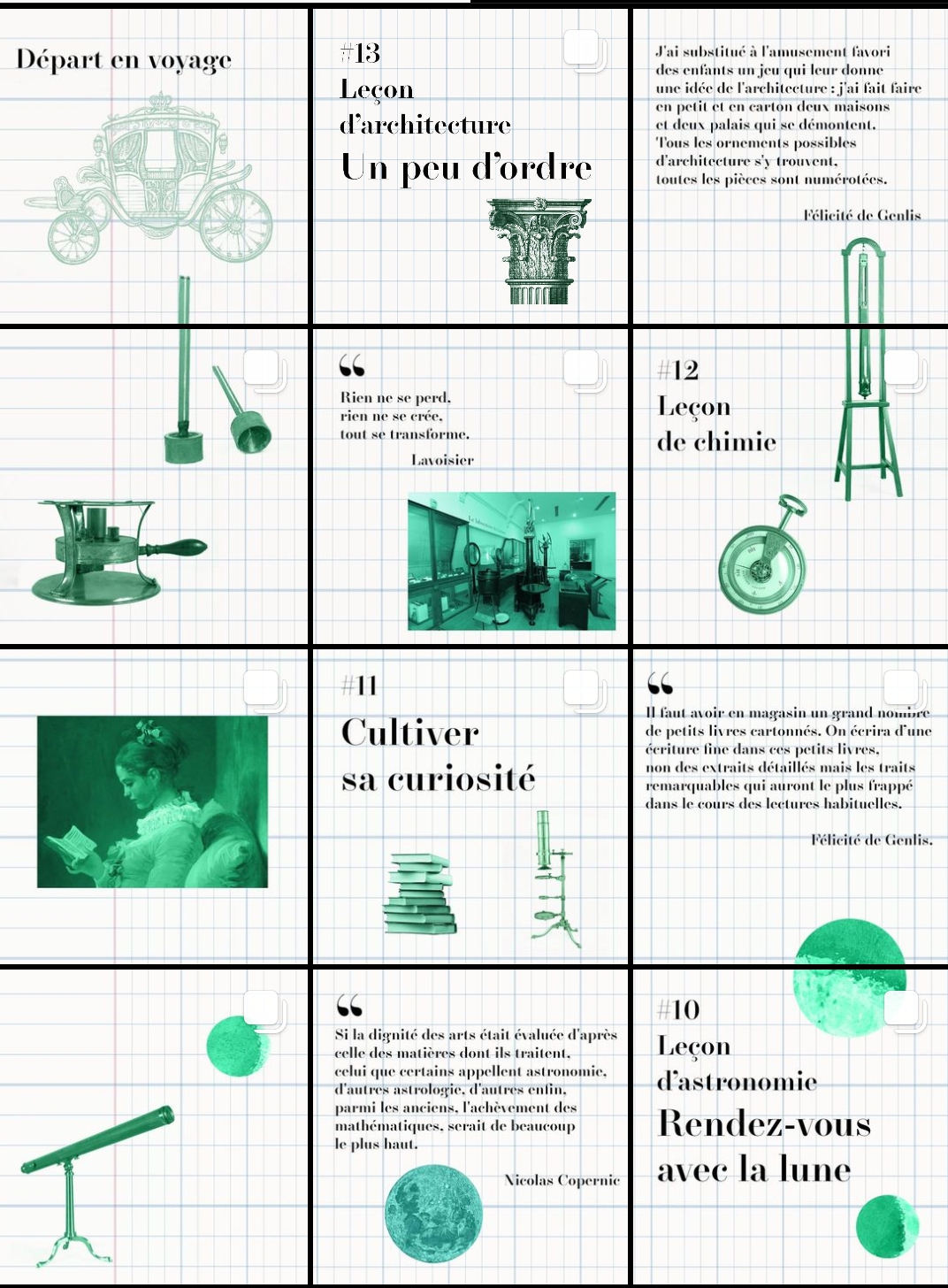
Capture d’écran du compte Instagram
En effet, notre neuf fois trentenaire nous parle depuis l’Ancien Régime, où elle fut la gouverneure des enfants de la famille d’Orléans, dont Louis-Philippe, futur roi des Français. Elle était alors chargée de leur éducation et grande amatrice de la pédagogie active, méthode d’enseignement rendant l’élève acteur de son propre apprentissage. C’est alors naturellement que le musée des Arts et Métiers a décidé d’adopter le même parti pris pour l’exposition qui lui a été consacrée du 16 octobre 2020 au 27 juin 2021, mais qui n’a malheureusement comptabilisé que trois semaines d’ouverture aux publics. Pensée autour de nombreux dispositifs manipulables mais aussi numériques, l’exposition Top modèles. Une leçon princière au XVIIIème siècle s’inscrit alors dans la lignée de madame de Genlis. Du fonctionnement d’un laminoir à celui d’un moule pour les tuyaux de plomb, les visiteur⋅euse⋅s tout comme ses élèves pouvaient s'immerger au cœur des ateliers d’artisans, grâce à des modèles regorgeant de précisions et de détails.
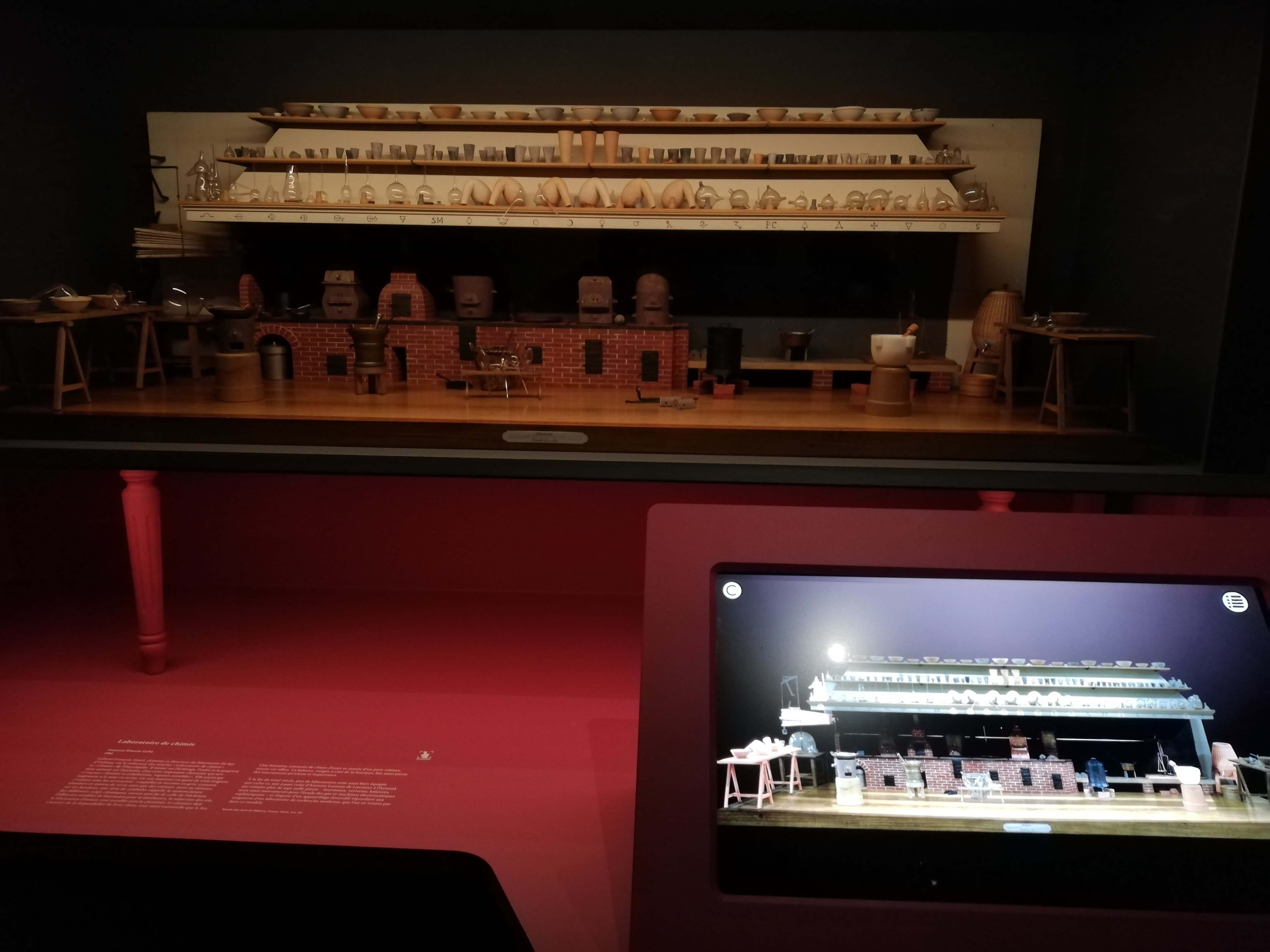
Modèle de l’atelier de chimie et dispositif numérique associé / Jade Garcin
Cette exposition, alors pensée pour être découverte les yeux grands ouverts et du bout des doigts, ne s’est cependant pas contentée d’un unique médium pour exister, et s’est jouée des contraintes liées à la fermeture des musées pour se repenser constamment. Le compte Instagramen est un premier exemple, avec notamment ses nombreux renvois vers le blog…
Apprendre à Bellechasse
Le blog fut le premier né de cette déclinaison de médias d’exposition. Pensé pour être une plateforme éducative, ce site internet partage des activités et leçons scientifiques pour petits et grands. Leçons d’astrologie, de géographie, de botanique… mais aussi création de son propre mobile céleste ou réalisation de sa maquette de fortification Vauban sont au programme. En commençant par la leçon, on découvre des contenus pensés pour aller à l’essentiel, agréablement illustrés par de l’iconographie des plus belles bibliothèques ou des plus beaux musées, comme la bibliothèque Mazarine ou le Rijksmuseum. On y (re)découvre de nombreux savoirs, pour enfin s’amuser et créer avec. Les contenus présents sur notre écran sont au plus proche de ce qui existe entre les murs du musée des Arts et Métiers, mêlant apprentissage et jeu, tout comme l’était pensée l’exposition avec ses différents dispositifs et son application de réalité augmentée.
Nous sommes accueillis au Pavillon de Bellechasse - virtuellement -, comme le furent les enfants royaux, selon la même pédagogie appréciée de madame de Genlis. Et si l’exposition cherchait à séduire un public familial, l'on peut ici imaginer que ce sont les parents en mal d’activités pour leurs enfants qui ont été charmés.
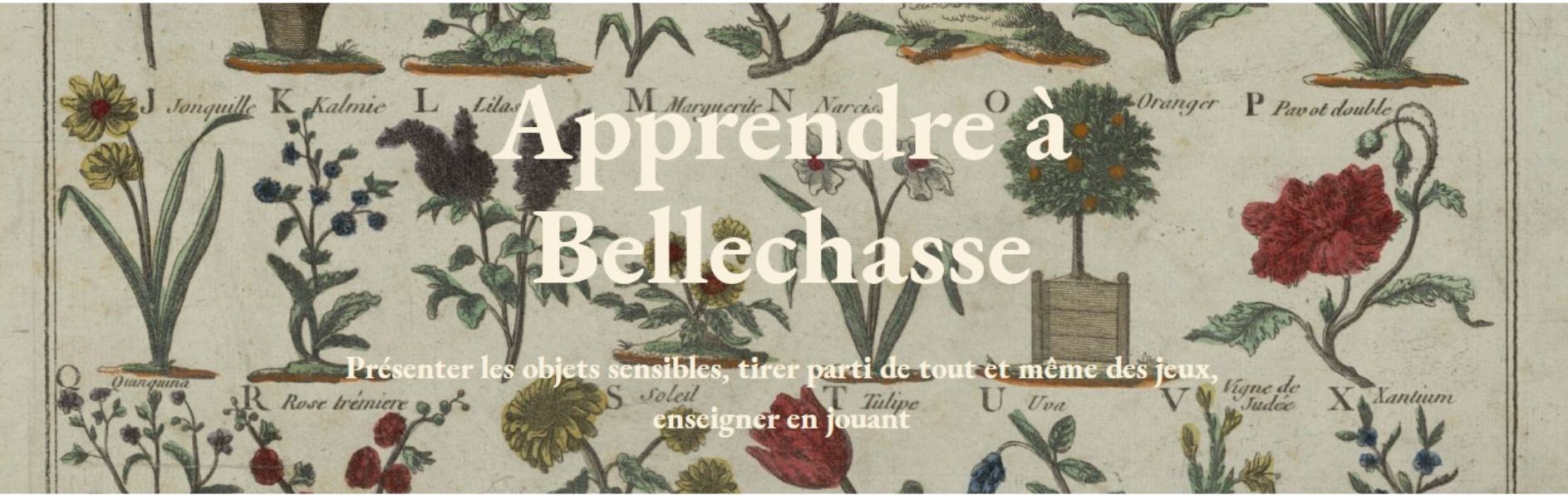
Bannière du blog / Musée des Arts et Métiers
Des manips au numérique...
Félicité de Genlis était convaincue que l’on pouvait apprendre en toute occasion, et de quelque manière que ce soit. En relevant les défis apportés par la fermeture d’une exposition sur la quasi-totalité de sa période d’ouverture prévue, le musée des Arts et Métiers s’est prêté à un exercice créatif de redéfinition des limites d’une exposition. Celle-ci s’est alors muée en un support transmédia, allant à la rencontre des publics de manière rassurante, en restant fidèle à son propos.
Pour autant, il n’était pas question de prétendre pouvoir pallier la fermeture des musées en répliquant exactement tout ce qu’une exposition aurait pu proposer. De lieu de sociabilité, on passe à l’intimité d’un foyer et à la limitation par la taille d’un écran. Les échanges, qui auraient pu se faire entre visiteur⋅euse⋅s ou avec les médiateur⋅ice⋅s n’ont pu se faire une place dans cet univers virtuel.
Cet univers est par ailleurs contraint par les algorithmes, notamment celui d’Instagram, bien souvent critiqué depuis quelques années pour la difficulté que peuvent avoir certains comptes d’être vus, même par leur abonné⋅e⋅s. Ce choix de réseau social permet néanmoins une présentation dynamique et synthétique où l’utilisateur·ice est d’autant plus libre du temps qu’il·elle accorde aux publications, puisqu’il·elle peut décider de les enregistrer pour y revenir à un autre moment de la journée, sans se perdre dans le flux de la plateforme. Enfin, le format blog, en diffusant les contenus sans permettre de réelles interactions, ne rejoint malheureusement pas entièrement les premières ambitions de l’exposition, démontrant une nouvelle fois que si une exposition peut se développer par la transmédialité, elle est bel et bien un médium à part entière, avec ses propres contraintes et opportunités.
Feed : enchaînement des photos et vidéos publiées sur un compte Instagram
Stories : publications éphémères de 24h, sous la forme de photos ou vidéos
#Numérique #Sciences #Médiation

La littérature jeunesse s’infiltre au muséum...
Tranquillement blotti dans votre fauteuil préféré, vous ouvrez votre livre et soudain, vous voilà transporté dans les salles d’un muséum pour y mener l’enquête. Fiction ou réalité ? Plongez dans la collection d’ouvrages jeunesse , Enquêtes au muséum !
Sélection de 10 titres de la CollectionEnquêtes au muséum de Laurence Talairach illustrée par Titwane et publiée aux éditions Plume de carotte © Pauline Dancin
Subrepticement, la fiction et notamment la fiction policière a investi l’univers du musée. Escape games, jeux d'enquête, audioguides et podcasts construits autour d’une énigme à résoudre par des visiteurs transformés en enquêteurs-amateurs font aujourd’hui florès dans les programmes de médiation. Mais si cette rencontre du musée et de la fiction policière se noue désormais sur les sites mêmes, elle s’est longtemps tissée sur le terrain de la fiction seule, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. De la série télévisée L’Art du crime (2017), au best-seller de Dan Brown Da Vinci Code (2003) en passant par L’Exposition (2008) de Nathalie Léger, le musée se pose comme le lieu d’une recherche qu’elle soit résolution d’un crime, quête existentielle ou scientifique. La littérature jeunesse ne fait pas exception à cette intrication de l’enquête et de l’univers muséal. La collection Enquêtes au muséum de Laurence Talairach installe ses intrigues dans les muséums de France et d’Europe. Commencée en 2017 et aujourd’hui composée de 26 titres, cette collection dédiée aux jeunes lecteurs de 8 à 12 ans met en scène les aventures de Zoé, accompagnée de sa meilleure amie Alice et de son petit frère Clarence – sans oublier Archibald, le fidèle chinchilla du garçonnet –, dans la recherche de ses parents, deux ornithologues disparus lors d’une mission en Nouvelle Zélande. Chaque nouvelle aventure entraîne le trio dans la découverte et l’exploration d’un nouveau muséum d’histoire naturelle.
Un projet singulier pour une pluralité de muséums
La quête de Zoé commence au Muséum de Toulouse. Laurence Talairach, professeur à l’Université y mène entre 2008 et 2014, en collaboration avec l’équipe du muséum, un projet de recherche, Explora, consacré aux représentations des sciences du vivant dans les arts et la littérature. Zoé et ses amis font leur entrée en scène dans deux titres, En piste, Punch ! et Le Collectionneur de Sirènes, tous deux situés dans l’établissement toulousain. D’abord soumis à Francis Duranthon, directeur du muséum, le projet de collection est ensuite proposé à la CPMF, la Conférence Permanente des Muséums de France, un réseau formé en 2011, rassemblant aujourd’hui 44 muséums franco-européens dont le Luxembourg et la Suisse.
Le projet est à la fois solidaire et participatif afin que tout muséum, quels que soient sa taille et son budget, puisse y trouver sa place. Il repose sur un financement participatif : les muséums qui le souhaitent, contribuent à hauteur de leurs moyens, entre 500 et 5000 € par an. En échange, ils bénéficient d’une remise sur le stock d’ouvrages à vendre dans leur boutique. Quelle que soit leur mise de fonds, chaque membre de la CPMF a la possibilité de lancer une invitation à Laurence Talairach. C’est ainsi que la quête de Zoé se poursuit depuis 2017 dans quinze muséums de France, de Lille à Marseille, en passant par trois musées européens, Oxford, Luxembourg et Neuchâtel.
Si le titre de la collection met en avant un singulier générique, une des raisons d’être du projet est pourtant bien de mettre en avant la diversité des muséums et de leur patrimoine. Chaque titre installe l’intrigue dans un nouveau site. Si certains se déroulent dans des lieux imaginaires, huit sur les vingt-six titres actuels, ils n’en restent pas moins très inspirés de lieux réels.
Chaque titre repose sur un schéma narratif identique. Une énigme se présente d’abord à Zoé que ce soit un étrange message codé glissé sous le paillasson dans Les Animaux du roi, la mort étrange et simultanée de plusieurs animaux du jardin d’acclimatation dans La Malédiction du gecko ou le soupçon d’un trafic animalier dans Le Monstre marin. Pour résoudre le mystère, Zoé entraîne ses amis dans les couloirs et les salles d’un muséum. Chaque exploration est donc prétexte à une description fine et détaillée de l’architecture et de la géographie des sites. Ainsi, dissimulés dans le MOBE dans Alerte en pleine forêt, les trois amis constatent que « sur chaque mur, des panneaux expliquaient comment participer à des projets de recherche scientifique, comment observer et agir pour défendre et protéger l’environnement, donnant l’exemple d’associations qui militaient pour la sauvegarde de certaines espèces et collectaient des informations. Ici, l’observatoire des vers de terre invitait tout un chacun à recenser les vers ; là, les murs exhibaient l’impact des activités humaines sur l’élévation du taux d’extinction de certaines populations. » Le détail de la description permet aux lecteurs informés, visiteurs ou futurs visiteurs des lieux, un effet de reconnaissance et de familiarité.

Le « 4 Tiers », 4ème étage du MOBE visité par Zoé et ses amis dansAlerte en pleine forêt © Pauline Dancin
La précision de l’ancrage s’explique par le travail préparatoire mené en collaboration avec les établissements. L’invitation reçue, Laurence Talairch engage un premier travail de recherche sur l’histoire du musée et de son patrimoine. Cette étape préliminaire est suivie d’une visite des lieux, notamment des collections permanentes et des réserves, au cours de laquelle l’autrice rencontre l’équipe du muséum et échange avec elle. Cette immersion, d’une journée à une semaine, permet de dessiner et valider le parcours du trio à travers les salles et les couloirs, y compris les espaces réservés au personnel du musée et donc inaccessibles aux publics, afin de dévoiler les coulisses tout en préservant la sécurité des lieux.

Pénétrer les réserves… Vue de l’exposition « Bien conservés ! » au Musée d’Histoire Naturelle de Lille – du 21 octobre 2022 au 03 juillet 2023 © Pauline Dancin
Pourtant, malgré le désir d’ancrage, les muséums sont anonymisés et les indications géographiques gommées. L’identité du lieu n’est révélée que dans le paratexte, le court dossier qui suit la fiction permettant de revenir sur des notions, de les expliciter et de les approfondir. Cette mise à distance de la réalité maintient les muséums dans l’imaginaire, évitant tout effet de vitrine promotionnelle. Il résulte pourtant de cette association entre le détail des descriptions et l’ambiguïté géographique, un sentiment paradoxal d’unité et d’unicité : d’un côté, l’affirmation d’une appartenance à une seule et même identité et d’un autre côté, la revendication de leurs particularités. Cette tension est représentative du statut des muséums dont l’appellation générique regroupe des collections très diverses : zoologie, géologie, botanique, paléontologie, préhistoire, archéologie, ethnographie, anthropologie, médecine, astronomie, pharmacie, physique-chimie, etc. Plus qu’un ancrage dans des lieux, chaque titre ancre l’intrigue dans une collection à partir des objets ou thématiques emblématiques et représentatifs du muséum. Le Palais des Glaces souligne la spécificité ethnographique des collections du Musée de l’Homme et met en avant la statuette de la Vénus de Lespurge ainsi que les cires anatomiques que les trois enfants rencontrent au cours de leur enquête.
A l’entre-deux entre le muséum générique et les muséums pluriels, entre le muséum réel et le muséum fictif, la collection des Enquêtes au muséum entraîne ses lecteurs sur les pas de Zoé, à la découverte de ces lieux de patrimoine. Elle les invite à franchir les seuils, pousser les portes, bref, à pénétrer les musées.
Entrée par les portes dérobées de la fiction
Issues de secours, portes dérobées, entrées de service, tous les chemins sont bons pour pénétrer les muséums et explorer leurs coulisses. Quand les portes principales lui résistent, le trio emprunte des voies détournées, des passages privés et réservés et défie les interdits. C’est là tout l’avantage de la fiction, de permettre cette entrée privilégiée et privée, ce pas de côté pour contourner l’obstacle que représente, peut-être, la porte du musée. Car la fiction joue bien ici un rôle de médiation, de passerelle comme nous le raconte le personnage de Clarence. Le benjamin de la bande, est parfois réticent voire effrayé à l’idée de pénétrer le muséum. Pourtant, sa propre interprétation imaginaire de l’énigme et son désir de résoudre le mystère le poussent à affronter ses peurs et à se confronter à l’inconnu. Ainsi, le petit garçon, persuadé d’une invasion de Luniens, extraterrestres venus de la lune, pénètre seul dans le muséum de Montauban, à la suite de Zoé et Alice parties à la recherche de la météorite écrasée.
Si les enfants pénètrent comme des voleurs, des intrus, obligés de se cacher à la vue des gardiens et des adultes en tout genre, ils ne transforment pas moins le muséum en un lieu familier. Leur statut d’« étrangers » ne résiste pas longtemps à leur capacité à s’approprier les lieux. Ils s’orientent avec facilité dans le dédale des salles. Aucun interdit ne vient les freiner dans leur exploration frénétique : de la cave au grenier, des combles aux réserves, des laboratoires aux bureaux, tous les espaces sont pénétrés, fouillés, inspectés. Au fur et à mesure de leur enquête, les trois enfants font du musée leur maison, leur repère. Seuls dans le muséum, ils ont tous les passe-droits. De manière générale, peu d’obstacles se présentent à eux. Les gardiens sont rares voire inexistants – ils demeurent une menace latente mais rarement réelle –, les portes sont rarement fermées à clef, ni caméras ni alarmes ne dénoncent leur présence : le muséum, tel que le découvrent les enfants, n’est pas une forteresse mais plutôt un lieu ouvert à l’exploration, de jour... comme de nuit.
Bien souvent en effet, Zoé, Alice et Clarence infiltrent le muséum à la nuit tombée, en catimini, lorsque les portes se ferment au tout public. Laurence Talairach joue avec notre imaginaire collectif, celui de l’animation nocturne des collections inanimées. La série de quatre films à grand succès La Nuit au musée, sortis entre 2006 et 2020, a en effet contribué à inscrire dans nos représentations, l’image du muséum comme un être biface et fantastique, présentant aux visiteurs diurnes un visage sage et immobile et laissant tomber le masque dès les portes refermées. Le muséum de Laurence Talairach révèle bien un monde « fantastique », mais ce n’est plus le fantastique chimérique et imaginaire de La Nuit au musée. Certes, le merveilleux demeure par l’intermédiaire de Clarence et de son imagination impétueuse, mais ses fantasmes d’invasion extraterrestre, de savant fou et de fantômes sont vites balayés par le rationalisme de Zoé pour qui le muséum est avant tout un lieu de science et de savoirs. Ainsi, pénétrant dans le muséum, les trois enfants découvrent la fantastique réalité de la nature et du vivant. Ni les animaux empaillés, ni les squelettes qu’ils rencontrent ne s’animent, mais le trio leur découvre un passé, une histoire, un discours qui leur donnent vie et qui font d’eux bien plus que des statues. Chaque enquête mène le trio à se frotter à des problématiques muséales tels que les enjeux de conservation ou la constitution des collections. Ainsi dans L’Énigme de la patte de chat, les enfants sont confrontés aux problèmes de conservation des collections naturalistes liés aux insectes et aux parasites. Dans Les Animaux du roi, ce sont les différentes techniques de naturalisation à travers l’histoire qui sont mises en valeur. La dimension coloniale est développée dans Le Monstre marin et La Malédiction du gecko.

Vitrine pédagogique sur la technique de taxidermie au Musée d’Histoire Naturelle de Lille © Pauline Dancin
Les collections ont une histoire et une vie, certes, mais les lieux aussi sont habités. Au cours de leurs enquêtes, les trois enfants découvrent l’activité cachée des muséums en dehors des expositions permanentes. Dans les coulisses, nombre de personnes œuvrent : techniciens et régisseurs montent et démontent les expositions dans Le Palais des glaces, les conservateurs tiennent l’historique et documentent les collections dans Le Fragment d’étoile, scientifiques et laborantins poursuivent leurs expériences dans Le Roi des rats… Le muséum se donne à lire comme un lieu de vie inconnu, dépaysant et déroutant mais délicieusement attirant puisque sa découverte nécessite d’enfreindre un interdit : pénétrer la nuit, sortir des sentiers balisés…
La fiction invite les lecteurs à pénétrer le muséum par ses petites portes, à la suite de Zoé, sans même quitter son lit. Ce premier seuil franchit, comment ne pas avoir envie de pousser les grandes portes ? C’est le pari que lancent plusieurs muséums dont celui de Toulouse. Ce dernier s’est emparé des Enquêtes pour proposer un programme de médiation à destination des scolaires de cycle 3. Le projet se structure en plusieurs sessions au cours desquelles il s’agit d’abord de découvrir l’œuvre littéraire, de se familiariser avec le muséum de papier avant d’aller rencontrer le muséum de pierre. La collection permet d’engager un dialogue autour de notions-clés liées à l’activité muséale et aux sciences du vivant. Mais plus encore, l’écrit devient un lien fort reliant les élèves au muséum, grâce à l’entretien d’une correspondance avec le médiateur. La fiction ouvre la porte à la découverte du muséum, permettant de tisser des liens qui ne sont pas seulement érudits, scientifiques mais aussi oniriques, poétiques, émotionnels, affectifs.
Parents et patrimoines naturels : une histoire de filiation
Un fil rouge relie les différents titres de la collection : la disparition des parents de Zoé lors d’une mission scientifique en Nouvelle Zélande. Leur métier d’ornithologue permet d’articuler au fil rouge de la parentalité celui de la biodiversité et de l’environnement. Si chaque titre apporte une preuve supplémentaire de la vie des parents de Zoé, il le fait au travers d’une nouvelle intrigue mettant en jeu des problématiques environnementales liées aux collections des muséums.
La spécificité de cette collection est aussi de mettre en valeur les missions contemporaines des muséums. Leur rôle de conservation des patrimoines naturels et culturels ne se limite pas à la protection d’une collection mais aussi à celle de la biodiversité. La protection des espèces menacées (Le Monstre marin), les programmes de recherche (Le Roi des rats), le développement des sciences participatives (Alerte en pleine forêt) sont autant de missions aujourd’hui assumées par les muséums que découvrent Zoé et ses amis. Plus largement, la collection joue un rôle de vulgarisation des savoirs liés aux théories de l’évolution et à la formation du vivant. Le Fragment d’étoile aborde au travers des météorites le mystère de l’extinction de masse des dinosaures quand Le Secret de Mélusine introduit la théorie de l’évolution au travers du plésiosaure.
Le choix du genre policier permet de souligner la valeur et la préciosité de ce patrimoine qu’est la biodiversité, à la fois dans sa dimension économique avec les spécimens protégés par la CITES saisis par les douanes dans Le Monstre marin mais aussi dans sa dimension existentielle. Les différents titres soulignent la fragilité de ces espèces éteintes ou menacées d’extinction et leur participation à l’équilibre de la chaîne du vivant. L’importance de ce patrimoine est aussi illustrée par son articulation à la parentalité : retrouver la trace de ses parents et préserver les traces du vivant sont finalement une seule et même quête.
Le muséum devient un espace névralgique où se rassemblent ces différents fils. Il se donne à voir à la fois comme un lieu de savoirs et de mémoire des évolutions passées, mais aussi comme le gardien d’un patrimoine vivant toujours en mouvement. Le muséum nous relie au monde, que ce soit au microcosme familial ou au macrocosme de notre environnement.
Le muséum de Laurence Talairach est un lieu de réponses et de résolutions plurielles, à la différence de nombreux ouvrages jeunesse, romans et escape books, qui font du musée le lieu d’une énigme dont la solution se trouve à l’extérieur, dans la ville et la rue. Ainsi, dans Mission dinosaure : Vol au musée d'Histoire naturelle de Lille (2016) de Nancy Guilbert, les trois amis Ylan, Nell, Théo, accompagnés de leur chien Mozart, partent à la recherche du squelette d’iguanodon, dérobé dans la nuit. Point de départ de l’intrigue, le muséum restera un lieu mystérieux et inexploré : empêchés par les policiers d’entrer dans le muséum, les trois enfants suivent les indices à travers la ville, jusqu’à la découverte du pot aux roses, dans un appartement lillois. Le muséum disparaît petit à petit au profit de l’enquête et de sa résolution. Une fois le mystère levé, rien ne ramène les enfants dans l’enceinte du musée. Le musée pose des questions, mais ne les résout pas. La réponse se trouve au dehors.
D’une façon similaire, Timothée et Liv, les jeunes détectives du Mystère de l'Alcyon (2020) écrit par Philippe Declerck, se heurtent, lors d’une visite scolaire au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, au problème d’une toile : qui est son vrai propriétaire ? Aurait-elle été volée ? Leur enquête les mène à l’extérieur du musée, dans la maison de monsieur Rubinstein, jusqu’aux archives départementales. Une fois de plus, le musée se pose comme un lieu de questionnements et non comme un lieu de réponses. Mais à la différence de Mission dinosaure, la résolution du mystère permet aux enfants de réinvestir le musée avec un regard informé.
Ces deux exemples esquissent les traits d’un paradigme de la représentation du musée dans la littérature jeunesse : le musée fait énigme – et peut-être n’est-ce pas un hasard s’il apparaît majoritairement dans la littérature policière –, il pose question, titille, intrigue, stimule, il fait naître une envie de connaissance. Mais le mouvement qu’il impulse est toujours dirigé vers le monde extérieur.

Le musée fait question mais la réponse est au dehors… Couverture de deux romans jeunesse
En posant le muséum comme un lieu de réponses à des quêtes plurielles, Laurence Talairach façonne dans l’imaginaire des jeunes lecteurs une nouvelle représentation du muséum. Il n’est plus uniquement le lieu du problème et de l’incompréhension, le lieu à quitter pour pouvoir avancer, mais il est un lieu qu’on pénètre, un lieu qu’on explore, un lieu qu’on investit. En devenant lieu de réponses, le muséum devient un espace habitable tant pour la fiction qui peut y dérouler son intrigue que pour les lecteurs d’aujourd’hui et futurs visiteurs. C’est aussi parce qu’il est un lieu de réponses que le muséum cesse d’être indifférent et détaché du monde. En peignant un muséum conscient et à l’écoute des enjeux contemporains, la fiction peut aborder des sujets engagés, tels que la biodiversité, et représentatifs des défis qui se présentent aujourd’hui aux muséums. Alors, plus besoin de preuves, partez à la recherche des Enquêtes au muséum… !
Pauline Dancin
Merci à Laurence Talairach d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Sources
- Charon Patrice, « Les collections des muséums d’Histoire naturelle en chiffres », La Lettre de l’OCIM, 25 juin 2014, no153.
- Cpmf, « Une définition inadaptée », La Lettre de l’OCIM, 1 novembre 2019, no186, p. 18-20.
- Duranthon Francis, « Point de vue : Enquêtes au muséum, un projet d’édition collectif original », La Lettre de l’OCIM, février 2019, no 181, p. 59-61.
- Declerck Philippe, Le Mystère de l’Alcyon : Drôle d’affaire au musée de Dunkerque, Aubane éditions, coll. « Polars du nord junior », 2020.
- Guilbert Nancy, Aventure au musée de l’Institut Pasteur de Lille, Villeneuve d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2018.
- Guilbert Nancy, Mission dinosaure : Vol au musée d’Histoire naturelle de Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2016.
Pour aller plus loin
- AG, « À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ? », L’Art de Muser, décembre 2020.
# Enquêtes au muséum # Laurence Talairach # littérature jeunesse

La mécanisme d’Anticythère a son médiateur particulier
Un outil spécial pour un objet spécial
Le mécanisme d’Anticythère, ça ne vous dit rien ? Votre esprit se remplit d’un grand point d’interrogation ? Si je vous précise qu’il s’agit d’un mécanisme de calculs scientifiques tout droit venu de l’an 87 avant Jésus-Christ, vous commencez à prendre peur ? Et si je vous propose de vous l’expliquer, en tenant compte des aspects historiques, scientifiques, astronomiques et mécaniques, ça vous tente ? Non, et c’est normal. Il est toujours un peu effrayant de tomber nez à nez avec une machine inconnue au nom compliqué dont l’aspect à tendance à vous faire croire que vous ne pourrez jamais la comprendre. Et pourtant, il existe l’outil de médiation parfait pour nous aider à percer les secrets de la machine d’Anticythère, ou du moins essayer.
L'outil de médiation © M. T.

Le principe de l’outil
Le tableau de bord pour activer les mouvements de la caméra et l’écran qui retranscrit en direct les images. © M. T.
La vitrine est encastrée, l’objet n’est visible que par une seule face, et son support est assez conséquent. En effet il est maintenu dans un bloc rectangulaire qui n’aide pas à le rendre visible. Cela est certainement dû à des problèmes de conservation et de fragilité. Mais pour rendre cet objet plus accessible, en terme de lisibilité, un système de caméra mobile a été installée, elle circule sur deux plans : elle tourne autour de l’objet sur un axe horizontal, mais aussi sur un axe vertical.
Les images de la caméra sont retranscrites en direct sur un écran à côté de la vitrine. Une table de contrôle est à disposition du visiteur en dessous de la vitrine : elle permet de faire pivoter la caméra. Six positions sont préenregistrées, ce sont les plus intéressantes au niveau de l’observation de l’objet. Mais le visiteur peut aussi faire pivoter librement la caméra en utilisant la sphère sur l’écran tactile. Il peut aussi activer un zoom, pour observer les nombreux détails de l’objet, mais celui-ci étant numérique, la qualité n’est pas excellente.
Un petit élément vient tout de même perturber la lecture de l’objet, il s’agit d’engrenages qui viennent se dessiner sur la face visible de la vitrine. L’objet étant déjà petit et le mécanisme de la caméra assez gros, on ne comprend pas pourquoi des roues crantées viennent s’installer dans le champ de vision. Cet élément uniquement décoratif n’apporte rien et trouble la compréhension de l’objet pendant un instant.
Un outil de médiation stratégique
En soi, cet outil ne diffuse pas d’informations, il permet juste de constater les prouesses techniques et l’esthétique de l’objet. Mais surtout, il éveille la curiosité. En effet, une fois que l’on s’est bien amusé avec, on se demande quand même à qui est destiné cet objet et quel est son rôle : il éveille la curiosité. Il permet une autre forme de médiation avec les autres supports de l’espace. On peut donc apprendre avec plaisir que ce minuscule objet est le plus ancien mécanisme à cran que l’on ait trouvé et que c’est un mécanisme de calcul qui se base sur l’année solaire et l’année lunaire égyptienne. Il traduit un phénomène cyclique en prenant le mouvement des astres comme fondement. Le mécanisme d’Anticythère est « la synthèse des connaissances astronomiques et du savoir-faire mécanique de son époque ». Ainsi nous pouvons aussi apprendre ses 16 fonctions. On peut se demander pourquoi l’écran et la vitrine ne sont pas côte à côte, ce qui oblige à ne regarder que l’un ou l’autre, mais cela a aussi un autre intérêt : ceux qui ne sont pas attirés par le fait de manipuler le tableau de contrôle peuvent quand même suivre l’action et découvrir l’objet en restant à une certaine distance.
Cet outil de médiation est donc intéressant car il valorise l’esthétisme et la technique, par le biais de la technologie, pour susciter chez le visiteur une curiosité favorisant l’envie de découvrir cet objet. L’espace dans lequel il est présenté résulte d’un partenariat entre la Fondation nationale de la recherche scientifique hellénique, le Musée national archéologique d’Athènes, le projet de recherches sur le Mécanisme d’Anticythère et la manufacture horlogère Hublot de Genève. Il a également été placé sous la tutelle de la délégation permanente de la Grèce auprès de l’Unesco.
Mélanie TOURNAIRE
Des infos sur l'expo et sur l'intrigante machine ici
La Nuit met nos sens en éveil !
L’exposition La Nuit qui se tient jusqu’au 03 novembre 2014 au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris vous a déjà été présentée sur ce blog en août 2014 (Cliquez ici !). Ce précédent article a été l’une de mes motivations pour aller voir cette exposition : traverser des forêts peuplées d’animaux avant de rencontrer les monstres qui hantaient les nuits de mon enfance, beau programme ! Mais La Nuit est plus qu’une déambulation au sein d’un parcours muséographique. Tous nos sens se mettent en éveil grâce aux dispositifs de médiation qui nous sont proposés.
L’exposition se trouve en rez-de-chaussée et plus nous descendons les marches, plus nous avançons dans la pénombre de la nuit noire. Ce choix scénographique apparait évidemment de circonstance, mais il est plus qu’un simple écho au titre de l’exposition. L’obscurité nous happe et met directement nos sens en alerte : nos yeux sont forcés de s’habituer à cet éclairage particulier, nous acceptons de nous plonger dans l’obscurité.
Dès la première partie de l’exposition notre toucher est sollicité : c’est une météorite qui s’offre à nos doigts. Difficile de voir à quoi elle ressemble précisément mais nous découvrons vite deux ressentis différents. Une partie est lisse, l’autre plus granuleuse. Ces expériences tactiles nous seront proposées à plusieurs reprises au sein du parcours muséographique, notamment lorsque nous traverserons la nature sauvage. Le toucher nous permet ainsi de savoir quel animal nous avons en face de nous ou, au contraire, celui que nous suivons à la trace.
Nos autres sens sont sollicités à des moments précis de l’exposition dans des maisonnettes nous proposant plusieurs expériences. Nous sommes ainsi totalement immergés dans la nuit : ce que l’on voit, les sons que l’on entend, les odeurs qui nous parviennent. Le goût n’est pas évoqué ? Qu’à cela ne tienne, d’autres expériences si coutumières aux animaux nous attendent pour nous dérouter.
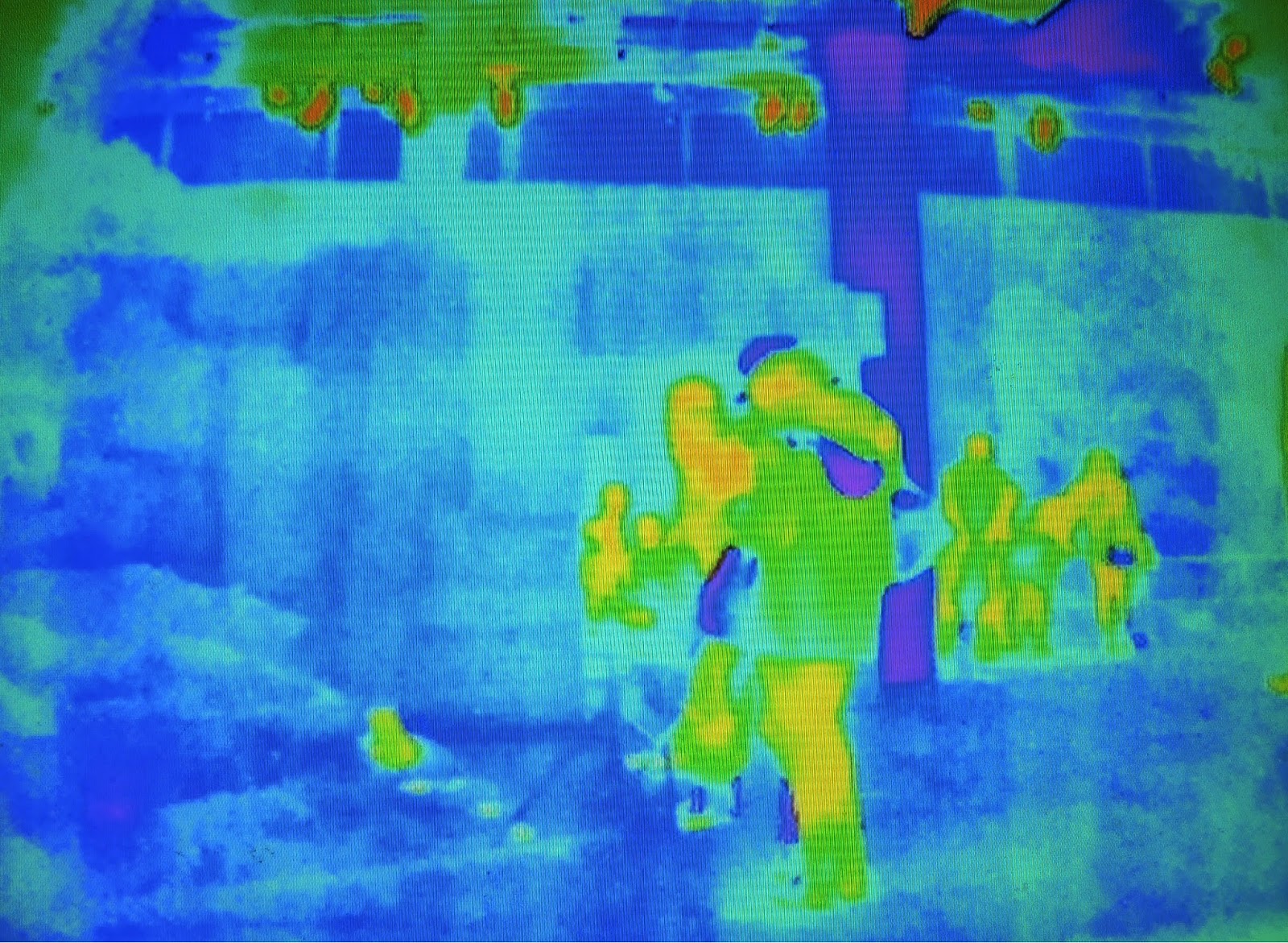
Dispositif de vision thermique - © Albc
L’intérêt de ces dispositifs est aussi qu’ils nous permettent de nous glisser un instant dans la peau d’un animal. Si pour nous un paysage est quasiment noir, en regardant à travers trois lunettes nous voyons que les perceptions du chat, du rat ou de la chouette sont toutes différentes. De même, la partie sur le sixième sens nous permet d’essayer de nous repérer comme le serpent le fait grâce à la vision thermique. Vous ne verrez plus les amis qui vous accompagnent à cette exposition de la même façon !
Et bien entendu nous pouvons mettre à l’épreuve nos propre sens : vous n’entendrez peut-être jamais plus un papillon d’une façon aussi audible ! Vous saurez désormais de quelles fleurs proviennent les odeurs qui nous montent au nez quand on se promène dans la nuit.
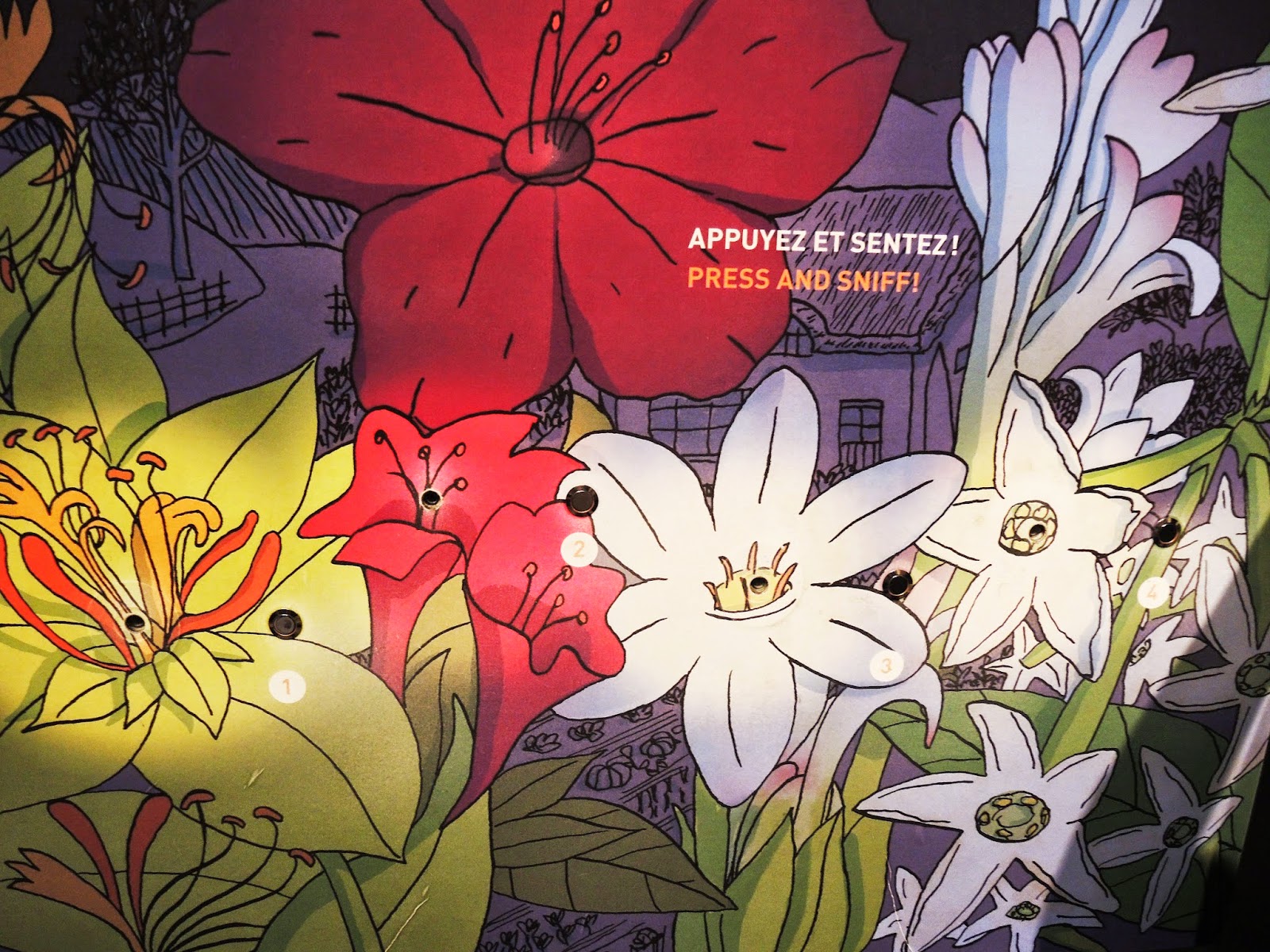
Dispositif utilisant l'odorat - © Albc
Tous les sens en éveil, nous explorons avec plaisir et curiosité ce monde d’obscurité, prêts à nous émerveiller, à être étonnés par cet univers parfois effrayant. L’esprit alerte et disponible nous appréhendons la nuit d’un point de vue scientifique et ludique. Chacun se laisse porter par cette exposition où l’on apprend sans s’en rendre compte.
Comme l’écrit un visiteur dans le livre d’or : « Une expo qui ne nuit pas ! »
Aénora Le Belleguic-Chassagne
Pour en savoir plus :
- Lien vers le site internet de l'exposition
#sciences
#expériences#sens

La rencontre du design et de la culture (scientifique)
Mettant les publics au cœur de ses préoccupations, les institutions culturelles cherchent sans cesse de nouvelles façons d’améliorer leur expérience de visite. Pour ce faire, le recrutement de professionnel.le.s aux parcours et compétences diverses est souvent envisagés. Ces politiques d’embauche témoignent d’une volonté d’apport de polyvalence et de transversalité dans les équipes.
Dans cet esprit, Le Vaisseau, un centre culturel et scientifique dédié aux enfants de 3 à 12 ans, à Strasbourg, a accueilli depuis mars dernier, Clara Speiser, une designeuse produit. A travers un entretien, je vous invite à découvrir son regard neuf et transversal.
Peux-tu te présenter ?
« Je m'appelle Clara Speiser, j'ai 26 ans, je suis designeuse d'objet, et actuellement, j'exerce cette fonction au Vaisseau ! »
Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?
« Mon DUT en science des matériaux m’a appris les différentes familles de matériaux, le verre, la céramique, les métaux, les polymères naturels et les polymères synthétiques et les composites. C'était fascinant ! J'y ai découvert pour chacun les propriétés microscopiques, macroscopiques. C’est, pour résumer, tout ce qui les caractérise et les procédés de fabrication qui leurs sont affiliés.
A ce stade de mon parcours, j'ai voulu apprendre à mettre en forme ces matériaux qui occupent notre quotidien. J'ai souhaité, moi aussi, leur donner corps et les faire vivre en tant qu'objet. Je suis donc partie en licence professionnelle à l'école de design de Nantes Atlantique pour me former au design d'objets.
Dans cette année charnière pour mon orientation, j'ai rencontré des enseignant.es/designers qui m'ont appris à créer des objets en accord avec un brief client. A travers une série de questions, ils m’ont appris à insuffler des valeurs à un objet, à effectuer un travail de recherche créatif pour donner un sens à l'objet. L'utilisateur est-il un enfant ? Un.e sportif.ve? Un.e retraité.e ? Dans quel lieu va être utilisé l'objet ? Sous l'eau ? En pleine nature ? À l'hôpital ? Dans une cuisine ?
Quelle valeur veut-on que l'objet dégage ? Veut-on qu'il soit robuste, ludique, minimaliste, honnête, futuriste, biomimétique, délicat, durable, élégant, dynamique, ....?
J’ai ainsi appris à m’interroger et définir les nombreuses caractéristiques que possèdera l’objet que je réalise : ses lignes, les matériaux utilisés, leurs aspects de surface, les couleurs choisies et sur quels éléments de l'objet, les mécanismes apparents ou non, les vis visibles et même exagérées, les formes arrondies ou anguleuses, des formes bombées ou très fines, des contours amplifiés, etc.
Je pense qu'à l'issue de cette licence, j'en étais là en termes de design d'objet. J'étais capable de mettre en place une démarche créative pour dessiner un objet pertinent pour un utilisateur et un contexte d'utilisation.
J'ai eu besoin d'aller plus loin, et d'approfondir le design. C’est pourquoi j’ai intégré une Ecole d’Ingénieur à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et leur formation « Ergonomie design et ingénierie mécanique ».
Cela m’a permis d’obtenir la double casquette ingénieur/designer.
J'ai appris à me servir de plusieurs logiciels de conception 3d, tels que Solidworks, Rhinocéros et Catia V5. J'ai pu me perfectionner sur ce dernier pendant ces 3 années d'études à un niveau avancé.
Durant cette formation, je me suis également formée aux méthodes et outils pour l'ergonomie et l'éco-conception qui sont des domaines transversaux du design d'objet.
Enfin, j’ai pu découvrir de nouvelles méthodes de créativité, de design thinking tout en m’exerçant au dessin, au maquettage et au prototypage.
Je terminerai là-dessus en précisant que lorsque je conçois un objet, mon objectif est toujours l'utilisateur et l'expérience qu'il va pouvoir vivre à travers l'objet. »
Que fais-tu au Vaisseau ?
« Au Vaisseau, je conçois les éléments d'exposition interactifs pour les enfants autrement appelé les manipes. Pour moi, le demandeur, c'est le muséographe. Il veut une exposition qui va raconter une histoire avec les objets interactifs pour véhiculer telle notion.
Suite à sa demande, je réalise des objets fonctionnels, et en adéquation avec la durée de vie de l'exposition qu’elle soit temporaire ou permanente. Pour cela, je dessine, croque, maquette, prototype avec des imprimantes 3d, une découpeuse laser.
Puis je passe par la phase de modélisation en 3D sur le logiciel Solidworks que j'implémente dans l'espace avec le logiciel SketchUp.
D’un projet à l’autre, je n'ai pas toujours les mêmes contraintes. Parfois, les manipes seront réalisées dans l'atelier de fabrication du Vaisseau, parfois, leur fabrication sera externalisée. L'une ou l'autre option dépendent toujours d'un unique facteur : le budget !
Ces contraintes de départ sont importantes car elles vont énormément impacter la direction artistique que vont prendre les objets.
Pour une exposition à 100% réalisée en interne, les formes des objets dépendront :
- des machines que l'on possède en interne et des matériaux qui leurs sont affiliés (principalement des plaques de bois)
- des compétences et des techniques des techniciens
- du délai du projet, donc du temps imparti pour la réalisation

Des prototypes de manipes pour l’exposition La Caverne © M.D
Je cherche le plus souvent à trouver des procédés de fabrication réalisables en interne. Et parfois, je suis amenée à aider à la fabrication finale. Je peins, visse, ponce, fabrique des moules en impression 3d et des contre moules en silicone entre-autre.
Dans cette configuration de création de manipe, je suis limitée en termes de moyens, de machines et de matériaux. Mais aussi contradictoire que cela puisse paraître, j'ai aussi plus de liberté dans mon expression artistique.
Je m'explique : Dans le cadre d'une exposition à plus gros budget, on peut faire des marchés de scénographie. À partir de là, la direction artistique sera entre les mains de la scénographie. J'aurai alors une posture beaucoup plus conciliante où je serai entre les choix de la scénographie et les faisabilités techniques des fabricants/manipeurs (donc les personnes qui branchent, programment, soudent, fabriquent le produit fini).
Je me trouve alors à la direction de conception des éléments de l'exposition.
Ainsi, j'intègre dans mon dessin 3D les codes formels et graphiques de la scénographie pour être en accord avec l'univers à naître. Et de l'autre côté, j'intègre dans mes volumes les contraintes du manipeur, c’est-à-dire les passages de câbles, les zones d'accès technique.
Malgré toutes ces contraintes auquel je dois concéder, je suis aussi garante de mes propres choix, que je défends : l'usage et ce que vont faire les enfants avec les objets. Un choix d'usages et des scénarii d'utilisation que j'ai d'ailleurs co-construits avec le(s) muséographe(s) du projet. »
Que penses-tu que le design produit peut apporter comme valeur ajoutée à un centre de sciences comme le Vaisseau ou aux institutions culturelles en général ?
« L'utilisateur est au cœur de la conception. En cela, le design s'assure que le parcours utilisateur sera positif.
En tant que designeuse, je pense aux postures, aux tranches d'âges et leurs tailles associées, aux sens mis en jeux pendant l'utilisation, sons, vue, toucher, l'odorat (ce qui me pousse à fuir les matières qui sentent le chimique, le "neuf" !).
Je pense aussi à l'approche : un jeu de résolution un peu complexe devra être détaillé et rassurant pour guider l'enfant vers la solution. Un jeu qui laisse une grande place à l'imagination de l'enfant devra être très suggestif, presque effacé (ex : il suffit d'un canapé et de quelques oreillers pour qu'un enfant créé une île au milieu d'une étendue de lave).
Le design c'est l'usage, c'est se mettre à la place de l'utilisateur pour lui faire vivre une expérience positive. »
Venue renforcée l’équipe du service de Conception et Développement de Projets, Clara vient répondre à l’un des objectifs : la conception des manipes en interne. Soucieuse de proposer un usage adapté aux enfants, elle assure une conception viable des manipes améliorant ainsi l’expérience de visite des publics.
Focus sur une manipe : De la demande au processus de conception à la phase de réalisation
Dans le cadre de la toute nouvelle exposition permanente Caverne, portant sur les couleurs dans la lumière et les illusions d’optique, Clara a eu l’occasion de mettre en pratique tout son processus de création. En effet, toutes les manipes de cet espace ont été entièrement réalisées en interne. Nous allons ici nous intéresser à l’espace « Coin du feu » dans lequel Clara a conçu et réalisé le « feu ». Ce dispositif lumineux vient dessiner l’ambiance de cet espace autour duquel on peut se rassembler en tribu (une famille, un groupe de visiteur.euses en « langage Vaisseau »). Il devient ponctuellement un espace de médiation que les animateur.rices peuvent s’approprier en profitant du dispositif de Clara, qui cache un rétroprojecteur, pour réaliser un théâtre d’ombres.
La réalisation de ce dispositif peut se diviser en plusieurs étapes
1. La demande
Cette « étape 0 » permet de comprendre les besoins, ici en l’occurrence des muséographes en charge du projet qui vont co-rédiger le cahier des charges qui est la base de travail de la designeuse.
2. La phase de recherche
Elle comprend une phase exploratoire à travers des planches d’inspiration et du sketching. Elles vont concerner l'usage et les scénarii, les postures qui sont envisageables, et aussi les matières.
L’idée, à ce moment du projet, est de ne pas se restreindre, et de se laisser aller à la créativité, aucune idée n'est encore à écarter.
Planche d’inspiration pour le dispositif © C.S
3. La phase convergente (cf le design thinking)
Le manque de temps à cette étape du projet ne permet plus d’explorer les différentes pistes pour des questions évidentes de plannings. Il est donc temps de passer en phase convergente et de resserrer ses idées. Pour cela, il faut formuler des concepts, 4 maximum.
Ils sont matérialisés par une architecture produit, donc une forme non définitive, qui suggère l'intention, mais dont le scénario est plus détaillé qu’en phase recherche.
À ce stade, le détail formel et graphique des concepts peut en réalité être plus ou moins avancé. Plus avancé si par exemple le demandeur est très précis sur ce qu'iel désire, ou si la designeuse est libre dans la direction artistique que doit prendre le projet. Moins avancé si la forme se construit en ping-pong avec les scénographes, qui est à la direction artistique, ou bien encore si le produit va subir beaucoup d'évolutions techniques en fonction des prototypes réalisés.
Les trois propositions pour le feu de l’exposition Caverne © C.S
4. Le choix
Vient finalement l’heure de présenter ses concepts au demandeur.euse.s qui choisiront le plus pertinents selon le projet. Il est parfois possible que ce soit un concept « bis » issu de deux propositions combinées ensemble.
5. La vérification de la viabilité
Il faut ensuite réaliser des maquettes et/ou des prototypes.
A coup de cartons récupérés, de cutter et de colle, la designeuse conçoit des maquettes. Ce sont des objets statiques dont on se sert pour valider des dimensions et des postures. Il est parfois possible d’utiliser la découpe laser pour des formes difficiles à découper au cutter. Le but, à cette phase du projet, est de limiter au maximum les matières coûteuses et plus « précieuses » que le carton usagé (bois et plastique entre autres).
Quant aux prototypes, ils sont là pour valider des fonctions, qu'elles soient mécaniques ou électroniques. L’utilisation de matières plus coûteuses et de procédés plus précis permet ainsi de rester fidèle aux jeux de mécaniques.

Test des rendus lumière du prototype. © M.D
6. Définition de l’architecture produit détaillé
Les conclusions des maquettes et des prototypes vont permettre de définir l'architecture produit détaillée, puis de modéliser l'objet en 3D dans sa version finale.
Architecture produit du dispositif du « feu » © C.S
7. Les plans techniques
On termine par la réalisation de plans techniques pour la fabrication. Dans le cas de Clara, certains plans iront pour l'atelier du Vaisseau et d'autres pour des éléments sous-traités ne pouvant être réalisés en interne.
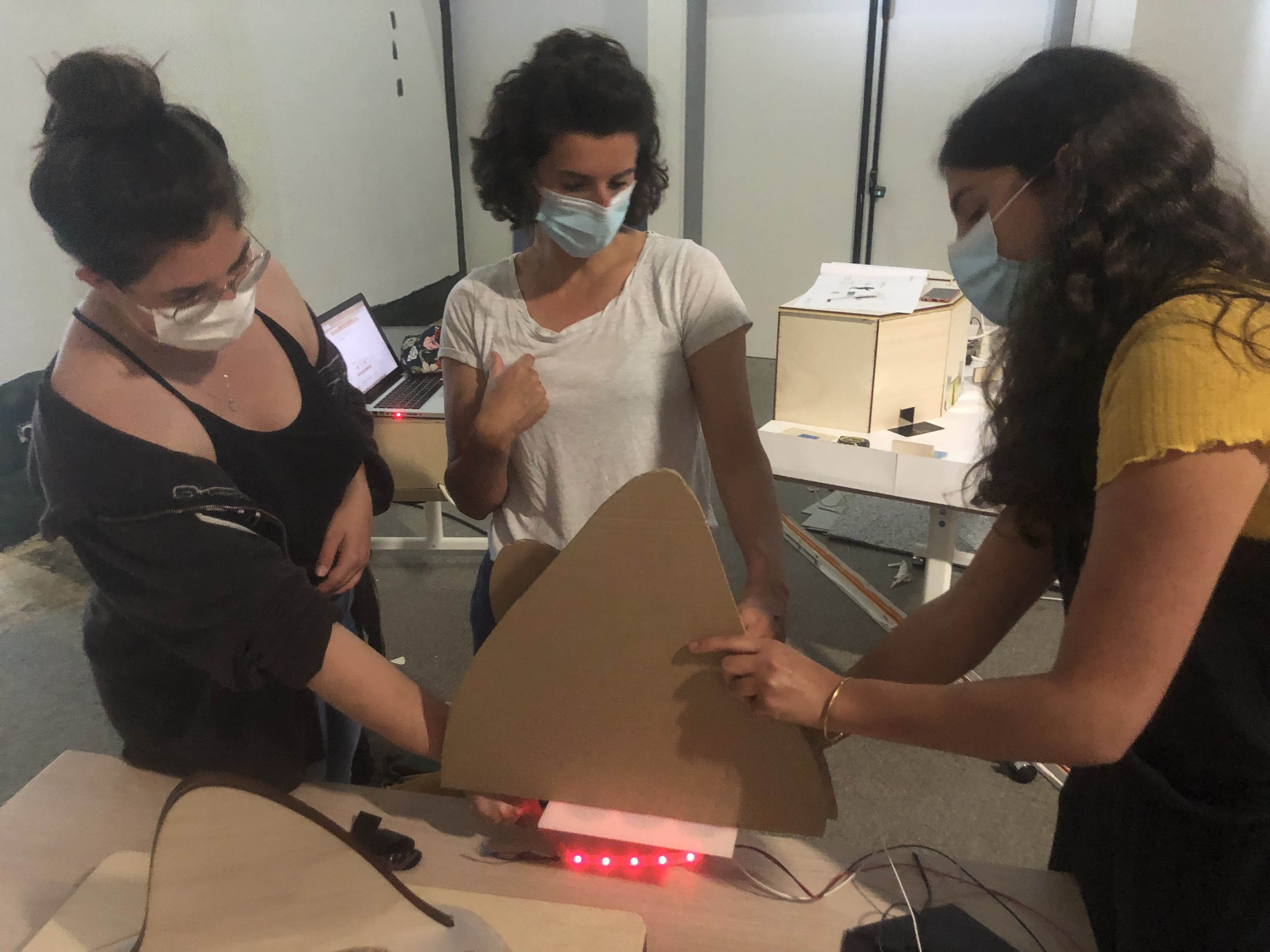
Tests et échanges sur le rendu avec la scénographe et la muséographe. © M.D
De gauche à droite : Margot Coïc, muséograhe, Céline Daub, scénographe et Clara Speiser, designeuse produit.

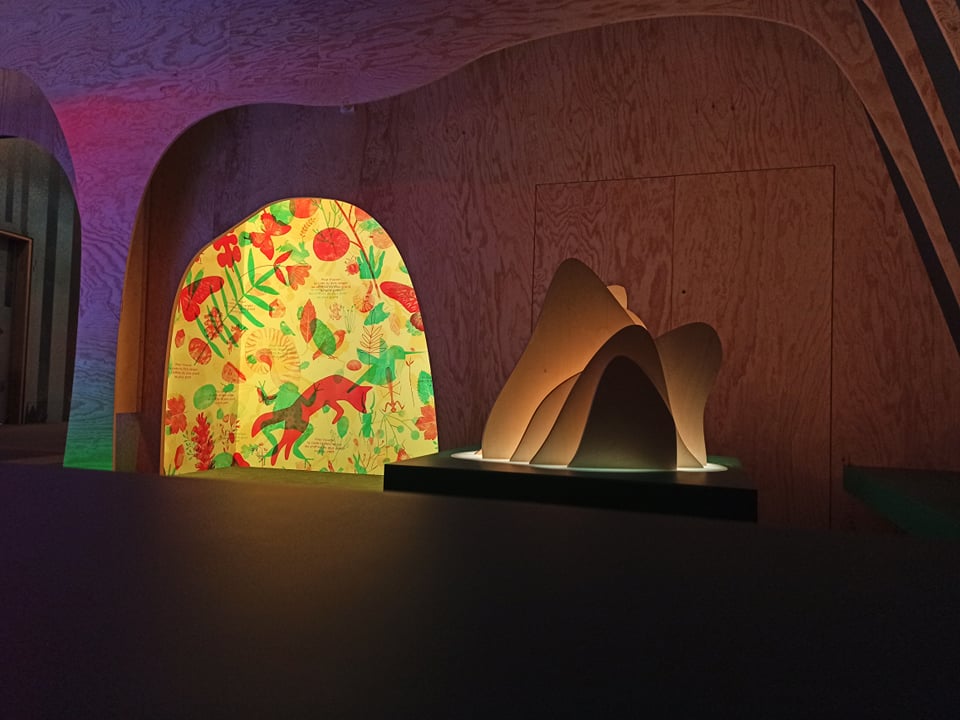
Le coin du feu dans le nouvel espace d’exposition La Caverne © M.D
#Design
#CentredeSciences
#Manipes
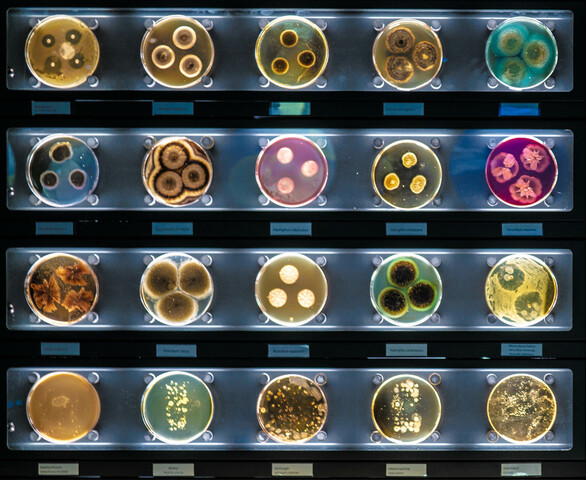
La vie des mondes microscopiques
© Yann Caradec, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, 2019.
Micropia, c’est quoi ?
L’objectif pédagogique du lieu
Dans le ventre de la bête
A la recherche des microbes
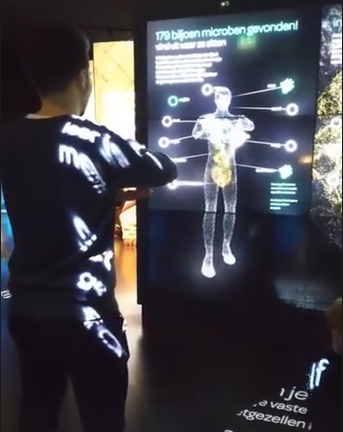 |
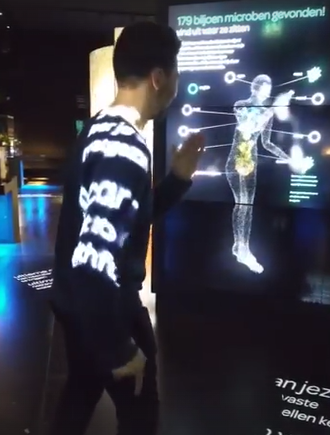 |
© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.
Observer l’invisible

© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.

© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.
Un retour à la réalité tardif
Passer à côté
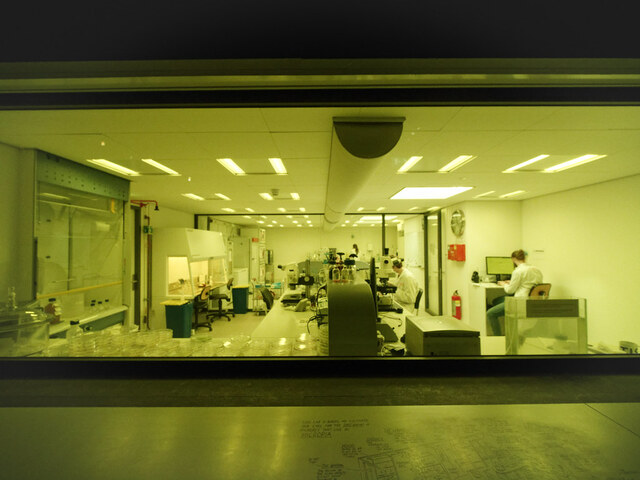
© Eric de Redelijkheid, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, avril 2019.
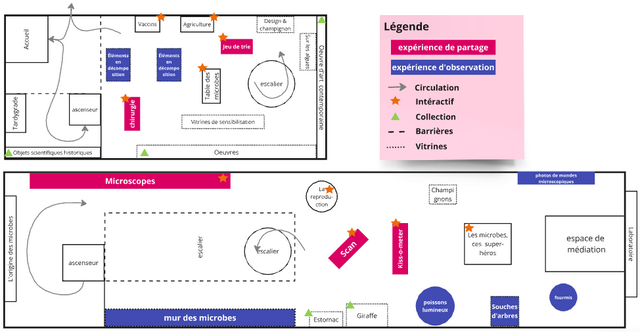
Schéma de l’exposition permanente, par Tiphaine Schriver, octobre 2024.
Encadré “Pour en savoir plus”
- Lieu : Micropia, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam, Pays-Bas
- Visite : 1 200m² sur 1 étage et 1 rez-de-chaussée
- Tarif : Entre 8,75€ et 17,50€. Gratuit pour les moins de 13 ans, détenteurs de la Museumcard, carte Icom ou la VriendenLoterij VIP Card.

La vraie-fausse nature des dioramas
En 2017, le Palais de Tokyo inaugure Dioramas, une exposition faisant la part belle à ce dispositif muséographique. Mêlant œuvres anciennes et contemporaines, l’exposition s’attachait à présenter les différentes facettes des dioramas. Objets de fantasme, les dioramas incarnent dans l’imaginaire collectif le charme un peu désuet des musées du XIXè siècle. Ces compositions en trois dimensions et généralement grandeur nature mêlent à la fois sculpture, peinture, objets et parfois vitrine. Ils illustrent un écosystème, un événement historique ou le mode de vie de populations proches ou éloignées. Ces reconstitutions tridimensionnelles sont souvent conçues comme les miroirs du monde dans lequel ils ont été créés : ils permettent de comprendre ainsi l’état des connaissances scientifiques lors de leur création et témoignent aussi du mode de pensée d’une époque. Très appréciés par le public familial, les dioramas sont néanmoins souvent vieillissants, et plus forcément représentatifs des modes d’expositions actuels. Retraçons son histoire pour en comprendre les évolutions, son intérêt dans les représentations de notre environnement et ses renouvellements.
Image de couverture : ©S.C – « Bête noire », Kent Monkman, Palais de Tokyo
Aux origines du diorama
Ce mode d’exposition prend racine en 1822 avec la création par Louis Daguerre, peintre en décors de théâtre, de ce qu’on appellera le daguerréotype. A cette période, le diorama se résume à une toile tendue légèrement translucide, qui s’anime grâce à des jeux de lumière. Au fil des années, il s’enrichit avec l’apparition d’objets en trois dimensions.
La fin du XIXè siècle marque un tournant dans la muséographie moderne : le public constitué d’élites laisse peu à peu place aux scolaires, et les musées doivent s’adapter. Les objets amassés dans les vitrines disparaissent pour laisser place à des espaces plus aérés. L’objectif est alors de démocratiser l’accès au musée, et la médiation en devient un instrument majeur. Le diorama, mettant en scène la nature, devient très rapidement une norme moderne et novatrice pour accueillir ses nouveaux publics, notamment en Amérique du Nord. Les modèles de cires et les animaux naturalisés figent un moment, un lieu, que de nombreux visiteurs ne pourraient voir en temps normal. A l’American Museum of Natural History de New-York (AMNH), des dioramas représentant des animaux d’Afrique en pleine chasse ou l’arrivée des colons en Amérique sont installés au sein du musée. Ce changement pour des espaces plus aérés et des connaissances scientifiques actualisées interviendra en France bien plus tard, dans les années 1920-1930.
Les muséums ne sont pas les seules institutions à intégrer des dioramas dans leurs nouvelles présentations. A la fin du XIXè siècle, la présentation des folklores traditionnels inspire : pour l’exposition universelle de Paris en 1878, les Pays-Bas présentent dans leur pavillon l’intérieur Hindenloopen, un habitat hollandais traditionnel, qui passionne les visiteurs. L’intérieur comporte des objets traditionnels donnés par les locaux, et la possibilité d’entrer dans la pièce apportait un caractère immersif très apprécié à l’époque. L’intérieur remporte le diplôme d’honneur du jury et un vif succès critique. Ce type de présentation influence grandement les musées d’ethnographie : de nombreux musées s’emparent du concept pour l’intégrer dans leurs muséographies, à l’image du Museon Arlaten qui ouvre en 1899.

Une représentation de l’intérieur d’Hindeloopen, lors de l’Exposition Universelle de 1878 à Paris ©Worldfairsinfo
Paradoxalement, bien que le diorama cherche à rendre compte de la réalité la plus pure, celui-ci n’est bien souvent qu’une nature arrangée, normalisée et il joue sur le caractère spectaculaire pour attirer les foules.
Le diorama, à la fois spectaculaire et normalisateur
Pour intéresser le public, le musée peut s’appuyer sur ses collections, en présentant des pièces qui attirent la curiosité des visiteurs. Le diorama, grâce à son aspect théâtral et immersif, joue sur ces codes pour toucher un plus large public.
A de nombreux égards, le diorama peut être comparé à une scène de théâtre. En effet, la création de ces espaces nécessite l’intervention de nombreux corps de métiers ayant traits au théâtre, comme les décorateurs et les peintres en décors. En intégrant des animaux naturalisés, le diorama apporte cette touche étrange qui fait entrer la scène dans une nouvelle dimension, plus spectaculaire. L’objectif est de donner au visiteur le sentiment d’être à l’intérieur de la scène, d’oublier le monde moderne. Ce dispositif avant tout muséographique devient un véritable objet culturel, fascinant. Dans un entretien réalisé par Noémie Etienne pour évoquer son travail en tant que commissaire de l’exposition « Dioramas » présenté au Palais de Tokyo en 2017, Laurent Le Bon évoque cette fascination : « Je crois qu’il y a une fascination pour ce dispositif. C’est aussi un retour dans le monde de l’enfance. Le temps d’un parcours, on peut avoir la sensation de dominer le monde, mais aussi d’être comme Alice au pays des merveilles. »1.
Toutefois, cette recherche de spectaculaire et d’immersion a pu avoir un effet néfaste sur la rigueur scientifique de ces présentations. En 1884, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro présente la Salle de France, regroupant des intérieurs typiques de différentes régions de France. Parmi eux, la vitrine « Bretagne » est très appréciée. Ainsi, Eugène Oscar Lami écrira « Dans une grande salle bien éclairée, quelques femmes bretonnes et frisonnes, et un intérieur breton de grandeur naturelle, frappant de vérité. Tout y est, pots, lits en forme d’armoires de bois ouvragé, et le vieux grand-père, toujours gelé, assis dans l’âtre même du foyer. Ce décor, très bien réglé, a le don d’attirer la foule »2. Ici, c’est le patrimoine, le visuel qui a été mis en avant, comme un discours pour la conservation des traditions. L’aspect scientifique n’est pas la motivation principale de ces vitrines. *
En ce qui concerne les dioramas naturalistes, un biais anthropocentriste affecte également la rigueur scientifique de certaines présentations. Loin de vouloir présenter une vérité scientifique, les naturalistes cherchent parfois à montrer leur supériorité face à la nature en la maîtrisant à travers le diorama. Cette maîtrise s’exprime de plusieurs manières. Les animaux naturalisés sont tout d’abord souvent issus de chasses effectués dans l’optique de trouver le spécimen le plus beau, le plus fort, le plus esthétiquement représentatif de son espèce. Une fois les spécimens rapportés en Occident, les animaux sont naturalisés pour les rendre le plus vivant possible. On nettoie les peaux en les débarrassant de la poussière et des puces, on masque les coutures, on fait disparaître les possibles cicatrices visibles sur la peau… L’être humain maîtrise alors la nature, en la rendant plus esthétique.
La mise en scène choisie théâtralise également la nature. En 1936, l’AMNH accueille l’African Hall, créé par le naturaliste Carl Akeley. Le naturaliste est parti lui-même en expédition pour capturer les animaux et s’imprégner des lieux afin de le reproduire au mieux dans ses dioramas. A son retour, Carl Akeley crée des scènes prises sur le vif, où l’animal prend une pose parfois dramatisée. Loin de la réalité, le fond du diorama représente le plus souvent une nature paisible, fantasmée, loin de la réalité. Le diorama des gorilles en est un exemple marquant. La scène, construite telle un tableau, présente un gorille mâle triomphant face à deux femelles accroupies en contrebas. La toile de fond, digne du jardin d’Eden, rend la scène hors du temps et onirique, sans aucun rapport avec la réalité. En parlant du diorama des gorilles, la chercheuse Anne Haraway écrit : « Bouleversant la logique muséale classique, Akeley expose des tranches de vie dans le jardin vierge d’une Nature aseptisée, parfaite et morale, expurgée d’animaux malades, difformes, âgés ou lâches » 3.

Le diorama des gorilles, dans l’African Hall du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©maaachuuun sur Flickr
Un art au service des idéologies
Objet culturel par excellence, le diorama reste une création humaine, et par conséquent est à son image. Ainsi, dans le même temps que leur popularité grandissante, les dioramas vont séduire et distraire les masses. Véritable outil éducatif dans le monde occidental de la fin du XIXè siècle, le diorama propose alors un discours qui n’a pas toujours de lien avec la réalité. Pour certains, il s’agit même de faire passer une idéologie représentant la pensée de l’époque, eugéniste et patriarcale.
Un exemple frappant se trouve (encore !) à l’AMNH. Le diorama des lions présente un groupe de lions avec un mâle debout et regardant au loin, tandis que les femelles sont allongées pour la plupart. Bien qu’ayant été sur le terrain, Carl Akeley propose ici un discours à l’image de son temps en transposant une idéologie humaine à un groupe animal. Ainsi le lion, représentant la force, la noblesse, est droit, debout, tandis que les femelles adoptent une position bien plus passive, à l’image de ce qui est attendu du statut de femme à la fin du XIXè siècle. Il aurait été bien plus rigoureux scientifiquement de présenter une scène de chasse où les femelles sont en action.

Le diorama des lions du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©AMNH
Ce discours est également rattaché à la pensée eugéniste de cette période. Les animaux, capturés comme étant les plus beaux spécimens de leur espèce, sont une recherche d’un idéal. Noémie Etienne résume le contexte idéologique de cette période dans un entretien pour France Culture : « il s’agissait de trouver le spécimen le plus représentatif de sa 'race', quitte à en abattre plusieurs jusqu’à obtenir celui qui serait naturalisé pour être transporté à New York. On construisait ainsi une image de l’espèce conformément à des critères relativement abstraits et qui ne reflétaient pas la diversité des animaux. La même ambition sous-tendait les représentations humaines sous forme de mannequins : elles sont ainsi problématiques car elles prétendent montrer une vision scientifique de types 'raciaux' - construisant ainsi une image factice et préconçue de l’altérité. » 4
Bien évidemment, les dioramas ethnographiques sont également touchés par les préjugés de cette période. Proposant une image biaisée de la réalité sur fond de roman national, les dioramas ethnographiques sont souvent directement rattachés aux zoos humains présentées dans les Expositions Universelles de la fin du XIXè siècle. Ces représentations sont de véritables outils de propagande à l’attention des scolaires. Ainsi, l’AMNH présente en 1939 le Old New York Diorama, une scène montrant l’arrivée des colons néerlandais sur le sol américain. Représentatif des clichés et de la volonté de créer un roman national fort sur la création du pays, le diorama présente des incohérences historiques importantes. Par exemple, la tribu Lenappe fait les frais des clichés sur les populations autochtones tandis que les colons blancs sont présentés comme arrivants pacifiques.

Le Old New-York Diorama, de l’AMNH, lors de sa création en 1939 ©Capture d’écran de la vidéo « Behind the Updates to Old New-York Diorama » de l’AMNH
Un exemple plus récent nous vient de l’Australian War Memorial de Cambera. Durement touché lors des combats de la Première Guerre Mondiale, l’Australie reste néanmoins loin des champs de batailles. Une partie des dioramas présentés ont été créés par Charles E. W. Bean, historien et correspondant de guerre durant le premier conflit mondial. Les dioramas de cette période manquent de recul sur la situation. Le diorama de Lone Pine présente par exemple une offensive australienne. La scène est centrée sur un soldat fauché par une balle, tandis que ses camarades reconquièrent des positions ennemies. Cette représentation, entre la scène de théâtre et celle de cinéma, sert le discours populaire présentant l’Angleterre indifférente au sort des Australiens, menant à terme à l’indépendance de l’Australie.
Le diorama Lone Pine de l’Australian War Memoria (1924) ©AWM
Et aujourd’hui ?
Un peu oubliés dans la seconde partie du XXè siècle car considérés comme désuets, les dioramas n’en restent pas moins très présents dans les musées, à travers des présentations d’époque ou plus récentes. A l’aune du XXIè siècle, les critiques ont été entendues, et de nombreux changements s’effectuent autour de ces dispositifs.
Les anciennes représentations ont pour la plupart été retirées des parcours permanents dans les musées de grande envergure, mais il arrive que certains aient été amendés, pour porter un nouveau discours. C’est notamment le cas du Old New-York Diorama, cité plus haut. En 2018, l’AMNH a fait le choix de présenter le diorama en ajoutant sur la vitrine de nombreuses informations. Cet ajout permet de recontextualiser la scène et d’évoquer les erreurs historiques portées par le diorama, en précisant par exemple le rôle des femmes chez le peuple Lenappe ou en évoquant la violence dont ont pu faire preuve les colons à leur arrivée.
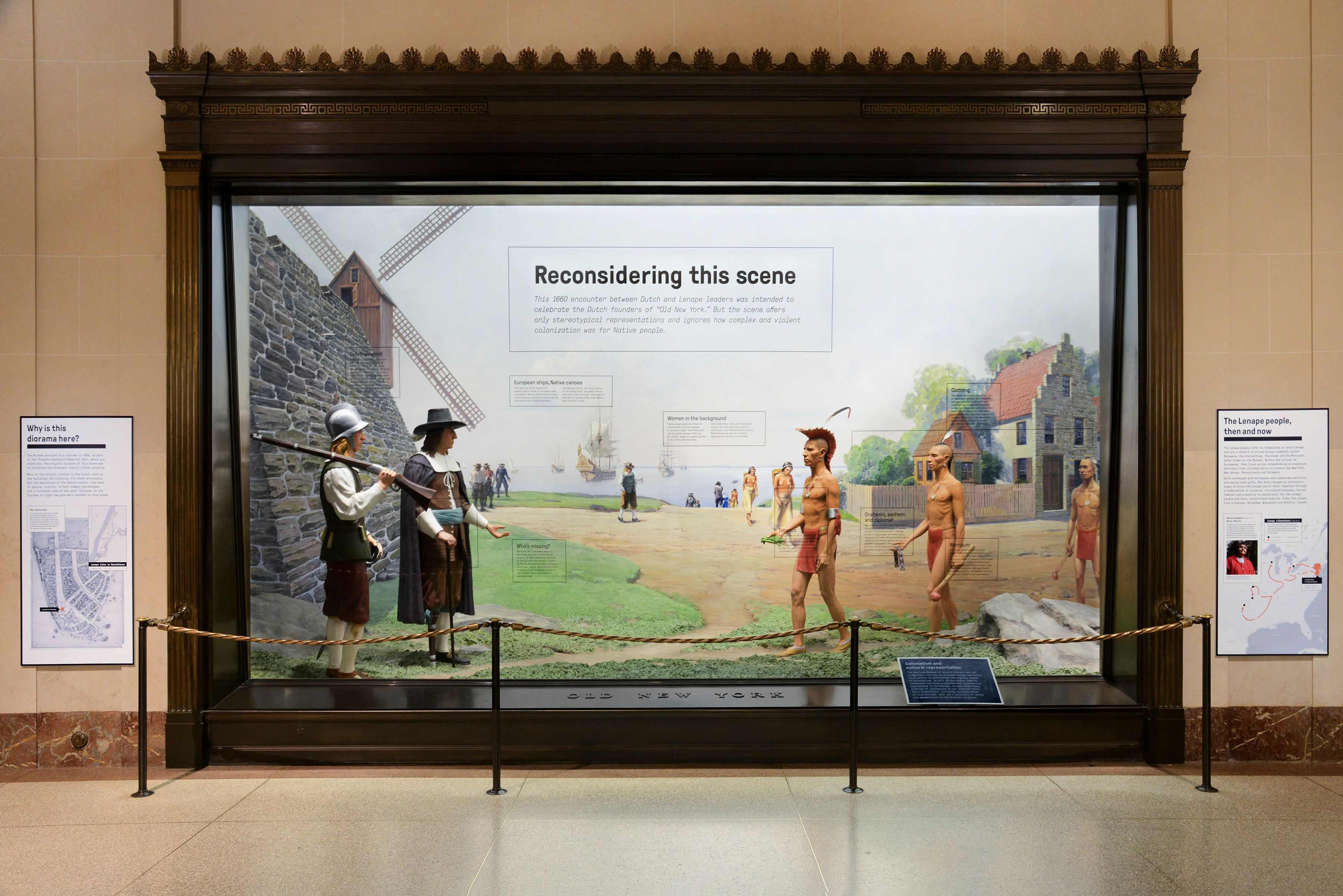
Le diorama Old New-York accompagné de ses cartels explicatifs depuis 2018 ©Hermes Creative Awards
Loin des visions caricaturales de l’époque, les dioramas produits aujourd’hui sont toujours conçus dans un objectif pédagogique, tout en portant sur des sujets différents. Les dioramas animaliers sont le plus souvent tournés vers la biodiversité, la dégradation des espaces. Cela permet d’apporter un contenu visuel pour les publics jeunes et scolaires, pour inviter à la prise de conscience sur ces thématiques. Plus qu’un simple dispositif pédagogique, le diorama devient alors un véritable support à la médiation. Dans le cadre de la refonte de son parcours permanent, le Musée d’Histoire de Lyon a fait le choix d’introduire un diorama dans la partie « Les pieds dans l’eau ». L’équipe de scénographie a recréé un lône, un espace retravaillé en bordure du Rhône pour réintroduire des espèces. La scène présente les espèces typiques des lônes (martin-pêcheur, castor…) cohabitant avec les déchets. Le diorama abrite plusieurs outils de médiation, comme une « hutte », dans laquelle les plus jeunes peuvent s’installer pour écouter des récits sur le sujet.

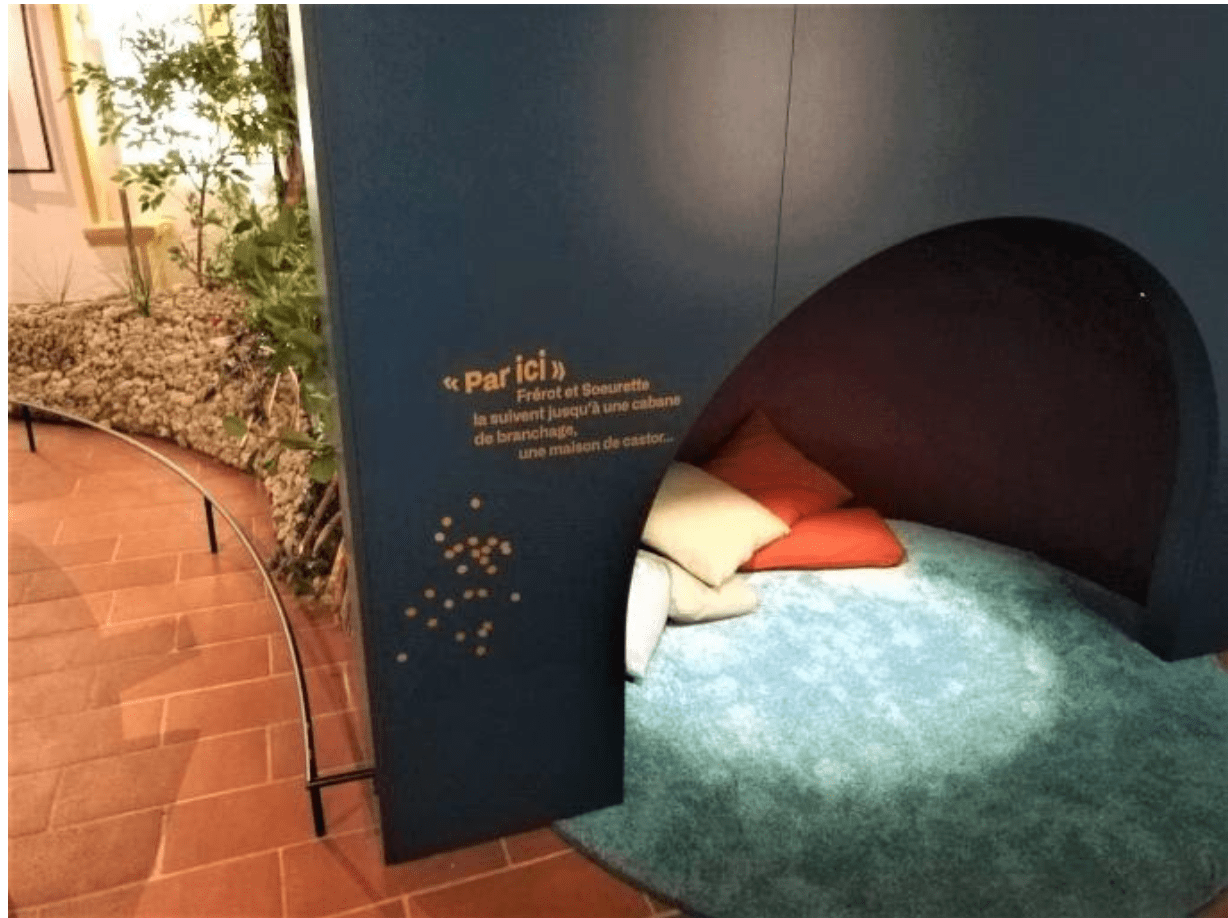
Le diorama du Musée d’Histoire de Lyon, conçu par Scénorama en 2020 ©J.G
Depuis sa création objet de fantasme et du spectaculaire, le diorama est représentant de sa période de faste, en présentant souvent une image biaisée de l’Histoire. Pourtant, il est toujours aussi plébiscité, principalement par le jeune public, car son caractère théâtral et immersif n’a de cesse d’émerveiller petits et grands. Désormais, le diorama n’est plus l’outil de médiation, mais simplement le support, sur lequel les médiateurs et/ou les dispositifs associés apportent un nouveau discours plus en accord avec son temps.
Image vignette : ©C.dC – Diorama « Un village néolithique en Haute-Provence » au musée de la Préhistoire de Quinson
Clémence de CARVALHO
1 Laurent Le Bon et Noémie Étienne, « Entretien avec Laurent Le Bon », Culture & Musées [En ligne], 32 | 2018, mis en ligne le 16 janvier 2019, consulté le 9 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/2651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/culturemusees.2651
2 Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels, publié par Eugène Oscar Lami, tome VI, Paris, 1886
*L’image de la vitrine Bretagne n’étant pas libre de droit, je vous invite à la visionner ici : https://www.photo.rmn.fr/archive/07-534152-2C6NU0JLYIBS.html
3 Modest Witness@ Second Millennium. Femaleman Meets Oncomouse : Feminism and Technoscience, Donna Haraway,1997
4 Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, consulté le 9 mars 2021.
Pour en savoir plus :
-
Publics et Musées, n°9, 1996. Les dioramas (sous la direction de Bernard Schiele), accessible ici : https://www.persee.fr/issue/pumus_1164-5385_1996_num_9_1
-
Culture et Musées, n° 32, 2018, L’art du diorama (1700-2000) (sous la direction de Noémie Etienne et Nadia Radwan), accessible ici : https://journals.openedition.org/culturemusees/2197
-
Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, accessible ici : https://www.franceculture.fr/histoire/le-musee-dhistoire-naturelle-de-new-york-temple-mondial-du-diorama
-
L’AMNH présente le diorama Old New-York amendé : https://www.youtube.com/watch?v=ndj59hGuSSY
-
Sur la fascination pour les intérieurs : https://brill.com/flyer/title/36506?print=pdf&pdfGenerator=headless_chrome
#diorama #mediation #museographie

Le DD, ça vous parle ?
Enerlya, la maison des Energies Renouvelables est un centre d’interprétation dont l’objectif est la sensibilisation au Développement Durable. Quésako? Le développement durable consiste en plusieurs objectifs : l’équité sociale, l’efficacité économique et la qualité environnementale. À nous, citoyens, d’améliorer nos gestes du quotidien pour assurer un futur sain et durable profitable à l’environnement et par conséquent à l’humanité.
© Enerlya, 2014
Un parcours scénographié propose de découvrir les diverses énergies renouvelables : le soleil, l’eau, le vent, la chaleur de la terre et la biomasse sèche. Avant la visite, un film ludique sur les énergies renouvelables et celles du futur est diffusé dans la salle de cinéma. Les visiteurs découvrent ainsi le territoire vu du ciel, les énergies et survolent même le parc éolien de la Haute Lys. Créé en 2004, il représentait à cette époque le plus grand parc éolien de France en production électrique. En effet, sa production représentait 15% de la production d’électricité éolienne nationale !
La scénographie dispose de bornes interactives permettant d’explorer les avantages des énergies renouvelables et de questionner nos savoirs à leur sujet. Des maquettes révèlentle fonctionnement de l’éolien, du photovoltaïque et de l’hydroélectricité. Une autre partie concerne les matériaux bio-sourcés dans le cadre de rénovation et de construction de bâtiments. Tout au long du parcours, les visiteurs perçoivent les clés d’un environnement sain et durable.
La maison des Energies Renouvelables est construite avec des matériaux durables. Il s’agit d’un bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale). Apprenez qu’elle se situe sur un ancien site de stockage d’engrais chimiques ! Pari relevé en ce qui concerne la décontamination d’un site hautement pollué. Sa structure est faite d’épicéas finlandais en lamellés collés. Cette technique de coupe consiste en la découpe du bois dans la longueur du tronc permettant ainsi une réduction des variations du bois et par conséquent favorise la stabilité du bâtiment. Les murs sont de verre pour laisser le soleil y pénétrer et réchauffer l’atmosphère.
Des panneaux solaires photovoltaïques sont installés sur son toit et produisent de l’électricité qui est redistribuée sur le réseau national. Le visiteur peut prendre connaissance de la production d’électricité par mois grâce à ces panneaux au sein de la scénographie où des compteurs sont installés. Relevons également l’originalité de cette structure construite à cheval sur le fleuve de l’Aa qui traverse l’atrium où se tient lors des festivals des expositions de créations originales issues ou non de matériaux de récupération.
© Enerlya, 2014
Des activités pédagogiques et ludiques sont proposées au sein d’Enerlya afin d’instaurer les gestes éco citoyens dans notre vie de tous les jours. Que ce soit la construction de carrousels solaires dans le but de démontrer l’efficacité du rayonnement du soleil sur les cellules photovoltaïques, ou encore les jeux de plateau familiarisant les joueurs au tri sélectif de nos déchets, les visiteurs, petits et grands, gardent de leurs expériences une prise deconscience de leur environnement et des actions à mener pour le sauvegarder.
Enerlya, la maison des Energies Renouvelables se situe à Fauquembergues, à 20 km au sud-ouest de Saint-Omer. L’équipe vous proposera également de parcourir les chemins du vent ou d’emprunter le sentier des faucons. Un bon grand bol d’air au cœur de la campagne audomaroise, il n’y a rien de tel pour apprécier la nature environnante !
Katia Fournier
En savoir plus :
#Energies
#Développement Durable#Centre d’interprétation

Le planétarium : zoom sur un outil de la Culture scientifique
Équipements particulièrement impressionnants, les planétariums sont des outils importants de la culture scientifique. Appuyés sur une expérience immersive et émotionnelle forte, ils s'inscrivent dans un environnement singulier, qui demandent une médiation particulière.
Les mutations technologiques ont apporté de nouvelles façons de vivre les expériences scientifiques et ont augmenté l’attrait pour ces outils scientifiques de médiation. De nombreux projets de création ou de renouvellement sont d’ailleurs en cours, comme à Douai, ou Strasbourg.
Image de couverture : © Tiffany Corrieri
Actuellement en apprentissage au Forum départemental des Sciences, j’ai échangé avec André Amossé, responsable de l’équipe médiation, qui m’en a dit plus sur ce qu’est un planétarium et sur la médiation associée.
Petit historique de l’observation des étoiles
Avant de se pencher sur l’histoire succincte des prémices du planétarium, il convient de définir le sens de ce mot : en français le mot planétarium désigne à la fois l’instrument de visualisation du ciel comme le lieu où cet appareil est implanté.
Ici, il sera question de s’intéresser au système qui permet de simuler le ciel.
A quoi sert un planétarium ?
Simuler l’observation du ciel étoilé à un moment et à un endroit donnés, telle est la mission des planétariums. Ils se différencient des observatoires par leur capacité de visualisation du ciel et permettent une démonstration de l’évolution de ce dernier au gré du temps sans avoir les contraintes météorologiques (ciel nuageux). Leur particularité est de proposer un point de vue interne et terrestre de la voûte céleste.
Pendant une séance de planétarium au Forum départemental des Sciences, le public peut admirer le ciel du moment vu depuis n’importe quel autre endroit de la Terre, visualiser tous les phénomènes astronomiques (rapprochements planétaires, phases de Lune, éclipses…) quelles que soient la position géographique, la date et l’heure sur une période de 5000 ans entourant notre époque.
La volonté de représenter le ciel et de montrer ses phénomènes cycliques existe depuis longtemps. Déjà à l’Antiquité des tentations de modélisation de ces mouvements ont été pensés, comme avec le planétarium d’Archimède. Mais c’est vers le milieu du XVIIe que le principe de fonctionnement des planétariums d'aujourd'hui trouve son origine. Plutôt que d’avoir un point de vue extérieur à la voûte céleste pour observer le ciel de façon réaliste et terrestre, un point de vue depuis l’intérieur de cette voûte est adopté.
C’est ce que propose Le Globe de Gottorp, un globe de 4m de diamètre, dans lequel il était possible d’entrer pour contempler un ciel étoilé. Il existe une copie de ce dernier, le Globe céleste d’Atwood, à Chicago qui fut à l’origine de la genèse des planétariums modernes.

Une réplique du Globe de Gottorp construite en 2005. © Wikipédia
Afin d’avoir une représentation de qualité du ciel étoilé, le premier planétarium moderne est créé en 1913 avec un système opto-mécanique (définit plus loin) par l’entreprise allemande Zeiss. Lors de l’exposition universelle de 1937, est construit le premier planétarium français, installé depuis 1952 au Palais de la Découverte à Paris.
La loi de décentralisation dans les années 80, qui valorise la diffusion de la culture en région, encourage la création de structures de culture scientifique sur l'ensemble du territoire national. L’association ALIAS voit le jour et acquis son premier planétarium itinérant en 1991. Elle change de nom pour Forum des Sciences en 1996, lors de la construction de l’actuel bâtiment, pensé avec l’implantation d’un planétarium fixe (le Forum des Sciences, est départementalisé en 2006 et s’appelle désormais Forum départemental des Sciences).

Construction du dôme du planétarium du Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq en 1996. © Forum départemental des Sciences
Décomposition d’un planétarium : mécanique, numérique ou hybride ?
Le choix de renouveler le système ou de créer un nouveau planétarium dépend de l’équipe et de son projet culturel, mais aussi de la tutelle et des financements accordés. Ainsi, suivant la volonté de privilégier une représentation fidèle du ciel ou de s’appuyer davantage sur les spectacles, plusieurs configurations de salles et de systèmes sont possibles.
Un planétarium est composé d’une salle, qui est surmontée d'un dôme et dans laquelle se trouve un système de projection piloté depuis un pupitre. Le FDS détient une salle de 130 places avec un projecteur central et un dôme de 14m de diamètre.
Une salle, un dôme et des projecteurs
La salle circulaire est composée de sièges pour admirer la voûte, et peut se décliner en 2 configurations : une salle avec des sièges disposés en un cercle de 360° à plat, permettant d’exploiter l’entièreté du dôme, ou bien inclinés sur une plateforme et agencés en demi-cercle, comme une salle de cinéma pour profiter d’une vue unidirectionnelle vers la voûte. Dans cette configuration, seule une partie du dôme est exploitée.
Suivant la disposition de la salle, le dôme sphérique peut également être incliné ou non.
Enfin, le système de projection est lui aussi étroitement lié à la modularité de la salle car son choix dépend de ce que l’on souhaite valoriser.
Le système opto-mécanique est le dispositif initial des planétariums. Il intègre un projecteur, situé au centre de la salle, composé de systèmes mécaniques et de combinaisons optiques offrant une représentation du ciel visible depuis la Terre.
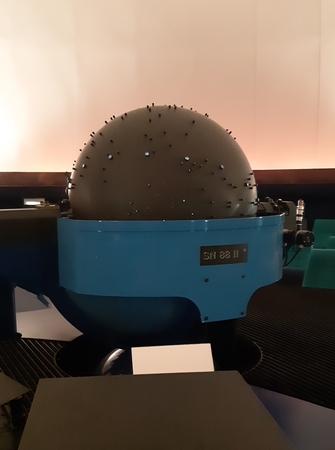
Système opto-mécanique du planétarium du Forum départemental des Sciences affichant le positionnement des étoiles pour une représentation la plus fidèle du ciel étoilé. © Tiffany Corrieri
Les projecteurs de diapositives, démocratisés dans les années 50-60, finissent par équiper les planétariums, montrant des éléments plus complexes et lointains géographiquement comme les galaxies, la lune et ses cratères, les planètes etc. Ils permettent ainsi de changer de point de vue, de ne plus seulement s’appuyer sur une vue terrestre. Leur disposition tout autour du dôme permet de constituer un paysage en 360°, les fondus apportant un effet de mouvement. Des scénarii sont alors pensés pour faire adhérer les plus jeunes, amenant à la réalisation de séances enregistrées sous forme de spectacles.
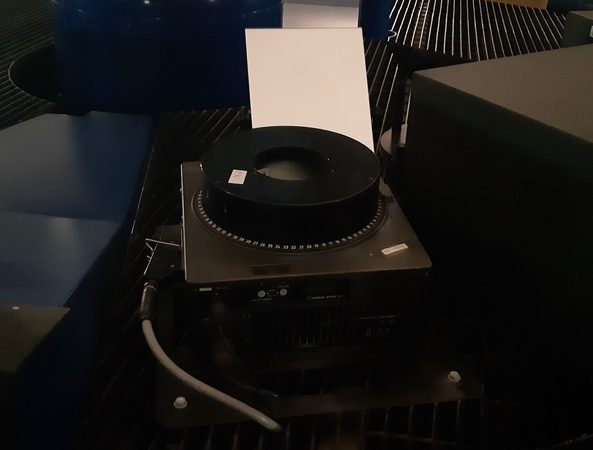
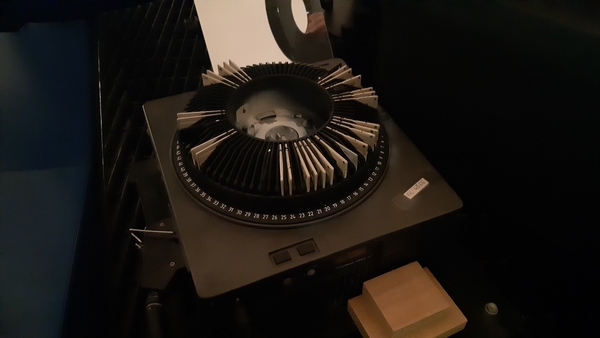
Dispositif de diapositives © Tiffany Corrieri
Puis, l’avènement du numérique dans les années 2000 a renversé la manière d’utiliser le planétarium et sa médiation. Les projecteurs numériques, qui intègrent la vidéo, apportent une dimension immersive à la salle qui se doit d’être semi-orientée et donc inclinée. Cette dimension numérique apporte de la profondeur et plus de possibilités en ce qui concerne les séances de spectacles : elle vise l'émerveillement à travers la simulation de voyage dans l’espace et la vidéo en relief, comme il est possible de le voir à la Coupole d’Helfaut.

Dispositif de projection du planétarium de la Coupole d’Helfaut : des projecteur vidéos sont intégrés sous le dôme (petits emplacements noirs) pour une projection en relief. La salle est orientée et inclinée. © Jérôme Pouille
Toutefois, même si un système favorise un type de salle et vice-versa, il est possible d’associer les deux mécanismes en formant un système hybride qui permet de lier la qualité d’un ciel étoilé rendu possible par l’opto-mécanique et la facilité pédagogique du numérique. Néanmoins, comme ce dispositif demande une orientation 360° - et une salle plate -, il peut demander des contraintes scénaristiques. Ainsi pour le confort du public, le Forum départemental des Sciences a opté pour le parti-pris de ne pas représenter physiquement les personnages qui discutent entre eux : seule une partie des visiteurs pourraient les apercevoir, l’autre devrait se retourner et pourraient ne pas profiter correctement du spectacle.
Dans tous les cas, le système est contrôlé depuis un pupitre par le biais d’un logiciel que le médiateur ou le régisseur pilote.

Le pupitre de commande du planétarium du FDS © Tiffany Corrieri
La configuration initiale du planétarium du Forum départemental des Sciences est celle d’un système opto-mécanique accompagné par des projecteurs de diapositives et de deux vidéoprojecteurs qui ne recouvrent cependant pas tout le dôme. Au vu de l’aspect obsolète de ce système de projection (les projecteurs de diapositives tombent souvent en panne, il devient rare de retrouver un même équipement de remplacement), si l’équipe avait l’opportunité de changer ce dernier, elle opterait pour une hybridation.

La salle plate du planétarium du Forum départemental des Sciences avec le planétaire optique au centre, des sièges disposés en cercle et un dôme de 14m de diamètre. © Tiffany Corrieri
Qu’en est-il des planétariums itinérants ?
Les planétariums itinérants, qui font leur apparition dans les années 70, ont évolué en même temps que les planétariums fixes. L’évolution de leur technologie suit celle des grands formats, à la différence que les mécanismes sont miniaturisés pour favoriser leur transport et que les projecteurs de diapositives ne sont pas utilisés.
Le premier planétarium itinérant du FDS était composé d’une structure en aluminium sur laquelle était tendue une toile. Cette structure soutenait un parapluie pour former le dôme sur lequel était projeté le ciel. Il demandait environ 2 heures de montage contre 30 min maximum pour une structure gonflable, aujourd’hui proposée avec une projection numérique. Au vu du succès de cet outil, le FDS possède à l’heure actuelle 4 exemplaires de ce dernier.
Suite à la démocratisation numérique, les producteurs ou les emprunteurs de planétariums peuvent être de nature différente : associations, club ou sociétés astronomiques, établissements nationaux (Universcience et Musée de l’air et de l’espace), collectivités (CCSTI: Forum départemental des Sciences, universités: Jardin des Sciences, muséums: Paléospace l’Odyssée etc). À ce jour l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF) répertorie une soixantaine de planétariums fixes et encore plus d’itinérants en France.


Les planétariums itinérants du Forum départemental des Sciences sont composés d’une structure gonflable et d’un projecteur vidéo. © Forum départemental des Sciences
Quelle médiation dans un planétarium ?
La dimension émotionnelle d’une séance, encouragée par la configuration hors du commun d’un planétarium, possède un impact nettement plus grand sur le public, que tout autre dispositif de médiation.
Il convient donc que le fonctionnement de la médiation dans un planétarium est propre à chaque structure. À la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, des spectacles sans médiation physique ont longtemps été majoritairement proposés. Au Forum départemental des Sciences, toutes les séances de planétariums sont accompagnées par un.e médiateur.trice. Une séance, traite d’un thème particulier et peut être composé d’un spectacle, mais aussi des moments d’échanges et de visualisation du ciel du moment.
Cette médiation peut être entreprise par une personne extérieure à la structure, notamment lors de séances in situ ou externe, comme lors de prêts de planétariums itinérants où les emprunteurs ne détiennent pas forcément les compétences pour animer une séance. Dans ce cas, il est souvent question de bénévoles d’une association, sollicités pour l’occasion sur la durée d’emprunt de l’outil. Ces personnes sont alors formées par l’équipe de médiation du planétarium, à l’utilisation du matériel.
Les difficultés
Du fait de contraintes propres à la structure, la médiation dans un planétarium se différencie d’une médiation d’une exposition qui se réalise sur le terrain. La capacité d’accueil d’une salle de planétarium implique pour le ou la médiateur.trice de parler seul.e face à un large public. De plus, la nécessité d’être dans l’obscurité pour observer le ciel, induit que la médiation se réalise dans le noir et implique ainsi davantage une transmission d’informations qu’un véritable échange. Pour pallier à cela, ce dernier se réalise plutôt en début de séance, de sorte que les thématiques abordées suscitent le questionnement, l’étonnement et provoquent des échanges en fin de séance.
La réalisation d’une séance de planétarium
La production de séance de planétarium peut être réalisée en interne comme en externe.
À savoir qu'aujourd'hui, les fabricants de planétariums se spécialisent dans la distribution, voire la production de films et de séances de spectacle. Les intervenants et la gestion de projet dépendent ainsi des financements et des ressources humaines de la structure. Il est parfois possible qu’existe une équipe dédiée à la production avec un.e chargé.e de production, un.e graphiste, un.e compositeur.trice qui renforcent l’équipe de réalisation, composée d’un.e réalisateur.trice en poste, comme à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Néanmoins les méthodes de travail sont souvent similaires.

Etapes de réalisation d’une séance de planétarium au sein du Forum départemental des Sciences © Tiffany Corrieri
La réalisation d’une séance de planétarium au Forum départemental des Sciences s’appuie sur la possibilité et les limites matérielles définies par le dispositif opto-mécanique accompagné de projecteurs de diapositives et des possibilités limitées des vidéoprojecteurs.
Elle commence par la proposition de thèmes en lien avec la thématique de saison culturelle afin de garder une cohérence et faire résonner les expositions présentées, quand cela est possible.
La note d’intention
Comme tout nouveau projet, une note d’intention est rédigée avec les titres, objectifs, sous-objectifs, une présentation du contenu et les cibles touchées. Les séances présentées s’adressent principalement au plus de 6 ans, à l’exception du “Petit ciel étoilé” ; les plus petits peuvent être réticents à être dans le noir, il est moins facile de réaliser une médiation qui leur est destinée. Ces présentations suivent les cycles des programmes scolaires, de la grande section de maternelle au lycée ; la plus grande limite d’âge recommandée pour commencer une séance, est donc de 12 ans.
Le scénario
Une fois que la note d’intention est validée, le scénario qui indique les textes et l’histoire à raconter, est réalisé en interne ou en externe et met en forme le cahier des charges pour la réalisation audio et visuelle. Il n’y a pas d’appel à scénariste pour ne pas être trop axé sur l’expérience cinématique, mais davantage être dans la théâtralisation, le storytelling lors des échanges entre les personnages et ainsi les sortir du cadre orienté.
Le cahier des charges
Il présente les contraintes et les volontés de réalisation en termes de visuels (intention graphiques, visuels utilisés) et d’audio (intention de la bande son, bruitages) de l’équipe projet.
La réalisation audio
Cette partie est soit réalisée par un prestataire qui suit le cahier des charges fourni avec les contraintes et volontés (comme les visuels à présenter par exemple) ou est produite en interne. Elle est par la suite validée par le responsable scientifique et pédagogique.
Au FDS, les prestataires, choisis par le biais d’un appel d'offres, sont souvent des compagnies de théâtre pour l’enregistrement audio.
Une fois la bande son réalisée avec les voix des comédiens enregistrées, il est possible de programmer les visuels adéquats.
La réalisation visuelle
Les diapositives et les vidéo projecteurs qui offrent une utilisation limitée - par la délimitation de la fenêtre de projection, il n’est pas possible d’exploiter l’entièreté du dôme - sont la forme de visuels possibles au FDS, c’est pourquoi ce dernier collabore avec un.e illustrateur.trice (il est question d’un infographiste en interne pour le planétarium de Dunkerque) pour mettre en image les personnages quand il s’agit d’un spectacle. Puis, la coordination des images avec l’audio et la simulation du ciel, réalisée par un.e médiateur.trice via un programme, est directement effectuée depuis le simulateur astronomique.

Production d’une séance de planétarium avec le logiciel SkyExplorer © Tiffany Corrieri
Il faut à minima prévoir un an pour la réalisation d’une séance de planétarium de A à Z. Le budget moyen étant de 30 000 à 40 000 euros pour une séance comportant un spectacle enregistré. La dernière production pour une séance LSS (Lhoumeau Sky-System) -destinée aux planétariums itinérants- au FDS a coûté seulement 12 000€ car elle ne demande pas de faire appel à un illustrateur : la couche numérique permet une plus grande liberté visuelle et technique. À savoir que l’animation d’un planétarium demande un coût significatif en termes de fonctionnement, par l’utilisation de ressources matérielles et humaines.
Enfin, la médiation d’un planétarium peut-être complétée par un équipement numérique connecté comme des boîtiers interactifs qui permettent au public de répondre aux questions du.de la médiateur.trice, à l’instar de la Coupole d’Helfaut.

Des boitiers interactifs intégrés aux sièges permettent une interaction avec le public © Jérôme Pouille
Pour correspondre aux attentes d’expérience du public et compenser l’obsolescence technologique (il devient compliqué de trouver des projecteurs de diapositives pour remplacer les anciens) de nombreux planétariums traditionnels se convertissent vers les nouvelles technologies numériques, parfois partiellement. Néanmoins cela dépend du temps et des financements accordés : les nouvelles productions numériques coûtent chères et les compétences recherchées particulières. Si l’effort n’est pas entièrement porté sur la partie spectacle, la médiation physique pèse alors sur la balance en termes d’expérience du public.
Je remercie André Amossé et son équipe pour son expertise et sa disponibilité.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
-
Les séances de planétariums du Forum départemental des Sciences
-
Esquisse pour une histoire des planétariums de Philippe Malburet dans Les Cahiers Peiresc, numéro 9, 2008
-
Les planétariums : des musées scientifiques en effervescence, La Lettre de l’Ocim, 2006
-
Les planétariums en pleine révolution, La Cité de l’Espace, 2018
#planetarium #sciences #ccsti

Le robot voit-il ?
Après le monde du hip-hop et les friches industrielles, la Maison Folie de Wazemmes profitait d'un « Fantastic » élan pour nous faire découvrir l'univers de la science-fiction. Sobrement intitulée Science et Fiction, cette exposition, réalisée par la Cité des Sciences et de l'Industrie, en partenariat avec Ankama et Science Fiction Archives, nous proposait jusque mi-janvier un voyage initiatique aux portes de l'irréel.
Retour vers le futur !
© Imaginelf
L'exposition abordait le genre de manière très large, dans le but de faire dialoguer sciences et fiction. Pour les non-initiés à ces mondes remplis de robots, vaisseaux spatiaux et monstres en tous genres, pas de panique ! Si les fans y trouvaient leur compte, les novices n'étaient pas oubliés. Ainsi, en abordant des thèmes précis, le propos général n'était jamais noyé sous un trop-plein d'informations. Du rêve d'alunissage aux sociétés robotisées, le tout illustré par les incontournables du genre que sont les films Stargate, Star Wars ou encore Dune. L'exposition ne surprenait pas dans son discours et même si la partie sur la robotisation de nos sociétés et la multiplication des puces RFID (Radio Frequency Identification) se permettait d'être critique, ce n'est pas là qu'il fallait chercher la force de cette exposition. Mais alors où ?
C'est dans la scénographie que résidait le potentiel de Science et Fiction. Cela paraît évident pour un genre qui a toujours été soigneux de son esthétique (les costumes exposés en témoignent). La scénographie donc, était très travaillée et les jeux de lumière participaient astucieusement à l'immersion du visiteur. Obscurité des lieux, jeux d'ombres, éclairage particulier pour les cartels ; la lumière était un point fort de l'exposition. S'il fallait associer un sens à cette exposition c'est bien la vue qui était mise à l'honneur. Qu'en est-il alors des publics mal ou non-voyants ? C'est à cette question que répondait tout un ensemble d'outils de médiation adaptés à ce public.
© Gentlegeek
En effet, l'éventail des outils utilisés était large. Chose la plus commune peut être, la transcription des cartels en braille. Une grande partie des panneaux introductifs étaient traduits. Dispositif plus rare, le braille était toujours accompagné de motifs en relief qui figuraient les thèmes abordés : combinaison spatiale, fusée, planète, robot, etc. En plus de permettre une meilleure compréhension de l'exposition et d'appuyer les écrits en braille, ce dispositif rendait le lieu accessible à des personnes non voyantes qui ne liraient pas le braille. Ces motifs jouaient, bien sûr, sur les formes des objets et en particulier leurs contours mais aussi sur leur texture. En proposant différents « grains » en relief la représentation spatiale de l'objet était plus aisée. Cela permettait d'appréhender plus facilement les objets mais aussi leur échelle. Dès lors, ce dispositif d'écriture en trois dimensions, couplé aux ambiances sonores du lieu nous plongeait tout entier dans un univers futuriste. Notons que de nombreux visiteurs, qu'ils soient malvoyants ou non, se laissaient aller à cette expérience tactile.
Autre outil de cet ensemble : l'audio-description. L'exposition comportait de nombreuses vidéos. Et même si elle étaient toutes accompagnées d'une voix off, le côté technique de certaines pouvait être incompréhensible sans l'image. L'audiodescription jouait donc un rôle important dans le décryptage de ces vidéos. Elle permettait, par exemple, de mieux apprécier le contexte de chaque vidéo et son environnement. Plus que cela, ce dispositif faisait appel à des images, des représentations qui permettaient à l'individu de ne pas se limiter à une visite sonore des lieux.
Thibault Leonardis

Le rôle du parent au musée, Bébés animaux
Coproduite par l'Institut des Sciences Naturelles de Belgique et le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, Bébés animaux adapte les connaissances scientifiques sur le sujet aux 3-8 ans, et développe un éventail de dispositifs à visée pédagogique. Le postulat de l'exposition (énoncé sur le fascicule donné à l'entrée du museum) est le suivant : "[...] pour bien comprendre ces histoires [celles des naissances animales et de leur diversité], il faut les vivre!" Les outils pédagogiques se doivent donc d'éveiller l'enfant par une pluralité d'actions à entreprendre : imiter, jouer, toucher, regarder, interagir. L'écart entre la conception, le sens des outils muséographiques et leur utilisation par les enfants fait l'intérêt de cette exposition. Dans cet intervalle perfectible émerge la question centrale du rôle du parent.
REGARDER / Séquencé en six parties visibles spatialement grâce à un code couleur au sol et à des titres conséquents, le parcours de l'exposition se déploie autour d'un axe médian constitué de vitrines. Cet outil muséographique incontournable du musée des sciences naturelles est ici adapté à l'âge du public ciblé par ses dimensions et ses codes de lecture.
Les vitrines sont composées d'une sculpture d'après nature du petit animal ; un cartel notifie le nom et l'apparence (sous forme de silhouette) de l'animal adulte ; une planche de quatre dessins spécifie les conditions et les étapes de la naissance, enfin, un court texte explicatif décliné en quatre langues (fr-nl-en-de) offre aux parents la matière nécessaire pour approfondir les connaissances de leur enfant. Ces vitrines permettent d'accéder rapidement à un nombre conséquents d'informations : la diversité des conditions et des étapes des naissances animales, d'appréhender l'aspect physique de celui-ci petit et adulte et d'apprendre les toutes premières étapes de son développement. Les vitrines sont pourtant désertées au profit d'autres modules plus ludiques.

Vitrines, la naissance, Bébés animaux, Muséum des Sciences naturelles, Bruxelles Crédits : O.L
IMITER / Dans la première partie (Naissance), l'enfant peut imiter le papa crapaud portant les œufs sur son dos. Pour se faire, il a à sa disposition une ceinture à scratch munie d'un petit plateau en mousse sur lequel il pose des balles. Ainsi harnaché de sa "progéniture" l'enfant peut suivre un parcours et reproduire dans un cercle figurant un sol de gravas le comportement du crapaud. L'idée plait aux parents, qui, s'ils ne vont pas jusqu'à se mettre accroupi et imiter le crapaud, tentent de motiver leurs enfants plus intéressés à jouer avec les balles en mousse.
INTERAGIR/ Les interfaces tactiles sont conçues par le Muséum des Sciences Naturelles de Bruxelles. Elles sont utilisées à trois étapes différentes du parcours avec à chaque fois un objectif et un message précis. L'interface proposée dans la seconde partie du parcours (Menaces et protection) témoigne de la difficulté de s'adresser à un public de jeunes enfants et de l'importance de l'accompagnement des parents.
Un écran tactile propose aux enfants de petites animations pour qu'ils prennent conscience des dangers et de la fragilité du monde animal. Après avoir choisi une langue, apparaît une série de silhouettes animales dessinées. En sélectionnant l'animal de son choix, l'enfant se voit proposer trois visages : un souriant, un triste et un s'esclaffant. Dans la première situation le petit animal survit de manière réaliste à un danger qu'il peut rencontrer couramment dans la nature (grâce à la protection de ses parents...). Dans la seconde situation, le petit animal meurt suite à une menace (prédateurs, dangers liés à l'environnement...). Dans la troisième situation, l'animal survit à l'aide d'un objet. On passe ici d'un scénario réaliste à un scénario dont le ressort est le gag. Le mélange des genres sert-il le propos de l'interface ? Il semble avoir pour but d'établir une frontière nécessaire entre l'imaginaire et le réel. Ces trois situations font sens les unes par rapport aux autres. Or, selon mes observations, l'enfant ne clique pas de lui même sur le visage triste qui, pourtant, est central dans la démonstration qu'opère subtilement l'interface tactile. L'outil pédagogique est à première vue adapté au public des 3-8 ans mais nécessite la présence d'un adulte soumettant à l'enfant l'idée de cliquer sur ce visage triste.
Module photographique, Apprentissage, Bébés animaux, Muséum des Sciences naturelles, BruxellesCrédits : O.L
L'efficacité de la transmission des savoirs savamment distillés dans Bébés animaux serait augmentée considérablement si un livret d'accompagnement, par exemple, pouvait être distribué aux parents à l'entrée. Leur rôle semble hélas sous-estimé dans cette intelligente et inventive exposition. Je garde un souvenir ému d'un module permettant de nous prendre en photo en train d'imiter la posture ou la mimique d'un animal, j'étais tombée sur la chouette. Ici, l'interface permet une identification par le mime réunissant petit(s) et grand(s).
Ophélie Laloy
Exposition du 14-03-13 au 11-06-14
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
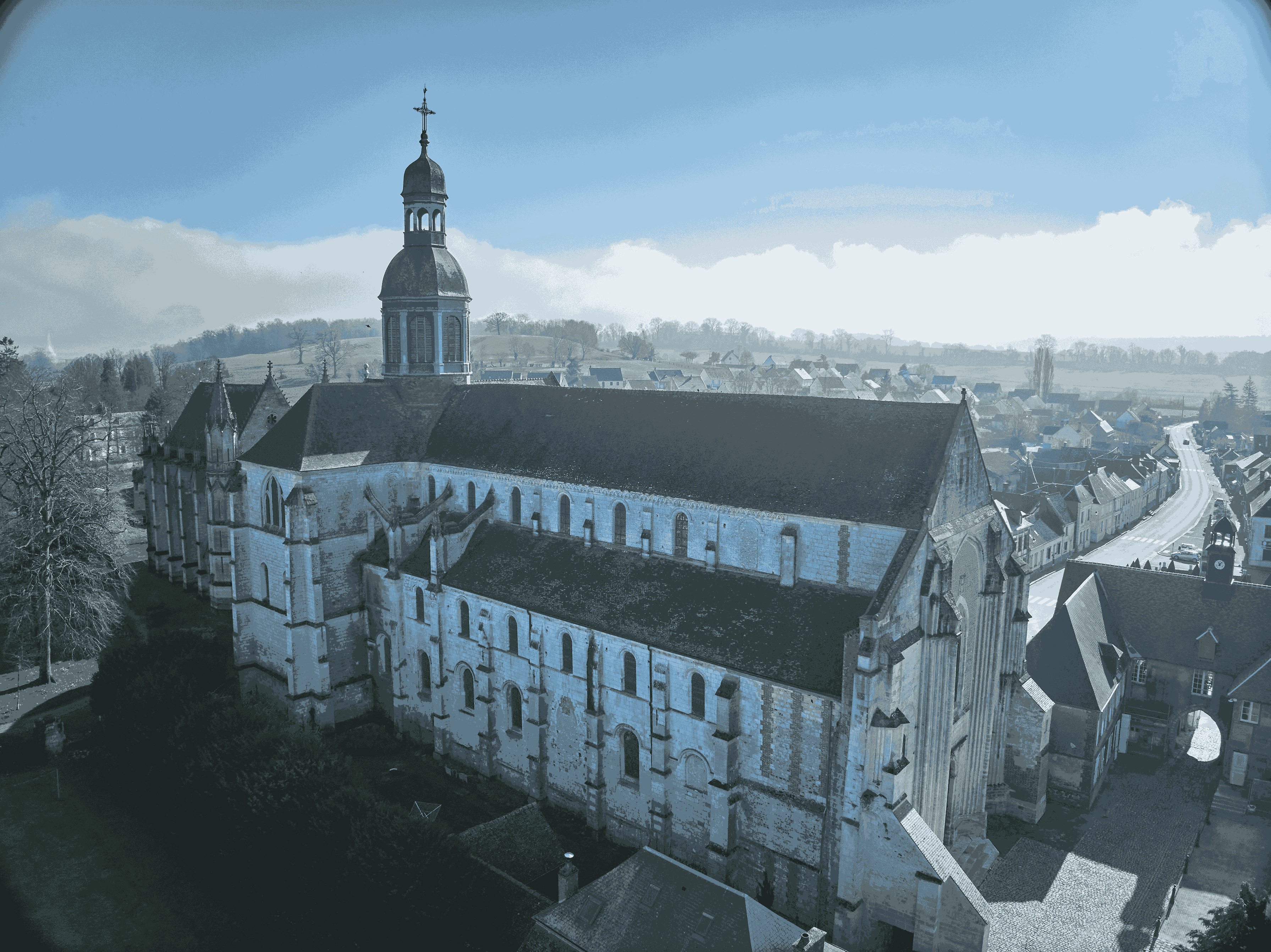
Les images sont-elles réelles ?
La modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ?
Photographie drone de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025
Un bâtiment peut subir de grandes modifications au fil du temps. Une abbaye moyenâgeuse peut être détruite entièrement ou partiellement puis reconstruite à l’identique ou non. Nous ne voyons alors que l’état actuel de l’abbaye sans connaître son évolution. C’est pour cette raison que la modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle, il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ? Intéressons-nous à l’exemple de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly pour laquelle j’ai travaillé pour répondre à cette question.
La méthode de réalisation d’une reconstitution 3D
Sur ce projet, le modèle 3D est construit à partir des scans laser et des prises de vue en drone de l’abbaye effectuées en 2023 par l’entreprise Art Graphique & Patrimoine. L’objectif était de faire un modèle au XVIIIe siècle et un autre au XIVe siècle permettant de voir l’évolution architecturale du lieu. Pour représenter l’abbaye à ces périodes, les modélisateurs et les graphistes travaillent de concert avec un historien, Anthony Petit. Ce dernier leur apporte des sources textuelles et iconographiques sur le bâtiment pour corriger les défauts de l’abbaye numérisée. Après plusieurs allers-retours, la reconstitution achevée ne peut être parfaite puisque tout n’est pas présent dans les sources. Les lacunes documentaires sont bien souvent inévitables et des choix de représentation sont faits. Par exemple la façade de l’abbaye, était composée de deux tours au XIVe siècle mais elles ont été détruites pendant la guerre de Cent Ans. Il n’en reste aucune trace, mais il faut bien la représenter. La façade était probablement ornée de sculptures, mais le choix a été fait de la neutraliser dans sa représentation. C’est-à-dire qu’elle est modélisée le plus sobrement possible pour ne pas interpréter le bâti à sa guise et ainsi tromper le visiteur.

Reconstitution de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025
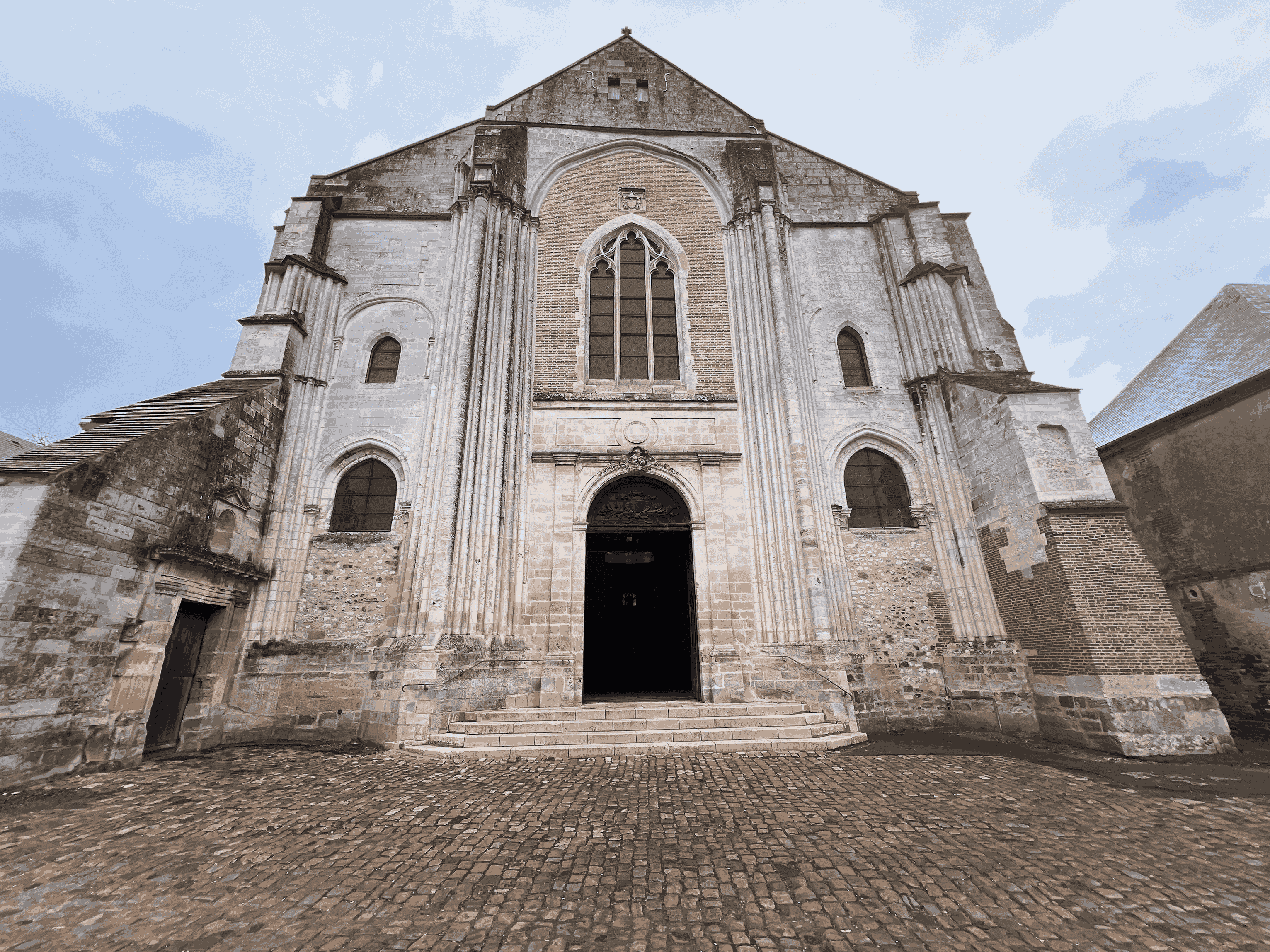
Photographie de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Mathis CHOCAT, 2025
Cette façon de représenter l’abbaye crée des biais dans la perception du visiteur. Une personne qui n’est pas connaisseuse de ce type d’architecture prendra pour argent comptant ce qui lui est présenté comme étant une reconstitution. Il faudrait exprimer cette incertitude dans la reconstitution, mettre en évidence les éléments neutralisés. C’est possible de le dire directement au visiteur dans un texte ou une capsule audio liée à la modélisation, mais c’est au risque d’alourdir le discours et de rendre confus les utilisateurs. Pour y remédier et faire comprendre intuitivement au visiteur cette incertitude, on peut mettre ces éléments en transparence.

Reconstitution du prieuré Saint-Martin d’Ambierle, AGP, 2025
La réalisation d’un modèle 3D d’un bâtiment encore visible pose déjà beaucoup de questions, mais c’est encore plus difficile pour des édifices disparus. Les sept merveilles du monde antique ou encore la bibliothèque d’Alexandrie ont été de nombreuses fois modélisées en se basant sur le peu de sources qui en parlent, mais jamais leurs images ne pourront être exactes. Pourtant, cela forge un imaginaire et crée des certitudes chez ceux et celles qui les verraient pour la première fois et les considéreraient comme des représentations fidèles.
Mathis CHOCAT
#modélisation #patrimoine #reconstitution
Pour aller plus loin :

Les muséums d’histoire naturelle, une prise de conscience écologique ?
Alors que les enjeux écologiques sont connus de tous depuis de nombreuses années, comment les institutions culturelles prennent part à cette « prise de conscience » ? Les muséums d’histoire naturelle sont, du fait de leur histoire, intimement liés à cette question. En effet, comme le démontrent très bien Florian Charvolin et Christophe Bonneuil dans leur article « Entre écologie et écologisme : la protection de la nature au Muséum dans les années 1950 », les muséums, et principalement celui de Paris, s’investissent d’un nouveau rôle à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale : celui de la protection de la nature. Même si aujourd’hui, leurs missions se sont éloignées de cet objectif et correspondent dorénavant à celles d'une institution culturelle, il n'en est pas moins intéressant de comprendre comment se placent les muséums face à ces questions d’environnement, de biodiversité et d’écologie.
Présenter la nature comme un bijou de biodiversité
Le musée d’histoire naturelle de Paris propose depuis le 23 octobre 2021, l’Odyssée sensorielle une exposition coproduite par le muséum et par la société Sensory Odyssey. Dans cette exposition, un parti pris fort est tenu : montrer la richesse de la nature et faire découvrir aux publics le monde animal. Durant tout le parcours, les visiteurs.euses passent d’espace en espace, de monde à monde : marais, forêt, savane, océan, souterrains, banquise, etc. Dans chacun de ces mondes, ils sont invités à regarder la nature vivre sur de grands écrans accompagnés d’un dispositif olfactif ainsi que des jeux de lumière et de température.

Odyssée sensorielle, © M.Maine.
Cette exposition « spectacle » souhaite montrer une nature qui émerveille. La protection de l’environnement n'est pas le fond du propos. Néanmoins, comme ce projet est basé sur des campagnes de vidéo-reportages, certains moments captés rappellent aux publics les problèmes écologiques actuels de fonte des glaces comme de pollution des mers, avec des exemples comme celui d’une chute de glacier ou encore d’une baleine essayant de manger un sac plastique. Pour autant, le discours proposé par le muséum en fin de parcours, dans le « point chaud », ne traite pas réellement de ces moments captés.
Il est vrai que les muséums d’histoire naturelle ont longtemps été un moyen de montrer aux publics la richesse et la beauté de l’environnement. Certaines scénographies sont très représentatives de ce discours comme la première partie du parcours du Naturalis de Leiden (Pays-Bas), Life. Une gradation scénographique et muséographique prépare petit à petit, depuis les profondeurs, les publics à s’émerveiller devant le foisonnement de spécimens à la surface. Un grand nombre de mammifères y sont exposés dans une mise en scène spectaculaire.

Life, Naturalis de Leiden © M.Maine.
Une histoire des collections à connaître
Cette idée d'accumulation fait partie intégrante de l’histoire des muséums et de leurs collections. En effet, les premières collections de sciences naturelles ont été rassemblées dans des contextes particuliers, principalement au XIXe siècle. Il s’agissait alors d’une collecte systématique dont témoigne aujourd’hui le nombre de spécimens présentés dans les institutions (200 000 au muséum de Paris par exemple). Certains muséums prennent même le parti de l’illustrer dans leur muséographie comme le Muséum d’histoire naturelle de Lille et la présentation d’oiseaux dans les anciennes vitrines.
Cette masse de spécimens se retrouve également dans le Naturalis de Leiden et notamment dans la partie dédiée à la séduction et à la reproduction. En effet, au centre d’un espace très scénographié, sont exposés œufs, nids, petits, adultes, fruits d’arbre, etc. La mise en scène à destination du jeune public rend le tout très ludique et amusant. Néanmoins, il s’agit de collectes massives de spécimens, allant toujours plus loin dans la « collection » : le mâle, la femelle, les petits, l’espèce avec son pelage d’hiver, les œufs, les nids, etc.
Comment parler de l’impact humain sur l'environnement dans un muséum ?
Le Natuurhistorisch de Rotterdam rappelle aux publics les enjeux écologiques actuels tout au long de son parcours. Une salle dédiée aux expositions temporaires accueille un.e artiste contemporain.e qui compose des peintures de paysages naturels « habités » par les déchets humains (masques, canettes ou autres). Dans le reste du parcours, un dispositif expographique pousse les publics à se remettre en question : l’animal est obligé de s’adapter à son environnement, imposé par l’humain. Ainsi, sur un socle, un cygne naturalisée est installée dans son nid entièrement constitué de déchets humains. Cette mise en scène peu habituelle et rare dans les muséums marque un réel tournant muséographique : ne plus présenter l’animal dans son environnement fantasmé et idéalisé mais bien dans un contexte bouleversé par l’humain.

Natuurhistorisch de Rotterdam© M.Maine.
La séduction, la reproduction, la naissance sont autant de thèmes particulièrement plébiscités par ces institutions mais la mort des espèces ne l’est pas tant que cela. Deux structures évoquent toutefois la mort des êtres vivants dans un discours engagé : le Naturalis et le Natuurhistorisch. Le premier accorde à la mort un espace d’exposition complet, Death mettant en scène le décès de l’animal causé par l’homme. Dans cet espace, la muséographie présente notamment les méthodes d’éradication des espèces qualifiées de nuisibles, la quantité d’insectes tués lors de nos déplacements en voiture, nos habitudes alimentaires omnivores ou encore l'utilisation du cuir ou des peaux animales pour certaines confections de vêtements. Même s’il n’y a pas de remise en cause de ces pratiques, aborder cette thématique reste un geste fort (et nécessaire) pour le muséum. Du côté du Natuurhistorisch, le propos autour de ce sujet est plus pointu : pour parler des espèces tuées sur la route, une vitrine expose directement un hérisson écrasé. Le muséum appose également la mention des circonstances dans lesquelles les animaux naturalisés, nouvellement acquis, sont décédés sur un cartel (impact avec un hélicoptère, marée noire, etc.). Les enjeux écologiques ne sont pas tant abordés dans les muséums par la démonstration des extinctions de masses mais bien par l’impact « direct » de l’humain sur la faune : transport, élevage, chasse, etc.
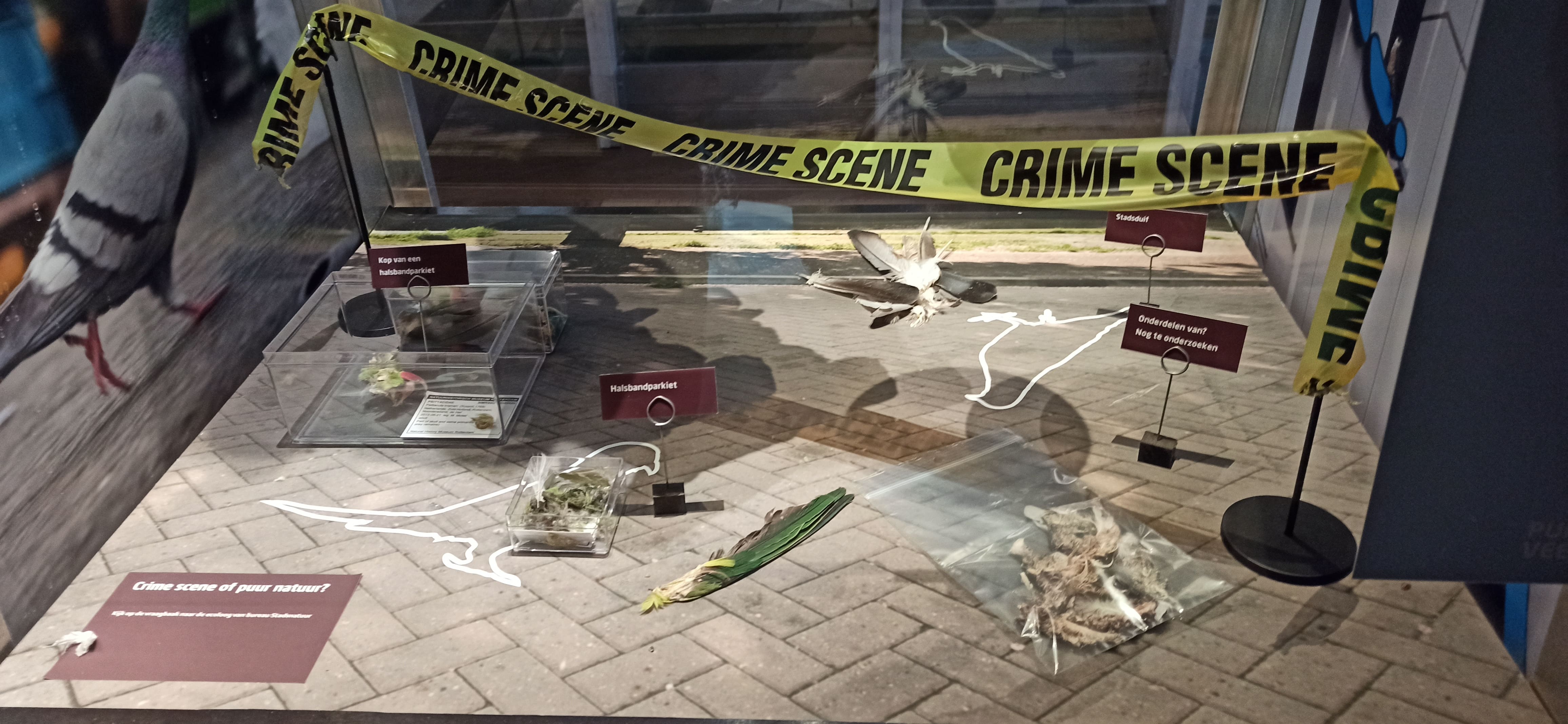
Natuurhistorisch de Rotterdam© M.Maine.
Les muséums peuvent aborder de différentes manières les questions d’écologie, d’environnement et de bien-être animal, que ce soit dans leurs discours, dans leurs sujets d’exposition ou même dans leurs expôts.
Et si ces institutions ne se limitaient pas à traiter ces questions comme un sujet d’exposition mais s’interrogeaient elles-mêmes sur leur propre consommation et leur impact écologique ? Énergie, matières premières, recyclage… De plus en plus d’expositions sont développées avec une volonté d’« écoconception » ; c’est-à-dire une conception respectant au mieux les principes du développement durable ainsi que l’environnement.
MAINE Marion
Références bibliographiques / pour aller plus loin
- C. BONNEUIL et F. CHARVOLIN, « Entre écologie et écologisme : la protection de la nature au Muséum dans les années 1950 », Responsabilité et environnement, n°46, avril 2007, p. 46 à 52. https://www.annales.org/re/2007/re46/charvolin-bonneuil.pdf
- C. CASEDAS, « Musées et écoconception : théorie et bonnes pratiques», J’ai l'œil du tigre,n°61. https://podcast.ausha.co/j-ai-l-oeil-du-tigre/61-musees-et-ecoconception-theorie-et-bonnes-pratiques
- A. SONVEAU, « Odyssée Sensorielle : expérience sensorielle, sensationnelle ou sensible », L’Art de Muser, 28 mars 2022. http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2331-odyssee-sensorielle-experience-sensorielle-sensationnelle-ou-sensible
#Muséum #Environnement #ImpactsHumains

Les zoos vont-ils se transformer en parcs d'attractions ?
Spectacles, décors, costumes… Certains parcs zoologiques s’inspirent de l’industrie du divertissement pour satisfaire leur public, au risque d’en oublier leurs missions de conservation et de culture scientifique.
© S.T.
Pendant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus, nous avons été nombreux à passer le temps en regardant Netflix. Une série documentaire semble avoir particulièrement profité de ce concours de circonstances et a battu des records d’audience : Tiger King (aussi connue en France sous le titre Au royaume des fauves). La série raconte le quotidien rocambolesque de Joe Exotic, propriétaire d’un zoo privé aux Etats-Unis, et amène le spectateur à s’interroger sur la détention d’animaux sauvages en captivité.
Vous allez me dire : quel est le rapport avec les musées ?
Le rapport réside dans le fait que cette série aborde en filigrane la thématique des parcs zoologiques en général. Oublions un instant les zoos privés filmés pour Tiger King et intéressons-nous aux parcs « officiels » auxquels nous sommes davantage habitués en France. Ces structures ont des objectifs similaires à ceux des musées : la conservation et la diffusion de connaissances. Les zoos conservent en effet des espèces animales et entretiennent ce qu’on appelle des collections vivantes, qui font l’objet d’échanges (plus rarement d’achats) entre différents établissements. Ils ont par ailleurs une vocation éducative puisqu’ils transmettent au public des connaissances sur les animaux présentés grâce à des panneaux pédagogiques, des animations, des dispositifs ludiques ou d’autres types de médiations. On peut donc les qualifier de musées vivants, au même titre que les jardins botaniques.
Il existe néanmoins des parallèles frappants entre certains zoos et les parcs d’attractions. Rares sont les structures muséales qui proposent de dormir sur place dans des lodges, de faire de la tyrolienne au-dessus des collections ou de s’offrir des visites VIP. Ces activités sont la plupart du temps payantes et très onéreuses. Pourquoi une telle flambée des prix (que l’on s’attendrait davantage à observer dans un parc d’attractions que dans un musée) ? La réponse se trouve en partie dans la situation hétérogène des différents parcs zoologiques : certains sont entièrement publics tandis que d’autres sont privés ou possèdent un statut mixte public-privé, et n’ont donc pas le même accès aux subventions. Chez ces structures qui dépendent fortement de la vente de billets et de prestations pour assurer leur fonctionnement, la concurrence est rude. Elles doivent gagner de l’argent par tous les moyens afin de pouvoir payer les frais très élevés liés à l’entretien des animaux et des infrastructures, qui restent invariables quel que soit le taux de fréquentation. C’est ainsi que s’engage une sorte de compétition marketing entre les parcs qui s’efforcent de devenir plus attractifs que leurs voisins, en vendant toujours plus de rêve, de divertissement et d’activités inédites aptes à drainer les visiteurs vers eux plutôt que vers leurs concurrents. Les structures les plus ambitieuses (Beauval, Sainte-Croix, La Flèche, pour citer quelques noms célèbres) se sont transformées en véritables complexes touristiques associant hôtellerie, restauration, et parfois spectacles à gros budget au sein de décors presque hollywoodiens. Certains zoos ont même créé leur propre marque d’alcool vendue sur place. C’est à qui trouvera l’idée la plus originale pour éveiller la curiosité d’un public qui aurait apparemment déjà tout vu.

Un nombre croissant de zoos développent une activité d’hôtellerie pour inciter les visiteurs à rester plus longtemps sur place – l’investissement est coûteux mais ensuite très lucratif.
© S.T.
Et les animaux, dans tout ça ? Ils conservent bien entendu une place centrale. La très grande majorité des zoos ne manquent jamais de mettre en avant leur rôle dans la conservation des espèces et de la biodiversité à travers des programmes d’élevage, la récolte de fonds pour des associations de protection, la sensibilisation du public – et parfois la réintroduction d’animaux dans la nature, bien que cela reste exceptionnel tant ce type d’action s’avère compliqué à réaliser. Les zoos modernes ont donc un rôle de conservation et d’éducation que ne possèdent pas les parcs d’attractions. Cela les différencie également des premières ménageries où l’on collectionnait les espèces sans se préoccuper de leur sauvegarde, et où les animaux étaient exposés comme de simples curiosités. Cet héritage n’a cependant pas tout à fait disparu : en parallèle de leurs actions de protection et de sensibilisation, beaucoup de zoos actuels continuent de gérer leurs collections en fonction des désirs du public – allant parfois à l’encontre des impératifs de conservation.
Prenons un exemple avec un animal emblématique de ce problème : le tigre blanc. Ce félin ne constitue pas une espèce à part entière ; il s’agit d’un tigre porteur d’une mutation génétique très rare qui modifie la couleur de son pelage. Les spécimens concernés peuvent rencontrer de grandes difficultés pour survivre à l’état sauvage, car leur blancheur les empêche de se camoufler et constitue donc un handicap pour la chasse. Ceux qui vivent aujourd’hui dans les zoos descendent d’un unique individu mâle que l’on a fait se reproduire avec sa propre fille. En effet, la mutation ne peut s’exprimer que si les deux parents la portent, ce qui a conduit les éleveurs à effectuer des unions consanguines sur plusieurs générations. Cette consanguinité engendre de graves problèmes de santé chez de nombreux tigres blancs. Le patrimoine génétique de ces animaux a été si bien affaibli par ce phénomène qu’il serait impensable de les réintroduire dans la nature ou de les inclure dans un quelconque programme de conservation. Par conséquent, les tigres blancs n’ont aucun rôle à jouer dans la sauvegarde de leur espèce et leur élevage est fortement déconseillé par les associations, dont l’AZA (Association of Zoos and Aquariums). Certains parcs, comme celui de Thoiry, l’ont bien compris et dénoncent ouvertement cette pratique ; mais d’autres persistent à reproduire des tigres blancs car le public apprécie les animaux rares, qui permettent d’augmenter les ventes de billets et constituent un outil marketing efficace. Nous voici bien loin des objectifs de conservation d’une structure muséale – quant à celui de la diffusion de connaissances, il est discutable dans ce cas précis : est-il vraiment nécessaire de perpétuer l’élevage d’animaux consanguins ayant une forte chance de naître malades ou handicapés pour expliquer au public ce qu’est une mutation génétique ?
Les tigres blancs sont des animaux consanguins ne jouant aucun rôle dans la conservation des espèces, mais plusieurs zoos continuent de les reproduire car ils plaisent au public.
© M.T.
Ce n’est là qu’un exemple parmi les diverses dérives qui ont cours dans un certain nombre d’établissements. Des difficultés financières peuvent pousser les gérants à prendre des décisions en totale contradiction avec leur discours de protection de la biodiversité – éloignant ainsi le zoo du secteur muséal pour le rapprocher de celui des parcs d’attractions. C’est un cercle vicieux qui s’enclenche : plus les visiteurs réclament du spectaculaire (des tigres blancs, des éléphants, des ours polaires, la possibilité de caresser des animaux sauvages, de se prendre en photo avec pour alimenter les réseaux sociaux, etc), plus les zoos leur proposent du spectaculaire afin de les attirer, les faire revenir et leur vendre des prestations. Cela a pour effet de conforter le public dans ses attentes initiales et de l’inciter à demander toujours la même chose en passant complètement à côté de l’essentiel – à savoir que la biodiversité ne se résume pas à des tigres blancs, des éléphants et des ours polaires, et que les animaux sauvages ne sont pas des peluches dont l’unique fonction est de se faire caresser. Cette spirale infernale fait sombrer certains responsables de zoos dans une démesure inquiétante : il est ainsi des structures (hors de France) qui vont jusqu’à proposer aux visiteurs d’être pris en photo avec de grands félins tenus en laisse, moyennant une somme assez conséquente, sous prétexte que cela permettrait au public de s’attacher à eux et ainsi se sentir plus investi dans leur protection… ! Mais par quel moyen le fait d’être photographié avec un animal sauvage « apprivoisé » – qui n’en reste pas moins dangereux – peut-il aider le visiteur à comprendre son rôle dans l’écosystème ? Ne risque-t-on pas plutôt de lui faire croire que l’espèce en question ferait un excellent animal de compagnie, et ainsi lui donner envie de posséder son propre zoo privé comme ceux présentés dans la série Tiger King ? Jouer sur l’aspect affectif pour attirer du public est toujours efficace et l’on peut comprendre que les parcs recourent à cette pratique, surtout s’ils sont en difficulté, mais les conséquences peuvent s’avérer très néfastes à long terme. Alors comment réagir face à pareil dilemme ?
La solution se trouve peut-être dans la manière dont le zoo s’adresse à son public : si les attentes actuelles de celui-ci ne correspondent pas à la philosophie de sauvegarde des espèces, alors les zoos se doivent d’essayer de modifier ces attentes en prenant soin d’éviter de s’adresser aux visiteurs comme à des ignares incapables d’apprécier autre chose que des spectacles de dauphins. Les parcs devraient démontrer que la nature est suffisamment fascinante en elle-même pour ne pas avoir besoin d’y rajouter des artifices ; ils devraient plus souvent mettre en lumière les aspects méconnus de notre faune locale, tout aussi intéressante que la faune exotique à condition que l’on daigne s’arrêter pour mieux l’observer ; ils devraient enseigner aux visiteurs comment protéger la biodiversité autrement qu’en se contentant de signer un chèque pour une association à l’autre bout du monde. Le ZooParc de Beauval (établissement spectaculaire s’il en est) commence à s’engager dans cette voie en proposant par exemple des ateliers de recyclage d’objets du quotidien : une activité à première vue moins cool que de se prendre en photo avec un lémurien sur l’épaule, mais beaucoup plus intéressante sur le plan pédagogique et applicable même après la visite, dans la vie de tous les jours.
Les zoos ne seront pas obligés de se transformer en Disneyland des animaux ou en cirques pour se perpétuer, à condition qu’ils mettent leur créativité au service de leurs missions de conservation et d’éducation plutôt qu’à celui d’un divertissement éphémère, sans réel contenu. Le grand défi actuel des parcs zoologiques consiste à trouver la meilleure façon de présenter les espèces pour ce qu’elles sont, et non pas pour ce que le public voudrait qu’elles soient. En relevant ce défi, les zoos pourront petit à petit élever les attentes de leurs visiteurs dans le bon sens et les amener à considérer les animaux avec respect tout en se passionnant pour la biodiversité dans son ensemble – qu’elle soit proche ou lointaine, commune ou plus rare.
Pour aller plus loin :
Communiqué de l’AZA à propos de l’élevage d’animaux présentant des mutations génétiques
Exemple de zoo proposant d’être photographié avec de grands félins et d’autres animaux sauvages
Atelier du ZooParc de Beauval sur la thématique du recyclage
#zoo
#divertissement
#sciences
M. T.
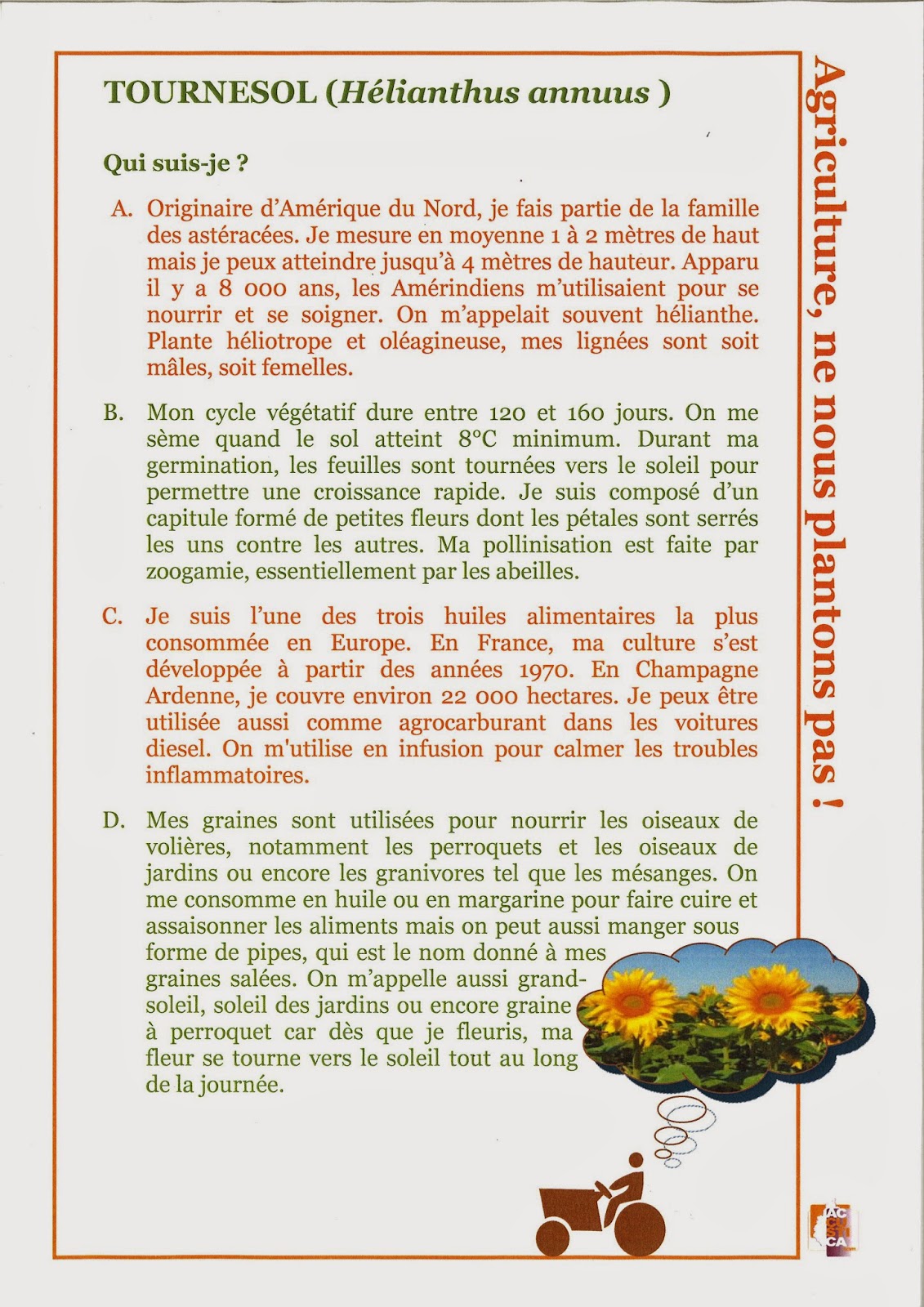
Mallette pédagogique, brève de stage
En première année du Master Expographie Muséographie, j’ai effectué mon stage à Accustica à Reims en tant que chargée de mission pour la création d’une mallette pédagogique sur l’agriculture. Il a fallu concevoir le contenu, penser les objectifs des outils, prévoir leurs formes et leur faisabilité mais aussi acheter le matériel en lien avec la malle ainsi que des livres et des jeux pouvant l’accompagner. Il s’agit de donner les clés à l’emprunteur de la malle pour qu’il comprenne l’agriculture.
Accustica, un CCSTI, une association
Créée en 2005, l'association Accustica est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Elle vise à promouvoir la culture scientifique en Champagne-Ardenne.Elle fut aussi nommée Pôle Territorial de Référence (PTR) en 2012 par le préfetde Région et le Président du Conseil régional. Par cette nomination, l'associationdoit animer le réseau régional des CSTI dans le respect de la diversité locale,proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives et inscrire lapolitique d'action culturelle régionale dans un projet global national pilotépar Universcience.
Les missions d'Accustica
- Rendre accessible au plus grand nombre les Sciences et les Techniques : enfants des écoles primaires, collégiens, lycéens, étudiants du supérieur et grand public.
- Favoriser la création et la diffusion d'outils de médiation et d'expositions itinérantes pour les professionnels et les amateurs de science.
- Mettre en place de nombreuses actions avec l'ensemble de ses partenaires, comme par exemple la Fête de la Science, organiser des conférences scientifiques et des visites d'industries ainsi qu'organiser des rencontres entre scientifiques et grand public (cafés des sciences, spectacles, portes ouvertes, Exposciences, Classes en Fac).
- Mettre en œuvre une politique globale de culture scientifique et technique en région Champagne-Ardenne en créant un réseau qui regroupe tous les acteurs locaux de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (industriels, laboratoires de recherche publics et privés, collectivités territoriales, milieux éducatifs, monde culturel et associatif,...), pour permettre une meilleure diffusion de cette culture scientifique, technique et industrielle sur l'ensemble du territoire régional.
Ma mission de chargée de médiation
J’avais pour mission de créer une Malle Doc sur le thème de l’agriculture, intitulée :« Agriculture, ne nous plantons pas ! ». Elle est composée de cinq outils pédagogiques. L’un des outils représentatifs de cette mallette, le « Qui suis-je » est un jeu qui consiste à deviner le nom d'une plante par le biais d'une courte biographie, d'une vingtaine de lignes, énoncée par l'animateur. Celle-ci commence toujours par des indices difficiles, puis de plus en plus faciles, de telle sorte que s'il est en général difficile de donner la réponse au début, tout le monde est susceptible de trouver la réponse à la fin de l'énoncé. Le candidat gagne de 4 points à 1 point selon la rapidité de sa réponse. Les habitués de Question pour un champion connaissent le principe…
Je vous propose de tester une énigme :
Qui suis-je ?
A. Originaire d’Amérique du Nord, je fais partie de la famille des astéracées. Je mesure en moyenne 1 à 2 mètres de haut mais je peux atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur. Apparu il y a 8 000 ans, les Amérindiens m’utilisaient pour se nourrir et se soigner. On m’appelait souvent hélianthe. Plante héliotrope et oléagineuse, mes lignées sont soit mâles, soit femelles.
B. Mon cycle végétatif dure entre 120 et 160 jours. On me sème quand le sol atteint 8°C minimum. Durant ma germination, les feuilles sont tournées vers le soleil pour permettre une croissance rapide. Je suis composé d’un capitule formé de petites fleurs dont les pétales sont serrés les uns contre les autres. Ma pollinisation est faite par zoogamie, essentiellement par les abeilles.
C. Je suis l’une des trois huiles alimentaires la plus consommée en Europe. En France, ma culture s’est développée à partir des années 1970. En Champagne Ardenne, je couvre environ 22000 hectares. Je peux être utilisée aussi comme agrocarburant dans les voitures diesel. On m'utilise aussi en infusion pour calmer les troubles inflammatoires.
D. Mes graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux de volières, notamment les perroquets et les oiseaux de jardins ou encore les granivores tels que les mésanges. On me consomme en huile ou en margarine pour faire cuire et assaisonner les aliments mais on peut aussi me manger sous forme de pipes, qui est le nom donné à mes graines salées. On m’appelle aussi grand-soleil, soleil des jardins ou encore graine à perroquet car dès que je fleuris, ma fleur se tourne vers le soleil tout au long de la journée.
La conception d’un outil pédagogique n’est pas facile : le contenant comme le contenu, à la fois ludique et pédagogique, donneront-ils envie d'utiliser l'outil et de comprendre le message que fait passer cette activité ? Tel est le défi.
Avez-vous trouvé ?
Si non, j’espère que vous avez appris des informations sur cette plante.
Si oui, bravo vous devez être un as de l’agriculture, j’espère que vous avez appréciéles explications pour la conception d’outils pédagogiques simples.
Voici la réponse :
L'une des fiches du jeu "Qui suis-je ?" - © Ludivine Perard
Ludivine Perard
#science
# brève de stage
# mallette pédagogique
Pour aller plus loin :

MICROBIOTE, MON AMOUR !
Ras-le-bol de ricaner dans votre for intérieur à l’écoute des mots « prout », « caca » ou « vomi » ? Assez de cette dictature de la bienséance, de la maturité et de cette hypocrisie qui tient à distance les joyeuses turbulences de nos fondements ? Appelons un chat, un chat et une crotte, une crotte, merde à la fin ! En toute décontraction, venez discuter de la consistance de vos selles au détour d’une conversation, extasiez-vous devant la composition de votre flore intestinale et découvrez sans rougir la meilleure position pour évacuer les délices de nos cuisines…
Coup de projecteur sur notre Microbiote bien-aimé à la Cité des Sciences et de l’Industrie du 04 décembre 2018 au 04 Août 20191 !
CHANGEMENT D’ÉCHELLE : UNE EXPOSITION REMAKE D’UN MALICIEUX BEST-SELLER ALLEMAND

Guilia Enders à l’inauguration de l’exposition Microbiote à la Cité des Sciences et de l’Industrie, le 4 décembre 2018. © 2018AFP
Comme on adapterait un livre en film, l’exposition Microbiote tire son scénario de l’ouvrage de vulgarisation scientifique « Le charme discret de l’intestin »2 des sœurs Guilia et Jill Enders. À 28 ans, Guilia est aujourd’hui gastro-entérologue à l’hôpital d’Hambourg. Lorsqu’elle était doctorante à l’université de Francfort, elle gagne à trois reprises le premier prix de la Nuit des Sciences, une sorte de session “slam” pendant laquelle les jeunes chercheurs allemands expliquent à leur public les résultats de leurs recherches. Cette prestation3 de dix minutes, qui fait un véritable buzz sur Youtube, est à l’origine de l’ouvrage. Le best-seller publié en Allemagne en 2014, s’est vendu à 1 200 000 exemplaires et est traduit dans plus de 40 langues… inutile de souligner l’ampleur de son succès. En 2017, la « mise à jour » de l’ouvrage fait état des résultats des récentes recherches au sujet des relations entre l’intestin et le cerveau qui agitent le monde des sciences. Le micorbiote a visiblement le vent en poupe, certaines expositions, à l’image de Manger, la mécanique du ventre4 présentée au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel en 2017, s’emparent de ce sujet qui fait l’objet de nombreuses attentions.
Jill Enders, l’illustratrice du « Charme discret de l’intestin », complète l’ouvrage par des dessins décalés et rafraîchissants, bienvenus pour illustrer les propos tout aussi scientifiques qu’espiègles de sa sœur. Ensemble, elles ont collaboré aux côtés de l’équipe muséographique de la Cité des Sciences et des chercheurs de l’INRA, à la conception de l’exposition Microbiote.
Force est de constater que les 600 m2 d’exposition collent parfaitement au texte de l’ouvrage scientifique. L’organisation tripartite du discours, les figures de style décomplexées, la facétie des illustrations de Jill Enders, les blagues grivoises, tout y est ! À l’image d’un pop-up, le livre s’anime pour changer d’échelle : les chapitres se hissent à la verticale et deviennent des modules expographiques, des manips, des dispositifs audiovisuels pour expliquer au visiteur le mécanisme de notre deuxième cerveau, l’intestin.
« DE LA BOUCHE À L’ANUS », TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR L’INTESTIN
Entrée de l’exposition Microbiote à la Cité des Sciences © Universcience N.Breton

Mur tactile dans la partie réservée au microbiote sur lequel le visiteur peut faire la connaissance de Faecalibacterium Prausnitzii, Akkermancia muciniphila ou encore Streptococcus salivarius. © C.F.
Rose ! Ensuite, le plat principal vous fera apprécier un des mets les plus raffiné du corps humain : le microbiote rôti sur son lit de bactéries, microchampignons, protistes et virus rissolés. Inutile de prendre peur devant leurs noms farfelus, ils sauront se présenter à vous dans les règles de l’art.
Blanc ! En dessert, la spécialité du chef : de précieux conseils enrobés des conclusions pratiques des dernières découvertes scientifiques pour prendre soin de son intestin et donc… de sa cervelle. Un repas à déguster bien chaud ! Ce menu « gastro-nomique » sera d’ailleurs réchauffé lors de l’itinérance de l’exposition, prévue aux tables du Portugal et de la Finlande. Ne dit-on pas que les plats en sauce sont toujours meilleurs réchauffés ?
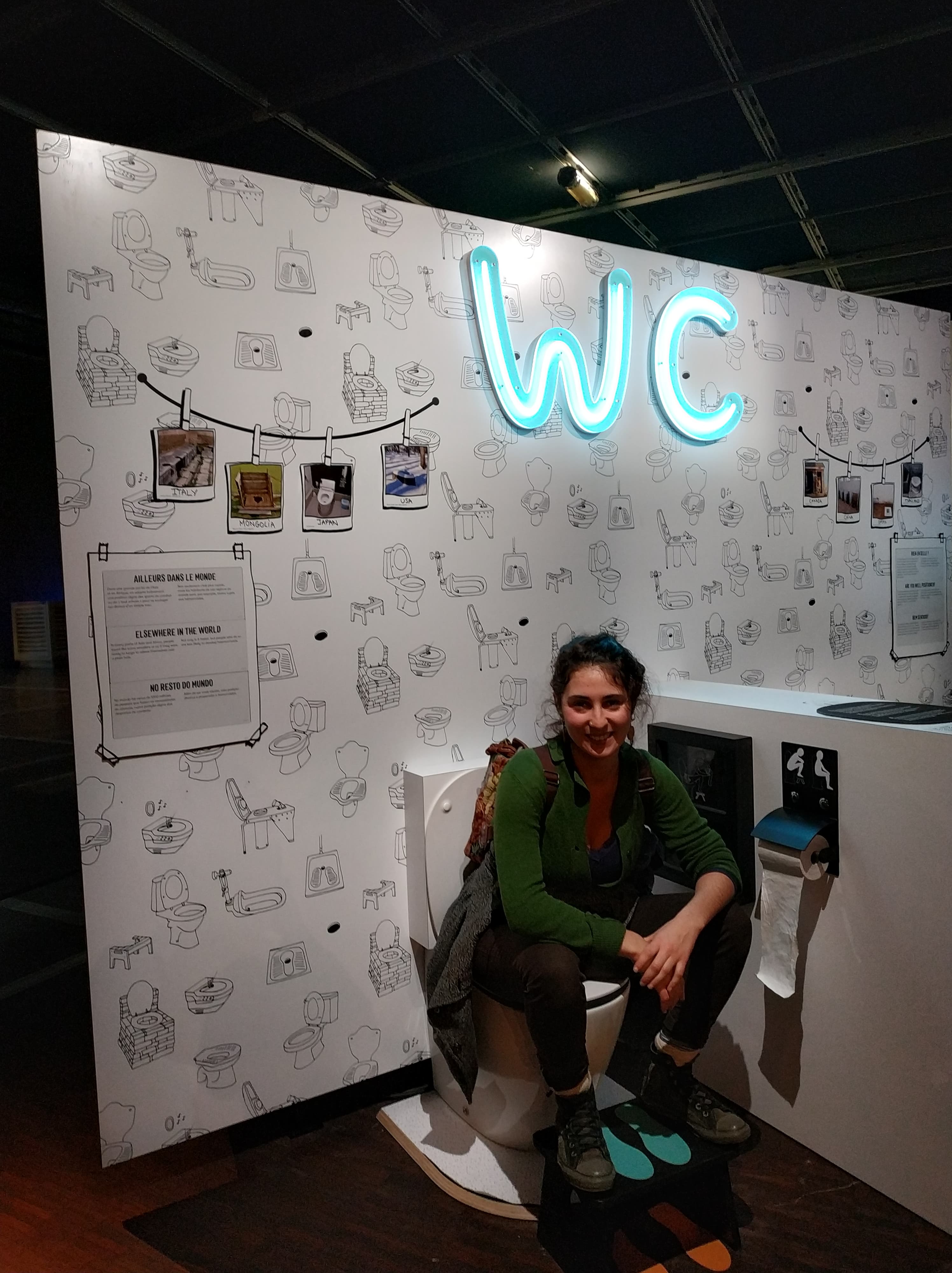
Dispositif expographique pour connaître la position la plus adéquate pour aller à la selle. © C.F.
La scénographie est ronde, colorée, brillante, lisse, moelleuse, gonflée… cette ambiance feutrée nous invite à toucher, caresser, tirer, basculer les multiples manips et dispositifs multimédias dont leur contenu pourrait pourtant en dégoûter plus d’un !
S’AMUSER EN APPRENANT OU INVERSEMENT : LE LEITMOTIV DE LA CITÉ DES SCIENCES
Ludique, interactif, expérimental, la Cité des Sciences est championne toutes catégories. Une des expositions Explora Corps et Sport5 présentée en ce moment au dernier étage de la Cité en est l’exemple probant. Le visiteur s’active, saute, smatche, frappe, court, s’accroupit, rampe dans des cages prévues à cet effet. Ça sent la transpiration à plein nez dans ce gymnase culturel improvisé où le sportif peut consulter a posteriori de son remue-ménage les données relatives à ses performances.
Pour Microbiote, point de transpiration mis à part si vous êtes atteint d’hypersudation. Néanmoins, les manips à gogo sauront tenir en haleine les visiteurs les plus distraits. Des murs interactifs sur les intolérances alimentaires au personnage à basculer pour faire roter, en passant par les seaux contenant différentes sortes de vomis résinés, tout y passe et rien n’est gratuit. Pour seul exemple, en plus d’être drôle et de faire son petit effet, les crottes tactiles permettent d’en apprendre un rayon sur les sept types de selles : leur consistance, leur couleur et leur composition. Le ton pince-sans-rire reprend celui de Guilia Enders et paraphrase le « Carnet scatologique » présent dans le chapitre « L’art du bien chier en quelques leçons - et pourquoi le sujet a son importance » de son livre. Ces informations peuvent notamment s’avérer judicieuses pour détecter certaines maladies.
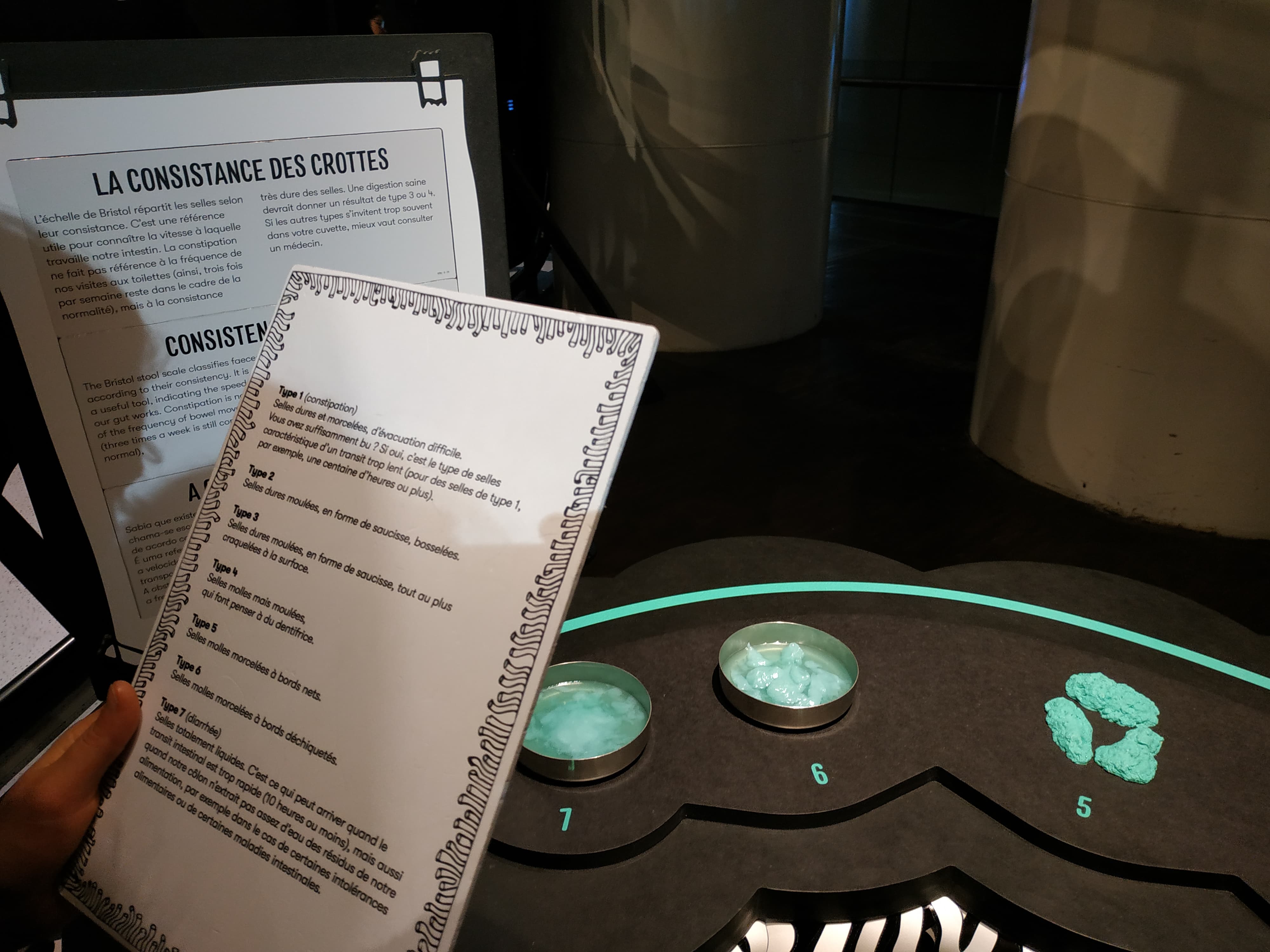
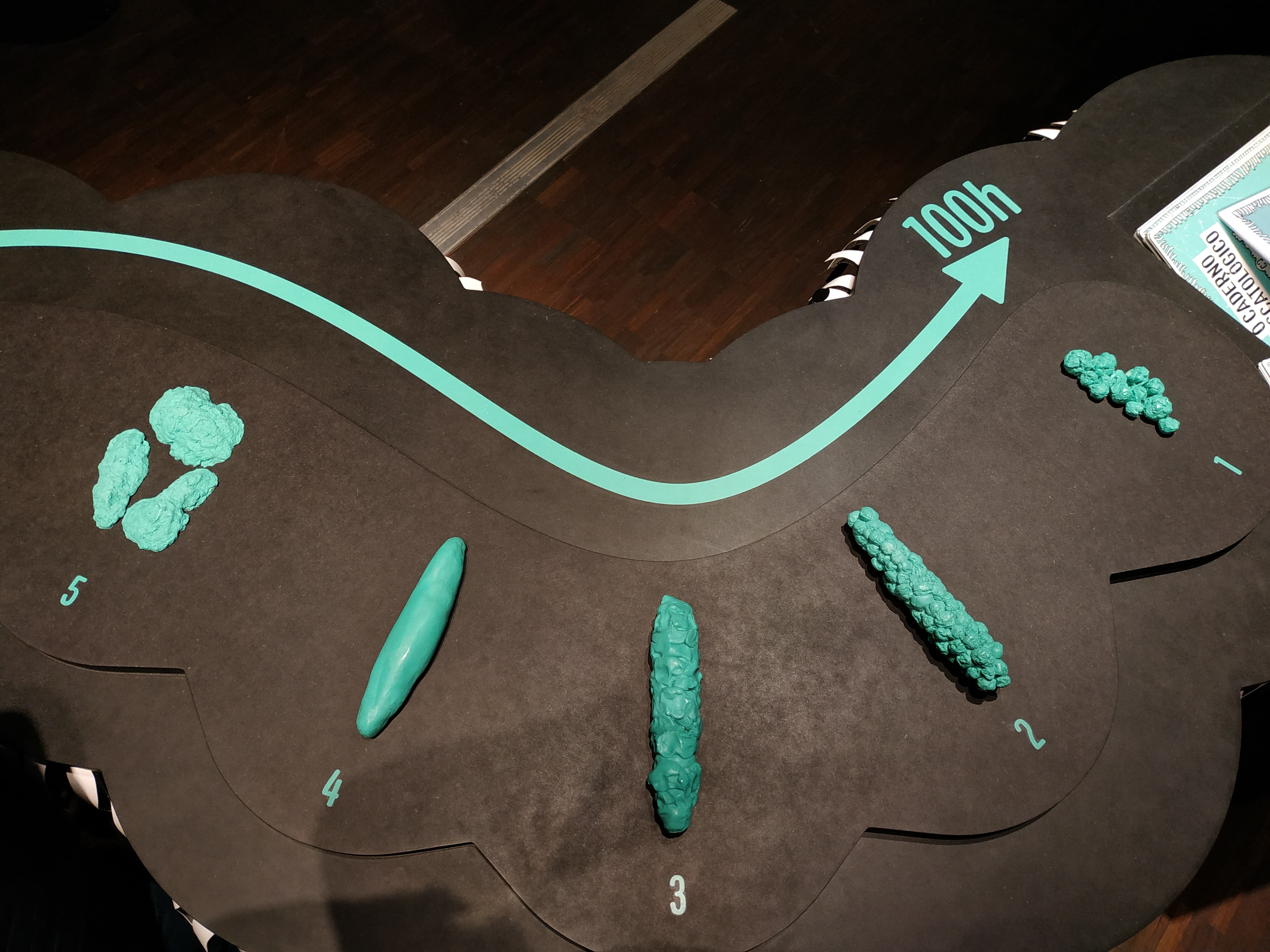
Sept types de crottes tactiles inspirés du « Carnet scatologique » de Guilia Enders © C.F.
En parcourant l’exposition, je ne peux m’empêcher de repenser aux épisodes de la série télévisée d’animation française « Il était une fois… La Vie »6 (Sous-titre : La fabuleuse histoire du corps humain), écrite et réalisée par Albert Barillé en 1986. Une série de vulgarisation scientifique dans laquelle bactéries, globules, champignons et autres cellules, sont personnifiés pour faciliter la compréhension des mécanismes de notre organisme. Les illustrations de Jill Enders s’inscrivent dans ce sillage. Personnifier pour apprendre quitte à parfois simplifier ? Je dis oui ! L’objectif de l’exposition n’est-il pas de sensibiliser le visiteur au sujet du microbiote plutôt que d’en faire un gastro-entérologue aguerri ? L’humour, la poésie et l’impertinence sont d’excellents médiateurs pour chatouiller la curiosité du public néophyte et enclencher une dynamique d’assimilation sur des sujets parfois très scientifiques. Pourquoi s’en priver ? Alors, allez-y ! Sensibilisez, titillez, choquez, étonnez, amusez les visiteurs. Nous sortirons des expositions avec dans la bouche, un goût d’y « reviens-y »…
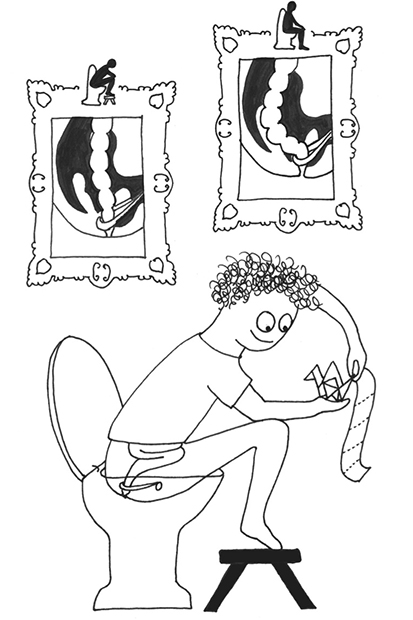
Illustration de Jill Enders pour « Le charme discret de l’intestin »
1 Exposition Microbiote d’après Le charme discret de l’intestin à la Cité des Sciences et de l’Industrie, du 04 déc. 2018 au 04 nov. 2019.
Commissaire : Dorothée Vatinel
Muséographes : Natalie Puzenat et Floriane Perot
Avec la collaboration de Guilia et Jill Enders.
En partenariat avec les chercheurs de l’INRA.
Pour plus d’informations :
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/microbiote/
2 ENDERS, Guilia. Le charme discret de l’intestin. Tout sur un organe mal-aimé. Paris, Actes Sud, coll. « Question de sante », 2015, 368 pages.
Edition augmentée parue en novembre 2017.
3 La présentation de Guilia Enders durant un concours de vulgarisation scientifique, véritable buzz sur Youtube elle est à l’origine du livre. Ça vaut le détour !
https://www.youtube.com/watch?v=MFsTSS7aZ5o
4 Exposition Manger, la mécanique du ventre au Muséum de Neuchâtel, du 27 nov. 2016 au 4 fév. 2018.
Pour plus d’informations :
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/a-decouvrir/actualites-et-animations/172-acces-3
5Exposition Corps et Sport à la Cité des Sciences et de l’Industrie, du 16 oct. 2018 au 5 janv. 2020.
Pour plus d’informations :
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/corps-et-sport/
6 Le générique de la série de vulgarisation scientifique « Il était une fois… La Vie » https://www.youtube.com/watch?v=kNnpHAszq64

Mmmmmmmmh !
Crédits : Virginie Potdevin
Trois temps, deux dynamiques
L’atelier est rythmé par trois temps ce qui permet de varier les activités et de garder l’attention des petits comme des grands.En entrant, des tables rondes présentent des mouillettes contenues dans des flacons. Chaque personne est donc invitée à reconnaître les odeurs de diverses huiles essentielles grâce à l’odorat. Cependant, la vue n’est pas en reste car les feuilles séchées au centre des tables sont de précieux indices, pouvant mener sur le chemin de la réponse que l’on obtient en soulevant un cartel. Ce temps, qui permet à la fois de déambuler dans l’espace et de se concentrer sur ses propres connaissances, laisse ensuite place à une dynamique de groupe. Situé au sein du parc de l’abbaye royale de Chaalis, l’atelier des parfums se déroule dans une ancienne écurie offrant ainsi aux participants un cadre agréable en lien avec la nature. En effet, l’atelier propose de découvrir les plantes par le biais de l’odorat.
Assis devant leur orgue à parfum, tous les participants sentent et tentent de reconnaître l’odeur des mouillettes que l’animatrice fait passer une à une. Une fois la fragrance reconnue, chaque mouillette est entreposée dans une des éprouvettes de l’orgue. Durant cette étape vivante, composée uniquement d’échanges, l’animatrice donne quelques renseignements sur les plantes ou encore sur la manière de procéder afin d’identifier au mieux une odeur, permettant ainsi une fluidité du discours. De même, elle divulgue des recommandations et des informations sur le déroulement de l’atelier au fur et à mesure de l’avancée de ce dernier. C’est donc tout en douceur, au fil des mouillettes, que l’animatrice va amener les participants à adopter une analyse de plus en plus fine.
Enfin, après une explication concise des trois notes (note de tête, de cœur et de fond), les participants doivent choisir les fragrances qui composeront leurs eaux parfumées. A l’image de cet atelier, très didactique, ce choix est facilité par la présence de couleurs sur les éprouvettes représentant chacune une note.
Entre fous rires et pédagogie
Crédits : Virginie Potdevin

L’atelier des parfums reste avant tout un moment de détente où les souvenirs se mêlent volontiers aux éclats de rire. En effet, il est toujours amusant de constater les diverses associations qui s’établissent entre une odeur et une idée. Ainsi, tout au long de l’atelier il est fréquent d’entendre « ça pue » ou encore « j’adore cette odeur, cela me rappelle ma grand-mère ». D’ailleurs, certaines remarques déclenchent facilement une euphorie générale, comme par exemple une dame qui en sentant l’eucalyptus s’est exclamée : « Ca sent le suppositoire ! ». Il est donc facile d’affirmer, avec ce genre de constat, que l’atelier met en éveil le sens que l’on développe le moins ainsi que la mémoire olfactive.
L’originalité de cet atelier est qu’il offre la possibilité de mettre en exergue une créativité immatérielle, une évasion, déclenchée par l’odorat. De plus, il valorise le travail de chacun puisque tous les participants repartent avec sa propre eau parfumée.
Outre le fait d’apporter des connaissances diverses et variées autour du thème des huiles essentielles, L’atelier des parfums sensibilise les participants à la nature et permet de prendre conscience que nous ne prêtons pas assez attention à sa richesse olfactive.
Un atelier qui rayonne
Crédits : Virginie Potdevin

Lieu emprunt de plantes, d’odeurs et de nature enchanteresses, le domaine de l’abbaye royale de Chaalis vous propose de participer à L’atelier des parfums toute l’année pour les groupes (sauf le vendredi et le samedi) et le dimanche à 15h pour les visiteurs.
Alizée Buisson
Abbaye Royale de Chaalis
60300 Fontaine-Chaalis
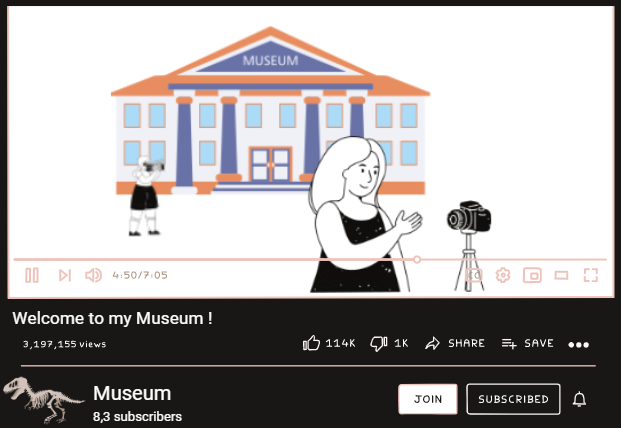
Musées scientifiques et YouTube : je t’aime, moi non plus
Image d'intro : ©M.T
Le YouTube des musées scientifiques
De nombreux musées scientifiques possèdent leur propre chaîne YouTube. Celle du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ouvre en 2017 et compte aujourd’hui 17 800 abonnés. Y sont postés des rediffusions de conférences, des podcasts, des interviews ou de courtes vidéos en lien avec les expositions. C’est le même type de contenu pour la Cité des Sciences et de l’Industrie (créée en 2006 avec aujourd’hui 36 000 d’abonnés) ou le Musée des Confluences (créée en 2015 avec aujourd’hui 1 470 d’abonnés). Ces chaînes YouTube sont un lieu de stockage de vidéos institutionnelles qui sont souvent relayées sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou leur site internet.
Rares sont les musées qui publient des contenus spécifiques à la plateforme. YouTube a ses propres langages et codes, popularisés par les youtubeurs : une vidéo rythmée grâce au montage, de nombreuses références à la culture internet (des chansons, des memes, …) et une relation entre vidéastes et public qui se veut sincère et authentique, en somme, des codes qui tranchent avec des formats télévisuels.
Voici deux exemples de musées qui reprennent ces codes : le musée de Minéralogie de Mines ParisTech ouvre sa chaîne YouTube en 2016 et compte aujourd’hui 1 980 abonnés. La chaîne sert principalement de stockage mais une websérie sort du lot : « Histoire de Cailloux ». En 2017, la première vidéo sort : pendant 1 minute et 44 secondes, Didier Nectoux nous parle de la Sépiolite à travers des anecdotes. 82 épisodes passionnants, vus par 100 à plus de 1 000 personnes. Le second exemple est le Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel qui ouvre sa chaîne en 2016 et compte aujourd’hui 412 abonnés. La websérie « Collections Bestiales », créée en 2017, présente des naturalisations des collections du muséum. Ces vidéos correspondent parfaitement aux contenus spécifiques de YouTube, bien réalisées et très comiques (et je ne dis pas cela parce que j’y suis en stage !).
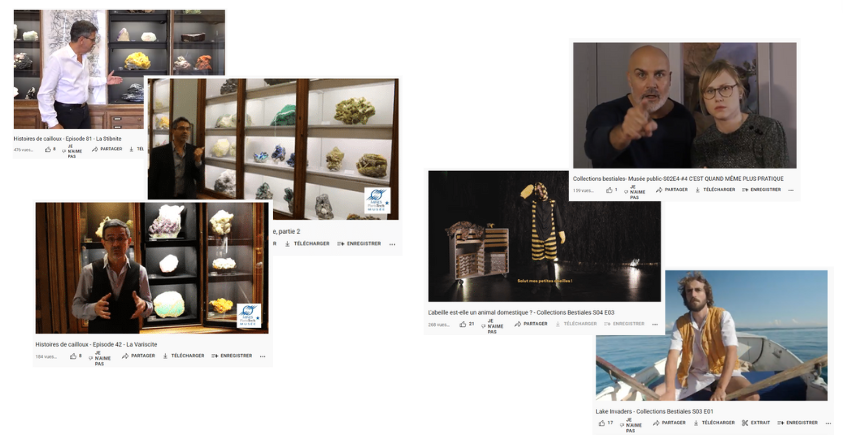
Captures d’écran de la Websérie Histoire de Cailloux (à gauche) ©MINESParisTech et de Collections Bestiales (à droite) ©MHNN
Des collaborations avec des youtubeurs
Les collaborations de youtubeurs avec le Louvre sont sans doute les meilleurs exemples. En 2016, le Louvre décide de collaborer avec 3 youtubeurs, Nota Bene, Axolot et Le Fossoyeur de Films. Ces formats ayant particulièrement bien marchés, le Louvre continue avec 5 autres youtubeurs. Aujourd’hui, ce sont 19 youtubeurs français ou britanniques qui ont réalisé en tout 28 vidéos, certaines ont fait plus de 700 000 vues. Collaborer ainsi est pour les institutions l’occasion de toucher un jeune public, voire de désacraliser l’image des musées, des sciences et des arts. Pour les youtubeurs, cela permet de gagner en crédibilité auprès de leur audience. Ce système de collaboration est souvent unidirectionnel, c’est l’institution qui commande aux youtubeurs.
Concernant les musées scientifiques, peu d’exemple existe. En 2009, Universcience lance la chaîne YouTube « Le Blob, l’extra-média » avec aujourd’hui presque un million d’abonnés. « Infox ? Riposte ! » est une série créée en collaboration avec le youtubeur Thomas Gauthier de la chaîne du même nom. Le Youtubeur Léo Grasset, de la chaîne DirtyBiology a collaboré avec le Louvre et avec le musée des Confluences à Lyon pour promouvoir une de leur exposition.
Somme toute, peu de collaborations existent, pourquoi ? Est-ce par méconnaissance réciproque : les youtubeurs ne se sentiraient pas légitimes et n’oseraient pas aller vers les institutions culturelles. Et de l’autre, les musées manqueraient de budget ou manquent d’intérêt et les médiateurs des musées pourraient craindre de se faire remplacer.
Est-ce que ces collaborations amènent de nouveaux publics ? Nous avons peu de recul sur cette question, une raison de plus pour que les institutions ne s’y engagent pas. En effet, youtubeur est un métier à part entière, l’investissement d’un musée sur cette plateforme en vaut-il la peine ? Vue l’énorme concurrence sur YouTube, il est compliqué de percer sans de gros investissements financiers et humains comme le Louvre.
Pour résumer, les chaînes YouTube des musées scientifiques servent principalement de stockage de vidéos institutionnelles, mais certaines institutions cernent le concept de la plateforme et s’y essayent. D’autres institutions optent pour une autre méthode : la collaboration avec des youtubeurs-vulgarisateurs scientifiques.
Je terminerai par une sélection de vidéos à voir :
« Que diriez-vous d'un os dans le pénis ? - Collections Bestiales #1 » du muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel ©MHNN
« La science des mythes (DirtyBiology et C'est une autre histoire) » de la collaboration entre le musée du Louvre et les youtubeurs DirtyBiology et C’est une autre histoire ©MuséeduLouvre
Enfin, la meilleure pour la fin, la youtubeuse Valentine Delattre de la chaîne Science de Comptoir qui vous fera enfin aimer la géologie. Je rêve de voir une de ses vidéos dans une exposition !
« Ivre, Elle Lèche Des Cailloux (Pour Une Bonne Raison) » ©SciencedeComptoir
Mélanie TERRIÈRE
Pour en savoir plus :
- Document recensant les « 350 chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones à découvrir et partager »
#YouTube #vulgarisation #muséescientifique #youtubeur

Muséonérique, le réveil des collections au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
A l’occasion de son bicentenaire, le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille propose aux visiteurs de découvrir ses coulisses. En effet, les missions du musée, notamment celle liées à la conservation des collections sont mal connues du grand public, et pour cause, peu de communication est faite à ce sujet. L’exposition Muséonérique comble un vide et offre à mon sens un vrai moment de découverte aux visiteurs.
Elle a été conçue et réalisée en partenariat avec La Fabulerie, lieu marseillais regroupant des acteurs qui œuvrent au renouveau des structures culturelles et facilitent leur accès au numérique.
Dans les vitrines, on peut admirer la variété et la richesse des collections d’un muséum : animaux naturalisés, secs, conservés en bocal, mais aussi des herbiers, des minéraux...

© C. L
Gérer les collections d’un musée demande beaucoup de compétences différentes, autant de métiers souvent peu connus en dehors de ses murs... Pour en apprendre un peu plus sur le travail du taxidermiste, une vitrine montre ses différents outils : mannequins en forme d’animal à habiller, yeux en verre, instruments pour sculpter, cordelette pour modeler les veines de l’animal,… Il est même possible d’entendre le témoignage d’un taxidermiste à travers le combiné d’un téléphone. Son travail ne consiste pas simplement à fourrer de la paille dans une peau d’animal, il faut rendre le spécimen le plus réaliste possible, chaque détail est important. Cela signifie aussi que le taxidermiste doit avoir de bonnes connaissances en zoologie !

© C. L
Les réserves d’un musée, c’est aussi des “croûtes”, des objets pas très jolis, pas très bien conservés, des curiosités. En témoignent les spécimens exposés dans un espace aménagé à l’image d’un salon. Ici, de la paille dépasse d’un flamant rose bien fatigué et plus loin, un pauvre cerf est affublé d’un énorme clou sur le front. Vous pourrez même les entendre se plaindre grâce à un dispositif sonore dans lequel ils narrent leur histoire au musée.
Un casque de réalité virtuelle permet d’en découvrir l’intérieur des réserves, espace d’habitude dissimulé et jalousement gardé le personnel du musée… On peut ainsi apercevoir un grand nombre de spécimens sagement rangés sur des kilomètres d’étagères. À cela s’ajoute un commentaire audio qui indique les conditions nécessaires pour préserver les fragiles collections.
En plus de ce casque, de nombreux dispositifs interactifs rythment le parcours de l’exposition. Du côté des insectes, vous serez invités à vous asseoir derrière un bureau en bois ancien pour créer votre insecte : choisissez le corps, les pattes, les antennes,… Une manière ludique de découvrir toutes les formes que peuvent prendre les petites bêtes. Plus loin, sur une table où le couvert est dressé pour un dîner, composez votre propre assiette à partir des aliments présents dans les réserves du Muséum.

© C. L
Plusieurs dispositifs sonores jalonnent l’exposition, dont un qui donne la parole à des spécimens du musée. Mettez un casque et faites la connaissance de l’ours brun, de la marmotte ou du puma.
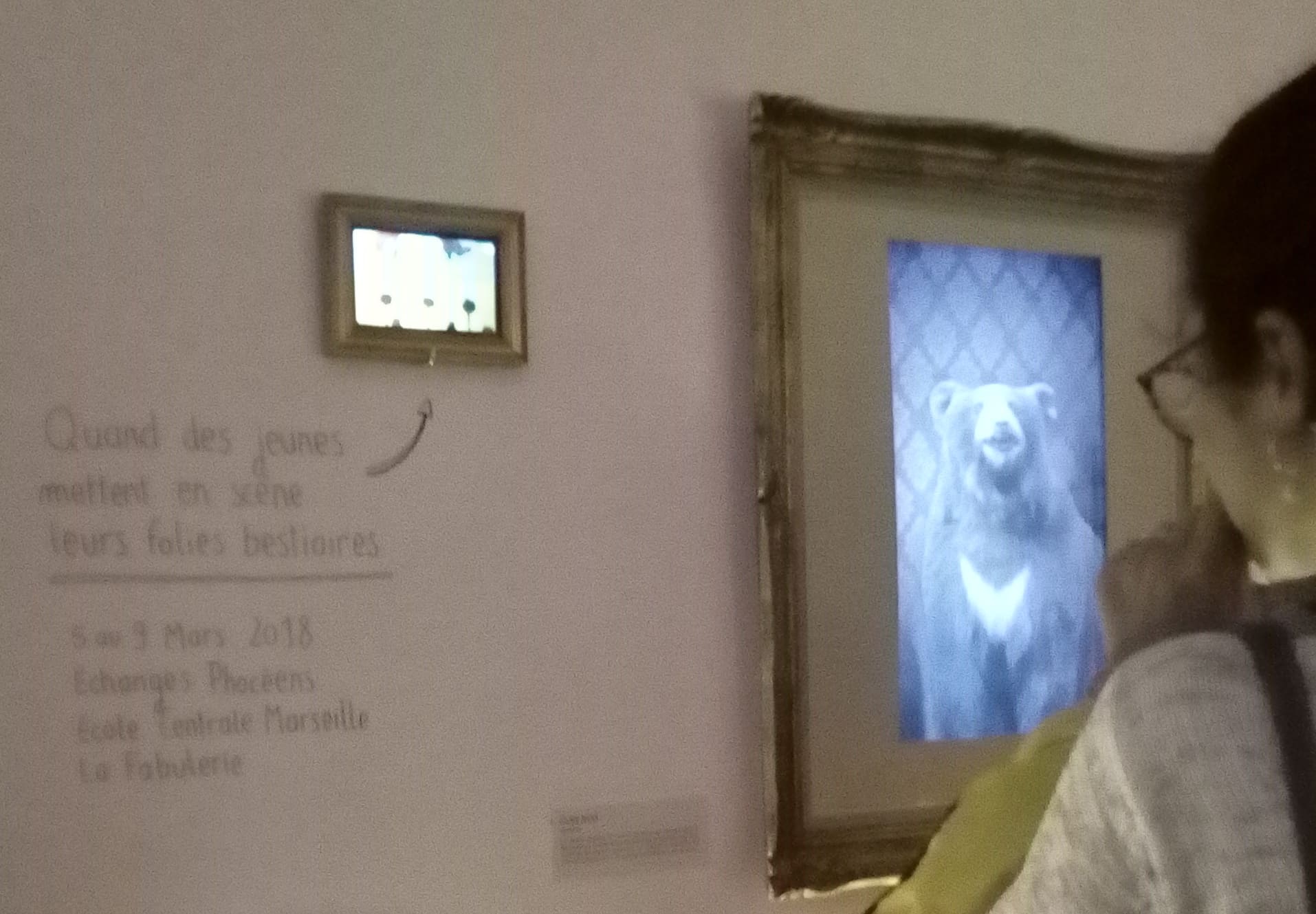
© C. L
Pour aller plus loin, les empreintes de pas des animaux sont accrochées au mur et vous pourrez même les toucher. Quel bonheur de pouvoir poser la main sur un objet exposé, on transgresse une des règles sacrées des musées !
Un dispositif particulièrement réussi consiste à écouter le cri d’un animal et deviner duquel il s’agit. Il suffit d’appuyer sur un petit bouton pour déclencher l’enregistrement et pour deviner la réponse, d’ouvrir une montre à gousset, qui révèle un animal.

© C. L
Plus loin, des tablettes numériques offrent plusieurs jeux : des quizz concernant les animaux exposés, des petits puzzles, etc. Mon préféré consiste à trouver les différences entre un spécimen dans une vitrine et sa photo sur la tablette numérique. Simple mais très efficace.

© C. L
Les dispositifs interactifs, très ludiques, sont tout particulièrement adaptés aux enfants. Cependant, les adultes ne boudent pas les petits jeux proposés. Cette exposition est susceptible de toucher tous les publics.
J’ai aussi beaucoup aimé le côté décalé de l’exposition, par exemple avec les animaux “mal” naturalisés ou des petits messages inscrits çà et là qui apportent un peu de légèreté.
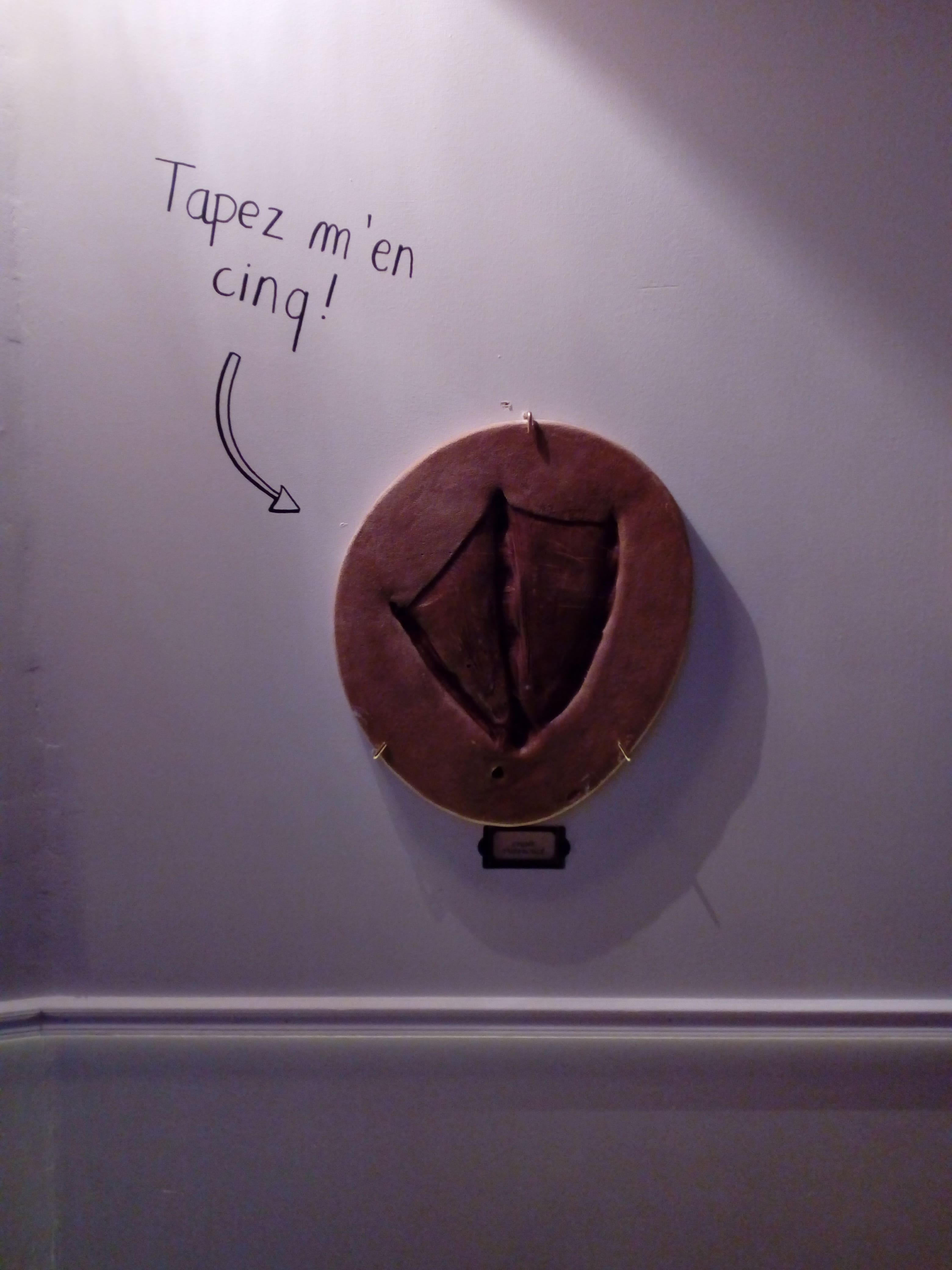
© C. L
Pour finir, la scénographie de l’exposition a su mettre en valeur l’espace d’exposition temporaire, notamment ses vitrines, très anciennes et très représentatives de l’architecture des Muséums classiques. Le musée a fait un choix ambitieux : allier l’existant avec les nouvelles technologies. La chouette naturalisée munie de lunettes 3D, qui sert de mascotte à l’exposition, symbolise bien cette association entre passé, présent et futur. Une sorte de retour vers le futur, en somme.
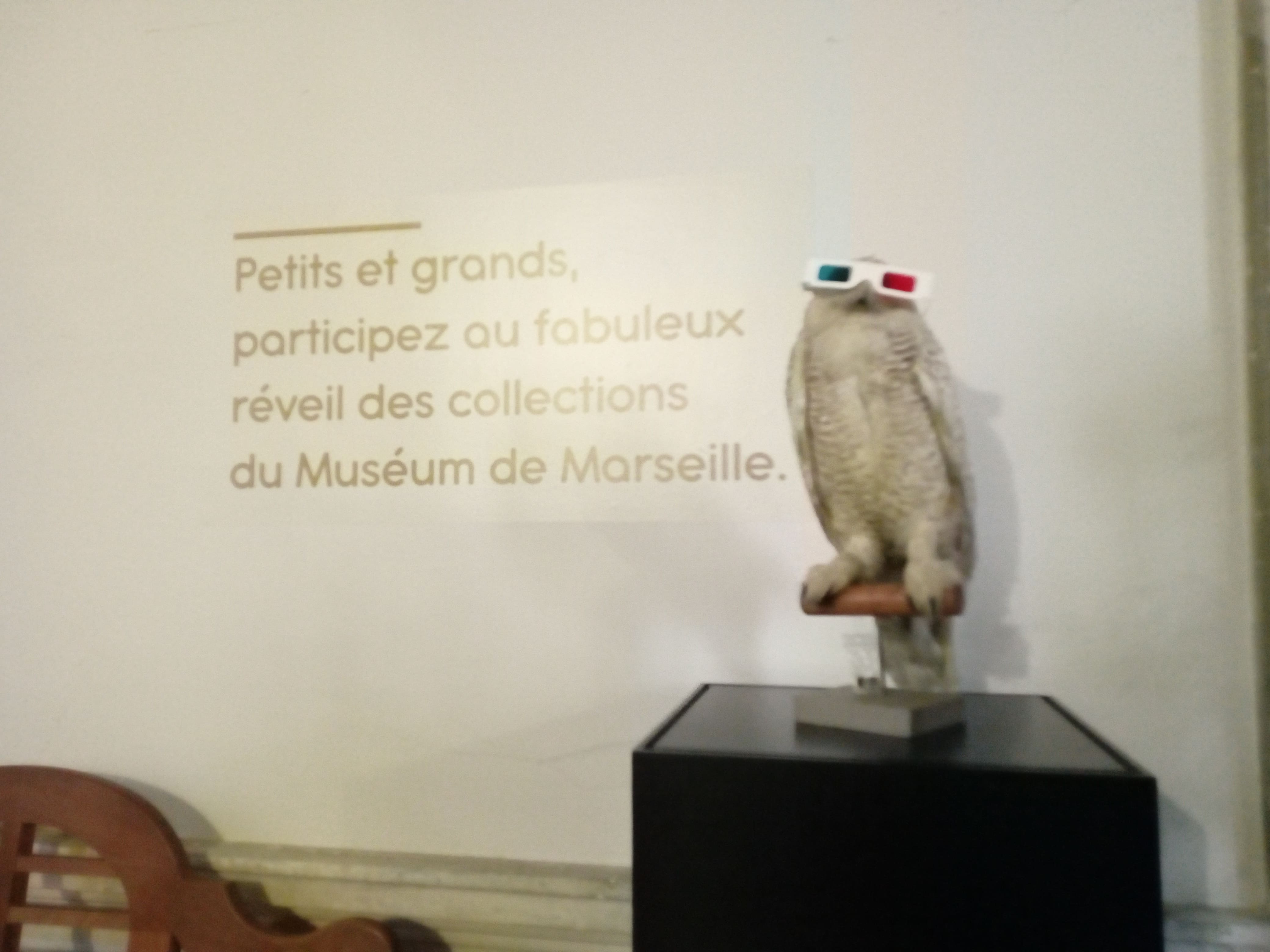
© C. L
Les nombreux messages positifs qu’on peut lire dans le livre d’or semblent indiquer que les visiteurs ont été, tout comme moi, séduits. Ils montrent que les publics ont été agréablement surpris par cette exposition qui sort du cadre muséal habituel, grâce à la dimension interactive et le ton léger du parcours : “Je me suis régalée. Et pourtant, les musées ça me saoul.” ou encore “D’habitude j’aime pas le musée mais là j’adore.”
Ces retours très positifs sur la forme de l’exposition conduisent à questionner le rôle des expositions et leurs supports de communication.
L’exposition Muséonérique s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, proposant une expérience sensorielle et ludique avec une vraie volonté de faire découvrir.
Pour voir l’exposition, direction le Muséum d’Histoire Naturelle au Palais Longchamp dans le 4e arrondissement de Marseille, avant le 24 février 2019
Clémence L.
#museum
#collections
#numerique
#expositiontemporaire
#marseille

N'ayez plus peur de la nuit !
Aventurez-vous au cœur de la Nuitau Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, jusqu'au 3 novembre 2014, pour y découvrir tous les secrets obscurs et magiques de ce moment particulier et de ce qui le menace.
©MNHN
Cette exposition mobilise plusieurs savoirs scientifiques de manière ludique : l'astronomie, la biologie, l'éthologie (étude du comportement des animaux), la physiologie (étude du rôle et du fonctionnement des organismes vivants), l’anthropologie (étude des relations entre l'homme et les animaux) et la neurologie. Elle associe sciences et imaginaire à travers les thèmes des divinités et des peurs nocturnes. C'est surtout l'occasion pour le musée de mettre en valeur ses collections : ainsi, c'est plus de 350 animaux naturalisés qui sont présentés, dont une cinquantaine ont été spécialement réalisés dans les ateliers de taxidermie du Muséum. Mais il s’agit aussi de sensibiliser le grand public aux problèmes liés à la pollution lumineuse…
Une nuit à la belle étoile
Vue de l'exposition ©Ludivine Perard
Depuis des siècles, le passage du jour à la nuit fascine l'Homme. De nombreux mythes évoquant ce spectacle nocturne sont présents dans l'exposition. Pour les Navajos, par exemple, les milliers d'étoiles dans le ciel étaient des galets que les animaux, à la demande du Grand Esprit, avaient placés dans le ciel lors de la création du monde. Le visiteur commence son voyage au clair de lune pour découvrir au fil de la visite tous les mystères du ciel : la course du soleil, les secrets de la lune et ceux des étoiles. Le visiteur endosse ainsi l'habit de l'astronome de retour chez lui, grâce aux différentes bases qu'il peut acquérir en astronomie dans cette première partie de l'exposition. Seule la pollution lumineuse qui efface les étoiles est encore susceptible de lui faire perdre son chemin dans le cosmos.
Une nuit dans la nature
Les animaux nocturnes ©MNHN
L'exposition se prolonge par une balade dans une forêt peuplée d'animaux nocturnes. De nombreux dispositifs, jeux et vidéos nous donnent des renseignements sur leur mode de vie. Un grand nombre de familles y sont représentées tels que les poissons de nuit, les primates nocturnes, les chauves-souris mais aussi les fleurs, avec des nombreuses plantes qui s'ouvrent le soir et se referment au petit matin. Des petits cabanons mettent en éveil tous les sens du visiteur - vue, ouïe, odorat et sixième sens - des dispositifs multimédias, sonores et olfactifs font vivre au visiteur la vie nocturne des animaux.
Le visiteur reçoit des informations sur la vue des animaux dans le noir et a la possibilité d'être nyctalope comme certains d'entre-eux. Puis, il écoute leurs chants, instrument essentiel pour percevoir leur environnement et découvrir la manière dont ils communiquent entre eux. Le visiteur sent ensuite l'odeur des fleurs et prend conscience des mille parfums que sentent les animaux nocturnes. Faute de voir, sentir est efficace dans le noir. Enfin, les animaux ont aussi un sixième sens pour les aider la nuit ! Certains oiseaux utilisent un sens de l'orientation aussi précis qu'une boussole, les chauves-souris lancent un sonar, ce qui leur permet de détecter les obstacles, de capturer leurs proies, de s'orienter ou de communiquer dans l'obscurité.
Belle et douce nuit
Vue de l'exposition©Ludivine Perard
Entre chien et loup, certains animaux sortent de leur habitat et partent en chasse tandis que d'autres plongent dans un sommeil profond. Les animaux vivant en groupe ont l'habitude de se rassembler le soir pour dormir ensemble et ainsi se protéger. D'autres à l'inverse, préfèrent dormir en équilibre comme les girafes, en volant comme les martinets, en nageant comme les cygnes ou dormir avec un demi-cerveau en veille pour être prêt à s'enfuir à la moindre alerte.
Le visiteur y apprend les différentes phases du sommeil dans le règne animal. Par exemple, le sommeil des oiseaux et des mammifères comprennent deux phases : le sommeil lent car l'activité du cerveau est lente, et le sommeil paradoxal où le cerveau est actif et rêve. Chez l'homme, un cycle dure environ 90 minutes pour 125 minutes chez l'éléphant alors que chez la souris 5 minutes seulement sont nécessaires pour achever ce cycle. Cette partie de l'exposition traite aussi du sommeil de l'homme et lui donne des conseils pour passer une bonne nuit. En effet, dormir est essentiel pour notre organisme, notre corps a besoin de se reposer, de se régénérer et d'éliminer toutes les toxines. A ce moment de l'exposition, les troubles qui perturbent le sommeil comme des cauchemars mettant en scène de personnages fantastiques sont présentés...
Dans la pénombre de la nuit
Une exposition peuplée de créatures imaginaires ©Ludivine Perard
Qui n'a jamais eu peur du croquemitaine dans son placard ou des vampires, chauves-souris, loups-garous et autres créatures effrayantes qui se cachent derrière chaque ombre ? De nombreux mythes se transmettent au fil des siècles, décrivant les monstres qui hantent nos songes et qui font peur aux plus petits. Ces peurs provoquent un sentiment d'insécurité et nourrissent l'imaginaire de l'Homme. L’exposition fait appel à l'humour pour dédramatiser ces peurs et montrer que ces montres sont inoffensifs. Un manuel de vampirologie et un grimoire sur les loups-garous accueillent les visiteurs et leur dévoilent l'origine et de nombreuses histoires sur ces deux mythes. Les visiteurs créent ensuite des ombres amusantes et jouent au loup-garou avec deux dispositifs de projections et de jeux d'ombres.
Menaces sur la nuit
Cette exposition met surtout en avant un phénomène qui la menace : les diverses pollutions lumineuses. Il en est même le fil conducteur afin d'alerter les visiteurs sur cette forme de pollution qui touche 20% du globe terrestre.
La pollution lumineuse ©Todd Carlson
Par peur des ténèbres, l’humain a voulu faire disparaître l'obscurité en inventant le réverbère au XVIIIèmesiècle et en installant des lampadaires un peu partout dans les villes et le long des routes, au péril du ciel. Cette quantité d'éclairage urbain a des conséquences atmosphériques. D'une part, une grande partie des étoiles ont disparu de la surface céleste. Si cet éclairage continue de gagner en intensité, nous ne verrons plusde ciel étoilé d'ici quelques années.
D'autre part, ce phénomène affecte l'horloge biologique des animaux, mais aussi des plantes, régulés par le cycle diurne / nocturne, ainsi que les comportements migratoires et les relations proies-prédateurs. De nombreuses espèces nocturnes sont alors perturbées, piégées ou repoussées par la puissance et la permanence des éclairages nocturnes. Les cassont nombreux : chouettes éblouies, oiseaux en perdition ou qui meurent en percutant des bâtiments, insectes attirés par la lumière et mourant d'épuisement... Ou alors ces lumières réduisent les territoires des animaux en les faisant fuir.
Heureusement, des solutions existent comme réduire le temps d'éclairage, diriger les lampadaires vers le sol et diminuer la puissance de la lumière. Un ciel plus sombre préserve à la fois le spectacle nocturne, la biodiversité et l'argent des citoyens.
Ludivine Perard
Pour en savoir plus :- Informations pratiques pour visiter l'exposition- Pour prolonger la visite : des jeux, des animations, des conférences....
#sciences
#imaginaire
#nuit

On refait la visite !
Samedi 4 Mars. Jour de pluie. Nous avons choisi de visiter le Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Lieu étrange baigné dans une atmosphère emprunte de nostalgie, sa visite fait naître chez nous bien des discussions.
© A. Erard et O. Caby
Océane [replie son parapluie et s’exclame] : Quel endroit sombre !
Anna[cherchant l’accueil du regard] : Alors, où se trouve l’accueil ?
Océane : Viens voir ! Cette vitrine est utilisée comme boutique ! Il y a deux livres et quelques cartes postales.
Anna : Ah oui … il n’y a pas grand-chose ! Bon, quel est le sens de visite ?
Océane : Il n’y a pas vraiment de sens de visite, on peut suivre l’ordre chronologique ? Je veux commencer par voir les dinosaures.
Anna : Ils sont imposants, tu crois qu’ils sont à l’échelle des dinosaures de l’époque ? C’est assez bien fait…
Océane : C’est dommage qu’ils soient mal éclairés.
Anna: Oui, mais ils sont représentés dans leur environnement, à l’époque carbonifère, ils ne se sont pas contentés de les poser juste là.
Océane : C’est vrai, il y a même une maquette montrant l’état des sols de cette période mais elle n’est pas très claire.
Anna [se dirigeant vers l’escalier] : Regarde ! Des fossiles, ils sont bien cachés, et ce n’est pas très lumineux. Cet espace n’est pas attrayant, nous sommes les seuls visiteurs à cet endroit-là.
Océane : Il y a quand même un jeu à côté des arbres carbonifères, il permet aux enfants de reconnaître des empreintes d’animaux et des fossiles de plantes. Tu vois le principe du jeu : Les faisceaux lumineux éclairent les animaux du décor, et l’enfant doit les associer avec les fossiles. C’est une sorte de QCM en trois dimensions.
Anna [montant les escaliers] : C’est incroyable, j’ai l’impression d’avoir fait un saut dans le temps, on se croirait dans un cabinet de curiosité du 18ème siècle !
Océane : Oui, avec cette accumulation d’objets on croirait vraiment avoir changé d’époque !
Anna : Encore des fossiles ! Les équipes du musée ont choisi de nous donner les explications de deux façons : des cartels ou bien des panneaux au mur.
© A. Erard et O. Caby
Océane : Oui, il y a des cartels qui sont récents et d’autres, ces petits-là [montrant des écriteaux jaunis autour d’une vitrine] sont clairement d’un autre âge.
Anna : Comme les fossiles !!
Océane : Le langage utilisé est complexe et je ne suis pas certaine que ces cartels apportent réellement des éléments de compréhension au visiteur.
Anna : D’autant plus que certains cartels sont déchirés, décollés, et d’autres ne sont associés à aucun contenu. Regarde ce cartel par exemple, il indique un jeu qui consiste à ouvrir des tiroirs pour découvrir des informations mais il n’est même pas possible de les ouvrir. Ce jeu nécessite vraiment une mise à jour… comme beaucoup d’autres éléments. Autrement, les informations sont intéressantes pour tous ceux qui veulent acquérir plus de connaissances scientifiques.
Océane : Le regard est attiré au premier abord vers le contenu des vitrines plus que vers les cartels explicatifs. Souvent, le visiteur ne les lit que lorsqu’il veut véritablement en apprendre plus sur les éléments exposés parce qu’ils l’intriguent.
Anna [continuant la visite] : Des aquariums ! Étonnant de tomber sur des poissons vivants juste après être passés devant des fossiles.
Océane : Ils illustrent le passage de la vie dans la mer à la vie sur terre. Les poissons sont les premières espèces à avoir évolué mais il existe encore des poissons préhistoriques dans les océans.
Anna : Je suppose que nous ne devrions pas être surprises de voir ces crânes conservés en vitrines, puisque nous nous trouvons à un mètre d’un squelette de baleine suspendu au-dessus de nos têtes …
Océane : Regarde : une des vitrines présente des crânes humains, c’est une reproduction de ce qui se faisait au XIXe siècle, à l’époque des théories raciales. Sur le cartel il est écrit : “Cette vitrine, ancienne (XIXème s), est conservée au titre de témoignage de théories idiotes, racistes et dangereuses qui ont pu avoir cours par le passé.” C’est très intéressant de montrer ça au visiteur !
© A. Erard et O. Caby
Anna : J’ai l’impression d’être dans le cabinet du professeur Rogue dans Harry Potter !
Océane : Justement, regarde ces bocaux là-bas !
Anna : Tiens-toi prête, j’espère que tu ne crains pas les bestioles conservées dans des bocaux !
Océane : Tout dépend du type d’animaux conservés dans le formol !
Anna [imitant un guide de visite] : Après les poissons en aquarium, vous trouverez sur votre droite de jolis exemplaires de poissons morts conservés dans du formol pour le bien des études scientifiques ! Mais ce n’est pas tout, étendez votre regard, et voyez donc ces spécimens de reptiles allant du lézard au serpent, de quoi faire de merveilleuses potions magiques !
Océane : Quelle plongée dans l’ambiance d’un cabinet d’étude ! Toutes les prochaines vitrines exposent des animaux empaillés en surnombre ! Redescendons voir ce qui reste à visiter au rez-de-chaussée.
Anna : Je perçois vaguement des insectariums, va voir, je crois qu’il y a des mygales ! Regarde celui-ci ! A ton avis, combien y-a-t-il de blattes ? Elles sont toutes les unes sur les autres.
Océane : Au moins ça fait le bonheur des enfants ! Regarde, ils sont tous fascinés par ces insectes !
Anna : Ce qui est sûr c’est que de voir des serpents ça ne fait pas mon bonheur…
Océane: Pourquoi le musée a-t-il fait le choix de montrer des animaux vivants à côté de leurs collections d’animaux empaillés ?
Anna : Pour montrer l’évolution de certains animaux ? Rendre le musée attractif ? S’adresser à un public large ?
Océane : Ce qui est intéressant c’est la vitrine dans laquelle la taxidermie est expliquée. Elle permet au visiteur de comprendre en quoi cela consistait et pourquoi était-elle si couramment utilisée au cours des siècles derniers.
Anna : Les reconstitutions d’habitats sont assez étonnantes. Voir ces animaux empaillés sous vitrine et surtout dans des positions improbables, ne rend pas vraiment compte de la réalité. Regarde ce lièvre, ils l’ont mis dans une posture qui laisse penser qu’à cette allure il risque de se cogner violemment contre la vitre.
© A. Erard et O. Caby
Océane : Au contraire, ces illustrations sont assez réalistes, mais ces scènes en arrêt sur image ont beau être probables elles paraissent étranges ainsi suspendues. Je pense que ces reconstitutions sont surtout adressées à un public plus jeune afin de montrer différents espaces naturels et les animaux qui les habitent.
Anna : Passons à la salle suivante !
Océane : … étrange, cette salle ne comprend que des vitrines remplies d’oiseaux empaillés !
Anna: Quel est l’intérêt de montrer autant d’espèces et où sont les cartels ? Il y a tellement d’oiseaux et d’informations visuelles que l’on passe très vite devant ces vitrines. Cela serait plus intéressant si certaines espèces avaient été mises en avant. Particulièrement des spécimens rares. Cela attirerait davantage notre regard et changerait le rythme de la visite.
Océane [passant à la dernière salle] : Cette dernière salle est vraiment plus épurée que les précédentes. Les animauxne sont plus sous vitrines ce qui crée une réelle proximité avec le visiteur. Les explications des cartels sont d’ailleurs plus claires.
Anna : Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un dauphin à côté de toutes ces espèces, c’est le seul animal aquatique de cette pièce et il est placé sur un socle au même titre que les autres.
Océane : C’est peut-être parce que tout le monde aime les dauphins ! Mais il n’y a pas véritablement de lien avec le reste des animaux représentés, bien qu’il soit positionné à côté d’une otarie.
Anna : La dernière vitrine crée un bel effet. Bien que les animaux ne fassent pas tous partie du même environnement, l’agencement et le décor rendent la reconstitution intéressante. L’espace est en hauteur, tous les animaux ne sont pas placés sur un même niveau. Nous sommes loin de l’impression d’empilement de la pièce ornithologique malgré le grand nombre d’espèces représentées.
Océane [se dirigeant vers la sortie] : En reprenant les codes d’exposition des siècles passés, le musée peut parfois être oppressant. Cela dit il nous permet de nous rendre compte de ce qu’était les premiers musées d’histoires naturelles ou cabinets de curiosité. Après ce type de visite il est facile de voir l’évolution muséale qui s’est appliquée dans ces structures mais sans doute ce musée va-t-il être modernisé ?
Anna : Effectivement il doit l’être, quitte à restreindre le nombre d’objets ou d’espèces présentées … Actualiser les cartels et les informations écrites permettrait de proposer une expérience de visite plus attractive. Les vitrines renfermant les animaux empaillés sont elles aussi à reconsidérer.
Océane : Cette visite étant réellement intéressante, j’ai l’impression d’avoir fait un voyage dans le temps !
Anna : Et puis c’est sympa de visiter un musée dont la boutique ne propose pas de peluches banales. Il est assez représentatif des anciens musées d’histoire naturelle avec ses vitrines d’époque.
Océane Caby & Anna Erard
#mhnlille#histoirenaturelle
Pour en savoir plus :
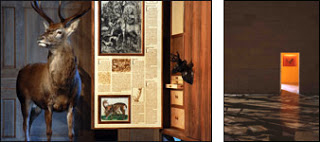
On y court, on y trotte, on y vole … !
Le quartier du Marais, dans les 3e et 4e arrondissements de Paris, ne se résume pas seulement en une succession de boutiques « bobos ». De nombreux musées de diverses natures s’y sont implantés : musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Cognaq Jay, Picasso, ou encore Carnavalet. Tous ont ce point commun d’être abrités dans de sublimes hôtels particuliers.
© D.R
Le musée de la Chasse et de la Nature
Au sein de cette forêt de bâtiments plus élégants les uns que les autres se cache le musée de la Chasse et de la Nature. Installé depuis la fin des années 60 dans l’hôtel Génégaud – classé Monument historique – mais également, plus récemment, dans une aile de l’hôtel Mongelas, ce lieu abrite de véritables trésors.
Présentant une des plus grandes collections européennes d’instruments de chasse, de trophées et d’animaux naturalisés, le musée ravira les amateurs et les passionnés de ce domaine.
Mais pas que. Un nombre considérable d’œuvres d’art anciennes et contemporaines y sont exposées : sculptures, peintures - Rubens, Chardin pour ne citer qu’eux -, céramiques, pièces de mobilier, installations - Jan Fabre, Othoniel entre autres – rendent hommage aussi bien au monde du chasseur qu'à celui de Dame Nature. Depuis le remaniement du parcours muséographique et d’importants travaux de rénovation dans les années 2000, nous pouvons affirmer haut et fort que ce lieu ne parle pas uniquement aux amoureux de la cynégétique. Bienau contraire, si nous devions le décrire en quelques mots : ludique – pour les grands comme les petits -, chaleureux – les agents de surveillance et d’accueil vous emportent dans leur engouement pour le musée – et fascinant.
A cheval entre maison de collectionneur et cabinet naturaliste, le musée de la Chasse et de la Nature offre à ses visiteurs quelques surprises. Mais pour cela, il vous faudra ouvrir l’œil et les nombreux tiroirs des meubles dédiés à un animal. En effet, c’est avant tout un musée consacré au répertoire animalier de la chasse où vous pourrez rencontrer le loup du Petit Chaperon Rouge ; Victor, l’impressionnant ours blanc ; Diane, la déesse de la chasse et de la lune ; ou encore le sanglier albinos de l’artiste Nicolas Darrot. Le visiteur navigue alors entre conte et réalité.
Deplus, un ensemble d’expositions temporaires sont organisées tout au long de l’année. Claude d’Anthenaise, directeur du musée, invite les artistes actuels à jouer de l’architecture et des œuvres qui définissent ce lieu autour de la notion de nature – sensiblement de la même manière que pour l’exposition "Bêtes off" à la Conciergerie qui a eu lieu en novembre 2011.
On ycourt, on y trotte, on y vole… !
Marie Tresvaux du Fraval
Muséede la Chasse et de la NatureHôtel de Mongelas - 62, rue desArchives - 75003 Paris

Photos hautes en couleur ! Regard d’un géant sur un monde microscopique.
Le Musée d’histoire naturelle de Lille propose une exposition temporaire de photographies totalement psychédéliques. Depuis le 20 février et jusqu’au 20 mai 2012, la salle qui suit celle consacrée aux mammifères est investie de photographies d’insectes et de plantes géantes signées Gilles Martin.
© Gilles Martin Sauterelle de Costa Rica, exposition Zoom au Musée d’histoire naturelle de Lille
Ce photographe naturaliste excelle dans son domaine en capturant les animaux de toutes espèces, des plus grandes aux infiniment petites. Le portique passé, c’est une explosion de couleurs, de textures et de formes qu’il est rare de croiser dans nos villes et même dans nos campagnes, qui nous envahissent. En se concentrant sur le contenu, ces formes semblent nous présenter les dernières découvertes zoologiques voir même ufologiques. Puis, en se penchant sur les loupes-lampes qui accompagnent chacune de ces photographies, on reconnait grâce à la précision de la taille réelle de ces espèces colorées et si singulières, que ce sont des insectes ! Il ne s’agit donc pas de nouvelles espèces mais bien d’un zoom, comme le titre de l’exposition l’indique, sur ces chères petites bêtes qui nous entourent et qui passent encore trop inaperçues du fait de leur taille minuscule. Le format des images, qui est de 120x180cm pour chacune des photographies, permet aux visiteurs de faire la connaissance d’un monde, de sa faune et de sa flore, encore bien souvent considérés comme répugnants et sans intérêt. Cette exposition de photographies révèle la beauté de ces petits êtres et nous rappelle leur réalité grâce à ces loupes-lampes en les replaçant dans leur état de vulnérabilité due à leur petitesse.
© Gilles MartinLoupe-lampe Exposition Zoom
© Gilles Martin Exposition Zoom
Cette exposition se veut également pédagogique, car au centre de cette salle se trouvent installés des microscopes et des loupes qui nous permettent d’observer des acariens par exemple. Une autre salle, celle-ci accessible uniquement en présence d’un animateur, est également consacrée à l’initiation d’observations aux microscopes ou encore à la loupe binoculaire. L’apprenti biologiste y trouvera son compte !
Les observations que l’on peut effectuer dans la salle d’exposition temporaire sont guidées par des cartels directifs qui posent des énigmes sur les êtres observés au microscope. S’il n’est pas possible d’effectuer un grossissement par soi-même, on est au moins mis dans la posture du chercheur penché sur son microscope, les yeux perdus dans l’infiniment petit, pour ensuite constater grâce à ces cartels fixés à côté des outils d’observation, le résultat de celle-ci.
Cette imbrication de l’observatoire scientifique et de la vision de l’artiste est tout à fait pertinente. L’œil du scientifique décortique un monde magnifique qu’il peine à mettre en lumière, à ce que nous appellerons le « grand public ». L’artiste apporte une vision accompagnatrice de cette pratique du zoom en révélant en taille surdimensionnée les objets d’étude. S’il ne révèle pas la complexité de leur fonctionnement, Gilles Martin met en lumière l’infiniment petit dans le but de faire prendre conscience au public de l’existence de ce microsystème et de l’intérêt qu’il peut susciter pour les chercheurs mais aussi pour les néophytes au sortir de cette exposition ! La manipulation initie les plus jeunes, tout comme les plus grands, à la discipline de la zoologie. Ces manipulations placées au centre d’une série de photographies qui sortent de l’ordinaire, plonge les visiteurs dans un univers insoupçonné.
Pour aller encore plus loin dans l’initiation à l’observation du vivant, les concepteurs de l’exposition ont imaginé un concours qui permettra aux gagnants de remporter l’ouvrage Macrophotographie de Gilles Martin. Il s’agit de retrouver des détails de la collection permanente dans le musée.
Zoomdévoile le monde de la macrophotographie et en même temps de l’entomologie. Cette immersion dans l'infiniment petit surligné par des photographies géantes provoque surprise, étonnement, contemplation, prise de conscience et connaissance. L’œuvre de Martin Gilles est extraordinaire par sa beauté envoutante et surprenante, et mérite véritablement le détour.
Katia Fournier

PLUS de Mémoire(s) !
Savez-vous qu’avoir une mémoire de poisson rouge est en réalité loin d’être offensant ? C’est ce que l’exposition Mémoire(s) tend à démontrer. En effet, la mémoire du cyprin doré ne se limite pas à la durée d’un tour de bocal, bien au contraire, il la conserve pendant plusieurs années !

©C. Cardot
Pour aborder une thématique si dense, l’exposition explore plusieurs types de mémoires, au sein desquelles le visiteur peut découvrir de multiples expérimentations et jeux testant sa propre capacité à mémoriser les multiples facettes de sa mémoire.
La mémoire est un domaine scientifique complexe et en permanente évolution, et c’est à cette thématique passionnante que le Palais de l’Univers et des Sciences a voulu dédier ses 300m2 d’exposition temporaire. Réalisée par une association de création artistique professionnelle, Art’M, elle a bénéficié de l’attention de multiples chercheurs travaillant dans différents domaines de la mémoire, rattachés aux grands organismes scientifiques nationaux (Universités, INSERM, CNRS, CEA).
L’exposition débute avec la « ronde des mémoires », qui reprend les différentes typologies de la mémoire humaine : mémoire procédurale, perceptive, de travail, épisodique, et sémantique. Vous souvenez-vous du nom des trois laboratoires de recherche cités précédemment ? Et bien, la mémoire à court terme, c’est exactement ça ! Ce qui se nomme « l’empan mnésique » limite la mémorisation des informations récentes à sept items.
Ex : lumière – cimaise – parcours – discours - expôt – régie – réserves – muséographe – médiation – œuvre –conservation – art – visiteur – public – multimédia – accessibilité
Observez les mots pendant 20 secondes, fermez les yeux. Combien en avez-vous mémorisés ?
Avez-vous encore oublié le code confidentiel de votre carte bancaire ? Rassurez-vous, c’est normal ! Chaque jour, l’automatisme de notre cerveau se déleste des informations inutiles, « parasites » ou purement encombrantes. Dûs à des états de stress ou de fatigue, ces oublis sont communs à l’être humain. Pour contrer ces manques, le fameux moyen « mnémotechnique » est là pour vous aider.
Ex :« Mais où est donc Ornicar ? »
Vous souvenez-vous à quoi fait référence cette interrogation ?

© P. Wittmann
Vous ne le saviez peut-être pas, mais au cœur de votre cerveau se cache une forêt de neurones (joli, n’est-ce-pas ?). De la même manière qu’on entretient ses muscles, le cerveau a aussi besoin d’un peu d’exercice, et n’aime pas la routine. Afin de densifier cet organe si précieux, sachez qu’il existe de nombreux entrainements à appliquer au quotidien :
- Se brossez les dents avec la main gauche si vous êtes droitier, ou inversement
- S’habillez les yeux fermés
- Choisir un parcours différent pour vos trajets quotidiens
La mémoire n’est pas un attribut spécifique à l’humain, elle se retrouve dans tout le vivant. Ce n’est pas parce que l’Homme est doté de réflexion qu’il dispose d’une mémoire plus développée que l’animal, et parfois c’est même le contraire. La « mémoire d’éléphant » le prouve bien : au même titre que les dauphins et les singes, ce mammifère qui parcourt de grandes étendues afin de se nourrir doit développer sa mémoire visuelle. Aussi, il reconnaitra votre visage si vous le recroisez dix ans plus tard dans la savane...
Pouvez-vous vous remémorer approximativement ce que vous faisiez il y a dix ans ?
Avec quel outil informatique lisez-vous actuellement cet article ? Et bien, sachez que loin d’être volatiles, les informations numériques se cachent derrière de multiples serveurs et disques durs. Ces outils ont aujourd’hui tendance à prolonger, et parfois même à se substituer à notre mémoire sémantique, celle qui enregistre les connaissances encyclopédiques. Au risque de diminuer notre gymnastique cérébrale. Voyons plutôt :

© C. Cardot
Pouvez-vous citer (sans utiliser d’outils technologiques):
- Le numéro de téléphone de vos parents ?
- La date d’anniversaire de votre grand-mère ?
- La date du sacre de Napoléon 1er
RÉSULTATS
3 oublis et + : vous faites quoi dimanche prochain ?
2 oublis : pas terrible, il falloir y remédier !
1 oubli : votre bonne mémoire ne vous dispense pas de venir voir l’exposition !
Aucun trou de mémoire : bravo, mais vous devriez quand même aller y faire un tour…
L’exposition est visible au Palais de l’Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande (Dunkerque), jusque décembre 2014.
En direct du PLUS, Capucine Cardot & Pauline Wittmann
#PLUS
#Mémoire
#Art’M
Pour aller PLUS loin :

Quelle signalétique pour le musée ?
Quand je rentre dans un musée, j’observe la cohérence et la position de la signalétique, afin d’instantanément visualiser mon parcours de visite. Pourtant au fil de mes nombreuses visites muséales je me suis perdue plus d’une fois et/ou ai été frustrée d’avoir raté une section de l’exposition. Je me suis donc penchée sur cet élément graphique indispensable, qui se doit d’être à la fois discret mais suffisamment visible pour être efficace.
Un système de signes à part entière
La signalétique se définit comme un système de signes identifiés dans un espace précis, présentant des repères scriptovisuels (langage qui présente à la fois des mots et des images) permettant un double niveau d’interprétation d’informations synthétisées. Pour résumer, la signalétique permet de faire passer un maximum d’informations à l’aide d’un minimum de signes1. Ces derniers prennent la forme de mots, de couleurs, de formes graphiques, composant un ensemble d’éléments visuels, qui, pour permettre une bonne compréhension, sont étroitement liés entre eux.
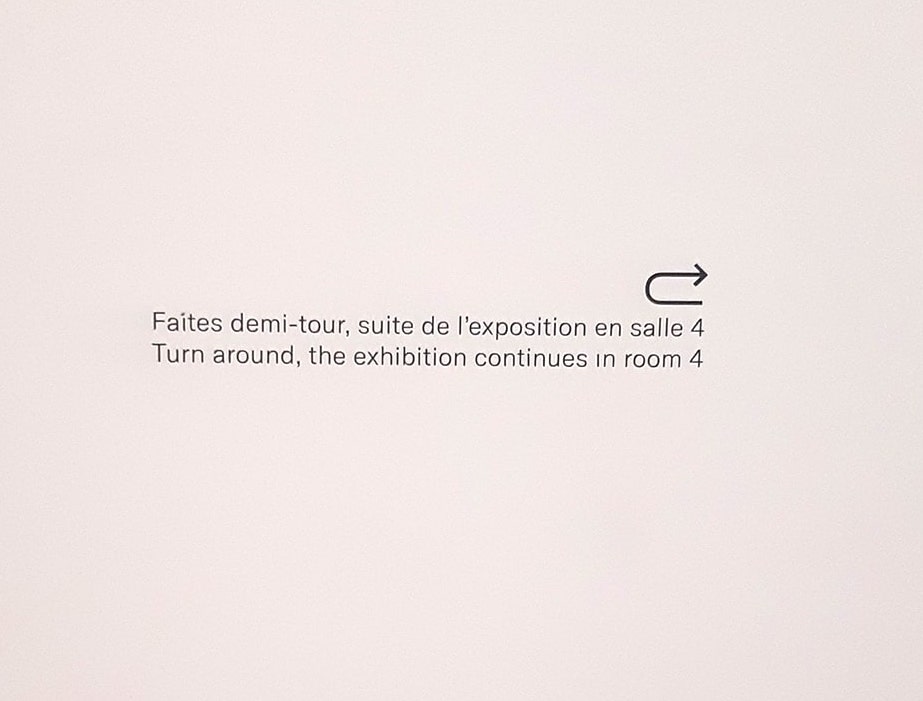
Exemple de signalétique directionnelle : Musée Picasso - Paris © Tiffany Corrieri

Exemple de signalétique directionnelle : Palais des Beaux-Arts de Lille - Lille © Tiffany Corrieri
Le champ de la signalétique est large et se retrouve partout. Pour autant il diffère d’un lieu à un autre ; la signalétique urbaine et routière ne remplit pas les mêmes fonctions et usages qu’une signalétique patrimoniale. En effet le musée s’identifie comme un espace chargé de sens, propre à une période historique, à un artiste ou une collection dont il est nécessaire de connaître les codes pour l'apprécier, et dans lequel le visiteur se retrouve suite à une intention, un projet, qui est décidé sur son temps libre et dont l’exploitation des connaissances peut-être nul par la suite. Cette signalétique accompagne, structure et prend en charge les déplacements des visiteurs dans l’organisation des parcours de visite, tout en assurant leur sécurité. C’est pourquoi il est important que ces derniers identifient distinctement ce qui est de l’ordre des services et de la circulation et ce qui touche à la visite et aux contenus.
Ainsi il existe plusieurs types de signalétique qui répondent chacune à un besoin spécifique.
La signalétique directionnelle pour diriger le visiteur
Également appelée signalétique orientationnelle, elle aide le visiteur à se repérer et à se diriger dans un parcours et un environnement précis, et ce sans difficultés. Elle illustre ce trajet par un balisage composé de repères facilement repérables mais suffisamment discrets pour ne pas jouer sur le confort et la qualité de visite. La signalétique directionnelle permet ainsi de rassurer le public dans son parcours, et « [..] d’éviter la frustration ou la peur de mal faire qui sont latentes chez beaucoup de visiteurs de bonne volonté2 » qui vont, d’après les études de S.Bitgood, très rarement retourner sur leurs pas après avoir emprunté un mauvais chemin.
Pour que cette signalétique soit efficace, il est nécessaire de mesurer la densité et l’emplacement des repères signalétiques, qui se doivent d’être déchiffrés de loin. Il faut donc trouver un juste milieu entre le trop de signes qui perd en efficacité et peut être confondu avec des informations secondaires, et le pas assez qui rompt le parcours du visiteur et le décourage.
Répondant à une orientation universelle, la signalétique directionnelle est aussi réfléchie en terme d’accessibilité, avec par exemple des bandes podotactiles qui permettent aux visiteurs malvoyants de se repérer au sol en les guidant vers les panneaux et œuvres accessibles, et en facilitant le passage d’une pièce à une autre.
La signalétique conceptuelle pour anticiper la visite
Elle prend la forme d'une anticipation, d’une visualisation du parcours de visite de la part du visiteur. Étant donné que ce dernier a un projet et un temps déjà réfléchi en amont lors de son arrivée dans un environnement muséal ou patrimonial, la signalétique conceptuelle lui permet de vérifier la pertinence de ses choix et/ou de les moduler par la suite, en fonction de l’offre proposée.
Les dispositifs de signalétiques conceptuelles les plus communs prennent la forme de cartes, plans, maquettes, listes ou menus qui apportent une vue d'ensemble, et schématisent les espaces à explorer en permettant de repérer les offres dites «vedettes» dans l’ensemble de la structure. Ainsi l’espace est plus facilement mémorisable et appréhendé, notamment quand des éléments concrets, facilement identifiables et favorisant l’interprétation d’éléments plus abstraits et symboliques, sont mis en avant, tel que la reproduction d’un chef-d'œuvre.
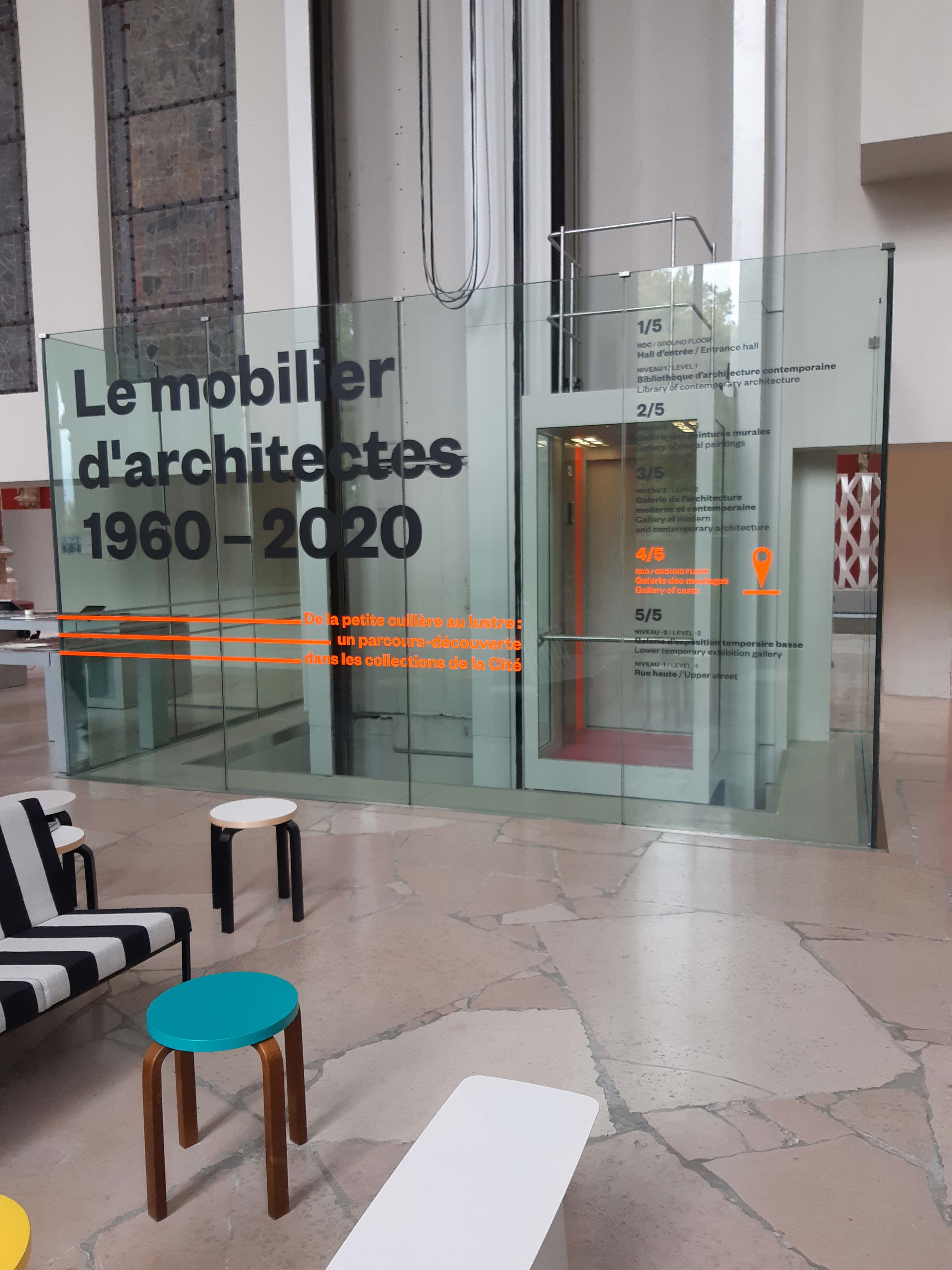
Exemple de signalétique conceptuelle mettant en avant le plan de l’exposition Le mobilier d’architectes 1960-2020 à la Cité de l’architecture et du patrimoine - Paris © Tiffany Corrieri
Que ce soit au sein d’une signalétique directionnelle ou conceptuelle, les pictogrammes et signes sont prépondérants car ils constituent un langage universel. Toutefois, ils répondent à des normes de compréhension auxquelles il est nécessaire de réfléchir. À l’instar du graphisme du pictogramme qui doit être suffisamment clair et monosémique (avoir un seul sens) afin d’être compris sans effort de réflexion, ou du regroupement d’informations en un même espace pour une meilleure lisibilité et visibilité. Enfin la typographie est également un domaine qu’il est important de réfléchir, notamment au travers de la taille et du style des caractères qui doivent être lisibles à bonne distance.
S’accorder avec l’identité du lieu
C’est dans les années 80 que l’intérêt porté à la signalétique apparaît dans le monde muséal. On s’intéresse au nouveau lien musée-visiteur et à la réception du patrimoine, tout en inscrivant ce système de signes dans le champ d’expression du graphisme. Ce domaine ne se présente plus seulement comme une fonctionnalité mais aussi comme un moyen d'expression, notamment dans les années 2000.
La signalétique devient donc un terrain de jeu pour le graphisme se devant d’être en cohérence avec l’esprit du lieu et son identité, afin d’être à la fois lisible et visible par le visiteur, tout en étant discrète. La signalétique de l’institution peut aussi influencer l’espace public ou l’ensemble du bâtiment afin de mettre en avant l’identité de ces derniers. La signalétique urbaine de la ville de Metz, qui, après l’implantation du Centre Pompidou Metz, reprend le design graphique du Musée, ainsi que la Bibliothèque Malraux à Strasbourg, illustrent bien cette influence.

Identité graphique de la Bibliothèque Malraux, réalisée par l’agence Intégral Ruedi Baur, qui reprend le graphisme de la signalétique intérieure - Strasbourg ©Tiffany Corrieri
Néanmoins l’évolution de l’identité muséale, de la société et du bâtiment, qui demande à la signalétique de s’adapter, d’être modulable, n’est pas aisée car elle implique des budgets importants.
Comme le présente l’ouvrage Graphisme en France (2013), bien qu’identifiée comme un «dispositif d’accessibilité universelle, chaque signalétique est confrontée à l'impossibilité de prendre en considération l’ensemble des usagers et de leur particularités cognitives, motrices ou culturelles.». Et ce malgré l’essor de considération du public au cœur des préoccupations des institutions et la nécessité de prendre en compte différents handicaps, qui a été mis en avant par la loi handicap de 2005.
Analyser le bâtiment et les flux
La mise en place d’une signalétique est loin d’être anodine, c’est un projet réfléchi et anticipé. Si cette dernière prend place au sein d’un projet de bâtiment, alors l’appel d’offre s’intègre à celui des architectes. Sinon les flux des visiteurs sont analysés dans un premier temps, puis anticipés au travers de projections, pour permettre la meilleure circulation possible au public.
Néanmoins, bien qu’il soit indispensable que cette signalétique soit envisagée en amont, il arrive encore souvent qu’elle ne soit pensée qu’une fois le bâtiment quasiment fini, ou à la fin, par le graphiste qui est sollicité tardivement.
Par ailleurs, la signalétique est confrontée aux problèmes de temps. La graphiste Eva Kubinyi, dans Graphisme en France (2013), précise «que même pérenne [la signalétique] a une durée de vie comptée». En effet, elle dépend des politiques des décisionnaires, de la fonctionnalité du lieu étant donné que les flux et usages changent avec le temps, et de la pérennité des matériaux qui sont plus ou moins durables. Il est donc important pour le graphiste de prendre en compte ces différents points, et c’est pourquoi il s’associe souvent à un designer qui va le conseiller.
Ainsi, donner les clés de visite au visiteur pour que celui-ci détienne une expérience muséale agréable et complète, en proposant une orientation rassurante et optimale, permet d’éviter la frustration et la perte d’attention de chacun.
1 La signalétique sur le lieu d'accueil : Être lu sans être vu, Gilles Février dans Culture et musées, 1994. Disponible sur : https://www.persee.fr/docAsPDF/pumus_1164-5385_1994_num_4_1_1257.pdf
2 Du panneau à la signalétique : lecture et médiations réciproques dans les musées, Daniel Jacobi et Yves Jeanneret dans Culture et musées : la muséologie 20 ans de recherches, 2013. Disponible sur : https://journals.openedition.org/culturemusees/708#tocto1n2
3 Expositions et parcours de visites accessibles, Ministère de la Culture et de la Communication
Pour en savoir plus :
Expositions et parcours de visite, du Ministère de la Culture et de la Communication
L’ouvrage Graphisme en France 2013 : La signalétique, points de vues des graphistes, du CNAP est téléchargeable en ligne
Du panneau à la signalétique : lecture et médiations réciproques dans les musées, Daniel Jacobi et Yves Jeanneret
La signalétique sur le lieu d’accueil : Être lu sans être vu, Gilles Février dans Culture & Musées
La signalétique patrimoniale. Principes et mise en oeuvre, Daniel Jacobi et Maryline Le Roy, compte-rendu de Caroline Buffoni dans Culture & Musées
Problems in Visitor Orientation and Circulation, Stephen Bitgood
La signalétique, entre fonction et expression, L’hebdo du Quotidien de l’Art, octobre 2020
Ruedi Baur, fondateur de l’agence Intégral Ruedi Baur, designer qui a créé de nombreuses signalétiques à l’instar de celle du Centre Pompidou Paris et celle de la ville de Metz après l’implantation du Centre Pompidou Metz
#signaletique #graphisme #reflexion
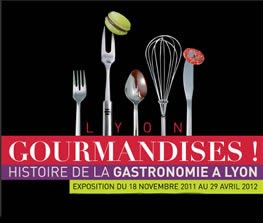
Quenelles, grattons, bugnes et autres spécialités des bouchons à l’honneur !
À l’heure où le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et où la ville de Lyon serait candidate pour accueillir la future cité de la gastronomie française, le Musée Gadagne présente pendant plus de cinq mois une exposition consacrée à la gastronomie lyonnaise.
Intitulée Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon, l’exposition se divise en trois sections : Lyon capitale de la gastronomie : construction d’une légende, les années glorieuses et modernité et nouvelles tendances de la gastronomie lyonnaise. Un parcours chronologique qui permet une approche historique simple et méthodique pour les Lyonnais comme pour les « étrangers » qui ne sont pas spécialistes. Au fil de l’exposition, le visiteur découvre témoignages littéraires, photographies, recettes, affiches, vidéos présentant ou prenant parti pour la cuisine rhônaise. Mis à l’honneur, le patrimoine culinaire de Lyon est célébré, honoré voire glorifié. La guide de l’exposition insiste particulièrement sur les comparaisons faites entre Lyon et les autres villes, terminant ses phrases par un trait chauvinisme non masqué. Certes, si une telle exposition est présentée au Musée d’histoire de Lyon, le Musée Gadagne, un point de vue « patriote » était inévitable… Pourtant peu ancré dans les dispositifs écrits de la muséographie, il a tout de même troublé ma visite par cette guide insistante et son groupe qui semblait me poursuivre dans les salles.
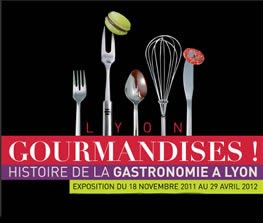
© Musée Gadagne
Mention spéciale pour la scénographie : l’espace d’exposition pas très grand est bien mis en valeur. Deux petites salles nous emmènent dans une cuisine, peinte en vert pomme, qui regorge de meubles (de cuisine bien sûr !) où tiroirs et autres placards deviennent des dispositifs de médiation. Le spectateur, piqué dans sa curiosité, se retrouve comme un enfant dans un terrain de jeu… ouvrant les buffets pour découvrir leurs trésors. La présence de ces outils est une très bonne initiative : les expôts étant principalement des documents écrits et visuellement peu attractifs (lettres, journaux, conseils culinaires, anciennes recettes…), le public n’y jette qu’un bref coup d’œil. Devoir ouvrir un casier et découvrir ce qui s’y cache, capte beaucoup plus l’attention du visiteur, adulte ou enfant.
Nous laissons, ensuite, derrière nous cette cuisine familiale pour nous retrouver dans une ambiance de restaurant… un peu chamboulée ! Ici, les tables se retrouvent sur les murs et les « dessous de bar » servent de cuisine ! En effet, en entrant le visiteur aperçoit sur le mur de droite, les nappes traditionnelles quadrillées de rouge et blanc typiques des « bouchons » (restaurant populaire lyonnais) ; et sur sa gauche, les nappes blanches qui rappellent un autre standing. Le bar du centre sert à la fois de lieu de repos, en nous transportant dans un environnement connu (les discussions s’engagent sans effort, on se retrouve au bistrot du coin…), et de dispositif de médiation pour les enfants qui préparent des plats faits de laine et tissu pour nous les présenter sous la cloche transparente du bar. De nombreux jeux permettent également de découvrir le « parler culinaire lyonnais », les odeurs typiques des mets ou encore leur composition.
D’autres initiatives sont à noter… Durant le temps de l’exposition, les Lyonnais (mais aussi les touristes qui s’initient au plaisir de la gastronomie lyonnaise) sont invités à envoyer témoignages, photos et/ou vidéos qui sont présentés à l’entrée. À la fin, les visiteurs trouveront une nouvelle cuisine scénographiée, plus petite et plus spartiate (celle d’un petit appartement lyonnais ?) où des livres sont proposés à la lecture.
Je regretterai, pour ma part, l’absence de dégustation à la fin de la visite… Entendre parler de cuisine pendant une heure donne envie de se mettre quelque chose sous la dent ! Cependant, c’est que je ne suis pas tombée au bon moment car en regardant le catalogue et le programme de l’exposition, on découvre les différentes propositions. Des rencontres gustatives aux « déjeuners-barvardage » en passant par les conférences ou les balades culinaires dans Lyon, le goût est bien présent dans cette manifestation autant que la vue ou l’odorat. Et pour les gens qui, comme moi, ne peuvent juste voir l’exposition, en sortant de musée le Vieux Lyon s’offre à nous avec toutes ses spécialités gastronomiques.
Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon,
Musée Gadagne, le musée d’histoire de Lyon,
du 18 novembre 2011 au 29 avril 2012.

Qui suis-je ? La question de l'identité d'un musée sous l'angle de sa dénomination : le cas de la Maison du Textile (Fresnoy-le-Grand)
Dansun contexte où l'on cherche à faire de l'espace muséal un lieu désacralisé et facilement abordable par tous, le terme de « musée » peut être considéré comme étant trop lourd de signification. Certaines institutions muséales choisissent alors de le bannir, auprofit de termes moins effrayants, tels que « espace » , « cité », ou encore « maison ». C'est le caspar exemple de la Maison du Textile, baptisée ainsi dès son origine. Mais cette volonté d'éviter l'emploi du mot « musée » ne nuit-elle pas à la lisibilité identitaire de l'institution ?
La Maison duTextile : musée vivant de la tradition textile en Vermandois
Créée à l'initiative de l'association « Tisserand de Légende », la Maison du Textile a ouvert en 2003 alors que l'atelier était toujours en fonctionnement. Dans la perspective d'un éco-musée, il s'agissait avant tout de montrer au public le travail des artisans sur les mécaniques à bras Jacquard. Deux ans plus tard, l'entreprise textile ferme et le musée lui survit : l'histoire des établissements « La Filandière » nous est retracée par la présentation de 28 ateliers à tisser Jacquard – tous fonctionnels –, de la reconstitution d'une maison de tisserand et d'un jardin de plantes tinctoriales.
De par sa présentation sur le site internet de l'Office de tourisme du Vermandois, ou bien la signalétique qui indique son emplacement, la vocation muséale du lieu est tout à fait avérée. D'où une certaine surprise en y pénétrant.
©N.V.
« Oui ? Vous venez pour quoi ? »
Une fois le seuil de la porte franchi, la personne de l'accueil interroge le « visiteur » sur la raison de sa venue : ce lieu abriterait-il une autre activité que celle du musée ? L'entrée se fait effectivement par un espace boutique relativement bien fourni (linge de table, vaisselle, accessoires brodés, tapisseries, jeux pour les enfants, quelques produits régionaux...). La distinction est donc très mince entre le client de la boutique et le visiteur du musée. Certaines personnes viennent uniquement faire des achats, sans même connaître l'existence de la partie muséale. Si la présence d'un espace marchand est susceptible d'attirer du public, et par extension de faire connaître le musée (la responsable de l'accueil les encourage vivement à venir le visiter), la motivation première du visiteur pose la questionde l'identité du musée, et de sa lisibilité auprès du public.
©M.S.
Il existe donc très nettement un clivage entre la façon dont l'institution elle-même se présente (comme un musée), et la vision qu'en ont certains de ses « clients » (boutique). Cette dernière est peu mise en avant sur le site internet de la Maison du Textile. Elle apparaît uniquement dans la rubrique « service », en tant que « boutique souvenirs en accès libre ». En revanche, sa vocation marchande constitue l'un des points d'appui de la communication du musée : outre la présence de nombreux ateliers créatifs relayés sur les réseaux sociaux, la Maison du Textile accueille également des animations commerciales. Si est vrai que ce genre d'événement est susceptible de faire vivre en quelque sorte le lieu et de lui amener un public potentiel, celui-ci n'est pas forcément intéressé par l'activité textile en elle-même.
© Maisondu Textile
Nul doute que cette dichotomie entre les deux vocations du lieu entraîne un flou identitaire pour l'institution muséale. Et l'utilisation du terme « maison » renforce encore cette imprécision.
D'où l'importance de la terminologie dans la construction de l'identité d'un musée
Même si le terme « musée » est présent dans le sous-titre (« musée de la tradition textile en Vermandois »), le mot « Maison » lui pré-existe dans sa dénomination. Ce terme est parfois utilisé par certains musées, dont le cas le plus fréquent est celui des maisons d'artistes, telles que la Maison Victor Hugo Paris – Guernesey, ou la Maison de Balzac (Paris). Il s'agit alors de muséaliser l'ancienne demeure d'une personnalité connue. Quoi qu'il en soit, il arrive que des éco-musées choisissent également cette terminologie, comme par exemple la Maison du blé et du pain de Verdun-le-Doubs, ou bien la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes.
Toutefois, la thématique de ces deux musées rend relativement lisible leur vocation... ce qui n'est pas le cas pour la Maison du Textile. Le mot « textile » peut effectivement avoir une connotation plus esthétique : son nom ressemble étrangement à celui d'une enseigne de magasin de décoration (Maison du Monde), ou à celui d'un lieu de création (comme les Maisons de Mode de Lille et de Roubaix, qui ont pour objectif d'encourager la création textile par exemple). Aucune dimension créatrice à proprement parler pour ce qui est de la la Maison du Textile : une partie objets de la boutique provient plutôt des métiers à mécanique Jacquard de Roubaix.
Le terme de « musée » peut donc être capital dans la construction de l'identité d'un lieu culturel. Le contourner par d'autres dénominations ne fait que rendre plus floue sa vocation muséale. Ne vaudrait-il pas mieux que les professionnels du secteur continuent leur travail de démocratisation culturelle, et permettent d'avoir une image moins intimidante et plus sympathique du musée ? Toutefois, il est vrai que le caractère plus large du mot « maison » permet de désigner les différentes composantes d'un lieu hybride, qui propose un ensemble de prestations variées... au risque donc de perdre la lisibilité de l'institution...
Ou de la redéfinir ? L'idée de musée renvoie effectivement à une volonté de conserver le patrimoine. Est-ce à dire qu'en muséalisant un métier, celui-ci est désormais considéré comme appartenantdéfinitivement au monde du passé ? Certains choix de dénomination sont effectivement portés par des convictions : éluder le terme de musée, est-ce lutter contre l'obsolescence de l'activité textile ?
Noémie V.
#identité #maison du textile

Ranger mais pas trop, zoom sur le Vaisseau
Le jour de la réouverture, le 19 mai dernier, après des mois sans voir de visiteur.euses, l’heure était à la fête. Nous venions tout juste de terminer un nouvel espace d’exposition permanente : La Pépinière. C’est un espace d’exposition permanente où les enfants de 3 à 6 ans peuvent explorer le tinkering – qui signifie littéralement la bricole, faire quelque chose avec ses mains –, viennent bidouiller et semer les graines de la créativité en composant des réactions en chaîne et en inventant des circuits de billes. Cette parcelle haute en couleur s’incarne comme un prolongement du jardin.
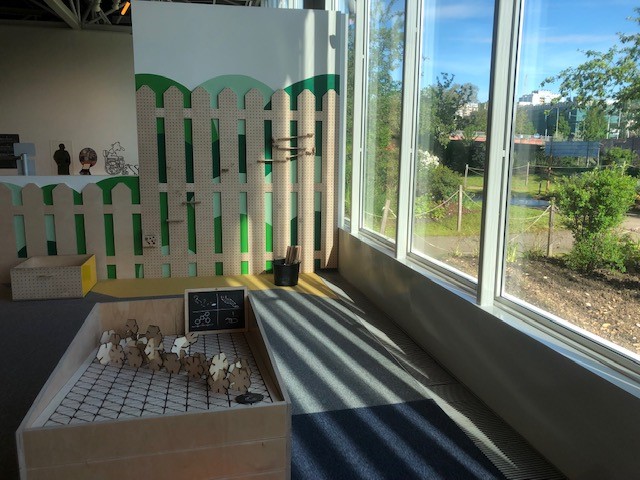
La Pépinière éclairé par la douce lumière du matin © M.D

La Pépinière à la fin de la première journée d’ouverture © M.D

Nathalie, médiatrice, en plein rangement des carrés potagers © M.D
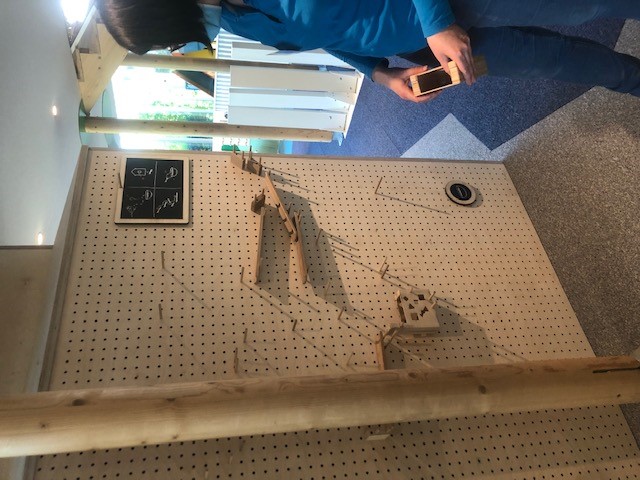
Nathalie, devant le cabanon de La Pépinière, en train de créer des amorces pour les circuits à bille © M.D
Manon Deboes
#Rangement #Centreculturescientifique #Enfants

Redécouvrir un musée, la maison de la Vache qui rit

© C CARON
© C CARON
Je suis invitée à commencer par les caves, lieu historique de l’usine ou Léon BEL lancé sa production de fromage.
Le sas d’entrée me plonge dans la planète BEL avec quelques affiches publicitaires, arbre généalogique et un petit dessin animé mettant en scène la vache qui rit de la préhistoire à nos jours tantôt héroïne, tantôt Joconde. Les affiches et le petit film d’animation sont une manière ludique de faire appel aux souvenirs du public.

(Aménagement 2018) - © Maison de la Vache qui rit

(Aménagement 2013) © Maison de la Vache qui rit
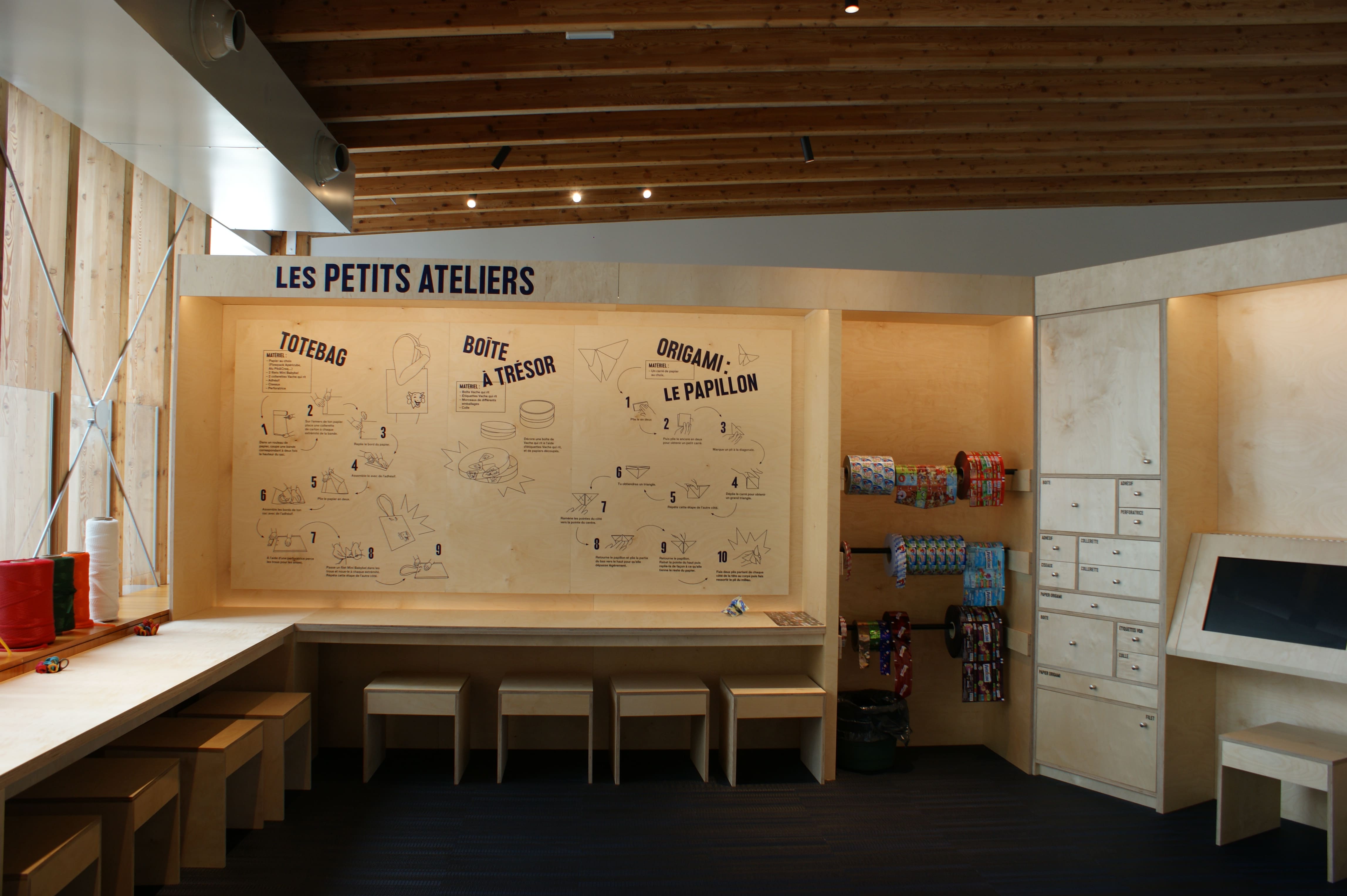
© C CARON
L’étage est divisé en plusieurs ambiances :
- Maquette d’une chaîne de production
- Espace de jeux numérique et créatif
- Espace de projection d’un film illustrant l’exportation du produit la vache qui rit dans le monde entier
- Espace de jeux
- Fondation d’art
- Produits du groupe BEL
Ces items traduisent les valeurs de la Marque et son emprise
Pour les visiteurs habitués, l’espace nouvellement conçu ne fait plus écho aux affiches publicitaires, humoristiques, aux figurines, l’illustration fait place aux questions sociétales du groupe.

Aménagement 2013 © C CARON
Le partis pris de l’équipe muséale, d’un espace immersif où l’on propose de nouveaux modes d’appréhension tout en transmettant les valeurs de marque à la société semble réussi ! le ton de l’exposition est d’ailleurs dans l’émotion (la fierté, l’échange, le jeu, la famille, la gourmandise, grandir). Mobilier moderne, scénographie assez épurée, médiateurs disponibles pour nous accompagner dans des ateliers et répondre à toutes questions. Le site propose peu d’écrans et tablettes numériques, seulement 3 à disposition des enfants des jeux numérique. La volonté d’un musée familial pour échanger et partager semble être une des explications.
Pour l’ensemble des espaces, le visiteur est acteur de sa visite, il choisit ou non de lire les îlots, d’ouvrir ou non les cachettes ou même de s’arrêter sur les hublots de la frise. A l’étage, il peut décider de traverser la plateforme comme se poser pour jouer, fabriquer.
La dimension ludique a été mon fil conducteur, j’ai pu grâce à l’épopée de l’illustration de Benjamin Rabier à la dimension 3D, aux ateliers vivre une visite.
Le dernier espace est l’atelier de cuisine et l’exposition temporaire consacrée, cette année au Sénégal « NAK BOU BEG ».
© C CARON
Cette exposition permet d’évoquer la présence du Groupe au sein de ce pays mais plus largement l’international. L’exposition temporaire invite au voyage et à la découverte d’artistes du Sénégal, artistes peintres, sonore, sculpteur, tricoteuse et graphiste qui se sont rencontrés autour de ce projet. Quel est le point d’orgue de ma visite ? L’écran 180° évoquant l’implantation de la vache qui rit dans le monde (une forte présence humaine, la description des quartiers, des villes en image et l’idée de regard croisé) ? L’atelier de cuisine permettra d’accueillir les ateliers enfants et goûters propose par le service des publics. Ces derniers sont tournés sur la nutrition, la gourmandise et le développement durable. La définition du directeur « Nous avons travaillé à la non définition d’un lieu, afin qu’il soit incubateur d’idée, laboratoire, centre aéré, centre d’art, atelier cuisine et Fab lab. », semble prendre tout son sens dans ces espaces comme l’illustre le concept de l’exposition temporaire.
Camille Caron
1 Laurent BOURDEREAU
2 Explication de Laurent BOUDEREAU dans Connaissance des Arts
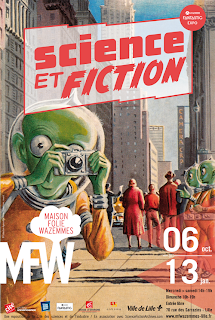
Science et Fiction: aller-retour dans un monde imaginé
C'est Fantastic ! L'exposition Science et Fiction pointe la richesse du dialogue entre sciences et science-fiction. La métropole lilloise a offert pendant tout l'automne 2012 jusqu'au début de l'hiver un panel d’œuvres et d'études autour du fantastique.
L'exposition Science et Fiction s'est déroulée du 06/09/2012 au 13/01/2013 à la Maison Folie de Wazemmes de Lille, elle s'inscrivait dans le cadre de Fantastic. Créé par Lille3000, pour une plus grande diffusion culturelle, Fantastic s'est déployé à travers la ville par le biais de métamorphoses, d'expositions, d'arts vivants, de littérature et de cinéma sur le thème du fantastique. Plus de trente expositions couvraient le sujet à travers la métropole lilloise, des maîtres de la peinture flamande du XVIème siècle aux textiles du futur en passant par une face inexplorée de Chagall.
Où ?
Affiche de la Ville de Lille Crédits : E.B.
La maison folie de Wazemmes nous a proposé, quant à elle, une incursion dans la richesse du dialogue entre science et fiction. Ce lieu mixte implanté, à l'occasion de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, dans un quartier célèbre pour son esprit populaire et sa vitalité culturelle a pour vocation de promouvoir les cultures populaires et de provoquer les rencontres. Il est au cœur d’échanges et de croisements multiples entre les disciplines, les artistes de tous horizons, et surtout les publics. C’est à la fois un lieu de diffusion où sont programmés des spectacles vivants, des expositions, des ateliers créatifs, des performances, des festivals mais aussi un lieu de création, de fabrique car la Maison Folie de Wazemmes accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence, particulièrement les artistes de la région.
Quoi ?
Science et Fiction est une exposition de la Cité des sciences et de l'Industrie créée en association avec ScienceFictionArchives.com qui propose une immersion dans toute la diversité dela Science-Fiction. L'exposition présentait les échanges entre science et fiction, des débuts de ce genre littéraire aux inventions les plus modernes de la science contemporaine. L'exposition souligne comment l’une et l’autre se sont mutuellement nourries grâce à l'une des plus grandes collections d'Europe d'objets originaux, ayant servi aux tournages de films cultes de la science fiction : maquettes de vaisseaux spatiaux, robots, masques d'extra-terrestres, costumes, combinaisons spatiales, extraits de films, livres, BD... Science et Fiction était divisée en trois niveaux eux-mêmes divisés en espaces : Explorer l'espace, Explorer d’autres sociétés et Explorer un univers transmédia afin de mieux orienter le visiteur sur le chemin de la Science-fiction.
Comment ?
Le partis-pris de Science et Fiction était que la science-fiction non seulement découle des avancements de la science mais aussi que ce genre littéraire alimente les ambitions des scientifiques et donc participe aux progrès de la science. Comme preuves de ces faits, l'exposition mettait en scène dans des vitrines les œuvres littéraires majeures de la science-fiction, notamment des romans de Jules Verne ou Cyrano de Bergerac imaginant voler en ballon jusqu'à la lune ou encore Tintin marchant sur cet astre, montrant que l'imaginaire autour du progrès scientifique n'est pas nouveau. C'était une exposition centrée sur son discours et ses thèmes mais aussi visant à sacraliser certains objets, comme les costumes originaux de films cultes mis en lumière et protégés comme des trésors.
Pour Qui ?

Galerie des robots Crédits : E.B.
Le visiteur dans Science et Fiction était invité à participer, à toucher, à se questionner et mettre tous ses sens en éveil. D'abord des bornes en Braille accompagnaient chaque thème de visite pour ne laisser aucun public de côté, ainsi que l'audiodescription présente dans un des films animés dans la partie Les robots, amis ou ennemis ? Également dans le deuxième niveau dans l'espace des Sociétés dans la tourmente le visiteur était invité à toucher ce que pourrait être un alien.
Pour un aspect ludique de nombreuses tables interactives jalonnaient le parcours afin de faire participer et aider à l'imprégnation des connaissances scientifiques. Un jeu à quatre joueurs est proposé au deuxième niveau posant des questions sur ce que le visiteur a pu découvrir auparavant dans l'exposition, un autre à deux joueurs, au premier niveau, entraîne les visiteurs à faire décoller une fusée et à la faire atterrir sur la lune... L’ouïe est aussi mobilisée par le biais de bruitage dans les espaces Explorer d’autres sociétés, embarquant le visiteur dans un monde futuriste, de plus de nombreux films audio sont proposés aux visiteurs. Enfin la vue est bien sûr sollicitée par les nombreuses couleurs utilisées par l'univers de la science-fiction et ses représentations, dessins ou photos accrochés aux murs, ou par les objets exposés dans les vitrines.
Alors ?
Au final le message de connexion étroite entre science et science-fiction transmis par le premier niveau est clair et compréhensible grâce aux panneaux, cartels et films à disposition. Le second niveau de Science et Fiction est axé vers les craintes et limites de la science voulant recréer la fiction, et nous amène à voir plus loin, à créer notre propre imaginaire. Enfin, le dernier niveau présentant le travail de création de personnages et mondes de science-fiction depuis les dessins aux moulages plastiques perturbe le message global de l'exposition. Le visiteur se trouve dans un espace à moitié show-room mettant en lumière le travail des graphistes des univers Dofus et Wakfus. Ce qui laisse le visiteur, profitant de toutes les salles du parcours, perplexe quant au message transmis par ce dernier espace.
Élisa Bellancourt

Scientifiquement artistique
Le lien entre art et sciences est indéniable mais souvent oublié. Les sciences donnent aux artistes des clés et des outils pour penser le monde : l’invention de la peinture à l’huile, la photographie, l’informatique, autant de nouveaux supports artistiques. De son côté, l’art démocratise les découvertes scientifiques, les vulgarise et les remet en cause. Sans oublier le point commun de ces deux disciplines : questionner le monde en rendant visible l’invisible. Tour d’horizon de ces alliances expographiques.
image d'introduction : ©Sarah Pflug
La science au service de l’art
De nombreux courants artistiques ont marqué l’histoire de l’art, et pour beaucoup d’artistes, la science est une alliée. Comme l’a nommé Hervé Fischer en 2007, les Arts scientifiques semblent être la nouvelle aventure créative de notre siècle.
C’est ce qu’encourage l’école d’art du Fresnoy à Tourcoing depuis 1997, où les artistes collaborent avec des scientifiques. Les étudiants-artistes s’appuient sur la science pour mener à bien leur processus de création. La série annuelle d’expositions Panorama leur permet de présenter aux visiteurs leur projet artistique. Plus de 50 œuvres sont exposés à Panorama 24 L’autre côté jusqu’au 31 décembre 2022. Le visiteur y découvre des projets mêlant art et science comme le film Les Hommes de la nuit de Judith Auffray, qui raconte la relation entre humains et grands singes en filmant un explorateur observant, étudiant et dessinant des orangs-outans.
Beaucoup d’artistes se basent sur les progrès de la science et, en retour, certaines de leurs œuvres permettent de nouvelles avancées scientifiques. Lors de la cinquième édition de la biennale d’art contemporain Appel d’Air (Arras, 2022) – L’attention au vivant, l’artiste Héloïse Callewaert propose des logements durables pour des petits oiseaux. Ces nids, composés de paille de chanvre, de chaux et de sable, offrent aux oiseaux un abri sûr en pleine ville. De plus, sa composition absorbe le CO2 atmosphérique. En parallèle, l’artiste travaille sur la construction de maisons de la même composition.

Nid de paille de chanvre, de chaux et de sable par Héloïse Callewaert, cinquième édition de la biennal d’art contemporain Appel d’Air – L’attention au vivant ©AppelD’Air
Une exposition est aussi le prétexte pour unir ces deux « milieux » et construire un projet commun. L’exposition Des eaux artificielles au muséum aquarium à Nancy, en est un exemple. Le muséum s’est associé aux trois FRAC du Grand Est afin de questionner un monde de plus en plus fragilisé par l’action humaine. Jusqu’au 22 décembre 2022, le visiteur peut déambuler entre œuvres d’art et naturalisations pour prendre conscience de l’aquarium géant dans lequel il vit.
Enfin, pour d’autres artistes, la science est un vaste terrain de jeu où expérimenter devient artistique. Avec sa série Présages, Hicham Berrada s’improvise chimiste en mélangeant différents produits et faisant pousser des minéraux dans un aquarium afin de filmer les réactions. Cette série a été exposée au Centre Pompidou, à l’école d’art du Fresnoy, à la Fondation EDF ou encore au Palais de Tokyo.
L’art au service de la science
Les musées scientifiques ne sont pas en reste. On ne compte plus le nombre d’expositions dont le propos scientifique est soutenu par des projets artistiques. Souvent commandées pour l’exposition, les œuvres questionnent la science, défendent une cause, vulgarisent des notions complexes ou émerveillent.
L’écologie et le dérèglement climatique sont les grands sujets scientifiques du moment et les expositions sont un support de communication important pour cette cause, et ce, à travers le monde. Le muséum d’histoire naturelle de Rotterdam a accueilli les œuvres de la biologiste et artiste Arike Gill en 2021. Dans une petite salle blanche sont accrochés des tableaux de scènes naturelles au quotidien rythmé par les déchets des humains.
De nombreux sujets font débat en sciences notamment les limites de l’humain. L’exposition Aux frontières de l’humain au musée de l’Homme de Paris, du 13 octobre 2021 au 30 mai 2022, présente une œuvre d’art par séquence pour interroger les avancées scientifiques. Dans la séquence Je suis un mutant, il est question de la modification de l’espèce humaine grâce aux biotechnologies. L’œuvre grandeur nature de Patricia Piccinini trône au milieu de la pièce et choque le visiteur. Une femme tient dans ses bras un enfant transgénique à l’apparence troublante, et si nos enfants ressemblaient à cela ?
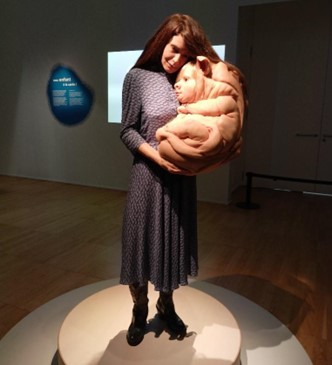
The Bond de Patricia Piccinini présenté au musée de l’Homme pour l’exposition Aux frontières de l’humain, ©MT
Jusqu’au 30 avril 2023, le musée de la Main à Lausanne présente une exposition sur l’intelligence artificielle. Même si elles font partie intégrante de nos vies, les IA restent encore un mystère pour beaucoup d’entre nous. Le musée a choisi de faire dialoguer recherches scientifiques et dispositifs artistiques, afin questionner et vulgariser des notions complexes. L’installation ECAL Alter ego créé par les étudiants du Bachelor Media & Interaction Design, permet aux visiteurs, à travers le jeu, de se familiariser avec l’intelligence artificielle.
Toujours autour de l’intelligence artificielle, Barbara Goblot a créé l’exposition A visages découverts dans le cadre du master Expographie Muséographie à l’Université d’Artois. L’exposition est narrée par une entreprise fictive de reconnaissance faciale Eyefinity. Ce dispositif mêlant art-fiction et science nous fait prendre conscience des limites de l’intelligence artificielle.

Exposition A visages découverts de Barbara Goblot, ©BG
L’art questionne, vulgarise, choque, défend une cause, mais peut aussi émerveiller et fasciner. L’exposition Regard(s) fascinant(s) en est un bon exemple. Tim Flach, un photographe animalier, présente ses photos au Muséum national d’histoire naturelle de Paris au cœur du zoo jusqu’au 31 décembre 2022. Absorbé par les yeux des animaux, le visiteur prend le temps de découvrir la nature sous un nouveau jour.
« Quand je regarde un animal, et qu’il me fixe de son regard en retour, je me demande toujours : à quoi pense-t-il ? Que ressent-il ? En quoi est-il différent de nous ? J’ai toujours éprouvé un sentiment d’émerveillement envers le monde naturel et les animaux en particulier. C’est cette émotion que je cherche à ressentir et à partager dans mon travail de photographe. » Tim Flach
Les expositions mêlant arts et sciences semblent plaire de plus en plus. Ces deux disciplines, très complémentaires, permettent d’aborder un sujet sous différents angles. Les visiteurs peuvent découvrir la science à travers l’art et découvrir l’art à travers la science. Qu’il s’agisse de questionner, s’amuser, s’engager, séduire, faire avancer la science ou la remettre en cause, ces alliances expographiques séduisent les professionnels comme les visiteurs.
Mélanie TERRIERE
En savoir plus :
#art #sciences #artscientifique #exposition

Silence, il s'expose
L’exposition « Silence » part du postulat que le silence est rare dans nos sociétés modernes et sur-stimulantes : tout bouge et évolue, les moyens d’accaparer l’attention se multiplient, notamment par le biais des courriels, réseaux sociaux et autres - « Ding ding ! » applications aux notifications infernales rappelant à l’ordre les utilisateur.ices.
Il faut traiter immédiatement la notification, consulter ou faire glisser hors du champ de vision la petite icône, sous peine de la voir longuement trôner dans un encadré angoissant, « barre des tâches », de l’écran. A contrario, ce qui demande un effort et un peu de courage, c’est d’activer le mode avion.
L’habitude facile, pourtant dommageable, est de continuer ainsi même dans une exposition smartphone parasite en poche, au lieu de s’ancrer autant que possible dans le présent, et de s’avancer vers une expérience inconnue. Cette exposition fait exception : écouteurs sur la tête, le.la visiteur.euse est immergé.e dans le silence.
« Silence » (Cité des sciences et de l’industrie, Paris) a l’ambition d’être une exposition immersive, vous amenant à expérimenter le silence sous différentes formes, avec un fort objectif méditatif. A l’aide d’un dispositif binaural généré en temps réel et d’un casque, vous évoluez individuellement dans l’espace de l’exposition, selon vos envies. Un système de captation de la position de chacun assure un parcours sonore individualisé.
Le but principal est d’explorer les multiples facettes du silence, qu’il soit perçu comme un refuge, une absence ou un espace d’introspection. Le scénario d’exposition se décline en 6 modules, décomposant le sujet (voir Plan). L’ensemble est conscrit entre une introduction et une conclusion décisives, comme des sas sensibles et par lesquels les visiteur.ices peuvent s’ancrer dans l’expérience.
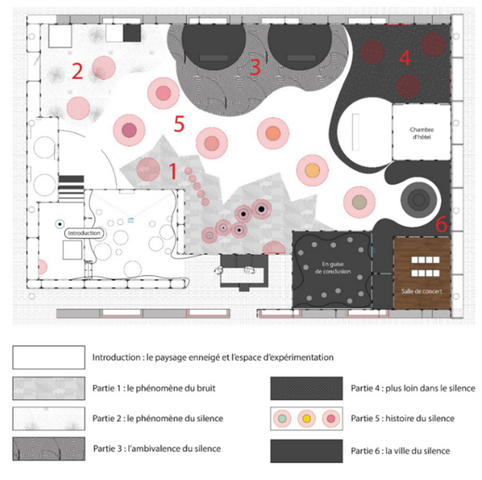
Plan, Dossier enseignants de l’exposition Silence. © Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
Ce premier temps est une familiarisation avec le sujet et le type d’approche, laissant à chacun.e la possibilité de s’habituer au dispositif auditif. Dans une salle aux revêtements cotonneux, l’image d’un paysage blanc est projetée, doucement animée par la neige tombant en continu. Ayant pris place sur les assises, vous écoutez la voix accompagnatrice expliquer le déroulé de l’exposition et la diffusion particulière du son en accord avec les déplacements.
Vous évoluez maintenant au centre de l’exposition, avec d’un côté le phénomène du bruit et de l’autre, celui du silence. Complémentaires, ces deux sections accès sur l’aspect physique interrogent l’intensité du son et l’existence du silence absolu ; en réduisant au maximum le bruit extérieur par exemple, vous expérimentez la chambre anéchoïque, une salle d'expérimentation dont les murs et le plafond sont totalement absorbants aux ondes sonores ou électromagnétiques. Mais observerez-vous pour autant un silence parfait ? C’est le battement de votre cœur que vous entendez ?
Après avoir abordé les oppositions silence/bruit, vient l’ambivalence du sujet : le silence est-il constamment une source de bien-être ? En s’appuyant sur deux exemples d’isolement, l’un délibéré et l’autre subi, le module traite de la relation du silence avec l’être humain, ses liens positifs comme négatifs sur son développement psychique.

Vue de la salle introductive. © N Breton-EPPDCSI
Plus prégnant encore, le silence volontaire anime un module voisin. Dédiée à l’expérience de Sara Maitland, isolée sur une île déserte pendant quarante jours, le module s’intéresse au potentiel d’introspection quasi-métaphysique de ce son et ses conséquences sur la conscience humaine.
Dans une approche historique, une section propose quelques exemples où le bruit et le silence ont marqué les sociétés à des périodes différentes, telles qu’à l’époque antique via l’Odyssée d’Homère, la période contemporaine, ou plus immémorial, durant le Big Bang, un cataclysme cosmique imaginé par tous et toutes comme bruyant. La reconstitution de ces scènes, sous forme de saynètes audio créées pour l’occasion, vous transporte dans ces moments clé ; comme lors des bombardements pendant les guerres mondiales ou lors d’une journée immaculée de bruit dans un cloître médiéval.
Enfin, le silence est contextualisé dans les environnements urbains modernes, notamment via la construction d’espaces significatifs tels que la chambre d’hôtel et la salle de concert. Sous quelles formes le silence existe-t-il dans ces lieux ? Quels refuges silencieux face à la pollution sonore omniprésente ? L’intégration de productions artistiques célèbres (l’œuvre musicale 4’33 de John Cage, et le poème Ma vie n’est pas de Rainer Maria Rilke) interroge également le bruit en tant que matière inspirante.
Enfin, le module conclusif prévoit une rencontre sonore méditative avec Niklaus Brantschen, jésuite et maître zen, qui partage ses réflexions sur les effets guérisseurs du silence, les bienfaits de la méditation, et la perspective d’un silence qui « relit et guérit ». Les mêmes assises qu’à l’introduction vous sont proposées pour pouvoir sereinement clôturer ce voyage et ouvrir les perspectives de l’« après-visite » du.dela visiteur.euse.
Captiver avec des sons et des silences
Conçue par le Musée de la Communication de Berne, l’exposition a précédemment ouvert ses portes en Suisse en 2018 sous le titre de « Sounds of Silence », en tant que premier grand projet depuis la réouverture de l’institution en août 2017.
L’utilisation de la technologie du son binaural, loin d’être un gadget de l’exposition, modèle une expérience réaliste en permettant de recréer l’effet d’une écoute naturelle en 3D, comme si le son provenait de l’environnement réel. En utilisant des microphones placés à la hauteur des oreilles humaines, cette technique capture les sons en tenant compte de leur direction et de leur distance. Cette diffusion réaliste s’adapte aussi en temps réel aux déplacements du public, faisant de chaque parcours une expérience unique.

Vue de l’ambiance graphique, Silence. © N Breton-EPPDCSI
Notons également que ce dispositif audio, allié à des vidéos et images d’environnements (paysage enneigé, forêt, mur d’une cellule, vue urbaine nocturne etc.) est entièrement chargé de médiatiser les contenus. Si ce choix peut paraître risqué, trop monotone, il permet de conscrire l’attention du public. Celui-ci, absorbé par le réalisme de la production, prend connaissance de la variété de formes dans la trame auditive : récits d’un point de vue externe racontant notamment l’histoire de l’ermite Christopher Knight ayant choisi de vivre sans contact humain pendant 27 ans, l’interprétation du poème de Rilke, reconstitutions, texte de création lyrique portant sur l’expérience de l’absence de stimuli (la « torture blanche »), vulgarisation scientifique, etc. Plus largement, un bel équilibre est respecté entre les propos et leurs incarnations, notamment avec des exemples parlants et compatibles avec le format audio, respectant le principe d’immersion.
L’effort muséographique pour attiser l’attention des visiteur.euses est soutenu par un design intérieur minimaliste, clair et calme, ayant reçu le IF Design Award 2020. Les choix de n’exposer aucun objet et de dissimuler à la perfection l’équipement technologique façonnent une expérience visiteur intuitive et favorisent la construction d’un paysage sonore. Au-delà d’espaces reconstituant des environnements précis tels qu’une cellule d’isolement ou la forêt, est appliqué un langage visuel qui éclaire les contenus plus abstraits ; lignes graphiques, torturées dans divers sens, associations, formes, et rythmes, évoquent les propagations d’ondes sonores, ou au contraire, des vides indiquent leurs absences.
Tout.e seul.e, ensemble
« - Tu ne te sens pas trop isolée avec ce casque ?
- Hein ? Qu’est-ce que tu dis ?
- Non rien laisse tomber… »
En fin de parcours, en retirant l’équipement de vos oreilles, vous aurez l’impression de renouer avec les autres, et plus spécifiquement avec vos accompagnant.es. En réalité, c’est le bruit et l’agitation environnants que vous rejoignez. Vos semblables, eux, ne vous ont jamais vraiment quitté. Ils étaient juste-là, à côtés, attentifs.
En principe, le dispositif audio utilisé comme seul principe de visite fait craindre une expérience isolante. Ici, la technologie mobilisée fait sens avec le sujet présenté et soutient une démarche réflexive, resserrée sur l’individu et sa manière de gérer le silence. En poussant vers un retour à soi, contrôlant les stimuli proposés, le dispositif permet un moment de méditation, vécu de manière plus ou moins simultanée, qui trouve une résonnance particulière en chacun.e. L’isolement du casque permet donc de créer cette bulle personnelle, et de traiter du silence de manière immersive.

Vue du module « ambivalence du silence », Silence. © N Breton-EPPDCSI
Enfin, la dimension poétique de cette mise en silence réside dans le partage simultané – ou presque, des expériences, et ce, sans piper mot. Les espaces étant rattachés à des pistes audio précises, vous partagez avec les inconnu.es avoisinant.es les mêmes contenus. Asseyez-vous ici, à côté de cette personne pour apprécier l’histoire racontée ; à quel moment de la piste en est-elle ? Pouvez-vous le deviner en observant ses réactions ou sa gestuelle ? Comment ressent-elle cela ? Tente-t-elle de deviner vos pensées en retour ? Ces divagations s’établissant, vous expérimentez une autre facette du silence, qui ne figurait peut-être pas au synopsis de l’exposition, qui est celle du silence vécu en relation, par une attention et une imagination propre à chacun.e.
Romane Ottaviano
Exposition crée par le musée de la Communication, Berne.
« Sounds of Silence » du 7 novembre 2018 au 7 juillet 2019.
Actuellement à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
« Silence » du 10 décembre 2024 au 31 août 2025.
Pour aller plus loin :
https://youtu.be/wQQHZcbHKdA
2018 | Museum of Communication | Bern - usomo
|
#ExpositionSilence #ExpositionImmersive #binaural |

Silence… BIG BANG !
Ambiance feutrée rouge. Alignement de sièges cosys. Ecrans plats. Présentation des « acteurs ». Générique…Non nous ne sommes ni au cinéma, ni au théâtre, mais bien dans l’un des dispositifs muséographiques du PLUS. Le Palais de l’Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande pousse lexicalement le rapprochement en intitulant cette installation multimédia « le théâtre du Big Bang ». Appellation quelque peu spectaculaire, mais qui, finalement, concorde parfaitement avec l’ambiance de l’exposition permanente et sa promesse de voyage au cœur de l’Univers !
© droits réservés
L’expérience interactive, la réplique phare
Le synopsis du guide de visite nous prévient : « une quarantaine d’expériences interactives » nous attendent tout au long du parcours. Ainsi, les écrans et les manettes se dupliquent. Tout le monde peut regarder et manipuler, en d’autres termes participer. La nouvelle technologie s’invite donc dans cet équipement culturel, sans malheureusement réussir à vaincre son ennemi : la panne a en effet la fâcheuse manie de se dupliquer elle-aussi !
Dans le « théâtre du Big Bang », tout fonctionne. Hubert Reeves, Marc Lachièze Rey et François Bouchet, astrophysiciens et cosmologues de renom, sont nos interlocuteurs privilégiés. Ils nous expliquent le Big Bang, en effaçant petit à petit la part de mystère que revêtent des termes comme la température de Planck, le quark ou encore le fonds diffus cosmologique.
Multiplicité de plans et d’écrans ou l’invention du travelling humain
Ici ce n’est pas la caméra qui effectue un travelling circulaire, mais bel et bien le visiteur. A l’aide d’un siège rotatif, il est amené à suivre le film projeté tour à tour sur trois écrans différents. Du spectateur passif, nous passons au spectateur actif voire même sélectif. En effet, le film ne se contente pas de passer d’un écran à l’autre. Quelquefois, les écrans se complètent : soit l’astrophysicien se présente sous différents profils selon les écrans, soit un schéma ou une photographie appuie ses propos sur un autre écran, soit les deux ! De plus, un fond sonore, fait de bruits sourds et généralement puissants, amènent le visiteur à s’immerger totalement dans cette présentation du temps zéro de notre Univers.
Bien sûr, il serait évident de rétorquer que toute la partie sonore ne pense pas aux visiteurs sourds. En réalité, le PLUS a développé de nombreux équipements pour les personnes souffrant de handicaps, notamment des maquettes tactiles pour les malvoyants. Ici, deux écrans, certes plus petits, viennent s’ajouter aux trois autres. L’un montre la vidéo présente sur les écrans principaux, l’autre la traduit en langue des signes française. Malheureusement, ces spectateurs perdent ce qui pour moi fait tout l’intérêt de ce dispositif, et marque sa différence avec une vidéo classique : le choix d’un spectateur actif !
Le hors-champ
Mais l’éveil ne s’arrête pas là. Les murs de cet espace de projection sont volontairement sectionnés par endroit afin d’ouvrir la perspective et de proposer une interaction entre le film et d’autres modules. Il se peut, en effet, que le visiteur-spectateur n’est pas entièrement compris l’information donnée par des spécialistes au langage et à la formulation quelque peu soutenus (c’est effectivement mon cas). Alors, pas de panique ! La scénographie l’incite à se diriger vers des modules expliquant et complétant la vidéo suivant différentes présentations plus ou moins attractives : un élémentaire tableau sur les particules élémentaires, une maquette du satellite Planck lancé en 2009 pour dévoiler les secrets du Big Bang, une BD rétro-éclairée sur la découverte du fonds diffus cosmologique, pour n’en citer que quelques-uns.
Ce dispositif conserve tout de même un paradoxe. La difficulté de comprendre une théorie aussi complexe que celle du Big Bang pourrait être augmentée par cette nécessité, toutes les deux minutes, de changer d’orientation, d’écran et d’interlocuteur. Mais dans un sens, cela rejoint l’idée du modèle cosmologique qu’est le Big Bang : c’est-à-dire un univers toujours en expansion, et donc non statique !
Alors, nos yeux, sortes d’électrons libres, se déplacent dans cet espace, pour finalement suivre une trajectoire aléatoire propre à chacun !
Marion Monteuuis

Six lycéens (em)portés dans les collections
Des idées ? Un smartphone ? L'envie de passer du temps dans un musée ? Ce concours national est peut-être fait pour vous... Musées(em)portables fédère de nombreux participants dans les Hauts-de-France chaque année. Une démarche activement soutenue par le Master Expographie-Muséographie à l'Université d'Artois.
Juliette Gouesnard et Camille Roussel-Bulteel, étudiantes de ce Master 2, ont accompagné plusieurs jeunes dans leur découverte d'un musée. Ces lycéens ont ainsi pu mener leur projet jusqu'à la réalisation de leur film et leur participation au concours.
La série vidéo "Médiation au musée" témoigne de cette expérience :
- Deux lycéens et leur professeur au musée d'histoire naturelle de Lille
- Quatre lycéennes et un portable au musée de la Chartreuse de Douai
La prochaine édition de Musées (em)portables sera lancée le 1er juillet 2017 pour une remise des prix en janvier 2018 : infos et formulaire d'inscription.
Juliette Gouesnard (réalisation vidéo) Camille Roussel-Bulteel (réalisation vidéo)
Hélène Prigent (article)
En savoir plus :
- Prix 2017 Musées(em)portables : le 2ème prix ICOM remporté par les centres socio-culturels d'Avesnes-sur-Helpe et de Fourmies et le Master Expographie-Muséographie (MEM),
- Expériences et films réalisés par le MEM pour Musées(em)portables,
- Musée d'histoire naturelle de Lille,
- Musée de la Chartreuse de Douai.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
10 mai 2017
#concours
#smarphone
#création

T. rex in Town : retour sur une tournée entre Crétacé et modernité
Un dinosaure déconfiné sur un vol transatlantique, une visite d'exposition au Museum, une parade nuptiale « préhistorique », bienvenue dans le monde d'avant ...
Fin d'un règne américain et début de l'engouement européen
Après trente ans de vie tourmentée, entre morsures, fractures et infections, un dinosaure, probablement une femelle, meurt il y a quelque 66,4 millions d'années, dans l'état actuel du Montana, au Nord-Ouest des États-Unis. Elle appartient à l'espèce Tyrannosaurus rex, qui signifie «roi des lézards tyrans». Ces carnivores géants (prédateurs, charognards ou les 2, le débat agite encore les scientifiques) règnent sur la Terre pendant environ deux millions d'années avant de disparaître avec les autres espèces de dinosaures il y a 65 millions d'années.

Tyrannosaurus rex dans son paléoenvironnement: les études géologiques témoignent de la présence de cours d'eau et de deltas au Crétacé, dans la zone de découverte de Trix. © Image de synthèse : Naturalis Biodiversity Center
L'endroit où elle succombe est idéal pour sa conservation préventive, le sol présente une haute teneur en craie ou plus exactement en carbonates, ce qui devrait neutraliser les attaques acides de ses os. Son instinct de futur spécimen muséal la pousse peut-être à ne pas se coucher sur le flanc, pour limiter la déformation due à la pression du lourd et long enfouissement qui l'attend. Elle pose donc son crâne horizontalement et attend patiemment son heure, et plus précisément une heure tardive du 27 mai 2013 où un couple d'Homo sapiens paléontologues amateurs, Michele et Blaine Lunstad, va la découvrir.
Cette découverte est une aubaine pour Naturalis, le centre néerlandais de la biodiversité, en quête d'un spécimen de T. rex pour sa future exposition permanente. Son équipe de paléontologues se rend sur place, fin août, informée par son interlocuteur américain, le Black Hills Institute, déjà impliqué dans la découverte de plusieurs spécimens. Une dizaine de jours est nécessaire pour dégager le squelette extraordinairement conservé et presque complet (entre 75 et 80 % de la masse osseuse).
Ce chantier marque le début de trois années de travail pendant lesquelles les paléontologues américains et néerlandais travaillent au nettoyage du squelette, à son étude, à son assemblage puis à son désassemblage. Les parties manquantes sont scannées, mises à l'échelle puis imprimées en 3D, en miroir des membres présents ou d'après l'anatomie de Sue et Stan, deux autres tyrannosaures, également très bien conservés.

Chantier de dégagement et assemblage du squelette © Naturalis Biodiversity Center
En parallèle, l'équipe de Naturalis recherche des financements pour compléter l'investissement de départ et la ramener au musée. Un enfant aurait proposé au directeur une modeste mais très sérieuse participation de 10 euros. C'est le début de la campagne de financement participatif «Tientje voor T. rex» (dix euros pour le T. rex) qui fera casser la tirelire de 23 000 jeunes et moins jeunes donateurs. S'additionnent les initiatives et financements publics et privés, américains et néerlandais, pour atteindre la somme de 5 millions d'euros et permettre le départ de Trix pour les Pays-Bas.
Dernier appel pour Trix sur le vol KL 612 en partance pour Amsterdam, last call for Trix on the flight KL 612 to Amsterdam
En été 2016, Trix est prête à rejoindre Naturalis. Le 23 août, elle est déchargée d'un camion à l'aéroport international de Chicago et s'apprête à embarquer pour l'Europe.

La remise du passeport de l'ambassadeur néerlandais au commandant de bord est l'occasion d'une cérémonie gourmande pour la crème de la crème des dinosaures. © Netherlands embassy in the US
Outre son passeport qui révèle ses dimensions et ses empreintes impressionnantes et une réception avec l'ambassadeur, Trix voyage « presque » incognito, en compagnie des 250 autres passagers du vol 612 de la KLM Royal Dutch, à bord du Boeing 747 qui relie Chicago à Amsterdam. Une royale compagnie pour une grande dame que les visiteurs de Naturalis ont baptisé Trix, du surnom de Beatrix, reine des Pays-Bas jusqu'en 2013. Le T. rex réparti en 5 tonnes de caisses dépasse largement le poids du bagage réglementaire en soute.

Embarquement de Trix © Netherlands embassy in the US
Acclamée telle une star à son arrivée, Trix prend place pour quelques mois au Naturalis, son musée d'adoption, récupère son numéro d'inventaire RGM 792.000, avant de partir en tournée pendant la rénovation des espaces d'exposition. Son voyage concerne uniquement l'Europe, l'étape chinoise ayant été annulée.
Un T. rex à Paris
Telle une rock star, Trix, la T. rex américaine tourne de 2016 à 2019. Elle voyage par les airs et par la route pour être exposée dans six villes du Vieux Continent. Au printemps 2018, Trix achève la 3e étape de sa tournée au grand musée de sciences barcelonais, Cosmocaixa, où 380 000 visiteurs sont venus l'admirer. Elle arrive à Paris le 23 mai, invitée de marque pour les 120 ans de la galerie de paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle. Une exposition lui est d'ailleurs entièrement consacrée : un T. Rex à Paris.
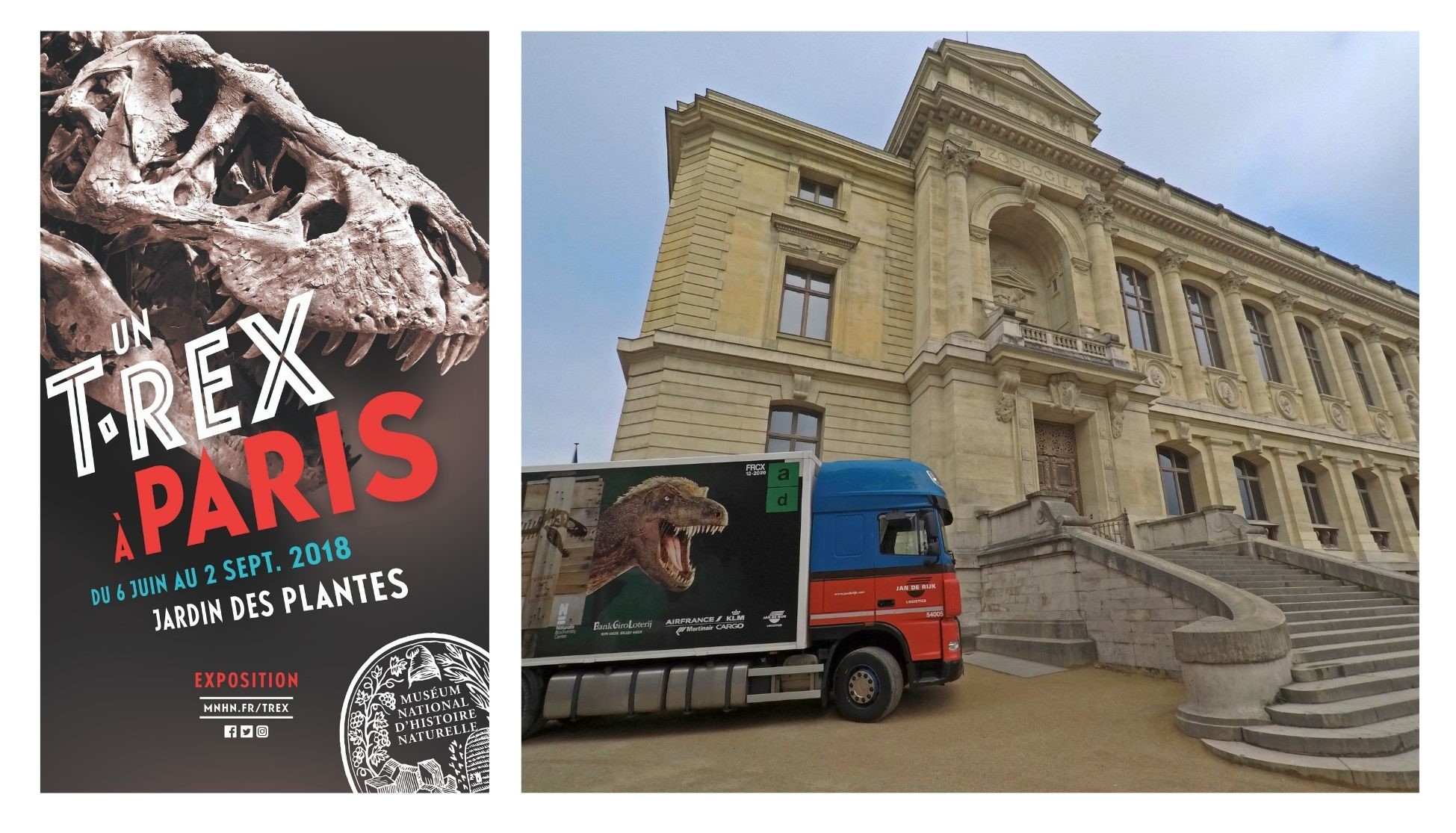
Trix arrive et s'affiche au Museum national d'Histoire naturelle de Paris. © MNHN- JC Domenech
Le squelette est très attendu, c'est la première fois qu'un vrai spécimen de cette espèce est présenté en France. Depuis l'automne précédent, l'équipe de paléontologues et de restaurateurs s'affaire autour du commissaire d'exposition, Ronan Allain, pour rassembler et préparer les expôts de la première salle, création du Muséum et véritable immersion dans les conditions de vie de Trix, au Crétacé. L'aménagement scénographique des 100 mètres de galerie est coordonné par Aude Pinguilly, cheffe de projet au Muséum. Le chantier mobilise des dizaines de personnes pendant 45 jours et s'achève juste avant l'ouverture début juin, entre travaux de soclage, de fabrication, d'agencement et installations hors normes comme celle du plafond à éclairage intégré à 7 mètres de hauteur ou celle des immenses fresques de végétation.
Question régie, un dinosaure de 12 mètres de long et de 4 mètres de haut arrive sous quel conditionnement ? Trix se présente dans des caisses, en pièces détachées et rangées dans des écrins de mousse, un puzzle qui compte pas moins de 304 pièces : 250 os et 54 dents numérotés à assembler dans le bon ordre sur l'armature métallique. Cette dernière est répartie dans sept autres caisses. Un casse-tête que maîtrise l'équipe de trois personnes de Naturalis qui accompagne cette vieille dame (trente ans est un âge honorable pour cette espèce) dans ses pérégrinations.

Conditionnement du crâne et des autres os. © Naturalis Biodiversity Center
La pose du crâne, dernière pièce du puzzle, intervient un jour et demi après le début du montage (sur les trois jours prévus). Trix est prête pour l'ouverture, le 6 juin 2018.
Rapprochement pour un selfie risqué
Je viens visiter Trix en septembre. Dans le premier espace immersif, je fais connaissance avec son environnement, ses contemporains et sa proie favorite sous les traits d'Edmond, le dinosaure à bec de canard du Muséum, monté et restauré pour l'occasion.
Dans la deuxième salle, je la rencontre enfin. Elle me fait face, elle semble prête à bondir. Je décide d'immortaliser l'instant. J'ai peu l'habitude de faire des selfies, probablement par manque de matériel, mon téléphone se situant quelque part entre les premiers 3310 (celui avec le serpent) et le téléphone des travailleurs en extérieur… Mais munie de mon appareil photo (ultra-moderne celui-ci), et guidée par le marquage au sol, je mitraille. Il est vrai que le selfie présente ici peu de risques. Quoique la mention mâchoire infectée me laisse songeuse. Et si, tapie, une bactérie du Jurassique ou plutôt du Crétacé attendait son heure?
En tous cas, cette proximité avec Trix me permet de mieux apprécier ses proportions, son extraordinaire état de conservation et d'imaginer la logistique de montage. L'assemblage des os est si précis qu'on ne devine pas l'armature métallique.

Entre filles? Selon les scientifiques, Trix était probablement une femelle, en témoigne la forme caractéristique de ses orbites (la découverte de stockage de calcium pour la ponte pourrait corroborer cette hypothèse). © Marianne Reuge (retardateur)
Course poursuite et pas de deux
Dans la troisième salle, les dispositifs interactifs permettent de mesurer mes capacités à celles de Trix et de ses congénères. Deux jeux me marquent particulièrement : la course-poursuite à vélo et la danse nuptiale.
Le premier dispositif consiste en un vélo d'appartement placé derrière un écran. Avec l'image, je peux voir l'environnement forestier dans lequel je vais évoluer et le rétroviseur me permet d'évaluer la distance avec le T. rex, lancé à ma poursuite. Particulièrement motivée, je monte en selle et je pédale frénétiquement. Un coup d’œil dans le rétro, le saurien a l'air distancé. Je tente une photo mais l'orgueil me perd, la mâchoire occupe maintenant tout l'écran et semble prête à me dévorer… Tant pis, je lui laisse la victoire… Blessée seulement dans mon amour-propre, je me demande quand même : et si nous avions cohabité, qui l'aurait emporté? Peut-être moi finalement si la poursuivante avait été Trix, car il me semble me rappeler que des chercheurs lui avaient diagnostiqué de l'arthrose…

Petite reine contre grande reine: La vitesse du T.rex a longtemps fait débat. Selon une étude de 2020 d'une équipe de paléontologues de Manchester, il n'aurait pas pu dépasser les 19km/h sans se briser les os. © Marianne Reuge (retardateur)
Un peu d'amour dans ce monde de prédateurs: le dispositif que je teste ensuite propose de s'essayer à la parade nuptiale du T. rex. Il s'agit de reproduire les mouvements qui apparaissent à l'écran, balancement de tête, mouvements de bras, de pieds. Mes congénères, tristes de me voir pour l'instant sans descendance, seront dépités à l'idée d'apprendre que j'excelle dans la séduction d'un partenaire certes grand et fort (mensurations idéales) mais d'une autre espèce, qui plus est éteinte depuis des millions d'années.

Petits bras mais grande parade © MNHN-JC Domenech
Après avoir testé les autres dispositifs, je retourne voir Trix pour prendre congé.
Forte de son succès, elle prolonge son séjour à Paris jusqu'en novembre 2018. Après avoir rencontré presque 340 000 visiteurs au Museum, elle s'envole pour les deux dernières étapes de sa tournée: Lisbonne et Glasgow.
Top 3 des charts

Trix de retour au Naturalis © Naturalis Biodiversity Center
Après une tournée géante au million de spectateurs mordus de dinosaures, la T. rex Trix a repris ses marques à Naturalis. Vous l'avez manquée? Naturalis, à la fois centre de recherches et musée de la biodiversité se trouve à Leyde, à cinquante kilomètres d'Amsterdam. Selon son directeur : «S'il y a bien un dinosaure que tout un chacun veut regarder dans les yeux, c'est bien le féroce prédateur, Tyrannosaurus rex». Alors, prêt pour une rencontre avec l'un des 3 des T. rex les mieux conservés au monde?
Marianne Reuge
Pour en savoir plus sur le centre de biodiversité Naturalis : Naturalis Biodiversity Center | Museum and research in Leiden
Pour voir les contemporains de Trix au Museum national d'Histoire naturelle Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée | Muséum national d'Histoire naturelle (mnhn.fr)
Image de couverture : Une compagne de voyage peu commune pour ces passagers. © Netherlands Embassy in the US
#museum, #exposition, #paléontologie
Merci aux équipes de Naturalis, du MNHN et de l'ambassade néerlandaise aux États-Unis d'avoir permis cette rencontre et à leurs services photos/médias pour l'illustration de cet article.

Test : quel musée de sciences es-tu ?
1. Quel est ton scientifique préféré ?
❀ Newton, parce que sans lui je pourrais pas twitter toute lajournée !
☾ Copernic, la tête dans les étoiles !
⚯ Einstein, pour faire des explosions dans mon labo !
✩ Déso, j’en connais pas, j’ai fait L.
2. Si tu devais avoir un compagnon de laboratoire ce serait :
⚯ Un poulpe, tellement drôle
☾ Une chouette, qui m’apporterait mon courrier
❀ Une pomme, simple mais redoutable
✩ Marty MacFly
3. Ta matière préférée c’est :
☾ Mathématiques, géométrie, astronomie
❀ Sciences et vie de la terre
⚯ Physique-chimie
✩ La corde à sauter dans la cour de récré
4. Ton icône absolu :
☾ Thomas Pesquet, et ses photos magiques
✩ Rihanna, tu peux pas test’
⚯ Heisenberg, because “I am not indanger Skyler, I am the Danger”
❀ Nicolas Hulot, de la fondation Hulot
5. L’ambiance de ton espace de travail c’estplutôt :
❀ Une cabane au fond du jardin, rien de plus inspirant que Mèrenature
☾ Cabinet de curiosité de la Renaissance (Ah le charme à l’italienne…)
⚯ Laboratoire de Marie Curie : explosif !
✩ Mon lit, tellement douillet !
6. Ta citation préférée :
❀ “Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.” Einstein
☾ “Le doute est père de la création”, Galilée
⚯ “2.21 Gigowatts ! 2.21 Gigowatts ! Mon dieu ! [...] Je devais être complètement dans les nuages !” Dr. Emett Brown, Retour vers le futur
✩ “Mais enfin, c’est quoi un gigowatt ?” Marty MacFly, Retourvers le Futur
7. Tu préfères :
☾ Dormir, tu adores rêver !
⚯ Cuisiner et mettre la main à la pâte
❀ Développer de la permaculture sur ton balcon
✩ Passer des heures sur Youtube, ils sont tellement mignons ces chatons !
8. Tu ne peux garder qu’un seul de ces films, lequel choisis-tu ?
⚯ Une merveilleuse histoire du temps, Eddie Redmane qui joue Hawking ! Mon choix est vite fait !
☾ Les figures de l’ombre, trois nanas noires badass qui envoient le premier homme en orbite pendant la guerre froide.
❀ Dans les pas de Paul-Emile Victor, quel homme...
✩ “Toc, toc, toc, Penny ?!”, Big Bang Theory, sans hésiter !
9. Si tu étais l’un des quatre éléments, tu serais :
✩ L’air, si volatile…
❀ L’eau, à l’origine de tout.
⚯ Le feu, ton côté savant fou pyromane.
☾ La terre... et pourtant elle tourne.
10. Enfin, si tu devais te définir en un mot :
❀ Curieux.se
☾ Inébranlable
⚯ Dynamique
✩ Courageux.se... mais pas téméraire
©Palaisde la Découverte, Galileo, PASS, Exploradôme
Résultats :
Si tu as le plus de ⚯
Toi, tu es le Palais de la Découverte ! Tu es là depuis 80 ans pour émerveiller petit.e.s et grand.e.s. Toutes les écoles et les collèges de la région parisienne se déplacent pour venir te voir. Ton côté vieillot fait certes une grande partie de ton charme mais tu prouves sans cesse que tu es plus dynamique que jamais. Une nouvelle salle dédiée à l’informatique et au numérique qui a ouvert en octobre 2016, la semaine des jeunes chercheurs, Muséomix 2017 en préparation et ta nuit des Musées 2017 qui dure 24h ! On peut dire que tu sais fêter un anniversaire toi !
Ton atout charme ? Tes médiateurs bien sûr ! Ils animent des exposés impressionnants pour nous raconter le système solaire, la vie de labo avec les rats, l’électricité statique, etc. Et puis, certain.e.s sont quand même très attirant.e.s… Eh ! Qui a dit qu’on ne pouvait plus draguer au musée ?!
Palais de la Découverte, Paris, France
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/
Si tu as le plus de ☾
Ciao Museo Galileo ! Prix ICOM 2010, on peut dire que tu sais prendre soins de tes collections. Avec tes conditions de conservation préventive optimales, chez toi l’objet est bichonné. De l’outil demesure à la mappemonde gigantesque en passant par les moulages anatomiques, toutes les conditions sont requises pour mettre en valeur tes étonnantes collections dans un esprit cabinet de curiosités à l’Italienne, bellissimo !
Attention tout de même à ne pas te reposer sur tes acquis. Car ton visiteur, aussi averti soit-il, peut vite se sentir submergé par l’ennui face à ce flot infini d’objets savants.
Petit conseil : pourquoi ne pas inclure plus d’expériences dans les salles d’exposition ?
Quelques pistes à explorer avec ta lunette astronomique : médiation innovantes, manips, numérique, expériences ludiques… Rien n’est trop beau pour Galileo !
Musée Galilée, Florence, Italie
Si tu as le plus de ❀
Tu es le PASS, un vrai aventurier. Entre tes expositions, tes parcours, tes animations et ton jardin, tu sollicites autant le corps que l’esprit !
Avec tes ateliers et tes activités pour tous les publics, on peut dire que chez toi on ne s’ennuie pas. Mention spéciale pour tes parcours en extérieur avec tes nombreux observatoires, rien de tel pour comprendre l’environnement qui nous entoure !
Trait de caractère dominant : l’expérience est pour toi un moyen d’explorer les découvertes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Toujours positif, tu fais confiance en l’intelligence des hommes pour trouver ensemble des solutions pour l’avenir.
Innovation, interpellation, découverte, plaisir, sont là tes maîtres mots ! Toutes ces aventures sont aussi exaltantes qu’épuisantes… Attention tout de même à ne pas trop tirer sur les jours de récupération.
PASS, Frameries, Belgique
Si tu as le plus de ✩
Tu es allergique aux musées de sciences. Désolées, on peut rien faire pour toi !
Non on rigole. Si tu as envie d’essayer mais que tu es un peu frileux.se, un conseil : l’Exploradôme d’Ivry. A deux pas du MAC/VAL ce musée où il est interdit de ne pas toucher permet de découvrir moultes phénomènes scientifiques en t’amusant. Cinquante manipulations réparties autour de cinq thématiques : énergie, climat et météo, le chemin des illusions (d’optiques), structures et formes et mouvements. Toutes t’invitent à te déplacer, essayer, manipuler, appuyer, toucher des choses pour découvrir et comprendre tous ces phénomènes scientifiques qui te semblent bien obscures aujourd’hui !
Qu’est-ce que tu attends ?!
Exploradôme, Vitry-sur-Seine, France
C’est pas tout ça, mais nous à force de crapahuter dans le Pass’âge des Aventuriers, de découvrir l’électricité statique, de nombreux objets anciens et de toucher à tout, on est épuisées, on va prendre notre goûter !
Marie & Margot
#test
#muséesdesciences
#aventures

Tous sauvages ?
Du 20 octobre 2024 au 25 août 2025, l'exposition "Sauvage ?" vous invite à explorer la frontière délicate entre animalité et humanité. Le concept de sauvage, une invention purement humaine, est revisité pour interroger la place que nous occupons au sein de cette nature que nous percevons souvent comme lointaine et inaccessible. Serions-nous tous sauvages ?
Une exposition adaptée pour son volet belge
Cette exposition remet en question le concept de la faune et de la flore “sauvage” et la relation que nous entretenons avec elle en tant qu'êtres humains. Elle incite les visiteurs à réfléchir, conteste la hiérarchie humaine sur les autres êtres vivants, et attire l'attention sur les menaces pesant sur la biodiversité. Conçue par le Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel (MHNN) en Suisse, avec une approche décalée et engagée propre au MHNN, cette exposition est reçue en itinérance par l’Institut des sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) pour un an et a été partiellement adaptée.
La principale adaptation de l'exposition consiste en un remaniement axé exclusivement sur la faune belge, intégrant uniquement des animaux naturalisés des collections de l’IRSNB. Des adaptations scénographiques internes ont été réalisées pour ajuster l'exposition aux espaces de l’Institut et pour proposer une présentation en quatre langues (NL, FR, DE, EN). Outre les ajustements spatiaux, la muséographie et le discours ont également été modifiés, notamment avec le changement de concept des zones 3 et 7 que nous abordons par la suite.
Chaque zone de l’exposition à Bruxelles reprend les relations que l’humain entretient avec le sauvage :
1. Avoir peur, être fasciné
2. Capter, posséder
3. Domestiquer, dominer
4. Se placer en dehors, se sentir supérieur
5. Étudier, classer
6. Menacer
7. Cohabiter, protéger
Déconstruction du concept de sauvage

Zone 1 : La voix des bêtes © CP
Zone 2 : L’envers du décor © CP
L’humain, un animal parmi les animaux. Grâce à notre éducation et notre culture, nous nous sommes soigneusement placés en dehors du règne animal en inventant le mot "nature". Pourtant, dans certaines sociétés d’Australie, d’Amérique du Nord et du Sud et où ce mot n'existe pas, les gens vivent sans cette distinction et semblent s'en sortir sans encombre. Cette exposition brise notre autocratie humaine et remet en question nos schémas de pensée autocentrés. Car la « culture » n’est pas le propre de l’humain. Une série de vidéos thématiques nous montrent que les autres animaux sont aussi capables d’avoir des comportements complexes : faire de l’élevage, de l’agriculture, s’amuser, prendre du plaisir, se soigner, faire le deuil...

Vues de la zone 4 : Sauvage y es-tu ? © CP
La zone 3, initialement intitulée “Être vivant” à Neuchâtel et dédiée à l’origine et à l’état actuel de la vie, a été transformée à Bruxelles pour mettre plus en avant le concept de domestication et de domination par l’humain. Ah, nos animaux de compagnie ! On ne les considère pas comme sauvages, mais ils conservent des comportements naturels hérités de leurs ancêtres. Peut-être avons-nous domestiqué non seulement les autres animaux, mais aussi nous-mêmes. L'auto-domestication n'est pas une théorie largement acceptée, mais notre apparence, notre comportement et nos gènes pourraient bien pointer dans cette direction. Alors, qui sait, peut-être que nous ne sommes pas si différents de nos fidèles compagnons à quatre pattes !

Vues de la zone 3 © CP
Focus sur la Belgique
Exclusivement consacrée aux animaux belges issus des collections de l’Institut, cette exposition met en lumière la faune locale. L’affiche a d’ailleurs mis à l’honneur le renard roux, en clin d’œil à ces nombreux renards urbains de plus en plus présents dans les jardins de Bruxelles.
L’exposition vise à faire découvrir aux visiteurs la richesse de la faune environnante, souvent réduite dans l'imaginaire collectif aux sangliers, castors et renards en forêts. Pourtant, cette faune réserve des surprises : saviez-vous que des ours bruns ont autrefois vécu en Belgique ? Qu’une tortue marine caouanne s’est échouée sur les plages de la mer du Nord ? Ou bien que des meutes de loups se sont récemment installés dans les forêts de Belgique ?
La zone 5, "Sauvage en boîte", met en avant la diversité de la faune belge et revient sur l'histoire des collections de l’Institut des Sciences naturelles. Un aspect particulièrement intéressant de l'exposition est l'histoire racontée sur chaque spécimen exposé. Lorsque connue, l’origine de chaque animal est relatée sur son cartel. Cette transparence sur la provenance permet aux visiteurs de prendre conscience de la diversité des sources : saisis par la douane, victimes d'accidents de la route, morts de vieillesse au zoo d'Anvers, collectés dans le cadre de recherches scientifiques...etc. Cela donne du sens à chaque spécimen, offrant une seconde vie et permettant d'en apprendre davantage sur leur parcours.
Pour rappeler avec humour que l’humain, tout comme le reste du règne animal, a été beaucoup étudié, le visiteur peut lui aussi se glisser dans une « boîte » sous le cartel d’Homo sapiens.
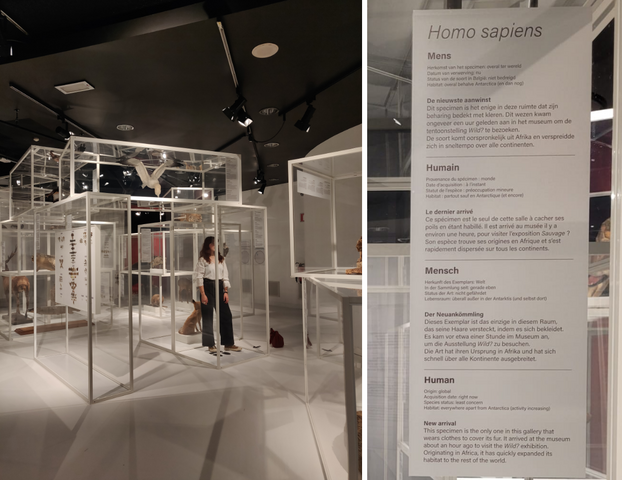
Vues de la zone 5 : Sauvage en boîte © CP
Qui est le plus sauvage ?
Surexploitation, destruction des habitats, espèces invasives, changement climatique et pollution sont toutes des menaces d'origine humaine qui pèsent lourdement sur la biodiversité. La Zone 6 de l’exposition engage le visiteur dans une réflexion sur la responsabilité humaine face à cette crise. Qui est réellement le plus sauvage : les animaux dits "sauvages" ou l'Homo sapiens qui menace leur existence ? Cette question sous-tend toute la zone, incitant le public à se confronter aux conséquences de ses propres actions.
Le dispositif muséographique repose sur cinq compteurs en temps réel et réactualisés tous les matins. Chacun symbolisant une menace directe liée aux activités humaines. Par exemple, un compteur défile, affichant en temps réel le nombre de kilos de plastiques déversés dans nos océans depuis 10h ce matin. Ces chiffres, qui ne cessent de grimper, sont un rappel brutal de l’impact humain. Les visiteurs ne peuvent rester indifférents face à cette matérialisation des menaces.
L'installation frappe par son approche immersive, teintée d'une inquiétante couleur rouge, évoquant des signaux d'alarme. Elle met en lumière la disproportion entre la lenteur de la nature à se régénérer et la rapidité avec laquelle l’être humain la détruit. L'humain pourrait-il un jour devenir aussi menacé qu'il est menaçant ?

Vue de la zone 6 : Sauve qui peut ! © CP
Cohabiter
La dernière salle "Nature chérie" a complètement été revue car elle n’avait pas très bien fonctionné à Neuchâtel. Cependant, son approche introspective reste inchangée. Dans la continuité de la zone 6, cette dernière salle cherche à pousser l’introspection plus loin autour de ces réflexions : Quelle est ma place dans ce monde vivant ? Que suis-je prêt à faire pour respecter les autres êtres vivants ?
L’installation muséographique utilise deux dispositifs pour renforcer cette connexion. Tout d'abord, des caméras animalières placées dans différents environnements en Belgique (forêts, villes, jardins publics et privés) capturent des scènes de vie sauvage, projetées sur deux écrans géants.
En s’immergeant dans ces images non éditées, le visiteur peut, s'il prend le temps, découvrir la nature telle qu'elle est. Pas besoin de parcourir des kilomètres pour l’observer, la nature sauvage se situe sous nos yeux, il suffit de bien regarder...

Vue de la zone 7 : Nature chérie © CP
Le second dispositif invite le visiteur à l'empathie à travers des téléphones fixés aux murs. Lorsqu'on décroche, des messages vocaux d'animaux en détresse se font entendre via une messagerie intitulée "SOS Nature", imitant un service téléphonique d'urgence. Ces animaux humanisés par des voix de comédiens demandent de l’aide face aux accidents de la vie quotidienne. Ils partagent leurs difficultés pour survivre qui nous rappelle que leur survie dépend directement de nos actions. Le visiteur y entend des oiseaux paniqués par la destruction de leur nid, des hérissons se noyant dans une piscine, ou encore des canards souffrant d'avoir ingéré trop de pain. Ce dispositif incite à un engagement personnel des visiteurs pour protéger les espèces qui les entourent.
Le visiteur sera-t-il prêt à s’investir pour écouter et voir cette nature en détresse ?

Dispositif SOS Nature © CP
La fin de l'exposition cherche à toucher les visiteurs au cœur, les invitant à rétablir un lien essentiel avec le monde vivant qui les entoure. Cette expérience immersive, à la fois visuelle et émotionnelle, vise à éveiller une curiosité durable et une envie d’agir pour la biodiversité.
Tous sauvages !
Camille Paris
#NatureSauvage
#Biodiversité
#Belgique
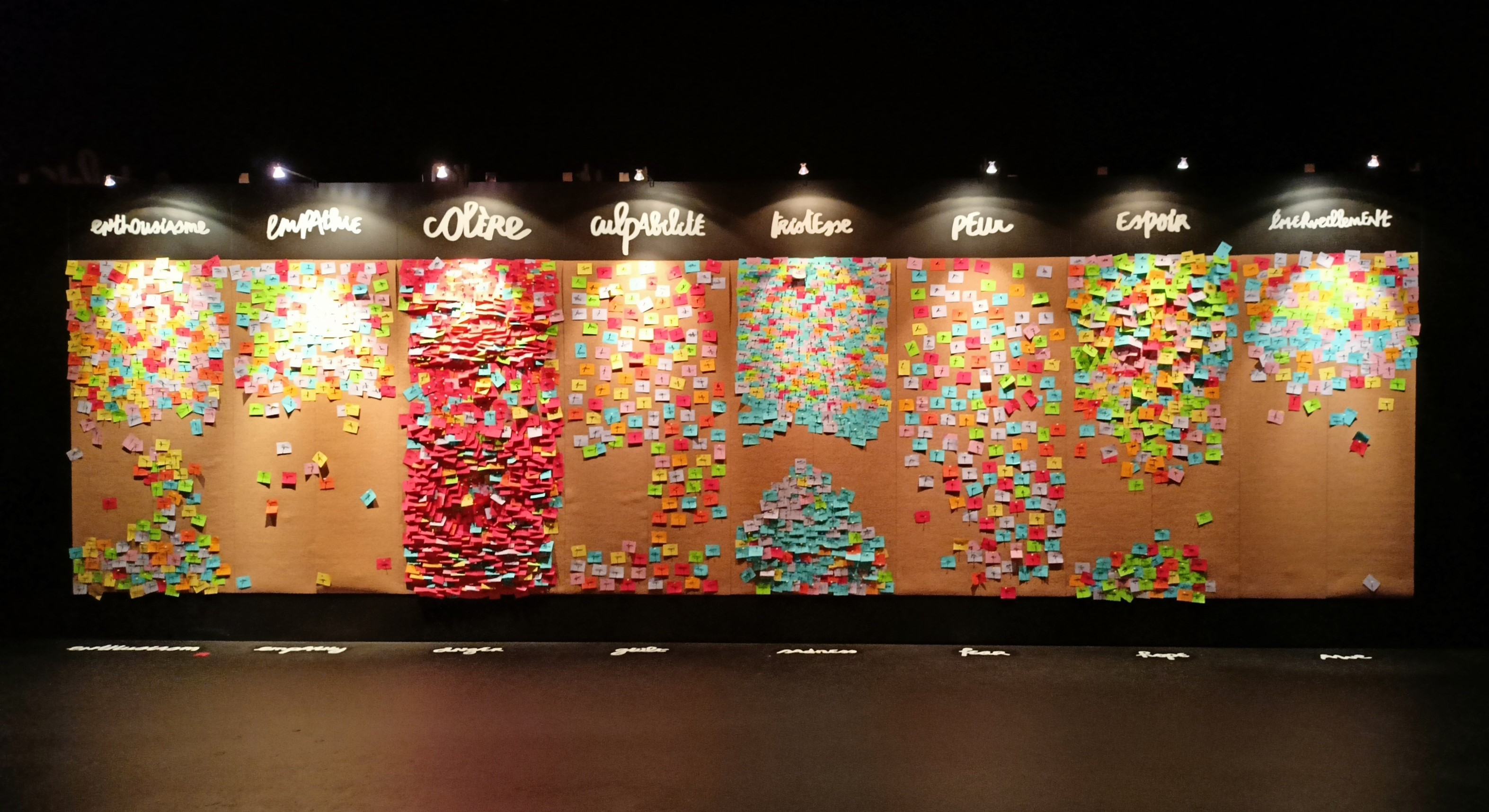
Tout contre la Terre ou tous contre la Terre ?
Angoissée par le dérèglement climatique, c’est à reculons que j’ai visité l’exposition Tout contre la Terre du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève. A quoi bon une énième exposition angoissante et culpabilisante sur le réchauffement climatique ? Pourtant, ce titre, Tout contre la Terre, a piqué ma curiosité.
Image d'intro : Mur des émotions de l’exposition Tout contre la Terre au MHN de Genève ©M.T
Tout contre la Terre ou tous contre la Terre ?
Tout contre, en contact direct, juste à côté, ne laissant aucun écart avec quelque chose. Tout contre toi, une expression pleine de tendresse et de bienveillance.
Tout contre la Terre, qui nous héberge, nous nourrit, nous l’aimons en retour. Et pourtant, à l’aube de la sixième extinction de masse, nous sommes tous contre la Terre. Le Muséum d’Histoire naturelle de Genève tente, à travers cette exposition, de nous faire prendre conscience de la nécessité d’avoir une relation respectueuse et bénéfique avec la Terre. Comment ?
Les équipes du muséum ont réfléchi à cette question. Ne voulant pas faire une énième exposition angoissante et culpabilisante sur le réchauffement climatique, ils se sont penchés sur nos émotions.
Depuis longtemps nos émotions sont mises en confrontation avec la pensée rationnelle, or d’après les recherches menées pour l’exposition, nous avons besoin de ces dernières pour bien fonctionner. Nos émotions nous montrent ce qu’il y a d’important dans nos vies, elles influencent nos décisions. Dans une crise environnementale, quelles sont les bonnes émotions à avoir ? De la peur à l’éco-anxiété et de la colère à l’agressivité.
La visite commence dans le hall par des chiffres clés sur “la grande accélération”. Des graphiques et des data donnent les clés de compréhension sur l’Anthropocène, les développements socio-économiques et leurs conséquences sur la biodiversité. Après cet état des lieux sommaire, les artistes qui ont collaboré avec le Muséum, sont présentés : 1011, Fabian Branas, Patrick Chappatte, Aline Kundig, Alessandro Pignocchi, Gabriel Ruta et Maëva Schito.
L’accès à ce hall est gratuit afin que tout le monde puisse avoir accès aux connaissances gratuitement, j’apprécie l’initiative.
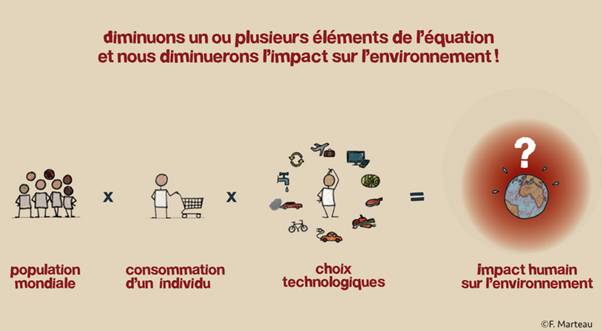
Graphique présenté dans le hall de l’exposition Tout contre la Terre ©F. Marteau
How dare you ?
L’exposition, en deux grandes séquences, débute en nous rappelant les dérèglements environnementaux illustrés par les collections du muséum et interrogés par les œuvres des artistes. Cette séquence est une succession de claques scientifiques. La première salle est sombre et une bande son diffuse des bruits d’orage et autour de nous sont exposées les limites planétaires. Des lumières clignotantes vertes, oranges et rouges nous montrent le degré de gravité de l’érosion de la biodiversité, de l’acidification des océans ou encore la pollution chimique. Ce début très brutal est un choix afin d’écarter tout climatoscepticisme. Mais la brutalité ne s’arrête pas là, le visiteur est invité à écouter le très célèbre discours de Greta Thunberg en 2019 aux Nations Unies. La phrase “How dare you” restera ancrée dans votre cerveau jusqu’à la fin de l’exposition.
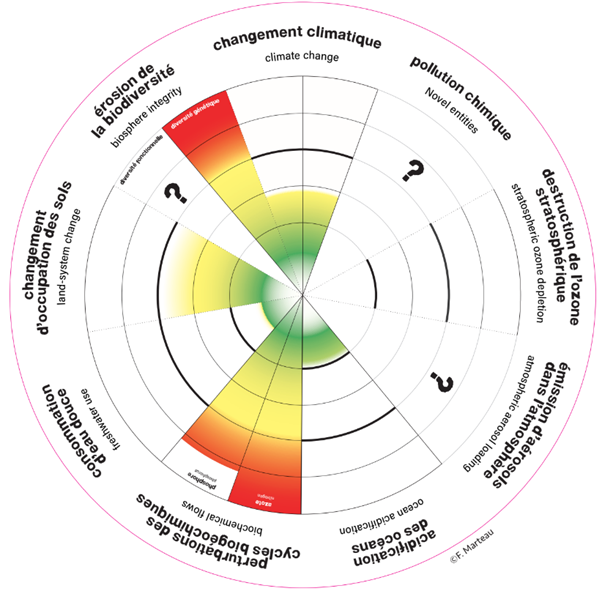
Graphique des limites planétaires ©F. Marteau
La visite se poursuit avec 4 alcôves à la suite, présentant les comportements toxiques de l’humain sur l’environnement et les solutions possibles. Pour appuyer la toxicité de l’humain, des planches de bandes-dessinées nous accompagnent jusqu’à la fin de l’exposition. Ce fil rouge est un dialogue entre un Petit rhinolophe et une Pie-grièche écorcheur qui montre le bouleversement de la vie des animaux.
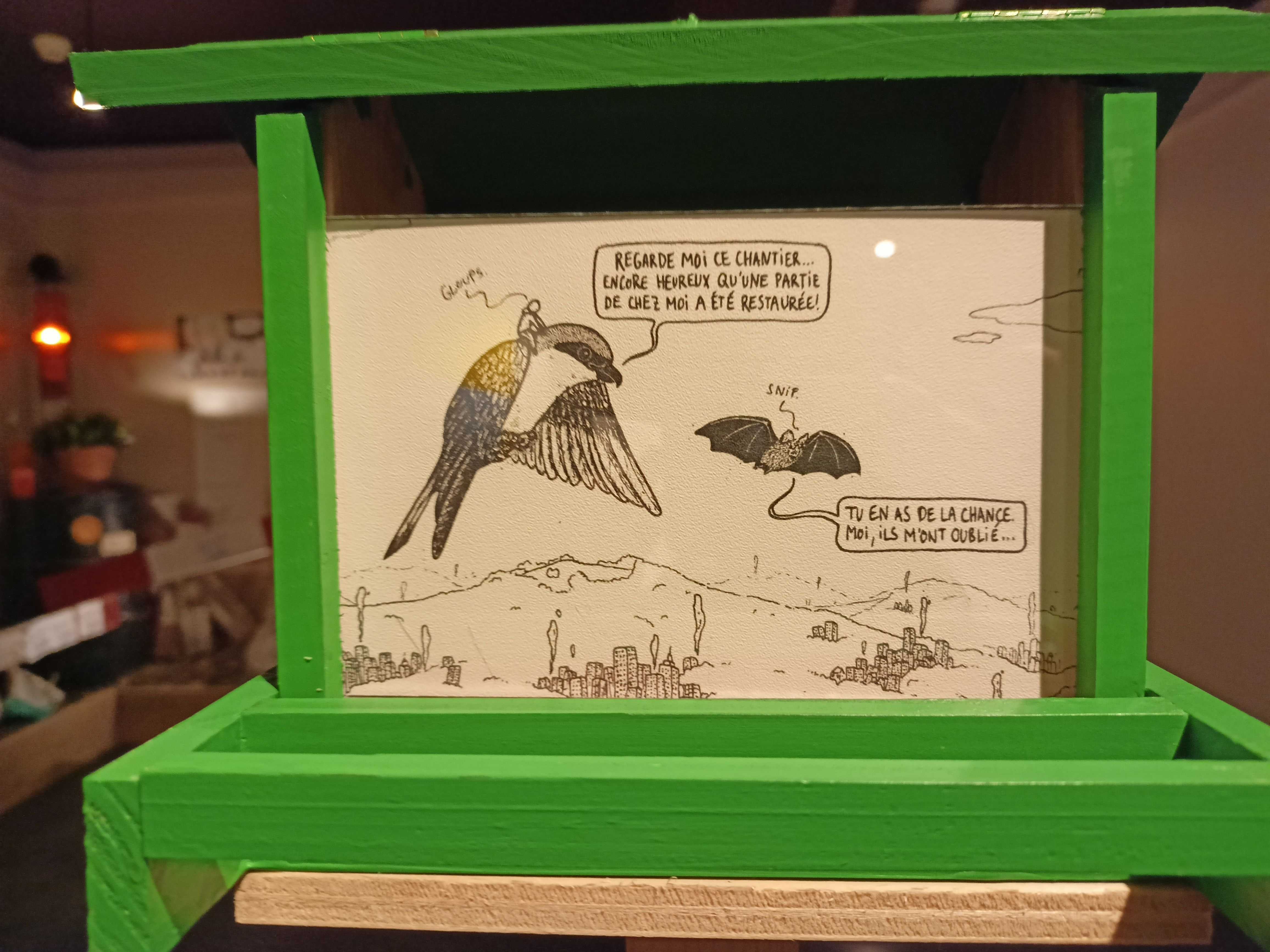
Bande-dessinée de F. Branas, dialogue entre un Petit rhinolophe et une Pie-grièche écorcheur ©M.T
Même si l’exposition se veut pleine d’espoir, certaines scénographies font l’effet d’un électrochoc. Il est difficile de se représenter les 3400 animaux inscrits sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction critique. L’artiste Gabriel Ruta, dans son projet 2635 Un plaidoyer pour nos frères, s’est donné la mission de tous les représenter. Ses œuvres sont exposées dans une petite pièce à l’esthétique d’un cimetière. Ainsi scénographié, le projet 2635 est un hommage à ces animaux qui vont disparaître si nous ne faisons rien.
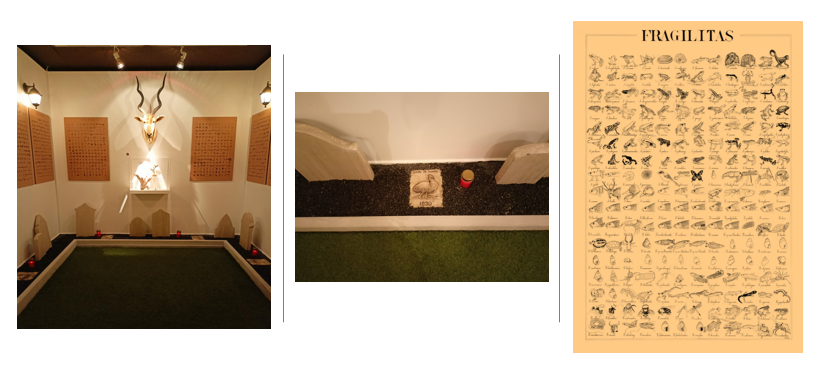
Salle du projet 2635 Un plaidoyer pour nos frères de Gabriel Ruta ©M.T ; projet 2635 ©GabrielRuta
La forêt des mots
Comment exposer des émotions ? Le Muséum a trouvé une solution : écrire les mots, écrire une forêt de mots pour nous confronter à nos émotions. Au milieu de cette forêt, une clairière est là pour éclairer la place et le rôle des émotions dans cette crise environnementale. Et nos émotions influencent nos décisions. Preuve en est que nos émotions positives peuvent mener à des actions durables : le “Warm glow” est ce sentiment chaleureux que nous ressentons après un comportement prosocial. Aussi, les bonnes actions entraînent plus de bonnes actions, et la conséquence sont des comportements plus durables. Cette deuxième et dernière séquence va nous aider à trouver et comprendre nos émotions.
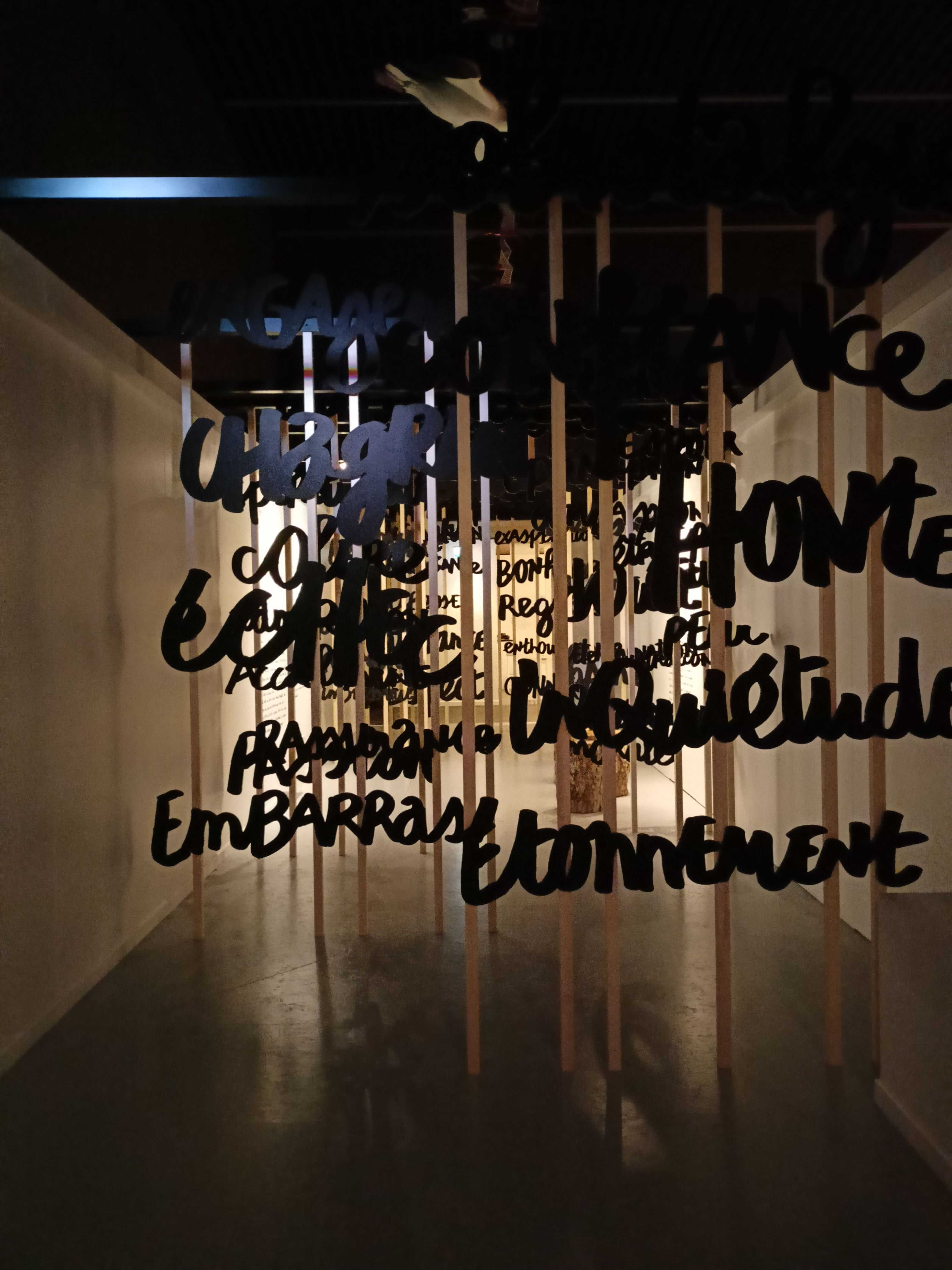
La forêt des mots ©M.T
Et demain ?
Après avoir compris que les émotions peuvent être un allié contre le dérèglement climatique, le visiteur est amené à écouter le philosophe Dominique Bourg qui analyse la situation et donne des pistes de réflexions. Ses paroles sont illustrées par les dessins de Alessandro Pignocchi.

Dessin de Alessandro Pignocchi ©A. Pignocchi
Pour terminer l’exposition, le visiteur se questionne sur ses propres émotions face à la crise écologique. Il est invité à observer la roue des émotions et trouver celle qui lui correspond face à la crise. Une fois trouvée, il la note sur un papier et la glisse dans le “ventre de la Terre”. Pour ma part, j’y ai inscrit deux mots : Culpabilité et espoir. Grâce à l’exposition j’ai gagné en espoir mais je n’ai malheureusement pas perdu en culpabilité.

Salle de la roue des émotions ©M.T
A la sortie de l’exposition se trouve un grand mur rempli de post-it, toutes les émotions des visiteurs y sont collées.
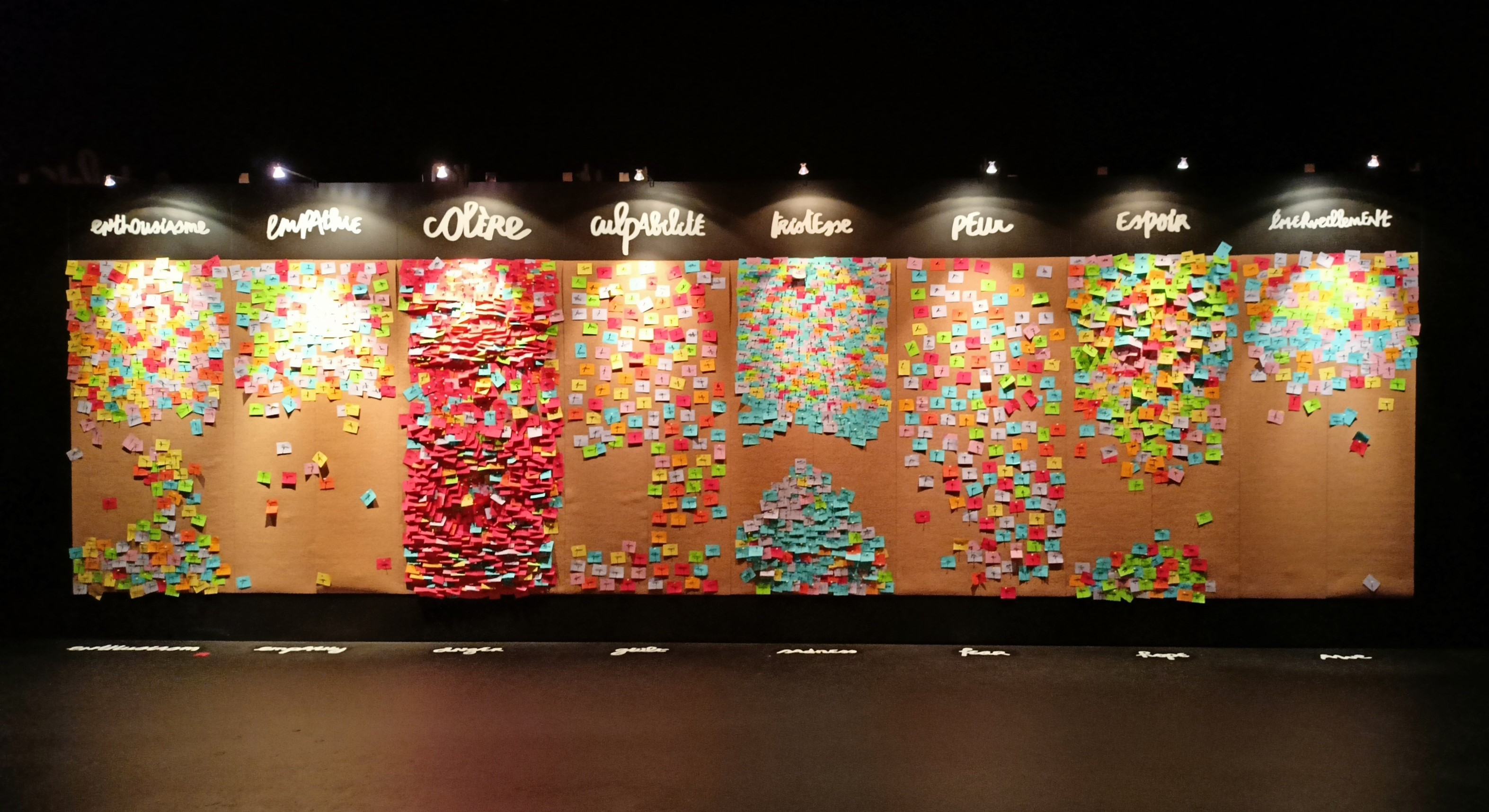
Mur des émotions ©M.T
Alors, à quoi bon une énième exposition angoissante et culpabilisante sur le réchauffement climatique ? Tout contre la Terre est une exposition grand public et pédagogique. La scénographie y est d’abord brutale puis douce et calme. Chercheurs et artistes s’unissent pour nous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Oui c’est une exposition angoissante sur le réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique est angoissant. Mais nos émotions peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions et changer le cours des choses.
Je ne suis pas la seule à avoir été bouleversée : à la fin de l’exposition, ceux qui le souhaitent peuvent participer au podcast Tout contre la Terre. A écouter, pour ses interventions sincères et poignantes. Mais vous pouvez aussi vous y rendre, l’exposition se termine le 25 juin 2023.
Mélanie TERRIÈRE
Pour aller plus loin :
- Le site internet de l’exposition Tout contre la Terre du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève
- Le Podcast Tout contre la Terre
#dérèglementclimatique #emotion #exposition

Un comité scientifique 007
En direct de la Cité des sciences et de l'Industrie à proximité d'un parc considérable et plein de Folies, je suis en mission spéciale pendant 4 mois accompagnées d'As1trid A. et Ma13ud G. Par chance, une coéquipière est venue en renfort, A15naïs spécialisée dans l'Histoire et la philosophie des sciences.
Campagnol (un compagnon fidèle ?) © Site internet Vue des collines
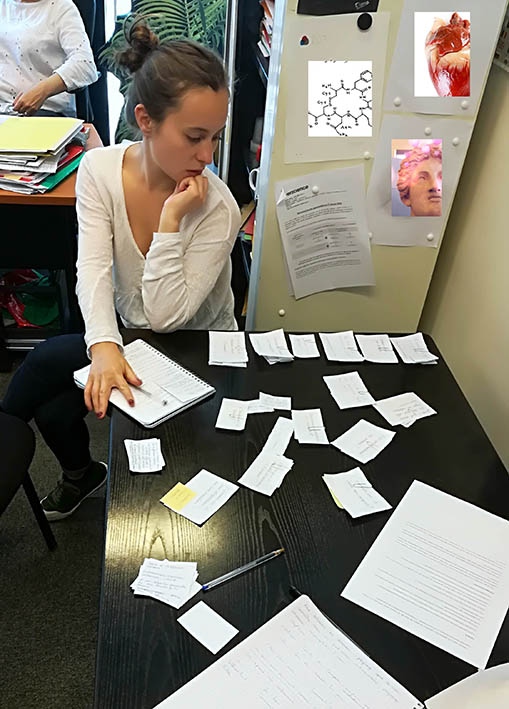
Séance de réflexion avec post-its © Charlène C.

QG © Charlène C.
1 13 15 21 18
15 3 25 20 15 3 9 14 5
19 5 3 18 5 20
cœur,
#Comitéscientifique
#Spécialistes
#Amour

Un panorama sans horizon
D’extérieur, le Panorama XXL de Rouen peut interroger. Quel est donc ce cylindre bleu vif de trente mètres de haut ? Posté sur les quais de la Seine, il peut surprendre et se confond avec les clochers d’églises ou de la cathédrale. Implanté depuis 2014, il est ancré dans le paysage, certains Rouennais l’oublient, y sont habitués. Pour d’autres, sacrilège !
Depuis longtemps, les quais de Rouen ont été un lieu prisé par les artistes, et en particulier par les peintres. Pissarro, Corot, Monet, entre autres, ont tiré de la Seine des œuvres mémorables...Il n’était donc pas surprenant de voir une fois encore l’art prendre ses quartiers sur ces quais de Seine.
Le Panorama XXL de Rouen est un lieu d’exposition temporaire pour accueillir les œuvres de l’artiste Yadegar Asisi, d’abord prévu pour 5 ans, le projet a été prolongé de 2 ans. Certaines personnes l’ayant toujours connu dans le paysage indiquent qu’ils n’imaginent pas la ville sans son Panorama. Ce dernier a amené de vives réactions. Des pétitions ont circulé dans la ville pour la destruction ou le déplacement du panorama, prenant comme arguments son coût financier et l’aspect peu esthétique du lieu.
Image de couveture : Panorama XXL de Rouen © Jeandavid Blaise
L’artiste à l’origine du Panorama XXL à Rouen est Yadegar Asisi. Autrichien, il est architecte et diplômé de peinture de l’Académie des Arts de Berlin où il vit. Dans son art, l’artiste aime utiliser les nouvelles technologies et créer en mélangeant les styles. Couleurs, pigments et perspective sont au cœur de ses œuvres. C’est en 2003 qu’il commence à créer ses panoramas, d’abord exposé en Allemagne, à Leipzig, Dresde et Berlin, il expose à Rouen depuis 2014.
Mais le panorama XXL ce sont aussi des recherches scientifiques et méticuleuses. Pour créer ses toiles, Asisi effectue un long travail de recherches en se rendant sur place où il réalise des séances photos dans le décor envisagé pour son œuvre future (en Amazonie, sur le mont Everest, ou en Australie par exemple). Il essaie absolument de recréer la réalité avec des détails historiques, architecturaux. Entouré de son équipe de 15 assistants il retravaille ses images sur ordinateur avant l’impression sur les toiles qui mesurent 3000 mètres carrés.
Si les panoramas de Yadegar Asisi sont une innovation par leur technique mêlant art, technologie et science, ceux-ci sont loin d’être les premiers dans l’histoire. Ce genre artistique était incontournable au XIXe siècle. C’est le peintre Robert Barker qui, en 1787, peignit un grand tableau circulaire, exposé dans une rotonde, créant ainsi le premier panorama. Les premiers sont exposés en Ecosse. Les thèmes sont variés. En France, les panoramas apparaissent vers 1800 à Paris, à l’initiative de James Thayer un armateur américain. Les rotondes présentent des vues de Paris, ou bien l’évacuation de Toulon par les Anglais en 1793.
Avant d’entrer véritablement dans l’œuvre, le visiteur a une courte exposition sur ce qu’il va découvrir. Des clés de compréhension sur le processus de création de l’artiste, de la technique. Pour la dernière exposition, « La cathédrale de Monet, l’espoir de la modernité » représentant la place de la Cathédrale au moment où Claude Monet l’a peinte, la première salle d’exposition se consacre à un bref historique du mouvement impressionniste, à Claude Monet et sa série Cathédrales. Le visiteur découvre ensuite des témoignages audios et vidéos de Yadegar Asisi pendant la réalisation des toiles, le travail avec son équipe ainsi que des esquisses.
Ces salles précédent l’immersion véritable permettent aux visiteurs de connaître le contexte général, puis de se consacrer pleinement au panorama, d’admirer simplement l’œuvre sans se poser de question. Il n’y a à l’intérieur aucun cartel, aucune explication. Libre, le visiteur peut s’approcher au plus près de l’œuvre, il se demande souvent si c’est une photographie ou une peinture tant les détails sont précis.
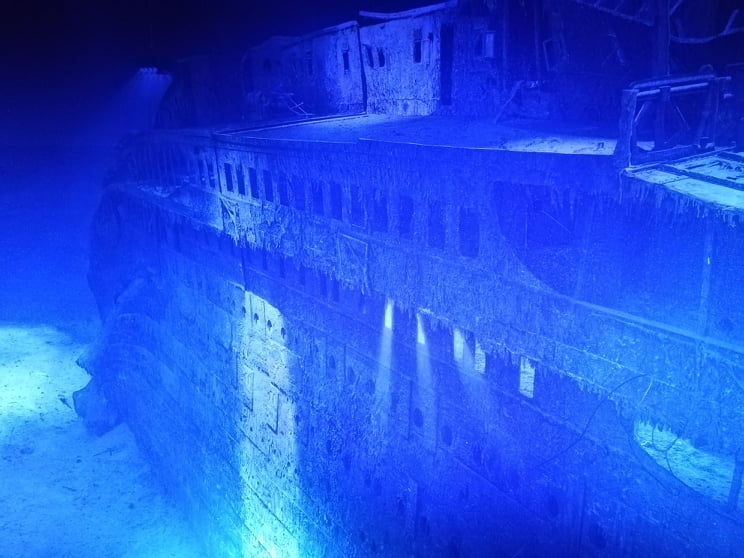
Intérieur du Panorama pendant l'exposition "Titanic les promesses de la modernité", 2020 © Alexia Thieriot
La médiation est très intéressante, avec du son et de l’image, le visiteur rentre à plusieurs niveaux dans l’œuvre, et le dispositif offre des vues globales à 360°. Les sujets abordés sont divers, c’est une des richesses du lieu. Pour les paysages naturels comme l’Amazonie par exemple, la lumière baisse en fonction du jour et de la nuit et le bruit change en même temps. La nature se réveille, accompagnée du bruit des animaux, du vent, des plantes, cela permet d’entrer dans la forêt et de se fondre dans le décor. La conception même de l’exposition amène des sensations physiques de hauteur, de vertige et de profondeur de champ : dans l’Amazonie la visite se déroule du sol à la canopée, au Moyen-Age on passe des rues pavées à l’aiguille de la cathédrale au fur et à mesure où l’on monte les étages de la tour centrale.
Il y a eu deux sujets spécialement sur la ville de Rouen, une volonté de l’artiste de « participer à l’identité de la ville », de la connaître différemment. C'est une vision nouvelle sur cette ville d'art et d'histoire. Monet devant « sa » cathédrale, et Jeanne d'Arc partant au bûcher interpellent le visiteur de manière très intime partageant leur fascination ou leur abnégation.

L'intérieur du Panorama pendant l'exposition "La Cathédrale de Monet, l'espoir de la modernité", septembre 2021 © Jeandavid Blaise
L’aventure du panorama a pris fin le 18 septembre dernier, déjà renouveler pour deux ans, la ville n’était plus en mesure de financer l’installation. Il est actuellement en train d’être démonter et ses matériaux devraient être entièrement recyclés.

Démontage du Panorama XXL sur les quais de Rouen, octobre 2021 © Alexia Thieriot
Marion Blaise
Pour en savoir plus :
https://www.asisi.de/en/homepage
#toile #numérique #expérience

Valoriser les artisans dans le milieu muséal
Celles et ceux exerçant des métiers artisanaux portent sur eux le poids de représentations négatives parfois lourdes. La vision binaire des professions dites intellectuelles et manuelles semble toujours bien ancrée en France. La séparation de la pensée et du faire est le résultat d’une longue histoire et du croisement de pensées occidentales passées. Des individus en payent aujourd’hui le prix fort, celui de la croyance que l’artisan exerce un métier purement empirique, et qu’il ne fait pas usage de sa réflexion et de son intelligence.

Édition originale de l’Encyclopédie, 1753, Planches tome III, Pl. I., Coutelier © 2016 Mazarinum - Les collections numériques
de la Bibliothèque Mazarine
Le rôle des musées sur la représentation des métiers artisanaux
Les métiers d’artisans : tous assez beaux pour être exposés ?


« Balenciaga, l’œuvre au noir » à l’atelier-musée Bourdelle, 2017 © CD

« Archéologie d’une ville romaine, Ratatium » au Chronographe à Nantes, 2020 © CD

Musée du 11 Conti à la Monnaie de Paris, 2018 © CD

Ateliers de fabrication de la monnaie visible depuis l’exposition du Musée du 11 Conti à la Monnaie de Paris, 2018 © CD
Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec

Exposition permanente du Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ) © BY-SA 3.0
Des expositions sur l’intelligence des métiers manuels, est-ce que ça existe ?

« Des mains pour penser », Musée des arts et métiers traditionnels, Salles-la-Source 2017 © Photothèque Conseil départemental de l’Aveyron
Pour aller plus loin :
« Tempêtes sur les représentations du travail », Laurence Decréau, 2018
« Une pédagogie par l’objet », Histoire du Cnam : https://www.arts-et-metiers.net/musee/une-pedagogie-par-lobjet

Venice Time Machine
C’est lors du mon aventure Muséomix à Lausanne que j’ai découvert l’immense laboratoire de fabrication présent sur le campus de l’université EPFL. Oui, un FabLab à Muséomix !
Scénographie lumière de l’exposition Venice Time Machine © EPFL
C’est lors du mon aventure Muséomix à Lausanne que j’ai découvert l’immense laboratoire de fabrication présent sur le campus de l’université EPFL. Oui, un FabLab à Muséomix ! Pourquoi est-ce que ce lieu a-t-il participé à un événement initialement destiné aux musées ? L’Art Lab est un lieu d’innovation qui se confronte également aux problématiques muséographiques puisqu’il met en place un certain nombre d’expositions temporaires.
Cet espace se définit comme un lieu entre art et sciences. L’exposition Venice Time Machine, montée par les chercheurs et historiens de l’université, en collaboration avec le FabLab est une réelle machine à remonter le temps dans l’histoire de Venise. L’université détient un nombre incalculable de numérisations d’archives sur la ville de Venise et elle a souhaité les présenter au public.
En apparence, le concept semble ne présenter aucun défaut. Cette simulation interactive reconstruit le passé de la ville par le biais de différentes techniques de visualisation telles que des cartes interactives en trois dimensions mais également des mises en scène muséographiques. Les moyens investis dans ce projet sont considérables. Au delà de l’aspect financier qui permet de se doter d’une masse de technologies nouvelles utilisées dans l’exposition, le travail en amont a été très important.Il se poursuit d’ailleurs aujourd’hui puisque les chercheurs ne cessent de dépouiller ces archives pour en découvrir le contenu.
Ce programme ambitieux a d’ailleurs fait l’objet d’une numérisation de ces archives, de mesure de conservation mais aussi d’organisation de cette grande masse de données. Le projet, lancé en 2013, semble aujourd’hui abouti en terme de muséographie et de scénographie. En pénétrant dans la salle d’exposition, la grande table centrale provoque un premier effet, on y découvre notamment un ensemble de témoignages de chercheurs, c’est derniers se retrouvent projetés sur les écrans apposés aux murs. Leurs visages semblent flotter au milieu d’une modélisation d’un réseau de la ville. Une atmosphère sombre mais ponctuée de faisceaux lumineux plonge le visiteur dans un espace proche de la fiction.
Venice Time Machine © EPFL
L’effet visuel est donc bien présent, mais l’ArtLab souhaite élargir son panel de visiteurs, qui est aujourd’hui trop cantonné au étudiants et chercheurs. C’est pour cette raison qu’a été mis à profit l’événement Muséomix pour repenser l’exposition. Le fond d’archives n’est pas accessible à tous de par son caractère très scientifique. Cet aspect limite réellement la compréhension du visiteur. Il s’agit également de rendre compte de la masse de données que l’université a en sa possession et qu’elle n’a d’ailleurs pas fini d’explorer.
L’équipe de museomixeurs formée de six personnes aux disciplines très différentes a dû imaginer un prototype répondant à ces enjeux. Mais comment rendre compte de la recherche scientifique tout en imaginant une interactivité qui faciliterait la compréhension du visiteur.
Après trois jours de dur labeur le projet naissant a vu le jour et s’est d’ailleurs confronté à l’avis d’un groupe d’experts et de visiteurs.
Énigmes du dispositif « La vérité est ailleurs » © A. E.
Le dispositif « La vérité est ailleurs » donne à voir la complexité de la recherche historique, mais offre également la possibilité de composer des récits singuliers, des tranches de vie de personnes réelles à partir des documents historiques. Il propose une découverte immersive et concrète dans l'histoire de Venise et de ses habitants à destination d'un public non averti.
Sous la forme d’un jeu, le visiteur se voit donner des consignes : “Retrouve Andrea qui a disparu, au travers d’un certain nombre d’énigmes et ce dans un temps limité; si tu relèves le défi, tu pourras repartir avec une copie de cette très belle bague”.
Le joueur incarne l'enquêteur, comme un chercheur qui fait des recherches historiques. Mais c'est un enquêteur ultra-connecté, qui s'appuie sur les données/datas produites parle projet, et qui sont une ressource dans laquelle puiser. Le jeu repose sur la géolocalisation de données, modélisées sur un fond de cartes existant, datant de 1808. Au fur et à mesure que le public progresse dans la résolution des énigmes, la maquette se modifie par un jeu de lumières : d’une mise en lumière totale au début, signifiant la présence d’Andrea quelque part dans Venise, puis la focale se resserre autour de lieux à l’activité d’Andrea. La spatialité de la ville rejoint celle de ses usages : où sont les marchands et lieux de commerce ? Où exerce-t-on le pouvoir ? Comment la vie économique, sociale est-elle organisée ?
Le jeu vise à amener le visiteur à se questionner : à quoi servent les données ? à chercher des indices, mais il faut les trier pour savoir où chercher… Quelles masses de données sont nécessaires pour obtenir les résultats demandés par les cinq énigmes ? Comment les chercher ? Les croiser ? Seraient-elles partielles, lacunaires, trompeuses ?
Ce dispositif ludique associe un jeu et une maquette interactive de la Sérénissime. Une application sur tablette propose une enquête et une exploration de la Cité des Doges au début du XIXème siècle. Une série de six énigmes successives nous mène sur la trace de l’orfèvre insaisissable qu’est Andrea. Quelques objets connectés et fac-similés ponctuent le parcours, unissant data impalpables et traces concrètes du passé.
Un dispositif conclusif vient donner une idée du volume global des données du Venice time project et celles qui ont été mobilisées pour mener cette enquête. C’est une invitation à aller plus loin dans la recherche.
Ainsi, les spécialistes mais également les visiteurs se prêtent au jeu malgré les dysfonctionnements du prototype par moments. Ils partagent leur expérience en revenant sur l’intrigue de l’énigme et ressortent avec la satisfaction d’avoir incarné le rôle d’un chercheur ou d’un historien le temps d’une visite. En prime, ils repartent avec la bague de l’orfèvre imprimée en 3D, ainsi qu’un passeport de l’enquêteur !
Ce dispositif a su déjouer l’aspect scientifique du fond d’archives tout en créant un lien direct entre le visiteur et ces données.
Anna Erard
#VeniceTimeMachine
#80kmdata
#EPFL
#ArtLaB
#museomixch2017
Pour en savoir plus :
http://www.museomix.org/editions/2017/lausanne
https://actu.epfl.ch/news/venice-time-machine-la-cite-des-doges-modelisee/
Voyage au coeur de la biodiversité marine
L'Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée, dans le XIIè arrondissement de Paris, vous invite à un voyage au cœur de la biodiversité marine de l'Île de la Réunion du 8 novembre 2013 au 15 juin 2014. Cet aquarium a un partenariat de longue date avec l'Île de la Réunion.
Précédemment, il a accueilli l'exposition Biolave (un projet scientifique). Intitulée « Sous l'océan, la vie secrète d'un volcan », cette dernière était consacrée à la découverte des nouvelles espèces marines vivant sur les pentes du volcan du Piton de la Fournaise à l'Île de La Réunion.
En outre, depuis 2010, Sciences Réunion, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Île de la Réunion (C.C.S.T.I), souhaite mettre en valeur la biodiversité marine de cette île volcanique. Ce travail de vulgarisation a d'abord été mis en place à travers une première exposition « Regards sous la mer » présentée sur place. Lors d'une deuxième initiative, Sciences Réunion a souhaité exposer « Biodiversité marine » à l'Aquarium tropical de Paris. D'envergure nationale, cette exposition a fait escale à Marseille, au Palais des Congrès du parc Chanot, dans le cadre du 40e Festival Mondial de l'Image Sous-marine, entre le 31 octobre et le 3 novembre 2013, avant de rejoindre Paris. Cette exposition temporaire, sur panneaux, retrace les différentes actions réalisées par Sciences Réunion.
Exposer la « Biodiversité marine », pourquoi ?
L'exposition a été réalisée sous la direction de Pascale Chabanet, chargée de recherche en écologie des récifs coralliens à l’Institut de Recherche pour le Développement à l'Île de la Réunion.
Divisée en cinq grandes parties, l'exposition interpelle le visiteur sur la fragilité de notre monde et plus particulièrement de l'Océan Indien. Tout au long du parcours, ce C.C.S.T.I souhaite sensibiliser l'individu à la nécessité de protéger ces écosystèmes particuliers occupant une place stratégique dans la préservation de la biodiversité marine globale. Suivons ce parcours dont nous mettons en évidence le didactisme et l’engagement.
©Aquarium tropical
La biodiversité menacée, un constat alarmant
La première partie de l'exposition est une introduction qui permet de définir la biodiversité : elle représente la diversité des milieux de vie (zone sableuse, zone rocheuse), des espèces (petites, grandes, de couleur sombre ou éclatante) et des individus d'une même espèce. A une échelle plus large, les êtres vivants, leur milieu et les interactions qui les unissent constituent un écosystème mais cet écosystème est en danger.
Aux définitions s'ajoutent des chiffres qui permettent d'illustrer la menace qui pèse sur la biodiversité. Ils renseignent le visiteur sur le nombre d'espèces marines qui disparaissent chaque année : « 27000 espèces animales et végétales seraient, chaque année, amenées à disparaître, soit 74 espèces par jour ou 3 espèces par heure » selon Edward O.Wilson(1993) et montrent l'état d'urgence de la situation. Avec ces chiffres choquants, l'exposition veut démontrer l'accélération du taux d'extinction des espèces.
Les écosystèmes de l'Océan Indien, sources de vie

©Sciences Réunion
Pour appuyer son propos, la commissaire de cette exposition dresse un panorama des différents et divers écosystèmes de l'Océan Indien. Prenons pour exemple les mangroves. Ce sont des forêts dont les arbres baignent dans l'eau mais cet écosystème est menacé par les constructions humaines qui cherchent à gagner de l'espace sur la mer et les côtes. Pourtant ce milieu marin est essentiel car il procure des ressources forestières et halieutiques pour les populations vivant sur les côtes mais est aussi un point d'alimentation pour certaines espèces tel que le héron. Le visiteur peut donc se rendre compte de l'importance de protéger chaque écosystème du milieu marin.
La vie sous l'Océan
De nombreuses espèces en tout genre peuplent le milieu marin. Certaines sont toutefois inconnues du public tels que le corail choux-fleur, la vieille ananas, le crabe trapèze ou encore la danseuse espagnole. Un aquarium, dans l'exposition, permet au visiteur d'observer différentes espèces marines, plus ou moins connues.
Invisible à l'œil nu mais remplissant l'océan, les œufs et larves de poissons forment le plancton. Ce-dernier est indispensable au repas des plus gros animaux qui rôdent dans l'océan marin tels les baleines et les dauphins. Venez aussi découvrir le plancton végétal qui joue un rôle important dans notre quotidien puisqu'il produit près des deux tiers de l'oxygène atmosphérique et qu'il absorbe le C0² dissout dans les eaux océaniques. Sciences Réunion accompagne le visiteur dans la compréhension de cet enjeu crucial.
Les liens du vivant
L'exposition montre ensuite les liens entre chaque espèce marine. Toutes les espèces vivantes ont leur place dans cet équilibre fragile des océans et dépendent les unes des autres. Le visiteur peut observer un schéma du réseau alimentaire qui montre toutes les espèces essentielles à ce réseau avec l'Homme comme consommateur final. Les espèces sont irremplaçables car si l'un des maillons venait à manquer, les espèces qui s'en nourrissent disparaîtraient et le réseau en serait perturbé.
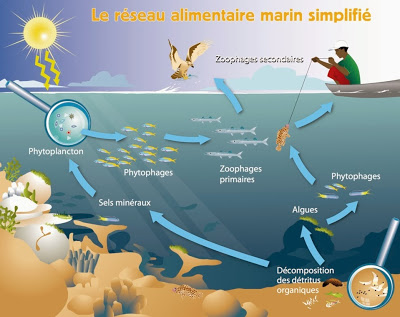
©Sciences Réunion
Devenir un écocitoyen ?
Pour terminer cette excursion au cœur de la biodiversité, l'exposition met en avant les nombreuses agressions de la biodiversité marine que fait subir l’homme. Les principales agressions sont liées aux activités humaines tels que la surpêche, le rejet de produits polluants et de millions de tonnes de déchets, ou dans le secteur tertiaire, le tourisme de masse et les activités nautiques.
L'exposition donne ainsi au visiteur les clés pour comprendre les enjeux de protection de l'environnement et pour agir en lui proposant des méthodes toutes simples comme ne pas jeter des ordures sur la place pour éviter de les retrouver dans l'eau ou comme signer des pétitions contre la pêche illégale qui menace les espèces menacées (le requin ou le thon rouge).
Si vous aussi vous voulez protéger la biodiversité marine et devenir un écocitoyen, n'hésitez pas à aller voir cette exposition pour avoir des pistes de réflexion et agir contre les menaces qui pèsent sur cet environnement envoutant et magnifique mais si fragile !
Ludivine Perard
Pour les curieux, un ouvrage sur les différentes actions de Sciences Réunion a été édité :
« Île de La Réunion – Biodiversité marine », Éditions Orphie, 2013, 112 pages.
#Biodiversité
#OcéanIndien
#Protection
Informations pratiques ;
Ouverture du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le week-end de 10h00 à 19h00.
Le tarif est de 5 euros et de 3,50 euros pour le tarif réduit.
Adresse :
Établissement public du Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical
293 avenue Daumesnil
75012 Parisienne
Téléphone : 01.53.59.58.60.

Wellcome Collection : La rencontre audacieuse entre la science et l’art, un musée qui éveille la curiosité
Imaginez un musée qui ambitionne d’explorer les liens entre la science, la médecine, la vie et l'art. Un musée qui vous invite à réfléchir sur les grandes questions qui touchent notre société, de la santé à l'humanité. Bienvenue à la Wellcome Collection, un musée unique en son genre situé à Londres.
Wellcome Collection, Londres
La curiosité est souvent l'élément moteur qui pousse les passionnés à découvrir de nouveaux horizons et à chercher des défis passionnants. C'est exactement ce qui a pu pousser une jeune muséographe, comme moi, à franchir les portes de ce musée lors d'un week-end dans la capitale anglaise. Sans attentes particulières ce musée à sur générer de la surprise et de l’inspiration. Au-delà de ses expositions sur des sujets variés, la Wellcome Collection est un espace de réflexion et de questionnement sur les grandes problématiques de notre époque.
L’histoire d’une collection aussi fascinante qu’éclectique
Le Wellcome Collection, fondé en 2007, est une institution culturelle gratuite qui se donne pour mission de défier la façon dont les gens pensent et ressentent la santé. Elle est inspirée par les collections assemblées par Henry Wellcome, un entrepreneur pharmaceutique et philanthrope du 19ème siècle. La collection comprend plus de 1,5 million d'objets qui témoignent de l'histoire de la médecine, de la santé et de la société, ainsi que de nombreux ouvrages rares et précieux en matière de médecine, de science et d'histoire.
Le musée propose des expositions temporaires sur des sujets variés, allant des pratiques de guérison traditionnelles aux dernières avancées scientifiques.
Une exposition permanente qui explore la notion d’humanité
La visite de la Wellcome Collection dirige dans un premier temps les visiteurs vers “Being Human", une exposition permanente qui cherche à explorer ce que signifie être humain au 21e siècle. Dans un espace peu vaste, des concepts complexes dialoguent à travers une variété de médias : vidéos, objets, créations artistiques, artefacts scientifiques, cartels et dispositifs ludiques, pour n'en nommer que quelques-uns.
Chaque section de l’exposition explore différentes facettes de notre pensée, de nos sentiments, de nos corps et de notre relation avec le monde en mettant toujours en avant l’importance de la diversité, qui porte le message que nous sommes tous uniques dans un monde commun. Ce qui rend cette exposition si captivante, c'est qu'elle ne se contente pas de montrer, elle interpelle. Les œuvres rassemblées sont comme des échantillons aux grandes questions que tout être humain peut se poser. L'exposition invite à prendre du recul, à remettre en question notre environnement, notre identité et les traces que nous laissons. Les éléments de collections exposés sont des œuvres engagées mélangeant art, design, science et bien d'autres.
Par exemple, une section est dédiée au changement climatique et à la crise écologique, mettant en question la capacité de l'humanité à passer à l'action. Les œuvres exposées dans cette section, comme la série de photo “Too” de Adam Chodzko, explorent la relation complexe entre l'être humain et le monde qui l'entoure, à une époque de profonds bouleversements. Certaines œuvres se concentrent sur les signes de ces changements, tandis que d'autres exposent des futurs potentiels, comme l'œuvre ‘Recipe for Potable Water” de Allie Wist qui présente un système de filtration d’eau fabriqué à partir d'objets du quotidien . Cette section suscite avant tout une question essentielle : sommes-nous prêts à nous adapter et à évoluer dans un monde en pleine transformation ?
Une installation remarquable, "Refugee Astronaut III" de Yinka Shonibare, met en scène un astronaute tenant précieusement quelques objets rassemblés à la hâte. Le titre suggère un exil forcé, un acte de désespoir plutôt qu'une exploration galactique confiante. Alors que la dégradation de l'environnement déplace de plus en plus de populations, cette œuvre interroge sur le nombre de personnes qui pourraient devenir des réfugiés.
"Refugee Astronaut III" de Yinka Shonibare, Wellcom Collection, Londres
Une autre section explore le corps et l'esprit, et cherche à offrir un regard différent sur le handicap et les différences. Une installation ludique intitulée "Oh my gosh, You're Wellcome... Kitten" réalisée par l'artiste The Vacuum Cleaner, est le fruit de six mois de collaboration avec quinze jeunes membres du personnel de l'unité Mildred Creak de l'hôpital Great Ormond Street. Ensemble, ils ont imaginé comment différentes expériences et environnements pourraient favoriser la santé mentale. Dans cette installation, les visiteurs sont invités à imaginer un lieu qui créerait une meilleure santé mentale pour tous. Les enfants participants ont proposé des réponses pleines d'imagination, telles que la présence d'un bébé rhinocéros dans chaque service de santé mentale pour enfants, des chambres avec des lacs, des montagnes et une bibliothèque de Poudlard, des infirmières aux grandes oreilles, et des seaux d'empathie.
Cette exposition offre un espace de réflexion où les préjugés sont remis en question, où l'on peut considérer les défis auxquels l'humanité est confrontée et envisager des solutions créatives. Elle illustre l'engagement du musée à explorer les multiples facettes de l'expérience humaine et à encourager des discussions approfondies dans un monde en constante évolution.
Exposition temporaire : Object in stereo
Cette exposition temporaire questionne le fonctionnement du musée, et ses collections, nous plongeant dans l’histoire des réserves du musée et de la conservation des collections pour mettre en évidence la façon dont ces espaces peuvent influencer la perception et la compréhension des trésors du passé.
L'exposition, intitulé “Objects in Stereo” se visite avec un habile dispositif permettant de voir les photographies stéréoscopiques de Jim Naughten en 3D. Elle se révèle être une véritable mise en abyme des collections du musée et de notre relation aux objets. Elle nous plonge au cœur des réserves et des problématiques de stockage, comme si en plein cœur d'une séance de psychanalyse, le musée partagerait lui aussi ses doutes et ses questions. Une grande table centrale présente une documentation accessible, recréant ainsi l'atmosphère d'un espace de recherche au sein d'une salle d'archives. Une véritable invitation à participer avec le musée, où chaque visiteur se sent convié à une expérience de découverte unique et immersive.

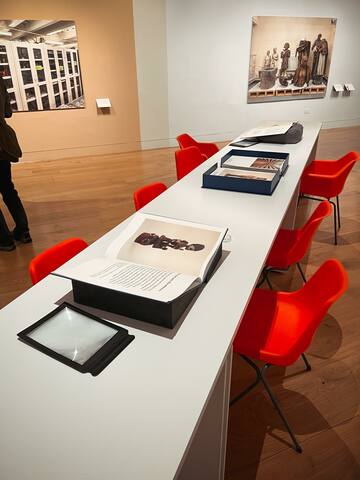

Exposition Object in stereo, 2023, Wellcome Collection, Londres
Un espace de lecture hybride
En plus des expositions, le musée abrite au premier étage une grande bibliothèque remarquable, riche d’ouvrages et de photos, meublée de canapés années 40 et réservée aux « incurables curieux ». Ici, les amoureux du savoir, qu'ils soient étudiants, chercheurs chevronnés, ou qui viennent d’ailleurs, trouvent refuge et inspiration. Cet espace est conçu comme un véritablement un lieu hybride, alliant les caractéristiques d'une bibliothèque et d'un musée et va bien au-delà d'un simple espace de recherche. En effet, elle est le reflet du musée dans son ensemble, offrant non seulement des ressources documentaires, mais également des médiations et des espaces d'exposition. L’espace n’est pas organisé par genre de livre ou par ordre alphabétique, mais il est organisé en grandes catégories. On retrouve par exemple des sections comme “Lives”, “vies” en français, qui regroupent des titres sur les thèmes de la biographie, de la maladie d’Alzheimer, du vieillissement ou des portraits. La section “Faith” qui se traduirait par “foi”, regroupe les ouvrages traitant d’amulettes, de religion et de médecine, de la mort et du processus de mort, ou d’autres sections, aux thématiques plus difficiles, comme la section “Breath”, “respiration” en français, qui aborde des sujets comme la cigarette, les guerres chimiques, les systèmes respiratoire, ou encore l'asphyxie.
A l’image des expositions, la bibliothèque encourage l'interaction et la contribution des visiteurs, des marque-pages sont mis à disposition pour laisser des traces, des avis et des critiques dans les différents livres. Des médiations sont judicieusement dispersées dans les espaces, pour offrir des expériences qui approfondissent les sujets, comme par exemple la création de journaux intimes, dresser son propre portrait ou encore s'adonner à des activités artistiques. L'espace est vaste, ouvert, et des coussins recouvrent les grands escaliers pour permettre aux lecteurs de s'y installer confortablement. La curiosité y est contagieuse. L'affluence est notable, loin d'un silence religieux, mais toujours dans le respect de tous les usagers.

Bibliothèque, Wellcome Collection, Londres
L'art de dialoguer avec son public
La Wellcome Collection résonne profondément avec la conviction que les musées sont des espaces de partage, de dialogues et d’interactions qui ont une mission primordiale de rendre accessible la culture auprès du public. Ce musée, un véritable bijou de curiosité, ne se contente pas simplement de présenter des objets de la collection de Henry Wellcome, il s’exprime de lui-même en créant un véritable dialogue avec le visiteur.
Le génie du musée réside dans sa manière accessible de présenter les choses et dans son intégration de la médiation. Il offre un espace ouvert et accueillant, où les publics se rencontrent et se retrouvent. La librairie et le café ajoutent à la convivialité à ce lieu de vie partagé, où la curiosité est valorisée. Les connexions entre les différents domaines créent du lien et montrent l'ancrage des sujets abordés dans un spectre plus large, celui du vivre ensemble, de l'innovation et de la réflexion collective pour un monde meilleur.
Pour en savoir plus :
- https://wellcomecollection.org/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Collection
- //www.youtube.com/@WellcomeCollection
- https://wellcomecollection.cdn.prismic.io/wellcomecollection%2F4207b8c8-70d1-461e-bea6-f9da13f9a55a_wellcome+collection+who+we+are+and+what+we+do_2.pdf