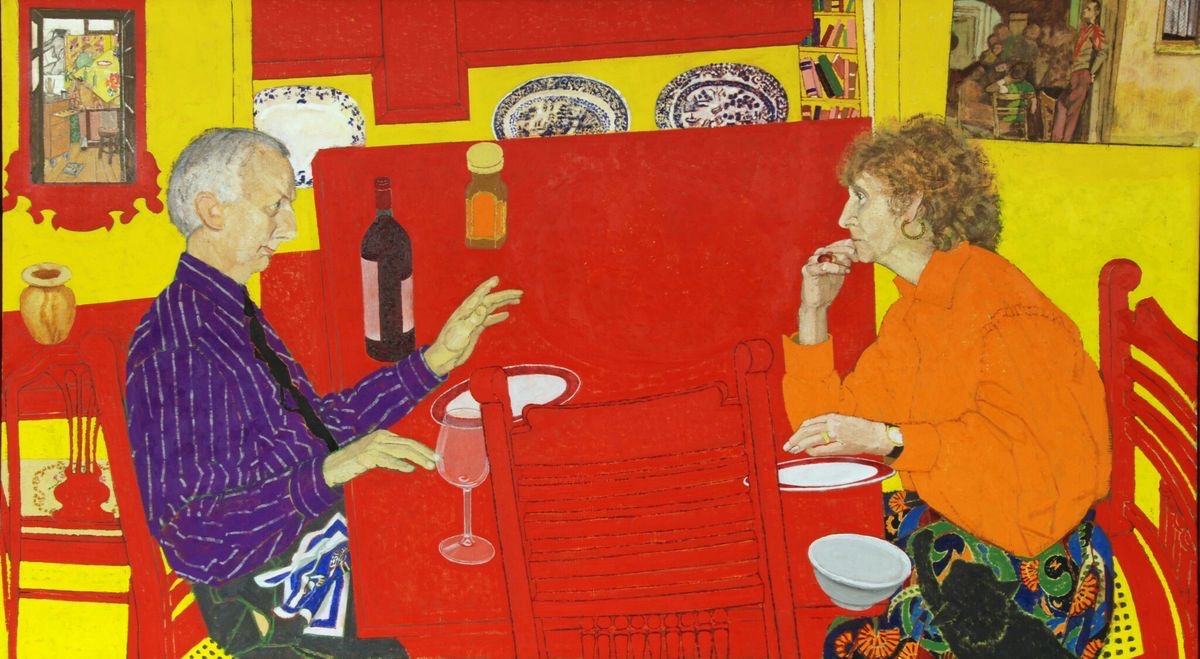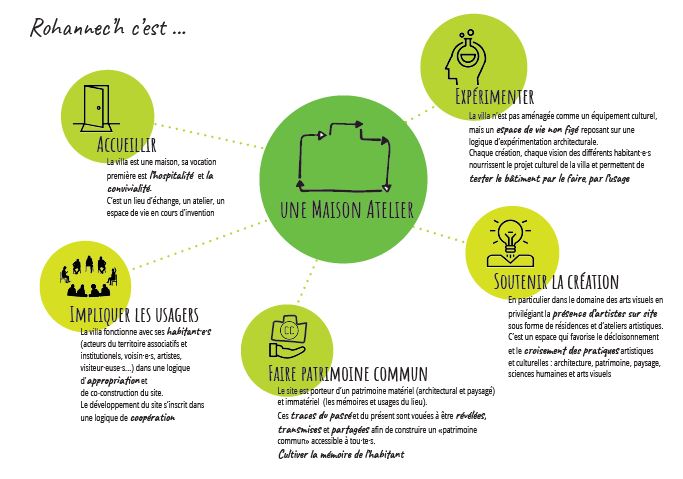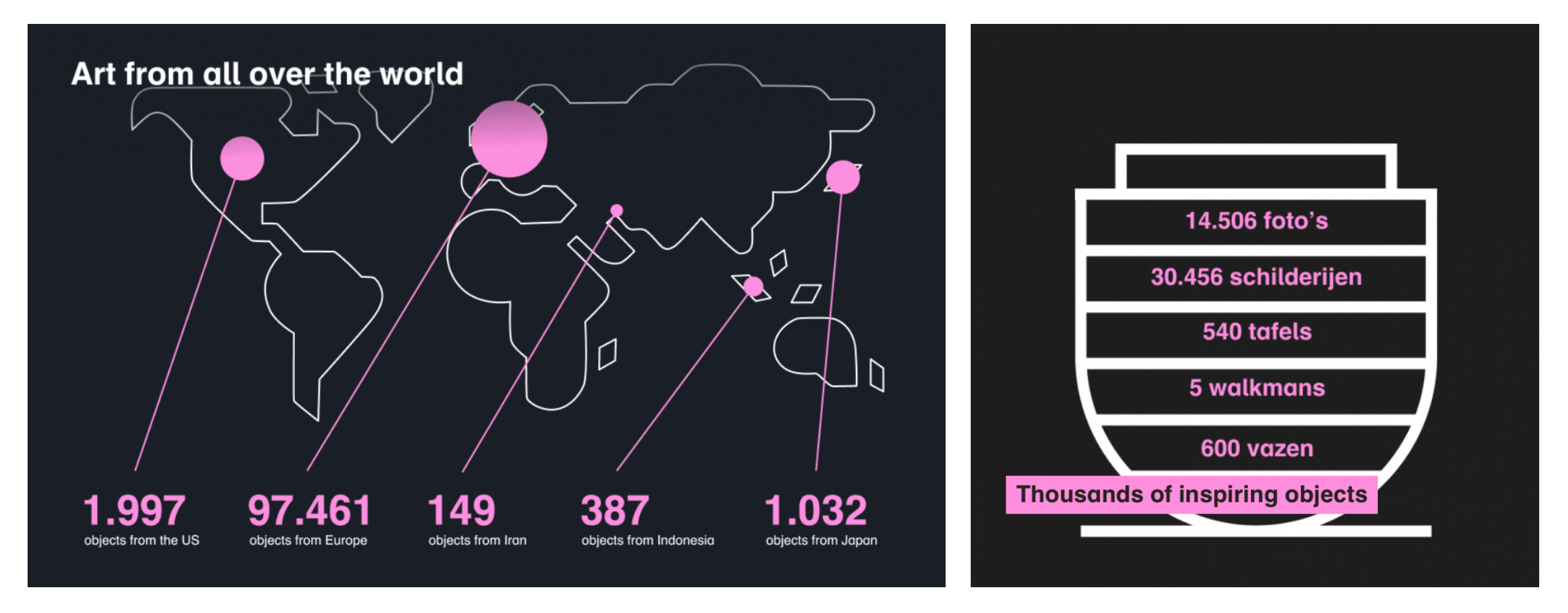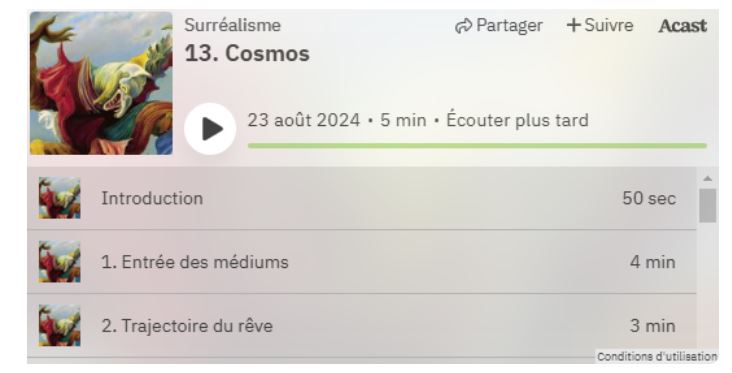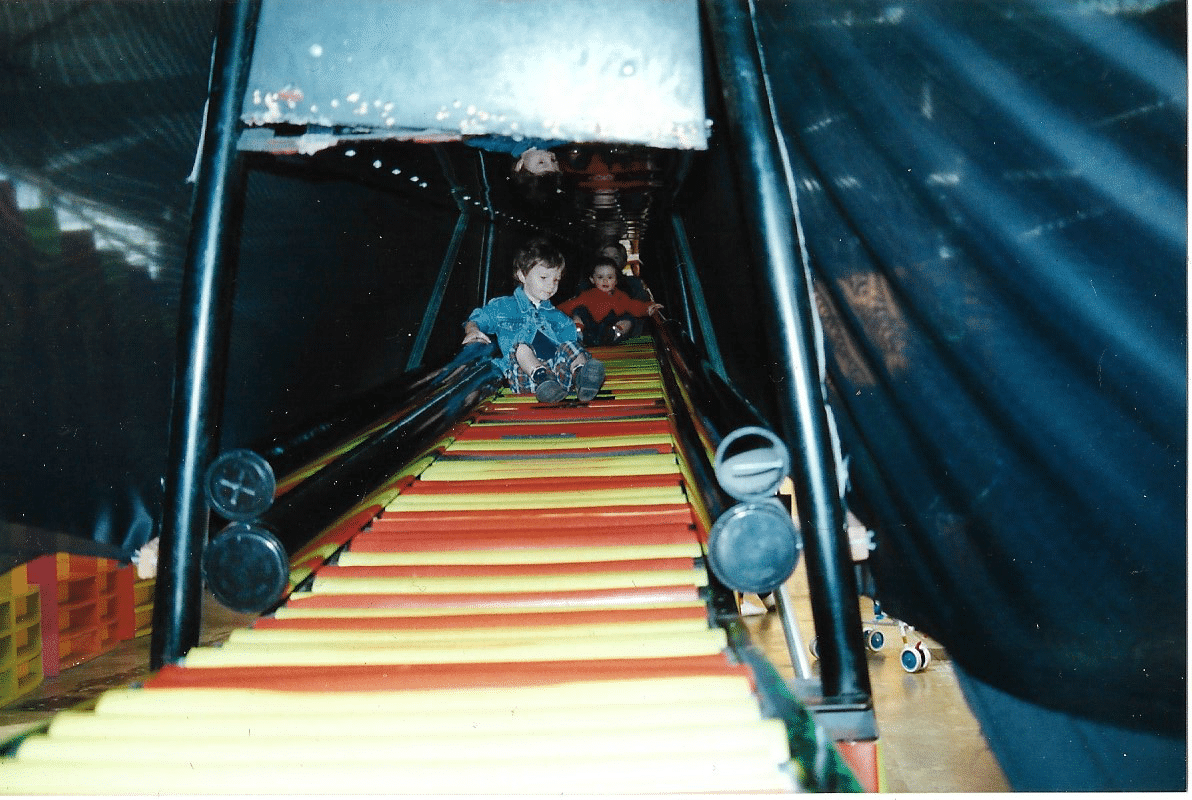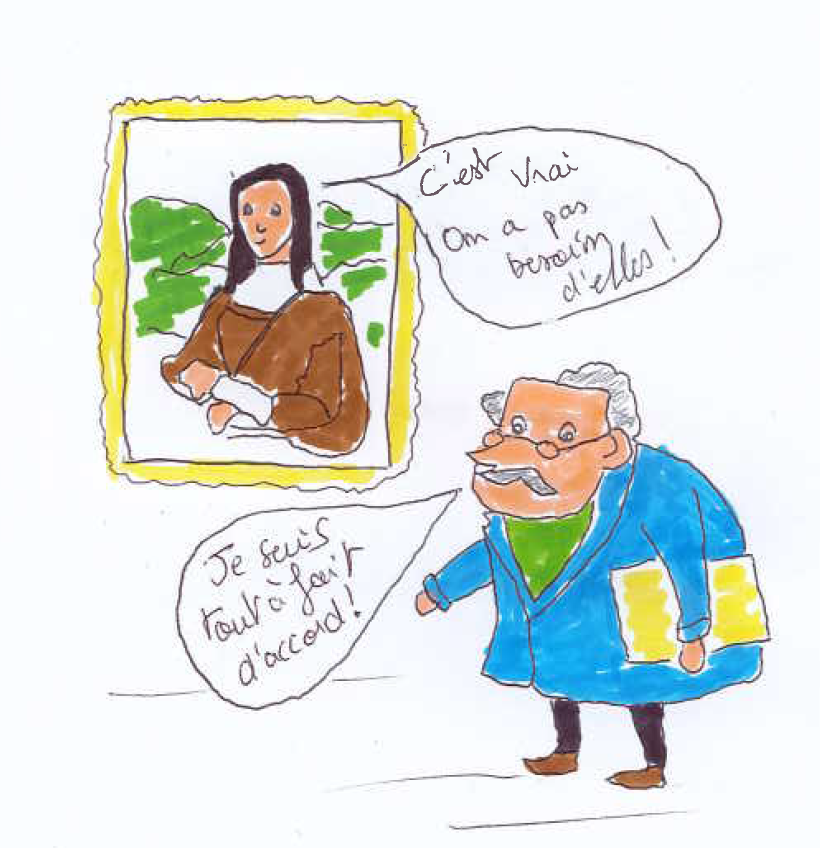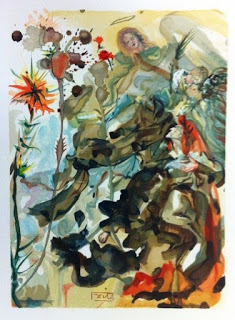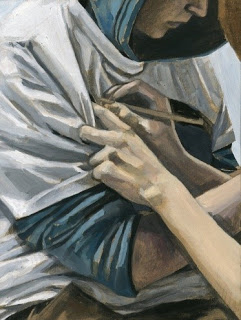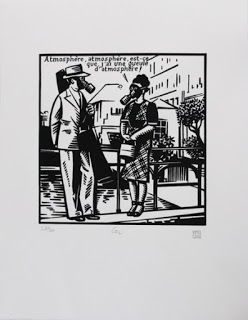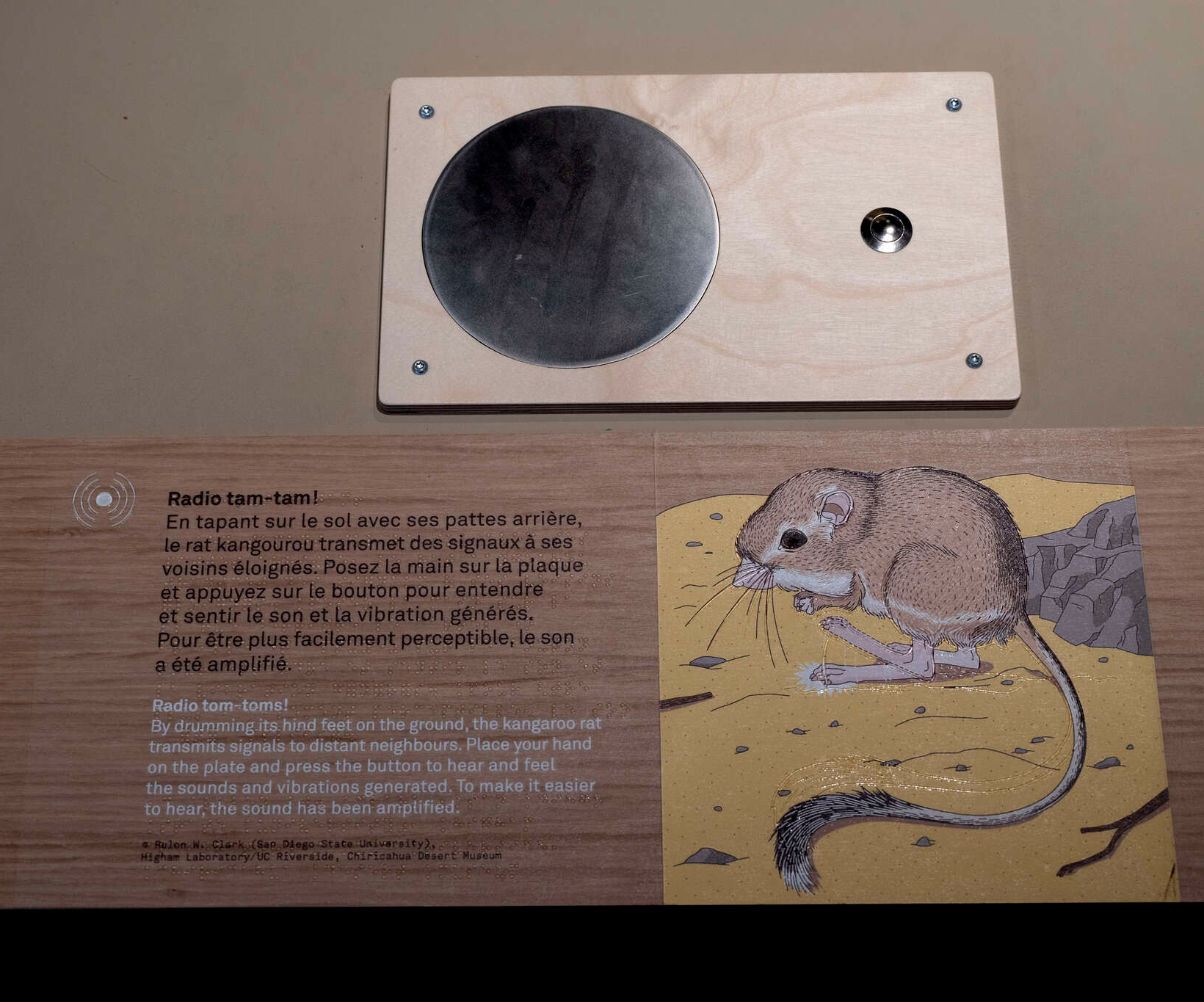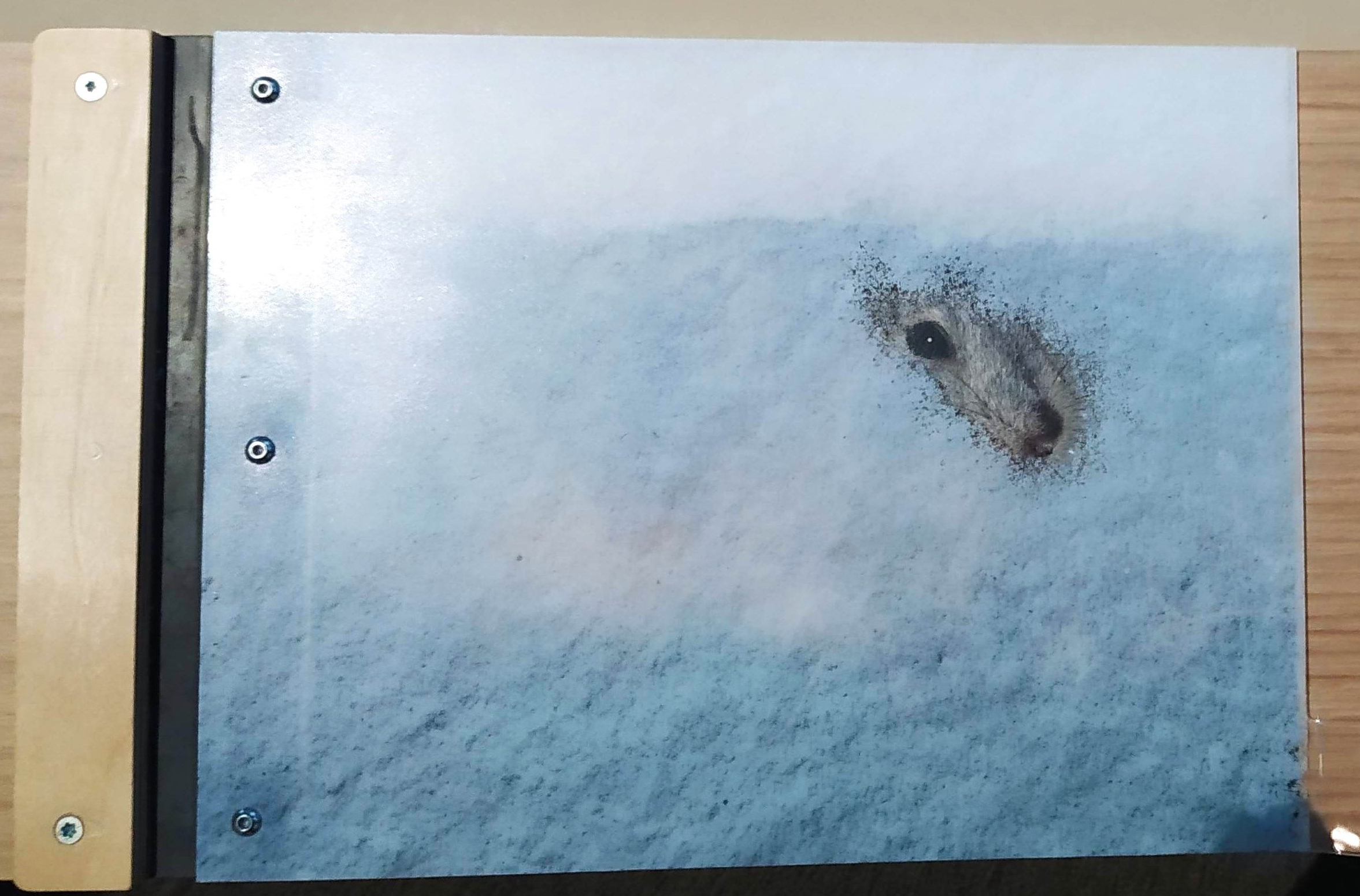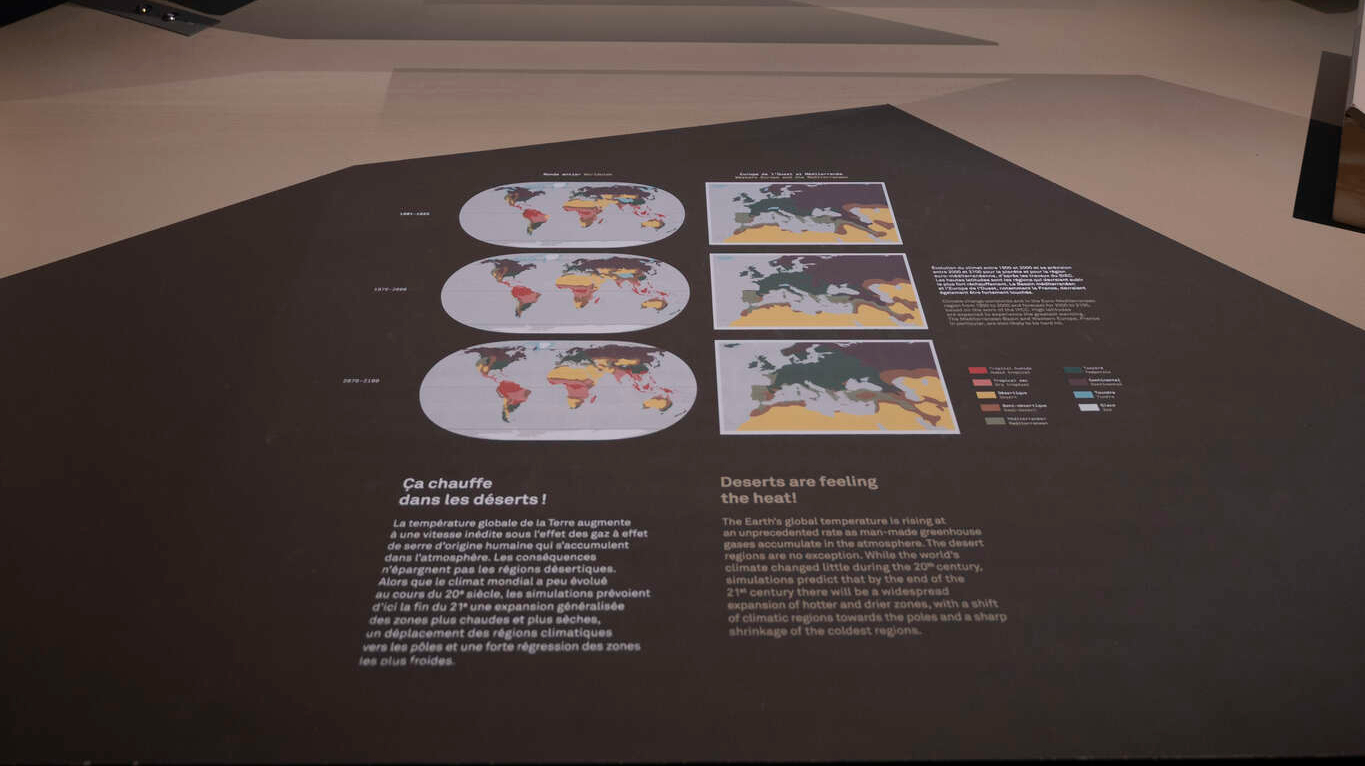Action culturelle et médiations

« C’est une forme d’amour que de créer »
Au cours de notre existence, nous pouvons être confrontés à la maladie, au handicap, à une situation de précarité, à toutes sortes d’accidents de vie. La pratique artistique peut être bénéfique dans ces moments difficiles pouvant apporter du soutien, apaiser et rendre le quotidien plus serein. Rencontre avec Caroline Chopin, sculptrice engagée auprès de publics spécifiques, dans son atelier situé dans l’ancienne filature de Saint André-lez-Lille.
Avant de devenir sculpteur, Caroline Chopin a étudié l’Histoire de l’art. C’est en voulant comprendre ce qu’elle étudiait, qu’elle se mit à la sculpture. La jeune femme débute alors une carrière artistique. Elle reçoit plusieurs commandes, contribue à de nombreux projets artistiques et culturels, crée des décors pour le cinéma et la télévision. S’ajoutent à ses multiples activités, les ateliers avec les publics dits « spécifiques ». Ces publics sont généralement des personnes en souffrance, qui ne donnent pas leur confiance facilement, qui ont souvent une vie réglementée et à qui on ne propose pas grand chose.
Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler avec des publics dits « spécifiques » ?

Atelier au Centre Social de l’Arbrisseau ©Caroline Chopin
Avec quelles autres associations travaillez-vous ?
Actuellement, j’interviens auprès de l’association lilloise O.S.E.R (Objectif S'exprimer Ensemble pour Réussir) qui aide les personnes à se réinsérer dans le monde professionnel. Cette association propose, en plus de formations classiques liées au monde de l’entreprise, des ateliers artistiques afin que ces personnes puissent s’exprimer, s’ouvrir à l’art et prendre confiance en elles. Je travaille avec un groupe d’adultes âgés entre 20 et 45 ans sur une dizaine de séances de trois heures. Cependant la thématique de l’emploi leur est imposée. J’essaye alors de leur faire aborder le sujet de manière imaginative et humoristique.
J’ai aussi travaillé pendant deux ans au centre de détention de Bapaume par l’intermédiaire de l’association lilloise KOAN qui travaille sur la relation entre les quartiers et leurs habitants. L’association organise donc des événements, des rencontres et des ateliers avec des artistes locaux. Ils ont mené plusieurs actions avec des publics particuliers dont les détenus du centre de détention de Bapaume. J’ai travaillé pendant ces deux années avec un groupe d’une douzaine de femmes détenues pour de longues peines et bien souvent à perpétuité. Ces séances d’une journée entière avaient lieu une fois toutes les deux semaines pendant quatre mois. Ces ateliers étaient étonnants ! Ces femmes avaient une telle demande, un tel besoin de s’exprimer ! Elles ont produit, produit, produit et avec une qualité de travail impressionnante ! Je les ai laissées complètement libres dans ce qu’elles voulaient faire. Principalement, elles voulaient faire des cadeaux pour leurs proches. Pour elles, créer était un acte d’amour. C’était vraiment émouvant. Je retiens que c’était une belle expérience humaine.
 Je suis aussi intervenue pour le projet MUS-E porté par l’association strasbourgeoise Courant d’Art. Ce projet met en place des ateliers artistiques dans des écoles de quartiers défavorisés de diverses villes françaises. Deux artistes sont affectés par classe et interviennent sur le temps scolaire. Il s’agit d’un véritable travail en binôme. J’ai travaillé avec des danseuses dans deux écoles lilloises situées dans les quartiers Faubourg de Béthune et Lille Sud. Le but du projet était avant tout de valoriser les enfants car beaucoup étaient en échec scolaire. L’autre objectif était de donner de la matière aux professeurs des écoles pour qu’ils puissent mieux intégrer les activités artistiques au sein de leur classe. Avec l’une de mes binômes danseuses, nous voulions aborder avec les enfants le thème de l’empreinte et nous les avons donc fait danser sur des lits et des murs de terre. Les enfants se lâchaient complètement. Il y a eu des moments magiques. Malheureusement ce projet a pris fin cette année faute de subventions.
Je suis aussi intervenue pour le projet MUS-E porté par l’association strasbourgeoise Courant d’Art. Ce projet met en place des ateliers artistiques dans des écoles de quartiers défavorisés de diverses villes françaises. Deux artistes sont affectés par classe et interviennent sur le temps scolaire. Il s’agit d’un véritable travail en binôme. J’ai travaillé avec des danseuses dans deux écoles lilloises situées dans les quartiers Faubourg de Béthune et Lille Sud. Le but du projet était avant tout de valoriser les enfants car beaucoup étaient en échec scolaire. L’autre objectif était de donner de la matière aux professeurs des écoles pour qu’ils puissent mieux intégrer les activités artistiques au sein de leur classe. Avec l’une de mes binômes danseuses, nous voulions aborder avec les enfants le thème de l’empreinte et nous les avons donc fait danser sur des lits et des murs de terre. Les enfants se lâchaient complètement. Il y a eu des moments magiques. Malheureusement ce projet a pris fin cette année faute de subventions. Atelier à l’association O.S.E.R ©Caroline Chopin
Avez-vous de nouveaux projets ?
Prochainement, je reçois les travailleurs handicapés de l’A.F.E.J.I du Val de Lys d’Armentières. Ils seront un groupe de 8 personnes qui viendront 6 matinées à l’atelier. L’association leur propose chaque année des formations avec des artistes. Je n’ai jamais vraiment travaillé avec des personnes handicapées, j’appréhende un peu. Pour l’année 2017 rien n’est encore prévu mais on m’a toujours sollicitée grâce à mon réseau associatif. Après, le problème est que ces associations dépendent beaucoup de subventions extérieures.
Comment s’organisent les interventions et comment les préparez-vous ?
En général, je me plonge dans le projet quelques temps avant. Je m’adapte surtout au public : si ce que j’ai préparé ne convient pas, il ne faut pas que je l’impose sinon j’ai tout raté. L’atelier devient alors une obligation et là je perds mon public. S’adapter est très enrichissant : on se remet en question et on fait des choses auxquelles on n’aurait pas pensé. Souvent, je commence par une première séance de découverte sensorielle : les participants ont les yeux bandés pour mieux découvrir la matière. Cette première approche fonctionne bien, les personnes sont plus détendues pour la suite.
Parmi ces personnes qui ont suivi vos ateliers, y en t-il qui se sont trouvées une passion pour la sculpture ?
Je sais qu’il y en a qui ont continué mais je n’ai pas d’exemples précis. Par contre, en 2008, sur le projet de l’exposition BD 3D, dans le cadre de Lille 3000, que je menais avec le dessinateur de bande dessinée, François Boucq, je me suis retrouvée à travailler toute seule. J’avais donc besoin d’un coup de main et j’ai proposé à l’École de la deuxième chance de Roubaix si ça intéressait des jeunes de travailler avec moi sur cette exposition. J’ai alors reçu une dizaine de jeunes à l’atelier, tous les jours pendant un mois, qui m’ont aidé à modeler, mouler et à faire des tirages papier pour préparer l’exposition. Ces jeunes ont pris confiance en eux, ils devenaient ponctuels et se levaient le matin avec un but. L’une des jeunes filles qui a participé à ce projet m’a demandé de faire son stage avec moi. Je l’ai donc prise dans mon atelier en tant que stagiaire.
Parmi ces publics, avez-vous une préférence ?

Œuvre d’une détenue réalisée lors d’un atelier au Centre de détention de Bapaume ©Caroline Chopin
Pensez-vous qu’il soit important que les artistes s’investissent auprès de ces publics?
Forcément, je ne vais pas dire non. Mais après ça dépend des personnalités. Moi, j’ai très vite aimé diffuser, transmettre mon savoir-faire. C’est important que les artistes fassent ces actions mais pas que, car c’est aussi une forme d’amour que de créer, de montrer son travail. Quand quelqu’un regarde une œuvre d’art il est ému, il reçoit quelque chose. Sans art, le monde dans lequel on vit va devenir encore plus compliqué. L’artiste doit révéler la beauté du monde et du quotidien : ma vision a toujours été celle là.
Parmi tous ces retours d’expériences, les souvenirs au Centre de détention de Bapaume semblent figurer parmi les plus marquants pour l’artiste. Les actions culturelles dans le milieu pénitencier se développent grâce aux initiatives de nombreuses associations et au travail des SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) qui ont pour mission la réinsertion sociale des détenus. Citons l’exposition « Des traces et des Hommes, imaginaires du château de Selle » présentée jusqu’au 12 février 2017 au Musée des Beaux-Arts de Cambrai qui dévoile les regards d’un comité de détenus du Centre de détention de Bapaume sur ce château médiéval qui conserve une variété de graffitis ayant traversé l’Histoire. Ce projet, fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs dont le Musée des Beaux-Arts de Cambrai, le Centre de détention de Bapaume, le SPIP du Pas-de-Calais, l’association lilloise Hors Cadre et l’université de Lille 3 parcours Arts et Responsabilité sociale, illustre bien cette dynamique culturelle qui se déploie dans le secteur carcéral.
Camille ROUSSEL-BULTEEL
Lien : http://www.caroline-chopin.com/ #sculpture #publics spécifiques #associations sociales et culturelles
« La Cité joyeuse » au Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt, une invitation à penser la ville autrement.
Prises de vue de l’exposition Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans,© - Giulia Guarino
Cinq zones ludiques pour s’approprier la ville
Activable avec des groupes ou en autonomie, cette salle de médiation, ouverte sur les espaces verts du musée, rassemble un certain nombre d’initiatives en lien avec les différentes thématiques abordées dans l’exposition Mécanique d’une ville. Organisé sous forme de carrefour urbain rythmé par des panneaux de signalétique, l’espace est divisé en cinq activités, chacune avec des intentions et enjeux différents.
« Permis de construire »
Ce premier module invite le visiteur à créer sa propre ville par le biais d’une maquette réalisée en bois. Plusieurs modes de jeu sont présentés pour guider l’enfant ou l’adulte dans la réalisation de cette ville idéale : un mode qui permet de s’approprier librement les différentes pièces et deux modes « apprenti architecte et architecte confirmé » plus poussés dans la réflexion qui propose d’aménager les quatre quartiers de la ville selon certaines spécificités : créer une cité ouvrière, un quartier avec de grandes infrastructures, une zone résidentielle et un quartier idéal. Libre à nous d’investir l’espace à notre convenance en positionnant les maisons, écoles et usines sur un schéma urbain schématisé.
Cette activité de la Cité joyeuse, nom qui n’est pas sans rappeler l’utopisme de Le Corbusier, permet d’appréhender sous un œil nouveau l’histoire et l’évolution de grandes villes industrialisées. Tournée vers le futur, cette manipulation permet de poser un nouveau regard optimiste sur la ville de demain et ses défis.
« L’île aux jeux »
Cet îlot est un lieu propice à la lecture d’ouvrages (prêts de la médiathèque municipale), au coloriage et aux jeux de société. Un memory ainsi qu’un jeu de sept familles ont été produits en interne par les équipes. Dotés d’une iconographie précise, ces jeux mettent en lumière les bâtiments phares du patrimoine manceaux. Un travail intelligent et précis qui est un très bel hommage fait à la ville.
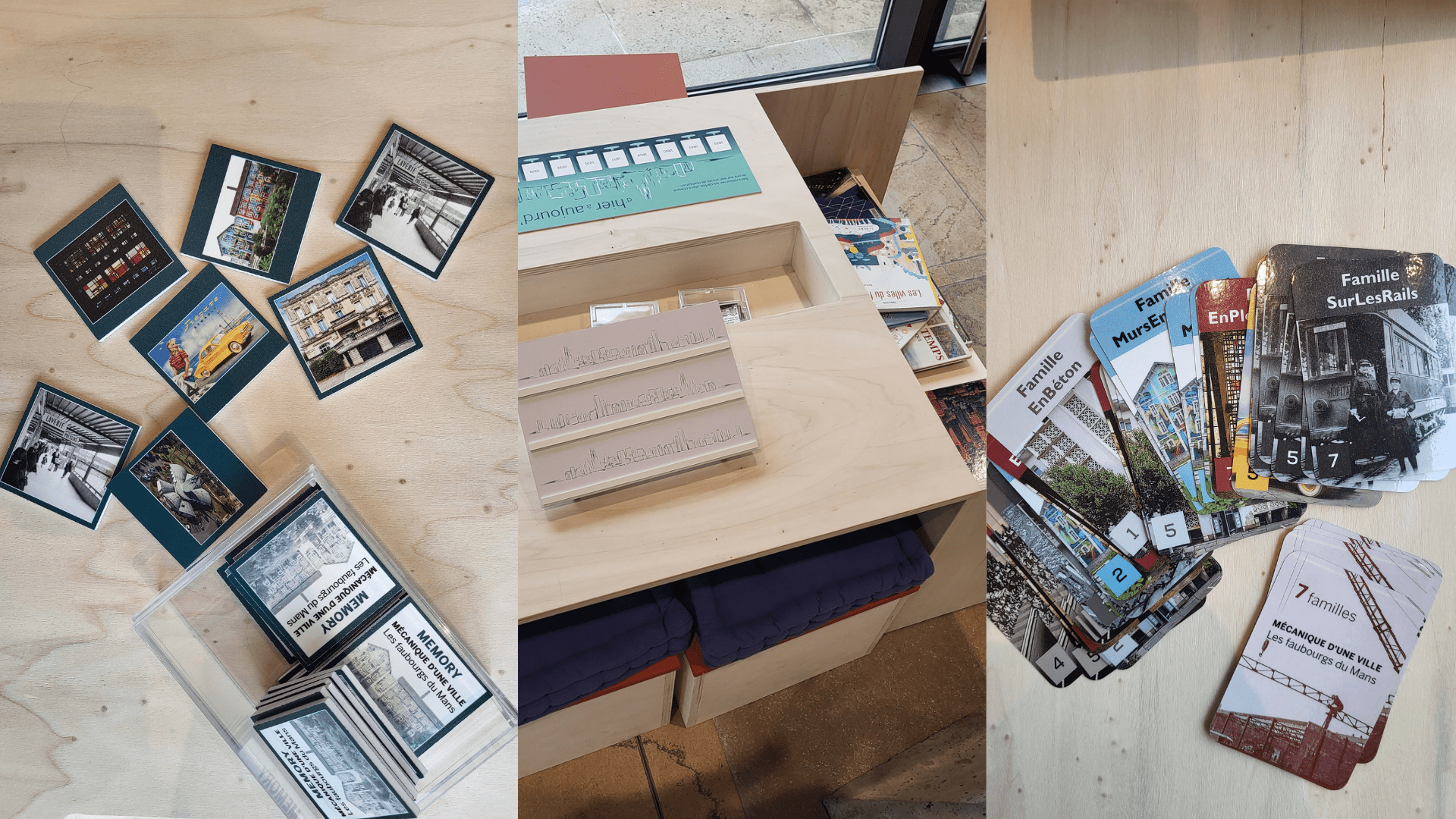
L’île aux jeux, jeu de memory et sept famille disposés sur une table adaptée et ergonomique © - Giulia Guarino
« Faces-habitats»
Trois façades typiques sont à recomposer grâce à un puzzle aimanté à une cimaise. Cette manipulation fait un joli clin d’œil à l’architecture mancelle, visible par tout un chacun quotidiennement mais ici sublimée. Ce jeu de puzzle peut également composer des façades hybrides en créant des architectures absurdes et imaginaires.

Trois puzzles aimantés sur une cimaise carrée © - Giulia Guarino
« L’échappée mancelle » - Cimaise d’expositions temporaires
Voir et apprécier la ville autrement, voici l’intention de ce dispositif. Une grande cimaise d’exposition blanche accueille, en roulement, des expositions temporaires de photographies ou de dessins de la ville du Mans aujourd’hui. Ce projet « Art dans la ville » s’inscrit dans une stratégie culturelle plus large nommée « Objectif le Mans » dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) de la ville. Ces expositions sont réalisées en co-production avec des élèves de l’école primaire ou étudiants des Beaux-arts, inspirés par des déambulations urbaines encadrées. L’accrochage qui habille actuellement cette cimaise est une exposition de dessin. Vu du ciel regroupe près d’une cinquantaine de dessins réalisés par quatre classes de cycle 2.

Cimaise de l’exposition Vue du ciel avec un cartel groupé avec l’identité de chaque enfant © - Giulia Guarino
Elle sera remplacée le 15 avril, par une exposition photo réalisée cette fois-ci par des élèves de cycle 3. Ces actions constituent pour les écoles participantes un véritable cycle pédagogique transdisciplinaire de 12 h (visite de l’exposition au musée, initiation à des domaines professionnels en lien, visite des archives municipales, séance shooting). Encadrés par un photographe professionnel, les élèves se sont essayés à la prise de vue contemporaine de leurs quartiers. Pour thème : l’humain dans la ville. Une riche restitution est attendue. Une trentaine de photos au format paysage seront exposées en un nuage d’images. Un catalogue sera tiré en édition limitée pour que chaque participant emporte avec lui ce souvenir. Un grand vernissage est également prévu à chaque investissement artistique de cette section «Echappée Mancelle ».

Test d’accrochage avant le montage de l’exposition photo « L’humain dans la ville » © - Giulia Guarino
« Le boulevard des mots »
L’installation « Le boulevard des mots », vient clôturer cet espace médiation en proposant une nouvelle expérience du livre d’or. Un pupitre met à disposition du visiteur des cartes postales du Mans et un stylo. Après avoir écrit son mot, il peut le disposer, à l’aide d’une pince, sur un mur rythmé d’avis, d’histoires, de témoignages, de dessins. Appelé livre d’or urbain, ces frises de cartes créent un inspirant nuage de mots et d’anecdotes, mêlant les âges, les genres et les origines. Participatif et incarné, dans son fond et dans sa forme, c’est une réelle inspiration pour réinventer le traditionnel et poussiéreux livre d’or de musée.

Livre d’or urbain avec station de cartes postales mises à disposition © - Giulia Guarino
Un centre d’interprétation et de sensibilisation aux questions patrimoniales et d’urbanistiques
Ainsi, la Cité joyeuse catalyse un grand nombre de très bonnes initiatives culturelles. Sous forme d’un espace d’interprétation, c’est une véritable action culturelle citoyenne tournée vers la ville et ses habitants. Activé en groupes scolaires, ce lieu de médiation est une initiative pédagogique très bien pensée qui fait vivre de façon amusante les connaissances données en classe. Cela favorise la mise en lumière et l’appropriation du territoire par les élèves.
Ces dispositifs de médiations mettent en regard l’histoire du Mans, l’appréciation et la préservation de son patrimoine architectural, l’art, la sensibilité citoyenne et la notion de vivre ensemble. Le tout réalisé en interne par des équipes dynamiques, déterminées et consciencieuses d’offrir une expérience de visite incarnée et personnelle. Ces axes de médiations font germer une multitude de réflexions stimulantes. En conclusion, allez visiter les Musées du Mans, ça vaut le coup !
Giulia Guarino
Pour en savoir plus :
#actionculturelleetcitoyenne #MuséesduMans #Mécaniquesd’uneville

Accrochage numéro 11
Depuis 2008, le Musée des Beaux-arts de La Rochelle a mis en place une politique d'accrochages participatifs. Renouvelé chaque année, le commissariat d'exposition est confié à des citoyens rochelais (dont l’équipe de rugby du stade rochelais, les femmes du quartier de Mireuil, un groupe de détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré, des personnes déficientes visuelles), pour proposer au public une sélection d’œuvres de la collection autour d'une thématique préalablement définie.
La 11ème édition de l’opération Accrochage a été confiée à vingt-trois élèves de 1ère en baccalauréat technologique du lycée hôtelier de La Rochelle avec leur professeur de français Dominique Terrier, et la documentaliste de l’établissement et Florence Michaud. Ils vous invitent à découvrir l'exposition qu'ils ont intitulée "Accrochage n°11 - Le Palais des sens" à partir du 18 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018. A l'heure où la question du participatif dans les musées est au cœur des débats, nous faisons le point avec Annick Notter, directrice du Musée des Beaux-arts.
Pour aller plus loin :
- Site officiel de la Rochelle: http://www.ville-larochelle.
fr/actualites/detail-actualite /b/2/h/638abc161024b3a680be5bc 0b6ec1378/article/accrochage- n11-1.html - Site du Lycée Hôtelier de la Rochelle: http://lycee-hotelier.fr
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Mathilde Esquer
#accrochageparticipatif
#cinqsens
#médiationsingulière

Ados au Musée : défi ou opportunité ?
Visite muséale en groupe © Drella Hubert
Adolescents : Un public à la croisée des chemins
L'adolescence est une étape de la vie marquée par une forte structuration identitaire. Cette période de variabilité représente un défi de taille pour les institutions culturelles qui cherchent à captiver ce public.
Vers une nouvelle dynamique muséale
La question de l'intégration des adolescents dans les musées revêt un intérêt croissant dans le paysage culturel contemporain. De nombreuses institutions culturelles, à l'instar du Centre Pompidou avec son initiative "Studio 13/16" dédiée spécifiquement aux jeunes de 13 à 16 ans ouvert depuis 2010, ou encore le programme “Circuit" développé entre 2013 et 2017 par la Tate, qui collaborait avec des jeunes de 15 à 25 ans sur des innovations au sein de différentes structures partenaires, cherchent à se rapprocher des besoins spécifiques de cette tranche d'âge. Dans ce contexte, plusieurs autrices se sont penchées sur la question, comme Laetitia Aeberli ou Noëlle Timbart, qui apportent des contributions significatives avec leurs études. Leurs stratégies se recoupent, surtout sur les réflexions de la co-construction et l'intégration, qui visent à nourrir les dynamiques existantes :
- Des expositions plus en lien avec les valeurs et les cultures adolescentes
- Contribution et interactivité
- Un accueil personnalisé
- Autonomie et rencontres
Une rencontre enrichissante à cultiver
Pour aller plus loin :
- https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/16_Adolescents-et-muse%CC%81es_2003_rect.pdf
- https://www.seuil.com/ouvrage/infantisme-laelia-benoit/9782021533491
- https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-1-page-21.htm
#Adosaumusée #médiationculturelle #innovationmuséale

Aller au musée, une difficulté pour beaucoup, un droit pour tous
Malheureusement, les visiteurs avec des troubles du spectre autistique (TSA) sont peu représentés dans les musées. Pour beaucoup, les visites au musée ne sont pas compatibles avec les difficultés qu'ils peuvent éprouver, car le musée est vu comme une ouverture sociale alors que, de manière tout à fait caricaturale, les visiteurs neuro-différents sont identifiés comme des individus repliés sur eux-mêmes, et ayant des intérêts culturels restreints.
Les musées américains ont été parmi les premiers à tenter de comprendre ce handicap afin de leur proposer un accueil adapté, comprenant que ces lieux chargés d’histoire sont parfaitement adaptés et adaptables aux visiteurs avec des besoins spécifiques.
Pour l'égalité des chances, la participation des personnes à handicaps
Permettre à ces visiteurs de préparer leur visite sereinement
Le Metropolitan Museum of Art de New York l’a bien compris. Afin de satisfaire ces besoins, il met à disposition des documents permettant aux visiteurs de préparer leur visite en amont (comme le Social Narrative). Ce document raconte comment leur visite va se dérouler dans le détail. Ces pratiques mettent en confiance des publics avec TSA pour l’avant-visite, mais cela ne suffit pas, il est également nécessaire d’apaiser leurs sens lors de la visite du musée pour éviter une souffrance ou un inconfort.
La nécessité d’un apaisement sensoriel pour certains visiteurs
Plein les yeux, plein les oreilles
Car dans le cas de l’hypersensibilité aux stimuli sensoriels qui nous intéresse ici, la réception aux sons, goûts, à la lumière ou à la stimulation tactile peut être plus intense et ainsi être plus difficile à gérer pour certains visiteurs. Ces troubles sensoriels surviennent souvent chez les personnes avec des troubles du spectre autistique (TSA). Comme Cyrielle Leriche l’explique, ces troubles sensoriels peuvent varier en intensité, affecter plusieurs sens, et sont causés par un dysfonctionnement du traitement de l’information par le système nerveux. Or les musées regorgent de stimulations : la lumière parfois vive dans les salles, de nombreuses couleurs, des changements de température voire un bruit envahissant qui peut gêner ou faire souffrir.
Items sensoriels classés par catégories © Cyrielle Leriche
Cette surstimulation sensorielle peut entraîner une anxiété que certains musées tentent d’apaiser en aménageant des espaces calmes ou en créant des circuits évitant les lieux “violents” pour ces visiteurs. C’est le cas du Metropolitan Museum of New York qui, dans sa “Sensory Friendly Map”, recense tous les espaces du musée plus calmes et moins bondés.
Lieux plus et moins fréquentés du MET de New York (Sensory friendly map) © MET Museum
Diminuer les sollicitations sensorielles envahissantes
Outre ces exemples, il existe des dispositifs de médiation permettant de diminuer la sollicitation sensorielle superflue. Les sacs à dos sensoriels du Victoria & Albert Museum de Londres en sont un exemple reconnu. Ils contiennent un casque anti-bruit permettant aux visiteurs sensibles aux bruits ambiants d’apaiser leurs sens et de pouvoir continuer leur visite sereinement. Ces sacs sont prêtés gratuitement à l’accueil du musée, sans condition de ressources et sans avoir à présenter des documents pouvant les déranger, voire amener à une stigmatisation.
Apaiser ses sens, se réapproprier son corps
Pièce multisensorielle © Snoezelen-France
Ces salles multisensorielles gagnent à être associées à des salles de mise au calme, dépourvues de stimulation sensorielle, permettant une rupture avec l’environnement source de stress et d’inconfort. Ces salles peuvent être utilisées en cas de crise ou bien simplement en réponse à une surcharge sensorielle.
Alors en France, on attend quoi ?
Dans les musées français aussi la sursimulation des sens est présente. Prenons la grande galerie de l’évolution du Museum d’Histoire Naturelle de Paris où les visiteurs peuvent activer des haut-parleurs diffusant le barrissement de l’éléphant, ce qui peut déranger les publics malvoyants, autant que les familles et les publics avec TSA, ces sons se rajoutant aux annonces diffusées et au brouhaha naturel de la galerie. C’est là un des principaux problèmes des expositions contemporaines, que l’on veut interactives et sensorielles.
Caravane africaine, Grande Galerie de l'Évolution © MNHN - Agnès Latzoura
# Musée
# Bien-être
# Accessibilité
# Handicap
Sources
- Cyrielle Leriche, « Accueillir les publics autistes au musée », La Lettre de l’OCIM, 186 | 2019.
- Cyrielle Leriche, « Musée et troubles du spectre autistique », Les Cahiers de l’École du Louvre, 14 | 2019.
Fanny Bougenies, Julie Houriez, Simon Houriez et Sylvie Leleu-Merviel, « Musée pour tous : un dispositif de découverte dans les murs et son évaluation », Culture & Musées, 26 | 2015, 115-139.
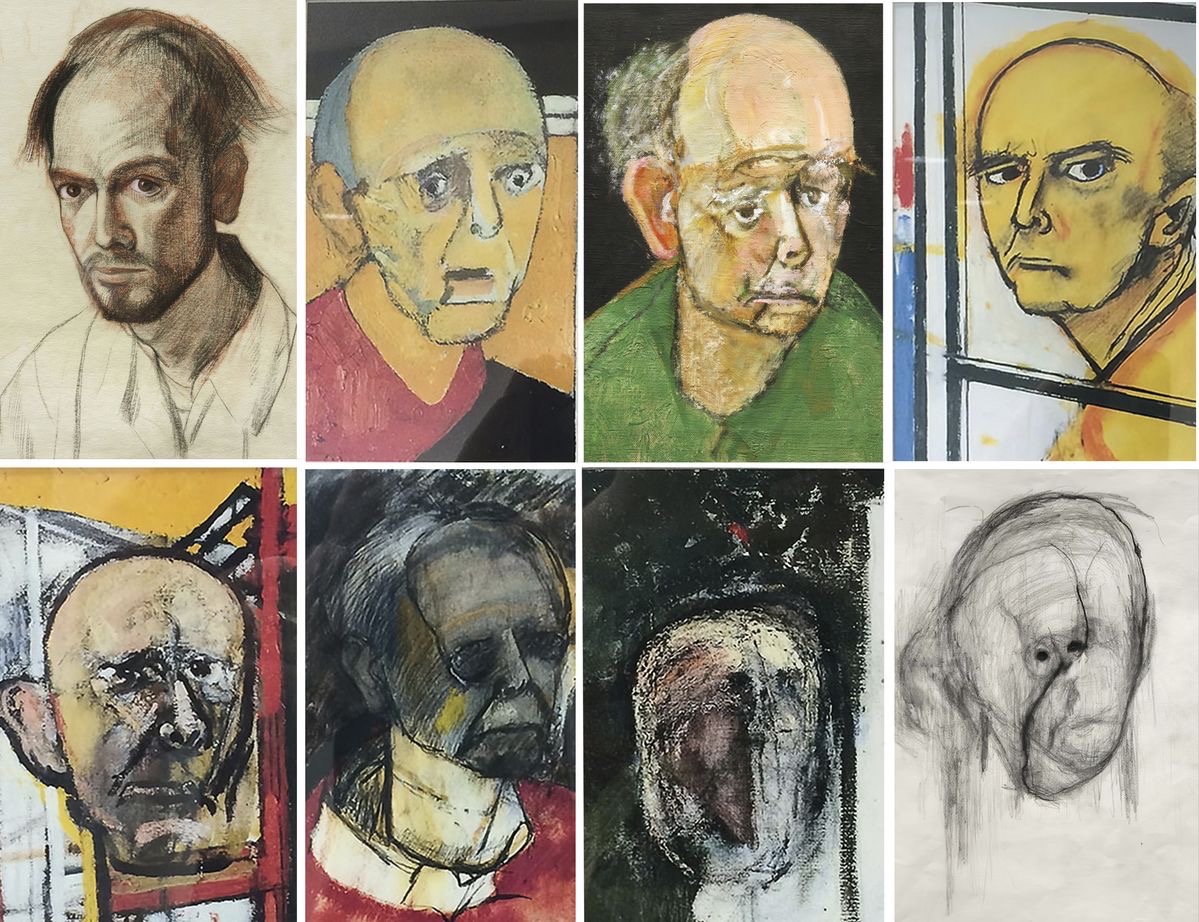
Alzheimer au musée
La France compte plus de 900 000 patients atteints de démences dont 700 000 avec une maladie d’Alzheimer. Malgré l’aide précieuse des aidants et soignants, cette maladie isole, engendre la solitude. Appelés TAU et Béta Amyloïde, ces protéines anormales se font discrètes, aucun dépistage n’est possible. Les symptômes sont identifiés à un stade ou les lésions sont trop importantes. Ces protéines rentrent progressivement, s’accumulent et viennent se nicher à différents endroits du cortex cérébral empêchant la communication entre les cellules nerveuses. Elles insistent sur le lobe pariétal droit et le cœur de l’hippocampe, partie du cerveau en charge du bon fonctionnement de notre mémoire. Il leur faut quelques années à peine pour qu’on les désigne comme des plaques causant la destruction des neurones amenant à une sévère phase de démence sénile.
Image d'intro : William Utermolhen, Galerie Beckel Odille Boicos
Les voilà maintenant maladie, maladie neuro-dégénérative et multifactorielle entraînant une détérioration de la capacité de réflexion et de mémoire. La mémoire épisodique, celle reliée aux événements, aux souvenirs personnels est touchée en premier suivi de très près de la mémoire sémantique, mémoire du langage des connaissances de l’apprentissage en éloignant les dates, les noms, les concepts. Quant à la mémoire procédurale, celle des gestes, elle persistera jusqu’au stade terminal. La mémoire sélective est la résultante de l’oubli, le souvenir lui n’est autre que la reconstitution de l’information passée. Vers 65 ans en moyenne la maladie se déclare, pose ses valises et ne quitte plus son domicile. Elle dérange les tiroirs, mélange les documents, fait voler les temps.
La personnalité de l’Homme ne survit pas à la destruction de sa mémoire. Il a beau usé d’un humour bien particulier pour tenter de dissimuler son décalage évident au monde, sans mémoire, il finit par oublier ses mots. Ce n’est pas un vieillissement commun, la maladie empêche la digestion des nouvelles informations et un oubli simple retentit alors sévèrement sur l’autonomie et fait subir divers troubles du comportement. Ne plus se lever, manger, écouter, jusqu’à perdre l’envie de parler. L’Homme malade s’isole, se renferme sur un monde dont il ne comprend plus les codes. Il est incapable de retrouver les informations recueillies au cœur de l’hippocampe, il n’a pas oublié, il a égaré.
Conversation Pieces – Conversation – 1991 Oil on canvas – 86 x 122 cm, Galerie Beckel Odille Boicos
LES MUSÉES OUVRENT LEURS PORTES AUX MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Fondée en 2008, la fondation Swiss Life s’engage dans des projets solidairess intitulés « art, culture et Alzheimer » et accompagne depuis 2009 les malades aux cotés de l’association France Alzheimer. Ensemble, elles offrent aux patients et à leur aidant la possibilité d’avoir accès à l’art, à la culture. Des visites spécialisées sont organisées dans plusieurs musées de France comme le musée des confluences à Lyon, la cité musicale de Metz, le Musée d’Angladon d’Avignon ainsi que la cité de la musique à Paris.
La Fondation Swiss Life a également initié et soutient depuis 2010 un partenariat novateur entre l’association France Alzheimer et le musée La Piscine de Roubaix. Les participants sont aussi invités à s’allonger pour écouter une bande-son restituant le bruit familier du bassin, avec ses cris d’enfants, son écho particulier. Inspirées par l’expérience du MoMA de New York, les visites-ateliers du musée, proposées tous les mois par Julien Ravelomanantsoa, plasticien-animateur, permettent de stimuler la créativité des malades, accompagnés par leurs aidants.
Des ateliers créatifs sont mis en place au sein des musées et les visites sont accompagnées d’une médiation spécifique.
La maladie d’Alzheimer affecte les compétences cognitives, comme la mémoire, le langage, le raisonnement, la logique, la pensée abstraite mais elle n’altère pas les capacités à ressentir, à éprouver des émotions, à exprimer des sensations. La médiation destinée à ces malades a à cœur de faciliter et encourager l’accès à la culture. Elle se veut la plus compréhensible possible, pour cela l’aspect didactique et pédagogique est en retrait, et une balade naît, balade dans laquelle chacun est libre de s’exprimer. L’équipe de médiation se constitue un vocabulaire approprié, les informations, si nécessaire sont dites avec parcimonie, les questions sont répétées et les réponses ne sont pas arrêtées.
Au Palais de Tokyo à Paris, les patients sont accompagnés dans une démarche singulière. L’idée est de se détacher de l’aspect mnésique de la médiation, pour n’en garder que les émotions. C’est le ressenti, l’instant vécu, le plaisir immédiat qui marquent les esprits. Loin des informations relatives aux œuvres et à leur contexte, on accède à la perception du sensible et l’art devient une manière d’accéder à la plasticité du cerveau. On les voit rire, partager, parler et renouer leurs liens sociaux. Un moment à part où la maladie n’a plus la première place.
Le jeu de paume à Paris adopte la même démarche et met en place un programme de visite pour le public en situation d’alzheimer, ici on entend stimuler la curiosité, les questions défilent sans se soucier du caractère éphémère des réponses. La visite se fait bulle de protection et d’écoute où chacun est libre de ne pas suivre, de ne pas comprendre, de ne pas se souvenir. Certaines œuvres réveillent chez les patients des souvenirs lointains d’une vie personnelle qu’ils ont bon plaisir à partager.
Le Grand Palais de Paris, quant à lui, s'intéresse à l’accessibilité de ces patients en leur proposant de regarder les tableaux et de déambuler de salle en salle avec le groupe pour retrouver une chaleur humaine. La culture permet de retisser des liens sociaux, de renouer le dialogue et l’interaction. Elle vient faire appel à des capacités cognitives mises de côté et tend à toucher le cœur de la réminiscence. Les aidants retirent leur étiquette, la maladie s’éloigne et la complicité prend toute sa place.
La mémoire perceptive est la plus résistante à la maladie, elle s’appuie sur les sens, retient des images ou des bruits, établit des repères visuels. Cette mémoire se trouve dans différentes régions corticales du cerveau et engage des émotions qui peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée et renforcer l’attention.
Dans les musées, les cinq sens sont sollicités. Si la maladie d’Alzheimer altère la mémoire, elle n’a aucune prise sur les sensations et les interactions sociales influencent le fonctionnement de notre mémoire. La sollicitation des sens et des interactions au musée développent de nombreuses capacités cognitives pour lutter contre l’aphasie et l’apraxie causées par la maladie d'Alzheimer.
Ces approches thérapeutiques non-médicamenteuses sont actuellement en développement et de nombreux musées s'ouvrent à cette nouvelle forme de médiation.
Dadure Alexane
Pour aller plus loin:
- https://artoistv.univ-artois.fr/video/3614-atelier-alzheimer-au-musee-de-la-piscine-de-roubaix/
- https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-alzheimer/
- http://aurythmedusouvenir.philharmoniedeparis.fr/docs/AurythmeDuSouvenir-methodologie.pdf
- https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-ethique-a-arts-culture.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab200098bac9f7a934b157c2ab3f74986765c41df19c277bd1084dc475d10ab66ddb4708917d27dc1430002586bfb93871c934cd122cc3d3655311528214474892eca84d90c5775ebab780301ca0cc76a8af7b24d267a54e56b29c
#médiation #alzheimer #musée
Appel d'Air : c'est bouleversant.
C’est bientôt l’imminence, c’est bientôt le début, mais aussi la fin. Je viens de sortir de ma salle de classe, j’y ai passé du temps dans un brouhaha productif et joyeux, plongée dans mes pensées, et j’ai de l’acrylique sur mes doigts. J’ai un peu mal aux pieds d’avoir tant marché. Jeudi c’est le lancement, le lancement d’Appel d’Air, la troisième édition de la biennale d’art contemporain d’Arras qui est organisée par les étudiants de mon master. Son thème cette année est le bouleversement. Sens-dessus-dessous, c’est marqué.
C en’est même pas le projet auquel je suis rattachée, mais l’ensemble de ma promotion est mandée pour en organiser la médiation. Avec ma classe donc, nous sommes tous chamboulés : ça fait depuis début février que l’on a des réunions pour l’organiser, depuis une semaine que l’on a réalisé les prototypes en commençant à rigoler, depuis ce matin que nous nous sentons concernés. Bien entendu, trois d’entre nous se sont déjà bien penchées sur le sujet afin de préparer ces réunions en amont devenant médiatrices entre nous et Annaëlle, Joanna, Margot, Julie & Alice, les chargées de production du projet.
 Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C
Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C
Mais d’abord, qu’est ce que la médiation ? La médiation culturelle, on peut la comprendre depuis celle issue du social : on crée un dialogue. Entre l’œuvre et le visiteur si on veut, entre les visiteurs si on sait. J’ai beau en avoir déjà fait, je n’ai pas la prétention de savoir la faire bien, parce que la médiation, elle l’est toujours elle, en débats, en discussions, il n’y a qu’à voir le cours d’hier, ou bien les anecdotes passionnées de Mathilde. La médiation culturelle n’est pas qu’un entre-deux qui lancerait une discussion, elle est aussi porteuse de relation, porteuse de sens. De sens dessus dessous, s’entend. Elle s’élabore et s’adapte, elle essaye d’anticiper les publics quivont être faces à nous dans un premier temps.
En somme, nous ne savons pas précisément qui sera là. On ne peut pas cibler le public passant. Alors on invente : et si on pensait à quelque chose qui interpelle sur le sol ? Et si on partait sur le bleu dénominateur commun des trois éditions ? Et si on cherchait un jeu que tout le monde connaisse ? Julie prend des notes sur le tableau.
Donc il y a cette interrogation, et puis l’émulation. Chaque groupe se forme assez spontanément, on sort du brouillon et des idées, on met cartes sur tables, on construit son idée et on la propose aux autres à la fin. Bethsabée présente le rythme du parcours qui lie les œuvres entre elles. En autonomie, nous sommes nous, avec nos moues réflexives, nos idées auto-stoppées, et ce projet qui finit par prendre forme. Nos tables sont regroupées en espaces distincts de travail. Amaury a un tablier et joue du cutter sur le carton plastifié, Clotilde annote dans du papier, Berivan prépare un pochoir. Chacun se prête au jeu : nos moues de ceux qui voulaient rentrer parce que bon, faim, dissert et compagnie sont quand même les dernières à êtres sorties de la salle parce que attends Maëlle, a t on pensé à ça ?
 Élaboration de prototypes. © J.F.
Élaboration de prototypes. © J.F.
Réalisation des cocottes interpellatrices. © C.D.
Entremêlée à ça, il y a la rencontre avec les œuvres que l’on va devoir présenter. Et derrière ces œuvres, les artistes. En début d’année lors des résidences, certaines d’entre nous ont accepté d’enloger alors que nous découvrions nous-mêmes Arras. Eloïse a dormi sur son matelas gonflable, il y avait quatre artistes qui dormaient chez Justine. Ces personnes, qui viennent des écoles d’art de Cambrai, de Bruxelles ou même du Mans, sont donc venues en octobre découvrir la ville, le postulat de l’édition d’Appel d’Air, pour ensuite construire leurs pièces. Et puis ce matin, certains étaient là pour nous présenter leur travail, en lien avec ce parti-pris : bouleverser Arras et recréer un lien social entretrois quartiers d’une ville fragmentée par une grande ligne ferroviaire, étalée dans la longueur. Cette longueur que nous vivons nous mêmes au quotidien: Julia vit trop loin, et je croise souvent Coralie qui attend son bus.
Je ne vous dirai rien ce soir sur les artistes et sur les œuvres contemporaines qui seront exposées. Bah non, ça serait trop facile. À vous aussi de venir un peu : c’est à Arras du 16 au 18 c’est bleu, c’est entre 11 et 18 heures, c’est dans les rues. Allez un indice : mon premier est sphérique, mon second se tortille, mon troisième se déverse un peu partout dans le monde. Et puis dedans, on y trouve des ponts entre les lieux importants de laville, la participation des habitants et l’invitation à broder. C’est trouble ? C’est tentant ? C’est vendredi !
La médiation, on l’élabore en fonction du lieu où l’on sera. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons marché, beaucoup, pour aller d’un point à l’autre et imaginer ce que seront les visites. Charlène a vérifié, ce matin on avait fait un peu plus de six kilomètres à travers toute la ville sans avoir fini. C’est un corps à corps avec la ville à ce stade, on imagine comment les œuvres se présenteront, une fois leur montage terminé demain soir. On se rend compte des éventuelles questions qui pourront être posées, alors on cherche un peu, on retourne la future visite dans tous les sens. Louison porte les plans que l’on fournira aux visiteurs, parce que oui, penser la médiation, c’est aussi penser l’organisation.
 Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.
Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.
Ponctuation du parcours. © A.L.
Là je suis fatiguée, je suis un peu inquiète. Qu’aurons-nous à dire aux visiteurs ? Ah bah non, attends, me souffle Charlotte, tu sauras quoi dire, il s’agit de créer le dialogue. Alors bien sûr tu n’auras pas rien à dire à tes interlocuteurs, mais le but n’est pas de leur faire un cours magistral, le but reste de les titiller. Et si le débat doit durer trois jours, de vendredi à dimanche, tu sauras le tenir, car on a pensé, ensemble, à tout ce qui était en notre pouvoir.
Reste les impondérables sur lesquels on n’a pas de prise, comme la météo. Le temps qui a l’air de tourner au froid, juste quand on fera de la médiation en extérieur, cool. Emeline sera identifiable à coup sûr avec son écharpe bleue qui recouvre son manteau en hiver. Ce qui est rassurant c’est qu’on ne le fera pas pour rien, car dans la médiation, réside de l’engagement. Bon d’accord rester dans le froid pour créer un dialogue ça n’est pas non plus être un militant, mais c’est quand même le signe d’une volonté de questionner la ville, son sens, sa création, les personnes qui y vivent. Redonner la parole, le geste aux habitants, qu’ils s’approprient, qu’ils prennent conscience que leur ville, ce n’est pas que de de la brique et des voies de circulation, mais que leur ville, ça commence par leur environnement du quotidien, à l’espace dans lequel ils évoluent.
Je conclus, parce qu’il faut que je travaille sur autre chose : nous sommes encore étudiants, ne l’oublions pas, nous avons d’autres travaux à réaliser. Donc face à nous, qui aurons-nous ? Il y aura l’étudiant en musicologie de la fac de l’université d’Artois qui aura vu l’affiche d’Appel d’Air sur l’amphi K, et qui se sera dit "ah bah ouais grave", il y aura la grand-mère qui rentre chez elle et qui tombe sur de la broderie sur les murs et qui sera intriguée, il y aura le maçon qui pensait faire son marché tranquille, et qui verra de loin des hurluberlus se balader avec des bulles de bande dessinée et qui voudrait savoir ce qu’elles auront à dire. Et vous, qu’aurez-vous à nous révéler ?
Coline Cabouret.
#Appeld’Air
#Médiation
#Sens-dessus-dessous
Pour en savoir plus: http://www.biennale-appeldair.fr/
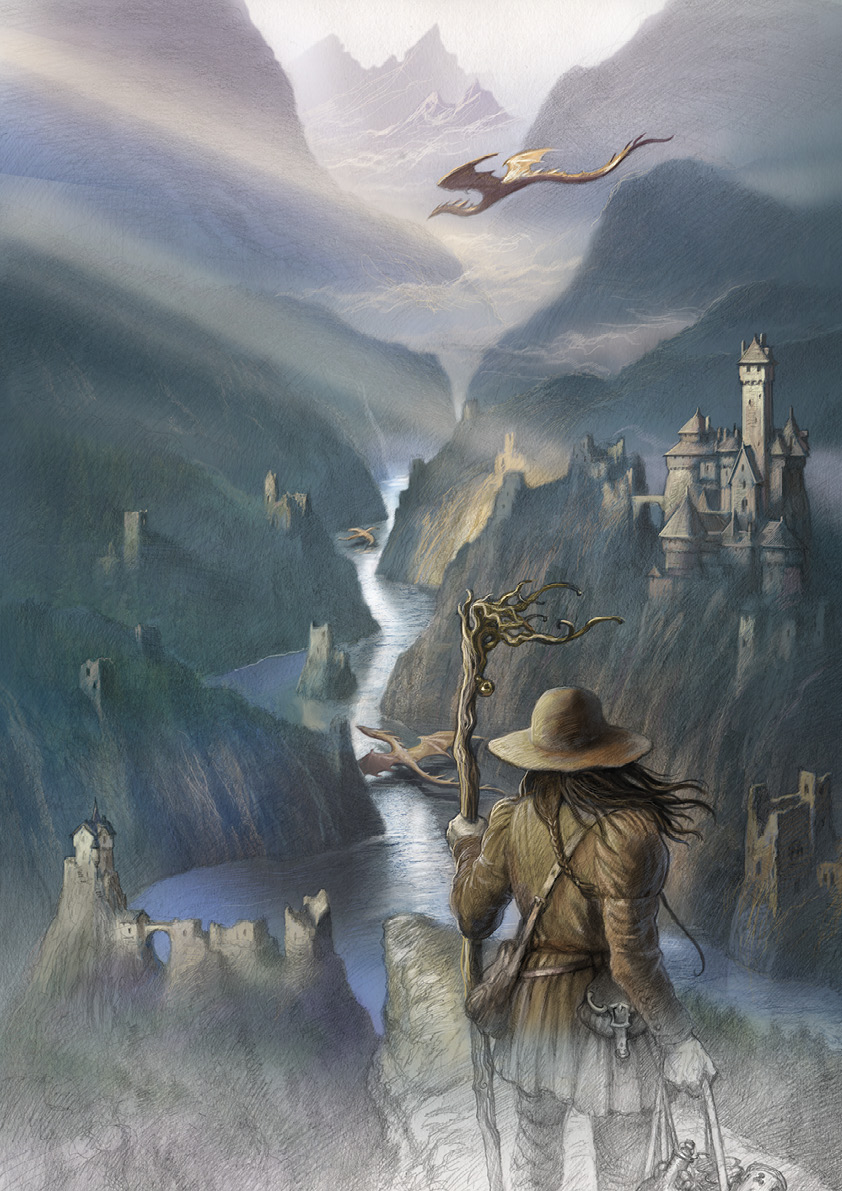
Archi-Fantastic : interpréter le patrimoine alsacien avec John Howe
L’Alsace est une région forte en patrimoine castral et religieux par le nombre conséquent de châteaux forts et édifices ecclésiastiques recensés. Cette richesse architecturale, mais aussi les paysages poétiques et légendaires de la vallée rhénane ou du massif vosgien et son grès rose, inspirent les artistes de fantasy, à l’instar de l’illustrateur John Howe.
C’est sur l’interprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de ce célèbre artiste d'héroïc fantasy, que repose l’exposition estivale Archi-fantastic actuellement présentée au CIAP de Guebwiller, au sein du Château de La Neuenbourg.
Pourquoi le territoire alsacien ?
John Howe, illustrateur de l’univers de J.R.R Tolkien et directeur artistique pour Peter Jackson, est né à Vancouver au Canada, et rejoint la France et plus particulièrement l’Alsace lors de son intégration à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il découvre alors l’architecture gothique et notamment la cathédrale de Strasbourg, l’architecture castrale et le château du Haut-Koenigsbourg, les paysages vallonnés et ses vignes, ainsi que le Rhin et les mythes qui y sont associés.

Le château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri
Marqué par la diversité culturelle et patrimoniale de l’Alsace, l’artiste y retrouve une vision imaginaire, notamment au travers de l’architecture médiévale, qui joue un rôle prépondérant dans l’univers de John Howe, et des légendes rhénanes qu’il retranscrit dans ses œuvres. C’est pourquoi, cette exposition, composée d’une cinquantaine d'œuvres originales, mêle des créations inspirées de la Terre du Milieu mais également des dessins plus méconnus inspirés du territoire alsacien.
Réinterpréter le patrimoine et l’appliquer dans la fantasy
Afin de valoriser le patrimoine de la région, l’exposition met en avant l’interprétation de lieux emblématiques par John Howe qui reprend essentiellement des éléments architecturaux de monuments caractéristiques, telle que la cathédrale de Strasbourg qui a fortement marqué le jeune artiste lors de sa vie étudiante strasbourgeoise. Au point qu’il lui consacre un ouvrage intitulé Cathédrale dans lequel il réinterprète les diverses ornementations et motifs gothiques selon sa propre idée architecturale. Ainsi gargouilles, statues, balustrades et corniches composent un univers plein de créatures et de figures fantastiques.
Le Haut-Koenigsbourg, château-fort restauré par Bodo Ebhardt au début du XXe siècle, l’impressionne aussi. La particularité de ce château, dont la restauration s’appuie sur des études historiques et architecturales qui l'inscrit dans une dimension fantasmée de l’époque médiévale et dans la continuité de l’idée du travail de Viollet-le-Duc, est de plonger le visiteur dans l’atmosphère d’un Moyen-Âge mythique. Cette architecture médiévale correspond pleinement à des représentations symboliques et imaginaires caractéristiques de l’univers de la fantasy. C’est pourquoi ce château alsacien est présent dans de nombreuses œuvres en lien avec celles portant sur La Terre du Milieu à l’instar de Watchful peace.
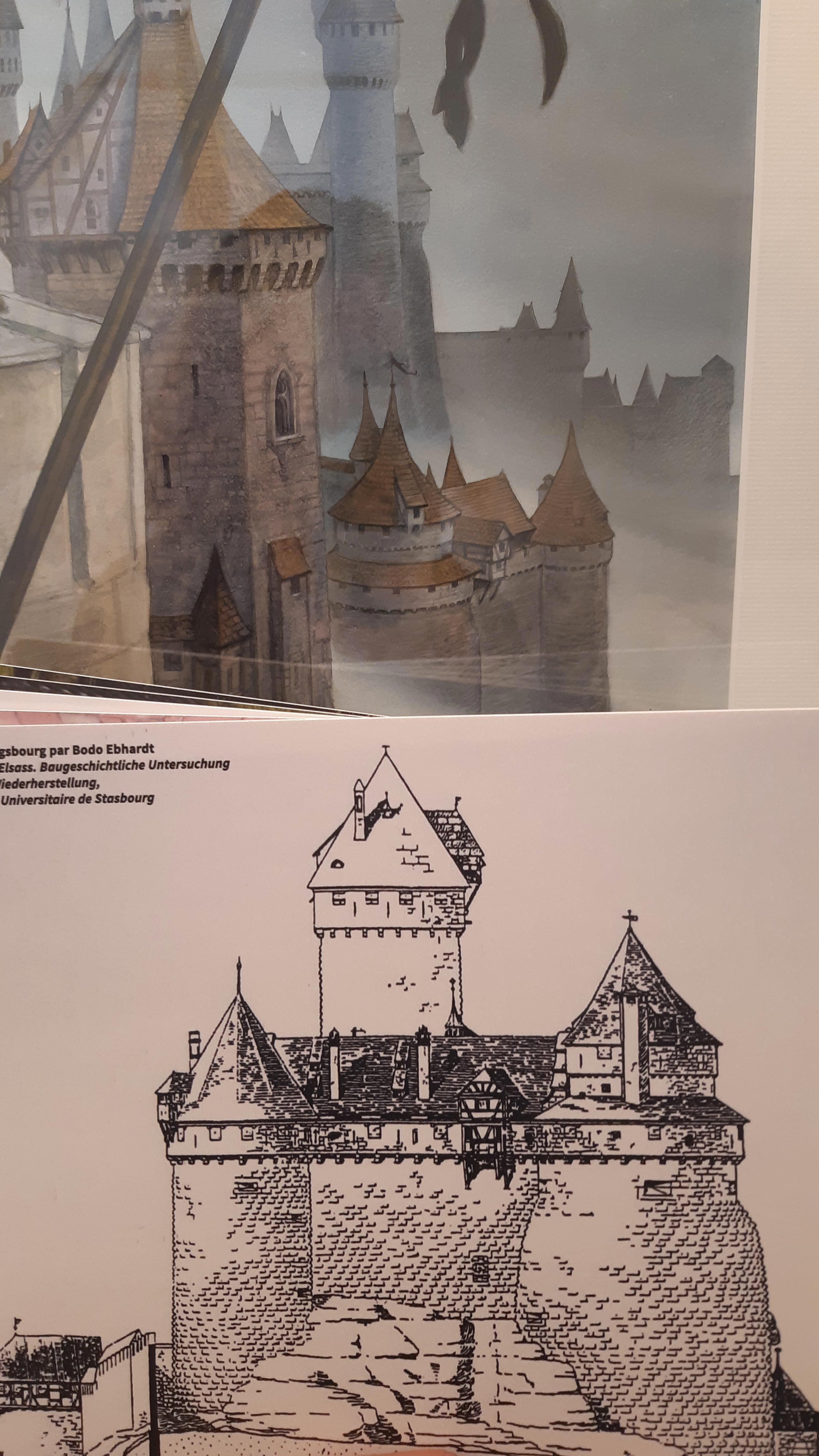
L’inspiration du bastion du Château du Haut-Koenigsbourg pour la réalisation d’une partie du château du tableau Watchful Peace © Tiffany Corrieri
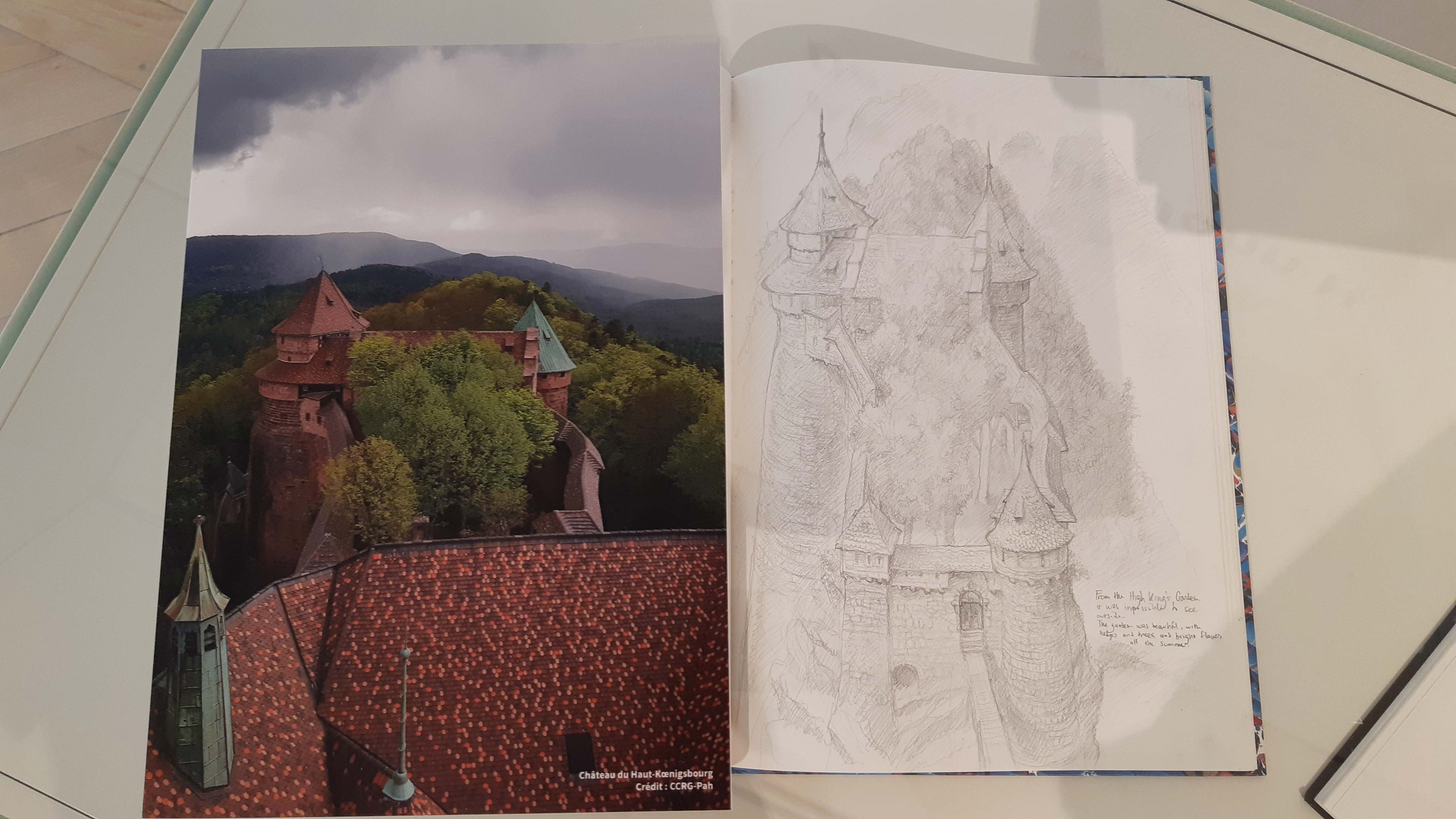
Croquis de John Howe réalisé au Château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri
Enfin les contes et légendes d’Alsace reflètent la féérie de la fantasy par la présence de personnages fantastiques telle la nymphe Lorelei, arpentant les bords du Rhin à la recherche de bateaux à faire couler à travers ses chants. Le tableau The Nixes peut faire référence à cette légende.
Interpréter par la médiation
Pour mettre en avant cette réinterprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de John Howe, des clés d’interprétations sont données aux visiteurs par le biais de médiations. Ainsi le visiteur peut comparer visuellement les éléments architecturaux des bâtiments dont l’artiste s’est inspiré, grâce à des panneaux mobiles montrant des parties des édifices en question, qui ont été repris dans les dessins de l’illustrateur.
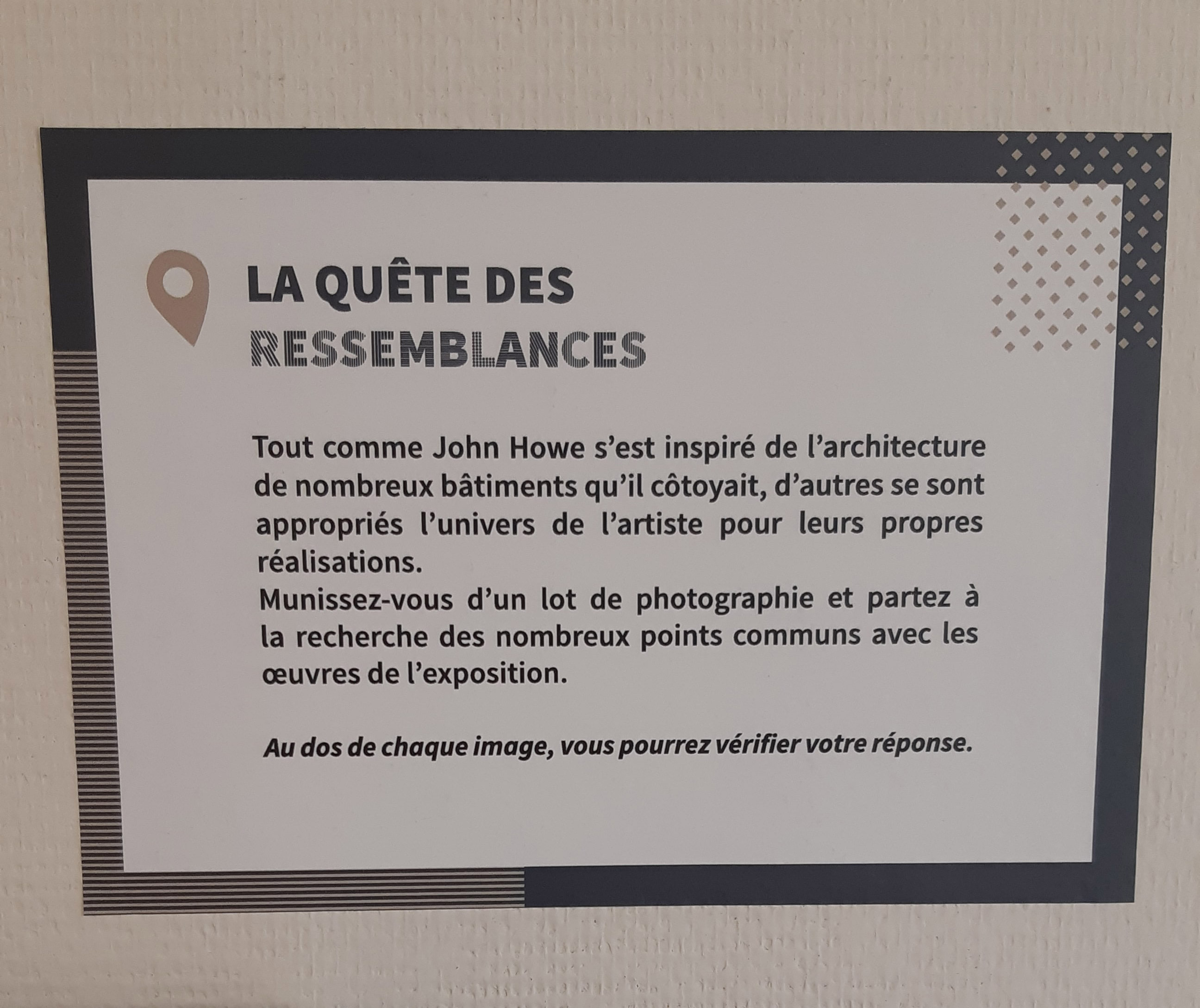

Les panneaux mobiles pour comparer les éléments architecturaux avec les tableaux © Tiffany Corrieri
De plus, une visite guidée, qui apporte d’autres visuels de comparaison, est proposée et permet de mettre en valeur les différentes interprétations que le visiteur peut retrouver au sein des illustrations de John Howe.
Cette visite et ces médiations semblent nécessaires pour comprendre la démarche de réinterprétation de l’artiste du patrimoine alsacien dans ses œuvres. En effet l'interprétation des édifices sous le prisme de la fantasy, qui s’appuie sur la recomposition et l’appropriation des bâtiments afin de les identifier à la vision de l’artiste, peut échapper au visiteur. Comme cela, l’accompagner dans la découverte des œuvres permet de lui faire découvrir des détails et correspondances qu’il n'aurait pas la spontanéité de trouver lui-même, particulièrement s'il n’est pas familier du patrimoine de la région.
Réenchanter le patrimoine castral
Cette exposition s’inscrit dans l’évènement Les Portes du Tempsqui dépasse la limite géographique du Château de la Neuenbourg puisqu’il est question de revaloriser le patrimoine castral de la vallée rhénane. Réalisé par John Howe et impulsé par la Collectivité Européenne d’Alsace, Les Portes du Temps repose sur une médiation numérique à destination des châteaux de la région.
Cette dernière s’appuie sur une application mobile qui présente une quête amorcée par une web-série, dans laquelle un alchimiste nous invite à retrouver des cristaux à travers les différents châteaux grâce à des questions, afin de débloquer des créatures magiques. Une programmation culturelle autour de ces monuments est également proposée. L’implication de l’artiste dans cet évènement et l’attachement de ce dernier à la région, se reflètent dans la réalisation d'œuvres s’inscrivant spécialement dans Les Portes du Temps, que l’on peut retrouver dans l’exposition Archi-Fantastic.
Ces médiations, qui nous apportent de nombreuses informations, ont pour but de faire gagner ce patrimoine représentatif de la région, peu connu ou reconnu par les Alsacien.ne.s, en visibilité, et de mettre en lumière ceux et celles qui protègent et rendent ces lieux vivants, tels que des veilleurs de forteresses ou des associations.
Vous pouvez retrouver le Château de la Neuenbourg sur Facebook.
Exposition ouverte jusqu’au 31 août 2021.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
- Le site internet Les Portes du Temps
- La web-série
- Le portfolio de John Howe
#fantasy #patrimoine #interprétation

Associer ses publics à la programmation culturelle ?
Retour d’expérience sur la démarche participative menée pendant la fermeture du Musée Zoologique de Strasbourg.
Comment maintenir un lien avec son public quand les portes d’un musée sont fermées ? Comment associer son public à la vie d’un musée et comment le faire sans sur-promettre ? En 2019, le Musée Zoologique de Strasbourg fermait ses portes pour une rénovation d’envergure. Plutôt que de laisser cette parenthèse couper le lien avec ses visiteurs, le musée a choisi de lancer une démarche participative centrée sur la programmation culturelle du futur musée. Une démarche ambitieuse sur trois ans qui offre aujourd’hui un retour d’expérience précieux pour toutes les structures culturelles.
La fermeture du musée : un cadre clair pour une ambition assumée
La rénovation du musée, fermé depuis 2019, est un chantier co-porté par la Ville et l’Université de Strasbourg qui visait à moderniser les espaces, repenser le parcours de visite et inscrire l’institution dans une approche sensible aux enjeux contemporains de la biodiversité. Mais ces travaux ont soulevé une interrogation primordiale : que faire pendant cette longue période sans public ? Des actions hors les murs étaient prévues mais elles concernaient essentiellement les publics scolaires. C’est à l’initiative de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec la direction de la Participation citoyenne, qu’a émergé une proposition plus large : concevoir une véritable démarche participative. Le projet architectural et muséographique ainsi que les expositions prévues pour la réouverture étant achevés, il s’agit de ne pas simuler un pouvoir décisionnel illusoire, mais d’engager une consultation sincère qui soit prise en compte. Le choix est donc fait : la démarche participative porte sur la future programmation culturelle. C'est en effet, un des seuls champs encore modulables à ce stade du projet, et celui où les apports des habitants peuvent être concrètement intégrés pour une mise en œuvre réaliste de la participation. L'idée est de créer un temps ritualisé pour penser, avec les habitants, les types d’activités, formats de médiation, manières d’habiter le musée qui composeront la programmation culturelle du futur musée.
La démarche est portée par Maïlys Liautard (Chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg, référente intermusées et hors les murs) et Joanne Hughes (chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg et référente pour le Musée Zoologique). Le cap, dès le départ, est de faire du musée un équipement culturel de proximité, en s’adressant à des habitants représentatifs de la diversité sociale et culturelle du territoire. Pour cela, elles ont été accompagnées par les structures Artizest, spécialiste de la participation citoyenne et de la méthodologie collaborative, et Mêtis une association proposant notamment des services de conseil et de recherche en muséologie pour une démarche articulant co-élaboration, évaluation et inclusion.
Une démarche structurée en trois temps
L’intelligence de cette démarche repose sur sa construction itérative, avec des évaluations intégrées à chaque étape, permettant d’enrichir progressivement le processus sans jamais le figer. « Il n’y avait rien de prédéfini. Ce sont les réponses au questionnaire, les échanges, les tests, qui ont permis de faire évoluer la démarche à chaque étape » explique Joanne Hughes. Chaque phase est accompagnée d’une auto-évaluation qualitative et d’outils de retour d’expérience, notamment des questionnaires de satisfaction, des entretiens post-ateliers et des grilles d’observation permettant d’évaluer le vécu des participants, l’atteinte des objectifs et l’efficience des dispositifs testés. Cette rigueur méthodologique s’est révélée indispensable pour garantir l’agilité et l'efficacité du dispositif.
Trois grandes phases ont rythmé l’expérimentation entre 2022 et 2025 :
- Phase 1 : sonder les représentations et les envies
À l’automne 2022, un questionnaire grand public (papier et en ligne) a recueilli 666 réponses, apportant une première cartographie des pratiques culturelles, attentes, freins et suggestions. Cette phase a permis d’identifier des profils récurrents, mais aussi des angles morts tels que des publics peu habitués des musées mais curieux, par exemple.
- Phase 2 : croiser les regards, ajuster les hypothèses
Au printemps et à l’automne 2023, l’équipe engage une phase qualitative. Cinq petit groupes de discussion sont constitués à partir des profils identifiés lors de la phase précédente : familles du quartier (9 parents et 8 enfants), 12 étudiants, 7 spécialistes, 7 usagers du CSC La Parenthèse et 6 personnes en situation de handicap mental. En parallèle, des stands mobiles sont tenus lors d’événements locaux (environ 480 personnes rencontrées, dont 150 enfants). Les méthodes employées sont adaptées aux publics : outils FALC, supports visuels, jeux de positionnement, etc. Cette phase permet d’affiner les besoins, de recueillir des ressentis, mais surtout de confronter les
propositions à leurs usages concrets.
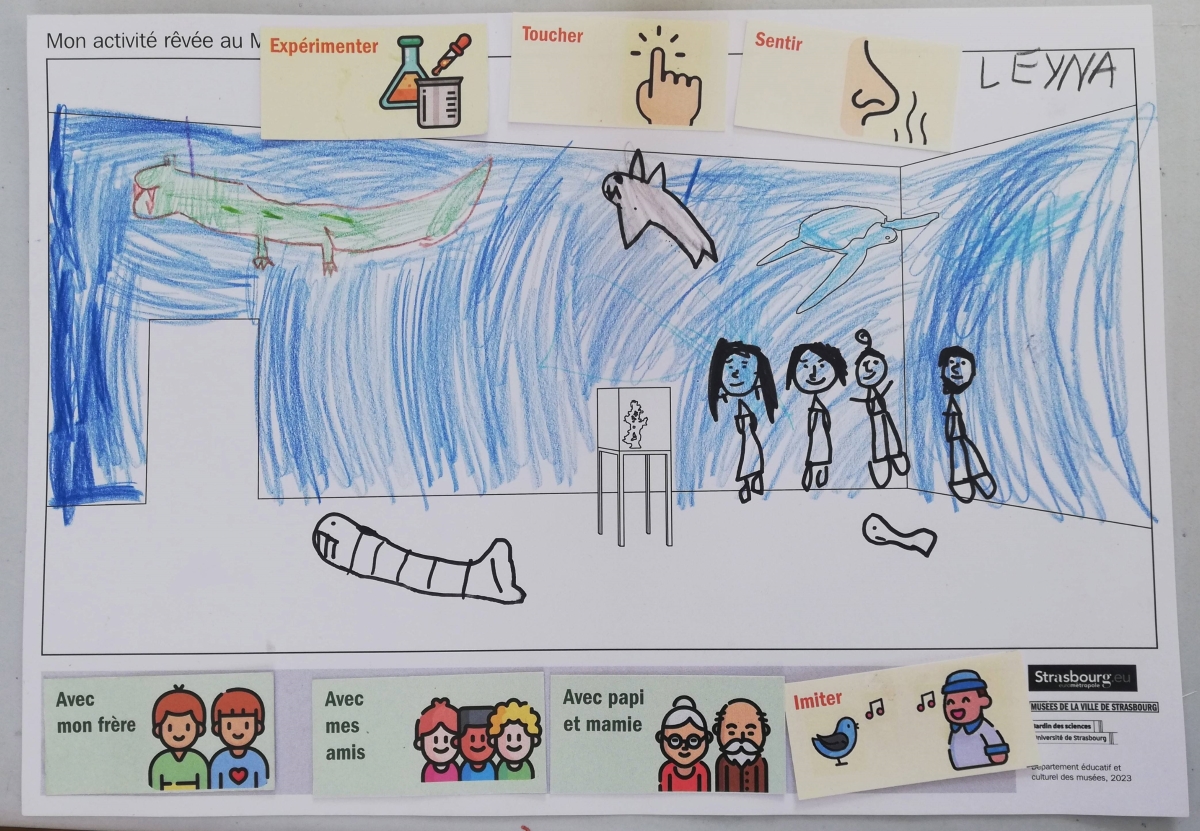
Dessin issu de l’atelier « Mon activité rêvée » © Musée Zoologique de Strasbourg
- Phase 3 : concevoir collectivement des formats à expérimenter
À partir des enseignements précédents, quatre ateliers de co-création sont proposés en 2024. Le choix est fait de revenir vers des groupes de la phase 2 qui sont les publics moins habitués et moins entendus dans la consultation au musée et déjà identifiés comme prioritaires : famille CSC et étudiant. Ces rencontres réunissent 63 participants ou deux formats d’activités sont alors co-imaginés : le mur participatif (porté par les étudiants, conçu comme un dispositif express de vote et de réaction visuelle à chaud), et le crash-test citoyen (pensé avec les familles). Parmi les suggestions explorées, celle d’un café des voisins émerge comme un possible format à activer plus tard.
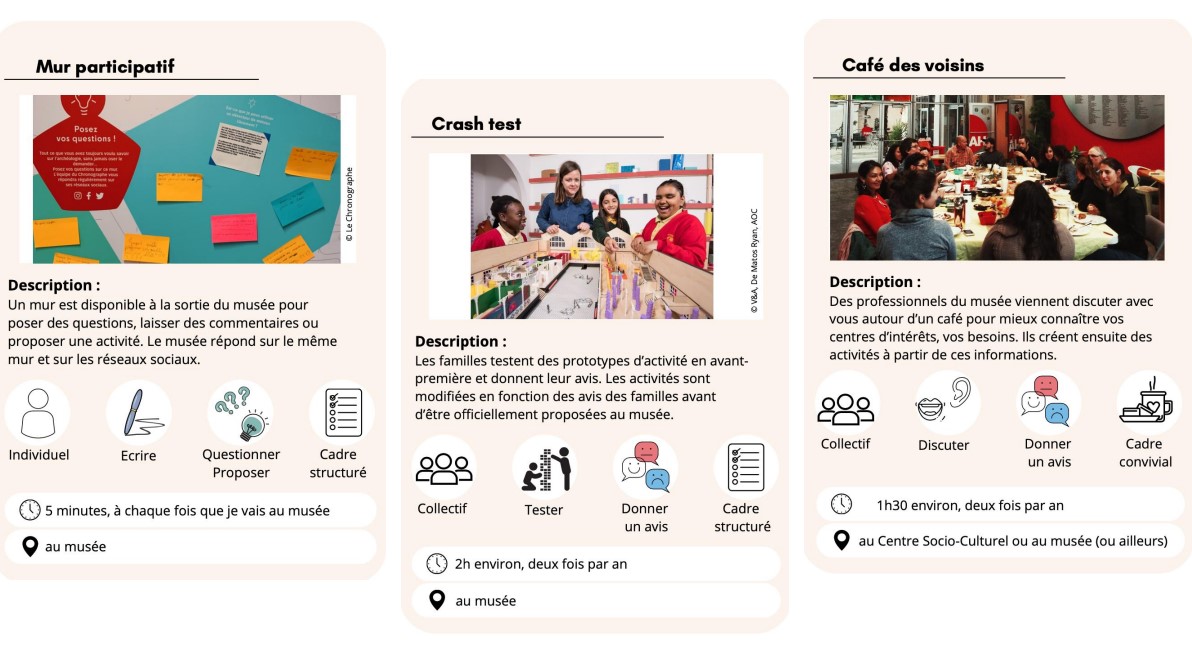
Visuels des cartes © Alexia Jacques-Casanova _ Artizest
Les deux dispositifs sont testés en conditions réelles à la rentrée 2024. Des questionnaires de retour sont exploités, les formats ajustés. Certains sont conservés, d’autres réévalués. Cette phase parachève une démarche d’écoute continue et d’ajustement permanent.
Les valeurs de fond : clarté, sincérité, adaptabilité
Trois grands principes structurent cette démarche :
D'abord un cadrage clair. Le périmètre est toujours explicitement défini : il ne s’agit pas de voter les scénographies ni de commenter les collections, mais de participer à l’élaboration des activités culturelles futures. Ce cadrage strict permet d'éviter la frustration, permet un engagement sincère, et favorise la lisibilité de la démarche.
Mais aussi un cadre relationnel éthique et cohérent. Les participants sont mobilisés en tant que personnes concernées, pas comme représentants de catégories. On les invite à parler en leur nom, pas pour d’autres. Les équipes ont aussi pris soin de questionner les propositions plutôt que de les valider systématiquement afin de décoder les besoins implicites. Joanne Hughes nous donne par exemple le cas suivant : « On a eu un enfant qui a laissé un post-it sur le mur d’expression indiquant son rêve de pouvoir « ressusciter les animaux » présentés au musée, vœu derrière lequel on peut interpréter une sensibilité pour la question des espèces disparues et/ou pour la question du
positionnement éthique du musée et de la provenance des collections, auxquelles on pourra chercher à apporter des réponses (alors qu’on n’a bien sûr pas la possibilité de réaliser littéralement ce rêve) ; de la même manière, lorsqu’un autre enfant écrit vouloir « caresser les animaux dans la vitrine », à défaut de pouvoir faire toucher les collections patrimoniales fragiles, on peut imaginer proposer des activités multisensorielles en ayant recours à du matériel pédagogique, des échantillons de peaux, etc. »
Enfin une adaptabilité constante. La force du processus réside dans sa capacité à s’ajuster. Aucun format n’est figé. Le processus accepte les détours, les réajustements. Il repose sur une posture de test, d’écoute, et de réaction.
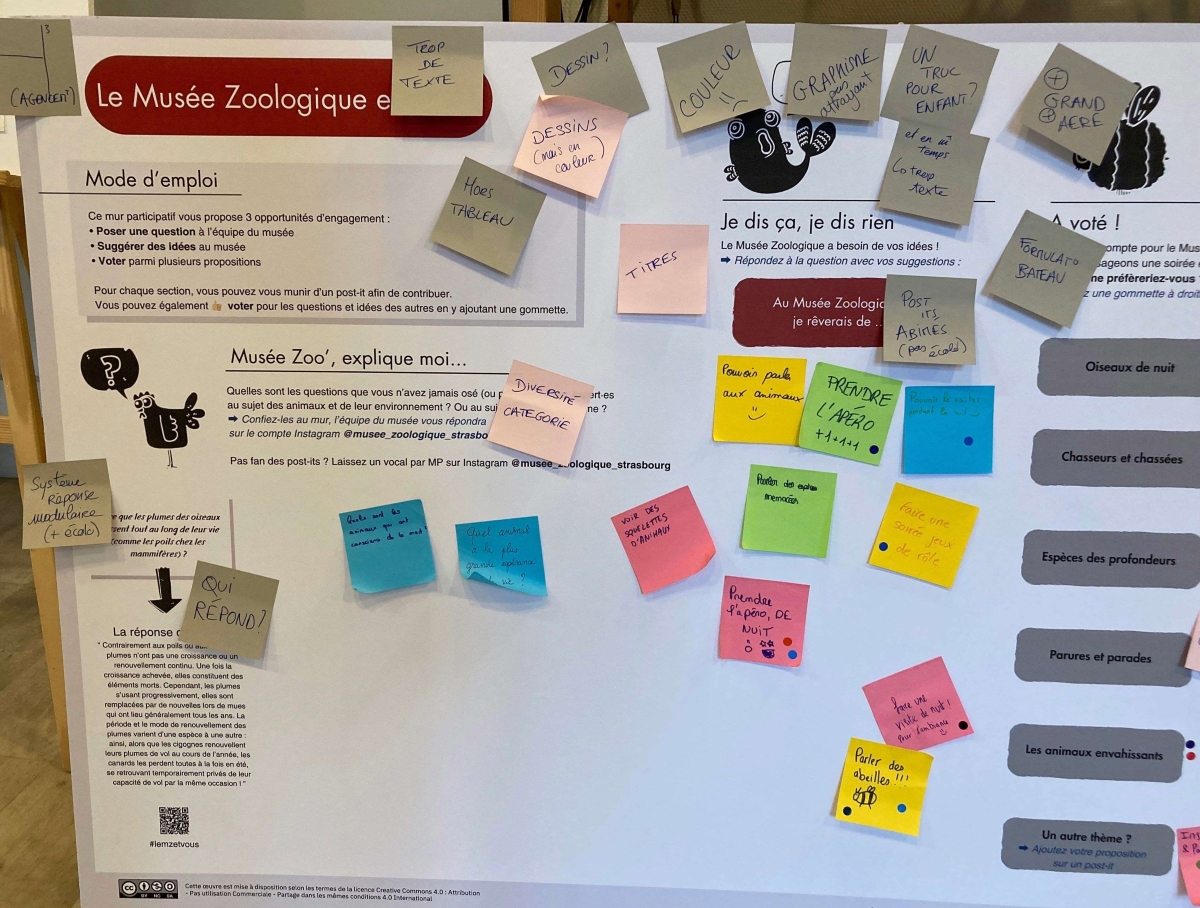
Atelier étudiants, Octobre 2024 © Maïlys Liautard.
Et maintenant ? Ce que la démarche transforme
Aujourd’hui, cette démarche constitue un socle. Pas un modèle à reproduire tel quel, mais un cadre de travail, une manière de poser des questions, de penser la programmation autrement. Pour Joanne Hughes, elle est devenue une "boussole professionnelle". « On ne peut pas faire du participatif en continu. Mais on peut garder en tête une logique d’écoute, d’interrogation, dans chaque choix qu’on fait. ».
Grâce à ces ateliers et aux multiples rencontres un lien de confiance est créé qui permet à un « répertoire » de participants de naître. Ce lien déjà tissé reste activable en fonction des besoins car il y a la volonté de recontacter ponctuellement les personnes ayant participés à la démarche pour des test d’atelier ou de visite par exemple. Ce vivier souple, construit dans le temps, est aussi pensé pour être renouvelé ce qui permet une continuité sans épuisement.
Et ailleurs ? Pour une approche réaliste et transposable
Trois ans, c’est long. Mais les principes expérimentés ici sont adaptables à des temporalités plus courtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation ne s’improvise pas : elle se construit, elle s’ancre dans le temps, et elle se pense avec méthode. La démarche du Musée Zoologique démontre qu’il ne s’agit pas d’une question de moyens, mais d’une posture : une volonté institutionnelle claire, une rigueur méthodologique, et une capacité à ajuster le cap selon les réalités du terrain.
Elle montre qu’une démarche participative est possible, réaliste et féconde, à condition de :
- Poser un cadre clair sur ce qui est ouvert à discussion,
- Incarner la démarche : qu’elle ait un visage, un lien humain,
- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,
- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,
- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,
- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,
- Intégrer l’évaluation continue de la démarche dans la logique même du projet.
La participation n’est pas une méthode toute faite. C’est un investissement sur plusieurs plans : humain, méthodologique, professionnel. C’est investir dans une équipe, du temps, des financements, mais comme tout ce que l’on cultive : ce que l’on sème aujourd’hui se récolte demain. Déjà, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de rester en lien avec le musée après sa réouverture, et certains formats testés comme le crash test et le mur participatif sont d’ores et déjà intégrés dans la programmation à venir c'est une preuve concrète d’une continuité entre consultation et mise en œuvre.
Le mérite de la démarche est de ne pas avoir cédé à la tentation du « participatif performatif » qui n'est pas pris en compte et finit par décevoir. Le Musée Zoologique a proposé une méthodologie solide, située, humaine, et pensée pour durer. Un cap, des limites, une rigueur et une sincérité dans la démarche qui en fait, pour d’autres structures culturelles, un exemple à suivre et à adapter !
Lorraine KLEIN
Toutes les citations proviennent de propos recueillis dans le cadre d'entretiens réalisés le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025 au Musée Zoologique. Remerciements à l’équipe du Musée Zoologique de Strasbourg et du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg. Plus particulièrement à Samuel Cordier, Joanne Hughes ainsi qu'à Maïlys Liautard.
Pour en savoir plus : https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/406076015
#DémarcheParticipative #ProgrammationCulturelle #Public

Bébé au musée
Bébés et parents sont les bienvenus au musée du Louvre-Lens pour partager un moment autour d'une oeuvre spécifique. L'animation "Bébé au musée" a été conçu pour vivre ensemble les premiers émois artistiques par le récit, le chant, le dialogue et l'éveil sensoriel. Découvrez le reportage d'Elise sur cette médiation proposée à partir de neuf mois !
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Elise Mathieu

Chemins de traverse : L’école muséographique buissonnière
Enfilez vos chaussures de marche ! Munissez-vous de votre crème solaire indice 50, enfournez les barres énergétiques dans votre sac à dos et rechargez votre gourde ! Surtout les amis, n’oubliez pas votre carte IGN… Vous êtes fin prêts ? On part à la rencontre de l’art contemporain !
À l’évidence, vous aimez la randonnée au cœur de grands espaces naturels préservés, la création contemporaine est votre péché mignon et en même temps vous êtes férus de patrimoine rural… Diable, cinq semaines par an ça n’est décidément pas suffisant… que choisir et comment faire pour réunir vos trois violons d’Ingres ? Tendez l’oreille, il existe des endroits fabuleux qui sont faits pour vous. Lacez vos chaussures et en route, nous partons à la rencontre de l’un d’entre eux !

Sentinelle d’Andy Goldsworthy dans Vallée de l’Asse, Tartonne © Brigitte PÉTRÉ
Nature, culture et territoire : le triptyque fertile
Prenez une grande inspiration. Vous sentez l’air des montagnes dignoises qui fait frétiller vos narines et réactive vos sens endormis par les pollutions quotidiennes. Allez, prenez une gorgée d’eau fraîche, le chemin sera long et levez le nez, les paysages sont exceptionnels.
Petits veinards, vous êtes au cœur de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Ici, prière de ralentir. À contre-courant de l’effervescence des musées et de la boulimie de l’art, le projet artistique Refuge d’Art est né d’une heureuse association entre le musée Gassendi, la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence et l’artiste britannique Andy Goldsworthy. Réalisé entre 1998 et 2010, ce parcours d’art contemporain de 150 kilomètres est ponctué des œuvres de l’artiste, il s’articule autour de trois sentinelles et sept refuges d’art réalisés au sein d’anciens bâtiments à l’abandon (chapelle, bergerie, grange, etc.). Certains d’entre eux sont équipés de dortoirs pour abriter, le temps d’une nuit, les randonneurs de passage.
« À cause des distances entre les refuges d’art, j’ai suggéré de restaurer d’anciens bâtiments afin que les gens puissent y passer la nuit, tout en intégrant une sculpture dans la rénovation. Pour moi, il existe une différence fondamentale entre l’œuvre d’art que l’on regarde quelques minutes dans un musée et l’œuvre avec laquelle on vit pendant un peu de temps, avec laquelle on dort. Dormir dans une sculpture, c’est une idée merveilleuse. »
Andy Goldsworthy

Chapelle Sainte-Madelaine, Toard © Musée Gassendi

Refuge d’Art, Vieil Esclangon © Musée Gassendi
La réhabilitation de ce patrimoine rural témoigne de la dimension sociale et économique du projet d’Andy Goldsworthy. Effectivement, en donnant une seconde vie à ces villages abandonnés, l’attrait touristique de la région s’est largement développé permettant ainsi de favoriser et de consolider des emplois locaux. L’art en chemin est l’association qui vise à valoriser et mutualiser ces activités professionnelles régies par les mêmes valeurs : « solidarité territoriale, lien social, coopération et respect » selon Pascal Bodcher, accompagnateur en montage. L’idée est d’accompagner un tourisme durable pour préserver la vallée tout en y développant des activités culturelles transdisciplinaires.
Cette œuvre d’art est à parcourir en une dizaine de jours de marche mais pour les moins téméraires, pas de panique ! Des randonnées de 1h30 à 6h sont réalisables à la journée avec des niveaux de difficulté accessibles à tous. Vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas partir à la rencontre de la poésie du travail d’Andy Goldsworthy.
Je profite que nous foulions les sentiers des alentours de Digne-les-Bains pour vous informer qu’outre ce projet monographique, le musée Gassendi s’attache depuis 1995 à constituer sur cette même réserve une collection d’œuvres d’art à ciel ouvert. Divers artistes contemporains tels que Richard Nonas, herman de vries, Mark Dion, Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette et d’autres ont travaillé in situ en symbiose avec les montagnes pour offrir leur propre lecture du lieu. Le musée propose aux visiteurs une approche de ces œuvres à travers vingt suggestions de randonnées, éditées en 2012 dans le livre L’art en marche.
Allez, on s’arrête un moment à l’ombre d’un cairn pour reprendre notre respiration et on y retourne pour comprendre pourquoi on marche autant depuis tout à l’heure.
« La marche comme médiation sur le paysage » : une expérience totale
« Dans l’acte de marcher, il y a le déplacement d’un pont à un autre, mais il y a surtout un effort, une intention, qui rendent la découverte de chaque œuvre plus intense et intime. »
Nadine Gomez, Conservatrice du musée Gassendi et directrice du CAIRN.
La proposition artistique d’Andy Goldsworthy organisée autour de stations nécessite, vous l’avez compris, un visiteur mobile qui réalise malgré lui une performance. C’est l’expérience de la marche qui fait art plutôt que la sculpture qui n’est finalement qu’un prétexte pour ressentir et faire corps avec le paysage dans lequel nous évoluons. Ces cairns, ces serpentins dans la terre, ces sculptures de pierres, ne sont que des invitations à ralentir et réfléchir à l’action de l’Homme sur le paysage. La marche est alors le moyen d’opérer cette prise de conscience chez le marcheur-visiteur qui est, à cet instant, intimement lié à l’écologie des montagnes dignoises.
L’artiste a filé la métaphore à la Longside Gallery avec une proposition artistique, Mud ball, présentée en 2007 et 2008 pour les trente ans du Yorkshire Sculpture Park. Cette œuvre d’art, tel un work in progress, est composée jour après jour des débris végétaux (herbe, feuilles, boue) apportés par les chaussures des visiteurs, vestiges de leur traversée du bois et des prairies du parc. Matérialisée, amassée et totémisée dans une grosse boulle de boue, la marche des milliers de visiteurs-marcheurs est l’expression la plus littérale de cette idéologie selon laquelle l’expérience du visiteur crée l’œuvre.
Ainsi, ne me demandez pas « c’est quand qu’on arrive ? », vous savez que l’important n’est pas le but mais le chemin.
Un concept qui fait des petits
Alors bien sûr, vous allez me dire que cette idée de marche dans l’art n’est pas nouvelle et que des artistes comme Richard Long, Francis Alÿs ou bien Marina Abramović l’ont exploitée depuis fort longtemps. Mais à l’heure où la randonnée n’a jamais été autant à la mode et où la population fait ressentir un réel « besoin de nature », ces parcours d’art contemporain en pleine nature fleurissent un peu partout en France et ce sont alors les visiteurs qui se mettent en mouvement.

Grand Lineux#2 de Xavier Rèche, Parcours des Fées, 2016 © Photodicidela
Non loin de Refuge d’Art et du musée Gassendi, la Via Per l’Art Contemporanea (VIAPAC) est un sentier de randonnée transfrontalier de 200 kilomètres servant de jonction touristique entre les villes de Digne-les-Bains en France et Caraglio en Italie. D’envergure européenne, le projet rassemble les travaux d’une douzaine d’artistes contemporains dont Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette, Stéphane Bérard, Mark Dion, Richard Nonas et bien d’autres. On peut encore une fois déplorer le fait que ces artistes de la scène contemporaine se conjuguent seulement au masculin bien que les femmes fassent partie intégrante de ces recherches informelles sur la nature et l’art. Je vous invite à consulter le bel ouvrage de Virginie Luc, Les magiciennes de la terre édité en 2017, qui fait la lumière sur le travail de 17 d’entres elles.
D’autres parcours d’art contemporain accueillent à l’année les randonneurs curieux adeptes de la marche culturelle à l’image de La Forêt d’Art Contemporain dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne ou encore Le Vent des Forêts. Implanté dans la Meuse depuis 1998, il constitue l’un des plus anciens « espace rural d’art contemporain » avec 70 bénévoles et 45 kilomètres de sentiers balisés. Chaque année, des artistes plasticiens en résidence étoffent la collection constituée à ce jour de plus de 90 installations.
À l’image du Voyage à Nantes, les territoires ruraux semblent avoir trouvé la parade pour rendre attractif leur territoire et redynamiser leur économie : une installation artistique in situ par-ci par-là le long de sentiers et le tour est joué ! Chaque été, pléthore de festivals d’art contemporain ouvrent leurs portes dans nos vallées et nos campagnes. J’ai choisi de vous présenter l’un d’entre eux qui a une forte dimension sociale et qui s’inscrit réellement dans une démarche de démocratie culturelle.

Installation dans les 5000 hectares du Vent des Forêts © COAL
Située dans la vallée de la Drobie au cœur du Parc Régional des Monts d’Ardèche, cette initiative est née des habitants et des promeneurs qui se désolaient de voir se désertifier leur paysage. De leur union jaillit un projet collectif, Sur le sentier des Lauzes, pour la création d’une « Vallée Culturelle ». Une repartie finement orchestrée contre le douloureux exode rural. Tout en encourageant et en accompagnant les contacts entre habitants, artistes et paysages, l’association a développé des résidences d’artistes qui, chaque année, contribuent à la réalisation d’un Parcours d’Art en Paysage. Une pierre deux coups ! Cet événement fédère les locaux au territoire en leur proposant un renouvellement culturel et attire des touristes avides de découvrir la vallée de manière singulière. Des touristes qui consomment et qui réenclenchent l’économie locale bénéfique aux habitants qui résident sur le territoire. La boucle est bouclée. Ces actions sont menées avec un réel respect de l’environnement et accompagnées d’une réflexion sur l’impact de ces projets par rapport à l’unité des paysages naturels. Une question épineuse qu’il serait imprudent d’ignorer.

Parcours des Fées, octobre 2015 © Serge San
Cette association n’est pas la seule à briller par sa démarche artistique et sociale, à 200 kilomètres à l’est, par exemple, dans la vallée de Crévoux, le Parcours des Fées organisé par l’association Fées d’hiver fait également partie de ces acteurs qui préfèrent « faire ensemble » plutôt que « pour ».
J’espère que vous en êtes maintenant convaincus. La création contemporaine en zone rurale est pleine de ressources quand elle est une manière de nous révéler l’enchantement de nos campagnes et le charme naturel de ses habitants.
Si vous n’en avez toujours pas plein les gambettes, prenez note des prochains rendez-vous de l’été 2019 et venez marcher l’art contemporain. Alors oui, peut-être, vous sentirez un peu plus la transpiration à la fin de votre sortie culturelle mais que diable, nous sommes corps et esprit indissociables, tâchons d’en prendre soin et de les nourrir simultanément le plus souvent possible.
Pour plus d’informations :
- Refuge d’Art : http://www.refugedart.fr
- VIAPAC : http://www.provence-alpes-cuneo.eu/fr/culture/viapac.html
- La forêt d’Art Contemporain : http://www.laforetdartcontemporain.com
- Le Vent des Forêts : http://ventdesforets.com
- Sur le sentiers des Lauzes : http://surlesentierdeslauzes.fr
- Parcours des Fées : http://parcours-des-fees.fr
D’autres parcours d’art contemporain à marcher en France :
- Les bords de la Vire (Manche) : http://www.usine-utopik.com/festival/
- Arras Artitude : http://arras-artitude.fr/fr/accueil/
- Parcours d’art contemporain en vallée du Lot : http://www.magcp.fr/project/measure-the-valleysparcours-dart-contemporain-en-vallee-du-lot01-07-02-09-2018/
- Horizons – Art et Nature en Sancy (Auvergne – Rhône-Alpes) : https://www.horizons-sancy.com
- Les balcons de l’Aigoual (Haute vallée de l’Hérault – Parc national et Cévennes) : https://www.lafilaturedumazel.org/parcours-land-art-les-balcons-de-l-aigoual/
- Aux bords des paysages, Pic Saint-Loup (Occitanie) : https://www.auxbordsdespaysages.com
- Vassivière Utopia (Creuse – Haute Vienne) : https://www.lamontagne.fr/saint-martin-chateau/environnement/creuse/2018/09/26/comment-le-centre-d-art-dessine-le-paysage-avec-son-programme-vassiviere-utopia_12994407.html

Comment faire de la médiation culturelle dans un lieu fermé au public ?
Insensé, impossible, étrange me direz vous !? C’est pourtant l’une des missions qui a rythmé mon année d’apprentissage à la Villa Rohannec’h à Saint-Brieuc.
Avant de livrer mes « secrets » de médiatrice, un peu de contexte historico-politique
La villa est un lieu en semi-friche, ancienne villa d’armateur, datant du début du 20ème siècle, dont le style architectural est directement influencé des riches villas italiennes.
Achetée par le département des côtes d’Armor en 1946, elle est mise à disposition du Ministère de l’agriculture pour y installer une école ménagère. Collège agricole féminin puis lycée agricole mixte la villa devient un établissement d’enseignement public pendant une quarantaine d’année. Le site ferme en 1994 pour cause de vétusté du bâtiment. Le lieu est semi-abandonné jusque dans les années 2010. Il accueille des réfugiés bosniaques en 1995 et une exposition d’art contemporain Extérieurs/Intérieurs en 1999.
Entre 2011 et 2015, la villa fonctionne sous forme de programmation estivale. Chaque été une équipe composée de vacataires se forme le temps de quelques mois. Les usagers s’approprient le site et en deviennent les « habitants ». Les espaces s’aménagent et se transforment au gré des thématiques des saisons culturelles d’année en année. Les visiteurs sont accueillis au rez-de-chaussée, seul espace aux normes.
Une situation malheureusement fragile au regard du fonctionnement départemental.En 2015, un changement de mandature réoriente le devenir de la villa Rohannec’h. Un restaurant panoramique, une maison de retraite ou un bulldozer pour la détruire ? Que faire de cette vieille villa qui tombe en ruine ? Le site est finalement conservé en tant que site culturel.
Depuis 2016 le site se réinvente en fabrique artistique, culturelle et territoriale à travers le soutien à la création contemporaine. Les artistes et étudiants, plasticiens, designers, paysagistes, cinéastes s’approprient les lieux et proposent des créations faisant écho au lieu et à son contexte territorial. L’accueil de ces différents « habitants » éphémère et leur vision du site de Rohannec’h nourrissent le projet culturel.
L’accueil et la co-organisation de Museomix en novembre 2018, permet un tournant dans le projet culturel de la villa, lui permettant d’affirmer de grands axes de travail : accueillir, faire patrimoine commun, soutenir la création, expérimenter et impliquer les usagers.
Projet culturel de la villa Rohannec’h © designed by Justine Faure
Accueillir, impliquer les usagers ? Dans un lieu qui n’ouvre que trois fois par an, accessible uniquement au rez-de-chaussée, seul espace mis aux normes pour l’accueil du public (la villa est composé de 3 étages, d’un toit terrasse et d’un sous sol, le tout équivalent à 1300m²) ?
Le problème ? Comment une équipe de 2 personnes peut-elle être présente sur tous les fronts : communication, médiation, logistique, administratif, accueil,… ? Impossible ! Ces grands axes de travail sont des aspirations de développement du lieu, mais cela reste très complexe.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre le contexte dans lequel j’arrivais en apprentissage.
Visiteurs du parc, collègues, élus, voisins… Personne ne semblait comprendre le lieu, ses idées, son devenir… Je devais donc faire preuve d’ingéniosité pour faire comprendre ce qu’il se passait derrière ces grandes fenêtres sans faire entrer le public ! Le parc de villa étant ouvert au public tous les jours, c’est environ 100 000 milles personnes qui déambulent chaque année.
Alors comment ai-je fait ?
Etape 1 : M’identifier auprès des visiteurs pour établir un dialogue avec eux.
« Cher.e.s curieux.ses, je m’appelle Justine et je serai votre hôte pendant les six prochains mois. Je vous embarque dans la vie de la villa à la découverte des traces laissées par ses habitant.e.s d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et des histoires qu’elles nous racontent. La villa est mon terrain de jeu : entre intérieurs et extérieur, les murs, fenêtres et terrasses seront mes outils pour dialoguer avec vous ! »
Pendant les rares ouvertures de la villa ou lorsque j’étais de passage dans le parc, cela a permis aux visiteurs ayant des connaissances sur l’histoire du lieu ou ayant vécu à la villa, de pouvoir s’identifier auprès de moi. J’ai ainsi commencé une collecte de témoignages oraux. Même en faisant de la médiation sur un lieu fermé, le contact humain reste important !
Etape 2 : Faire parler les façades : supports de dessins et d’anecdotes

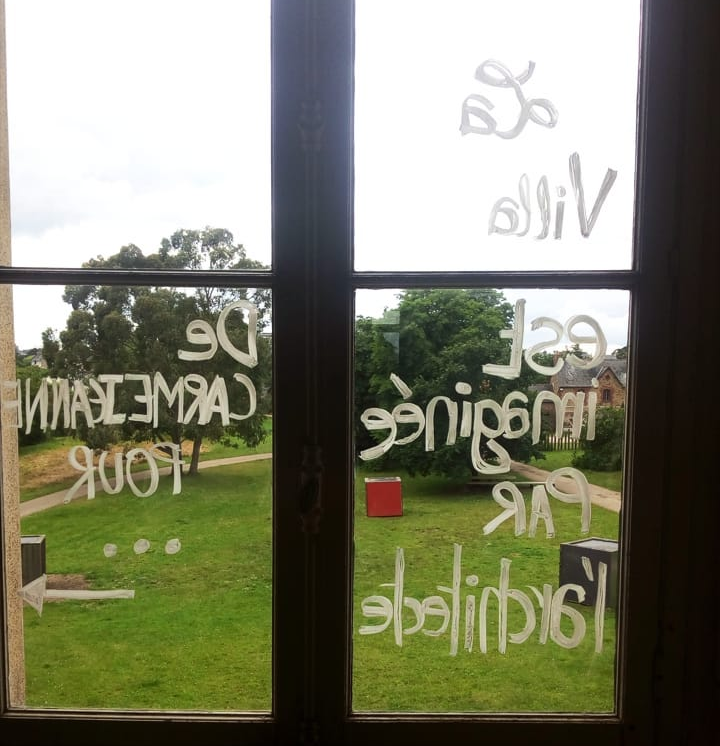
Fenêtres de la ville Rohannec’h © Justine Faure
Aussi simple que cela puisse paraître, c’est ce qui a le mieux fonctionné. En écrivant sur les différentes fenêtres de la villa, je livrais un message, une anecdote sur l’histoire de la villa. C’était assez amusant de voir les passants, depuis mon bureau, lever la tête en l’air pour lire tout en faisant le tour de la villa pour découvrir la phrase complète. Même si ce n’était que quelques mots, une phrase par ci par là, c’était la seule chose que les visiteurs avaient à se mettre sous la dent pendant leur promenade.
Etape 3 : Quand Instagram devient un outil de médiation culturelle
Outre l’idée de faire passer un message historique, je me suis aussi demandé comment montrer l’intérieur sans ouvrir.
J’ai décidé de créer un compte Instagram, réseau social de la photographie. Cependant j’ai utilisé cet outil de communication comme un outil de médiation culturelle. Le but était de réaliser une sorte « d’exposition virtuelle » montrant les intérieurs de la villa et leurs usages à travers le temps et l’histoire du site. Sur le principe du story-telling, les usagers pouvaient chaque semaine découvrir la villa selon une thématique différente et surtout apercevoir et découvrir les intérieurs, les détails, en bref tous les aspects cachés de la villa.
Un principe qui a permis de générer une banque d’images des intérieurs de la villa, des traces laissées par ses divers habitants au fil du temps.
Etape 4 : Un support pour parler de la villa hors les murs
Dans le cadre de la mise en place d’une « bibliothèque buissonnière » dans le parc de Rohannec’h, avec la bibliothèque de la ville de Saint-Brieuc, j’ai eu l’occasion de co-construire un dispositif de médiation.
L’idée était de proposer aux visiteurs un atelier d’expression sur la villa Rohannec’h. Dans un premier temps ils pouvaient écrire et/ou dessiner pour raconter un souvenir, témoigner, inventer la villa du futur, etc.
Dans un deuxième temps les visiteurs étaient invités à deviner les usages et occupations des différentes pièces de la villa par le biais du dispositif suivant :
Le support de médiation villa Rohannec’h © Justine Faure
Les façades de la villa Rohannec’h ont été découpées en quinze morceaux représentant chacun des espaces différents de la villa. Ces morceaux forment de petits carnets construits à la manière des livres de Tana Hoban. Cette photographe et auteur utilise son travail photographique dans la réalisation de livres pour enfants. Le livre Regarde bien1est celui qui a inspiré la démarche créative pour réaliser ce dispositif. Une page noire, un cercle découpé au milieu de la page, duquel on aperçoit un détail de la photo se trouvant sur la page suivante.
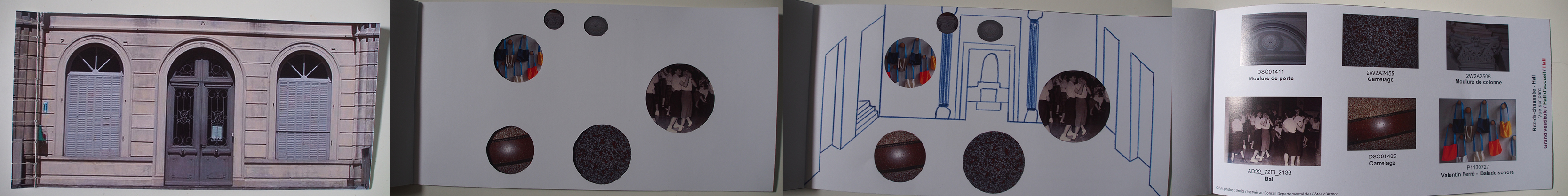
Les différents volets du carnet à la manière de Tana Hoban © Justine Faure
Comme l’enfant l’est dans le livre, à travers les photographies, le visiteur est ici invité à se demander ce qui se cache derrière telle fenêtre ou telle porte de la villa. Il peut ensuite vérifier en ouvrant le premier volet du carnet. Des images apparaissent, représentant chacune une période différente de l’histoire de la villa. Le deuxième volet représente la pièce avec les photographies situées dans l’espace. Enfin le dernier volet donne le crédit des photographies et leur légende. De cette manière nous pouvons échanger avec le visiteur sur l’histoire du lieu à travers les différentes pièces de la villa. Ont-elles eu différents usages ou au contraire ont-elles toujours gardé les mêmes ?
Le dispositif rend le visiteur acteur dans sa quête d’informations et nous permet d’instaurer un dialogue sur les usages passés et actuels du lieu. Les visiteurs comprennent pourquoi la villa est fermée actuellement en comprenant qu’elle accueille des artistes en résidence. Cela permet également de parler du projet culturel et des aspirations de la villa tout en concertant les visiteurs de manière informelle. En effet, à terme l’idée est d’utiliser le lieu comme une maison où les notions d’accueil et d’hospitalité prennent une place importante. Mais plus largement cela permet de créer du lien entre les usagers du site, de fédérer une communauté de personne et de peut être faire émerger de nouveaux usages pour faire évoluer le projet culturel et permettre aux « habitants » de prendre part réellement à la construction du site.
Faire de la médiation sur un lieu fermé au public la plupart du temps, implique de reconnecter ce lieu avec ses potentiels visiteurs afin qu’ils puissent eux aussi se l’approprier et en parler. Informer et transmettre permet de (re)donner vie au lieu et d’affirmer une position face aux politiques. Faire de la médiation, devient alors un moyen de résister !
Justine Faure
1. Regarde bien, Paris, coll. « Kaléidoscope / L'École des loisirs », 10 mars 1999, 48 p.
https://www.instagram.com/villa_rohannech/
#communiquer
#dialoguer
#etremediateur

Comment nous avons construit une cathédrale
A l’occasion des 800 ans de la cathédrale Notre Dame d’Amiens, la métropole a invité l’artiste Olivier Grossetête à construire une architecture insolite dont il a le secret de fabrication. L’évènement nommé « Les bâtisseurs cartonnent » propose aux habitant.es de participer à la construction d’une cathédrale géante le tout en carton. C’est l’occasion de revenir sur le projet artistique et humain que propose l’artiste au cours de ses interventions à travers le monde.

Affiche de l’évènement « Les bâtisseurs cartonnent » dans la ville d’Amiens.
©AGR
Le concept de l'artiste
Atelier de fabrication et modules d’assemblage.
©AGR
Entre production artistique et médiation collective
Phase de construction sur le parvis de la cathédrale Notre Dame d’Amiens.
©Amiens Métropole
Axelle Gallego-Ryckaert

Comment visiter du bout des doigts ?
Vous êtes un professionnel de la culture ? Vous travaillez dans une institution qui cherche à rendre accessible son parcours permanent aux visiteurs malvoyants ou non-voyants ? Vous souhaitez améliorer l’expérience de visite de tous ? Cet article est fait pour vous.
L’accessibilité universelle au musée ?
L’accessibilité universelle, concept auquel se réfèrent les professionnels, vise à offrir un accès au musée adapté à tous les publics, ce qui passe par la prise en compte des besoins spécifiques de chacun – dont les publics en situation de handicap font partie. Et ce, afin de proposer un parcours de visite unique, utilisable par tous les visiteurs, qui favorise une expérience de visite positive. S’il peut paraitre utopique d’imaginer pouvoir répondre aux besoins de chacun, des outils permettent de se rapprocher de cet idéal. De même, l’ensemble des outils ou dispositifs de médiation – hormis les vidéos en LSF*, qui sont ciblées pour les publics sourds signant et le braille – améliorent le confort de visite de chacun. Simplifier et clarifier les textes expographiques en FALC* profite autant aux visiteurs maîtrisant mal le français, aux enfants, qu’aux personnes en situation de handicap intellectuel. Les objets à toucher tels que les fac-similés ou les images visio-tactiles participent quant à eux à rendre le musée didactique et ludique, et se démarquent d’une vision élitiste. L’accessibilité globale est rendue possible dans l’enceinte de la structure muséale par une prise en compte non seulement du cadre bâti, mais également des contenus. Elle est établie comme un idéal vers lequel les établissements muséaux souhaitent et doivent tendre. Si ce postulat n’est pas admis de tous, l’accessibilité est – enfin – questionnée et mobilisée comme une prérogative essentielle des projets d’établissements culturels. Ainsi, elle s’est progressivement imposée comme une condition pour répondre à l’une des missions essentielles du musée : accueillir les publics.
L’émergence des parcours tactiles, un engouement récent
Depuis une dizaine d’années, de nombreux musées français engagés dans une démarche d’accessibilité se dotent de parcours tactiles. Jalonnant les espaces permanents, des stations permettent de découvrir un nombre restreint d’objets à toucher sous la forme de maquettes, de facsimilés en 3D ou d’images dites visio-tactiles – dont les lignes de contours mettent en relief un objet 2D.
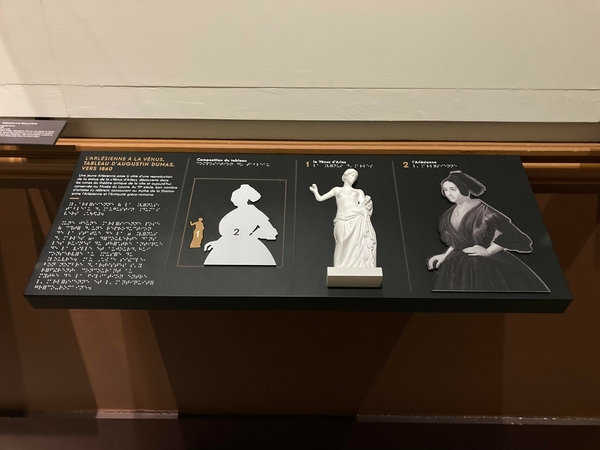
Station tactile du Muséon Arlaten « L’arlésienne à la Vénus » ©CL.
Pour les visiteurs privés de la vue, la découverte par le toucher est le principal mode d’appréhension et de compréhension des œuvres. Si ces dispositifs sont systématiquement conçus en ayant à l’esprit les besoins des publics en situation de handicap visuel, ils sont aussi le reflet d’une politique d’ouverture à tous les publics. En particulier les familles, et sont également conçus à cet effet. Récemment, divers établissements culturels se sont dotés de parcours tactiles. Musées nationaux, musées départementaux, musées de province, les tutelles et les statuts de ces institutions diffèrent. Les contextes de réalisation de ces parcours également : construction du musée, rénovation, refonte du parcours permanent ou encore ajout au parcours existant. Plusieurs musées nationaux ont vu le jour en France au 21e siècle, c’est notamment le cas du musée du Quai Branly – Jacques Chirac en 2006, ainsi que du Mucem, plus récemment en 2013. Ce premier est l’une des premières institutions à avoir intégré une démarche d’accessibilité de ses outils dans les parcours permanents, et ce, dès la construction du bâtiment. Aussi, dès l’origine, il existe dans ces deux sites une volonté d’être accessible. Cela se traduit notamment par l’intégration de parcours tactiles. Par ailleurs, au regard de la loi de 2005 et des nouvelles obligations d’accessibilité au sein des établissements culturels, plusieurs musées ont dans le cadre de lourds projets de rénovation, engagés d’importants travaux de mises aux normes et de réaménagements, impliquant la fermeture temporaire des établissements. L’occasion de réfléchir à l’accessibilité globale souhaitée dans ces futurs musées. Loin de se limiter à la conception d’un parcours tactile pour les publics déficients visuels, ces musées développent une offre plurielle et multisensorielle. Pour d’autres institutions culturelles, cette réflexion s’inscrit dans l’ADN du musée. À cet effet, les projets de refonte du parcours permanent apparaissent comme une véritable aubaine pour poursuivre la démarche engagée. Enfin, il existe un autre type de cas, plus rare cependant, où le parcours tactile n’est pas pensé en même temps que le parcours permanent, venant ainsi s’ajouter à postériori. C’est ce qui a été fait au Lugdunum Musée et Théâtres romains, à Lyon. Ce qui pose un certain nombre de difficultés, notamment en termes de cohérence.
1ère étape : sensibiliser les équipes
Porter un projet d’accessibilité suppose de travailler avec une équipe sensibilisée. Certains établissements optent pour la nomination d’un chargé de mission handicap et accessibilité, plus communément appelé « référent accessibilité ». Véritable personne-ressource, il est de son ressort d’avoir une vision transversale des besoins et de proposer des actions et outils concrets afin d’améliorer l’accessibilité du site. Le référent travaille en collaboration avec l’ensemble de l’équipe du musée, mais également avec les partenaires extérieurs tels que les architectes, graphistes, scénographes, afin de les rendre attentifs à tous les niveaux. Cependant, le reste de l’équipe se doit de garder à l’esprit la diversité des publics à besoins spécifiques auxquels s’adressent les expositions produites. C’est pourquoi certains établissements privilégient les postes de chargés des publics. D’autres, comme le MuséoParc Alésia, créent un pôle accessibilité, dont fait partie un représentant de tous les services du musée. Si la sensibilisation en interne repose sur la bonne volonté de chacun, elle est également le fruit d’un long travail rythmé par des journées de formations annuelles permettant à chacun de se sentir concerné. L’obtention de la labellisation Tourisme & Handicap apparait par ailleurs comme un véritable moteur d’engagement.
« Parce que d'une part, si l’on obtient le label, cela permet de communiquer dessus, d'être référencé sur le site qui est assez consulté par les personnes en situation de handicap. Mais c’est aussi l'occasion de faire un audit, donc ça donne des outils précieux pour avancer en interne et c’est une bonne manière afin d’établir une feuille de route et définir des priorités pour se rendre accessible » (Chargée de mission RSO du musée du Quai Branly Jacques Chirac, entretien réalisé le 15/06/2022)
Enfin, l’accompagnement d’un professionnel de l’accessibilité est particulièrement conseillé. L’équipe du musée peut s’entourer d’un consultant spécialiste, notamment pour réaliser un diagnostic, établir des préconisations en vue d’une labellisation et définir les besoins spécifiques à prendre en compte. Par ailleurs, nombre d’institutions travaillent de concert avec une assistance à maîtrise d’ouvrage – AMO*. Ses compétences de conseil permettent d’alerter sur les points de vigilances, de rédiger les cahiers des charges, de sélectionner les entreprises compétentes, de suivre la fabrication des dispositifs sélectionnés, mais aussi d’établir des liens et des partenariats avec des représentants institutionnels ou associatifs du champ du handicap. A titre d’exemple, l’agence Polymorphe design a accompagné le MuséoParc Alésia, l’entreprise Accèsmétrie a assisté le Muséon Arlaten et l’agence Handigo guide actuellement le Musée national de la Marine. Ainsi, en étant entouré par des professionnels qualifiés, très au clair avec les normes et préconisations en vigueur et en contact avec les représentants associatifs, les projets sont plus à même d’être menés à bien et de répondre véritablement aux attentes des publics à besoins spécifiques.
2sdétape : concevoir les dispositifs de médiation
Chaque projet est singulier : par la temporalité qui lui est propre, les enjeux internes à l’institution, les changements de mandatures, les coûts financiers attribués, les thématiques soulevées dans l’exposition, l’espace disponible, les différents acteurs impliqués et les relations créées. L’écosystème du projet est profondément lié à la méthodologie choisie et malgré un guide très détaillé édité par le ministère de la Culture et de la Communication, tout n’est pas applicable et relève du cas par cas. C’est souvent au service médiation que revient la mission de concevoir les dispositifs de médiation. Celui-ci doit donc penser la réflexion sur les contenus accessibles comme une réflexion sur les publics. Prenons l’exemple du Musée national de la Marine, dont le projet de conception du parcours tactile est en cours. La méthodologie employée est la suivante : l’équipe commence par définir les informations qu’elle souhaite transmettre (le contenu), puis les objectifs et les rôles de chaque dispositif, avant de définir les besoins spécifiques des différents publics à prendre en compte et enfin, la forme qui leur sera donnée. Il est question de diversifier les approches. Les dispositifs sont conçus et pensés d’abord pour leur rôle de transmission d’un discours manquant, qu’ils viennent compléter. Par ailleurs, le parti-pris muséographique de l’institution, en ce qui concerne les dispositifs tactiles, est de rendre compte des émotions procurées par les œuvres.
« On est parti espace par espace. Au tout départ : de quel sujet je parle ? Comment est-ce que je peux répéter l'information ou la compléter pour que ce soit clair ? Quelles activités peuvent être intéressantes ? Quel registre j'ai envie de mobiliser ? Est-ce que j'ai envie de faire rire les gens, de leur faire peur, de leur susciter de l'émotion, de leur rappeler quelque chose qui est familier pour eux ? […] Je pense que la réflexion pour nous, elle a été différente que pour d'autres musées. C'est de se dire « qu'est ce qui est important pour moi quand je vois une œuvre, moi, voyante ? ». Et en fait, c'est l'émotion qu'elle me procure. Donc j'ai besoin de comprendre à minima à quoi ressemble l'œuvre si c'est une sculpture, si c'est un tableau, si c'est un modèle. Quel format ? Qu'est-ce qu'elle présente ? Et surtout, quelle émotion elle dégage ? On a ensuite travaillé sur les besoins, comment transmettre ce contenu. Et une fois que vous avez un peu tout listé, comment on fait pour rentrer ça dans un seul et même dispositif. » (Chargée de médiation et référente accessibilité au Musée national de la Marine, entretien réalisé le 15/06/2022).
Pour l’équipe du MuséoParc Alésia, il était primordial d’avoir un outil de médiation adapté à chaque moment du parcours. Pour ce faire, un lutrin jalonné de dispositifs de médiation guide les visiteurs et répond à cette demande. La réflexion sur les contenus s’est ensuite centrée sur les grandes typologies de handicap, afin de définir les outils à mettre en place. Ici, le parti pris muséographique est de multiplier les supports, afin que chaque visiteur puisse au gré de son envie et de ses compétences, interagir ou non avec les dispositifs à sa disposition.

Visiteur s’apprêtant à toucher une reproduction de pièce de monnaie au MuséoParc Alésia ©Sonia Blanc.
3ème étape : identifier les besoins spécifiques
« Il faut se dire une chose, c'est que toutes les personnes mal ou non voyantes n'ont pas ce qui est mon cas justement, de représentation à plat dans l'espace. Moi, si vous me faites toucher une carte ou un dessin, j'ai du mal. Je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent très bien, surtout les aveugles tardifs, mais nous les aveugles de naissance, on a une très mauvaise représentation à plat dans l'espace. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 13/07/2022)
Un aveugle de naissance n’a pas les mêmes besoins qu’un aveugle tardif, tout comme il existe une diversité de degrés de malvoyance. C’est pourquoi il est important de varier les approches et les dispositifs, et de ne pas seulement proposer des images visio-tactiles, afin de ne pas exclure de visiteurs. Proposer une reproduction de l’œuvre en trois dimensions, avec des textures se rapprochant de la matière originelle de l’œuvre ou de l’objet en question, et privilégier une charte unique pour tous les dispositifs aux couleurs contrastées est ainsi recommandé. Par exemple, augmenter les contrastes sur les différentes parties d’un facsimilé permet à un visiteur malvoyant de mieux identifier la composition d’une œuvre.

Station tactile du Muséon Arlaten « Tarasque de procession », les couleurs choisies sont le blanc et le jaune ©CL.
« Malheureusement il y a peut-être 4 ou 5 œuvres qui sont mises en avant et qui sont représentées sur toute une exposition, donc ce n’est pas énorme. On est un peu frustré, on a juste accès à ce dont on a bien voulu nous mettre en reproduction. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 15/07/2022)
Le nombre de stations tactiles a son importance, puisque les œuvres ou les objets présentés sont les seuls auxquels les visiteurs non-voyants auront accès. Il en est de même pour le braille – un système d’écriture tactile –, qui semble intrinsèquement lié à l’accessibilité des contenus. Or, seulement 10% des déficients visuels lisent le braille. En outre, cela signifie que très peu de visiteurs sont en mesure de lire et comprendre ces documents. Imprimer des cartels en braille ne suffit donc pas à rendre les parcours d’expositions accessibles. Cependant, bien que son utilisation soit très spécifique, les associations du champ du handicap visuel préconisent d’y avoir recours, en doublant toutefois l’information d’un contenu textuel (en gros caractère) et/ou sonore. Et ce, afin d’éviter toute stigmatisation des publics non-brailistes. Il faut par ailleurs noter qu’un texte en braille est beaucoup plus long qu’un texte dit en noir. Le choix du contenu répond donc des contraintes techniques et spatiales de chacun. Si pour certaines institutions l’écriture en braille est une traduction exacte des cartels, pour d’autres il s’agit d’un nouveau texte résumé sous la forme de courtes phrases, ou encore d’une synthèse comprenant les informations de base. Synthétiser le texte en braille est également recommandé au regard de la concentration que cela requiert. Enfin, pour un confort d’usage optimal, les cartels en braille doivent être inclinés et fabriqués avec des matériaux résistants à l’écrasement.
« J’ai visité une exposition avec un audioguide et en fait on se perdait parce qu’il y avait plein de tables avec des choses à toucher, l’audioguide parlait, mais bon malheureusement il ne vous disait pas « tournez à gauche, tournez à droite », ce qui fait que vous n’aviez rien sous les pieds. Et en fait, on y allait au petit bonheur la chance. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 13/07/2022)
Par ailleurs, si les éléments tactiles sont indispensables pour avoir accès au message global de l’exposition, ils ne sont pas suffisants s’ils sont appréhendés seuls. Un audioguide ou une audiodescription – une description orale des éléments visuels – est nécessaire à la bonne compréhension des expôts, et facilite la découverte tactile. Dans un souci d’autonomie et pour repérer l’emplacement des dispositifs accessibles, il est particulièrement recommandé que l’audioguide apporte des indications de déplacements. Toutefois, la mise en place de bandes podotactiles et d’un guidage au sol à l’utilisation d’une canne blanche reste la seule solution qui permet une autonomie complète des visiteurs non-voyants. A titre d’exemple, le LWL Industrial Museum à Dortmund, en Allemagne, présente une exposition permanente inclusive. Installée dans un ancien bâtiment administratif, le parcours est équipé d’un système de guidage au sol depuis l’entrée du bâtiment jusqu’à sa sortie. Il guide les visiteurs mal ou non-voyants vers un plan de chaque salle présentant les objets à toucher, les points d’écoutes et les images visio-tactiles ainsi que la disposition des cimaises. Les visiteurs peuvent appréhender l’espace en toute sécurité et profiter pleinement de l’expérience de visite.

Bandes podotactiles, image visio-tactile et buste à toucher au LWL Industrial Museum, Dortmund ©CL.
4ème étape : tester les dispositifs avec les publics concernés
« Solliciter les associations ou les usagers eux-mêmes pour avoir leur avis, c'est vraiment l'essentiel, je pense. Ça rallonge les processus de création, de validation, etc, mais si on ne convie pas les personnes elles-mêmes, on va systématiquement tomber à côté de la plaque. Même avec toute la bonne volonté du monde, même en étant formé. » (Chargée de mission RSO du musée du Quai Branly Jacques Chirac)
Afin que les dispositifs conçus soient réellement utilisables et appropriables, il faut travailler avec les publics concernés. Ici, la co-construction est entendue comme le fait d’associer à la conception des dispositifs à destination des publics à besoins spécifiques, les usagers eux-mêmes. Et ce, par le biais de réunions ou de groupes de travail dans lesquels sont préconisés les mesures à mettre en place, les besoins à prendre en compte, les améliorations à effectuer. L’acte de co-construction le plus aboutie étant la validation en cours de réalisation des dispositifs – ou des prototypes –, testés plusieurs fois par un petit groupe de personnes en situation de handicap. Dans le cadre des parcours tactiles, il est recommandé de demander à des personnes aux degrés de malvoyance différents. Cette co-construction garantit une expérience de visite adaptée. Toutefois, ces phases de test et de validation allongent les délais, notamment quand les dispositifs doivent être revus, il est donc important de prendre en considération ces derniers lors de l’établissement du rétroplanning. A défaut de ne pas pouvoir réaliser de tests utilisateurs, des compromis peuvent être trouvés comme la consultation d’un comité composé de relais associatifs.
5ème étape : ne pas négliger la médiation humaine
« Je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait quand même un guide qui soit présent. Parce que le tactile ne vous donnera jamais des explications détaillées sur une œuvre. Il faut que ce soit une combinaison des explications orales et du toucher. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy)
Le guide est largement privilégié à l’utilisation de l’audioguide, notamment pour le rôle communicationnel et participatif de l’expérience proposée, et la possibilité d’interaction qui en découle. La présence d’un guide est également préférée en ce qu’elle diminue la fatigabilité des visiteurs. En effet, la navigation tactile requiert une grande concentration, et accéder au contenu n’est pas aisé. Ne pas avoir à lire les cartels en braille ou à chercher l’information peut permettre de maintenir son attention sur un temps plus long. En cela, l’appropriation des parcours tactiles, la compréhension des œuvres et la satisfaction retenue de la visite sont profondément liées à l’accueil et l’accompagnement humain proposés au sein du musée. Les médiateurs culturels sont les premiers représentants de l’institution muséale, et les garants d’une expérience de visite agréable.
6ème étape : communiquer sur l’offre
Concevoir un parcours tactile est une première étape pour rendre accessible le musée aux publics mal et non-voyants. Bien que ces dispositifs profitent à tous, il est important que le musée soit perçu comme un lieu adapté dans lequel le visiteur, quelles que soient ses envies, puisse profiter pleinement de la visite. De ce fait, il ne suffit pas d’avoir les outils à disposition pour que ces derniers soient utilisés. Les musées dans leur mission d’accroissement, de fidélisation et de diversification des publics ne doivent pas se contenter d’attendre que les visiteurs viennent à eux, ils doivent aller chercher les publics en transmettant l’information. En effet, les institutions culturelles ayant récemment conçu une offre accessible peinent à attirer ces publics, notamment dans le cadre des visites spécifiques. Le défi pour ces musées dont l’accessibilité est récente, est de communiquer auprès des publics sur l’existence d’une offre qui leur est adaptée. Ils peuvent prendre contact avec les organismes et des associations locales et nationales – Association Valentin Haüy, CFPSAA, Les auxiliaires des aveugles, apiDV, Voir ensemble... Les supports d’information créés leur sont envoyés et l’information est diffusée aux adhérents par le biais de l’emailing et des magazines spécialisés, édités par les associations nationales. En guise d’exemple, le Lugdunum Musées et Théâtres romains, a créé une brochure envoyée à près de 500 structures médico-sociales réparties sur le territoire Lyonnais. Mais tout cela prend du temps et il ne faut pas s’attendre à ce que les effets positifs soient visibles immédiatement. De fait, le rôle du « bouche à oreille » n’est pas à négliger. Les publics étant plus enclins à visiter un site recommandé par un proche digne de confiance.
Les parcours tactiles, des dispositifs nécessaires mais insuffisants
Pour conclure, concevoir un parcours tactile à destination première du public déficient visuel ne suffit pas à rendre le musée accessible. Dans la réalité des faits, l’expérience de visite est régie par un grand nombre de facteurs, et la visite ne débute pas dans l’espace d’exposition. Afin de proposer une expérience de visite accessible à tous, il faut nécessairement penser l’accessibilité dans sa globalité. La conception d’un dispositif de médiation ne doit pas être pensée ex-nihilo, mais en lien avec son environnement, immédiat ou non. Et si les parcours tactiles sont à destination de tous les publics, ils ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accessibilité universelle. A la différence des parcours multisensoriels. En effet, la multiplication des canaux sensoriels permet d’appréhender les œuvres, les expôts ou encore le discours général de l’exposition, et ainsi la découverte et l’apprentissage selon les envies et compétences / capacités de chacun. Lorsqu’une personne est privée d’un sens, varier les modes d’approches sensorielles permet de proposer une expérience adaptée. Concrètement, ces parcours multisensoriels se présentent comme des stations sur lesquels la mobilisation de tous les sens est rendue possible, et ce pour tous les visiteurs. A titre d’exemple, le Musée d’Aquitaine à Bordeaux a récemment inauguré un parcours sensoriel composé d’une trentaine de stations. Certaines mobilisent simplement le toucher, d’autres présentent des dispositifs olfactifs, etc. Au Musée des Augustins à Toulouse, un parcours multisensoriel qui n'est pas encore ouvert au public proposera également une série de stations qui mobilisent les sens et font vivre aux visiteurs une véritable expérience.

Module « L’orgue » du parcours Touchez la musique au musée de la Musique ©CL.
Camille Leblanc
*LSF = La Langue des Signes Française est une langue visuelle et gestuelle qui permet de communiquer par des signes.
*FALC = Le Facile A Lire et à Comprendre est une méthode d’écriture simple développée en France par l’Unapei.
*AMO = Pour assumer pleinement son rôle, le maître d’ouvrage peut s’adjoindre les compétences d’un assistant au maitre d’ouvrage.
Pour aller plus loin :
- CASEDAS Claire, « Les publics en situation d’handicap visuel », podcast J’ai l’œil du tigre, n°46, 26 octobre 2021, 20 min.
- LEBAT Cindy, « Une muséologie du sensible : enjeux et conséquences pour les visiteurs déficients visuels », Les cahiers de muséologie, n°2, 2022, 15 p.
- LEBAT Cindy, « Les personnes en situation de handicap sensoriel dans les musées : réalités d’accueil, expériences de visite et trajectoires identitaires », Héritage culturel et muséologie, Thèse, Université Sorbonne Paris Cité, 2018, 512 p.
- SALMET Ariane, « Expositions et parcours de visite accessibles », Ministère de la Culture et de la Communication, collection Culture et handicap, 2017, 148 p.
#Expositions #Accessibilité #Handicap

Communiquer à la Cité des Enfants
La Cité des Enfants de Paris-La Villette est un espace conçu spécialement pour les enfants mais aussi pour leurs familles. Divisée en deux, une partie est dédiée aux 2-7 ans et une autre aux 5-12 ans. Cet article repose sur une des thématiques de la Cité des 5-12 ans, la communication, outil indispensable au développement de l’enfant.
Communiquer, c’est entrer en relation et échanger avec les autres ; une aptitude importante pour pouvoir vivre avec eux. La communication repose sous des mots, des gestes mais aussi des images grâce au téléphone, à internet, à la télévision et à la radio mais elle passe aussi par le langage et l’écriture. De plus, la maîtrise du langage est fondamentale pour structurer la pensée.
Fan de manipulations et d’outils pédagogiques, je me suis prise au jeu et je vous communique mon expérience.
Vivre Ensemble jusqu’au bout de la planète
Dans cet îlot, l’enfant est invité à voyager et à découvrir le monde et les différentes cultures de la planète grâce au langage et notamment à trois outils.

"Les "bonjour" du monde", © Ludivine Perard
● « Écris en chinois » et « Écris en arabe » : après avoir observé le tracé d’un mot, l’enfant s’entraîne à le reproduire trait par trait avec le doigt en s’aidant d’un modèle sur un écran tactile. L’enfant écrit “maison” en chinois ou en arabe et en apprend plus sur ces deux alphabets.
L’enfant entre ainsi en contact avec deux sociétés différentes et y découvre la richesse culturelle. Ces outils permettent de provoquer un plaisir esthétique lié à l’écriture et de comprendre qu’apprendre une langue demande du temps.
Jouer avec les mots
Dans une autre partie de cet îlot, l’enfant apprend à raisonner et à trier, classer, hiérarchiser des informations pour se poser les bonnes questions comme pour un quiz ou des devinettes.
● « Le quiz des mots » : ce jeu est équipé d’un écran de télévision et de quatre postes avec des boutons A, B, C. Il se joue soit tout seul ou soit à plusieurs. L’objectif est de découvrir ce que signifient plusieurs expressions données par deux protagonistes, un chat et un cochon. La France regorge d’expressions « à dormir debout » mais que signifient-elles ? A votre avis, que signifie avoir le coup de foudre ?
o A : Recevoir la foudre sur la tête
o B : Frapper du poing aussi fort que la foudre
o C : Tomber fou amoureux au premier regard
Alors vous avez trouvé ? Et oui, c’était la réponse C.
Ainsi à la manière des quiz télévisés, l’enfant découvre le sens des expressions.

"Qui suis-je", © Ludivine Perard
Communiquer avec autrui
L’enfant apprend aussi à communiquer autrement qu’avec les nouvelles technologies – en chuchotant, en langue des signes, en dialoguant – pour comprendre et se faire comprendre auprès des autres.

"Parle avec les mains", © Ludivine Perard
● « Se coordonner » : les joueurs doivent ici faire monter à deux une boule le long d’un plan incliné percé de trous à éviter. Cette boule est posée sur une petite nacelle suspendue par deux ficelles de chaque côté. Chaque joueur doit tirer l’une des deux ficelles. Ils doivent communiquer pour se coordonner et arriver à monter ensemble la boule au sommet. Ce dispositif est doublé en recto/verso pour permettre à plusieurs joueurs d’y participer. Cet outil a pour but d’apprendre à l’enfant à communiquer avec l’autre pour se mettre d’accord sur la réussite d’une tâche. Il lui apprend également du vocabulaire dans le champ lexical de la spatialisation et met les joueurs dans une situation ludique où l’enfant gagne avec l’autre.
 ● « Les tubes à paroles » : ce dispositif est composé de cinq grands tubes colorés qui servent à communiquer à distance, deux par deux. Le même tuyau sert à la fois à écouter et à parler avec son interlocuteur. L’objectif est de trouver un rythme commun pour réussir à communiquer car pour entendre et comprendre son interlocuteur, il faut alterner parole et écoute, et parler chacun son tour tout en chuchotant.
● « Les tubes à paroles » : ce dispositif est composé de cinq grands tubes colorés qui servent à communiquer à distance, deux par deux. Le même tuyau sert à la fois à écouter et à parler avec son interlocuteur. L’objectif est de trouver un rythme commun pour réussir à communiquer car pour entendre et comprendre son interlocuteur, il faut alterner parole et écoute, et parler chacun son tour tout en chuchotant.
"Les tubes à paroles", © Ludivine Perard
● « Paroles et paraboles » : deux grandes paraboles se font face dans cet espace, une à chaque bout de la pièce. Dans ce jeu, il n’est pas nécessaire d’hurler pour se faire entendre, il suffit à l’enfant de chuchoter pour que son interlocuteur l’entende. Un pavillon enforme de parabole permet de concentrer la voix pour la transmettre sur une longue distance. L’enfant expérimente la transmission du son dans l’espace et ainsi identifie mieux les rôles d’émetteur et de récepteur dans un message. Il y découvre même les propriétés d’une parabole et comprend comment celle-ci concentre une onde sonore.
Un dernier message
Si vous voulez en savoir plus sur la communication, n’attendez pas et emmenez vos enfants à la Cité des Enfants !
Ludivine Perard
Pour en savoir plus :
Adresse :
Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris01 40 05 70 00
#sciences#enfants#outils

Conquête des publics connectés : où sont les musées ?
Quel avenir pour les musées dans la transition numérique ?
L’engagement numérique des musées les pousse à dématérialiser leurs collections afin de promouvoir l’ouverture culturelle et l’accès au patrimoine. Pour l’instant, peu d'offres de médiations existent réellement avec ces collections numériques. Cependant, les nouvelles problématiques, mises en exergue par la crise sanitaire, ont impliqué les musées dans de nouvelles opportunités sociovirtuelles.
En cherchant à établir un contact avec les internautes, les institutions culturelles répondent par l’accessibilité en ligne de leurs collections. Mais sur le terrain des usages numériques, les musées ne seraient-ils pas en train de passer à côté d’un certain type d'expérience muséale ?
Je vous propose d’évoquer ensemble des actions culturelles menées dans le domaine du numérique : le cas d’Animal Crossing: New Horizon ©.
Crédit image d’intro : Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo © / Le goût des musées, éditions Le Petit Mercure /Musée et muséologie, Dominique Poulot / Traité d’expologie, Serge Chaumier
Un musée (pas) comme les autres
Replaçons le contexte: nous sommes en mars 2020, en plein premier confinement en France, avec pour principales distractions : instagram, netflix et les jeux vidéo. La coïncidence veut que le dernier jeu Animal Crossing, très attendu, vient de sortir et trouve très rapidement son public dans cet environnement d’attente et d’incertitude.
Édité par Nintendo pour sa console, la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons est un jeu de simulation de vie avec une nature immersive. Le gameplay est simple: customiser sa propre petite île, tisser des liens amicaux avec ses voisins, des animaux anthropomorphes et explorer les alentours. Le jeu japonais propose également une fonctionnalité qui va ici nous intéresser : la possibilité de compléter les collections du musée de l’île !
Quand il est tard le soir et que toute l'île est endormie, un petit hibou, Thibou, conservateur du musée, est bien réveillé et peut converser avec vous toute la nuit. Il laisse les portes de son musée ouvertes jour et nuit, pour vous permettre de vous balader dans les collections qui invitent à la balade et la rêverie.
Le musée se divise en 4 sections : les fossiles, les animaux marins, les insectes et la section "œuvres d’art” qui est intégrée en mai 2020. Le musée ne se caractérise pas par son implication culturelle sur l’île mais par sa fonction de recensement des ressources vivantes et sa dimension de collection d’objets rares du jeu. Ainsi les joueurs se lancent à la recherche de toutes les espèces différentes en pêchant des poissons, en attrapant des insectes ou en déterrant des fossiles. Mais il peut également acheter des œuvres d’art, auprès du mystérieux personnage de Rounard, qui fait halte sur l’île seulement quelques jours par mois. En moyennant quelques clochettes (monnaie du jeu) et en aiguisant son regard pour ne pas se faire revendre une contrefaçon, le joueur peut acquérir des chefs d'œuvres comme la Joconde ou le penseur de Rodin et les intégrer à son musée. Tel un trafiquant d'œuvres d’arts venu d’une autre réalité, Rounard fait la passerelle entre notre univers culturel et le monde d’Animal Crossing.
Dans un jeu de simulation de vie imitant nos pratiques, le musée est un vecteur de lien entre le monde réel et virtuel. Le jeu, ainsi que ces possibilités, ont conquis les internautes et certains musées. Dans un souci de se rapprocher de ses visiteurs, plusieurs initiatives sont nées des potentiels de médiation qu’offre le jeu.

La section oeuvres d’arts du musée, Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
Léo Tessier, médiateur scientifique au Muséum d’Angers, connaît bien l’univers des musées, il en a fait son métier. Et ce jeu vidéo l’inspire. Il met en place dès avril 2020, des visites virtuelles, sous la bannière de son musée dans la vie réelle. Le Nintendo Switch Online permet aux joueurs de se connecter entre eux et de s’inviter les uns chez les autres pour venir découvrir son île. Léo organise ainsi des visites de 7 personnes maximum (jauge du jeu), connectées en parallèle sur skype, et avec ce groupe réduit il mélange ses deux passions, les musées et les jeux vidéo. Il présente les collections d’Animal Crossing et n’oublie jamais de faire le lien avec son musée, à Angers.
Visite virtuelle par Léo Tessier, Muséum d’Angers / Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
« Je me suis dit que ce serait rigolo de recréer le muséum : la collection est bien sûr différente et moins fournie (une soixantaine d’objets contre 500.000 !). Mais on peut faire des parallèles : dans le jeu, où il y a un vrai souci de réalisme, j’ai par exemple un plésiosaure, ce gros reptile marin de six mètres de long et sa grande mâchoire, également présenté au Muséum. » Livre t’il dans un article pour le magazine 20 minutes.
L’initiative a commencé timidement, avec quelques créneaux, et a rencontré un franc succès. Un planning s’est vite instauré et les visites (complètes) se sont déroulées régulièrement pendant les deux mois du confinement. La visite de Léo Tessier était très pédagogique et inventive, mais également humaine et participative. Le médiateur a su transposer virtuellement une expérience de visite.
Passion culture
Imiter sans égaler
Si l'on peut saluer ces deux initiatives, les musées peinent encore à trouver leur place dans le paysage virtuel dans lequel les collections s’immiscent, mais quid de l’expérience muséale… En effet, si l’intégration, de plus en plus courante, des nouvelles technologies dans les espaces d’exposition s’avère conquérir les publics, les musées semblent encore peu innovants sur leurs propositions dématérialisées.
Voyons le cas du musée du Prado qui a créé sa propre île sur le jeu en reconstituant son propre musée. Dans un souci d’accessibilité pour les personnes ne possédant pas la console ou le jeu, des visites virtuelles sont disponibles sur Youtube. La proposition semble plus éloignée des deux précédentes en cherchant plus à tirer profit d’un effet de mode que de mettre en place une réelle ambition culturelle. En simulant leur musée dans Animal Crossing, le musée du Prado tombe dans l’écueil de simplement transposer ses collections et son identité graphique, sans exploiter l’interaction avec les visiteurs.
Un besoin de réinventer
Deux ans après le premier confinement, la fréquentation des musées n’est toujours pas remontée à sa jauge d’avant pandémie. Un besoin de se réinventer émerge.
Et si le temps était venu de continuer à explorer les espaces numériques et d’apporter des changements dans notre accès à la culture ? Et si les espaces culturels commençaient à créer des liens durables avec le public connecté ?
A l’heure ou la transition numérique est en plein essor, de nombreuses plateformes (jeux vidéo, Instagram, Facebook, …) s’installent dans les pratiques d'accès à la culture et la conditionne. Par leur rôle et leur essence, il devient alors important (peut être vital ?) que les institutions culturelles s’adaptent rapidement aux questions relatives au numérique.
Les musées gagneraient à exporter l'expérience utilisateur plutôt que simplement les contenus. Même si l’accessibilité des collections est une valeur enrichissante pour la communauté, il est intéressant d'appréhender la médiation et l'expérience de visite comme pouvant s’étendre jusque dans les univers virtuels. Les internautes restent des visiteurs, curieux de découvrir et de vivre de nouvelles expériences. Il ne s’agit plus seulement de transposer, mais d'habiter, d’inventer, de faire vivre et vibrer les visiteurs, tant dans les musées, que sur la toile.
Les musées ont toutes les clés pour conquérir les nouveaux espaces numériques, à eux d’en tirer parti.
Drella Hubert
Pour aller plus loin :
- https://experiments.getty.edu/ac-art-generator/
- https://www.rfi.fr/fr/culture/20220108-entre-coup-de-com-et-v%C3%A9ritable-m%C3%A9diation-culturelle-les-mus%C3%A9es-s-allient-aux-jeux-vid%C3%A9o
- https://medium.com/museonum/explorer-les-possibilit%C3%A9s-des-collections-ouvertes-avec-animal-crossing-new-horizons-742e3a60fb4c
#AnimalCrossing #JeuxVidéo #MédiationNumérique #MuséeVirtuel

Croiser les regards : exposer autrement
L’exposition peut être vécue comme une promenade balisée : le parcours, qu’il soit linéaire ou relativement libre, conduit les visiteurs à observer des œuvres réunies par thématique, artiste ou encore période. Cette présentation est rassurante, déroulant une histoire parfois connue d’avance. Et si l’on renversait l’ordre établi ? C’est ce que
proposent certaines institutions en exposant côte à côte des œuvres de courants opposés, mais reliées par un geste, une couleur, une vibration de la matière. C’est moins l’histoire qui guide l’œil que la sensation immédiate. Mais n’est-ce pas frustrant pour d’autres visiteurs ? Apprécier ces associations ne présuppose-t-il pas d’avoir des connaissances préalables sur les œuvres ?
Dialogues inattendus : comprendre ce type d’accrochage
Ce choix curatorial semble agir comme un antidote contre les classifications académiques. Il refuse que l'œuvre soit réduite à son étiquette historique ; il invite à voir ce qui relie au lieu de ce qui sépare. En forçant l’œil à chercher des points communs inattendus, l’espace d’exposition devient un terrain d'expérience, où formes et couleurs tissent des liens, parfois plus éloquents pour certains publics.

Vue de l’exposition Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters, KMSKA, 2024, © KMSKA
Entre émerveillement et désorientation : les limitesAu KMSKA d’Anvers, récemment rénové, le parcours muséal décloisonne les époques en mettant en dialogue les maîtres anciens flamands, comme Rubens ou Van Dyck, avec des œuvres modernes et contemporaines. Non pour illustrer une progression historique, mais pour mettre en évidence des gestes formels partagés : la flamboyance du
rouge, la construction des volumes, l’intensité dramatique. Loin d’exercer le regard à une époque ou une technique particulière, l'institution cherche à provoquer une lecture
transversale. Cette approche a fait l’objet d’une exposition particulière et temporaire Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters (2024), questionnant le rôle des musées ainsi que des collectionneurs privés. La muséographie crée ainsi un nouveau dialogue, avec la croyance que les œuvres d'art contemporaines peuvent renouveler les représentations figées des portraits traditionnels ou des figures maternelles, en y insufflant un regard critique et ancré dans l'actualité.
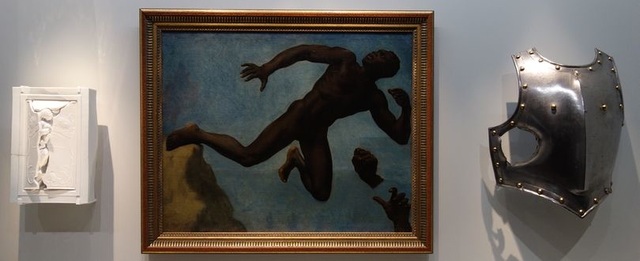
Vue de l’exposition Carambolages, Grand Palais, 2016 © spectacles sélection
Cette approche trouve également un écho dans l’exposition Carambolages (Grand Palais, 2016), conçue par Jean-Hubert Martin. L’éloignement des cartels numériques, invitaient le visiteur à cheminer de manière intuitive, réagissant aux affinités plastiques et symboliques. Jean-Hubert Martin semble ici faire renaître une logique propre à celle du cabinet de curiosité, plus que celle du directeur de musée.

Vue de l’exposition « La couleur parle toutes les langues », Hôtel de la Marine, 2024 ©The AI Thani Collection, photographie par Marc Domage
D'autres exemples confirment cette tendance : l’exposition La couleur parle toutes les langues à l’Hôtel de la Marine (jusqu’au 5 octobre 2025) dont Hélène de Givry, curator
à la Collection Al Thani est la commissaire fait dialoguer 80 œuvres de différentes civilisations issues des cinq continents et couvrant une période chronologique allant du
Néolithique à nos jours. Le parcours est organisé de manière chromatique correspondant aux couleurs fondamentales dans les arts : noir, blanc, rouge, jaune, bleu et vert. Ce mode de classement invite les visiteurs à explorer les matériaux utilisés en lien avec les techniques de production, à percevoir les effets visuels créés par les variations de teintes, d’éclats et de contrastes, et à réfléchir à leur dimension symbolique à travers différentes cultures.
Cette approche rejoint des réflexions théoriques contemporaines sur l’exposition comme « langage », tel que formulé par Jérôme Glicenstein dans « L’exposition comme langage et dispositif », chapitre de son ouvrage L’art : une histoire d’expositions (2009). L’agencement des œuvres devient lui-même un énoncé, engageant le visiteur dans une lecture libre, intuitive et polysémique.
Entre émerveillement et désorientation : les limites
Cependant, cette esthétique de la correspondance comporte ses risques. Si elle invite certains visiteurs à aiguiser leur regard, elle peut également dérouter ceux qui s’attendent à une structure narrative plus claire. Les salles d’exposition permanentes du KMSKA en sont un exemple : selon un article du The Art Newspaper, des préoccupations ont été soulevées concernant les choix esthétiques et curatoriaux du musée, notamment l'absence de fil conducteur historique dans la présentation des œuvres.
De plus, ce type d’accrochage présuppose souvent une certaine culture visuelle. Pour saisir pleinement les échos entre un retable du 15e siècle et une abstraction géométrique du 20e, il faut pouvoir identifier ce qui distingue, et ce qui rapproche. Or, tout le public n’est pas équipé pour une telle lecture. Comme l’analyse Odile Le Guern dans son article Rhétorique d'une mise en espace (2005), une mise en scène audacieuse peut renforcer l’élitisme muséal si elle ne ménage pas des points d’entrée accessibles pour tous. Le risque serait de diluer le sens historique des œuvres en occultant les contextes de création nécessaires à leur compréhension.
Une tension féconde, vers une exposition à double lecture
La juxtaposition libre d'œuvres de styles et d’époques différents constitue une tentative salutaire de revitaliser l'expérience muséale. Elle lutte contre la muséographie figée,
favorisant une lecture intuitive et sensible des formes. Dans ce sens, elle permet de renouveler l'attention du spectateur, de l'arracher à la passivité critique.
Cependant, pour que ce type d'accrochage soit pleinement efficace, il doit s'accompagner d’outils de médiation adaptés : cartels explicatifs, parcours thématiques optionnels,
dispositifs interactifs. Il ne s'agit pas de renoncer à l'histoire au profit d'une pure expérience esthétique, mais de trouver un juste équilibre entre l'émotion immédiate et la contextualisation raisonnée.
Ainsi conçu, l’accrochage par correspondances ne remplace pas la chronologie ; il la questionne, l’enrichit, et ouvre d’autres chemins pour apprendre à voir autrement. Car
exposer autrement, c’est avant tout multiplier les expériences du regard.
- Nina Colpaert
Pour en savoir plus ::
- La couleur parle toutes les langues, 2024, Hôtel de la Marine, du 3 octobre 2024 au 5 octobre 2025 : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/la-couleur-parle-toutes-les-langues.-aeuvres-choisies-de-la-collection-al-thani
- Collected with vision, 2024, KMSKA : https://kmska.be/en/collected-with-vision-private-collections-in-dialogue-with-the-old-masters
- Carambolages, 2016, Grand Palais : https://www.grandpalais.fr/fr/programme/carambolages
- Zeugma 01, 2025, Abbaye royale et musée d’art moderne de Fontevraud : https://www.fontevraud.fr/evenement/zeugma-romain-bernini/
#ExposerAutrement#DialogueDesOeuvres#MuséographieContemporaine

Dans les musées d'art, on touche avec les yeux ?
Qui n’a jamais rêvé de toucher une sculpture en se baladant dans les ailes du Musée du Louvre ou encore de sentir la douceur du marbre des colonnes du forum antique de Rome sous ses doigts ? Toucher les œuvres dans un musée ou sur un site archéologique est tabou. Entre sécurité des œuvres et satisfaction du public, n’y aurait-il pas un compromis à trouver ?
Le musée d'art, un lieu sacré
Il est interdit de toucher les objets d’art dans un musée pour des raisons de conservation des œuvres. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Pendant la Renaissance, il fallait toucher en plus de regarder pour appréhender l’objet dans son ensemble. Dès le 19e siècle, le nombre de visiteurs s’accroît, et pour préserver les œuvres une interdiction formelle de toucher s’impose dans les institutions muséales. Le monde des musées se professionnalise dans les années 1970 et cinq fonctions principales lui sont attribuées : acquisition, conservation, étude et recherche, interprétation et exposition. Aucune mention du visiteur.
Nous avons déjà tous ressenti cette frustration en nous promenant dans les allées d’un musée de ne pas pouvoir toucher des œuvres dont les matériaux nous intriguent et les couleurs nous appellent. Dans une perspective de développer leur rôle social auprès du public, les musées mettent en place des expériences de visite, notamment en s’appuyant sur le sensoriel. Ainsi, le toucher commence à retrouver une place dans l’appréhension des œuvres par le visiteur.
Toucher pour mieux voir ?
Certains musées ont d’ores et déjà mis en place des dispositifs tactiles au service des visiteurs dans le cadre d’événements ponctuels. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon par exemple a pensé une exposition temporaire L’art et la matière. Prière de toucher proposant au visiteur de découvrir les œuvres en les touchant pour comparer les différents matériaux. Dix reproductions d’œuvres d’art sont exposées retraçant l’histoire de la sculpture de l’Antiquité au 20e siècle. En plus d’admirer les œuvres, le public peut exceptionnellement les toucher.

La Galerie tactile du Musée du Louvre © Musée du Louvre, Antoine Mongodin
Des dispositifs tactiles sont également proposés aux personnes malvoyantes et non-voyantes, pour faciliter l’accès à des contenus qu’ils ne pouvaient pas appréhender auparavant. C’est le cas du Musée du Louvre qui a mis au point une galerie tactile mettant à disposition du visiteur des moulages en résine, en plâtre ou en bronze. Il peut ainsi toucher différents matériaux et différentes textures et appréhender les volumes des œuvres en trois dimensions. Un objet d’art peut être lu par des personnes souffrant de déficiences visuelles si on lui en donne les moyens. Dans une perspective de démocratisation culturelle, enjeu au centre des préoccupations muséales, développer ce type de dispositif est une évidence.
Solliciter les sens de manière pérenne

Matériauthèque du Musée National Fernand Léger @ Musée National Fernand Léger
D’autres solutions existent : comme installer une matériauthèque. Un dispositif simple contenant des échantillons de différents matériaux, scellés à un socle et en libre accès pour le visiteur. Le Musée National Fernand Léger a mis en place une salle dédiée à la découverte de différentes pâtes de verre et pierres de mosaïque par le toucher. En visite libre ou en visite accompagnée pour les publics en situation de handicap, ce dispositif raconte l’histoire de la mosaïque monumentale réalisée pour la façade principale du musée en 1960, d’après un projet de décoration murale de Fernand Léger. La matériauthèque permet ainsi au visiteur de découvrir l’œuvre sous un nouvel angle en faisant appel à un autre sens que la vue pour apprendre à regarder différemment. Ludique et demandant plus de concentration car mobilisant un sens supplémentaire, la matériauthèque rend également plus facile la compréhension d’une œuvre et le souvenir que l’on en garde.
Lisa Sécheresse
#toucheraumusée
#expériencesensorielle
#dispositiftactile
Pour aller plus loin :
https://www.louvre.fr/la-galerie-tactile
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/l-art-et-la-matiere/l-art-et-la-matiere.
Image de couverture : Vue de l'exposition L'Art de la matière. Prière de toucher au Musée des Beaux-Arts de Lyon © Musée des Beaux-Arts de Lyon

Dansez au rythme de la photographie
La photographie est un geste, geste inhérent à la pratique du quotidien, geste qui façonne un regard sur le monde : il faut documenter, il faut témoigner, il faut se souvenir. C’est ce qu’offre l’Institut Pour la Photographie : un lieu POUR la pensée et l’expérience de l’image.

Dans l’exposition Fragments & Trans de Serge Clément © Sophie Delmas, 2020
L’Institut Pour la Photographie - IPP pour les intimes - est le tout nouveau haut lieu dédié à la photographie en France. Le projet initié par la Région Hauts-de-France, et en étroite collaboration avec les Rencontres d’Arles, prend place dans un ancien lycée de la rue de Thionville, au cœur du Vieux-Lille. Amoureux de la photographie, coutumiers des Rencontres d’Arles et tous les curieu.ses.x qui le souhaitent s’y retrouvent, car tout y est. Entre DJ sets, les brunchs et les transats, l’endroit est résolument « branchouille »
.

Brunch au soleil dans la cour de l’IPP © Sophie Delmas, 2019
Mais quid de la photographie ? Elle est partout : à travers les conférences, les ateliers, la bibliothèque, les portfolios ouverts, les nocturnes, les rencontres, les séances de cinéma… et tous les autres espaces de détente informels et à la mode permettent au visiteur d’échanger, d’apprécier, de partager son émotion. Et enfin dans ces salles de classes aux papiers peints arrachés, où le plancher grince, encore imprégné de poussière de craie, la photographie s’expose. Le plaisir de retrouver l’ambiance d’un lieu détourné de sa fonction initiale est intact, et y voir toute la diversité des images et des regards invoque immanquablement le souvenir de la joie de cuire dans la poussière des ateliers SNCF d’Arles (épicentre des Rencontres de la Photographie), avant les travaux qui ont transformé ces hangars en espace d’exposition impersonnel aux cimaises blanches.

À l’étage de l’Institut, perspective de l’exposition Home Sweet Home, commissariat Isabelle Bonnet © Sophie Delmas, 2019
Les deux expositions déjà présentées — extraORDINAIRE et en QUÊTE — et sa programmation hors les murs de 2021, ne sont que les prémices de ce que proposera le lieu en 2022, pour sa réouverture après aménagements — notamment liés à l’accessibilité. Outre les expositions, son action est basée sur cinq principes fondamentaux : les expositions, la conservation de fonds d’archives photographiques, la transmission, l’édition, et le soutien à la création. Tous ces enjeux sont connexes et chacun des projets mené par l’Institut le démontre. Son ancrage dans le territoire est fort, en lien avec d’autres acteurs locaux de la photographie comme Le Château Coquelle à Dunkerque, Destin Sensible à Mons-en-Barœul, Diaphane pôle photographique en Hauts-de-France à Clermont-de-l’Oise, ou le CRP/ Centre Régional de la Photographie à Douchy-Les-Mines.
Lors de la dernière manifestation en QUÊTE, 10 expositions étaient présentées pour explorer le regard qu’offre la photographie sur le territoire, l’actualité historique, politique, environnementale, établir l’importance de l’enquête photographique. L’accent est mis sur la collaboration, entre artistes pour Mascarades et Carnavals où 10 artistes ont présenté leur travail autour de la thématique du rituel, de la tradition et du costume, mais aussi entre structures pour la carte blanche offerte au CRP/, à Diaphane, à Destins Sensibles, et enfin avec le public pour l’exposition participative Si j’étais.
Comme dans tout bon lieu culturel, le public est au centre des préoccupations de l’Institut. L’image sans spectateur a encore moins de sens qu’exposée dans le noir. La transmission artistique et culturelle se fait, là encore, en croisant les pratiques. J’ai eu la chance de suivre l’une des visites dansées à travers les expositions. Accompagnée par Alice Rougueulle, chargée des publics, la chorégraphe et danseuse contemporaine Sandrine Becquet nous emporte dans une folle expérience de déambulation sensible.

Début de l’atelier danse & photo dans l’exposition Mascarades et Carnavals, commissariat Anne Lacoste, Paul Leroux, Clémence Mathieu © Sophie Delmas, 2020
L’atelier commence par la présentation des visiteur.euse.s les un.e.s aux autres, pour se découvrir avant de rencontrer les œuvres, et ce n’est pas anecdotique, c’est l’occasion de mettre le groupe en confiance. Le premier mouvement commence dans l’espace Mascarades et Carnavals où toutes les images invitent à la danse et à en faire l’expérience par son corps. Les regards sont accrocheurs, les costumes flamboyants et on s’échauffe. Pour réveiller les corps, Sandrine propose d’abord de déambuler sans s’arrêter, en rythme avec la musique qu’elle diffuse. Cette première marche rappelle sans aucun doute le geste standard d’une visite d’exposition, marcher sans vraiment s’attarder, sans regarder activement les œuvres, croiser d’autres gens, et repasser encore et encore devant les images au mur. Contraint par l’espace dans lequel les allers-retour se multiplient, le regard change déjà doucement, glisse vers la reconnaissance, le dialogue avec les photographies peut commencer. Le rythme de la musique s’accélère, la marche passe à la course avec des arrêts soudains devant une image. L’assemblée de portraits de Marialba Russo semble bouger en même temps que nous, suivre des yeux tous les danseurs. Encourageants, ils soutiennent mon regard quand je me campe devant l’un d’eux, on se dévisage.

Portraits de Marialba Russo pour Mascarades et Carnavals © Sophie Delmas, 2020
La salle de danse suivante est dédiée aux œuvres de Charles Fréger qui travaille sur les héritages contemporains des fêtes rituelles où l’imaginaire d’une humanité sauvage, pulsionnelle et animale transpire. Les personnages sont tour à tour recouverts de poils, de paille, de tissus divers, de laine… Encore le temps d’une déambulation, Sandrine sort de son grand sac toutes ces matières, les distribue, elle offre alors l’opportunité de rentrer dans l’image, d’être en contact avec ces créatures anthropomorphes, de les toucher et de les sentir, de vivre l’image en plus de la regarder. Ces matériaux sont ensuite disposés par terre pour créer un totem éphémère, et après l’expérience du toucher, le groupe est à nouveau embarqué dans une danse, une transe rythmée par les percussions autour de la création au sol, les photographies deviennent alors spectatrices à leur tour, gardiennes de notre procession. L’ultime scène de cet acte consiste à écrire sur un papier ce dont on souhaite « se libérer ». Se libérer de quoi ? De qui ? Par quoi ? La danse comme action libératrice, se libérer du « regarder sans voir » ? Ce mot libérateur, anonyme, probablement sans futur, est caché sous le totem qui le protège.

© Sophie Delmas, 2020
On lance alors un dernier regard à ces personnages qui sont devenus des complices l’espace d’une danse avant de passer à une autre étape de la visite dansée.
La seconde expérience proposée par Sandrine est bien différente. Il n’y a pas de corps représentés dans les images d’Ilanit Illouz où l’humanité brille par son absence. Mais ces images sont aussi le témoignage de l’activité humaine ayant épuisé les ressources naturelles, ici la Mer Morte. Son assèchement crée des paysages lunaires et uniques, grâce au sel abondant, matière que l’artiste réutilise dans son processus de tirage photographique pour proposer des images oniriques invoquant l’identité physique du lieu de prise de vue. Dans cet espace, nous sommes amené.e.s à regarder à travers une longue vue faite d’une feuille A4 roulée.
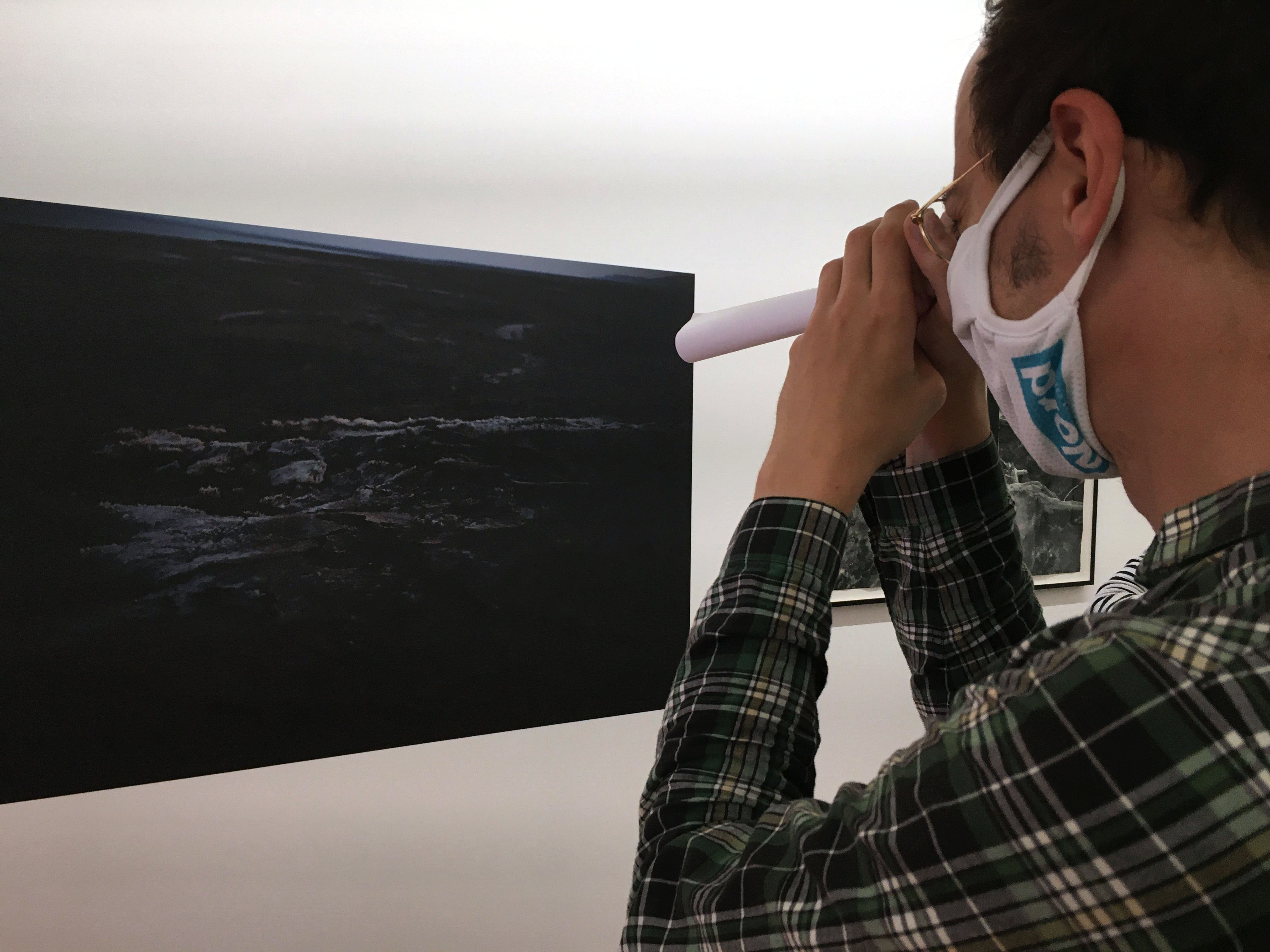
Longue vue dans l’exposition Dolines, d’Ilanit Illouz © Sophie Delmas, 2020
Le regard est guidé et forcé d’observer les détails précis et précieux des images dans l’intimité d’un couloir où l’extérieur disparaît. Le rapport devient privé, intime et privilégié avec les images. On s’assied devant un carré de tissu noir au sol et la longue vue se transformant en entonnoir, un peu de matière sèche et granuleuse est versé. Chacun.e a son petit tas, de cette poudre qui rappelle étrangement la texture des images. Les yeux fermés on touche, caresse, dessine les formes et détails des images. Le frottement des doigts avec la matière rappelle la respiration de la mer, alors les gestes deviennent plus grands, sortent de l’espace du tissu et les doigts s’élèvent, dessinent dans l’air, sur les autres, sur soi. La texture encore en mémoire dans les mains, on dessine par le geste, le sel, devant les images. Tous les carrés de tissus sont alors assemblés les uns à côté des autres, les dessins blancs contrastent fort et c’est la deuxième œuvre collective de la visite où le geste photographique est repensé par le dessin dansé.

Matière © Sophie Delmas, 2020

Dolines, Ilanit Illouz, carte blanche au CRP/, commissariat Muriel Enjarlan © Sophie Delmas, 2020
L’espace de confiance offert par Sandrine est précieux, tous les sens sont mis à contribution et sont rassasiés par cette expérience de visite sensible et intelligente, réfléchie pour aborder la photographie et l’instant de l’exposition autrement, pas seulement pour faire de la danse en dehors d’un contexte de danse. L’émotion de cette visite s’étiole doucement mais son souvenir reste longtemps et change profondément le regard porté sur la visite d’une prochaine exposition, sur l’appréhension à venir d’une œuvre.
Dans les anfractuosités de l’IPP © Sophie Delmas, 2020
Sophie Delmas
D’autres articles du blog relatant l’expérience de la danse au sein de l’espace d’exposition, de l’espace muséal :
Alors on danse
Portrait d'artiste : Boris Charmatz
Page dédiée à l’atelier photo-danse de l’IPP sur la Plateforme des Médiations Muséales :
Atelier danse et photographie sur la Plateforme des Médiations Muséales
#photographie
#danse
#médiation
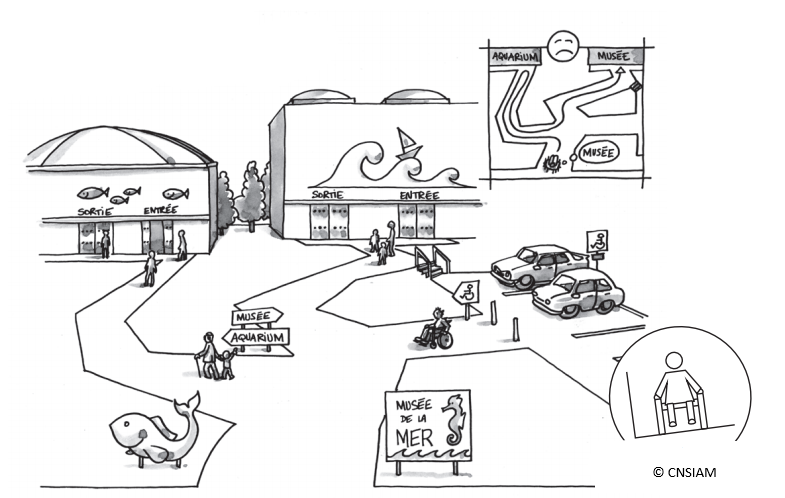
De l’accessibilité à l’inclusion : la conception universelle à l’épreuve des musées
Imaginez que vous souhaitiez vous rendre au musée. Après avoir traversé tout Lille, pris les transports en commun, traversé des routes très fréquentées, vous arrivez enfin devant le musée. Devant vous se dresse une volée de marches pour accéder à l’entrée principale, vous ne pouvez pas les emprunter et devez donc faire un détour pour emprunter une porte isolée. Vous sonnez et attendez qu’un agent vienne vous ouvrir. Pourquoi devriez-vous attendre et effectuer des efforts supplémentaires alors que d’autres peuvent emprunter l’entrée principale ? C’est ce que vivent chaque année des milliers de visiteurs en situation de handicap qui ne peuvent pas emprunter les mêmes entrées ou participer aux mêmes activités que les valides en autonomie.

Entrée PMR à distance de l’entrée visiteurs, Palais des Beaux-Arts de Lille © CHF
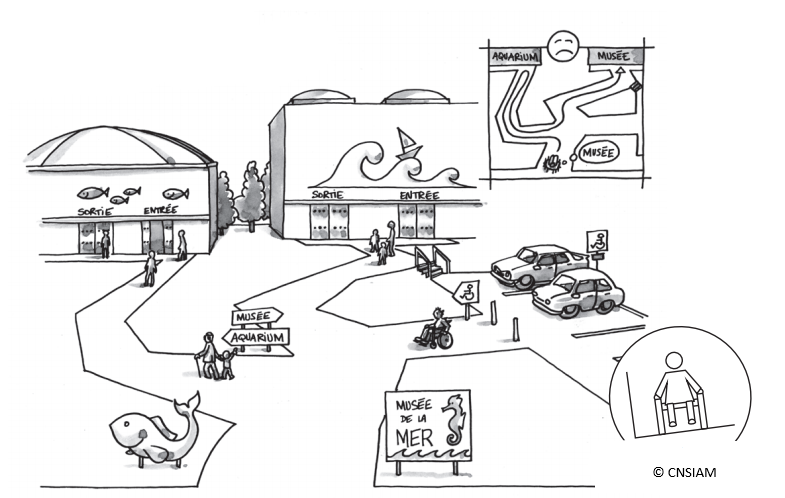
Entrée pour tous, inclusive © CNSIAM
Bien qu’il soit obligatoire d’avoir une entrée accessible aux personnes en situation de handicap, rendre son site accessible en ouvrant un accès PMR n’est pas suffisant. L’accessibilité des prestations et du bâtiment est mise en avant par les lois handicap successives mais la mise aux normes des établissements culturels recevant du public ne suffit pas à offrir une vie culturelle inclusive et confortable aux personnes en situation de handicap.
Dans le domaine de la culture, on entend par inclusion, le mélange de tous les visiteurs, quelle que soit leur origine ou leurs capacités dans une même expérience muséale commune et indifférenciée. Cet idéal paraît utopiste et compliqué à mettre en place, pourtant, en changeant de paradigme et en incluant les usagers dans le processus de création, l’utopie peut devenir réalité.
L’accessibilité, la surface émergée de l’iceberg
« Je ne vais pas très souvent au musée, j’aimais beaucoup avant, mais maintenant j’aime beaucoup moins, vue ma problématique [sa situation de handicap moteur et visuel, ndlr]. Le musée c’est très fatigant quand on n’a pas d’endroit où s’asseoir, quand on n’a pas d’audio description ou pas de choses tactiles. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Rendre sa structure culturelle accessible est une première étape pour permettre aux visiteurs en situation de handicap d’accéder à la culture muséale, mais il s’agit du sommet émergé de l’iceberg. En réalité, la visite culturelle se prépare en amont et commence dès le site internet, en passant par la voirie, les transports en commun jusque dans la structure. Il s’agit de la chaîne de déplacement, ou chaîne d’accessibilité, du domicile de la personne jusqu’à la fin de son expérience culturelle. Les points clés de la chaîne d’accessibilité sont : l’accès à l’information, la sortie du domicile, la voirie, les transports en commun ou le parking, l’entrée dans le bâtiment, l’accueil, les circulations, les sanitaires et la signalétique. Si l’une de ces zones est impraticable ou impossible à passer par le visiteur, alors la chaîne d’accessibilité est brisée, et quand bien même l’offre culturelle est accessible, le visiteur en situation de handicap risque de ne pas se déplacer jusque dans votre structure.
La mise en accessibilité de ces éléments constitue ainsi une amélioration vers une autonomie des personnes en situation de handicap, mais est loin d’être suffisante. En obligeant un usager en situation de handicap moteur à faire un tout autre chemin pour accéder à une offre culturelle ou bien en ne lui donnant accès au lieu qu’à travers une visite guidée, il s’agit d’une pratique ségrégationniste. « On n’a pas tous envie d’une visite guidée, il y a des jours où tu veux être autonome » (Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel). En créant une offre culturelle destinée uniquement aux personnes en situation de handicap et en les mettant ainsi à part des personnes dites « valides », c’est de l’intégration mais pas de l’inclusion, la bulle entre personnes en situation de handicap et personnes « valides » n’est pas rompue. La différence est marquée et renforcée et s’apparente à une ségrégation des personnes en situation de handicap.
Vers la conception universelle, répondre aux besoins spécifiques de certains pour améliorer le confort de tous.
La mise en accessibilité d’une structure peut être coûteuse, pour économiser du temps et de l’argent, et éviter de devoir créer un dispositif par type de handicap ou par profil de visiteur, il ne faut pas penser adaptation mais changer l’angle de vue, le curseur sur le problème. Démultiplier les offres par type de handicap est ainsi chronophage et inutile, c’est pourquoi, lors de la création d’expériences muséales, il convient de créer une offre englobant les besoins de tous, en situation de handicap ou non. C’est la ligne de pensée que revendique Signes de Sens, une association lilloise qui croit que le handicap est un levier d’innovation et que les besoins particuliers des personnes en situation de handicap peuvent être un point de départ à la création d’expériences utiles et bénéfiques à tous. Au lieu de créer un parcours alternatif pour les personnes en situation de handicap, transformez ce parcours alternatif en nouveau parcours pour tous les visiteurs.
C’est ce qu’a fait le Musée de l’Homme à Paris en créant des reproductions d’œuvres ou d’objets accompagnées de dispositifs sonores rendant possible la découverte de la galerie de l’Homme par le toucher et par l’écoute. Ces dispositifs ont été créés en ayant à l’esprit, les besoins des publics en situation de handicap visuel, pourtant, ils ont été placés dans le parcours de visite classique. Les besoins spécifiques des visiteurs en situation de handicap visuel sont ici satisfaits, toutefois, en répondant aux besoins spécifiques des uns, le Musée de l’Homme améliore la visite de tous. En ne passant pas exclusivement par le texte, en permettant aux visiteurs de découvrir le parcours de visite par les sens, le musée de l’Homme et en ne reléguant pas le parcours sensoriel à une salle annexe du parcours, le musée de l’Homme propose une manière intéressante de créer une expérience de visite inclusive et universelle.

Visiteur observant des reproductions à toucher d’ossements dans le parcours d’exposition du Musée de l’Homme © Mon cher Watson
Prenons également l’exemple du musée Carnavalet de Paris. En créant leur exposition temporaire en cherchant avant tout à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et en réécrivant ses documents en écriture claire et facile à lire pour répondre aux besoins d’usagers avec des troubles cognitifs. Les visiteurs avec troubles cognitifs peuvent présenter des difficultés de lecture, notamment avec la lecture des chiffres romains. En effet, dans les règles du FALC (facile à lire et à comprendre), qui consiste à produire des documents accessibles à ces visiteurs, l’usage de chiffres romains est déconseillé. Ainsi, l’équipe a choisi de les traduire en chiffres arabes pour simplifier la lecture pour tous les visiteurs.
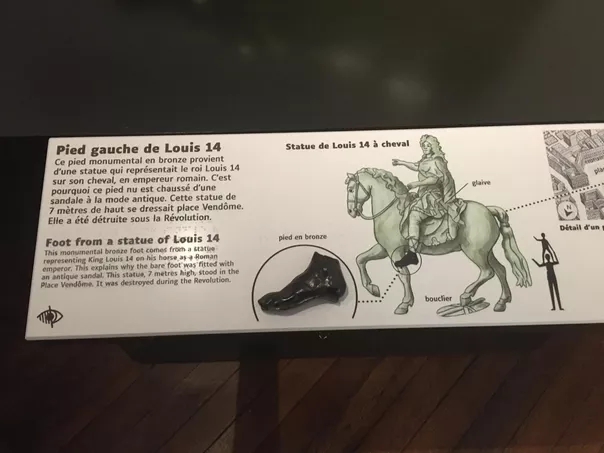
Photographie des cartels du Musée Carnavalet © Le figaro
« C'est uniquement, sur 170 textes, sur un ensemble de 3 000 contenus, qui ont été produits pour le nouveau parcours dans le musée, que nous avons choisi d'appliquer cette mesure d'accessibilité universelle. C'est une recommandation européenne, pour une information facile à lire et à comprendre » - Noémie Giard, cheffe du service des publics au musée Carnavalet – Histoire de Paris
Cette adaptation n’est pas uniquement destinée aux visiteurs en situation de handicap cognitif, mais profite également à l’enfant qui apprend à lire de mieux appréhender les informations, mais également à l’usager de nationalité étrangère d’avoir accès à l’information. Et il servira également aux usagers de structures culturelles qui peuvent, en fin de journée, ne pas avoir envie de lire de longs textes pour trouver l’information qui les intéresse. Ce type de refonte pour une accessibilité universelle des informations a déjà été effectué dans d’autres musées européens comme le Louvre ou le British Museum depuis déjà quatre ans. Cette adaptation de l’écriture des contenus est ainsi née d’un besoin des personnes en situation de handicap cognitif et servira tous les publics à court ou long terme. Le musée Carnavalet se place ici dans une démarche de conception universelle.
Malgré ces initiatives à visée universelle, beaucoup reste à faire pour se diriger vers une expérience muséale inclusive, car nombre de dispositifs inclusifs et universels sont finalement le fruit du hasard et n’ont pas été réfléchis comme tel. Charles Gardou définit la société inclusive comme soutenue par cinq piliers fondateurs dont font partie la prise en compte des besoins de tous mais aussi l’abandon des phénomènes de hiérarchisation, le partage du patrimoine humain et social commun, le droit d’exister au-delà du droit de vivre, ainsi que la reconnaissance de la diversité.
La diversité humaine* se reconnaît au-delà du handicap. En 1983 Edward Gardner théorise que chaque personne a une manière de réfléchir différente des autres, elle peut être musicale, kinesthésique ou encore logico-mathématique. A travers cette théorie des intelligences multiples, il conçoit que chaque personne pense différemment. C’est un des biais par lequel on peut comprendre la conception universelle. Ainsi, en offrant une expérience muséale mobilisant au maximum les 8 intelligences d’Edward Gardner, la structure culturelle touche un panel de visiteurs plus larges, sans handicap, mais également les personnes en situation de handicap. L’intelligence kinesthésique et l’imitation d’une œuvre par son corps par exemple peut aider un visiteur avec troubles du spectre autistique d’appréhender une œuvre ou une exposition, là où l’écrit aurait échoué. Les expositions muséales sont encore aujourd’hui trop visuelles et reposent majoritairement sur l’écrit, l’image et l’objet exposé, alors que les autres sens sont encore sous-exploités. Pourtant, pour qu’un visiteur puisse retirer ce qu’il souhaite de l’exposition (un sentiment, une information …), il lui faut pouvoir passer par le canal qui lui convient le mieux, ce à quoi la pluri sensorialité et les espaces sensoriels dans les musées répondent. D’autant plus qu’une approche tactile, par exemple, bénéficiera à tous les publics. Il est notamment prouvé que l’approche tactile aide à la rétention d’informations par les publics. Elle bénéficie aux personnes en situation de handicap visuel, mais aussi aux voyants : Henri Focillon (Éloge de la main, 1934), « « Mais les voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact et par la prise la perception des apparences ».
« Laissez-nous toucher. Mettez-nous des reproductions, rien que pour avoir le regard de la statue. En touchant, on voit dans notre cerveau. Laissez-nous voir à travers nos mains vos sculptures, mêmes vos tableaux, même un relief de tableau, ça peut nous apporter beaucoup. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Grâce à cette réflexion sur les intelligences multiples, nous nous rendons compte que créer des expériences muséales pour tous, et non plus par handicap, atténue la séparation entre visiteurs en situation de handicap et visiteurs « classiques ». Au-delà d’un gain financier, créer des expériences universelles aide à viser juste. Au sein d’un handicap, il existe une multitude de ressentis personnels. Le trouble du spectre autistique est caractérisé par des symptômes qui sont, par définition, tellement variés qu’ils représentent un spectre de possibilité d’adaptations, cela est moins connu mais c’est également le cas pour les personnes en situation de handicap visuel, auditif ou encore moteur. En effet, à handicap équivalent, deux personnes en situation de handicap visuel n’auront pas les mêmes besoins, l’une préfèrera avoir des dispositifs en braille alors qu’une autre ne saura pas le lire. Produire des expériences universelles ouvre les programmations culturelles à tous ces publics, au-delà de leurs handicaps.
Vers l’inclusion : faire « avec »*, ou comment éviter la maladresse accessible
Créer des contenus en ayant en tête le concept de conception universelle améliore donc non seulement l’accessibilité des structures culturelles au plus grand nombre, mais aussi de gommer les différences entre les différents visiteurs, évitant ainsi de mettre les visiteurs en situation de handicap face à leurs difficultés. La conception universelle initie un premier pas vers l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les musées et vers une expérience universelle et inclusive du musée.
Toutefois, connaître les besoins de ses publics ne suffit pas à créer des dispositifs adaptés. Pour produire des dispositifs fonctionnels et inclusifs, il faut travailler de concert avec les publics concernés, cela permet d’éviter d’oublier des besoins, de mal les comprendre ou encore de viser à côté du besoin en pensant bien faire. Le meilleur exemple reste le braille. De nombreux musées traduisent tous leurs cartels en braille pour rendre accessible leurs contenus aux visiteurs en situation de handicap visuel. Pourtant, sur la totalité des visiteurs malvoyants ou aveugles, seuls 10% lisent le braille. De plus, traduire un cartel en braille n’est pas accessible aux visiteurs malvoyants qui ne savent pas le lire et ont simplement besoin que ces textes soient rédigés en gros caractères.
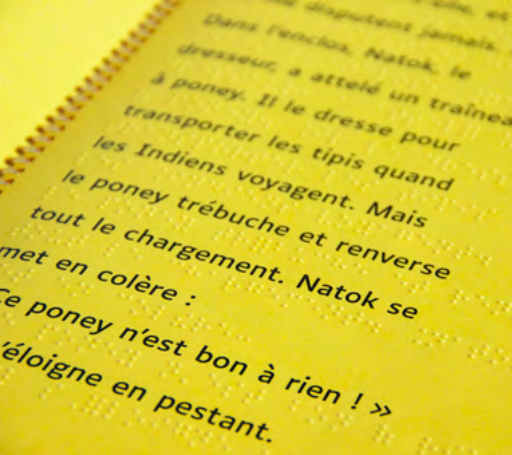
Page de livre en gros caractères et braille, Les belles histoires, Winona, la cavalière des plaines © Mes mains en or
« S’ils font des cartels en braille, qu’ils les fassent aussi en grands caractères. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Cet exemple de cartels uniquement en braille représente parfaitement ce que l’on appelle la « maladresse accessible »*, en voulant bien faire, il est courant de ne pas atteindre son objectif ou que le dispositif ne soit pas inclusif car le public concerné n’a pas été consulté et que des aspects importants de l’accès à l’objet ont été oubliés. C’est pourquoi il est important de garder à l’esprit que, si bienveillant que nous puissions être, si nous ne sommes pas en situation de handicap, nous ne pouvons pas comprendre l’étendue des difficultés rencontrées par nos publics.
« Je pense qu’il y en a beaucoup qui n’imaginent même pas nos difficultés. Nous, en tant que personnes en situation de handicap, on ne montre pas nos difficultés donc ils n’imaginent pas. Il faut côtoyer ou travailler avec des personnes en situation de handicap pour comprendre. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Afin d’éviter cet écueil et la perte de temps et d’argent qui peut l’accompagner, il est important de travailler directement avec les publics ciblés. Cette collaboration est essentielle à la pertinence du dispositif créé et peut se penser à court terme, en faisant appel pour la durée du projet à une personne en situation de handicap, une association, ou à long terme, en constituant un comité à consulter pendant les différents projets de la structure constitué de personnes en situation de handicap et de personnes sans handicap. Ce processus d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la création des dispositifs leur étant destiné en premier lieu est une pratique qui bénéficie tant aux destinataires qu’à la structure culturelle.
NB : Les propos rapportés des témoins ne représentent qu’un point de vue sur le sujet et n’ont pas valeur d’universalité.
*: contenus et termes étudiés par Maëlle Bobet, cheffe de projet culture et inclusion chez Signes de Sens, dans le cadre de ses projets au sein de l'association.
#Inclusion #ConceptionUniverselle#Handicap
Pour aller plus loin :
-
Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! : Il n'y a pas de vie minuscule, Erès 2012
-
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/tag/universal+design%3B+conception+universelle
-
Exposition et parcours de visite accessibles, guide du ministère de la culture, 2016

Décoloniser les musées : penser de nouvelles Alter Natives
Alter Natives est une association Loi 1901 fondée sur une convention en vertu de laquelle deux personnes au moins décident de partager leurs connaissances et/ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ou la recherche de profit. S’adressant à tous, elle conduit des actions dans lesquelles les jeunes personnes sont les premières bénéficiaires.
Mais qu’est-ce que ce type d’association apporte aux musées ? Comment peut-elle être porteuse de nouvelles pratiques qui poussent à réfléchir sur les héritages coloniaux et leur réappropriation par les nouvelles générations ?
Image d'en-tête : Médiation au Château des Ducs de Nantes, Mobiles Mémoires 2020 © Alter Natives
J’ai découvert Alter Natives au sein de mon apprentissage en septembre 2020. A l’instar de la recherche documentaire et de la préparation des médiations pour lesquelles j’avais été engagée, j’ai compris ce que l’expérience associative supposait au sein d’un projet organisé à Nantes en octobre de la même année. Le programme proposait aux jeunes adhérents de découvrir l’histoire de la ville à travers les traces de la « traite négrière » passée et de l’économie développée à travers l’esclavage. Le troisième jour était proposée une visite urbaine partant du Château des Ducs et se terminant au Mémorial de l’esclavage. La médiation se finissait au sein de ce lieu symbolique et fort, qui invite plus au recueillement qu’à la réflexion. Pourtant, ces jeunes, postés devant les citations abolitionnistes, parlaient d’Haïti, devenue indépendante en échange d’une dette nationale de 150 millions de francs d’or, de l’esclavage persistant au Mali ou du sénateur américain Tom Cotton qualifiant l’esclavage américain de « mal nécessaire ». J’ai été frappée par l’absence de distance entre ces jeunes et ces questions raciales et du calme qui s’installait progressivement autour de moi en les écoutant parler. Aucun n’avait de colère ou de dénonciation virulente à porter. Ce qui les dérangeait et les stimulait était plutôt ce silence laissé par l’édifice, comme si la mémoire portée par ces questions coloniales devait se faire à travers l’omission de la parole.
Qui sont les adhérents d’Alter Natives ?
Alter Natives touche chaque année 75 à 90 adhérents. Acteurs et bénéficiaires des projets, certains sont nés sur les terres d’anciennes colonies françaises, d’autres portent dans leur famille des mémoires collectives multiculturelles, d’autres, encore, ont vécu les épisodes nord-américains du Black Live Matter comme un écho profond de leurs maux sur le territoire français. Tous partagent l’envie de faire des écarts et des fêlures laissés par les épisodes de la colonisation des interstices leur permettant de se faufiler vers de nouveaux dialogues. Cacher cette histoire, ou la laisser au repos des programmes scolaires et muséaux, n’en recoud pas la plaie mais empêche l’émergence de ces aspérités où naissent de nouveaux liens sociaux. Les héritages de la colonisation et de la décolonisation sont nombreux au sein du patrimoine français. Les voix émergentes en faveur de la restitution de certains objets d’art, au niveau politique, scientifique et social en sont une preuve tangible. Les adhérents d’Alter Natives, résidents sur le territoire francilien, âgés de 15 à 21, portent la volonté de s’approprier ces legs. Leur double culture, ou la double mémoire que porte leur histoire familiale, alimente souvent cette volonté d’interroger collectivement les objets pris entre l’histoire croisée de la France avec les autres continents.
Mobiles Mémoires : une expérience collective
Cette expérience vécue à Nantes est née d’un programme proposé par l’association à partir de 2018. Pourquoi ne pas prendre Le Havre, Cherbourg, Lorient, Marseille ou encore Bordeaux comme terrains d’étude historiques et mémoriels ? Ces places, ouvertes sur la façade maritime, s’imposent comme les témoins qui font l’histoire longue des relations entre la France et les autres continents, notamment l’Afrique, mais également comme de véritables terrains patrimoniaux où les participants acceptent de déployer quatre entrées thématiques différentes : l’exploration du monde avec le mythe européen poussé par la science et le savoir - la traite des hommes et des femmes mis en esclavage - le second empire colonial français de Napoléon aux indépendances et les migrations - pris comme autant d’épisodes de déplacement des peuples et de leur culture. Ces quatre points d’articulation leur permettent de respirer au sein de ces villes portuaires l’air d’un passé à la brise contemporaine.
Car c’est tout cela qui se joue lorsque l’on se prend au jeu des articulations historiques et d’une synergie qui tend tout à la fois vers le passé et le monde actuel : c’est la reconstitution d’un monde, d’une réalité qui ne peut être peinte que si l’on accepte d’entremêler les tresses d’un monde perdu.
Rapprocher des jeunes franciliens des musées
Alter Natives est une association francilienne née de la volonté d’interroger les usages sociaux du patrimoine. Ses projets empruntent autant aux nouvelles pratiques muséales d’Europe et du Nord de l’Amérique qu’à la volonté de créer une cohésion sociale à partir d’interrogations historiques et culturelles communes. Parler d’Alter Natives et des diverses approches inclusives et participatives qu’elle porte mériterait plusieurs pages. Les outils de communication de l’association le font de manière plus exhaustive, ainsi que ses pages internet1. Néanmoins, l’utilisation des mots « inclusifs » et « participatifs », de plus en plus présents au sein des musées français rend légitime de décrire, ce qui, chez Alter Natives, mérite d’être qualifié comme tel.
Les projets d’Alter Natives ont en commun la volonté de rapprocher de jeunes franciliens des institutions patrimoniales et d’en développer les usages. Ils proposent non seulement de faire du musée des lieux familiaux pour un public qui s’y sent lointain mais également de rendre aux objets patrimoniaux leur qualité de « bien commun ». En périphérie des visiteurs scolaires parfois cyniquement qualifiés par les institutions de « public captif », Alter Natives donne à voir d’autres pratiques associatives où l’invitation faite à ses adhérents de se rapprocher des musées et du patrimoine ne se fait que par la décision, libre et autonome, de chaque participant.
Je crois que cette participation libre et déterminée de jeunes, issus d’horizons différents, liés à des histoires différentes et vivant à des rythmes différents, témoigne de deux qualités : d’abord de la prise de conscience d’une certaine fracture sociale actuelle ; ensuite, de la conviction que créer un dialogue avec les musées et leurs professionnels ménage un espace d’expression et de liberté où émerge une forme de résilience face à des contestations juvéniles contemporaines.

Médiation au Mémorial de l’esclavage de Nantes, Mobiles Mémoires 2020 © Alter Natives
Le participatif est social
Le mot « participatif » a été affilié, depuis la fin des années 1990, aux programmes d’expositions inclusifs et de partenariats entre conservateurs et communautés sources afin de doubler l’approche esthétisante d’une contextualisation des objets extra-européens au sein des collections ethnographiques. L’application concrète de nouvelles pratiques dans les institutions muséales et patrimoniales a permis de rendre une voix sociale et civile aux objets exposés. L’anthropologue James Clifford, théoricien du musée comme « zone de contact » cite l’exemple particulier du musée de Portland, où les cartels explicatifs d’un objet sacré se faisaient grâce au dialogue entre l’équipe du musée voulant parler de l’objet et les anciens Amérindiens souhaitant parler de l’histoire et de questions contemporaines. Cette compréhension mutuelle se retrouvait également chez les « cultural Olympiads » de Londres de 2012 qui intégraient des « comités de jeunes » londoniens au sein de quatre musées nationaux. Il s’agissait d’action de médiation, de réinterprétation de collections permanentes et de co-création d’expositions.
A une échelle plus modeste, ces participants aux projets d’Alter Natives créent un nouveau niveau de dialogue. Rassemblés autour de l’étude de l’histoire des villes portuaires françaises ou autour des collections extra-européennes du Quai Branly, c’est une agora qu’ils forment. Le processus créatif qu’ils portent, que ce soit par des court-métrages, du théâtre ou des médiations leur permet de devenir des acteurs de l’appropriation patrimoniale.
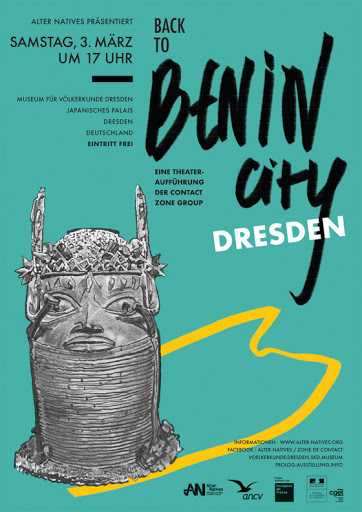
Affiche du projet Retour sur Benin City, 2018 © Alter Natives
En ouvrant un nouveau terrain d’action à ses adhérents, Alter Natives redonne une parole à la société civile et lui fait prendre part au destin des objets et au rapport qu’ils entretiennent avec les nouvelles générations. Elle créé des zones de dialogue entre des acteurs différents, qui se différencient par la relation que chacun entretient avec les institutions. C’est une mobilité des discours et des médiations que l’association nourrit. Ces jeunes bousculent les institutions en interrogeant les silences et en revenant sur des évidences qu’on ne questionne plus. Le dispositif de performance Retour sur Benin City, créé en 2018, invitait ainsi un jeune public à effectuer un travail de recherche sur l’histoire de l’acquisition de bronzes nigérians de Benin City afin de réaliser des performances restituées au musée de Dresde, à Vienne et à Montreuil. Décoloniser le musée devenait ainsi un objectif civil commun qui invitait, pour se faire, à penser la colonisation et l’expliquer à l’aune de notre société et non du silence laissé par la blessure de la domination des uns sur les autres.
Ainhoa Gomez
1Site internet d’Alter Natives : http://www.alter-natives.org/association/
Lien d’un article de Multitudes rédigé par Emmanuelle Cadet, directrice d’Alter Natives, Zone de contact autour d’histoires d’objets mal acquis : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2020-1-page-174.htm#re7no7
Photo de couverture / vignette : Médiation au Château des Ducs de Bretagne, Mobiles Mémoires 2020 © Alter Natives
#Association #participatif #décolonisation
Découverte du musée du Folklore de Tournai par le biais d'une visite atypique à but créatif
Cet article a été rédigé à la suite de ma première visite de cette institution municipale, à l’occasion de l’opération Musées(em)portables, concours de film courts organisé par le SITEM. Dans ce cadre 3 étudiantes du MEM sont responsables du jumelage entre le Musée du Folklore de Tournai (lieu de tournage) et les étudiants de l’HELHa qui créent leur film sur place. Simple accompagnatrice de mes camarades, je n’ai été qu’observatrice des interactions et de la découverte des lieux par les septante étudiants (présence en territoire belge oblige je ne dirai pas soixante-dix par respect de la culture wallone).
Devant l'entrée du Musée du Folkore après avoir sonné la cloche © J. D.
Installé dans une maison tournaisienne derrière la Grand’Place, les collections du musée sont abritées derrière des façades datant du XVII et épargnées par les bombardements. Après que l’on ait fait sonner la cloche de la porte d’entrée, Jacky Legge responsable du lieu depuis septembre nous accueil. Il est une personnalité phare de la vie culturelle de Tournai puisqu’il est aussi coordinateur de la maison de Culture, et chargé de cours auprès des étudiants participants.
Crée en 1930 sous la direction du conservateur Walter Rivez, le Musée du folklore de Tournai en Belgique fut novateur notamment par la récolte importante des dons de la populations, pratique muséale que l’on retrouve aujourd’hui dans des institutions de plus grande échelle tel que le Musée national de l’Histoire de l’Immigration1.
Toutefois comme le concède le nouveau responsable des lieux à ses étudiants, l’ensemble est resté dans son jus. En parcourant les 23 pièces du musée nous découvrons effectivement dioramas, vitrines et maquettes qui évoque la vie quotidienne la région tournaisienne entre 1800 et 1950 aussi bien par les expôts que par-là scénographie.
Ce retour dans le temps c’est aussi bien la force et la faiblesse de ce musée (au point que cela en ferait presque un cas d’école). Les effets en sont donc multiples pour l’expérience du visiteur dépendant bien évidemment de son profil. La visite gratuite est un point fort car elle permet une visite plus « légère » sans pression de rentabilité du temps passé sur place. De même en cassant la barrière financière on révèle davantage les autres barrières d’entrées au musée. De par son sujet non élitiste, le musée du folklore de Tournai n’est certes pas concerné par l’inconfort que certains groupes qualifiés tantôt de « public empêché », « champ social » voir « non public » peuvent ressentir dans des lieux de culture dite légitime. Au contraire ces individus peuvent prendre goût à leur visite par le caractère authentique des lieux des artefacts présentés. D’autant plus s’ils reconnaissent des objets, décors, particulièrement si le groupe de visite est intergénérationnel. L’ancrage territorial du musée, ainsi que sa longévité renforce ce type de visite. En effet aux mémoires préservés dans les lieux par les collections s’ajoutent celles des visiteurs qui venaient enfants avec leurs parents, aujourd’hui adultes ils peuvent prendre plaisir à retrouver les liens tel qu’ils les ont connus et, évoquer leurs souvenirs de visite.
D’un autre coté si le groupe ne possède pas les codes de référence des époques traités, on pense aux jeunes non accompagnés par leurs familles ou enseignants, le ressenti est tout autre. C’est d’ailleurs ce que j’ai pu observer lors de cette visite, certes dans un cadre scolaire mais dont le but était la production d’un contenu créatif s’inspirant des lieux, collections, sujets. Aussi a aucun moment il n’y a eu à l’intérieur du musée de transmission traditionnel délivré par un « savant » à un « non-initié ». La classe s’est de suite dispersée, à la recherche d’un point de départ d’une fiction. Ils n’ont pas été déçu par l’image du musée figé et des éléments de mise en scène « un peu flippant »2 (voir les photos ci-dessous) car pour eux c’était la matière nécessaire à leur créativité.
Ce sont souvent les mannequins et poupées qui sont perçues de manière négatives par nos jeunes visiteurs.
Sentiments que nous étudiantes du MEM partageons. © J. D.
Aussi plus qu’au statut et au contexte d’utilisation des objets, c’était l’effet du visuel qui était recherché au prime abord par ces étudiants. Jacky Legge s’est d’ailleurs étonné qu’ils ne soient pas venus demander de renseignements complémentaires sur les objets alors qu’il avait spécifié qu’il était disponible et volontaire à ce sujet. Ce constat n’est pas pour autant négatif, il montre juste que leurs imaginations n’ont pas besoin (pour la plupart) d’être nourries par des faits scientifiques sur les sujets filmés. Il est fort probable qu’ils reviennent par la suite, lors du développement de scénario demander le contexte d’utilisation d’un objet particulier par exemple. Cette visite alternative en groupe peut aussi susciter la même curiosité qu’un visiteur individuel peut avoir, c’est à dire qu’il choisit l’objet qu’il souhaite approfondir en termes de connaissance.
Cependant le musée du Folklore de Tournai étant très chargé malgré ses 1000m2, la documentation n’est pas toujours accessible librement, aussi c’est souvent une personne physique qui est dans la capacité de renseigner le visiteur. C’est par ailleurs une chose que le personnel permanant (trois personnes au total sur place) réalise d’une manière remarquable. Sylvain passionné par son lieu de travail et les mémoires qu’ils conservent, n’a pas hésité à me faire une visite spontanée. Agissant comme un médiateur volant qui s’ignore. Les actions envers le public m’ont semblé du même acabit. Simples, tout en étant efficaces et sensibles, ici les défauts sont tellement flagrants, les actions de renouvellement de l’exposition tellement faites « mains » que l’on ait touché par ce nouveau souffle apporté au musée…
© J. D.
 C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
Par ailleurs comme on peut le voir sur le cliché ci-haut cette intervention de l’artiste est signalée par un fil rouge noué. Il s’agit d’une table d’accouchement liée à une photo en noir et blanc d’une toile d’araignée (Bénédicte Hélin). Ce rapprochement permet de nombreuses interprétations : le fil serait cité comme une allusion au cordon ombilical. A cette association s’ajoute le texte « Si j’étais un fil je serai un filou philanthrope et je donnerai du fil à retordre » de Eric qui peut entrer en résonnance avec l’ensemble, si l’on pense par exemple qu’un accouchement peut donner du fil à retordre à la femme allongée sur la table ainsi qu’au gynécologue. Suivre cette idée conduit à des questionnements sur le contexte d’utilisation de l’objet valorisé, « A quel point cette table d’accouchement a-t-elle été bénéfique en terme pratique ? Est-ce que cela a été une révolution dans les arts obstétriques ? Est-ce que cela a permis de minimiser les risques ? ».
La liberté et surtout la présence du travail d’un artiste de manière temporaire dans un musée de société tel que le musée du Folklore de Tournai est à saluer. Ce sont des initiatives de ce genre que Jacky Legge peut poursuivre de manière plus fréquente, qu’à l’occasion de la programmation culturelle de la ville, dont le festival d’art contemporain l’Art dans la Ville3 (3ème édition en 2017) utilise le même principe de disposition d’œuvres en complicité avec des éléments, de l’espace urbain, de commerces et d’équipement culturels. Cette année, en octobre c’était Nicolas Verdoncq et sa proposition nommée L’île Noire qui s’est prêté au jeu au sein d’un musée du Folklore.
On peut imaginer que la participation du Musée du Folklore au projet Musées(em) portables grâce au jumelage avec les septante étudiants de l’HelHa pourra être valorisée tout en éclairant les collections grâce à la projection des films in situ.
Julie D.
#muséedufolklore
#tournai
#musées(em)portables
#HELHa
_________________________________________________________________________
1 Voir la galerie des dons du musée2 Citation de plusieurs élèves qui ont utilisé des objets dans leurs films pour faire un film reprenant les codes des films d’horreurs.3 https://artville.tournai.be/

Déjeuner au fond de la mine
Une mine d’ardoise au cœur des Ardennes belges
Une fois les blocs remontés à la surface, les fendeurs prenaient la relève. Travaillant à l’extérieur de la mine – un privilège ! – ils étaient chargés de découper les énormes blocs remontés des profondeurs en fines ardoises de 3 à 5 millimètres d’épaisseur prêtes à être posées. Payés au nombre d’ardoises découpées, ils travaillaient jusqu’à 10h par jour, pour sortir quotidiennement plus d’un millier d’ardoises. Celles-ci étaient ensuite chargé directement dans des camions pour être livrés.
Vestiges d'outils dans une galerie ©Chatenet A.
Du paternalisme au renouveau économique
Le système mis en place par les exploitants de la mine correspond complètement au schéma du début de l’industrialisation. Afin d’attirer les travailleurs, la paie est meilleure que celle des journaliers dans les champs et le travail ne dépend pas des saisons, provoquant un petit exode rural. Les salaires sont versés toutes les semaines – sauf pour les porteurs et les fendeurs – en fonction de la production des équipes, encourageant un travail acharné. En contrepartie, toutes les infrastructures appartiennent au patron, notamment le magasin général et surtout le bar, qui récupère ainsi une bonne partie de l’argent investi. Le patron contrôlait alors tous les domaines de la vie du mineur, de l’offre du travail à l’approvisionnement en biens de première nécessité, en passant par le divertissement.
La région de la Wallonie a particulièrement souffert de la fermeture des mines, et de manière plus générale, du déclin industriel de toute l’Europe de l’Ouest. De même qu’en Allemagne de l’Est, en Lorraine ou dans les Hauts-de-France, la disparition des grands employeurs et l’arrêt des usines a provoqué une crise économique et un chômage de masse dont les effets sont toujours visibles de nos jours. De nombreux savoir-faire ont alors disparu en même temps que les métiers, qui sont aujourd’hui remis en valeur comme partie intégrante de notre patrimoine historique.
Pour relever la tête, la Wallonie cherche alors à développer le tourisme, pour profiter de ses retombées économiques, en mettant en valeur à la fois son patrimoine naturel comme la Grotte de Han, et son patrimoine historique tel que le château de Bouillon ou l’abbaye d’Orval. Dans ce contexte de renouveau, d’anciens mineurs réhabilitent l’ardoisière en 1997 en créant « Au cœur de l’ardoise ». Ce ne fut pas une mince affaire ! Il a d’abord fallu pomper une grande partie de l’eau qui avait envahi la totalité de la mine (six mois de pompage furent nécessaires), puis nettoyer les montagnes de déchets envahissant l’espace. Aujourd’hui, seul l’étage le plus haut – à 25 mètres de profondeur – est accessible au public, l’étage intermédiaire servant de zone de sécurité par rapport au niveau de l’eau. La visite est libre, avec l’installation de plusieurs bornes interactives et multilingues (français, néerlandais et wallon), ou guidée. L’option qui vous est proposée ici est plus originale : la visite « mine gourmande ».
La Grotte de Han ©Chatenet A.
Un pari risqué
La salle à manger ©Chatenet A.
Chim Chollin
#AuCoeurDeLArdoise
#MineGourmande
#VisiteInsolite
#PatrimoineIndustriel
Pour réserver votre visite gourmande : http://www.aucoeurdelardoise.be/fr

Depot Boijmans Van Beuningen, le dépôt aux multiples facettes
Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
Le Depot Boijmans Van Beuningen, conçu par le cabinet d’architectes néerlandais MVRDV et inauguré en 2021 s’impose dans le Museumpark de Rotterdam comme le premier entrepôt d’œuvres d’art au monde entièrement accessible au public. Son architecture circulaire recouverte de panneaux miroirs reflétant l’environnement urbain qui l’entoure est une attraction en elle-même. Au-delà de son apparence iconique, le Depot interroge la manière dont un musée peut repenser son rapport au public et à la conservation de l’art. Est-il un simple dépôt visitable, une extension muséale ou un concept hybride redéfinissant les règles de la présentation artistique ?
Provenance des collections et leur nature, données et graphiques par © Depot Boijmans Van Beuningen
Un projet pionnier qui bouscule les codes muséaux
Traditionnellement, les réserves des collections des musées sont en grande partie inaccessibles au public, pour des raisons de conservation et de place. Le Conseil international des musées (ICOM) estime que 80 à 90% des collections muséales ne sont pas exposées et restent en réserve. Cette situation soulève des interrogations tant pour le grand public, qui peut percevoir ces œuvres comme inaccessibles, que pour les partenaires, les mécènes et les élus locaux, qui s’interrogent sur la visibilité et la valorisation de ces collections.
Le Depot Boijmans Van Beuningen prend le contre-pied en rendant visible l’intégralité de la collection du musée Boijmans Van Beuningen, soit plus de 154 000 œuvres. Ce désir engendre des choix particuliers à l’organisation des réserves : les œuvres ne sont pas classées par période ou mouvement artistique, mais en les regroupant en fonction de leurs exigences climatiques et matérielles.
Autour d’un espace central, sorte d’atrium déstructuré par des escaliers et passerelles (qui me fait penser à l’école de sorciers Poudlard !), le dépôt fonctionne comme un immense coffre de verre. Cette ligne artistique pensée par la designeuse Marieke van Diemen permet l’observation — des œuvres, des réserves, des ateliers de restauration — sous de nouveaux angles.
Vues de l’atrium central conçu par Marieke van Diemen, Depot Boijmans Van Beuningen. ©NC
Explorer, observer, apprendre : quand la pédagogie s’invite au cœur du dépôt
Le dépôt n’est pas seulement un espace de stockage ouvert au public, il s’agit d’un lieu de travail à ciel ouvert. Depuis les passerelles vitrées, les visiteurs peuvent regarder les restaurateurs et conservateurs à l’œuvre, voir les objets d’art déballés ou préparés pour le transport. C’est l’occasion d’observer en direct une restauration d’une peinture, pour raviver le teint d’une joue, les reflets de soleil sur un ruisseau. Le dépôt donne l’occasion de comprendre le cycle de vie des objets d’art.
Vue sur les réserves, Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
L’absence de cartels classiques met en tension une expérience qui peut se révéler à la fois plus intimiste, grâce à la possibilité de voir les objets en vision 360 degrés, ou plus froide, en raison du détachement provoqué par l’absence initiale d’informations. Néanmoins, les visiteurs sont invités à scanner des QR codes pour obtenir des renseignements sur les œuvres, les plaçant dans une posture peut-être plus active de découverte.
À gauche : Les « chevalets en verre » de Lina Bo Bardi, 2022, © Boijmans Van Beuningen
À droite : Les QR codes © Boijmans Van Beuningen
Certains espaces du dépôt vont encore plus loin en proposant une hybridation entre exposition et atelier pédagogique en autonomie. Ils ne se contentent pas de montrer des œuvres : ils invitent le public à adopter la posture d’un chercheur en histoire de l’art. Un exemple marquant est l’initiative menée autour des dessins italiens de la Renaissance, où les visiteurs entrent dans la peau d’un expert : sans cartel explicatif immédiat, ils sont amenés à observer, comparer les styles, repérer des détails significatifs pour identifier les dessins.
Aperçu de Secrets of Italian Drawings, Dépôt Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024. © Lotte Stekelenburg.
Une identité hybride qui questionne le rôle des musées
Si le Depot Boijmans Van Beuningen se présente comme un projet visionnaire, il soulève néanmoins des interrogations sur son propre positionnement. Ce modèle où le public accède aux coulisses d’un musée est une innovation qui peut troubler ceux qui cherchent une narration claire ou une expérience d’exposition plus classique. L’absence de parcours structurant et l’utilisation du numérique pour accéder aux informations peuvent créer une distance avec les œuvres, rendant la visite déroutante pour certains.
Par ailleurs, en brouillant la frontière entre exposition et recherche, certains espaces du dépôt transforment la visite en une expérience participative, où le regard est plus analytique et interprétatif que contemplatif. Ce modèle, à mi-chemin entre la monstration d’œuvres et l’expérimentation pédagogique, introduit une nouvelle dynamique dans la médiation muséale, en faisant du spectateur un acteur actif de sa propre découverte.
Enfin, en raison des travaux de rénovation du musée Boijmans Van Beuningen, certains espaces du dépôt accueillent temporairement des expositions. Cette proximité permet au public de continuer à accéder aux collections du musée en dehors de ses dispositions habituelles. Ces installations confèrent au lieu une dimension muséale, bien que le Depot ne revendique pas ce statut. Cette ambiguïté interroge : est-on face à une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la notion même de musée ?
Un modèle d’avenir pour les institutions muséales ?
Le Depot Boijmans Van Beuningen préfigure-t-il une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la manière de concevoir l’accès aux collections muséales ? Il offre en tout cas une réflexion sur la transparence des institutions culturelles et sur la façon dont elles peuvent partager leurs ressources concrètes et intellectuelles avec le public. Une chose est certaine : en effaçant les barrières entre l’espace muséal et ses réserves, le Depot invite à repenser la relation entre conservation, exposition et interaction avec le public.
Nina Colpaert
#Rotterdam #muséeinsolite #réserves
Pour en savoir plus :
- Le site du dépôt : https://www.boijmans.nl/en/depot/about-depot
- Présentation de la médiation autour de l’exposition Secrets of Italian Drawings, Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024 : https://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/dans-la-peau-d-un-chercheur-sur-les-traces-des-dessins-italiens
- À propos des QR code présents dans le dépôt, un moyen de constituer sa propre réserve : https://www.boijmans.nl/en/depot/app

Des assassins aux Invalides

L’expérience Assassin’s Creed a été accueillie à trois reprises par le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides. À elles seules, les deux premières éditions (vacances de Toussaint et de Noël 2018) ont réuni plus de 11 000 participants. Il s’agit là d’un jeu immersif basé sur l’univers d’Assassin’s Creed, un des jeux vidéo phares d’Ubisoft. L’agence Cultival, spécialisée dans la médiation culturelle, s’est chargée de l’élaborer à leurs côtés. Par le biais de cet « escape game » à demi-ciel ouvert, les participants découvrent ou redécouvrent le lieu, ayant même accès à des parties habituellement interdites au public au cours du jeu. Celui-ci, après les explications et modalités énoncées, leur laisse 1h30 pour venir à bout de leur mission et ainsi parcourir ces bâtiments historiques en renouvelant leur regard. Seuls ou accompagnés, ils errent guidés par leurs smartphones (un pour deux, maximum), et force est de constater que le collectif est plutôt préféré …
Attendez. Et si on présentait tout ça autrement … ?
Signe distinctif de participant facilitant l’accès à l’Église du Dôme © Emeline Larroudé
« Dans le tombeau de l’aigle,
Caché sous un autre ciel
Sur lequel les anges veillent
Le fruit défendu attend »
L’année 2018 a vu renaître un conflit historique : celui des descendants d’assassins et de templiers (ou serait-ce les rosicruciens du XXIe siècle ?). Une première vague a vu plus de 11 000 d’entre eux s’affronter, bizarrement un peu avant la Toussaint succédant à la fête des morts … Coïncidence ? De mi-juin à début juillet 2019, ils ont lancé une nouvelle offensive, toujours empreinte de discrétion, à l’ombre de nombreux regards, dans les coulisses de l’Hôtel national des Invalides. Guidés par les astres tant solaires que lunaires, de nuit comme de jour, ils se sont mobilisés pour percer un des secrets les plus énigmatiques de Napoléon 1er : l’emplacement de la Pomme d’Eden. Héritée de la Première Civilisation, on lui prête des pouvoirs inestimables qui auraient, par ailleurs, servis à l’empereur … La détenir reviendrait alors à avoir accès à une puissance incommensurable.
Mais, n’y a-t-il pas là comme un petit problème ? Rien ne vous titille ?

Vues intérieures de l’Eglise du Dôme © Emeline Larroudé
Cette deuxième version est, indéniablement, romancée. Elle mêle fiction et réalité si bien que sa lecture en est floue : comment prendre la mesure de cette porosité ? Qu’est-ce que le lecteur doit vraiment prendre en compte ? C’est peut-être là toute l’ambiguïté de cette expérience. « Enquête très stimulante, mi-historique, mi-fiction », nous dit Le Parisien. J’irai plus loin encore. Trois niveaux de lecture sont possibles : ce qui relève de l’univers Assassin’s Creed créé par Ubisoft ; ce qui relève de l’adaptation de l’univers Assassin’s Creed au lieu et à son histoire ; ce qui relève de l’histoire du lieu. Une fois ce constat établit, comment les distinguer de fait ? L’exercice semble bien ardu. S’il ne paraît pas nécessaire d’avoir déjà parcouru le dit jeu-vidéo pour avoir envie de participer, le faire, et réussir la mission à temps, les amateurs peuvent avoir certaines clés de compréhension supplémentaires qui manqueront aux participants lambda (symboles, univers, … et plus largement ce qui relève de la citation du jeu, notamment AC II ou encore AC Unity). Comment donc cette visite peut-elle alimenter sa culture personnelle lorsque, malgré le bon temps passé et l’attention portée aux différentes énigmes, l’on ne sait pas ce que l’on doit vraiment en retenir ?
Arrêtons-nous sur la devise des Assassins : « Rien n’est vrai, tout est permis ».

Hôtel national des Invalides, et modalités de jeu sur l’application dédiée © Emeline Larroudé
Qui plus est, qui sont ces assassins et templiers des temps modernes ? A l’inverse des institutions culturelles prônant généralement le « tout public » à tel point qu’elles finissent parfois par ne s’adresser à personne, le game design s’attache véritablement à cette question. Il propose alors des projets pertinents qui touchent le public visé, déterminé bien en amont, au lancement. Ici, même si l’expérience est ouverte à tous, il semblerait que le public visé soit plus particulièrement celui des jeunes adultes voire adolescents, adeptes de jeux-vidéos mais pas seulement. Pour résumer, le type de public qui se fait rare dans ces institutions culturelles qui n’arrivent pas à le mobiliser et ne savent comment l’attirer. L’univers emprunté, la durée de l’expérience, le niveau de difficulté des différentes énigmes … Tout est pensé pour eux. Le cadre « ludique », cependant, nuit lui aussi à l’apprentissage. Globalement, le but de ces joueurs est de gagner (c’est aussi le but des organisateurs), qu’ils soient bons ou mauvais perdants. Mais cette quête de la réussite amène parfois à privilégier l’efficacité, la rapidité, à l’attention qui ne se porte alors que peu sur le contenu quant à lui toujours ambigu.

Vues extérieures de l’Hôtel national des Invalides © Emeline Larroudé
Pourquoi, cependant, l’objectif serait-il d’apprendre ? Ne pourrait-on pas se contenter de la venue de milliers de personnes qui, peut-être, ne s’étaient jamais rendues en ce lieu auparavant, voire ne s’y étaient jamais intéressées ? Ces visiteurs, conquis par l’expérience, s’y rendront peut-être à une autre occasion pour tenter de percer ses véritables mystères … Soit. A cet égard, le score de plus de 11 000 participants en seulement deux sessions est remarquable. Par ailleurs, le fait que le Musée de l’Armée ait accueilli trois fois l’expérience est significatif : la plupart des séances (limitées à 20 personnes, mais proposées toutes les demi-heures environ) ont affiché complet, ce qui témoigne d’un engouement réel. Soulignons cependant que, si c’est là le résultat attendu (à savoir de nouveaux visiteurs conquis qui auraient moins de scrupules à pousser les portes du lieu une prochaine fois), malgré une bonne expérience, ludique, ce but est rarement atteint par les organisateurs. Pourquoi ? Peut-être parce que la visite classique n’est pas en mesure de leur apporter les sensations promises, elles, par un escape game ou un de ses cousins, et donc perd de l’intérêt pour eux.
Quoi qu’il en soit, l’expérience a le mérite indéniable d’être singulière et de conquérir les cœurs des participants, primo-visiteurs pour la plupart, qui s’en souviennent comme d’un moment très agréable et qui y associent le lieu, devenant décor 4D du jeu.
Voir la vidéo :
Emeline Larroudé
#museedelarmee
#cultival
#assassinscreed
#experienceassassinscreed
#escapegame
#ubisoft
Liens internet :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur notre chaîne youtube

Des expos recyclées
La production d’expositions et leur recyclage figurent au cœur des préoccupations alliant musées et développement durable. À Paris, le Viaduc des Arts accueille les Ateliers Chutes Libres et l’agence de design et d’architecture intérieure Premices and co. Ces deux structures sont formées par une seule équipe particulièrement soucieuse de l’économie circulaire. Rencontre avec Jérémie Triaire, designer scénographe et co- fondateur.
Pourriez-vous nous décrire ce lieu ?
Les Ateliers Chutes Libres ont été portés par l’agence Premices and co fondée en 2012 avec Camille Chardayre et Amandine Langlois suite à une formation à l’École Boulle et une résidence d’un an à l’incubateur des Ateliers de Paris.
Les premiers ateliers ont eu lieu dans le cadre de l’exposition Matière Grise conçue par Encore Heureux Architectes au Pavillon de l’Arsenal. Nous y proposions des sessions de valorisation de chutes de bois, ateliers qui se sont prolongés après l’exposition et que nous avons ensuite proposé à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.
Par la suite, nous avons souhaité occuper un lieu permettant de stocker les matériaux récupérés et d’accueillir des publics pour des ateliers. Nous sommes installés au Viaduc des Arts depuis plus d’un an.
Quels sont vos matériaux et d’où proviennent-ils ?
Ce sont surtout des chutes de bois que nous collectons exclusivement auprès d’entreprises, dont le Pavillon de l’Arsenal et le Théâtre du Châtelet. Ces chutes sont de nature variée. Pour les expositions, le pin et le bouleau sont majoritairement utilisés.
Nous récupérons aussi de petits dépôts de cuirs, de tissus ou de sangles, qui proviennent de la Réserve des Arts et que nous utilisons pour concevoir des accessoires lors des ateliers.
Comment est organisé ce lieu ?
Par pôles. Au rez-de-chaussée, un lieu dédié à l’assemblage et à la finition, composé de grandes tables, de perceuses, de visseuses et d’une quincaillerie. Au sous-sol, un espace insonorisé qui accueille des machines de découpe comme une scie sauteuse et des scies circulaires sur table. À l’étage, nos bureaux.
Comment répartissez-vous votre agenda entre les ateliers et l’agence ?
Notre temps est généralement divisé en deux. Parfois, les projets des ateliers et de l’agence peuvent aussi se rejoindre. Par exemple, via Premices and co, nous avons travaillé sur un projet d’aménagement de bureaux et décidé d’utiliser les Ateliers Chutes Libres pour accueillir nos clients et leur proposer de concevoir certains meubles, ainsi qu’un logo à installer dans leurs bureaux.

Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn
Quelles activités proposez-vous aux publics ?
Différents formats d’ateliers, de 2 à 4 heures, à la fin desquels les participants repartent avec leur création : une table, une lampe, une chaise ou encore une petite étagère. Pendant la réalisation, nous les sensibilisons à la provenance des matériaux et à la notion de récupération. Au sein-même des ateliers, nous tentons de générer le moins de chutes de matériaux possible.
Comment avez-vous financé ces ateliers ?
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) nous a octroyé un soutien financier. Par ailleurs, nos ateliers sont payants pour les participants, qui ont accès au lieu, aux matériaux, aux machines et consommables, ainsi qu’aux conseils des encadrants.
Avez-vous de futurs projets ?
Nous souhaiterions proposer des ateliers plus individualisés, ainsi que des formats plus courts, qui permettraient aux participants de repartir avec de plus petits objets.
Aussi, pour le moment, le prix auquel proposons nos ateliers attire un public plutôt privilégié, en partie car le lieu coûte cher à la location. Nous recherchons donc des aides pour pouvoir en proposer à moindre coût et sommes aussi ouverts à des partenariats. Par le passé, nous avions notamment collaboré avec Paris Habitat et proposé des ateliers gratuits dans les espaces communs d’un immeuble.
Signalétique Nuit Blanche 2016 © Premices&Co
Pourriez-vous nous présenter certaines réalisations de l’agence ?
Chaque projet implique des contraintes différentes et donc des solutions différentes. De manière générale, nous allons toujours tenter d’avoir un impact moindre, en sélectionnant certains types de matériaux, en privilégiant le local, en réemployant du matériel ou en privilégiant la location à l’achat.
Par exemple, dernièrement, nous avons conçu l’accueil de la Mairie de Paris où figurait initialement un tribunal. Le mobilier originel étant de bonne qualité, nous avons proposé de le conserver en partie pour concevoir la banque d’accueil. Cela ne s’est pas prémédité à l’avance, mais s’est décidé en voyant les meubles existants, conçus dans un beau bois.
Pour la scénographie d’une petite exposition dans un kiosque entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, portant sur les travaux en cours dans ces deux lieux, nous avons utilisé des projecteurs inutilisés du Théâtre du Châtelet et des échafaudages de chantier, qui ont ensuite retrouvé leur fonction première.

La maison du chantier, Exposition Figures Marquantes, réalisation Jean-François Aimé et Premices&co © Benjamin Verlomme
Et pour la signalétique de Nuit Blanche 2016, nous avons réemployé des caisses de transport d’œuvres d’art, que créent parfois les musées pour un usage unique et qui étaient destinées à être jetées, afin de s’en servir comme balises repères le long de la Seine. Faciles à repérer et utiles pour protéger les programmes du vent et de la pluie.
Avez-vous été confrontés à une problématique de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le recyclage de la scénographie d’une exposition ?
C’est un point qui pose vraiment problème. Nous n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre d’un concours, pour lequel nous proposions de réemployer le mobilier existant et n’avons pas été retenus. Bien que cela se comprenne et soit lié à une peur du recours, il devrait exister des solutions, comme grouper des marchés de scénographie pour plusieurs expositions, ou de façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord.
Propos recueillis par Laurence Amsalem
#economiecirculaire
#developpementdurable
#atelierschuteslibres
https://atelierschuteslibres.com/
Image de vignette et image d'introduction : Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Des musées font leur festival!
Cette année j’ai passé mes vacances à Budapest, pour découvrir son impressionnant parlement, la douce chaleur des bains thermaux, le quartier juif très animé, le musée de la Terreur à l’histoire douloureuse, mais surtout le Sziget Festival !
Une île sur le Danube est presque entièrement consacrée à ce festival pour accueillir un demi-million de « Szitoyens » tels qu’on les appelle ici.
À peine arrivée, la tente installée pour 3 jours, je consulte le programme et me rends très vite compte que je n’arriverai pas à profiter de toute cette mini ville reconstituée : une dizaine de scènes, un cirque, un théâtre, un cinéma, une fête foraine, un parc aventure, des terrains de sport, un quartier d’artisanat, un espace artistique, des Food trucks à n’en plus finir et surtout un quartier de musées.

Programmation du quartier des musées, Sziget Festival 2017. © C.D.
Après une bonne nuit de concerts et quelques heures de sommeil je cours voir de quoi il s’agit. En effet, c’est bien un véritable quartier avec une rue principale et des musées éphémères à découvrir de chaque côté. Pas moins de 10 musées de Budapest (excepté un musée parisien) se partagent la vedette :
- Le musée d’Aquincum
- Le musée d’Histoire militaire
- Le musée des Arts décoratifs
- Le musée de la bande dessinée et de la caricature
- La maison hongroise de la photographie
- Le musée hongrois de science, technologie et de transport
- Le musée national de Hongrie
- Le musée d’histoire naturelle
- Le musée d’Ethnographie
- Le musée de l’Immigration de Paris

Entrée du quartier des musées, Sziget Festival 2017. © C.D.
Chaque institution propose une découverte de son musée à sa façon.
Le musée d’Aquincum présente une reconstitution au style « bricolé » de l’intérieur d’une villa antique hongroise. Plusieurs activités sont proposées pour les visiteurs : les ateliers de parure pour les plus manuels, les jeux antiques pour les plus stratèges, sans oublier des soldats romains qui combattent à l’épée plusieurs fois par jour. Une occasion d’impressionner le public et d’inviter à l’échange.
Pour ceux qui ont rêvé de se mettre dans la peau de « Bones », le musée d’Histoire naturelle est fait pour vous ! En touchant trois véritables crânes humains du XVIIIe siècle, vous devez deviner quel était le sexe du défunt. Pour poursuivre la découverte des collections du musée, une exposition de panneaux et de vitrines racontait le parcours de divers explorateurs hongrois.
Le musée National Hongrois proposait des tests de personnalité pour se mettre dans la peau de personnages historiques locaux, et des goodies à réaliser soi-même ; badges et éventails estampillés avec les œuvres d’art du musée.
On ne pouvait non plus rater le bus « Ikarus », au milieu de toutes ces tentes, déplacé par le musée hongrois de science, technologie et de transport.Le musée ne pouvait se passer de l’un de ces bus typiques de Budapest des années 1970. On plongait alors dans le temps pour composter son propre ticket, entrer dans le bus et en apprendre plus sur son histoire.
La maison de la photographie rencontre aussi un franc succès ! Et pour cause le musée propose aux visiteurs de se prendre en photo dans deux mini-studios avec deux fonds différents et des costumes ; l’un était un fond vert, l’autre un fond de style 19e siècle. Les festivaliers se sont prêtés au jeu avec plaisir et repartent avec une photo inédite en souvenir.
Outre des ateliers de dessins, le musée de la bande dessinée et de la caricature, a invité les concepteurs du court métrage « Dirty Fred » à se prêter au jeu de la médiation. Le réalisateur et d’autres membres de l’équipe sont donc présents pour nous faire découvrir le projet par le biais d’un questionnaire et de nombreux goodies à la clef.
Le musée d’Histoire militaire a ravit les amateurs de batailles du 20e siècle avec une exposition sur les hussards hongrois pendant la première guerre mondiale et la présentation de costumes et d’armes d’époque.
Trônait également l’impressionnant dôme en céramique du sommet du musée des arts appliqués.Un atelier permettait de réaliser des rosaces en sable coloré afin de reproduire le motif de la verrière du musée. J’ai particulièrement apprécié jouer avec les collections du musée qu’il s’agissait de replacer selon différents critères, esthétiques ou financiers, montrant alors que l’appréciation d’une œuvre est relative.
La « tente sans frontière » accueillait le musée d’Ethnographie de Budapest et le musée de l’Immigration de Paris. Un partenariat a été mis en place entre les deux musées il y a 2 ans et c’est que qui a permis de les réunir cette année sous la même tente autour des thématiques de l’immigration et de l’intégration. Des expositions panneaux étaient à découvrir sur les côtés de la tente et au centre un grand écran avec un espace de dialogue et de documentation. Cet espace de 100m2 a accueilli de nombreuses animations tout au long de la semaine de festival : conférences, débats, présentations d’artistes, projections de films, etcetera.






Pendant ce voyage à travers les musées de Budapest, les différentes propositions de médiation se mélangeaient afin de recevoir au mieux ces publics si variés. On retrouvait des présentations plutôt classiques d’expositions panneaux et d’objets (en vitrines ou non), mais aussi des ateliers plus décontractés toujours en lien avec le musée et ses collections, des moments d’échanges et de co-création, et surtout des rencontres avec le personnel du musée dans un contexte totalement inédit. De nombreux médiateurs étaient là pour nous accueillir que ce soit pour un moment de détente ou quelques minutes d’apprentissage.
Le Sziget Festival fête cette année son 25ème anniversaire, et cela fait plus de 10 ans que le quartier du musée a vu le jour. Il faut dire que le festival ne ménage pas ses efforts pour booster le tourisme de la ville. Le pass du festival permettait d’avoir une réduction de 50% sur plusieurs musées dans Budapest et d’autres villes jusqu’à fin août 2017. Il existait aussi des « city pass » permettant de prendre les transports gratuitement et d’obtenir des réductions pour les thermes et diverses boutiques en ville. Un vrai plus pour rendre plus confortable le voyage de tous les festivaliers de passage dans la capitale.
Une belle découverte donc que ce surprenant quartier de musées, où se mêlent les institutions culturelles, le public et les artéfacts et où l’on rebondit de découvertes en découvertes suivant ses envies. L’idée de prime abord étonnante, que des musées soient représentés dans un festival, prend finalement tout son sens. Toutes ces personnes sont venues pour partager une passion commune : la musique. N’est-elle pas le médium par excellence qui à la fois transcende et différencie chaque population ? Tout comme les musées qui rassemblent les créations de l’Homme et de la nature, elle permet) à la fois de s’identifier et de découvrir l’autre. Les festivals, comme les musées, sont des lieux d’ouverture vers le monde qu’il ne faut pas hésiter à expérimenter.

Deux films du MEM primés, en prime!
Ce mercredi 23 janvier, le SITEM avait déroulé le tapis rouge : à midi avait lieu la remise des prix du concours Musées(em)portables. Le principe de la compétition est simple : produire avec du matériel non-professionnel un film de trois minutes dans un musée ou un lieu patrimonial. Son but : inviter à une réappropriation du musée par une démarche créative très libre et très simple à mettre en œuvre.
Comme chaque année, les étudiant.es du MEM ont répondu présent.es au défi lancé par Museumexperts. Elles ont réalisé six films au Musée des beaux-arts d'Arras et ont accompagné 14 groupes d'élèves du secondaire, d'étudiant.es ou d'adultes pour la réalisation de leurs propres films dans diverses institutions volontaires des Hauts-de-France. Au total, le master a participé de près ou de loin à l'élaboration de 56 films envoyés aux organisateurs du concours, qui en ont reçu 78 pour cette édition.
Et il faut croire que la quantité n'a pas nui à la qualité pour cette édition puisque deux films réalisés par les étudiantes du MEM ont été primés : La Belle Hélènea obtenu le 1er prix décerné par Museumexperts et MBA Hotel a obtenu le 3e prix. Le jury a choisi de récompenser deux productions de tonalité et de facture très différentes qui ont néanmoins en commun, a précisé le jury, d’assumer un parti-pris, un regard original sur les lieux filmés. MBA Hotels’inscrit dans un tout autre registre : c’est un court-métrage humoristique, une réflexion décalée sur les nouvelles appropriations des musées par le public. La Belle Hélène est un court-métrage poétique, qui propose au spectateur de suivre le quotidien d'Hélène, une femme-muse. La Belle Hélène s’est également vu remettre un prix spécial de l’Association des Conservateurs des Collections publiques de France qui a ainsi voulu distinguer tant ses qualités esthétiques que l’audace de son propos.
Vous vous en voulez d'avoir raté la cérémonie ? Bonne nouvelle : vous pouvez visionner les six films produits par les étudiant.es du MEM ici.
Et bientôt les 6 films lauréats de cette édition sur : http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/videos
C.R.
#SITEM
#Musées(em)portable
#vidéo

Ecrire³ au musée, sur le musée, pour le musée
Avec la promotion des Master 1, nous sommes parti.es en résidence d’écriture à Boulogne-sur-Mer. Accueilli.es pour l’occasion au musée de la ville, nous avons pu découvrir la collection Alaska en compagnie d’Elikya Kandot, directrice de l’institution, et de Justine Vambre, en pleine rédaction de sa thèse sur la transmission et le patrimoine partagé autour de cette même collection composée de 270 objets. Donnée en 1875 au musée, cette collection rassemblée lors du voyage d’Alphonse Pinart, un explorateur ethnologue du 19ème siècle, possède une histoire bien particulière. Tombée dans l’oubli de 1900 à 1980 et divisée entre la France et Berkeley aux Etats-Unis, elle se caractérise par un manque de connaissance et une perte de sens pour la ville de Boulogne-sur-Mer. Elle soulève ainsi la problématique de son interprétation et sa réappropriation qui pourrait être initiée à travers un échange et un partage entre les deux parties de la collection et le lieu d’origine de ces objets.
Durant trois jours, nous avons donc fait la connaissance de la collection et plus particulièrement des masques associés aux chants rituels, de leurs histoires et nous avons écrit à leur sujet, accompagné de Catherine Berthelard, animatrice de résidences d’écriture. Nous avons pu, à travers l’écriture, nous approprier cette collection, comprendre leur histoire, leur origine. La résidence d’écriture et tous ces exercices ont su tisser un lien au fur et à mesure entre les participant.es et la collection. Cet article est donc l’occasion de se pencher sur l’intérêt des résidences d’écriture, ou plus particulièrement de l’écriture comme médiation.
Image d'en-tête : Le château-musée de Boulogne-sur-Mer © M.D
Qu’est-ce que l’on entend par résidence d’écriture ?
Une résidence, de manière générale, est une forme de soutien à la création ou à l’action culturelle. Fournissant les conditions financières et techniques nécessaires, la résidence permet à tout écrivain ou artiste (chorégraphe, musicien, plasticien, …) de créer, écrire et produire une œuvre, en dirigeant éventuellement quelques actions de médiation. Institutionnalisées depuis les années 80, les résidences peuvent prendre des formes variées selon la structure et le projet que ce soit de l’ordre de la valorisation, de jeunes artistes, d’une pratique artistique, de l’expérimentation, de l’animation ou générateur de rencontre, sociale, intergénérationnelle, interprofessionnelle, ect.
La résidence peut ainsi s’apparenter à de la médiation culturelle dans la mesure où le projet et ses acteur.ices ou l’artiste en question décident de mener des actions avec les publics. Dans ce cas, la résidence ne se cantonne pas à la création de l’artiste mais vise à créer des liens entre l’œuvre réalisée et des publics. (Carole Biseniues-Penin, « Les résidences d’écrivains et d’artistes : des dispositifs de créations et de médiation »). En ce sens, la résidence incarnerait alors un médium pour mettre en relation les publics et leurs intersubjectivités avec l’objet culturel. Il s’agirait de mettre en dialogue les sujets et l’artefact, le regardeur et le regardé et d’ainsi offrir aux publics un moyen de s’approprier un objet culturel, une collection.

Une partie de la collection « Alaska » © M.D.
Des textes dans une exposition à la médiation littéraire, il n’y a qu’un pas
Cette médiation peut tout à fait se vivre avec l’écriture. L’écrit dans les expositions est, effectivement, omniprésent. Les visiteur.euses, en arpentant une exposition, découvrent des œuvres d’art, des objets et des textes. On les retrouve sur tout type de support, des cartels aux fiches de salles en passant par les panneaux et les murs. Sur un ton scientifique, humoristique, philosophique ou poétique, ils viennent partager des connaissances sur ce qui est exposé, sur la thématique de l’exposition. Ils fournissent du sens, un discours, un point de vue sur un sujet en particulier. Les clés de compréhension semblent donc, le plus souvent, passer par l’écrit. Néanmoins, ils restent lointains car écrits par une tierce personne, le(s) commissaire(s) de l’exposition ou le(s) muséographe(s) et pas toujours à la portée de tous.tes. Le vocabulaire utilisé, le ton semblent essentiels pour permettre de toucher et d’intéresser le plus grand nombre. La réception des textes d’expositions, des écrits dans les expositions reste tout de même différente en fonction de chacun.es.
Comment le public peut-il s’approprier ces écrits et se saisir du sens d’une exposition et de son discours ? En gardant à l’idée que cette médiation écrite contribue à produire du sens pour les visiteur.euses, ne serait-il pas judicieux que ces dernièr.es puissent le produire eux-mêmes ?
Venir écrire sur une exposition, une collection, un objet, une œuvre en particulier ne serait-il pas un moyen de venir s’approprier le sens, de créer sa propre interprétation et de devenir acteur de sa visite comme ce fut le cas pour la promotion des Master 1 lors de leur résidence d’écriture au Musée de Boulogne-sur-Mer ?
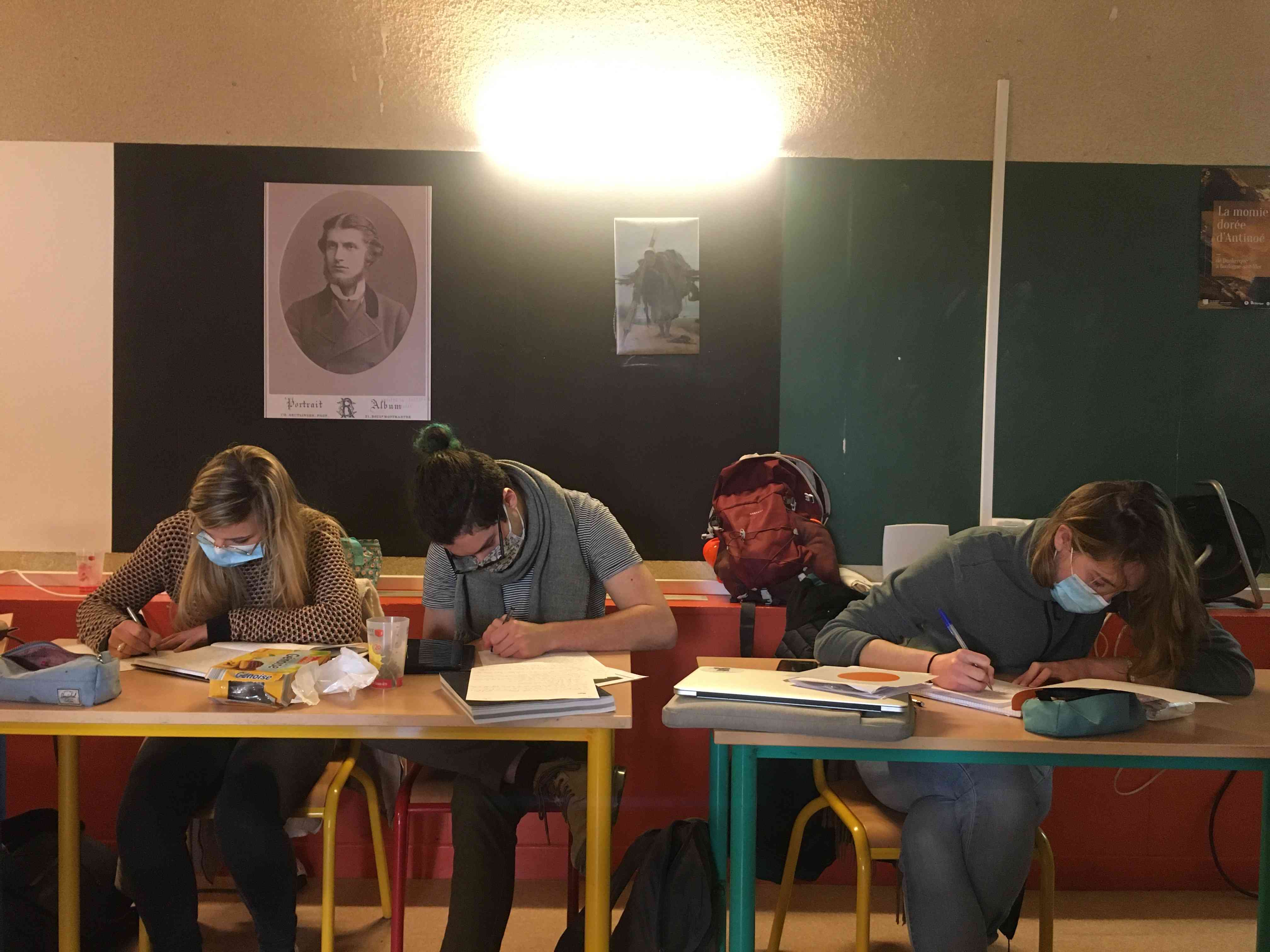
Tous.tes inspiré.es pour écrire sur la collection « Alaska » © M.R
Petit tour d’horizon des actions de médiation littéraire …
Dans le département du Nord, on pense à la Villa Marguerite Yourcenar, un centre de résidence d’écrivains européens. Il s’agit ici pour un.e écrivain.e ayant publié au moins un livre chez un éditeur professionnel de participer à une résidence d’écriture de un à deux mois sans devoir produire un ouvrage mais en devant participer à trois rencontres lors d’événements littéraires organisés par l’institution. Ici, cette résidence a pour objectif d’offrir aux écrivain.es sélectionné.es les moyens de rédiger un livre tout en participant à quelques rencontres. Il n’est cependant pas question d’une animation de production d’écrits avec un public autour d’une thématique, d’une collection.
Evidemment, beaucoup de musées littéraires proposent des résidences d’écriture à des écrivain.es. Parmi elles, la maison de l’écrivain Michel Butor à Lucinges dans la Haute-Savoie ou encore le Musée Rabelais, à Seuilly dans le Centre-Val de Loire, qui accueille depuis 2015 des écrivain.es en résidence. En Nouvelle Aquitaine, on retrouve le Chalet Mauriac, fréquenté par l’écrivain François Mauriac durant son enfance, qui possède un espace dédié à toutes les formes contemporaines d’écriture : de l’écriture numérique ou graphique en passant par l’écriture littéraire, cinématographique et aussi audiovisuelle ou musicale... Accueillant des auteur.es/réalisateur.trices d’une semaine à deux mois, la structure vient alors soutenir la création cinéma et audiovisuel par l’accompagnement dans l’écriture et le développement d’un long métrage.
Bon nombre d’autres musées et institutions se sont prêtés au jeu de cette action de médiation littéraire venant offrir un regard neuf et extérieur sur l’objet/le sujet en question, et bien au-delà de musées littéraires. Parmi eux, Le Muséum National d’Histoire naturelle de Paris, en 2017, qui a mis en place un atelier d’écriture pour des personnes à partir de 15 ans avec l’écrivain en résidence, Patrice Pluyette. Avec pour thème La nature exposée, l’écrivain et les participants ont écrit à la manière du roman initiatique. Ce genre littéraire, nourri par les expéditions passées et par le travail actuel de chercheurs, vient faire la jonction entre le public et cette histoire culturelle.
Autre exemple : une initiative plaçant les publics au cœur de la rédaction d’un recueil fut organisée en janvier 2017 par le Musée National de l’Histoire de l’immigration. Bernado Toro, auteur en résidence, a proposé pendant dix mois des ateliers d’écritures dans différents quartiers de la capitale. Avec des publics variés ayant un lien avec l’immigration, il a produit un recueil de dix nouvelles sur l’immigration à Paris et le regard que les migrants portent sur la société française.
Une action plus récente d’ateliers d’écriture durant l’automne 2020 dans ce même musée a eu pour thématique Ecrire sur soi ; Kidi Bebey, écrivaine, a, dans le cadre de sa résidence d’auteure au musée, animée six ateliers d’écriture à un groupe d’élèves d’une classe d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPEAA) d’un collège de Grigny en Essonne conduite par Bénédicte Vermogen. Ces ateliers, effectués à distance en raison du contexte sanitaire actuel, avait pour but de permettre à des élèves marqués par l’expérience migratoire d’écrire un récit sur soi et sa famille.
Vous l’aurez compris les résidences d’écriture et ateliers d’écriture ont de multiples objectifs. Elles viennent soutenir la création littéraire, elles invitent un.e auteur.e à porter un regard extérieur et singulier sur une institution, un territoire et ses habitants ou encore occasionnent pour les publics la rencontre avec un.e artiste, une œuvre, une collection et/ou une pratique artistique. Ainsi, la médiation littéraire semble être avantageuse pour les deux parties avec d’un côté, les participant.es qui deviennent acteur.ices d’un projet en étant inclus dans ce processus de production de sens, et de l’autre les institutions, à l’origine du projet, qui viennent enrichir les approches et les discours autour de l’objet culturel en question. Il semblerait que ces actions soient encore minimes et concentrées chez certains musées adeptes de ces formes de médiation. Les résidences d’écriture et plus particulièrement les médiations littéraires peuvent aider à l’inclusion des publics au cœur des expositions et actions que proposent les musées et institutions.
Manon DEBOES
Venez découvrir le carnet réalisé lors de la résidence d’écriture par la promotion des MEM1
http://formation-exposition-musee.fr/formation/projets-et-actions/37-workshops-museographie-expographie
Bibliographie
« Les résidences d’écrivain et d’artistes : des dispositifs de création et de médiation », sous la direction de Carole Bisenius-Penin, avril 2017
https://journals.openedition.org/culturemusees/1487
« La médiation écrite au musée : miroirs et jeux de miroirs », Pascal Ancel, décembre 2010
https://journals.openedition.org/ocim/378
Pour aller plus loin sur la question des résidences d’artistes
La résidence d’artiste : Enjeux et pratiques, Nicole Denoit, Catherine Douzou, Collectif, 2016.
#médiationlittéraire #résidencedecriture #lecritaumusée
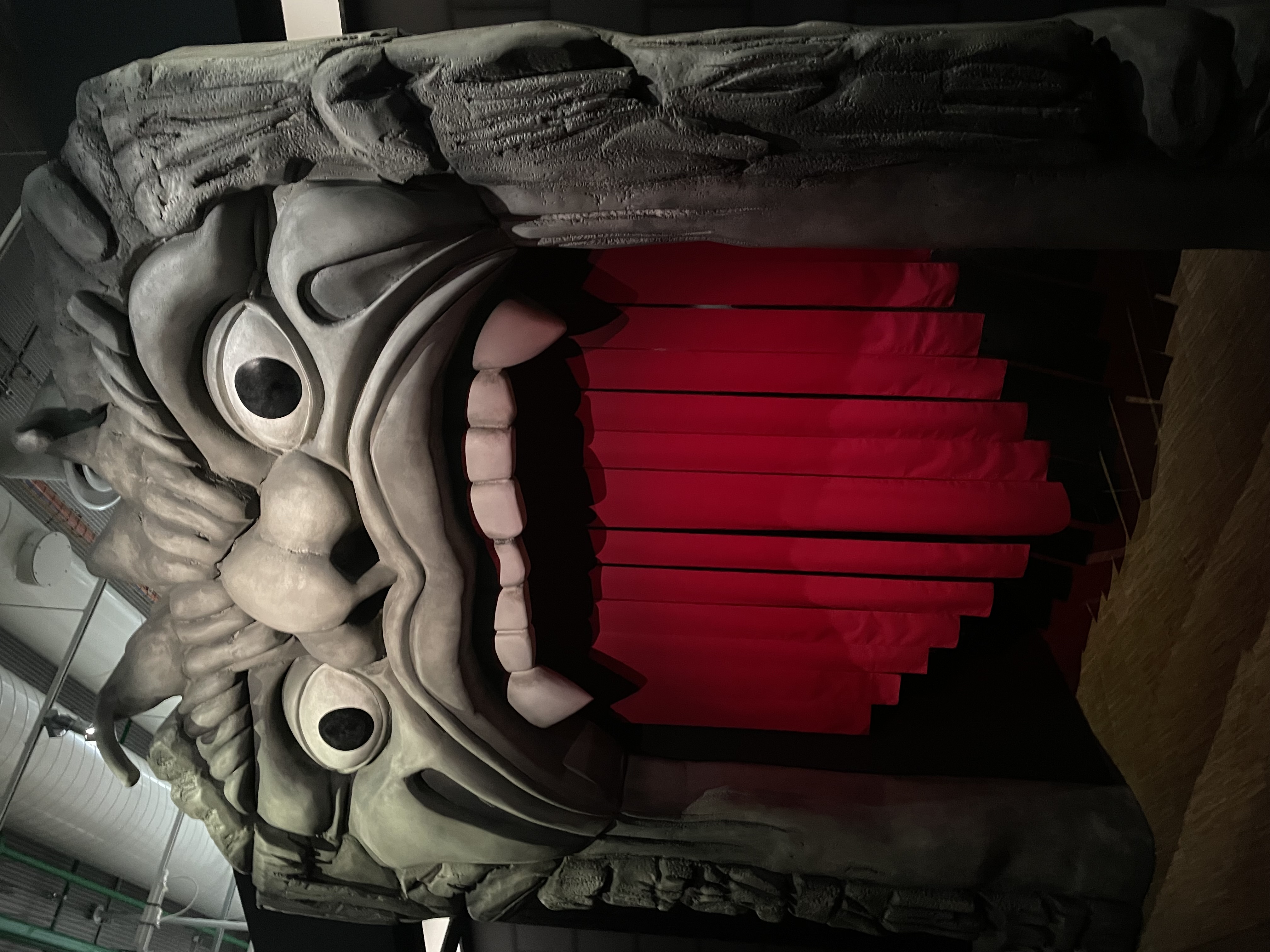
Exposer ou médier l’art ?
Les expositions d’art reflètent des choix stratégiques quant à la manière de présenter les œuvres et de dialoguer avec les publics. L’exposition Surréalisme (2024) au Centre Pompidou à Paris et Ensor, rêves fantasques. Au-delà de l’impressionnisme (2024) au KMSKA à Anvers illustrent deux approches diamétralement opposées : l’une laisse l’œuvre se suffire à elle-même pour susciter une interprétation, tandis que l’autre place la médiation au cœur de l’expérience. Ces choix, loin d’être anodins, influencent directement la relation des visiteurs avec l’art et interrogent les responsabilités des musées envers leurs publics.
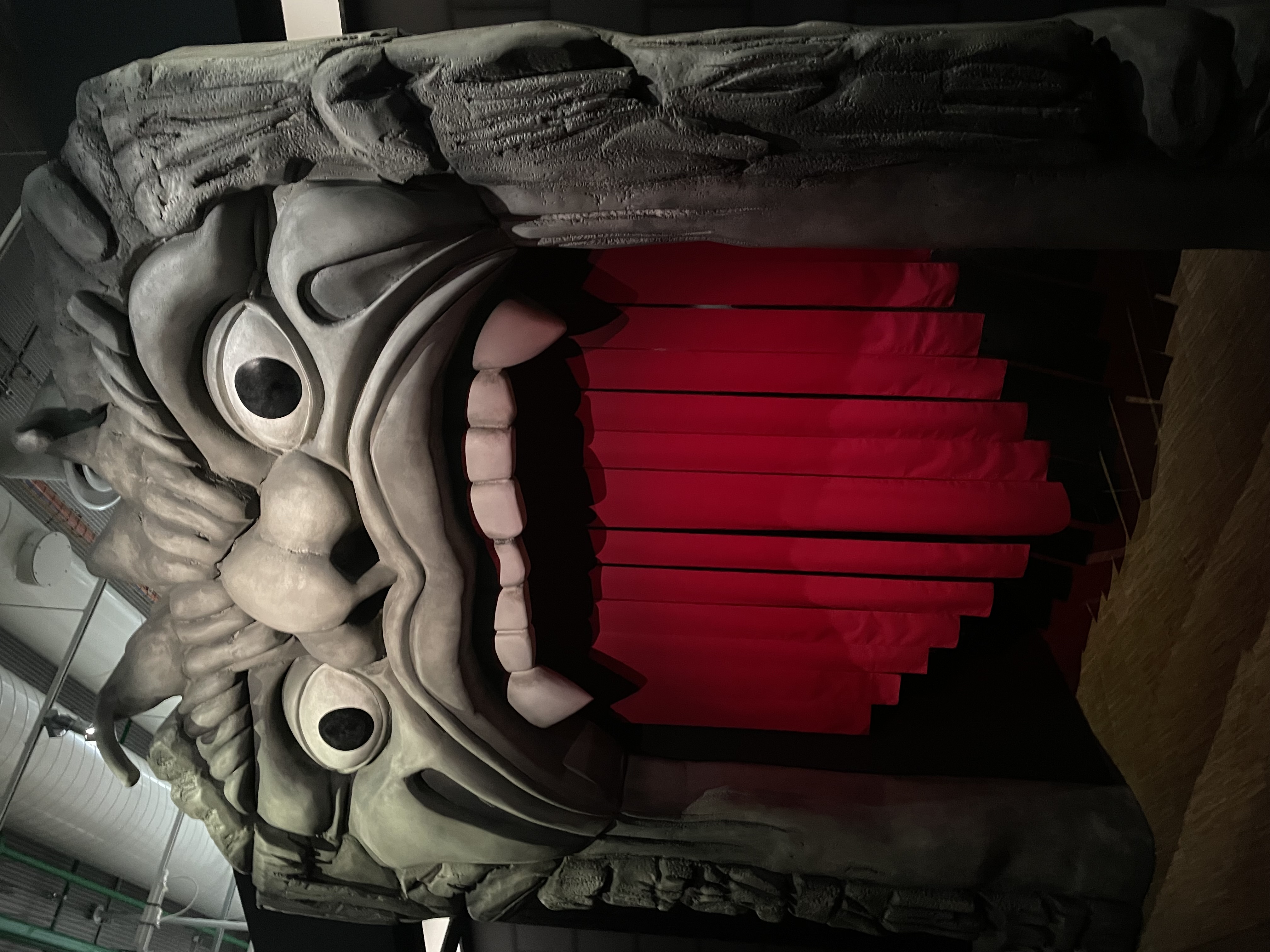

Exposition “Surréalisme”, Centre Pompidou et “Ensor, rêves fantasques. Au-delà de l’impressionnisme”, KMSKA. Les deux expositions s’inspirent de la façade de l’Enfer, un cabaret emblématique qui a marqué James Ensor dans son art, mais aussi un lieu de rassemblement pour les surréalistes autour d’André Breton. ©E.L
L’œuvre comme unique narrateur : les limites d’une médiation minimale
Visite guidée pour jeune public proposé par le Centre Pompidou dans le cadre de l’exposition “Surréalime” ©capture d’écran du site internet du Centre Pompidou.
Podcast conçu par le Centre Pompidou dans le cadre de l’exposition “Surréalime” ©E.L
Une médiation inclusive et plurielle : la force de l’exposition Ensor ?
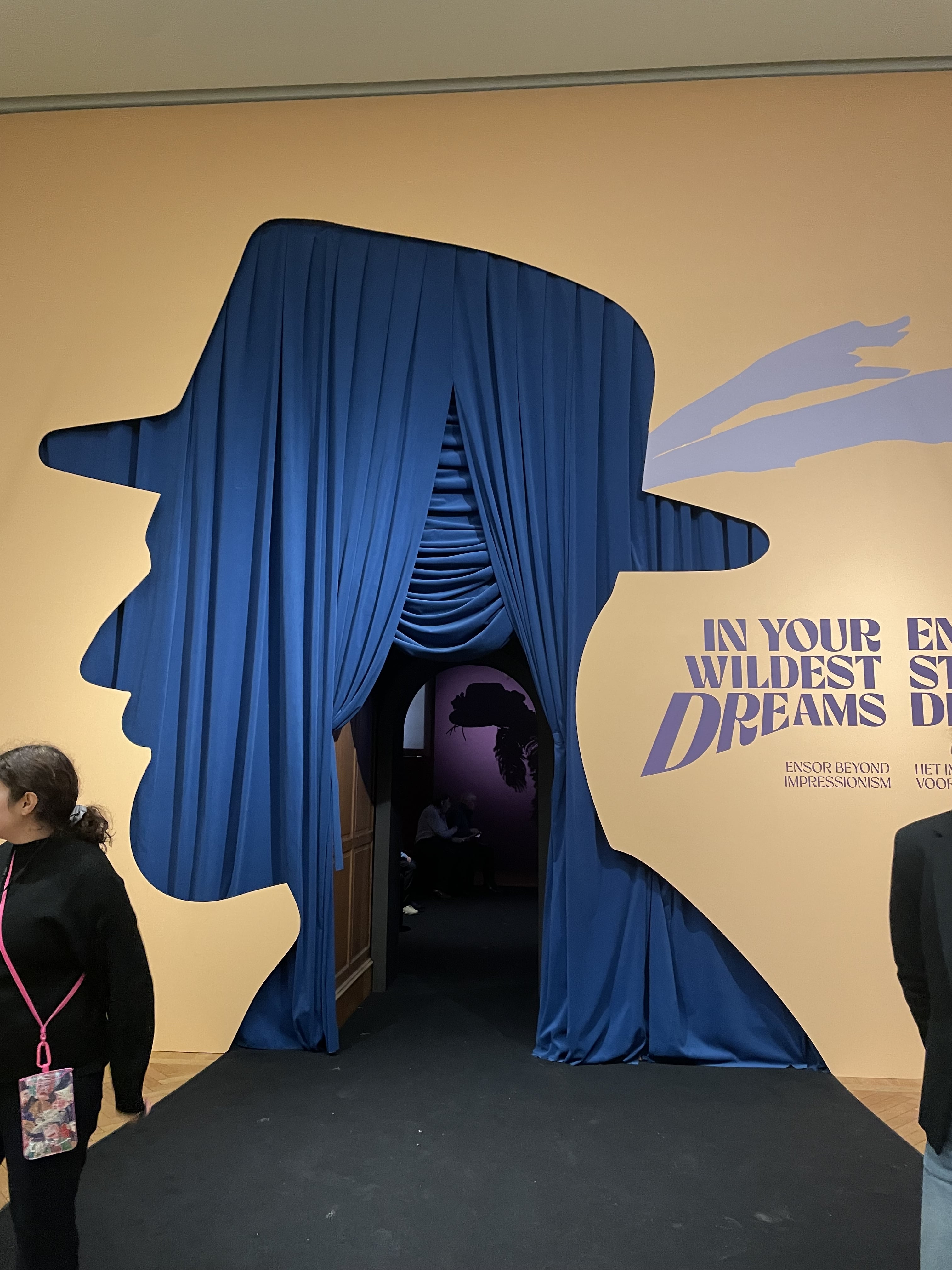
“Ensor, rêves fantasques. Au-delà de l’impressionnisme”, KMSKA à Anvers ©E.L

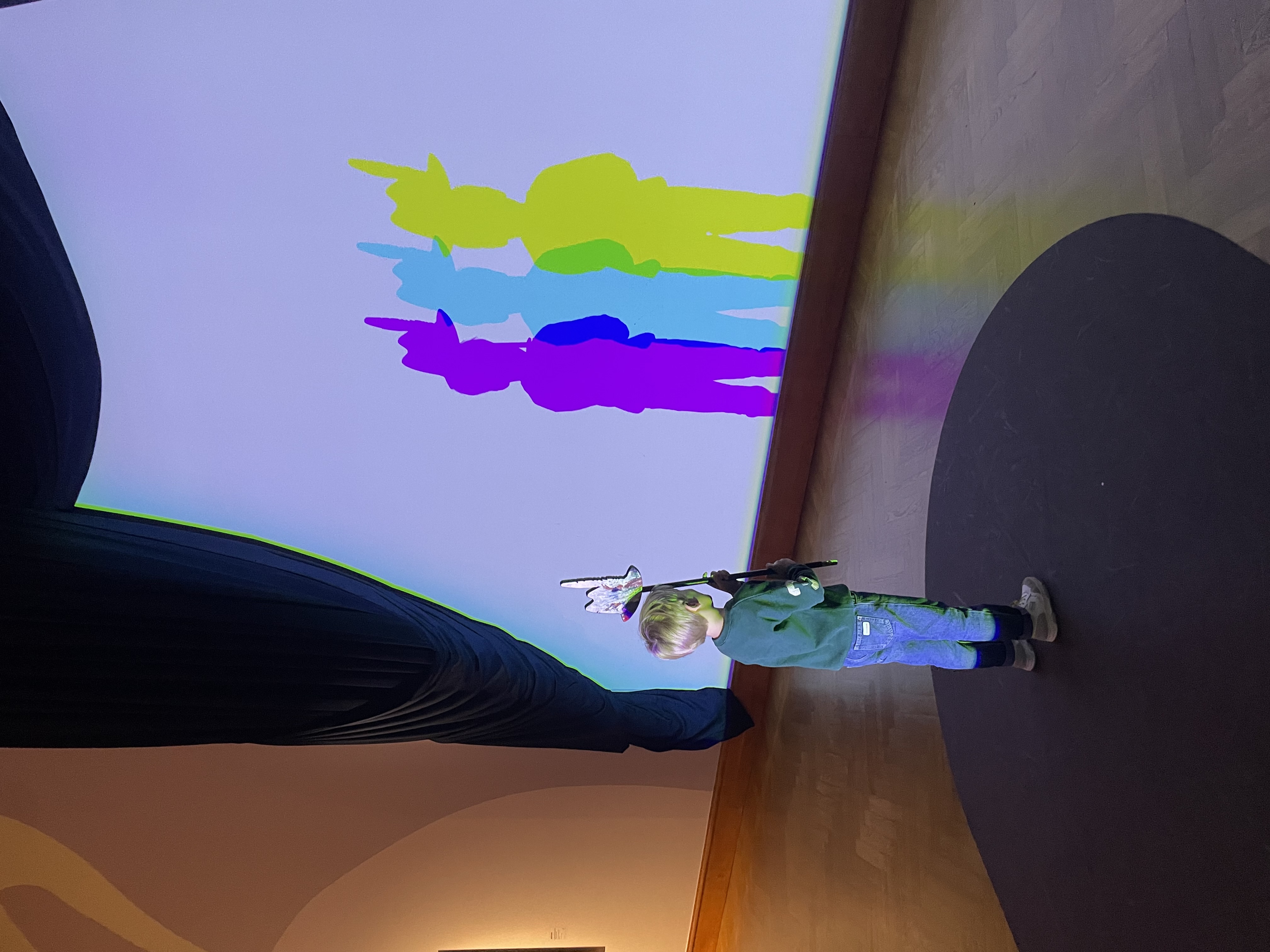
Exemples de dispositifs de médiation proposés par le KMSKA ©E.L
Réconcilier l’art et ses publics

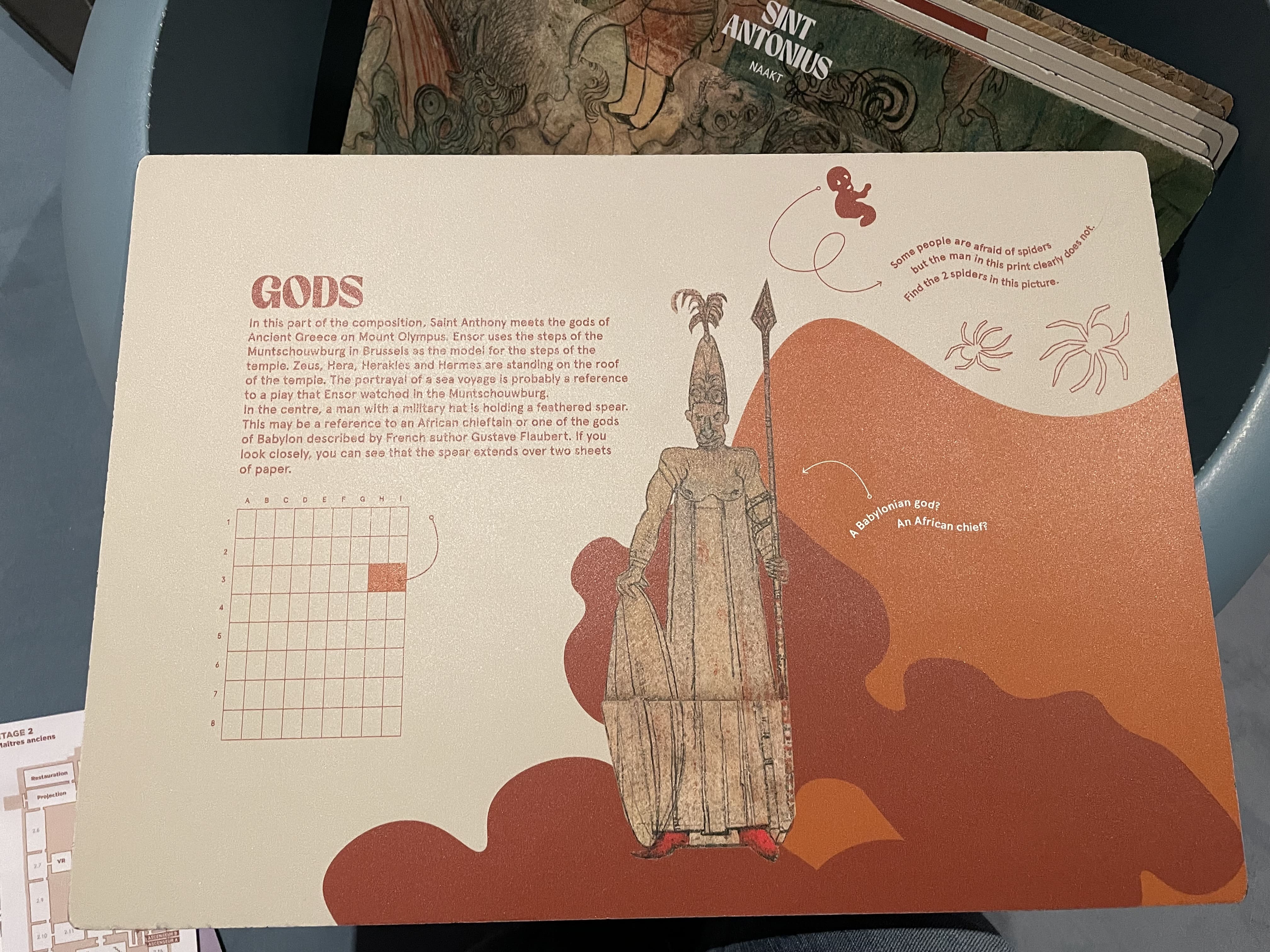
Exemples de dispositifs de médiation proposés par le KMSKA. Ici, la compréhension de cette œuvre monumentale est enrichie par un jeu qui exploite le quadrillage naturel formé par les pliures de l’œuvre, mettant en lumière certains détails spécifiques. ©E.L
Vers une médiation équilibrée et inclusive
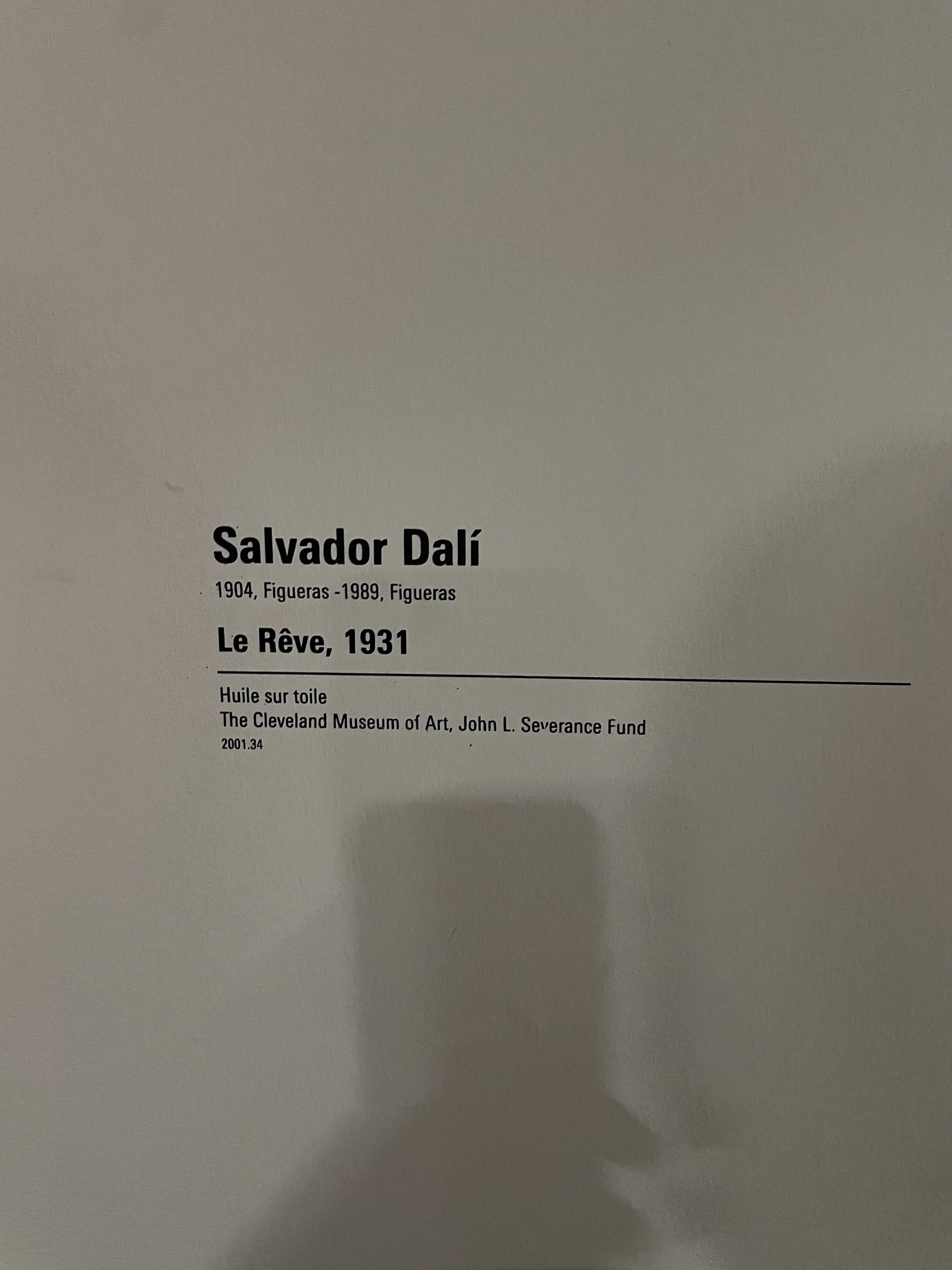
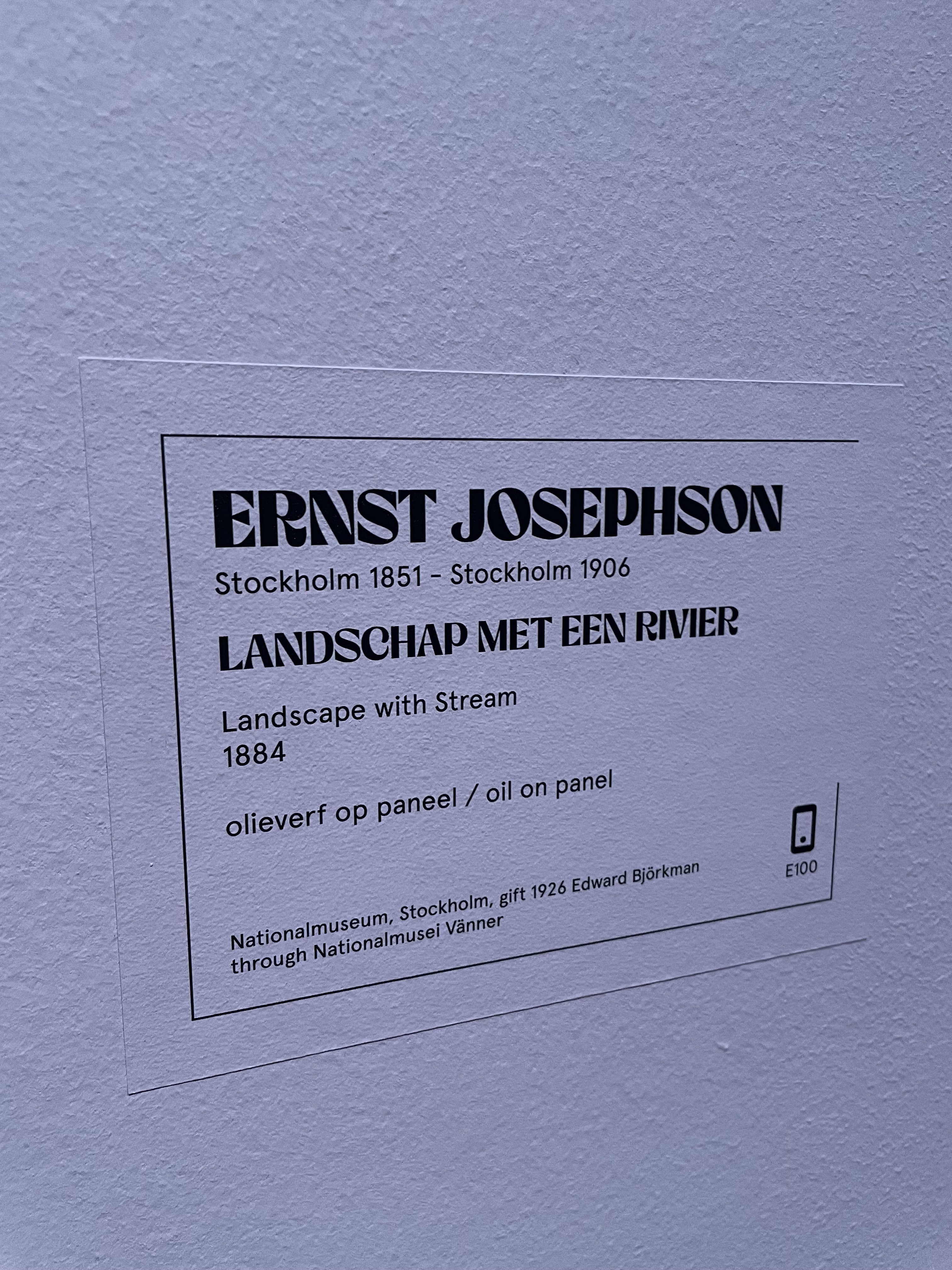
Exemples de cartels du Centre Pompidou et du KMSKA (le logo présent en bas à droite permet aux visiteurs de se référer à un livret d’aide à la visite qui donne des explications supplémentaires sur les œuvres) ©E.L
E.L

Familles au musée : le Tote Bag du Louvre-Lens
Le 6 novembre 2019 s’est tenu au Louvre-Lens une présentation d’un dispositif famille mis en place grâce à un partenariat réunissant L'École de la deuxième Chance de Liévin (E2C), Le Louvre-Lens et le MuséoLab du Louvre-Lens-Vallée. Y a collaboré le Master Expographie Muséographie pour la phase test. Il s’est agi de créer des outils de médiation inclus dans un tote-bag mis à disposition des familles pour animer leur visite de la galerie du temps *.
Le MuséoLab : un espace de co-construction
Lancé en 2014 par Serge Chaumier, qui en est le responsable scientifique, le MuseoLab prend place dans le bâtiment de Louvre-Lens Vallée. Il a été inauguré fin août 2019. Ce fablab au service de la muséographie permet de travailler en partenariat avec des structures culturelles et de faire découvrir aux publics les outils numériques. Plusieurs projets sont en cours de développement, dont celui décrit ci-dessous.
Une collaboration enrichissante
Louvre-Lens, 10 heures. La présentation du dispositif famille commence. Gautier Verbeke, responsable de la médiation au musée, explique le projet en quelques mots. L’E2C propose à des jeunes de participer à un dispositif construit en partenariat avec le musée et le MuséoLab afin de créer des supports de médiation pour les familles visitant la galerie du temps. Il s’agit de former les jeunes à la maîtrise des machines, en leur faisant fabriquer des outils de médiation et ce faisant de les sensibiliser au contenu du musée. Le projet co-organisé entre l’E2C et les équipes de médiation du musée consiste en une série de six ateliers animés par le FabManager. Le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois (MEM) y est associé pour la phase d’évaluation des usages des outils réalisés. Le soutien de la Fondation Orange a permis de financer le projet. Le film relate en une dizaine de minutes le projet. « Le musée est un outil pour tous » conclut celui-ci.
Le film débute. Nathan Chateau, fabmanager du Louvre-Lens (auquel a succédé aujourd’hui Léo Marius), apprend aux jeunes de l’E2C les bases des outils informatiques. Grâce aux imprimantes 3D et autres découpeuses laser, le kit de médiation prend forme : on découvre un puzzle représentant la galerie du temps et de petits viseurs pour voir l’œuvre autrement. Ces viseurs, créés grâce à l’imprimante 3D, permettent de jouer sur les perspectives de l’œuvre, mais aussi sur la perception que le visiteur en a puisque, selon la forme utilisée - carré, rond ou rectangle - les perspectives changent et les tableaux prennent vie autrement. L’écran s’obscurcit, le film se termine : il est maintenant temps de découvrir le Tote Bag.
Les familles arrivent pour le test. Le dispositif est alors présenté par les jeunes de l’E2C. Julien, de l’école, nous raconte le projet. Le Tote Bag contient un puzzle, les viseurs, mais également des planches de dessin et des indications pour la visite de la galerie du temps. Les familles doivent trouver six œuvres dans la salle et répondre aux questions sur l’œuvre. Le Tote Bag est mis gratuitement à la disposition des familles à leur arrivée. Il est pensé pour la tranche d’âge 3-11 ans et a nécessité 2 mois pour concevoir et réaliser les objets qui le composent. Julien est ravi du résultat : grâce à ce projet, il a appris à utiliser une découpeuse laser et les logiciels numériques. Cette expérience lui a redonné confiance en lui.

Les jeunes de l’E2C présentent le Tote Bag aux étudiantes du MEM. © C.DC
Le but de ce projet, plus que de créer un dispositif famille, est de permettre à des jeunes de s’intégrer dans la vie active, mais aussi culturelle de la région. Ce programme s’inscrit pleinement dans la vision du musée. Le choix de la ville de Lens en 2004 pour délocaliser une partie des œuvres du Louvre s’inscrit dans une politique visant à rendre la culture plus accessible en région. Le bassin minier était donc un choix logique pour y implanter le Louvre-Lens. Le projet conçu avec le Muséolab est un vecteur de cette démocratisation culturelle. Beaucoup des élèves de l’E2C n’étaient jamais allés au Louvre Lens auparavant. Ce projet leur permet de découvrir de nouveaux outils - et autant de possibilités en termes de compétences - mais aussi de s’approprier l’espace muséal.
Il en est de même pour les familles. En effet, bien que les habitants de la région Hauts-de-France constitue le noyau des visiteurs du Louvre-Lens, les locaux ont encore du mal à s’approprier le musée. Le Tote-Bag peut devenir un véritable moteur pour les familles découvrent le musée, un enfant ne venant jamais sans être accompagné d’un adulte.
En avant pour le test !
Les enfants s’impatientent : il est temps d’essayer les Tote Bag ! Ceux-ci sont distribués et les enfants s’élancent vers la galerie du temps. Les étudiantes du master les observent. Après quelques minutes de jeux, elles s’approchent des familles et les questionnent sur la réception du dispositif. Hélène et ses deux garçons observent Une assemblée des mystiques. Le parcours plaît aux enfants, mais certains mots sont parfois compliqués : c’est le cas d’« architecte ». Une autre famille s’approche des œuvres. Timéo, 7 ans, a l’impression de faire une chasse aux trésors. Sa petite sœur de 3 ans, joue avec les viseurs. Son grand-père Gérard estime que le parcours n’est pas adapté à son âge, mais les « loupes », comme il les appelle, sont un formidable moyen de rendre la visite plus attractive. Les deux enfants ont beaucoup aimé le puzzle, coloré et ludique. Gérard apprécie lui aussi le dispositif. Peu attiré par les œuvres d’art, le parcours et les questions lui permettent de s’intéresser à certains aspects des œuvres auxquels il n’aurait pas prêté attention sans le Tote Bag. « Ce serait un bon concept à adapter aux adultes ! » lance-t-il. A bon entendeur…

Les familles testent et s’amusent. © C.DC / J.G
Petit à petit, les familles se dispersent. L’équipe du master se rassemble pour partager ses premières constatations. Le Tote Bag est un bon outil de médiation pour les familles. Le dispositif est varié, et le puzzle est très apprécié. Les fiches du parcours sont pour le moment des feuilles volantes mais, dans une version améliorée, celles-ci seront plastifiées et attachées entre elles. La forme même du sac est quant à elle à redéfinir. Le Tote Bag est tendance, mais pas forcément adapté à la petite taille des enfants. Pourquoi ne pas le remplacer par un sac triangle ou une petite valisette type “lunchbox” ? La place du sac est à redéfinir en fonction de la personne qui le porte : enfant ou accompagnant ?
Midi, la matinée se termine. Un beau travail de collaboration entre plusieurs entités vient de prendre un tournant : une fois le dispositif ajusté, les Tote Bag, au nombre de dix, seront proposés par le personnel d’accueil du musée aux familles visiteuses. Un nouveau cycle de formation commencera avec de nouveaux jeunes participants en janvier prochain
Clémence de Carvalho
*Pour garder l’anonymat des familles, certains noms ont été changés.
Pour aller plus loin :
Les Makers de l’Art, vidéo de présentation du projet conduit par les jeunes de l’E2C. https://www.youtube.com/watch?v=lJZ9lRErN2s
#famille
#louvrelens
#dispositif

Fermez les yeux et observez !
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans un musée et de toucher. Toucher les œuvres, ne pas être frustré, touché, retouché, caressé. C’est ce que les visiteurs sont invités à faire dans L’art et la matière, Prière de toucher, qui propose une autre manière de découvrir les œuvres et de visiter une exposition.
Prière de toucher itinère depuis 2019 et est le fruit d’une collaboration entre six musées des beaux-arts (Nantes, Lyon, Lille, Rouen, Bordeaux) dont le musée Fabre de Montpellier à l’initiative du projet. L’exposition a posé ses valises à Rouen du 26 mars au 18 septembre 2022.
Image d'intro : Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, août 2022, ©Nathalie Delzenne
Une « contemplation tactile »
L’exposition ouvre une autre problématique qui est l’importance des sens au-delà de la vue. Privé de ce sens, nos repères sont perturbés, le visiteur découvre les sculptures les yeux bandés. S’il ne s’agit seulement de reproductions de sculptures des collections des musées, tout est mis en œuvre pour retrouver la sensation exacte de la matière, le poids des reproductions est identique.
L’exposition a été réalisée avec des personnes souffrant de déficiences ou handicaps visuels, qui ont contribué à l’écriture des textes des audio-guides. Fournis à l’entrée de l’exposition, ils nous décrivent les œuvres minutieusement.
Dix sculptures sont présentées de manière circulaire, il n’y a pas d’ordre ou de parcours spécifique. Une première salle donne accès à une première entrée en matière pour « apprendre à voir avec les mains » L’exposition se divise ensuite en quatre modules indépendants « Voir autrement » ; « Toucher avec son corps » ; « L’atelier du sculpteur » ; « Prière de toucher » sur les techniques de sculpture, le geste du sculpteur et les matières utilisées. Des outils à disposition permettent de reproduire le geste du sculpteur, un casque de découvrir les bruits d’un atelier. Enfin le visiteur approche son nez pour sentir la pierre, le bois, le plâtre travaillés.

Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, septembre 2022 © Marion Blaise

Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, septembre 2022 ©Marion Blaise
Une visite inédite
Nathalie, éducatrice auprès de jeunes déficients intellectuels scolarisés en IME, a souhaité leur vivre l’expérience « prière de toucher ». Les six jeunes concernés avaient entre 12 et 15 ans, présentant tous une déficience cognitive (troubles de l’attention, de la compréhension, spatiaux-temporels ou de la concentration). Issus de milieux plutôt défavorisés où les découvertes culturelles ne sont pas habituelles, les jeunes se montrent toujours avides d’apprendre et d’être confrontés à de nouvelles découvertes, ce que leur lieu de vie très rural ne permet pas facilement.
Les attentes éducatives de cette visite sont une approche nouvelle d’œuvres d’art, répondant aux besoins sensoriels des jeunes accompagnés : découverte des textures, concentration sur les consignes de l’audio-guide, mise en lumière dans leur tête de ce que découvraient leurs mains…mais également de pouvoir rendre accessible un environnement, des réalisations, des œuvres.

Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, août 2022, ©Nathalie Delzenne
Dans l’accompagnement de ces jeunes au quotidien, il s’agit toujours de donner du sens : tout doit être éclairé dans sa fonction, son utilité ou sa beauté, que ce soient des mathématiques, de l’histoire ou de la découverte du monde, ou encore des actes de la vie quotidienne. Les éducateurs se doivent d’aider les jeunes à enrichir leur vocabulaire pour une meilleure compréhension du monde en parallèle d’une expression de leurs ressentis.
Cette expérience culturelle et sensorielle a répondu pleinement aux objectifs visés.
Les enfants ont vérifié à plusieurs reprises qu’ils avaient bien le droit d’explorer avec leurs mains. Et après chaque découverte, ils ont échangé avec Nathalie ou avec les médiateurs de l’exposition, sur leurs impressions : ce qu’ils avaient aimé, imaginé, ressenti « agréable, doux, bizarre », se conseillant les uns les autres sur les œuvres intéressantes.
Cette expérience a pu être prolongée par la visite du muées des Beaux-Arts et on en mesure sa réussite lorsque certains ont pu dire « ça doit être doux comme la statue de femme tout à l’heure », ou encore « ça me fait penser à ce que j’ai touché tout à l’heure, ça devait y ressembler, c’est tout rond comme les formes ».

Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, août 2022, ©Nathalie Delzenne
Nathalie a pu en relever tout l’intérêt et en faire part à l’équipe après la visite. Elle a exprimé quelques limites à dépasser pour aller plus loin dans l’idée de s’adapter encore davantage à ce public à besoins particuliers : les audio-guides enfants peu nombreux et n’existant pas pour toutes les œuvres présentées, ce qui est frustrant pour les jeunes. Le texte écouté est un peu long et mériterait plus de dynamisme. De même, si le visiteur explore les œuvres avec un bandeau sur les yeux, seule l’une d’entre elles est cachée derrière un rideau. Ce fut la plus appréciée par les jeunes, ne sachant vraiment pas à quoi s’attendre. Il s’agit de La Rieuse, dit aussi Bacchante aux roses n°2de Jean Baptiste Carpeaux, en résine chargée de poudre de marbre.
En effet pour le visiteur lambda, ayant besoin d’enlever son bandeau pour se déplacer dans la pièce, les œuvres sont visibles et appréhendées avant même d’être touchées, ce qui est dommage. Un bandeau pouvant angoisser certaines personnes, le rideau est une solution pour une expérience sans stress.
Enfin, le choix des œuvres est assez large et donne lieu à de jolis moments. Ainsi, Bradley, 14 ans, a eu un moment de recul en caressant derrière le rideau un buste en marbre d’une femme nue, demandant s’il avait vraiment le droit de la toucher là, mais a pu dire ensuite sans l’avoir vue, qu’elle était vraiment jolie. Les enfants peuvent se rendre compte de la matière de l’œuvre. « C’est froid, c’est de la pierre ! », « C’est du bois ? »…
Il serait intéressant, d’aller en bout de l’exposition en mettant en place une réelle expérience dans le noir complet. Les visites de groupes ou à deux (avec un guide et un visiteur) sont plus appropriées.
« L’art et la matière Prière de toucher » réveille d’autre sens et perturbe totalement nos repères. Au plus près de l’œuvre, cette découverte prend plus de temps, et cela provoque des émotions. La vue prend le dessus, lorsqu’il est utilisé, les autres sens sont en retrait. C’est une nouvelle manière de visiter.

Exposition Prière de toucher, Musée des Beaux-Arts de Rouen, août 2022, ©Nathalie Delzenne
MB
#Tactile #Itinérance #Accessibilité

Fouilles archéologiques au collège : de l'archéologie au bahut!
Après avoir épuisé les livres, séries et films à ma disposition lors du confinement, j’ai regardé l’offre en ligne des musées français. Mon choix s’est rapidement tourné vers l’exposition « Pompéi chez vous » du Grand Palais et en consultant les diverses rubriques proposées j’ai découvert la série de photos « L’archéologie préventive : des experts à l’action » de l’Inrap, l’institut national de recherches archéologiques préventives. Une des photos m’a alors étonné : des fouilles avec des collégiens du collège Victor Hugo de Narbonne dans l’Aude, dans la cour même de leur établissement !

© Myr Muratet, Inrap
Le collège a été construit en 1895 à l’emplacement du Capitole, le temple antique de Narbonne. Lors de la construction du collège, des fouilles avaient été réalisées mais en 2012 une équipe de scientifiques constituée de chercheurs du CNRS et d’universitaires décident de reprendre l’étude du monument. En 2016, sous l’impulsion du conservateur du musée antique de Narbonne, l’Inrap se rapproche du collège pour effectuer des fouilles archéologiques dans la cour du collège. Le principal Jean-Michel Malvis accepte à condition que les collégiens soient associés au projet et c’est donc dans le cadre d’un Parcours d’éducation artistique et culturelle, qu’est né le projet « Des archéologues en résidences ».
Pour la directrice des fouilles, le but n’est pas seulement de leur faire découvrir le métier d’archéologue ni de susciter des vocations mais aussi de sensibiliser les futurs citoyens au patrimoine auquel ils pourront être confrontés plus tard dans leur vie professionnelle en travaillant dans le bâtiment ou dans des administrations par exemple.
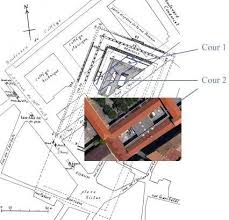
© Collège Victor Hugo, Narbonne
Le projet débuté en 2016 a été proposé à l’intégralité des 6ème et suivi tout au long de l’année par les caméras pour la réalisation d’un reportage intitulé « Des fouilles au collège ». Les apprentis archéologues ont suivi plusieurs heures de sensibilisation aux sciences et techniques de l’archéologie avec des professionnels qui se sont déplacés dans l’établissement pour parler des différents aspects de leur métier. Ils ont aussi bénéficié d’interventions sur la Narbonne antique par le conservateur du musée et des visites de site archéologique pour se préparer à la deuxième phase, sûrement la plus attendue.
Pendant les vacances d'avril, les travaux de dégagement ont commencé dans une des cours du collège et à leur retour, les 160 élèves ont eu la chance de fouiller le site. Certains équipés de pelles, truelles, sceaux travaillent à même le sol, d'autres lavent les objets découverts à l'aide de brosses à dents, le tout encadré par des archéologues et l'équipe pédagogique du collège. Même le proviseur met la main à la pâte. Dans le reportage, on découvre alors la fierté de Wassim qui fait une découverte et qui grâce au programme de sensibilisation en amont, conclut lui-même que c'est un morceau de chapiteau, ce que valide fièrement la directrice des fouilles.
Seuls les archéologues continueront les fouilles après ces deux semaines mais l'expérience pour les collégiens ne s'arrête pas là. Pour valoriser leur travail, une série de photos est exposée sur la façade du collège et ils deviennent ensuite médiateurs lors des Journées nationales de l'archéologie (JNA) au mois de juin lors de l’ouverture du chantier au public. Ils peuvent ainsi mettre à profit leur connaissance et montrer leurs découvertes aux Narbonnais.

© Myr Muratet, Inrap
Dans le reportage, la directrice des fouilles plaisante et suggère à l’équipe : « L’année prochaine, on fouille dans la cour principale ? » et suite au succès de la première édition l'expérience a été reconduite dans les autres cours du collège. Ainsi en 2018 ce sont deux classes de 5eme qui ont fouillé et l'ensemble des 6eme ont pu visiter le chantier et en 2019 deux classes de 4eme. Chaque année la participation au JNA est devenue un rituel et en 2019 ce sont les 750 élèves du lycée ainsi que les autres lycées de la ville de Narbonne qui étaient sensibilisés aux objectifs de la recherche archéologique lors d'une restitution des trois années de fouilles sous la forme d'ateliers animés par les archéologues (présentation du contexte de la ville et du capitole romain, exposition de photos et d'objets trouvés durant la fouille et visite du chantier). Avant l’enfouissement définitif des vestiges en juillet 2019, une capsule temporelle a été ensevelie avec en son sein des écrits, des questions des collégiens pour le futur, un ballon de rugby, des clefs USB et une bouteille de vin du terroir bien-sûr !

© Myr Muratet, Inrap
En définitive, cette expérience est extrêmement intéressante et émouvante à plusieurs niveaux. Les élèves ont eu la chance de découvrir un métier et d'être sensibilisés à l'histoire de leur ville au sein même de leur établissement scolaire. L'Inrap a eu l’opportunité de faire des fouilles sur un lieu qui semblait difficilement accessible, de faire découvrir leurs missions et de faire avancer la recherche sur un site antique majeur de Narbonne et les plus belles pièces trouvées vont rejoindre les collections du musée NarboVia qui devrait ouvrir courant 2020.

© Myr Muratet, Inrap
Pour ce programme innovant au sein duquel l’archéologie s’inscrit comme vecteur d'apprentissage de la citoyenneté, le collège Victor-Hugo de Narbonne a reçu le trophée 2019 de l'Inrap dans la catégorie « Éducation artistique et culturelle ». Pour l'instant aucune nouvelle fouille prévue au collège Victor Hugo mais cette initiative prouve que pour intéresser et toucher les adolescents, il n’y a rien de plus efficace que l'immersion et la pratique !
Cloé Alriquet
#Archeologie
#Fouille
#EducationCulturelle
Pour aller plus loin :
L'action culturelle sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux se sont imposés comme l’un des moyens privilégiés de communication, d’information, de diffusion ou de promotion des musées. Le nombre de followerset de partages a de nombreuses vertus rajeunissantes : il redynamise l’image, popularise, modernise… La présence du musée sur les réseaux sociaux le rend tout de suite plus cool. L’image est sauve (ouf !).
Les institutions culturelles peuvent aussi se servir de ce formidable outil numérique pour se concentrer sur l’une de leurs missions principales : la démocratisation culturelle ! Mais oui, qui mieux que les réseaux sociaux pour remplir cette mission dans ce cas où la seule barrière d’accessibilité serait l’accès à une connexion internet ? Ils sont accessibles par tous, pour tous, presque partout, à n’importe quel moment et quelle qu’en soit la durée.
Éclairons tout de suite un point, il ne s’agit pas de substituer la visite in situ mais plutôt de compléter, de varier l’expérience du musée et de donner envie aux personnes de venir dans l’institution. Sur les réseaux sociaux l’institution culturelle va pouvoir susciter l’intérêt, piquer la curiosité des « socialeurs » sans pour autant les écraser sous le poids de l’exactitude scientifique et historique. Car, pour reprendre Michel Serres, une fois que « petite poucette » est intéressée, elle ira chercher le savoir, la connaissance scientifique par elle-même. Elle ira peut-être même chercher ce savoir au musée, lieu de connaissance et de science mais aussi lieu de délectation et d’enrichissement. Et ces deux derniers points peuvent lui paraître beaucoup moins évidents.
Sur les réseaux sociaux, il s’agit de mener des actions culturelles pour et avec les publics. Twitter, Facebook, Snapchat… c’est aussi interférer avec la vie quotidienne des gens, partager un moment, se rencontrer. Le musée peut sembler plus proche, plus accessible quand il n’y a pas la barrière de la billetterie et que les personnes peuvent directement et instantanément s’engager dans les actions culturelles proposées. Car les institutions doivent aussi rencontrer le visiteur, sans filtre, pour ainsi provoquer un enrichissement, une acculturation.
Tout repose sur l’idée du participatif. Il faut laisser les gens s’approprier un contenu, ne pas vouloir le contrôler (ce qui inévitablement briserait le charme). Aller du participatif au collaboratif voilà un bel objectif pour des musées qui sont avant tout un service public (nous avons tendance à l’oublier un peu trop souvent).
Voici un focus sur trois exemples d’actions culturelles menées par des institutions qui présentent plus d’un intérêt :
Les live-tweet
En 2015, à l’occasion de l’exposition Le roi est mort, le château de Versailles a retracé sur Twitter les derniers jours de Louis XIV tels qu’ils se dérouleraient à notre époque. L’action permetde mettre l’accent sur l’anecdote et de révéler la petite histoire, peut-être plus méconnue que la Grande. Maïté Labat, chef des projets multimédias au Château explique sur France 24 : « On s’est demandé comment on aurait raconté cette histoire si Louis XIV était mort aujourd’hui. Et de fait, Twitter s’est rapidement imposé, notamment comme première interaction avec les internautes, car c’est un outil qui favorise et crée le dialogue permanent avec le public. » Car le visiteur s’empare de l’histoire et peut la moduler, se l’approprier par ses commentaires, ses retweets. En voici un exemple publié sur France 24. Il s’agit d’un commentaire de @velkounette à l’annonce du départ de Madame de Maintenon de Versailles, l'une des favorites du Roi Soleil, le 30 août : "Je confirme ! Je l’ai vue dans le RER tout à l’heure !".
Retweet "Le roi est mort" © EPV
Mais cette initiative n’est pas isolée et en 2014 le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux fait office de précurseur avec la création du compte Facebook d’un poilu, Léon Vivien. Durant cinq mois, des publications ont couvert la vie quotidienne du soldat jusqu’à sa mort comme si Facebook existait en 1914. Cette action permet non seulement de valoriser les collections du musée avec la publication de photographies mais permet aussi à près de 65 000 personnes de revivre une partie de l’histoire.
Le « tracking des habitants », dispositif de la Halle aux sucres de Dunkerque
Partager son circuit dans la ville, voilà ce que propose la Halle aux sucres aux Dunkerquois et plus globalement aux habitants des Hauts-de-France. Chaque personne peut ajouter et partager son trajet quotidien sur une carte interactive via une application mobile développée par Orbe. Pour cela rien de plus simple. Il suffit de se géo-localiser, d’enregistrer son circuit quotidien et de le partager sur une carte interactive qui devient alors le réseau de tous ces chemins entre croisés.L’habitant est acteur et pas uniquement consommateur du lieu culturel. Bémol : Comment donner envie aux habitants d’utiliser un outil pour trace ret partager leurs chemins quotidiens ? Le dispositif participatif a du mal à prendre l’ampleur souhaité puisqu’il dépend entièrement des Dunkerquois qui ne l’utilisent tout simplement pas. Cela vient peut-être du nom très peu accrocheur de l’application : « tracking des habitants ». Oui, nous pouvons le dire, ça fait peur. Surtout, cette action pose la question de la limite des dispositifs participatifs quand les habitants ont du mal à s’en emparer. C’est peut-être ce qui résulte de la démarche de faire quelque chose pour les gens mais sans les gens…
"Tracking des habitants" © Orbe
Le Rijkmuseum sur Youtube
C’est la plateforme qu’a utilisé le Rijkmuseum pour annoncer sa réouverture en 2013. La vidéo est une opération de communication certes. Mais c’est aussi une action culturelle hors-les-murs aussi surprenante qu’inattendue. Dans un centre commercial d’Amsterdam, les gens qui faisaient tranquillement leurs courses sont pris à partie et emmenés dans une histoire folle de voleur au XVIème siècle. Il s’agit de mettre des personnes en action autour d’une rumeur, de l’anecdotique et ce grandeur nature. Nous pouvons facilement imaginer que ces personnes vont avoir envie d’aller au musée ensuite. Qu’ils regarderont certaines œuvres plus attentivement car ils auront rencontré les personnages au hasard d’une session shopping, auront vécu une expérience palpitante et que les œuvres feront partie de leur histoire. Onzehelden zijn terug ! (Nos héros sont de retour !)
https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg
D’autres initiatives sont courantes notamment sur Instagram avec des jeux concours ou la proposition aux publics de choisir les œuvres des expositions comme l’a fait le Columbus Museum of Art en 2013. Les institutions culturelles sont aussi présentes sur Snapchat comme le LACMA (Los Angeles) qui utilise ce réseau avec beaucoup d’humour et invite les visiteurs à s’amuser avec les collections.
M.D.
#réseauxsociaux
#participatif
#actionculturelle
Pour en savoir plus sur les live-tweet : http://www.france24.com/fr/20150901-france-chateau-versailles-mort-louis-xiv-twitter-exposition-leroiestmort
Pour en savoir plus sur l’utilisation de Snapchat par le LACMA : http://www.club-innovation-culture.fr/en-rejoignant-snapchat-le-lacma-incite-son-public-a-jouer-avec-sa-collection/
Pour en savoir plus sur la Halle aux sucres: http://lartdemuser.blogspot.fr/2017/09/la-halle-aux-sucres-histoire-dun.html

L'ADN du street art
Des ducs de Lorraine à la culture urbaine
Quand on pense street art, et plus généralement cultures urbaines, on pense plus volontiers à New York ou Philadelphie qu’aux villes de province françaises. Et pourtant, depuis quelques années maintenant, des œuvres colorées fleurissent sur les murs des villes de toutes envergures, et des sculptures et des installations contemporaines viennent habiller l’espace public plus ou moins régulièrement. Si l’art de rue est clairement inscrit dans l’ADN de certaines villes, d’autres n’ont choisi d’explorer ce terrain que récemment : Toulouse par exemple a vu cette forme d’expression artistique se développer sur ses murs dès les années 1980, et si les premiers graffeurs ont d’abord joué au chat et à la souris avec la municipalité, la ville rose revendique aujourd’hui d’avoir été l’un des berceaux du street art français. D’autres villes ne disposent pas de cette culture de l’art dans l’espace public : ainsi, si la Cité des Ducs a accueilli quelques œuvres depuis 1988, elle n’a pour autant pas développé une grande culture de l’installation dans l’espace public1.
Les dernières élections municipales ont marqué un tournant pour le street art nancéien (notons qu’il est question ici du street art « institutionnel », et non pas de l’art de rue dans sa globalité) : le projet « Aimons Nancy - Cap sur 2020 », porté par Laurent Hénart, affirme le développement de l’art urbain comme l’une de ses priorités. La ville arbore ainsi fièrement un nombre croissant d’œuvres de street art depuis l’été 2015 : des artistes de renommée locale, nationale et internationale ont ainsi été sollicités pour habiller l’espace urbain. L’idée étant d’encourager une production artistique riche et variée, complémentaire aux propositions des musées et des galeries de la ville, qui puisse être accessible à un public plus large. En pratique, cette entreprise se traduit par la mise en place de nombreuses commandes artistiques publiques, émanant d’acteurs en lien avec la ville : certaines œuvres sont commandées par la Ville de Nancy, d’autres par la Métropole du Grand Nancy. Une installation peut également être un dépôt du FRAC Lorraine à l’initiative de la Ville, ou être le fruit d’une coproduction entre la ville et une galerie d’art. La gigantesque fresque « Giulia » réalisée en 2015 par l’artiste David Walker illustre bien le second cas de figure : c’est suite à l’invitation de la Galerie Mathgoth, spécialisée en art urbain et installée dans le XIIIème arrondissement de Paris, que le célèbre portraitiste mural s’est déplacé à Nancy. La Ville étant propriétaire du mur sur lequel a été réalisée la fresque, l’œuvre résulte d’une coproduction entre elle et la galerie.

David Walker, Giulia © Ville de Nancy
ADN : L'art à portée de rue
L’opération « ADN » (pour « Art Dans Nancy ») a pour objectif principal la création d’un musée à ciel ouvert via un parcours de street art, qui vienne compléter l’offre artistique proposée par les musées de la ville, l’idée étant d’offrir à la vue des œuvres variées qui viennent aussi bien rythmer le quotidien des Nancéiens, qu’attiser la curiosité des touristes ou des visiteurs de passage. Voici un aperçu (non-exhaustif) des types d’œuvres que les passants peuvent rencontrer en arpentant la ville.
Ces œuvres dans la ville sont de natures variées, et ne sont pas placées au hasard dans l’espace public. Une œuvre peut être le fruit de la demande d’un mécène, ou accompagner les transformations de la ville : ainsi, lorsque la rue des Ponts est devenue semi-piétonne en 2015, les artistes suisses Sabina Lang et Daniel Baumann ont réalisé « Street painting #8 », une œuvre colorée à même le sol, dans l’idée d’interroger l’architecture des lieux et de marquer la fermeture de la rue aux automobiles. Cette œuvre à l’esthétique pop permet également de créer un autre rapport à la création contemporaine, puisque les passants peuvent marcher directement sur l’œuvre et ainsi mieux se l’approprier.

Lang/Baumann, Street Painting #8 © Ville de Nancy
Ces changements dans l’espace urbain peuvent faire l’objet de plusieurs installations successives, d’ampleur grandissante : la rénovation de la place Thiers, située devant la gare, s’est accompagnée de la mise en place de modules d’exposition sur lesquels les passants peuvent observer les projets photographiques d’artistes locaux, comme le collectif Salle de Shoot ou l’artiste Arno Paul. Le changement de nom de la place, qui passera de « place Thiers » à « place Simone Veil », fait actuellement l’objet d’un appel à projet publié par la Ville, dans le but d’installer sur la place une œuvre faisant écho à l’action de Simone Veil pour les droits de l’Homme, et pour les droits des femmes.

Modules d'exposition, place Thiers © lasemaine.fr
Une œuvre peut également faire écho au patrimoine local : il en va ainsi pour le portrait monumental « Stan » réalisé par Jef Aérosol à quelques pas de la place Stanislas, créant ainsi un effet de perspective et de dialogue avec celle qui fut désignée comme étant l’une des plus belles places d’Europe. Notons que cette œuvre est, comme « Giulia », le fruit d’une commande artistique de la Ville de Nancy en collaboration avec la Galerie Mathgoth.

Jef Aérosol, Stan © Galerie Mathgoth
Enfin, les œuvres dans l’espace urbain peuvent entrer en résonance avec l’activité des musées de la ville : à l’occasion de la fermeture pour rénovation du Palais des ducs de Lorraine (le musée lorrain), la Ville de Nancy a passé commande à Julien de Casabianca. Dans un premier temps, l’artiste a été invité à découvrir les collections du musée lorrain ; il a ensuite choisi certaines œuvres, dont il a reproduit, agrandi puis collé les personnages en format géant sur les murs des bâtiments de la ville. Ce ne sont donc pas moins de vingt personnages des collections du musée lorrain qui ont été « libérés » dans la ville ; l’idée de faire de la ville un musée à ciel ouvert prend alors tout son sens.
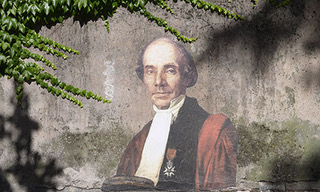
Julien de Casabianca, Outings © Nancy Tourisme Info
Quelles médiations autour de ces oeuvres?
Cette opération s’axe sur trois points principaux :
- Le développement d’un parc d’installations urbaines pérennes, grâce à l’acquisition d’œuvres par la Ville (ou la Métropole),
- La programmation évènementielle sur l’espace public, en lien avec le parcours street art mis en place dans le cadre de l’opération,
- La médiation et la communication autour des œuvres, le travail en direction des publics et la valorisation et l’entretien de l’existant.
La question de la médiation autour des œuvres placées dans l’espace public est toujours délicate. C’est pourquoi le département des publics de la Direction Nancy-Musées propose une initiation à l’art urbain via la conception d’un parcours street art, à réaliser en visite libre ou en visite guidée, permettant de découvrir les œuvres installées dans les principaux quartiers du centre-ville. Le service des publics met également à disposition un dossier pédagogique, facilement consultable sur internet, détaillant la carrière des artistes, l’historique et la signification des œuvres et les techniques employées pour les réaliser. Des distributeurs de dépliants « ADN » sont placés à des endroits stratégiques de la ville (des lieux de passage), afin que chacun puisse avoir aisément accès aux informations nécessaires pour comprendre et apprécier le projet mis en place par la collectivité.
Au final, les projets de cet acabit présentent de nombreux avantages pour les villes, parmi lesquels ceux de rajeunir leur image, et de permettre une approche différente de l’art pour les habitants, et d’insuffler une nouvelle dynamique au tourisme : les parcours que composent les œuvres permettent aux visiteurs de passage dans la cité des ducs d’arpenter les différents quartiers de la ville à la recherche des œuvres, découvrant ainsi les lieux et monuments phares de la ville le temps d’une escale. A Nancy, les graffiti outdoor font écho à des œuvres placées dans les musées : ainsi l’anamorphose de Felice Varini s’invite dans le parcours permanent du Musée des Beaux-Arts, créant un pendant aux personnages de Julien de Casabianca tout droit sortis des réserves pour s’en aller arpenter les ruelles de la ville.

Felice Varini, Anamorphose © Jason Whittaker sur Flickr
Solène Poch
#streetart
#nancy
#insitu
1. Propos de Pierre Mac Mahon, Pôle Culture et attractivité, direction des affaires culturelles, Services « Arts visuels » et « Art dans la ville » (ville de Nancy)
Sur l’opération ADN et les œuvres

L'exposition du futur ?

L’église Saint-Pierre du site Le Corbusier, ©JD
L’idée d’une exposition qui explore le futur
…et c’est réussi !

Le jardin des attachements, ©JD
Mais, faire une expo, c’est écolo ?

Atelier « retissez la ville » où les visiteurs brodent sur des photos de l’ère industrielle les aménagements qui permettraient un futur enviable, ©JD

Les casiers de piscine et le support de cartes postales achetés sur Leboncoin, ©JD
Mais la responsabilité environnementale d’une exposition ne passe pas uniquement par la scénographie. Le catalogue de l’exposition par exemple se constitue uniquement de six feuilles A3, glissées dans une enveloppe kraft qui a été sérigraphiée à la main par l’équipe. Chacune de ces feuilles est née d’une réflexion entre un graphiste qui a réalisé le recto, et un écrivain novice (architecte, habitant, enfant, mais aussi le nouvel acheteur du catalogue) qui occupe le verso grâce à ses mots. Chaque binôme a traité l’un des six thèmes, ce qui permet aux visiteurs d’avoir une vision encore différente que celles qu’il a pu lire ou entendre dans l’exposition.
En savoir plus :

L’animal peut-il être un outil de médiation ?
On sait peu de choses quant à l’impact de manipulations répétées sur le bien-être des reptiles - © S.T.
Il est un personnage que l’on croise régulièrement dans les musées : le médiateur. Son rôle consiste à transmettre un savoir aux visiteurs en établissant un dialogue, ou tout du moins un discours, autour des collections. Dans cet article, nous considèrerons que la médiation consiste en un processus par lequel une personne interne à l’équipe du musée utilise un ou plusieurs éléments des collections pour délivrer des connaissances au public.
Ce processus revêt un aspect tout particulier lorsque le médiateur s’accompagne d’un animal vivant – cas de figure que l’on observe notamment dans les parcs zoologiques.
Rien ne vaut une petite démonstration pour expliquer au public le comportement des crocodiles - © S.T.

L’art de la fauconnerie attire un large public ; une occasion pour le parc de délivrer son discours au plus grand nombre - © S.T.
La principale difficulté du médiateur consiste à capter (puis maintenir) l’attention d’un public plus ou moins passionné par le sujet évoqué. L’exercice est particulièrement délicat au sein des parcs zoologiques qui attirent des profils de visiteurs très variés : familles avec enfants et/ou adolescents, jeunes couples, personnes âgées, groupes scolaires, IME, touristes étrangers, etc. Rares sont les établissements culturels à accueillir un panel social aussi large, avec des attentes et des besoins aussi différents. De plus, une part importante de ce public ne vient pas forcément au zoo dans le but de s’instruire, ce qui peut la rendre hermétique au discours du médiateur si celui-ci ne parvient pas à rendre son intervention attractive. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les zoos emploient souvent des « animateurs » plutôt que des médiateurs : il s’agit en effet de divertir et pas seulement de transmettre. Or, quoi de plus divertissant qu’un animal vivant ? Ce dernier réussit à faire ce dont un outil inerte est souvent incapable en s’adressant à la sensibilité émotionnelle du public. Peu de gens restent insensibles lorsqu’on leur propose d’approcher, voire de toucher un animal sauvage – et les zoos ont très bien compris les trois mécanismes principaux qui entrent ici en jeu :
- L’attendrissement : les animaux de petite taille et d’aspect inoffensif inspirent aux visiteurs une affection quasi immédiate.
- La peur du prédateur : les grands carnivores fascinent les foules à la recherche de sensations fortes.
- L’admiration : certaines espèces (rapaces, éléphants, gorilles…) sont porteuses d’une forte valeur symbolique dans l’imaginaire collectif.
Chaque parc possède ainsi ses stars qui permettent à l’animateur d’attirer le public à qui il souhaite s’adresser. Une fois que cet « hameçonnage » a fonctionné, il devient alors possible d’entrer dans le processus de médiation : l’animateur profite du fait que son auditoire soit captivé par l’animal pour lui transmettre des connaissances en présentant l’espèce et en commentant ses comportements. Ces animations s’accompagnent très souvent d’un nourrissage qui incite l’animal à se montrer (détail important dans le cas d’espèces farouches ou peu actives en journée). La médiation s’articule donc autour d’une dimension émotionnelle liée à l’animal, et d’une dimension intellectuelle liée à l’animateur humain. L’action conjuguée de ces deux canaux renforce le processus et permet de capter un public souvent considéré comme difficile.
Il convient cependant de s’interroger sur les questions éthiques que soulève l’utilisation d’animaux captifs comme outils de médiation. En effet, il arrive que ces derniers soient forcés de participer à une animation source de stress potentiel : public agité et bruyant, mains qui se tendent pour toucher, musique tapageuse diffusée par des enceintes, voix de l’animateur qui lorsqu’il ne parle pas dans un micro doit presque crier pour se faire entendre en cas de forte affluence… Si certains animaux s’habituent facilement à ces stimulations, d’autres peuvent être amenés à en souffrir – sans forcément le montrer. Nous commençons tout juste à prendre conscience du problème ; de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui contre les spectacles de cétacés depuis la diffusion du documentaire Blackfish, sorti en 20131. Mais que savons-nous par exemple de l’impact que peuvent avoir des manipulations répétées sur le bien-être d’un serpent ? Très peu d’études sérieuses se sont penchées sur la question étant donné que les reptiles inspirent moins de sympathie que les dauphins ou les orques. Il en résulte que certains animateurs de parcs zoologiques ne possèdent pas les connaissances nécessaires à l’évaluation du bien-être des espèces dont ils ont la charge. Incapables de détecter d’éventuels signaux d’alerte, ils ignorent comment se comporter face à un animal en détresse. Cette situation est en partie liée à la manière dont ces animateurs sont recrutés : il s’agit parfois de stagiaires ou saisonniers dont les connaissances scientifiques n’ont fait l’objet d’aucune vérification, et dont le discours peut contenir des erreurs. Des défaillances surviennent alors non seulement au niveau du respect des besoins de l’animal, mais aussi dans le contenu du message délivré au public. Ajoutons à ce problème le cas des zoos qui, pour drainer toujours plus de visiteurs, décident d’abandonner presque totalement leur discours scientifique pour le remplacer par des spectacles proches de ce que l’on s’attendrait à voir dans un cirque. Le show Tiger World présenté au zoo d’Amnéville en est un exemple flagrant, et a d’ailleurs amené l’EAZA à exclure ce parc de la liste de ses membres permanents2.

Les spectacles avec dauphins, souvent plus proches du numéro de cirque que de la médiation scientifique, font aujourd’hui polémique - © S.T.
Peut-on encore utiliser des animaux vivants comme outils de médiation/animation à l’heure où se pose la question de leur accorder davantage de droits, et alors que les scandales liés aux cas de maltraitance enflamment l’opinion publique ? Ce problème complexe ne trouvera pas de résolution immédiate, car il interroge une tradition solidement ancrée dans nos sociétés et remet en cause le fonctionnement d’institutions entières. Si les cirques avec animaux sauvages tendent à régresser, les parcs zoologiques, muséums et autres lieux présentant des collections vivantes sont encore largement acceptés et attirent un public nombreux. Peut-être faudrait-il donc formuler le problème de manière plus nuancée, en se demandant comment faire en sorte que l’utilisation des animaux par ce type de structures se fasse en accord avec le bien-être des espèces concernées.
M.T.
1. DAVIER, Margot. "Blackfish, la bête noire des parcs aquatiques". Télérama [en ligne], publié le 18/07/2017.[consulté le 21/02/19]
2. MATAS Jennifer. "Le zoo d'Amnéville rétrogradé au rang de "membre temporaire" de l'EAZA". Zooactu [en ligne], publié le 2/11/15. [consulté le 21/02/19]
#animal
#médiation
#éthique
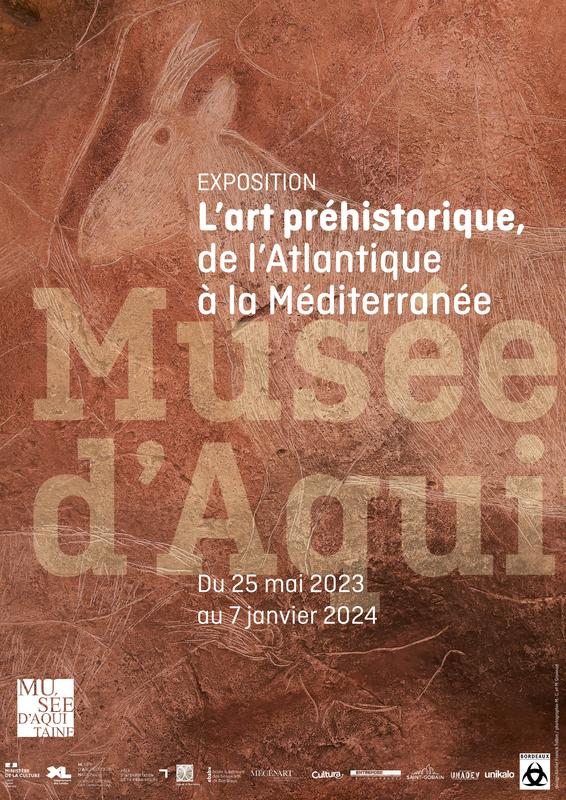
L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée
Une exposition (pré)historique
L’Art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée est une exposition produite par le musée d’Aquitaine, en collaboration avec un comité scientifique international. Cette exposition a pour ambition de tenter de répondre à des questions telles que : « A quoi sert cet art ? Qui l’a fait ? Est-ce seulement de l’art ? » grâce aux nouvelles méthodes d’étude et de restitution, comme les fac-similés ou encore la 3D, mais aussi à partir d’un nombre exceptionnel d’artefacts préhistoriques inédits ou rarement montrés au public. A travers le prisme géographique de la chaîne pyrénéenne, l’exposition présente l’art préhistorique sous toutes les formes connues. Le but n’est pas tant de fasciner le visiteur mais de le faire s’interroger sur le rôle de l’art, sur ces artistes, voire même sur la définition de l’art.
Si les questions autour de l’art préhistorique agitent les esprits depuis qu’on a découvert les premières pièces du genre au XIXe siècle, le musée d’Aquitaine, installé dans l’ancien palais des Facultés et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, apporte aujourd’hui des éléments de réponse. De la parure aux instruments de musique en passant par les grottes ornées, le musée d’Aquitaine propose une thématique qui n’avait pas été traitée depuis près de 30 ans et passe les arts préhistoriques pyrénéens au crible.
Une exposition internationale
Si l’événement est transfrontalier par la trentaine de prêteurs privés et institutionnels français, espagnols et portugais, il l’est aussi dans sa conception avec un comité scientifique venant des mêmes horizons. Grâce à ces collaborations, ce sont près de 600 pièces qui sont réparties sur 800m² au musée d’Aquitaine. Un tiers d’entre elles sont en réalité des moulages ou des reproductions. C’est une caractéristique courante dans les expositions préhistoriques pour plusieurs raisons. D’une part, ces pièces sont aussi exceptionnelles que fragiles au vu de leur ancienneté, elles ne peuvent donc pas toutes voyager. D’autre part, bien que certaines pièces soient conservées en réserves, voire, pour certaines, jamais montrées au public, d’autres sont dans les vitrines des parcours permanents des musées préteurs, et l’on ne peut pas se permettre de vider leurs vitrines ! Enfin, certaines conditions de donations aux musées ne leur permettent pas de sortir les artefacts de leur enceinte. C’est le cas de l’exceptionnelle collection Piette, donnée au Musée national d’archéologie. Elle a été mise en scène par E. Piette, et la scénographie n’a plus le droit d’être modifiée, et ce, sans prescription.
L’art paléolithique est présenté dans l’exposition dans sa réalité géographique : l’écrasante majorité de la production artistique européenne qui nous est parvenue se situe dans l’extrême sud-ouest du continent, soit entre la France et la péninsule Ibérique.
Cette exposition est aussi conçue pour être itinérante. Sa présentation à Bordeaux jusqu’au 7 janvier 2024 n’en est que le premier acte, elle partira ensuite à la rencontre des visiteurs espagnols, à Saint-Sébastien du 1er mars au 2 juin 2024, avant de se partager durant l’été entre le musée archéologique de Santander et le musée national d’Altamira. Puis elle se déplacera au musée de Foz Côa au Portugal à l’automne 2024, avant de revenir en France entre avril et septembre 2025 à l’Abbaye d'Arthous dans les Landes. Elle fera un passage en 2026 aux Eyzies, en Dordogne, avant de finir son périple en 2027 à Bilbao, de nouveau en Espagne.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Des thématiques variées et complémentaires
Le parcours aborde le sujet de manière à ce que le visiteur ait une vision d’ensemble du phénomène. Il se développe en plusieurs thématiques, en commençant par la difficile reconnaissance de l’existence de l’art préhistorique par les scientifiques de la fin du XIXe siècle. Mais c’est aussi l’actualité de la recherche qui est développée : des méthodes d’études du siècle passé jusqu’aux dernières avancées techniques (fac-similé, photogrammétrie, impression 3D).
L’exposition s’interroge sur le cadre climatique et environnemental dans lequel vivaient les artistes et sur la place qu’ils ou elles avaient dans la société. Malgré la barrière géographique que sont les Pyrénées, il existe des points de passage et l’on voit bien des circulations, des échanges, des influences très nettes sur plusieurs centaines de kilomètres du nord de la chaîne, jusqu’au nord du Portugal. Cet espace dépassait d’ailleurs largement les limites actuelles, puisqu’au Paléolithique récent, le niveau de la mer était jusqu’à 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui. A présent, toute la frange littorale est submergée et des sites exceptionnels sont engloutis, comme l’a été par exemple la grotte Cosquer.
Qu’il se développe sur du petit mobilier ou sur de vastes parois dans les grottes, cet art préhistorique fait la part belle aux animaux. Les pièces exposées sont réparties par biotopes, avec les cerfs, biches, ours et carnivores dans le biotope forêt, ou encore les phoques, poissons et grues dans un biotope aquatique. Les représentations humaines, bien que moins connues, sont toutes aussi remarquables. Mais dans l’art paléolithique, ce sont aussi les signes abstraits et codifiés qui sont omniprésents, sans que leur sens nous soit accessible.
De par la grande variété de techniques, de supports, de pigments et d’outils, l’art préhistorique c’est aussi la parure et la musique. Les nouvelles technologies permettent de voir à quel point le geste est maîtrisé. On sait actuellement restituer l’ordre des traits de gravure - de la tête de l’animal, qui est toujours première, jusqu’à l’intérieur du corps -, dire si le graveur était droitier ou gaucher, et si plusieurs mains sont intervenues. L’exposition questionne aussi l’art du jeu grâce à des reconstitutions d’empreintes de main d’enfants dans l’argile à côté desquelles ont été retrouvées des boulettes d’argile projetées contre les parois de la grotte de Fontanet (Ariège).
L’exposition donne l’occasion au visiteur de comprendre le « comment ? » de l’art préhistorique. Cependant, en ce qui concerne le « pourquoi ? », depuis la reconnaissance de l’art pariétal, toutes les interprétations avancées ont donné lieu à autant d’arguments les invalidant, et il existe désormais un certain consensus sur le fait qu’il faut renoncer à interpréter ! Aujourd’hui, on peut simplement dire que cet art était certainement un marqueur social et territorial, et qu’il n'était pas toujours fait pour être vu, comme l’indiquent certaines représentations placées à des endroits qui n’offrent aucun recul, à très grande hauteur ou dans des espaces très difficiles d’accès, réduisant à un nombre assez limité les personnes pouvant les voir.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Chacun y trouve son compte
Chaque espace de l’exposition comporte un module multisensoriel qui permet à tous les visiteurs de découvrir l’exposition, non pas seulement avec la vue, mais aussi grâce au toucher, à l’ouïe ou encore à l’odorat.
Le sens du toucher est particulièrement sollicité, grâce à la reproduction en relief d’un cerf de la grotte de Las Chimineas (Cantabrie) permettant l’accès de l’art pariétal aux non-voyants, mais aussi de reproductions en taille agrandie de mobilier remarquable tels qu’une statuette d’ours en position assise, la dame de Brassempouy, ou encore, deux bouquetins sculptés sur une dent de cachalot. La plupart des matières premières que pouvaient utiliser les groupes paléolithiques peuvent aussi être vues et touchées grâce à un module dédié. De plus, tous les textes de ce parcours sont traduits en braille. Le visiteur peut aussi familiariser son oreille aux sons que peuvent produire la baleine, le cerf, l’ours ou encore le renard, tout comme aux sons des premiers instruments de musique paléolithiques : sifflet de la grotte de Bize, flûte d’Isturitz, rhombe de la Laine, et conque de Marsoulas. Enfin, le visiteur a l’occasion de se plonger dans une grotte, une steppe, ou bien une forêt grâce à son odorat et aux boites à odeurs du module de contextualisation environnementale.
Ce parcours multisensoriel est aussi composé d’une maquette topographique, en bois, de la zone géographique mise à l’honneur par l’exposition. Les visiteurs peuvent toucher les reliefs pyrénéens.
Une imprimante 3D, outil incontournable d’une exposition composée d’artefacts aussi fragiles et rare, est exposée et imprime avec un filament biosourcé fait d’amidon de maïs et de coquilles d'huîtres, pendant toute la durée de l’exposition des pendeloques en ivoire imitant la forme d’une cyprée (coquillage) de la grotte de Pair-non-Pair. Ces impressions sont distribuées sous forme de goodies lors de visites guidées ou d’ateliers.
Afin de préserver au mieux la surstimulation sensorielle de certaines personnes, deux périodes par semaine sont identifiées comme « temps calme ». Le son et la lumière de l’exposition sont abaissés, et les visiteurs ont pour consigne de s’exprimer à voix basse.
Par ailleurs, un parcours famille est accessible tout au long de l’exposition. Il s’adresse au public libre, en premier lieu aux enfants et accompagnants de tout âge, mais aussi à tout visiteur friand d’une visite ludique de l’exposition. Le fil rouge de ce parcours correspond à l’aventure d’un archéologue qui va d’abord découvrir une grotte préhistorique fictive, puis en étudier les artefacts et manifestations symboliques qui s’y trouvent grâce à des quizz, des manipulations de reproductions 3D ou encore des jeux d’association.
Ce parcours a pour but de proposer une visite complémentaire ou alternative aux visiteurs, selon leurs besoins ou envies. Il se veut avant tout ludique, mais aussi pédagogique, afin de faire passer des concepts clés de l’art préhistorique et de son étude. Cela se fait au travers d’une quête au cours de laquelle les visiteurs remplissent de tampons un passeport d’archéologue avec lequel ils pourront repartir. Ces derniers peuvent aussi choisir de profiter du parcours sporadiquement, les contenus et l’amusement n’en sont pas moins au rendez-vous.
Pour ces raisons, et bien d’autres, l’exposition L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée s’adresse à la fois au public familial et individuel, aux érudits, aux amateurs ou aux curieux, aux personnes valides autant qu’aux personnes porteuses de handicap.
Alors n’attendez pas et revenez 40 000 ans en arrière, découvrir toute la complexité et la variété des arts de la préhistoire !

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Coline Favreau
Pour en savoir plus :
- Site de l’exposition – Musée d’Aquitaine : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/exposition-lart-prehistorique-de-latlantique-la-mediterranee
#exposition #préhistoire #médiation #tout public
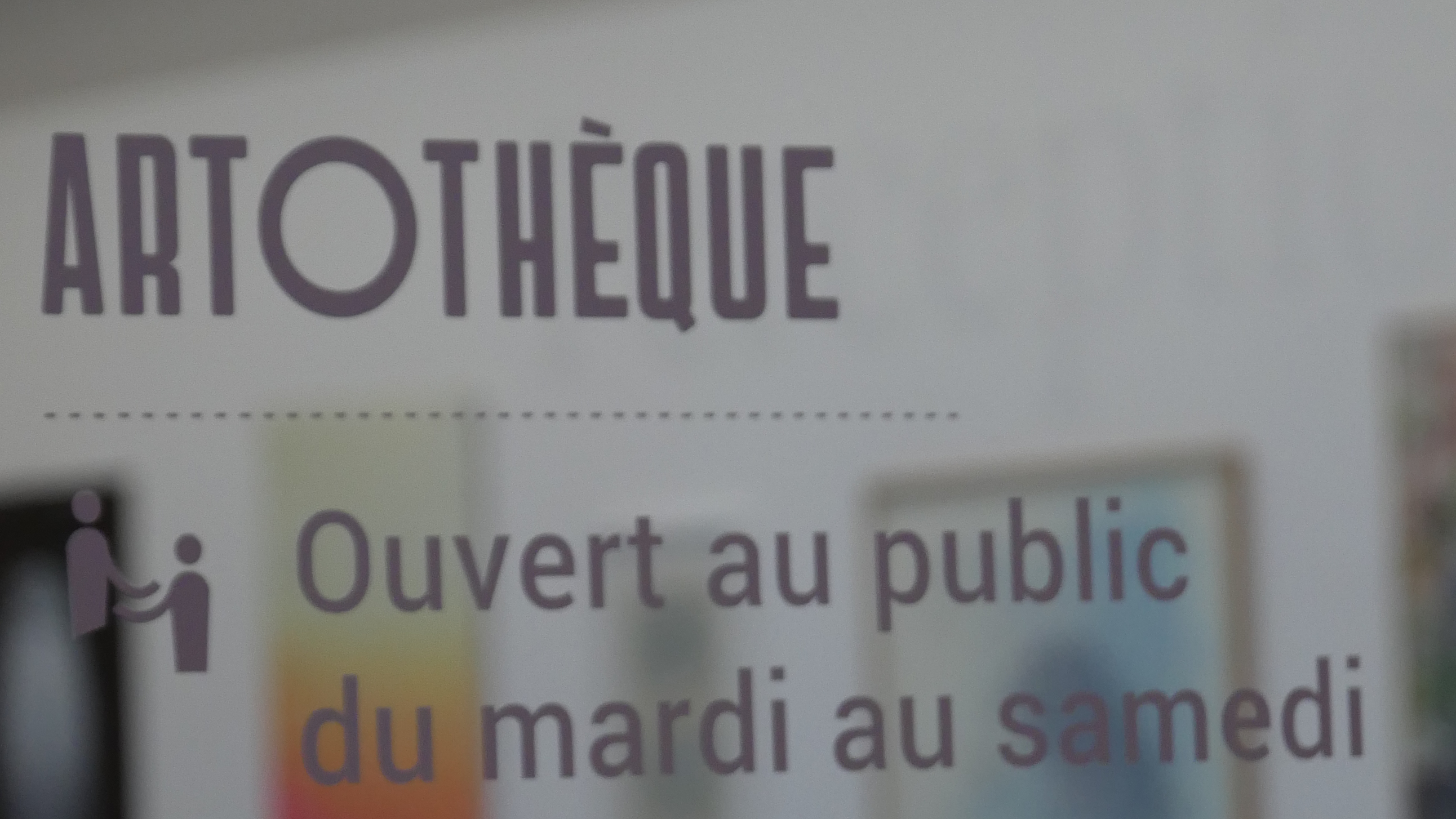
L’Artothèque d’Angers, actrice de la création contemporaine
Qui n’a jamais eu envie de ramener une œuvre chez soi ; voir un tableau dans une exposition, le décrocher et l’installer dans son salon ? C’est possible grâce aux artothèques. Ces lieux de prêt d’œuvre d’art, à destination des particuliers, se développent en France. Elles sont soutenues par les instances nationales et participent à la création contemporaine en valorisant et en soutenant les artistes. Parmi les plus dynamiques, l'Artothèque d’Angers expose actuellement deux sorties de résidence.
Le principe de l’Artothèque
Fondée en 1984, l’Artothèque d’Angers suit la mouvance instaurée par André Malraux de diffuser l’art contemporain en région. Sa collection s’est construite autour d’axes thématiques comme le paysage, tant naturel que mental, l’abstraction géométrique, la vidéo, la photographie ou encore, depuis 2010, le dessin contemporain. Chaque année, l’Artothèque acquiert de nouvelles œuvres ; sa collection est aujourd’hui composée de 1373 œuvres originales. Si la grande majorité est proposée au prêt, certaines sont devenues patrimoniales et sont valorisées dans les expositions d’autres lieux culturels de la ville d’Angers. C’est le cas des photographies de Lee Friedlander, William Klein ou encore Mario Giacomelli, par exemple.
L’Artothèque d’Angers compte plus de 300 abonnés. À destination de tous les publics, l’abonnement se fait à l’année, à partir de 40€, pour le prêt d’une ou deux œuvres changées tous les deux mois. Ainsi, les œuvres circulent dans les foyers et n’importe qui peut avoir le plaisir d’accrocher une estampe ou une photographie chez soi. L’abonnement à l’Artothèque est également adapté aux étudiants, qui sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à ce service municipal. Dans le nombre total d’abonnés, figure une douzaine d'entreprises et une vingtaine d’organismes scolaires. Ces derniers peuvent emprunter plus d’œuvres et les garder plus longtemps. Pour les professionnels, c’est un moyen d’organiser une activité en dehors du travail et de participer à la cohésion d’équipe ; pour les élèves, c’est un moyen de travailler sur des œuvres contemporaines qu’ils peuvent parfois choisir eux-mêmes.

Abonné.e.s en train de sélectionner leur prochain prêt, 2023 © J. Crépin
L’aide à la création contemporaine
L’Artothèque d’Angers dispose aussi de deux espaces d’exposition. Le premier est situé dans les locaux de l’Artothèque et présente principalement de nouvelles acquisitions, mais aussi des expositions temporaires qui s’inscrivent dans des parcours avec d’autres musées d’Angers. Le second espace d’exposition est celui du Repaire Urbain (abrégé RU), lieu culturel dans lequel sont implantés différents services municipaux, dont l’Artothèque. En partenariat avec le service d’Angers Patrimoine, les expositions du RU s’attachent à montrer le travail d’artistes contemporains. La visite du RU et de l’Artothèque est gratuite.
Le 13 octobre 2023, ces espaces ont inauguré deux nouvelles expositions de sortie de résidence. À l’Artothèque, l’artiste Lo Kee présente un travail photographique autour du patrimoine et de la lumière. Il est le quatrième résident de la bourse Mécène & Loire, un partenaire majeur de l’Artothèque, qui finance des photographes pour travailler sur la représentation du territoire. Les 23 œuvres exposées entreront ensuite dans la collection de l'Artothèque et seront disponibles au prêt. Dans la salle du RU est exposée Mathilde Caylou, lauréate de la troisième édition de la bourse Arts visuels de la Ville d’Angers. Artiste verrière, elle a aussi été inspirée par la région angevine et l’a représentée dans son travail.
Outre les résidences de trois à six mois, l’Artothèque travaille en étroite collaboration avec des artistes locaux. Par exemple, un atelier d’estampe aide les médiateurs à concevoir des dispositifs permettant d’expliquer au public les différentes techniques (linogravure, sérigraphie, etc.). Des workshops peuvent avoir lieu avec des étudiants des Beaux-Arts d’Angers et les expositions sont ponctuées de rencontres ou d’ateliers avec les artistes.
Enfin, l’Artothèque d’Angers est active dans le réseau national des artothèques (ADRA). En partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques (CNAP), un appel à candidature est lancé tous les deux ans pour que des artistes contemporains réalisent des estampes. Pour cette quatrième édition sur le thème “Les temps changent…”, une dizaine d’œuvres originales intègreront les collections des artothèques françaises en janvier 2024.
Au travers de ces expositions, résidences, ateliers, ou la commande de l’ADRA et du CNAP, l’Artothèque d’Angers s’attache à produire et valoriser l’art contemporain.

Visiteurs dans l’exposition Perceptions, présentée à l’Artothèque d’Angers du 26 mai au 17 septembre 2023 © J. Crépin
J. Crépin
Pour en savoir plus :
-
L’exposition Ombres et lumières de Lo Kee à l’Artothèque d’Angers du 13 octobre 2023 au 30 mars 2024
-
L’exposition La mécanique des fluides de Mathilde Caylou au Repaire Urbain, du 13 octobre 2023 au 06 janvier 2024
-
Le réseau national des artothèques : Association de Recherche et de Développement sur les Artothèques (ADRA) -
Les temps changent…de l’ADRA et du CNAP
#Arthotèque #ArtContemporain #médiations

L’éloge, le spectacle vivant à l’ère du digital
En pleine mutation numérique, le spectacle vivant trouve une nouvelle voie pour toucher un public plus large grâce à des initiatives innovantes. Parmi celles-ci, L’éloge, un média culturel fondé en 2020 par Constance Arnoult et Anaëlle Malka, démontre que les plateformes digitales comme Instagram peuvent être des outils puissants pour promouvoir les arts de la scène.
Une initiative née durant le confinement
L’idée de créer L’éloge a germé pendant le confinement de 2020, une période propice à l’exploration de nouveaux formats. Constance Arnoult, danseuse passionnée et ancienne élève du Conservatoire de Tours, a commencé par partager des recommandations littéraires sur Instagram. Le format des « Claques littéraires » court, rythmé et frais, fonctionne. Face à l’enthousiasme suscité par ses vidéos, elle s’associe avec son amie Anaëlle Malka pour créer un compte Instagram relayant leurs coups de cœur culturels : littérature, cinéma, danse. Leur objectif ? Dépoussiérer l’image parfois élitiste des arts de la scène et les rendre accessibles à un public jeune.
 Constance Arnoult et Anaëlle Malka devant le Théâtre du Châtelet © India Lange
Constance Arnoult et Anaëlle Malka devant le Théâtre du Châtelet © India Lange
Quatre ans après, l’on peut dire que le succès est au rendez-vous : avec près de 40 000 followers sur Instagram, L’éloge fait office de figure de proue dans son domaine. L’équipe rédaction s’est agrandie avec Dobra Szwinkel et Emma Lavenka pour continuer à produire du contenu toujours plus qualitatif. Le média est relayé et reconnu : Vanity Fair leur accorde un article à l’occasion de la cérémonie Les Éloges. La liste des partenariats s’allonge et l’on fait confiance au média : l’équipe est régulièrement invitée à venir en coulisses de divers spectacles comme en octobre dernier où le média était invité à filmer les behind the scene des répétitions du gala d’ouverture du Palais Garnier. Les maisons Guerlain et Cartier sont fréquemment partenaires d’événements réalisés par L’éloge.
Une diversité de contenus
Aujourd’hui, L’éloge propose une vaste gamme de contenus : des interviews et chroniques sur le théâtre, le ballet et l’opéra, mais aussi des guides sur les expositions et sorties cinématographiques. Le principe des « Claques littéraires » est poursuivi et s’étend à d’autres domaines : les cabarets, les comédies musicales, etc. Le média relaie l’actualité du spectacle vivant en France, à Paris principalement, et plus rarement à l’échelle internationale. Ainsi, des guides concernant l’actualité des sorties des 7 arts sont publiés par saisons avec un bref décryptage du synopsis des spectacles en question et des informations pratiques.
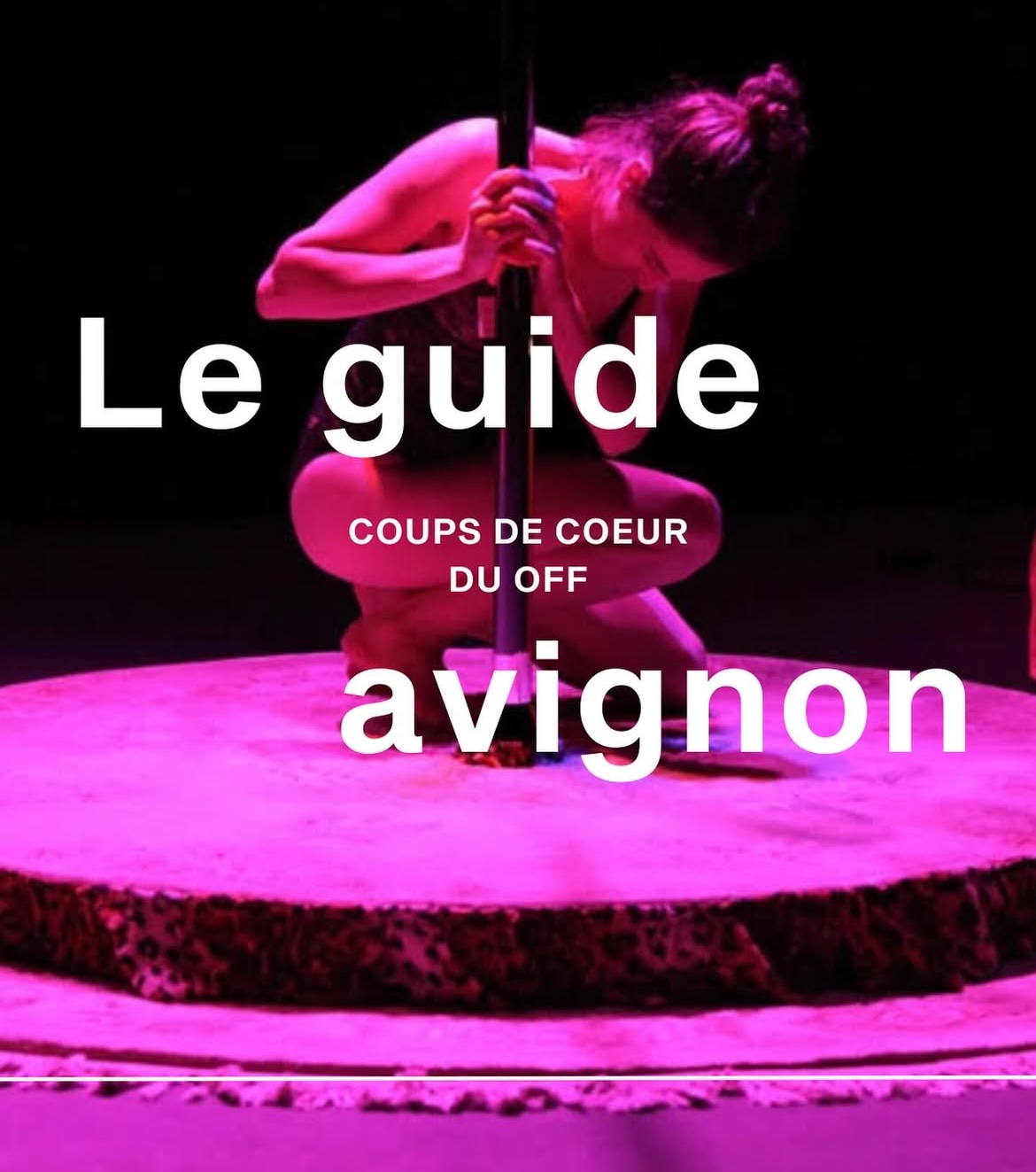 Publication Instagram « Le guide, coups de cœur du off Avignon » © Maria Clauzade
Publication Instagram « Le guide, coups de cœur du off Avignon » © Maria Clauzade
L’éloge met en avant des nominations et attributions de rôle comme celle de Roxanne Stojanov en tant que danseuse étoile de l’Opéra de Paris ou encore Angelina Jolie dans le biopic de Maria Callas en tant qu’interprète de la célèbre cantatrice. Les posts sont des rencontres filmées avec des acteurs du spectacle vivant dans les coulisses de leur travail pour échanger sur leur métier ou évoquer leurs propres recommandations culturelles à l’instar de l’actrice française Anna Girardot qui s’est prêtée au jeu. Ces vidéos sont généralement un format court d’une à trois minutes maximums, correspondant parfaitement à la plateforme Instagram. Les « Starter Pack », des focus sur des personnalités, viennent compléter le tableau des contenus proposés par L’éloge.
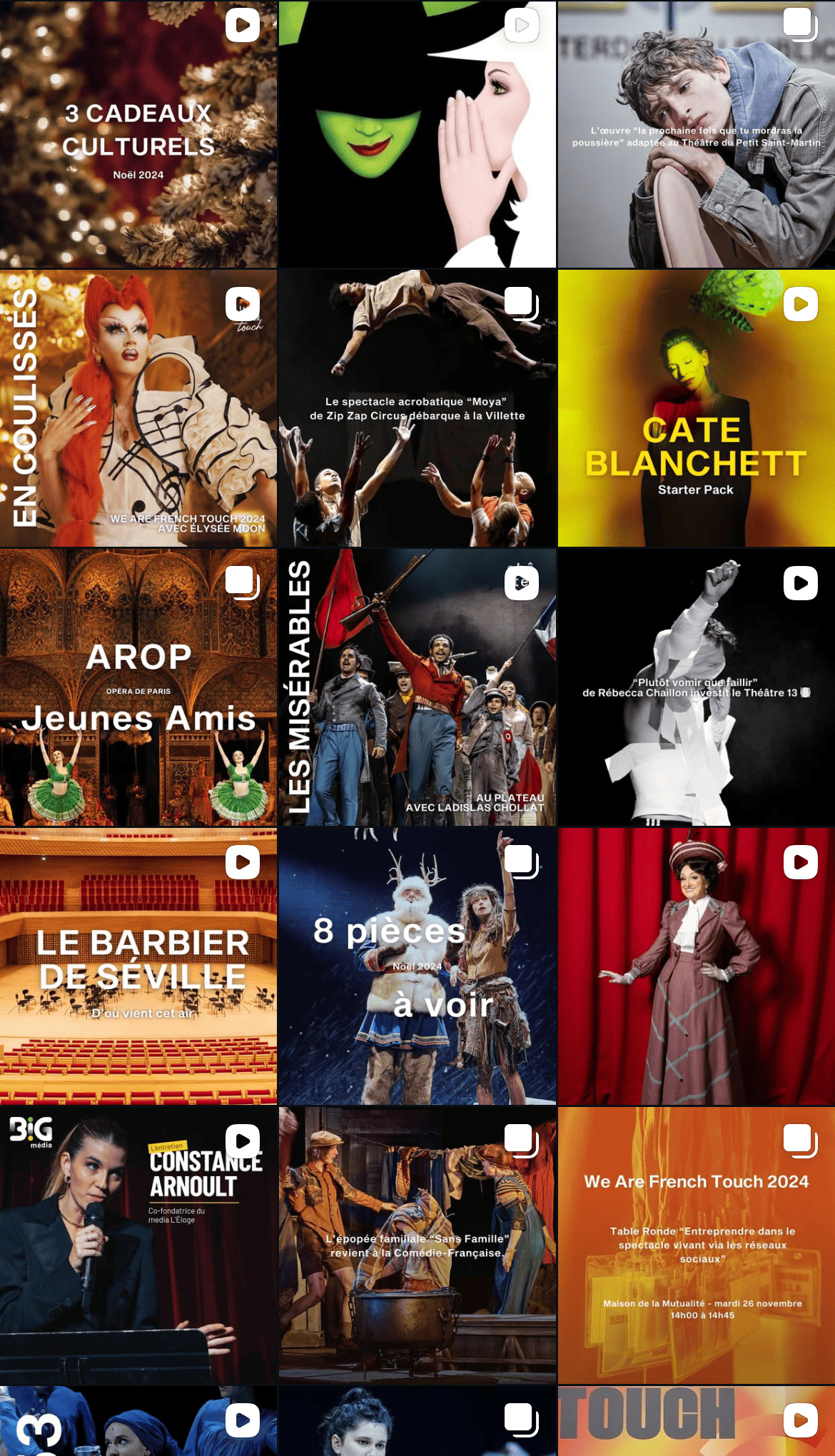 Compte Instagram de L’éloge © L’éloge
Compte Instagram de L’éloge © L’éloge
Les posts sont publiés majoritairement sur Instagram et sur YouTube. Quelques rencontres ont été enregistrées en podcast, disponibles sur toutes les plateformes de streaming audios, bien que ce ne soit pas plus approfondi par le média.
L’approche de L’éloge se distingue par sa vision positive : l’équipe de rédaction présente uniquement des spectacles et œuvres qu’elles apprécient. En s’abstenant de toute critique négative, elles ne s’inventent pas critiques d’art et valorisent foncièrement l’essence créative et humaine des arts de la scène.
La Cérémonie Les Éloges : une ode au spectacle vivant
En complément de leur activité en ligne, L’éloge organise depuis 2023 une cérémonie annuelle pour célébrer les arts scéniques avec comme partenaires le Théâtre du Châtelet, Vanity Fair et la French Touch. À l’image des Molières, cérémonie de récompense du théâtre français et des Trophées de la comédie musicale, Les Éloges propose une cérémonie qui récompense tous les acteurs du spectacle vivant, artistes comme artisans. La première édition, tenue au Théâtre du Châtelet en octobre dernier, présente des catégories mettant à l’honneur des chefs d’ateliers perruques, coiffures et maquillage, des chorégraphes, des chefs d’ateliers costumes et designers ou encore scénographes.
 Constance Arnoult, Elysée Moon, Dobra Dobra Szwinkel et Emma Lavenka à la cérémonie L’Eloge© India Lange
Constance Arnoult, Elysée Moon, Dobra Dobra Szwinkel et Emma Lavenka à la cérémonie L’Eloge© India Lange
La seconde édition, en 2024, a confirmé le succès de cet événement. Avec la drag-queen Elysée Moon comme maîtresse de Cérémonie, le metteur en scène Vincent Huguet en parrain de cette édition, les Éloges a récompensé des figures emblématiques telles que Marina Hands, comédienne et metteuse en scène, qui a reçu l'Éloge d’Honneur. La Claque, prix donné par les fondatrices de L’éloge, a été attribué au spectacle L’Art de la Joie d’après Goliarda Sapienza, pièce mise en scène par Ambre Kahan. Enfin, l'Éloge du Public est revenu à Mais quelle Comédie ! spectacle musical conçu et mis en scène par Serge Bagdassarian et Marina Hands joué à la Comédie Française.
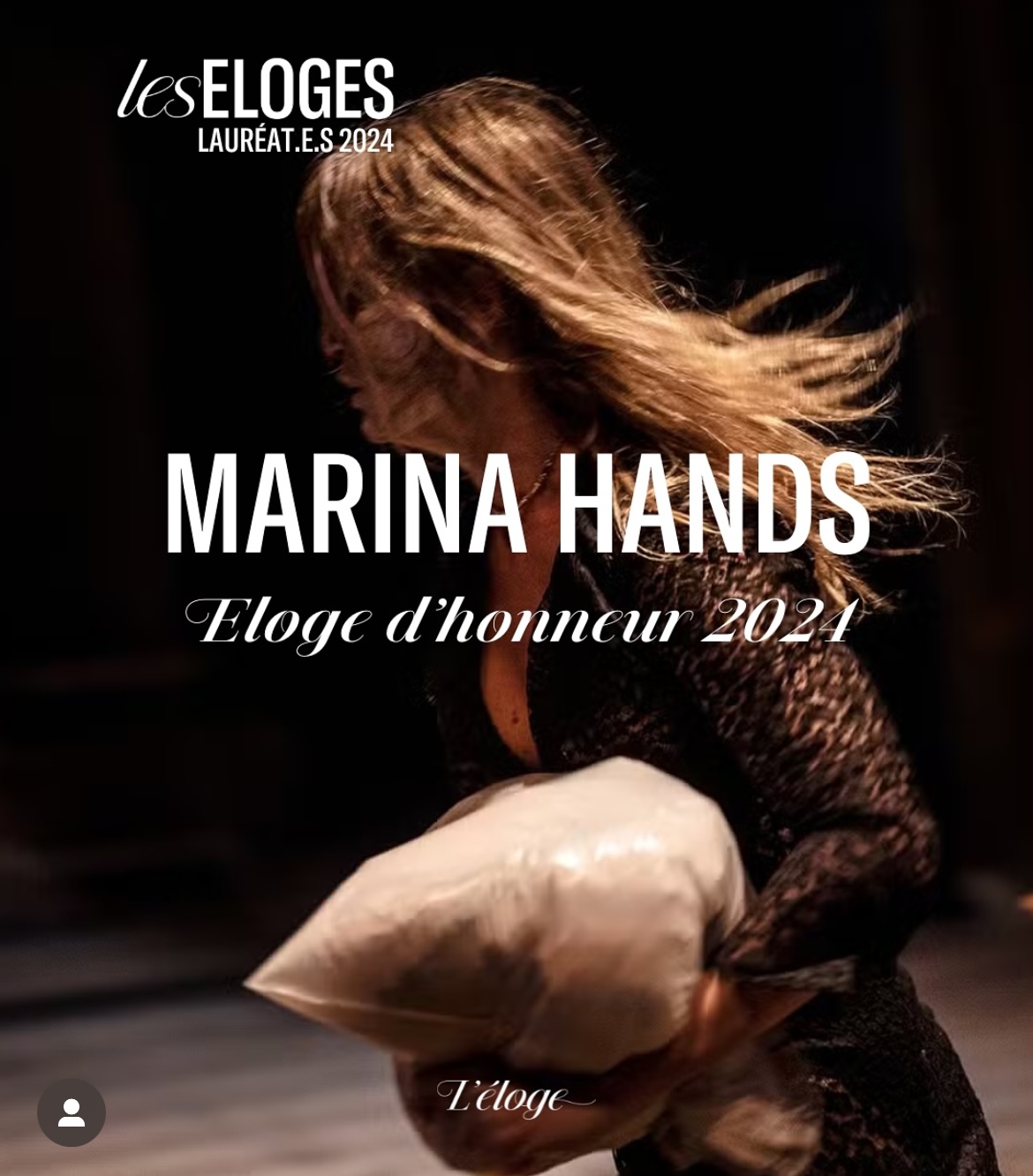 Marina Hands, Eloge d’Honneur 2024 © Jean-Louis Fernandez
Marina Hands, Eloge d’Honneur 2024 © Jean-Louis Fernandez
Cette soirée festive, placée sous le thème des arts forains, a été émaillée de performances artistiques vibrantes : d’un défilé Repetto par la compagnie Gam en passant par une performance de cirque de la compagnie Le Roux. La cérémonie Les Éloges réaffirme le rôle essentiel des arts de la scène dans notre société.
Mais une définition du spectacle vivant qui a ses limites
Malgré les nombreuses qualités de L’éloge, un élément clef semble manquer à leur initiative : la représentativité de la diversité du spectacle vivant. En se concentrant exclusivement sur les formes traditionnelles scéniques telles que le théâtre, l’opéra, le ballet et le cinéma, les expressions artistiques non-conventionnelles et contemporaines sont délaissées comme les arts de la rue, la scène drag ou humoristique. La subjectivité du média atteint là sa limite : en cantonnant le spectacle vivant uniquement aux arts scéniques, L’éloge réduit la visibilité de ce dernier. Bien qu’il y ait une ouverture dans les thématiques abordées avec des contenus portant sur les cabarets ou encore les arts de la marionnette, le choix des contenus mis en avant reste essentiellement traditionnel et à destination d’une certaine catégorie sociale. Ce parti-pris, bien que défendable, peut sembler réducteur voire même trompeur, car il ne reflète pas la richesse et la pluralité du spectacle vivant dans sa globalité, ni la volonté revendiquée par le média de rendre la culture plus accessible. Intégrer ces formes alternatives d’expressions artistiques enrichirait leur démarche de manière plus inclusive et représentative des réalités actuelles des arts de la scène. À quand une Claque Humoristique à propos du spectacle Attends-moi j’arrive ! d’Emma Bojan ou encore une Claque Circassienne sur Le Souffle de Mellia de la compagnie équestre L’Art est Cabré ? Le média aurait tout à gagner – public et enrichissement - à ouvrir leurs thématiques, sans pour autant diminuer la qualité de leur contenu. De plus, on note également que les recommandations culturelles faites par L’éloge sont en grande majorité concentrées autour de Paris. À nouveau, on observe une volonté d’ouvrir le sujet en s’intéressant aux grandes villes de France comme le montre la rencontre avec la danseuse étoile Mathilde Froustey à l’occasion du ballet Casse-Noisette à l’Opéra de Bordeaux ou encore la mise en avant du Festival d’Avignon. Cependant, ces initiatives restent minoritaires en comparaison avec le tropisme parisien de leur contenu. Les partenaires auxquels s’associe L’éloge peuvent aussi être interrogés. Pourquoi ne pas les diversifier en mettant en lumière des structures de la culture plus petites qui auraient besoin de plus de visibilité ? Peut-être une marge d’évolution pour L’éloge dans les années à venir ? Affaire à suivre.
Un avenir fait de projets nombreux
À sa manière, L’éloge incarne une nouvelle façon de mettre en avant les arts du spectacle vivant dans une société où les réseaux sociaux sont les premiers moyens de communication. Le travail de L’éloge rappelle que le spectacle vivant, loin de s’éteindre face aux technologies, peut s’enrichir et toucher un large public.
Constance Arnoult dans un interview donné à la French Touch, évoque des projets futurs allant de collaborations internationales, à la création d’un festival en passant par le rachat d’un théâtre. L’avenir de L’éloge s’annonce à son image : brillant.
Louise Cherel
Pour aller plus loin :
Compte Instagram de L’éloge : @l_eloge_
Compte Instagram Prix du spectacle vivant Les Éloges : @les_eloges
Article Vanity Fair sur la cérémonie Les Éloges : https://www.vanityfair.fr/galerie/les-eloges-une-ceremonie-hors-des-clous-pour-celebrer-le-spectacle-vivant-dans-ce-quil-a-de-plus-vibrant
#spectaclevivant #lEloge #media

L’itinérance : une force de diffusion
Mobilisée depuis le XIXe siècle, l’itinérance s’est aujourd’hui intensifiée comme outil indispensable pour la diffusion d’une exposition sur le territoire régional, national voire international.
Produite par une même institution ou coproduite entre plusieurs acteurs, réalisée en interne ou externalisée, elle nécessite, comme tout outil, une gestion de projet particulière propre à chaque structure.
Image d'introdution : ©Tiffany Corrieri
Le Forum départemental des Sciences (FDS), Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel où je réalise mon apprentissage, privilégie l’itinérance et réalise des outils depuis 1984. À ce jour, une cinquantaine d’outils, dont 30 créations originales parfois déclinées en plusieurs exemplaires afin de pallier les demandes d’un même produit, composent le catalogue. Je vous propose un bref état des lieux des spécificités des expositions et outils itinérants, grâce aux échanges que j’ai eu avec Catherine Ulicska, coordinatrice de projet itinérance au Forum départemental des Sciences.
Pourquoi choisir l’itinérance ?
Développer le musée et diffuser ses savoirs hors les murs pour toucher un public plus large et éloigné géographiquement et culturellement, sont des points essentiels pour la promotion d’une exposition. Ainsi la force de diffusion permet d’identifier plusieurs intérêts :
Avoir une portée plus grande sur le territoire quand la situation géographique de certaines institutions est trop lointaine. Ces dernières ne peuvent pas se déplacer jusqu’au musée faute de moyens, de temps ou de ressources humaines. Par ailleurs, aller vers le public et proposer ses outils dans des structures, c’est aussi faire tomber les barrières du transport.
L’itinérance des expositions affirme donc la mission de diffusion de culture scientifique au sein du territoire, en exprimant son savoir-faire en termes de médiation et d’ingénierie culturelle. De par son historique, le FDS peut se positionner comme une référence en termes de conseils en gestion et réalisation de projet, pour les acteurs qui auraient envie de tenter l’expérience. Ces partages et retours pratiques sont une des missions du poste dédié à l’itinérance.

Le planétarium itinérant est très sollicité. Il permet de diffuser le savoir scientifique et faire découvrir l’astronomie sur l’ensemble du territoire. © Forum départemental des Sciences
Proposer une mise à disposition pour les institutions éducatives de la région s’inscrivant dans l’offre de service public, lors de réalisation de dispositifs. Au Forum départemental des Sciences, les emprunteurs qui participent à Science Collège Nord ou l’Appel à projets peuvent bénéficier de la gratuité des outils. Ainsi écoles maternelles, primaires, collèges ou médiathèques peuvent gratuitement accueillir une exposition et un ou plusieurs outils.
Néanmoins, au FDS, à chaque sortie, prêt ou location, le transport, montage et démontage restent à la charge de l’emprunteur.
Apporter une seconde vie à l’exposition après son implantation et ainsi renforcer ou renouveler la programmation sur une thématique spécifique. Le FDS renouvelle sa programmation par la location d’une exposition tous les ans, portant sur une thématique de saison. Il reste cependant plus compliqué de trouver des expositions à destination des tout-petits (3-6 ans) en location.
En plus de ces aspects sociaux, des critères économiques sont évidemment prépondérants: faire itinérer une exposition peut amortir les coûts de production en intéressant des institutions et un public plus larges, et ainsi dégager quelques recettes. Pour autant, cette intention s’applique davantage aux producteurs privés, que je ne vais pas développer ici, puisque je limite mon propos aux institutions publiques.
Quelle gestion de projet ?
Puisque les expositions itinérantes demandent une gestion de projet mobilisée par une équipe dédiée, des institutions bénéficient aujourd’hui d’un poste ou des missions dédiées à l’itinérance, au vu de la professionnalisation du secteur de production d’exposition.
Anticiper et réfléchir aux critères d’itinérance en amont, lors de la réflexion du projet, sont des points clés pour ce type d’exposition. Le manque de vigilance au préalable peut apporter des modifications bien lourdes et onéreuses à effectuer par la suite.
Intégrer une équipe diversifiée pour penser le projet en termes de co-design, et gérer le cycle de vie du projet permet d’identifier les difficultés pouvant être rencontrées et de souligner les points de vigilance à intégrer. Au Forum départemental des Sciences l’équipe se constitue d’un.e chef.fe de projet, d’un référent technique, d’une coordinatrice itinérance, d’un.e médiateur.trice, et éventuellement d’une référent accueil. Outre l’équipe projet, les prestataires doivent aussi être conscients des critères de réalisation; au FDS la chargée d’itinérance insiste sur la durée de vie prévue à minima de 10 ans des expositions auprès des prestataires, afin qu’ils privilégient des matériaux durables.
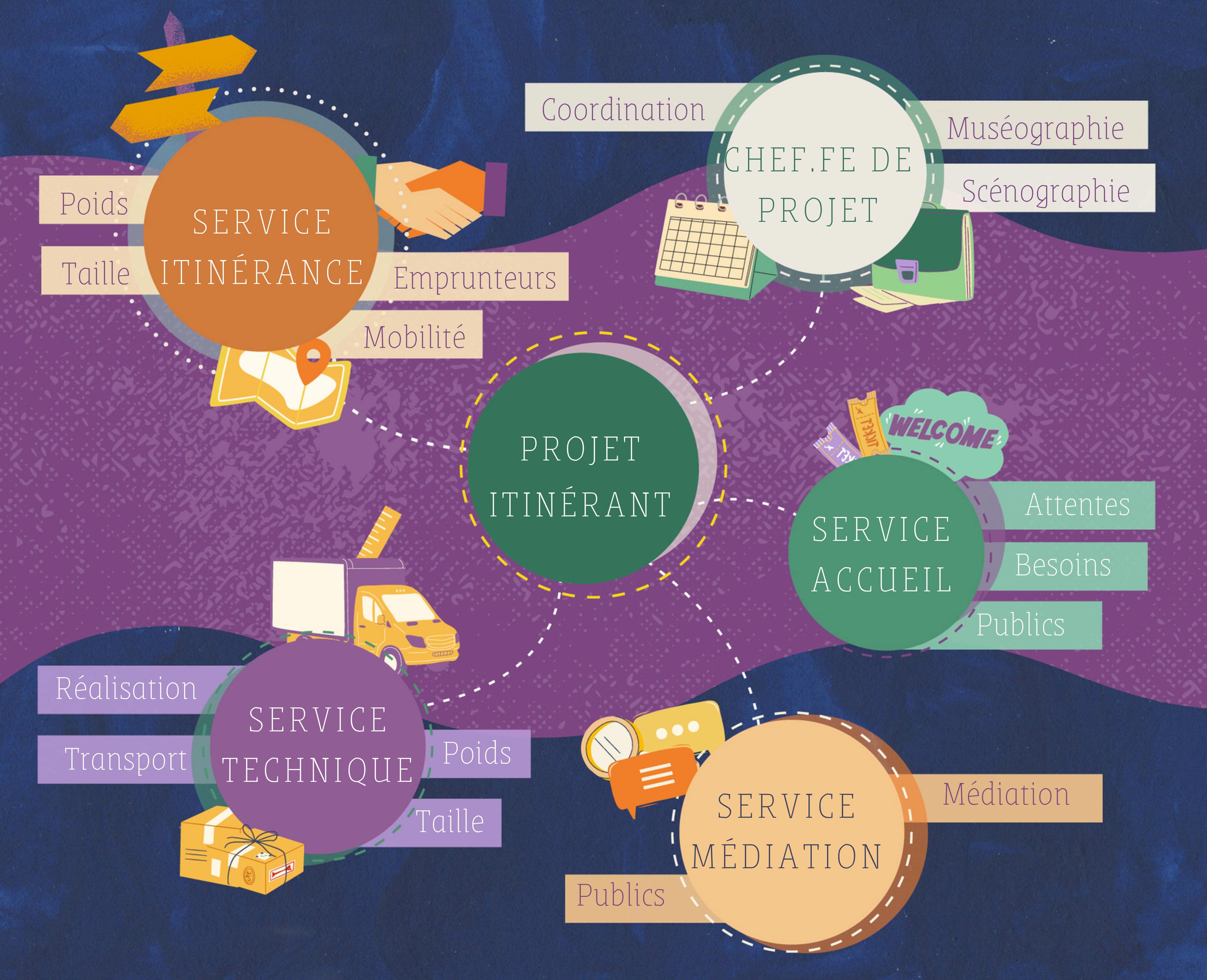
La réalisation d’un projet ou outil itinérant demande une transversalité des différents services de l’institution. ©Tiffany Corrieri
Une exposition itinérante demande donc une mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières importantes.
Enfin dans la durée de vie de l’exposition, les retours emprunteurs, premiers confrontés aux critères de location de l’exposition, sont à prendre en compte car ils permettent de réaliser un bilan sur le fond et la forme de cette dernière, et éventuellement de réaliser des modifications.
Quelle évolution du poste de coordinatrice de projet d’itinérance ?
«Le poste de Chargé.e de l’itinérance au FDS consiste en la promotion, la prospection, l'évaluation des expositions sur le territoire, et la coordination entre services afin que les mises à disposition se déroulent au mieux. Il s’agit également de participer à l’animation des réseaux des emprunteurs et futurs emprunteurs, en place depuis longtemps et agrandie par des mises en relation, pour parfois aboutir à des co-productions dans lesquelles chaque entité se complète.
L’évolution du poste en interne porte sur la gestion de relation client (CRM) via un logiciel dédié, les besoins en termes de communication étroitement liés à la promotion, la consultation pour de nouveaux projets d’exposition ou d’animations à venir. Puis, d’un point de vue externe, il s'agit de mettre en place des dispositifs d’intégration des réseaux emprunteurs, de mettre en relation des acteurs culturels entre eux avec des moyens complémentaires».
Carte d’identité technique d’une exposition ou outil itinérant
Afin de mieux répondre aux besoins d’itinérance, certains points sont à prendre en compte dès la réflexion du projet. Néanmoins ces derniers dépendent de l’objectif de réalisation de l’exposition et des moyens.
Une taille et un poids mesuré : l’exposition ne doit pas être trop encombrante pour pouvoir être accueillie dans un maximum d’institutions, particulièrement pour les petites entités qui détiennent un espace restreint pour accueillir l’exposition (médiathèques, écoles). Comme cela, la logistique (transport, montage/démontage, maintenance) reste accessible financièrement et techniquement. Ainsi, au FDS les expositions pour le Petit Forum, à destination des 2-7 ans, occupent moins de 100m2.

De grands modules avec de hauts montants en aluminium composent l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran. Ici un fond vert de 12 mètres 30 de long. © Forum départemental des Sciences
Certaines institutions proposent une déclinaison de l’exposition en plus petit format à l’instar du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris avec ses grandes expositions déclinées en Petit forme, en exposition panneaux.
La prise en compte du poids et de la taille s’applique aussi à l’emballage dont les dimensions vont influencer sur le stockage des caisses.
Néanmoins, le parti-pris existe d’assumer une taille plus importante des modules, comme avec l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran réalisée par la Cité des Sciences qui va être accueillie par le FDS en octobre 2022, et demande la mobilisation de 3 semi-remorques.

L’exposition L’Homme est-il un grand singe ? est composée de bâches qu’on peut enrouler et de montants en aluminium, facilement démontables qui permettent un transport facile.
© Forum départemental des Sciences
Un mobilier stable : le mobilier de l’exposition doit être résistant, notamment les manipulations, à l’épreuve des enfants. Les normes incendies sont aussi un point à réfléchir en amont. Ce mobilier doit pouvoir être facilement déplaçable et résistant pour ne pas être remplacé tous les ans.
Un montage et démontage facile : l’institution hôte (comme les écoles, ou les petites collectivités) peut ne pas avoir le matériel nécessaire pour le déplacement ou le montage de l’exposition. Par leurs poids et taille, les modules se doivent d’être pratiques et intuitifs à monter. Au FDS, les expositions du Petit Forum (2-7 ans) sont réfléchies en termes de praticité pour un montage et démontage sans encombres pour les emprunteurs; certains modules ne demandent pas d’assemblage et sont livrés sans besoins de montage.

Préparation du montage de l’exposition Mon Dodo © Forum départemental des Sciences
Le service associé à l’exposition : certains musées ou centres de sciences proposent un service clé en mains avec une prestation prête à l’emploi portant sur des animations ou spectacles associés à l’exposition louée, comme à la Cité de l’Espace à Toulouse, ou par le déplacement d’un animateur en camionnette pour animer des ateliers sur place comme avec Le colporteur des Sciences au Pavillon des sciences à Montbéliard.
La plupart du temps la médiation et l’animation d’outils itinérants est réalisée par des médiateurs.trices de l’institution hôte, qui, mené.es par des guides d’animations, se réapproprient le sujet de l’exposition pour l’adapter à la thématique mise en avant par leur établissement.
Profils d’emprunteurs diversifiés
Les emprunteurs d’une exposition itinérante sont divers et les conditions d’emprunt propres à chaque structure proposant le contenu. Il peut exister des forfaits comprenant certains critères qui définissent si le transport, le montage et/ou la médiation sont compris dans le prix de location.
Les emprunteurs peuvent être issus du service public, tel que les écoles, médiathèques et bibliothèques, les musées, les bâtiments administratifs ou touristiques (mairies, office de tourisme), et les associations. Il peut également être question d'une société privée identifiée dans le domaine artistique et scientifique ou non, comme des sièges d'entreprises, des gares, aéroports ou centres commerciaux. Il est aussi possible pour des particuliers de louer des expositions ou outils itinérants.

Vue d’ensemble des outils itinérants empruntés par la ville d’Ostricourt. Les modules sont présentés dans la salle des fêtes de la ville. © Tiffany Corrieri
Certains établissements sont fidèles à la location d’expositions d’une même institution et créent ainsi un réseau au fil des années. Les loueurs sont toujours demandeurs, d’où l'importance de créer de nouvelles expositions à un rythme régulier qui peut être difficile à tenir lors de restrictions budgétaires, et de prendre en compte leurs retours.
Quelle vie après avoir fait le tour de France ?
Afin de savoir quelles expositions ou outils pourraient être améliorés, mis à jour ou jetés, un état des lieux annuel est réalisé avec la direction, en suivant des critères d’évaluation spécifiques. Initialement, le FDS s’appuyait sur le seul fait de faire itinérer l’exposition au maximum 10 ans. Néanmoins les demandes et le renouvellement difficile des offres ne permettent pas de proposer des créations originales, afin de faire tourner la programmation et de remplir le catalogue, en remplaçant les précédentes.
L’obsolescence est le critère le plus favorisé pour trier les expositions et outils du catalogue et définir leur fin de vie ou non. En effet, certaines conceptions pédagogiques du FDS, de par leur ancienneté, présentent une obsolescence technique par l’utilisation de CD, de diapositives ou de clés USB qui ne correspondent plus aux normes et pratiques couramment utilisées.
Ainsi, les outils itinérants sont passés sous le crible de l’évaluation financière, du réinvestissement humain, du renouvellement des droits à l’image et du traitement du sujet qui peut devenir obsolète. Les évaluations post-location permettent de rester à jour sur l’impact de l’exposition en termes de contenu, scénographie, de maintenance etc, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs lors de la prochaine création.
Quand un mobilier est marqué comme obsolète, le matériel est parfois récupéré et réutilisé, ce qui n’est plus exploitable est jeté. D’autres fois l’exposition peut avoir une seconde vie via une vente ou une donation.
Je remercie Catherine Ulicska pour sa disponibilité et son expertise.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
- Méliné Kéloglanian, «Le marché de l’exposition itinérante internationale, ses acteurs et sa filière », La Lettre de l’OCIM 178 | 2018.
- Catalogue des outils itinérants pour la médiation scientifiques et techniques en Hauts-de-France, édition 2020.
- Les expositions itinérantes : guide à l’usage des gestionnaires de tournées, Société des Musées du Quebec.
#itinerance #technique #ingenierie

La Cité des bébés : la curiosité et l'exploration, un jeu d'enfants
Les bébés demeurent encore largement invisibles dans les statistiques de fréquentation des musées et autres institutions culturelles, mais leur intégration commence à croître dans ces espaces. Depuis les années 2010, la recherche sur la petite enfance ainsi que la création d’ateliers et de dispositifs adaptés marquent une évolution notable dans la manière dont le monde de la culture intègre les tout-petits.
Lancé en juillet 2019, le Lab de la Cité des bébés a ouvert ses portes aux tout petits et à leurs familles, explorant les enjeux du développement cognitif et psychomoteur de la petite enfance. Ce projet en construction a été marqué par une série de conférences et de journées d’étude, dont celle animée le 9 décembre 2022 par Sylvie Rayna, docteure en psychologie, reconnue pour ses travaux sur les objets et pratiques culturelles dédiés à la petite enfance. Ces moments d’échange ont offert une plateforme précieuse de réflexion sur la place et le rôle des bébés dans un espace muséal. Le Lab a permis de démontrer qu’il y avait une attente forte pour ce type de lieux. Prévu initialement pour durer neuf mois, ce laboratoire a tiré sa révérence après quatre années d’expérimentations, courant 2022, pour donner naissance à une version permanente et ambitieuse. Ouverte le 17 décembre 2024, la Cité des bébés s’inscrit dans la continuité des espaces permanents de la Cité des Sciences et de l’Industrie, aux côtés de la Cité des enfants et de leurs expositions telles que « Urgence climatique » ou « Robots ». Fidèle aux principes qui avaient façonné son identité dans sa phase expérimentale, cet espace adopte plusieurs partis-pris forts.
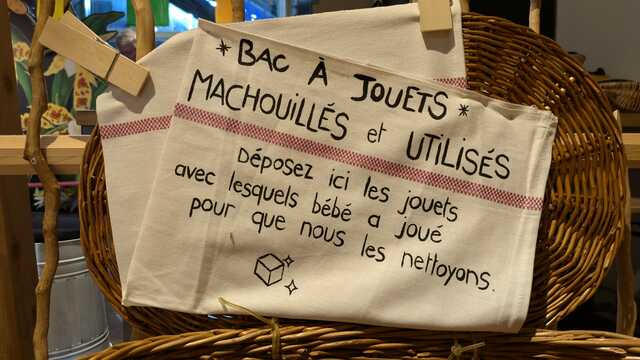
Le bac à jouets mâchouillés et utilisés, situé à l'entrée de la Cité, les jouets sont nettoyés entre chaque session. © É. V.
Tout d’abord, la Cité des bébés est un espace sans écran : les accompagnateurs sont invités à éteindre leur téléphone pour privilégier des interactions avec leur enfant. De plus, le lieu se distingue par l’absence totale de plastique, que ce soit dans les aménagements ou les jouets proposés. Ce choix s’inscrit dans une démarche symbolique et engagée pour un monde futur plus sain et durable. Dans cet esprit écoresponsable, la quasi-totalité des matériaux utilisés pour aménager l’espace provient du réemploi d’anciennes expositions ou de dons d’objets du quotidien. Un bac de collecte est également prévu pour y déposer les jouets usagés et les textiles tachés, qui sont systématiquement nettoyés à la fin de chaque session. Par ailleurs, les jouets en tissu ont été conçus avec deux couches de protection : lorsque la première est souillée, elle peut être retirée pour être lavée, laissant l’objet toujours prêt à l’usage grâce à la seconde couche. Enfin, l’un des objectifs clés de la Cité des bébés est de devenir un lieu de mixité sociale et d’inclusion. Lors des expérimentations du Lab, il a été constaté que l’espace attirait les familles du quartier populaire de la Villette, un public souvent peu présent à la Cité des Sciences. Ce lieu se veut également un espace de rencontre, où les familles peuvent tisser des liens, partager des expériences et être encouragées à revenir.
| Tarifs |
Gratuit pour les 0-23 mois | 4,50 €
|
| Horaires |
Du mardi au dimanche
|
| Age max |
De la naissance à 23 mois
|
| Pratique | Présence d’un chauffe-biberon Trois espaces de lange disponibles |
Sur réservation, les petits peuvent participer à une session matinale (2 heures) ou l’après-midi (3 heures) à la Cité des bébés, située au rez-de-chaussée de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Les horaires des sessions ont été conçus pour répondre à plusieurs contraintes pratiques. Bien que les bébés soient généralement matinaux, l'ouverture du musée à 10 heures fixe le début du premier créneau. Le second créneau, quant à lui, est positionné de manière à laisser un temps suffisant après le repas et la digestion, permettant aux enfants d’arriver repus, soit avant leur sieste, soit juste après, afin de profiter pleinement des installations, pour dormir ou bien jouer. Ces plages horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des retours des familles, une démarche déjà mise en œuvre lors du Lab. Les visiteurs sont libres de rester pour toute la durée de la session ou de partir plus tôt, selon leurs besoins. Enfin, sous réserve de capacité, l’accueil de visiteurs sans réservation pourrait également être envisagé.
Conçu pour accueillir une quarantaine de personnes au maximum, cet espace propose une jauge limitée à une quinzaine de bébés accompagnés d’un ou deux adultes. Dès l’arrivée, un rappel est affiché : il est interdit de photographier les bébés dans l’espace. Les visiteurs déposent ensuite leurs effets personnels dans des casiers et doivent se déchausser ou utiliser des surchaussures pour préserver l’environnement et l’hygiène des lieux. Pour l’enfant, l’espace muséal est avant tout un lieu d’empêchement : ne pas toucher, ne pas courir, ne pas parler trop fort. Au contraire, dès l’entrée dans la Cité, les tout-petits sont invités à explorer librement et à éveiller leurs sens. Plusieurs espaces distincts et immersifs composent ce lieu.
Une yourte mongole colorée, visible dès l’accueil, propose des assises confortables et une sélection de livres adaptés aux enfants.

Espace yourte © É. V.
Derrière la yourte, deux zones aux sols distincts suscitent la curiosité : l’une, équipée de tatamis en bois et de jeux de luminaires ; l’autre, plus intime, dispose d’un sol texturé mêlant paille et terre de marbre légèrement vallonné, menant à une tente touareg plongée dans l’obscurité.

L'espace tatami et la tente touareg © É. V.
Face à la tente, un espace bleuté se distingue par son sol en béton ciré orné de tuyaux, d’une baignoire et de parapluies d’où s’écoulent doucement un filet d’eau, offrant une ambiance apaisante.

Espace baignoires et parapluies © É. V.
Enfin, un espace rempli de coussins et agrémenté d’une large « cloche à cravates » complète l’ensemble.

La cloche à cravate © É. V.
Chaque recoin est soigneusement pensé pour stimuler la curiosité, le confort et l’expérience sensorielle des bébés tout en offrant un moment de détente et d’échange pour les accompagnants. Le prochain défi pour la Cité des bébés est l’aménagement d’un petit jardin extérieur, offrant aux tout-petits un espace sécurisé pour découvrir et explorer le monde extérieur en toute sérénité.
Au fil des sessions, une équipe de médiateurs et médiatrices anime ponctuellement des ateliers spécialement conçus pour les tout-petits. Contes et lectures théâtralisées, spectacles de marionnettes, chansons, ou encore animations autour de la langue des signes rythment ces moments. Sans inscription ni programmation fixe, ces interventions s’adaptent spontanément aux besoins et aux envies des enfants présents. Chaque médiateur évalue en temps réel si l’instant est propice à une animation ou si une autre approche serait plus appropriée, offrant ainsi une expérience sur mesure.
La Cité des bébés incarne une nouvelle étape dans l’intégration des tout-petits au sein des espaces culturels. En conciliant une approche écoresponsable, des principes pédagogiques innovants, qui placent le développement sensoriel, cognitif et social des tout-petits au cœur de son approche, ainsi qu’une flexibilité adaptée aux besoins des enfants comme de leurs accompagnants, elle redéfinit les contours de l’expérience muséale pour la petite enfance. Ce lieu, pensé comme une invitation à explorer, ressentir et partager, témoigne de l’engagement croissant des institutions culturelles envers les plus jeunes visiteurs. Ces principes, bien que spécifiquement ici conçus pour les bébés, résonnent plus largement dans le secteur muséal. Ils ouvrent la voie à une réflexion sur la manière d’aborder le musée pour des publics adultes ou à besoins spécifiques, en favorisant des approches plus sensorielles, inclusives et interactives.
Éléa Vanderstock
Pour en savoir plus : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/cite-des-bebes
Séminaires de muséologie de Toulouse, « Muséologie et petite enfance », édition 2017 : https://www.instantscience.fr/actualite/retour-sur-le-seminaire-de-museologie-2017/
Plus d’informations sur le Lab : https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/expositions-passees/le-lab-de-la-cite-des-bebes/presentation-du-lab
Sur l’importance de l’usage des sens au musée et le concept de slow visit : Antoine-Andersen Véronique, « Faire entrer le corps et l'attention », La Lettre de l'OCIM, 2021, p. 18-23. URL : https://journals.openedition.org/ocim/4234?lang=en
Sur l’intégration progressive des plus jeunes dans les institutions culturelles : Sylvie Sagnes, « Musées pour enfants ou l’enfance d’un certain sens du patrimoine », In Situ. Au regard des sciences sociales, n° 3, 2022. URL : https://doi.org/10.4000/insituarss.1584
#Citédesbébés #Bébésaumusée #MuséesEcoresponsables
La fable d’un éveil à l’art
L’Enfance des Lumières se présente comme la nouvelle fable du musée Cognacq-Jay. Cette« expo pour s’éveiller à l’art »s’est installée sous les combles de la structure du 12 avril au 29 juillet 2018. Paris Musées en est l’initiateur, soucieux de participer à l’éducation du jeune public et d’aller à sa rencontre. Pour ce faire, cet établissement public a entrepris de créer une série d’expositions qui leur sont adressées. Destinées à l’itinérance, elles entendent présenter des thèmes en lien avec les musées et institutions dans lesquels elles s’implantent. Ces parcours, conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, sont confiés au commissariat d’Anne Stephan. Muséographe chargée des projets de médiation, elle s’emploie vivement à coordonner ces initiatives avec l’aide des équipes de Paris Musées et des structures d’accueil elles-mêmes. Fruit d’échanges entre multiples acteurs, L’Enfance des Lumières veut avant tout répondre aux attentes d’un public trop souvent délaissé.
Tapis de jeu de l'oie géant en l'honneur de M. Cognacq et Mme. Jay ©Emeline Larroudé

A l’instar des enfants du XVIIIe siècle, explorons l’exposition à travers les personnages des fables de La Fontaine, auteur du XVIIe, qui ont bercé les enfants du siècle suivant.
Salle d'exposition et modules ©Emeline Larroudé
La Cigale et le Musée
« Nuit et jour à tout venant, Je chantais, ne vous déplaise.»- La Cigale et la Fourmi, Jean de La Fontaine

Recomposition de visages enfantins issus de tableaux ©Emeline Larroudé
Le Lion et les Lumières
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi. »- Le Lion et le Rat, Jean de La Fontaine

Activité proposée dans le dernier tiroir du module éducation ©Emeline Larroudé
Le Renard et les Modules
« Et toi, Renard, a pris ce que l’on te demande. »- Le Loup plaidant contre le Renard par devant le Singe, Jean de La Fontaine
 De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
Vitrine comparative du module jeu ©Emeline Larroudé
Comment mieux impliquer le visiteur, d’autant plus lorsqu’il est avide d’interactivité et d’expériences, qu’en le rendant acteur ? L’Enfance des Lumières, initiatrice d’une série d’expositions lancée par Paris Musées, répond parfaitement aux attentes probablement insoupçonnées d’un public auquel peu s’adressent. Une multiplicité d’accès à l’information s’offre à lui afin qu’il saisisse et s’approprie le contenud’une exposition riche par le ou les biais qui lui conviennent. Tout comme le XVIIIe siècle s’est intéressé à l’enfant et son développement en lui consacrant une place nouvelle, cette initiative se place en digne successeuse de ces considérations en en faisant l’interlocuteur principal. De même, si le jeu s’est avéré être un élément constitutif du développement de l’enfant au siècle des Lumières, il est ici mis en exergue. Cohérence et pertinence se mêlent avec brio pour transmettre un message tout en exploitant le plus de sens possible.
#enfants
#jeunepublic
#jeu
Pour en savoir plus :http://www.museecognacqjay.paris.fr/fr/les-expositions/lenfance-des-lumieres
https://www.facebook.com/museecj/
http://www.parismusees.paris.fr/fr/expositions

La fatigue muséale : pour une visite du musée décomplexée
Visiter un musée est fatigant. Même si l’on adore les musées, il faut admettre que leur visite est souvent source d’inconfort. Loin d’être un concept neuf, la fatigue muséale est étudiée depuis le début du XXème siècle.
La fatigue muséale, un syndrome étudié par les études de publics
En 1916, le conservateur du Boston Museum of Art, Benjamin Ives Gilman, publie un article intitulé Museum Fatigue. Il se base sur une observation des postures parfois... sportives des visiteurs et visiteuses du musée cherchant à regarder certains objets. Ces efforts causés par la scénographie sont immortalisés par des photographies. Ils amènent le public à être moins concentré au fur et à mesure de la visite. Après s’être penché ou agenouillé plusieurs fois, le visiteur ou la visiteuse serait moins volontaire pour lire les cartels ou regarder les expôts. Cette étude pionnière est à placer dans un contexte où la la scénographie n’était pas pensée en termes de confort, mais afin de placer le plus d’objets possible dans une mise en scène héritée des cabinets de curiosités.
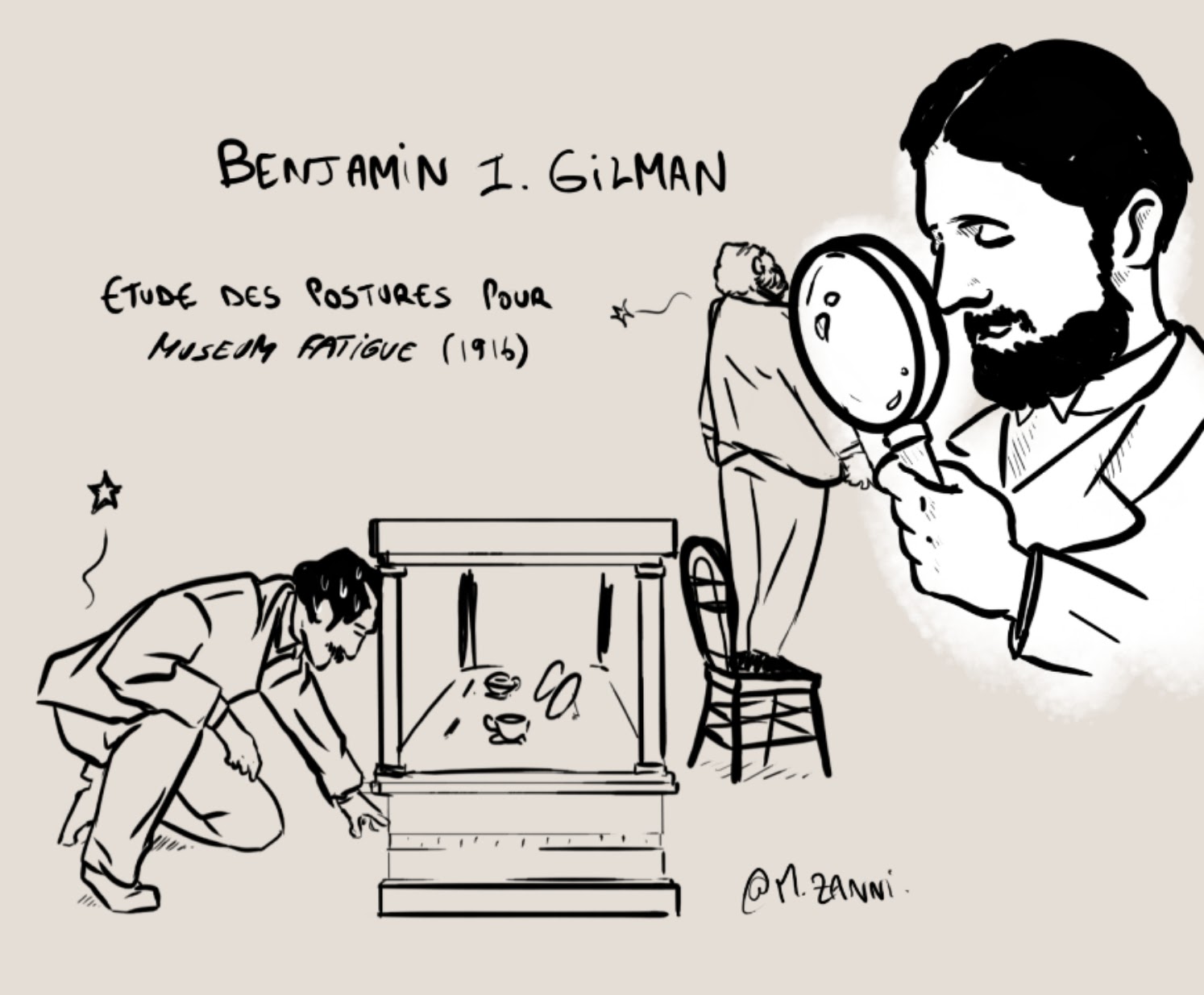
Etude des postures pour Museum Fatigue par Benjamin Ives Gilman, visuel non contractuel, @Marco ZannI
Dans les années 1980 et 1990, John H. Falk, entre autres sociologue des musées, observe un phénomène particulier. D’abord dans des parcs zoologiques puis dans différents musées, ses études collectives montrent des débuts de visite concentrés, avec des déplacements lents qui suivent plus fidèlement le parcours … Puis le public accélère en sélectionnant des points d’intérêts et en sautant certaines parties … Cette tendance est à peu près uniforme, quels que soient les expôts présentés ou la longueur du parcours. La fatigabilité serait donc une donnée intrinsèque à la visite. Cela donne des déambulations très diverses auxquelles ne s’attendent pas toujours les commissaires d’exposition. Mais pour Falk, l’intérêt n’est pas uniformément décroissant, il connaît des pics au cours de la visite.
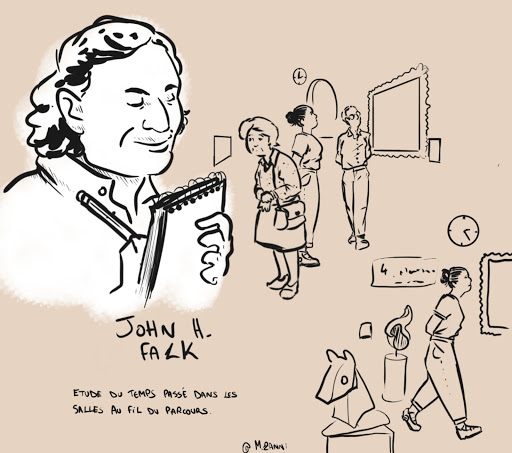
Étude du temps passé dans les salles au fil du parcours par John H. Falk, visuel non contractuel, @Marco Zanni
Entre fatigabilité et tranquillité corporelle
Améliorer le confort de visite, de l’ergonomie à la visite décomplexée
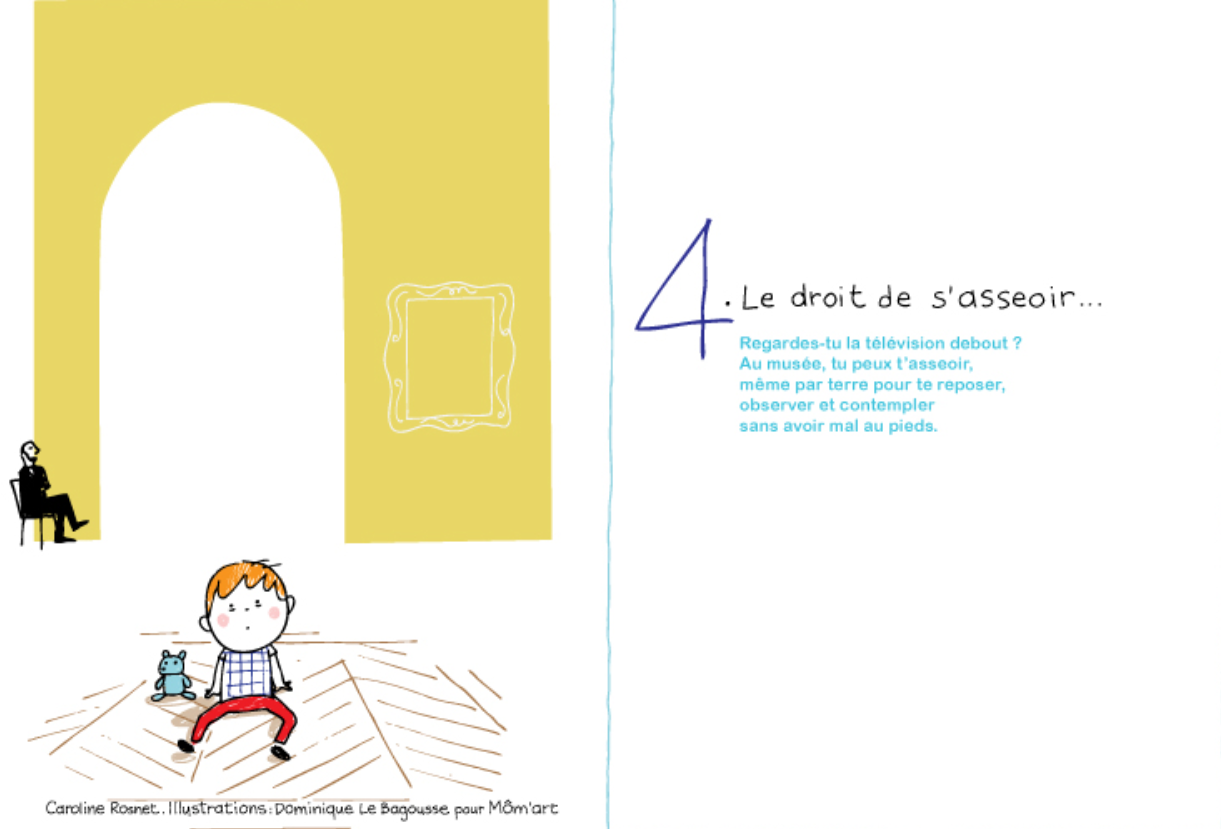
Droit 4 des Dix droits du petit visiteur, Caroline Rosnet et Dominique Le Bagousse pour Môm’Art, @Môm’Art Association
Evidemment, l’assouplissement des mœurs muséales est passée par là, permise par le développement de la médiation et des courants muséologiques attentifs au public. Le monde professionnel y contribue, souvent en ciblant des publics (enfants, familles, scolaires) ou types d’institutions (musées de sciences, écomusées, etc). Parmi de nombreuses actions, on peut citer les Dix droits du petit visiteur de l’association Môm’Art. Sa charte, signée par une partie du réseau muséal, insiste sur la liberté de visite de l’enfant et mentionne la fatigue. Des contenus à destination du grand public abordent également ce point, comme l’ouvrage Comment visiter un musée et aimer ça (2015), qui propose des remèdes aux “jambes de musées”. Joham Idem nous conseille : “arrivez reposés, n’essayez pas d’assimiler tout en même temps, asseyez-vous de temps à autre, buvez régulièrement et n’oubliez pas de vous restaurer”. Et l’auteur de rappeler que si le musée “est un excellent stimulus, [...] il nécessite un temps de récupération”.
Tenir compte des fatigues muséales reviendrait donc à décomplexer le visiteur ou la visiteuse. Accepter et traiter la fatigabilité de façon plus globale est un pas vers la pérennité de l’attractivité des musées et de leurs missions.
Marco Zanni
Pour aller plus loin :
Davey Gareth, 2005. “What is Museum Fatigue”, Visitor Studies Today, Vol. 8, n°3, pp. 17-21 : https://www.academia.edu/1093648/What_is_museum_fatigue.
Lebat Cindy, Maroun Johnny, Moreau Philippe, 2017.La fatigue muséale: le musée peut-il être confortable ? (Rencontres Muséo de l’Association Metis, 28/11/17), voir la chaîne Youtube de l’association Metis : https://www.metis-lab.com/evenements/fatigue-museale-le-musee-peut-il-etre-confortable
Lebat Cindy, 2018. Les personnes en situation de handicap sensoriel dans les musées : réalités d’accueil, expériences de visite et trajectoires identitaires (thèse dirigée par F. Mairesse), Université Paris III, Paris : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02542710.
#Fatigue muséale #Ergonomie #Publics

La Grande Guerre se rapproche de vous
Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose des web-visites qui permettent à un public, notamment étranger, de bénéficier d’une visite au sein des collections permanentes sans avoir à se déplacer.
Il existe actuellement trois variantes de web-visites au sein de ce musée, toutes accessibles via un logiciel de visio-conférence et accompagnées d’un médiateur. Les web-visites sont différentes de par leur médium qui varie de la tablette au robot télécommandé, mais également par l’expérience de visite, à la fois pour le public mais également pour le médiateur.
Pour en savoir plus :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Samantha Graas
31 juillet 2017
#histoire #mediation#robot

La littérature jeunesse s’infiltre au muséum...
Tranquillement blotti dans votre fauteuil préféré, vous ouvrez votre livre et soudain, vous voilà transporté dans les salles d’un muséum pour y mener l’enquête. Fiction ou réalité ? Plongez dans la collection d’ouvrages jeunesse , Enquêtes au muséum !
Sélection de 10 titres de la CollectionEnquêtes au muséum de Laurence Talairach illustrée par Titwane et publiée aux éditions Plume de carotte © Pauline Dancin
Subrepticement, la fiction et notamment la fiction policière a investi l’univers du musée. Escape games, jeux d'enquête, audioguides et podcasts construits autour d’une énigme à résoudre par des visiteurs transformés en enquêteurs-amateurs font aujourd’hui florès dans les programmes de médiation. Mais si cette rencontre du musée et de la fiction policière se noue désormais sur les sites mêmes, elle s’est longtemps tissée sur le terrain de la fiction seule, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. De la série télévisée L’Art du crime (2017), au best-seller de Dan Brown Da Vinci Code (2003) en passant par L’Exposition (2008) de Nathalie Léger, le musée se pose comme le lieu d’une recherche qu’elle soit résolution d’un crime, quête existentielle ou scientifique. La littérature jeunesse ne fait pas exception à cette intrication de l’enquête et de l’univers muséal. La collection Enquêtes au muséum de Laurence Talairach installe ses intrigues dans les muséums de France et d’Europe. Commencée en 2017 et aujourd’hui composée de 26 titres, cette collection dédiée aux jeunes lecteurs de 8 à 12 ans met en scène les aventures de Zoé, accompagnée de sa meilleure amie Alice et de son petit frère Clarence – sans oublier Archibald, le fidèle chinchilla du garçonnet –, dans la recherche de ses parents, deux ornithologues disparus lors d’une mission en Nouvelle Zélande. Chaque nouvelle aventure entraîne le trio dans la découverte et l’exploration d’un nouveau muséum d’histoire naturelle.
Un projet singulier pour une pluralité de muséums
La quête de Zoé commence au Muséum de Toulouse. Laurence Talairach, professeur à l’Université y mène entre 2008 et 2014, en collaboration avec l’équipe du muséum, un projet de recherche, Explora, consacré aux représentations des sciences du vivant dans les arts et la littérature. Zoé et ses amis font leur entrée en scène dans deux titres, En piste, Punch ! et Le Collectionneur de Sirènes, tous deux situés dans l’établissement toulousain. D’abord soumis à Francis Duranthon, directeur du muséum, le projet de collection est ensuite proposé à la CPMF, la Conférence Permanente des Muséums de France, un réseau formé en 2011, rassemblant aujourd’hui 44 muséums franco-européens dont le Luxembourg et la Suisse.
Le projet est à la fois solidaire et participatif afin que tout muséum, quels que soient sa taille et son budget, puisse y trouver sa place. Il repose sur un financement participatif : les muséums qui le souhaitent, contribuent à hauteur de leurs moyens, entre 500 et 5000 € par an. En échange, ils bénéficient d’une remise sur le stock d’ouvrages à vendre dans leur boutique. Quelle que soit leur mise de fonds, chaque membre de la CPMF a la possibilité de lancer une invitation à Laurence Talairach. C’est ainsi que la quête de Zoé se poursuit depuis 2017 dans quinze muséums de France, de Lille à Marseille, en passant par trois musées européens, Oxford, Luxembourg et Neuchâtel.
Si le titre de la collection met en avant un singulier générique, une des raisons d’être du projet est pourtant bien de mettre en avant la diversité des muséums et de leur patrimoine. Chaque titre installe l’intrigue dans un nouveau site. Si certains se déroulent dans des lieux imaginaires, huit sur les vingt-six titres actuels, ils n’en restent pas moins très inspirés de lieux réels.
Chaque titre repose sur un schéma narratif identique. Une énigme se présente d’abord à Zoé que ce soit un étrange message codé glissé sous le paillasson dans Les Animaux du roi, la mort étrange et simultanée de plusieurs animaux du jardin d’acclimatation dans La Malédiction du gecko ou le soupçon d’un trafic animalier dans Le Monstre marin. Pour résoudre le mystère, Zoé entraîne ses amis dans les couloirs et les salles d’un muséum. Chaque exploration est donc prétexte à une description fine et détaillée de l’architecture et de la géographie des sites. Ainsi, dissimulés dans le MOBE dans Alerte en pleine forêt, les trois amis constatent que « sur chaque mur, des panneaux expliquaient comment participer à des projets de recherche scientifique, comment observer et agir pour défendre et protéger l’environnement, donnant l’exemple d’associations qui militaient pour la sauvegarde de certaines espèces et collectaient des informations. Ici, l’observatoire des vers de terre invitait tout un chacun à recenser les vers ; là, les murs exhibaient l’impact des activités humaines sur l’élévation du taux d’extinction de certaines populations. » Le détail de la description permet aux lecteurs informés, visiteurs ou futurs visiteurs des lieux, un effet de reconnaissance et de familiarité.

Le « 4 Tiers », 4ème étage du MOBE visité par Zoé et ses amis dansAlerte en pleine forêt © Pauline Dancin
La précision de l’ancrage s’explique par le travail préparatoire mené en collaboration avec les établissements. L’invitation reçue, Laurence Talairch engage un premier travail de recherche sur l’histoire du musée et de son patrimoine. Cette étape préliminaire est suivie d’une visite des lieux, notamment des collections permanentes et des réserves, au cours de laquelle l’autrice rencontre l’équipe du muséum et échange avec elle. Cette immersion, d’une journée à une semaine, permet de dessiner et valider le parcours du trio à travers les salles et les couloirs, y compris les espaces réservés au personnel du musée et donc inaccessibles aux publics, afin de dévoiler les coulisses tout en préservant la sécurité des lieux.

Pénétrer les réserves… Vue de l’exposition « Bien conservés ! » au Musée d’Histoire Naturelle de Lille – du 21 octobre 2022 au 03 juillet 2023 © Pauline Dancin
Pourtant, malgré le désir d’ancrage, les muséums sont anonymisés et les indications géographiques gommées. L’identité du lieu n’est révélée que dans le paratexte, le court dossier qui suit la fiction permettant de revenir sur des notions, de les expliciter et de les approfondir. Cette mise à distance de la réalité maintient les muséums dans l’imaginaire, évitant tout effet de vitrine promotionnelle. Il résulte pourtant de cette association entre le détail des descriptions et l’ambiguïté géographique, un sentiment paradoxal d’unité et d’unicité : d’un côté, l’affirmation d’une appartenance à une seule et même identité et d’un autre côté, la revendication de leurs particularités. Cette tension est représentative du statut des muséums dont l’appellation générique regroupe des collections très diverses : zoologie, géologie, botanique, paléontologie, préhistoire, archéologie, ethnographie, anthropologie, médecine, astronomie, pharmacie, physique-chimie, etc. Plus qu’un ancrage dans des lieux, chaque titre ancre l’intrigue dans une collection à partir des objets ou thématiques emblématiques et représentatifs du muséum. Le Palais des Glaces souligne la spécificité ethnographique des collections du Musée de l’Homme et met en avant la statuette de la Vénus de Lespurge ainsi que les cires anatomiques que les trois enfants rencontrent au cours de leur enquête.
A l’entre-deux entre le muséum générique et les muséums pluriels, entre le muséum réel et le muséum fictif, la collection des Enquêtes au muséum entraîne ses lecteurs sur les pas de Zoé, à la découverte de ces lieux de patrimoine. Elle les invite à franchir les seuils, pousser les portes, bref, à pénétrer les musées.
Entrée par les portes dérobées de la fiction
Issues de secours, portes dérobées, entrées de service, tous les chemins sont bons pour pénétrer les muséums et explorer leurs coulisses. Quand les portes principales lui résistent, le trio emprunte des voies détournées, des passages privés et réservés et défie les interdits. C’est là tout l’avantage de la fiction, de permettre cette entrée privilégiée et privée, ce pas de côté pour contourner l’obstacle que représente, peut-être, la porte du musée. Car la fiction joue bien ici un rôle de médiation, de passerelle comme nous le raconte le personnage de Clarence. Le benjamin de la bande, est parfois réticent voire effrayé à l’idée de pénétrer le muséum. Pourtant, sa propre interprétation imaginaire de l’énigme et son désir de résoudre le mystère le poussent à affronter ses peurs et à se confronter à l’inconnu. Ainsi, le petit garçon, persuadé d’une invasion de Luniens, extraterrestres venus de la lune, pénètre seul dans le muséum de Montauban, à la suite de Zoé et Alice parties à la recherche de la météorite écrasée.
Si les enfants pénètrent comme des voleurs, des intrus, obligés de se cacher à la vue des gardiens et des adultes en tout genre, ils ne transforment pas moins le muséum en un lieu familier. Leur statut d’« étrangers » ne résiste pas longtemps à leur capacité à s’approprier les lieux. Ils s’orientent avec facilité dans le dédale des salles. Aucun interdit ne vient les freiner dans leur exploration frénétique : de la cave au grenier, des combles aux réserves, des laboratoires aux bureaux, tous les espaces sont pénétrés, fouillés, inspectés. Au fur et à mesure de leur enquête, les trois enfants font du musée leur maison, leur repère. Seuls dans le muséum, ils ont tous les passe-droits. De manière générale, peu d’obstacles se présentent à eux. Les gardiens sont rares voire inexistants – ils demeurent une menace latente mais rarement réelle –, les portes sont rarement fermées à clef, ni caméras ni alarmes ne dénoncent leur présence : le muséum, tel que le découvrent les enfants, n’est pas une forteresse mais plutôt un lieu ouvert à l’exploration, de jour... comme de nuit.
Bien souvent en effet, Zoé, Alice et Clarence infiltrent le muséum à la nuit tombée, en catimini, lorsque les portes se ferment au tout public. Laurence Talairach joue avec notre imaginaire collectif, celui de l’animation nocturne des collections inanimées. La série de quatre films à grand succès La Nuit au musée, sortis entre 2006 et 2020, a en effet contribué à inscrire dans nos représentations, l’image du muséum comme un être biface et fantastique, présentant aux visiteurs diurnes un visage sage et immobile et laissant tomber le masque dès les portes refermées. Le muséum de Laurence Talairach révèle bien un monde « fantastique », mais ce n’est plus le fantastique chimérique et imaginaire de La Nuit au musée. Certes, le merveilleux demeure par l’intermédiaire de Clarence et de son imagination impétueuse, mais ses fantasmes d’invasion extraterrestre, de savant fou et de fantômes sont vites balayés par le rationalisme de Zoé pour qui le muséum est avant tout un lieu de science et de savoirs. Ainsi, pénétrant dans le muséum, les trois enfants découvrent la fantastique réalité de la nature et du vivant. Ni les animaux empaillés, ni les squelettes qu’ils rencontrent ne s’animent, mais le trio leur découvre un passé, une histoire, un discours qui leur donnent vie et qui font d’eux bien plus que des statues. Chaque enquête mène le trio à se frotter à des problématiques muséales tels que les enjeux de conservation ou la constitution des collections. Ainsi dans L’Énigme de la patte de chat, les enfants sont confrontés aux problèmes de conservation des collections naturalistes liés aux insectes et aux parasites. Dans Les Animaux du roi, ce sont les différentes techniques de naturalisation à travers l’histoire qui sont mises en valeur. La dimension coloniale est développée dans Le Monstre marin et La Malédiction du gecko.

Vitrine pédagogique sur la technique de taxidermie au Musée d’Histoire Naturelle de Lille © Pauline Dancin
Les collections ont une histoire et une vie, certes, mais les lieux aussi sont habités. Au cours de leurs enquêtes, les trois enfants découvrent l’activité cachée des muséums en dehors des expositions permanentes. Dans les coulisses, nombre de personnes œuvrent : techniciens et régisseurs montent et démontent les expositions dans Le Palais des glaces, les conservateurs tiennent l’historique et documentent les collections dans Le Fragment d’étoile, scientifiques et laborantins poursuivent leurs expériences dans Le Roi des rats… Le muséum se donne à lire comme un lieu de vie inconnu, dépaysant et déroutant mais délicieusement attirant puisque sa découverte nécessite d’enfreindre un interdit : pénétrer la nuit, sortir des sentiers balisés…
La fiction invite les lecteurs à pénétrer le muséum par ses petites portes, à la suite de Zoé, sans même quitter son lit. Ce premier seuil franchit, comment ne pas avoir envie de pousser les grandes portes ? C’est le pari que lancent plusieurs muséums dont celui de Toulouse. Ce dernier s’est emparé des Enquêtes pour proposer un programme de médiation à destination des scolaires de cycle 3. Le projet se structure en plusieurs sessions au cours desquelles il s’agit d’abord de découvrir l’œuvre littéraire, de se familiariser avec le muséum de papier avant d’aller rencontrer le muséum de pierre. La collection permet d’engager un dialogue autour de notions-clés liées à l’activité muséale et aux sciences du vivant. Mais plus encore, l’écrit devient un lien fort reliant les élèves au muséum, grâce à l’entretien d’une correspondance avec le médiateur. La fiction ouvre la porte à la découverte du muséum, permettant de tisser des liens qui ne sont pas seulement érudits, scientifiques mais aussi oniriques, poétiques, émotionnels, affectifs.
Parents et patrimoines naturels : une histoire de filiation
Un fil rouge relie les différents titres de la collection : la disparition des parents de Zoé lors d’une mission scientifique en Nouvelle Zélande. Leur métier d’ornithologue permet d’articuler au fil rouge de la parentalité celui de la biodiversité et de l’environnement. Si chaque titre apporte une preuve supplémentaire de la vie des parents de Zoé, il le fait au travers d’une nouvelle intrigue mettant en jeu des problématiques environnementales liées aux collections des muséums.
La spécificité de cette collection est aussi de mettre en valeur les missions contemporaines des muséums. Leur rôle de conservation des patrimoines naturels et culturels ne se limite pas à la protection d’une collection mais aussi à celle de la biodiversité. La protection des espèces menacées (Le Monstre marin), les programmes de recherche (Le Roi des rats), le développement des sciences participatives (Alerte en pleine forêt) sont autant de missions aujourd’hui assumées par les muséums que découvrent Zoé et ses amis. Plus largement, la collection joue un rôle de vulgarisation des savoirs liés aux théories de l’évolution et à la formation du vivant. Le Fragment d’étoile aborde au travers des météorites le mystère de l’extinction de masse des dinosaures quand Le Secret de Mélusine introduit la théorie de l’évolution au travers du plésiosaure.
Le choix du genre policier permet de souligner la valeur et la préciosité de ce patrimoine qu’est la biodiversité, à la fois dans sa dimension économique avec les spécimens protégés par la CITES saisis par les douanes dans Le Monstre marin mais aussi dans sa dimension existentielle. Les différents titres soulignent la fragilité de ces espèces éteintes ou menacées d’extinction et leur participation à l’équilibre de la chaîne du vivant. L’importance de ce patrimoine est aussi illustrée par son articulation à la parentalité : retrouver la trace de ses parents et préserver les traces du vivant sont finalement une seule et même quête.
Le muséum devient un espace névralgique où se rassemblent ces différents fils. Il se donne à voir à la fois comme un lieu de savoirs et de mémoire des évolutions passées, mais aussi comme le gardien d’un patrimoine vivant toujours en mouvement. Le muséum nous relie au monde, que ce soit au microcosme familial ou au macrocosme de notre environnement.
Le muséum de Laurence Talairach est un lieu de réponses et de résolutions plurielles, à la différence de nombreux ouvrages jeunesse, romans et escape books, qui font du musée le lieu d’une énigme dont la solution se trouve à l’extérieur, dans la ville et la rue. Ainsi, dans Mission dinosaure : Vol au musée d'Histoire naturelle de Lille (2016) de Nancy Guilbert, les trois amis Ylan, Nell, Théo, accompagnés de leur chien Mozart, partent à la recherche du squelette d’iguanodon, dérobé dans la nuit. Point de départ de l’intrigue, le muséum restera un lieu mystérieux et inexploré : empêchés par les policiers d’entrer dans le muséum, les trois enfants suivent les indices à travers la ville, jusqu’à la découverte du pot aux roses, dans un appartement lillois. Le muséum disparaît petit à petit au profit de l’enquête et de sa résolution. Une fois le mystère levé, rien ne ramène les enfants dans l’enceinte du musée. Le musée pose des questions, mais ne les résout pas. La réponse se trouve au dehors.
D’une façon similaire, Timothée et Liv, les jeunes détectives du Mystère de l'Alcyon (2020) écrit par Philippe Declerck, se heurtent, lors d’une visite scolaire au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, au problème d’une toile : qui est son vrai propriétaire ? Aurait-elle été volée ? Leur enquête les mène à l’extérieur du musée, dans la maison de monsieur Rubinstein, jusqu’aux archives départementales. Une fois de plus, le musée se pose comme un lieu de questionnements et non comme un lieu de réponses. Mais à la différence de Mission dinosaure, la résolution du mystère permet aux enfants de réinvestir le musée avec un regard informé.
Ces deux exemples esquissent les traits d’un paradigme de la représentation du musée dans la littérature jeunesse : le musée fait énigme – et peut-être n’est-ce pas un hasard s’il apparaît majoritairement dans la littérature policière –, il pose question, titille, intrigue, stimule, il fait naître une envie de connaissance. Mais le mouvement qu’il impulse est toujours dirigé vers le monde extérieur.

Le musée fait question mais la réponse est au dehors… Couverture de deux romans jeunesse
En posant le muséum comme un lieu de réponses à des quêtes plurielles, Laurence Talairach façonne dans l’imaginaire des jeunes lecteurs une nouvelle représentation du muséum. Il n’est plus uniquement le lieu du problème et de l’incompréhension, le lieu à quitter pour pouvoir avancer, mais il est un lieu qu’on pénètre, un lieu qu’on explore, un lieu qu’on investit. En devenant lieu de réponses, le muséum devient un espace habitable tant pour la fiction qui peut y dérouler son intrigue que pour les lecteurs d’aujourd’hui et futurs visiteurs. C’est aussi parce qu’il est un lieu de réponses que le muséum cesse d’être indifférent et détaché du monde. En peignant un muséum conscient et à l’écoute des enjeux contemporains, la fiction peut aborder des sujets engagés, tels que la biodiversité, et représentatifs des défis qui se présentent aujourd’hui aux muséums. Alors, plus besoin de preuves, partez à la recherche des Enquêtes au muséum… !
Pauline Dancin
Merci à Laurence Talairach d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Sources
- Charon Patrice, « Les collections des muséums d’Histoire naturelle en chiffres », La Lettre de l’OCIM, 25 juin 2014, no153.
- Cpmf, « Une définition inadaptée », La Lettre de l’OCIM, 1 novembre 2019, no186, p. 18-20.
- Duranthon Francis, « Point de vue : Enquêtes au muséum, un projet d’édition collectif original », La Lettre de l’OCIM, février 2019, no 181, p. 59-61.
- Declerck Philippe, Le Mystère de l’Alcyon : Drôle d’affaire au musée de Dunkerque, Aubane éditions, coll. « Polars du nord junior », 2020.
- Guilbert Nancy, Aventure au musée de l’Institut Pasteur de Lille, Villeneuve d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2018.
- Guilbert Nancy, Mission dinosaure : Vol au musée d’Histoire naturelle de Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2016.
Pour aller plus loin
- AG, « À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ? », L’Art de Muser, décembre 2020.
# Enquêtes au muséum # Laurence Talairach # littérature jeunesse

La Machine à contes du Musée Dauphinois
Sur ce blog Muséomix nous est bien connu. Si plusieurs de nos articles l’ont déjà évoqué, cette fois nous vous parlons d’un dispositif né à la suite de l’édition de 2013. Pour cela, allons au Musée dauphinois ; ce musée de société situé à Grenoble est sensible depuis longtemps au patrimoine oral dont la mise en exposition n'est pas sans difficultés. C’est pourquoi le musée avait souhaité en faire une des thématiques de l’édition Muséomix accueillie dans ses murs. Une équipe, les « blablateurs », a produit un prototype de « machine à contes » pour faire écouter des contes, faire comprendre leurs mécanismes et surtout en récolter.
Aujourd’hui la machine à contes, c'est un dispositif numérique dans une sorte d'alcôve dans lequel les visiteurs entrent et peuvent écouter un conte, en créer grâce à un jeu qui permet de comprendre et d’explorer les ressorts narratifs qui sous-tendent les contes et enfin enregistrer un conte. Le jeu consiste à inventer un conte à plusieurs en suivant des étapes indiquées par le dispositif.
La façade de l’alcôve dans lequel se trouve le dispositif (crédits : C. R.)
Le cartel interpellant les visiteurs et expliquant le dispositif (crédits : C. R.)
Vidéo du Musée dauphinois expliquant le fonctionnement de la machine à contes : https://www.youtube.com/watch?v=x6gETf8Mpkc
Le Musée dauphinois a décidé d’en faire un dispositif pérenne au sein de son exposition longue durée Gens de l’Alpe, consacrée à la vie en montagne. Ce projet a pu être mis en œuvre en remportant l’appel à projet « services culturels numériques innovants » lancé en 2015 par le Ministère de la culture.
Le prototype a été conçu en trois jours (conformément aux conditions d’un Muséomix) mais la conception et réalisation du dispositif pérenne a duré plus de deux ans et a mobilisé de nombreux partenaires. La notion d’équipe et de travail partagé par plusieurs corps de métiers s’est retrouvé tout au long du projet, du prototype Muséomix à la réalisation finale. En effet, de nombreux partenaires ont participé, le musée bien-sûr, le pôle innovation de la direction de la culture et du patrimoine, le service de la lecture publique, le Centre des Arts du Récit (scène conventionnée d’intérêt nationale dédiée aux contes et conteurs) ainsi que France Bleu. A ceux-ci s’ajoute l’agence SètLego de Marseille a fait le développement numérique du projet et sa scénographie, puisque le dispositif prend place dans une alcôve conçue sur mesure.
Cette liste témoigne de l’intérêt suscité par ce projet et par la thématique du patrimoine oral et des contes, qui a rassemblé des institutions qui ne se croisent pas forcément.
Vue du dispositif dans son alcôve (crédits : C. R.)
La Machine à contes s’appuie sur le travail de Charles Joisten, ancien conservateur du Musée dauphinois qui a collecté et retranscrit de très nombreux contes alpins. La conception du dispositif a donc naturellement commencé par un choix de contes, effectué par Alice Joisten et Jean Guibal, directeur du musée au moment de la conception. Ils ont ensuite été interprétés par deux conteuses qui se les sont appropriées tout en restant fidèles aux retranscriptions de Charles Joisten. Enregistrés dans les studios de France Bleu, les contes ont nécessité un important travail technique sur le son.
Le reste du contenu a ensuite été créé à partir des contes : il a fallu d’abord faire le nuage de mots, développer le jeu et enfin les outils d’enregistrement et de gestion des contes enregistrés.
Pourquoi pérenniser ce dispositif ? Quel intérêt pour le musée ?
Celui-ci souhaitait mettre en valeur le patrimoine oral des contes, et le numérique constituait le bon un outil pour construire un module de mise en exposition des contes. Cela permet aussi de les faire entendre dans un contexte proche de leur « environnement naturel », c’est-à-dire par la voix d’un conteur et non par la lecture d’un livre comme c’est souvent le cas.
Mais la machine à contes n’a pas seulement pour but la simple écoute d’aller au-delà en faisant comprendre le fonctionnement des contes et en donnant la possibilité d’enregistrer un conte existant, ou inventé. En effet poursuivre la collecte de ce patrimoine oral est un objectif que le musée s’est fixé en créant cet outil. Les visiteurs ne peuvent enregistrer de contes qu’une fois qu’ils ont écouté, afin de s’assurer qu’ils aient bien compris la démarche. Si l’équipe du musée juge que le conte enregistré a sa place dans la machine à contes, il intègre le corpus des « contes d'ici et d’ailleurs » et les visiteurs pourront l’écouter.
J’ai rencontré Patricia Kyriakides, chargée de la médiation au Musée dauphinois à l’été 2018, nous avons échangé autour de la Machine à contes et de retour sur expérience deux ans après la mise en place du dispositif.
Selon elle, si le jeu consistant à inventer un conte marche bien auprès du public, elle n’est pas complètement satisfaite de l’utilisation actuelle du dispositif car il y a peu d’écoutes et d’enregistrements. Dans la situation actuelle elle a l’impression que le dispositif ne remplit pas ses objectifs, à savoir faire comprendre ce qu’est un conte et surtout en collecter. Je pense cependant, que les visiteurs sont sensibilisés à la thématique et que s’il ne faut pas s’en contenter, on ne peut considérer que c’est un échec.
En conclusion Patricia constate que le dispositif est compliqué s’il n’est pas accompagné. C’est pourquoi elle souhaite améliorer la médiation autour de la machine à contes, en faisant des ateliers, des formations avec les enseignants, en accueillant des scolaires. L’avenir du dispositif passera donc par davantage d’accompagnement et de médiation.
Cet échange nous rappelle que si les dispositifs numériques donnent parfois l’impression qu’ils peuvent fonctionner tout seuls, qu’ils seront automatiquement attractifs pour les visiteurs car numériques, ils ne peuvent bien souvent se passer de médiation.
En revanche ne laissons pas cette conclusion en demi-teinte faire oublier que les dispositifs numériques sont des outils précieux pour mettre en exposition et peuvent permettre de renouveler notre approche d’une thématique, comme ici la culture orale.
Merci encore à Patricia Kyriakides, responsable de la médiation au Musée dauphinois d’avoir accepté de répondre à mes questions et pris le temps d’échanger autour de la machine à contes.
Bethsabée Goudal

La mécanisme d’Anticythère a son médiateur particulier
Un outil spécial pour un objet spécial
Le mécanisme d’Anticythère, ça ne vous dit rien ? Votre esprit se remplit d’un grand point d’interrogation ? Si je vous précise qu’il s’agit d’un mécanisme de calculs scientifiques tout droit venu de l’an 87 avant Jésus-Christ, vous commencez à prendre peur ? Et si je vous propose de vous l’expliquer, en tenant compte des aspects historiques, scientifiques, astronomiques et mécaniques, ça vous tente ? Non, et c’est normal. Il est toujours un peu effrayant de tomber nez à nez avec une machine inconnue au nom compliqué dont l’aspect à tendance à vous faire croire que vous ne pourrez jamais la comprendre. Et pourtant, il existe l’outil de médiation parfait pour nous aider à percer les secrets de la machine d’Anticythère, ou du moins essayer.
L'outil de médiation © M. T.

Le principe de l’outil
Le tableau de bord pour activer les mouvements de la caméra et l’écran qui retranscrit en direct les images. © M. T.
La vitrine est encastrée, l’objet n’est visible que par une seule face, et son support est assez conséquent. En effet il est maintenu dans un bloc rectangulaire qui n’aide pas à le rendre visible. Cela est certainement dû à des problèmes de conservation et de fragilité. Mais pour rendre cet objet plus accessible, en terme de lisibilité, un système de caméra mobile a été installée, elle circule sur deux plans : elle tourne autour de l’objet sur un axe horizontal, mais aussi sur un axe vertical.
Les images de la caméra sont retranscrites en direct sur un écran à côté de la vitrine. Une table de contrôle est à disposition du visiteur en dessous de la vitrine : elle permet de faire pivoter la caméra. Six positions sont préenregistrées, ce sont les plus intéressantes au niveau de l’observation de l’objet. Mais le visiteur peut aussi faire pivoter librement la caméra en utilisant la sphère sur l’écran tactile. Il peut aussi activer un zoom, pour observer les nombreux détails de l’objet, mais celui-ci étant numérique, la qualité n’est pas excellente.
Un petit élément vient tout de même perturber la lecture de l’objet, il s’agit d’engrenages qui viennent se dessiner sur la face visible de la vitrine. L’objet étant déjà petit et le mécanisme de la caméra assez gros, on ne comprend pas pourquoi des roues crantées viennent s’installer dans le champ de vision. Cet élément uniquement décoratif n’apporte rien et trouble la compréhension de l’objet pendant un instant.
Un outil de médiation stratégique
En soi, cet outil ne diffuse pas d’informations, il permet juste de constater les prouesses techniques et l’esthétique de l’objet. Mais surtout, il éveille la curiosité. En effet, une fois que l’on s’est bien amusé avec, on se demande quand même à qui est destiné cet objet et quel est son rôle : il éveille la curiosité. Il permet une autre forme de médiation avec les autres supports de l’espace. On peut donc apprendre avec plaisir que ce minuscule objet est le plus ancien mécanisme à cran que l’on ait trouvé et que c’est un mécanisme de calcul qui se base sur l’année solaire et l’année lunaire égyptienne. Il traduit un phénomène cyclique en prenant le mouvement des astres comme fondement. Le mécanisme d’Anticythère est « la synthèse des connaissances astronomiques et du savoir-faire mécanique de son époque ». Ainsi nous pouvons aussi apprendre ses 16 fonctions. On peut se demander pourquoi l’écran et la vitrine ne sont pas côte à côte, ce qui oblige à ne regarder que l’un ou l’autre, mais cela a aussi un autre intérêt : ceux qui ne sont pas attirés par le fait de manipuler le tableau de contrôle peuvent quand même suivre l’action et découvrir l’objet en restant à une certaine distance.
Cet outil de médiation est donc intéressant car il valorise l’esthétisme et la technique, par le biais de la technologie, pour susciter chez le visiteur une curiosité favorisant l’envie de découvrir cet objet. L’espace dans lequel il est présenté résulte d’un partenariat entre la Fondation nationale de la recherche scientifique hellénique, le Musée national archéologique d’Athènes, le projet de recherches sur le Mécanisme d’Anticythère et la manufacture horlogère Hublot de Genève. Il a également été placé sous la tutelle de la délégation permanente de la Grèce auprès de l’Unesco.
Mélanie TOURNAIRE
Des infos sur l'expo et sur l'intrigante machine ici

La Museum Week : voyage à travers le monde en une semaine
C’était il y a 4 ans (en 2014), lorsque des community managers de musées français décident de lancer cette vitrine interactive autour des institutions culturelles. Le principe est simple : 7 jours, 7 thèmes, 7 mots-dièse ; le tout régi par une thématique globale. Lancé dans un premier temps sur Twitter, aujourd'hui l’évènement est suivi dans 75 pays ; avec une participation de plus de 3000 institutions.
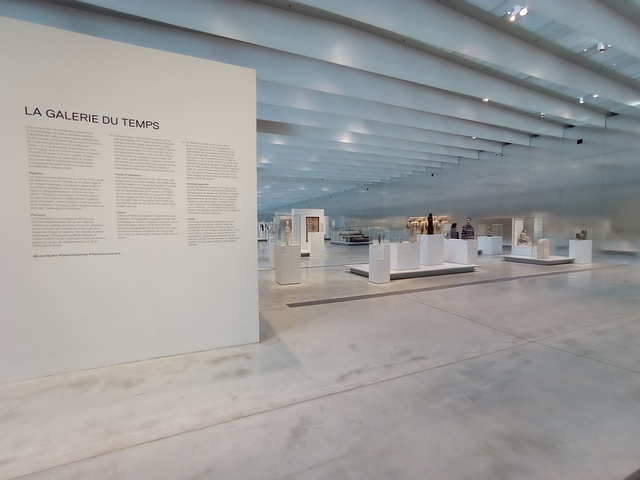
Le Louvre-Lens thérapie : une approche différente des œuvres d'art
Galerie du temps du Louvre-Lens © Gaëlle Magdelenne
De l'art thérapie avec des œuvres d'art
Un instant d'évasion et d'apaisement, ouvert à tous

Contemplation dans la Galerie du temps © Gaëlle Magdelenne
Après être accueilli dans une salle calme, à l’écart des autres visiteurs, une description du déroulé des activités est faite. Les ateliers sont divisés en deux temps : un premier temps est accordé à la découverte de l’œuvre d'art. La médiatrice et la thérapeute aident le public à comprendre l’œuvre choisie, parlent du ressenti de chacun pour que tout le monde puisse se questionner sur sa propre expérience. Positionnée devant l'œuvre, la thérapeute invite les personnes à fermer les yeux et à se plonger dans la thématique. Comme avec la thématique “Le corps en jeux”, après cette immersion, les visiteurs déambulent dans la Galerie du temps pour observer les différents corps représentés dans les œuvres.
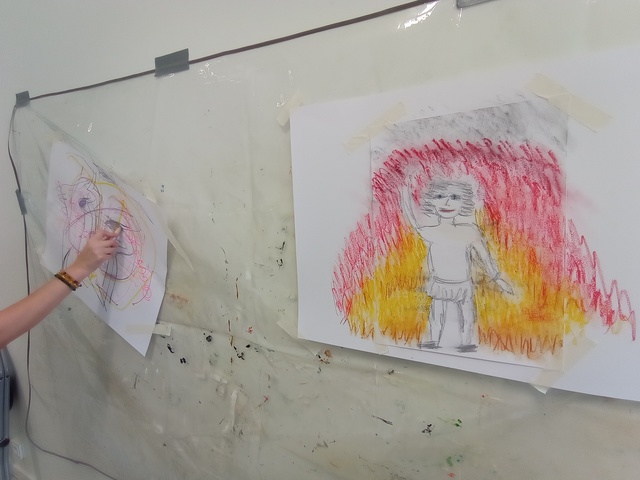
Dessins produits lors d'un atelier en février 2024 © Gaëlle Magdelenne
Pour aller plus loin :
- Plus d'information sur le Louvre-Lens-thérapie : https://www.louvrelens.fr/activity/louvre-lens-therapie-2/
- Article Prescription anti-blues d'hiverde L.L : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1850-prescription-anti-blues-d-hiver
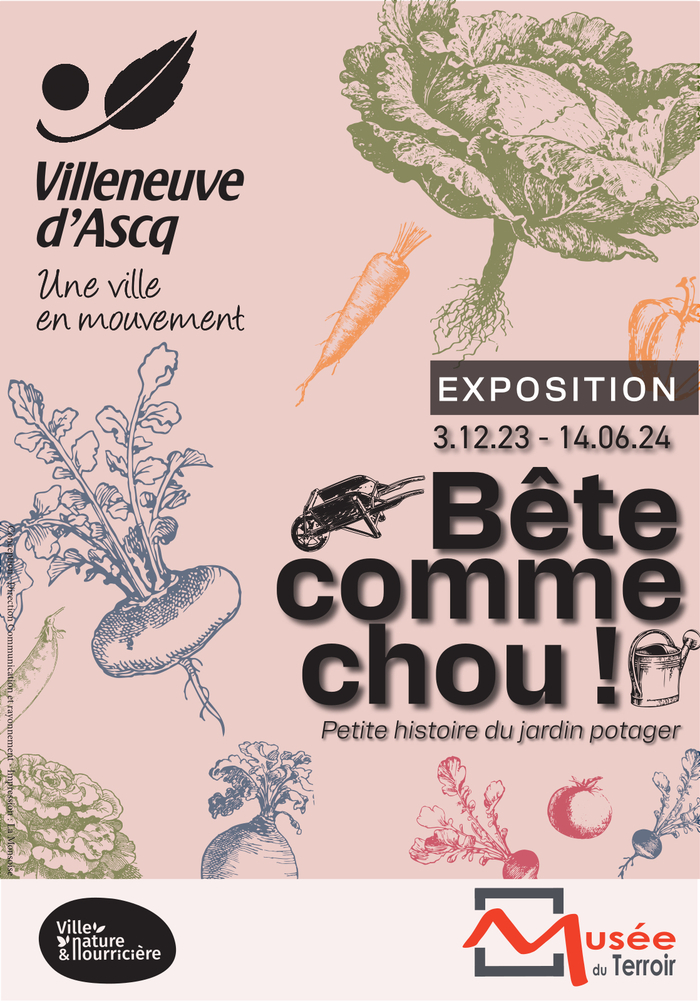
Le Musée du Terroir : savoir-faire autonomes d’antan ou de demain ?
A l’ère de la surconsommation, des lieux comme le Musée du Terroir de Villeneuve d’Ascq deviennent des lieux de transmission de savoir-faire oubliés permettant aux habitants de se reconnecter à leur territoire.
© Musée du Terroir
Créé en 1973, le Musée du Terroir est situé à Villeneuve d’Ascq, dans le quartier d’Annapes. Le Musée se distingue par son bâtiment : un ancien corps de ferme « la ferme Delporte », le nom des anciens exploitants agricoles, avant d’appartenir aux familles de Brigode et de Montalembert. Le Musée est fondé à l’initiative d’une association, « La société historique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois », qui initie une collecte d’objets. La collection compte aujourd’hui environ 20 000 objets. Afin de les conserver, des réserves ont été créées dans les années 2010 quand le Musée a été réhabilité. Depuis 2016, la ville de Villeneuve d’Ascq est gestionnaire du Musée.
Sauvegarder le patrimoine rural à l’ère de la surconsommation
Des expositions temporaires engagées
Le Musée du Terroir propose chaque année des expositions temporaires qui interrogent nos modèles de vie et de consommation. Leur prix est inclus dans le billet d’entrée du Musée. Cette année, l’exposition s’intitule « Bête comme chou ! Petite histoire du jardin potager », accessible depuis décembre 2023, elle peut encore être visitée jusqu’au 14 juin 2024. L’exposition invite le visiteur à découvrir l’histoire des jardins potagers et la manière dont nos ancêtres les cultivaient.
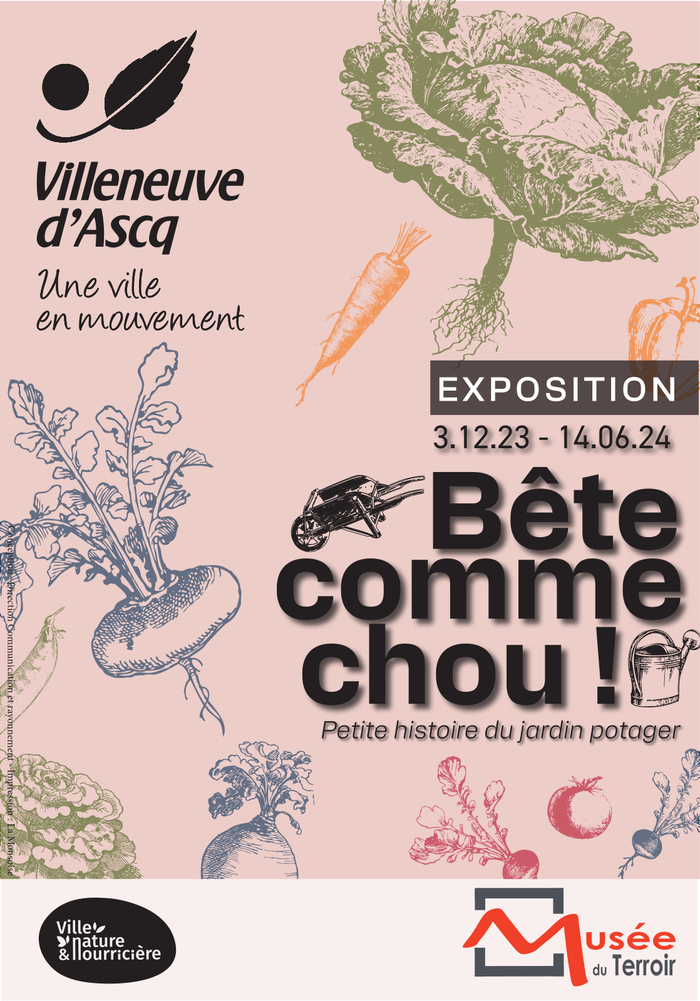
Affiche de l’exposition temporaire © Musée du Terroir, Ville de Villeneuve d’Ascq
Dans cette petite exposition, des objets sont présentés dans plusieurs vitrines, outils anciens pour cultiver le jardin potager ou encore des ouvrages ou manuels scolaires à destination de ceux et celles qui souhaitaient prendre soin de leur parcelle de terre.
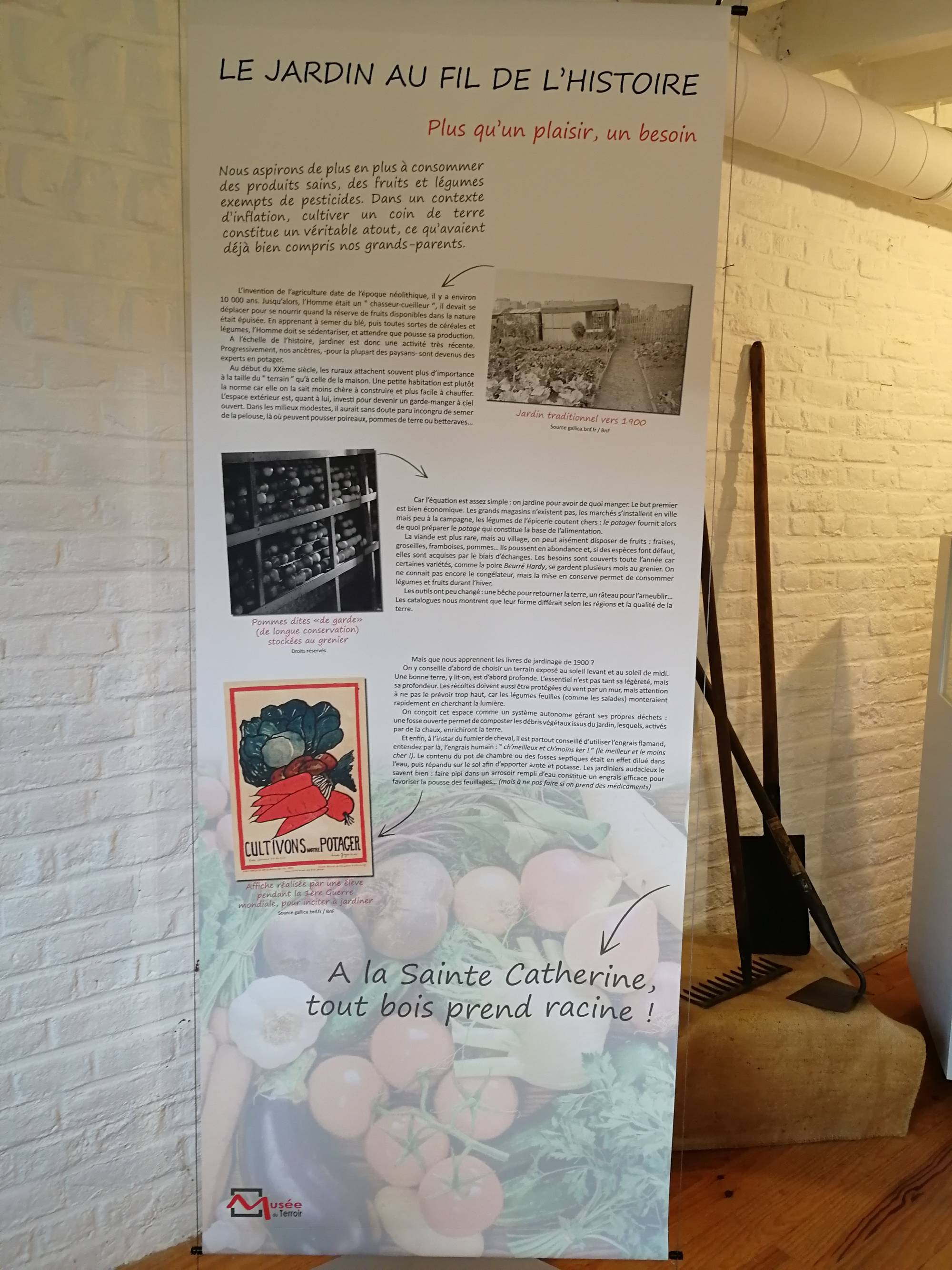
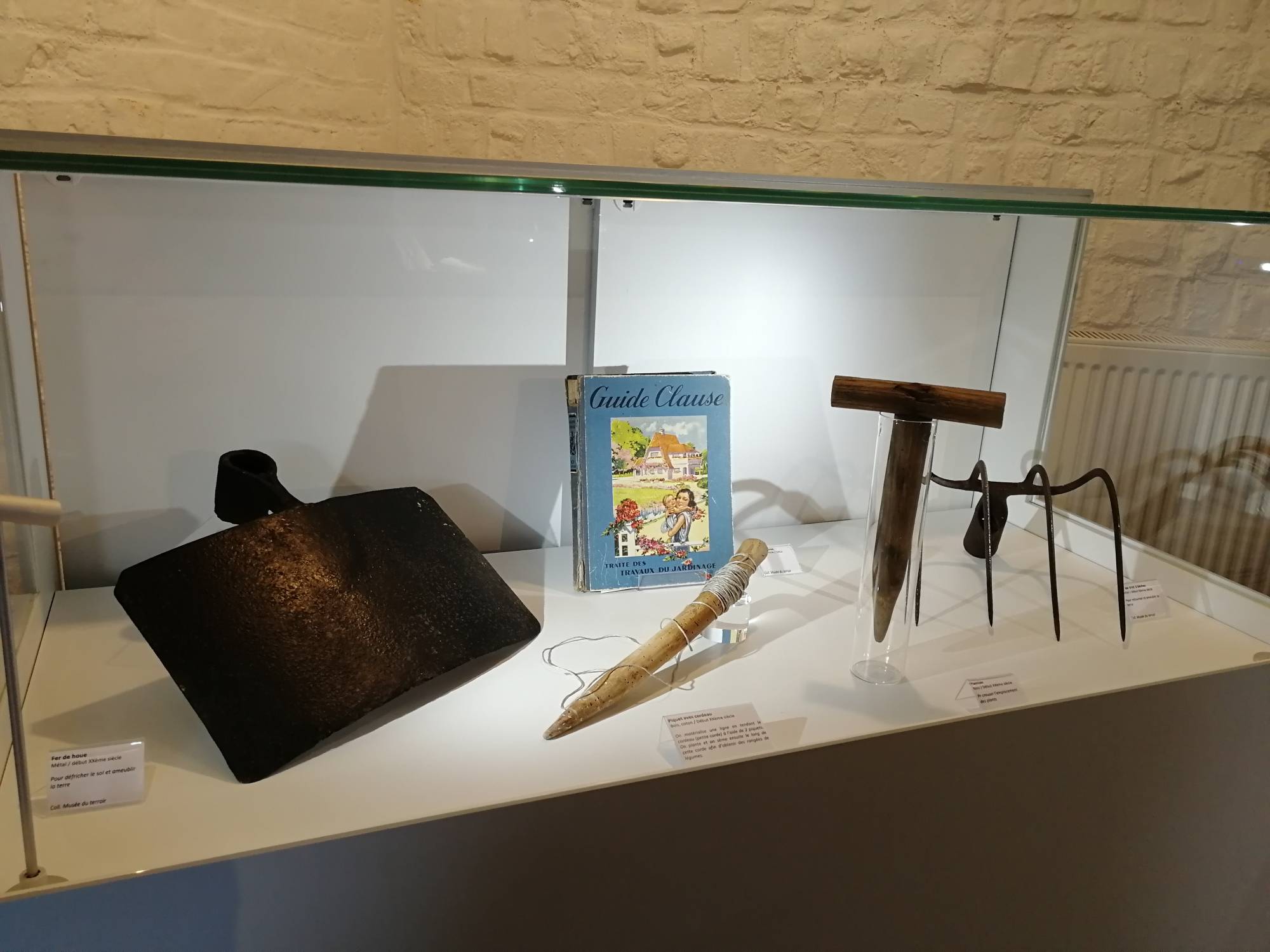
Vues de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Au Musée du Terroir, les thématiques d’expositions sont choisies en fonction des objets conservés dans les réserves, que l’équipe souhaite valoriser. Pour cette exposition, le propos se focalise sur le jardin cultivé par les habitants et nous partage leur regard. Le thème est actuel. Le propos rend hommage à nos ancêtres attentifs à leur environnement et visaient une autonomie alimentaire. Il y a 100 ans, le terme d’« écologie » n’existait pas. Par moindre progrès et agriculture intensive, ils vivaient de façon plus responsable vis-à-vis de l’environnement. Les biens matériels avaient plus de valeur car les gens mettaient plus de temps à les acquérir. Une tendance qui revient aujourd’hui, certains préfèrent acheter peu et privilégier la qualité ou le circuit-court. L’équipe du Musée veille toujours à faire référence aux enjeux écologiques actuels pour souligner cet écho entre les collections anciennes du musée et la société moderne. Le musée est ainsi reconnecté à sa vocation, à son rôle, à notre époque et à son territoire.

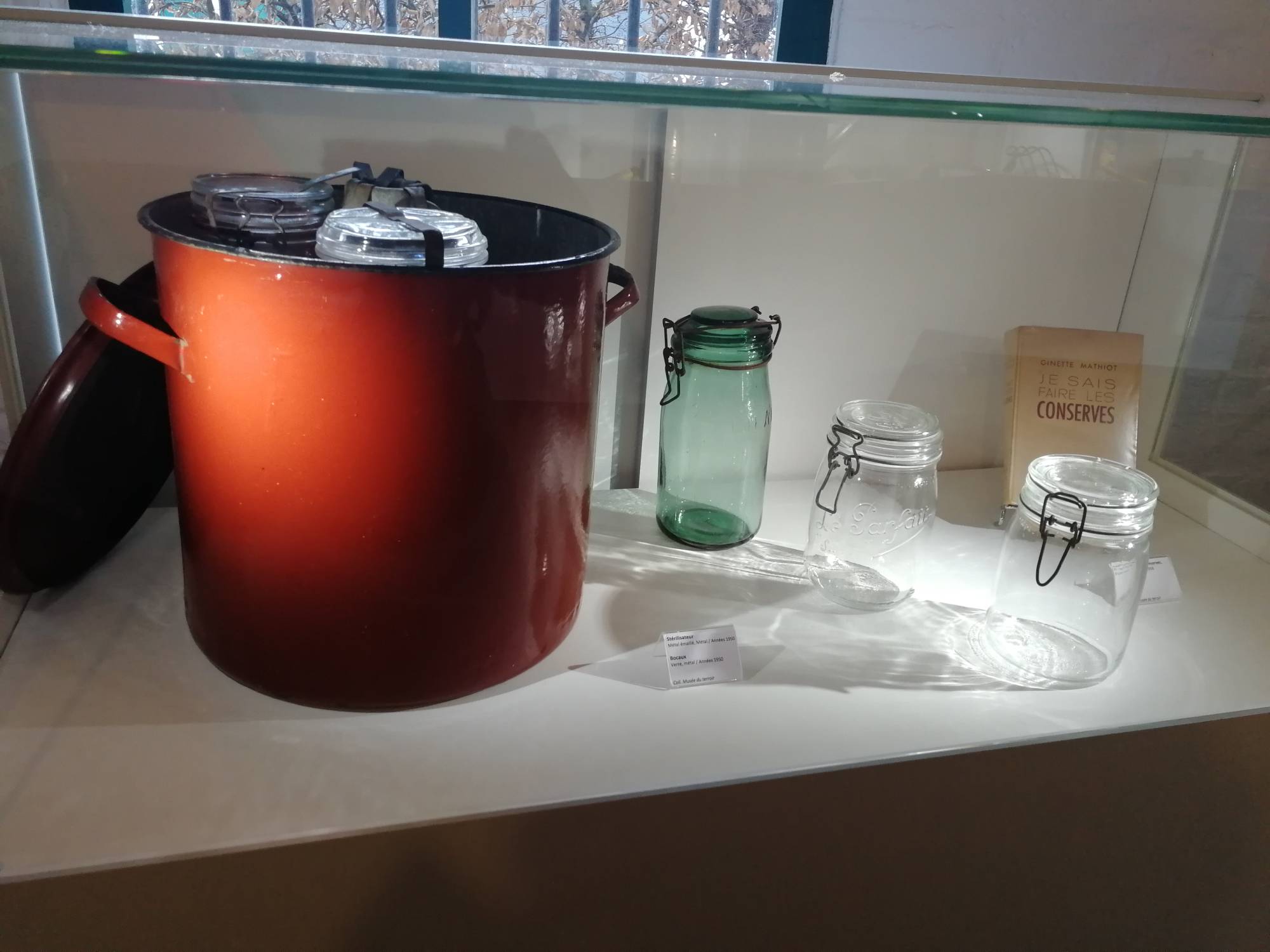
Vues de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Autour de cette exposition des visites sont organisées avec des « classes patrimoine ». Les professionnels de l’équipe proposent aux enfants des ateliers en rapport avec le jardinage.

Vue de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Sensibiliser les visiteurs pour faire face aux enjeux écologiques actuels
Millie CHIRON
Pour en savoir plus :
- Site du Musée du Terroir : https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/
#écologie #savoir-faire #transition
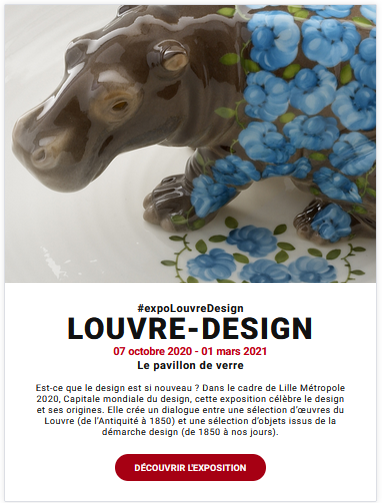
Le numérique comme lien social ? Visite à distance d’une exposition au Louvre-Lens
Avec la crise qui subsiste depuis plus d’un an, les musées ont dû s’adapter et revoir leur programmation. Nombreuses sont les expositions qui ont été annulées ou reportées. Cependant, la technologie s’est avéré être un outil non négligeable pour garder le contact avec les publics. Retour sur expérience et rencontre avec Marie Gord, médiatrice culturelle au Louvre-Lens.
Une offre culturelle vaste
Les visites à distance ne résultent pas seulement de la crise sanitaire, cette dernière a certes servi d’amplificateur mais elles préexistaient. Au Louvre-Lens, des visites à distance ont déjà été mises en place pour faciliter l’accès aux publics empêchés. De façon ponctuelle, le musée organise avec l’aide d’un robot, de la fondation Orange, des visites à distance pour les écoles isolées sur le territoire, pour les publics fragilisés, sous main de justice, hospitalisés, ou en EHPAD. Citons aussi les réseaux sociaux qui permettent de réaliser des lives avec leurs publics sur des formats très hétérogènes et généralement de courte durée.
En tant que publics, il est parfois compliqué de se retrouver dans la diversité de l’offre numérique des musées notamment par le vocabulaire utilisé. En fonction des offres, la terminologie n’est pas la même : visite guidée à distance, visite en visioconférence, visite en ligne, visite virtuelle, etc. Très floues, ces notions ne rendent pas bien compte de l’offre et de ce qu’elles contiennent réellement. Est-ce que la visite est réalisée par un médiateur ? Est-ce qu’elle est en direct avec une interaction possible ? Le numérique étant un médium souple, les possibilités de conception sont nombreuses. Sans compter que la diversité de cette nouvelle offre numérique résulte également des moyens techniques, humains et financiers de chaque institution. Cette nouvelle offre numérique pourrait se définir comme suit : « L’accès à un dispositif faisant appel à des moyens techniques et numériques divers et variés permettant aux publics de visiter et de découvrir un lieu. Cette appropriation d’un savoir ou d’un patrimoine ne peut se faire qu’ex situ, depuis chez soi et en dehors du cadre muséal ou institutionnel ».
Parmi les mesures déclenchées par le gouvernement, le télétravail est devenu une règle et les outils permettant de réaliser des visioconférences sont devenus familiers auprès de nombreux employé·e·s. Hybrides entre réseaux sociaux et outils de bureautique, des dispositifs tels que Zoom, Teams se sont vus attribuer d’autres missions. En effet, les institutions culturelles telles le musée Préhistoire de Nemours (Ile-de-France) ou le Musée du Textile et de la Mode à Cholet se sont saisies de ces logiciels de bureautique pour garder du lien avec leurs publics et le succès est au rendez-vous.
Le numérique comme lien social
Lié au contexte sanitaire, ce genre d’offre numérique présente deux objectifs. Premièrement, il s’agit de maintenir le lien avec les publics fréquentant régulièrement les institutions culturelles. Le Louvre-Lens a d’ailleurs orienté son offre à distance vers le public familial en proposant des ateliers plastiques à réaliser à distance et en direct. Deuxièmement, pour Marie Gord, le numérique s’avère être un outil très intéressant pour se familiariser avec le monde des musées. C’est un premier pas vers la culture qui se fait depuis chez soi et de manière rassurante.
Visite à distance au Louvre-Lens : mon expérience personnelle
J’ai donc voulu m’essayer à cette nouvelle pratique culturelle en visitant à distance l’exposition du Louvre-Lens, Louvre-Design. Dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du design, l’exposition propose de s’immerger au travers de collections et d’objets hétéroclites pour comprendre les origines du design. La visite est réalisée en direct sur Teams par un·e médiateur·trice du musée. Gratuite, elle ne dure que 45 minutes. Pour l’équipe du musée, la politique tarifaire doit également s’appliquer à cette nouvelle offre. la gratuité des visites à distance est en cohérence avec la gratuité d’accès pour tous à la Galerie du temps lorsque le musée est ouvert

2004 Hella Jongerius (production : manufacture de Nymphenburg), Bowl with hippopotamus, céramique peinte à la main © Porzellan Manufaktur Nymphenburg
La réservation en ligne
L’expérience commence sur le site internet lors de la réservation du billet. Pour chaque visite à distance le nombre de connexion (équivalent à des places) est limité à 6 personnes par session. Une fois la réservation accomplie, un mail est envoyé afin de la confirmer. Le nombre de place limité garantit un confort, non pas seulement du visiteur·e puisqu’iel est à distance, mais bien des deux médiateur·trice·s nécessaires au bon fonctionnement du dispositif.
La veille de la visite, l’e-billet est envoyé sur la boite mail contenant un lien de connexion, des modalités comme l’heure de connexion ainsi que quelques conseils pour profiter de l’expérience au maximum.
La connexion internet
Même si le numérique peut s’avérer être un outil formidable, il n’est pas sans faille. Des problèmes de connexion peuvent survenir et mettre en péril la visite à distance. C’est un problème qui a été anticipé par le Louvre-Lens qui a eu, le jour de ma visite, un disfonctionnement sur le réseau. Un mail m’a été envoyé pour me prévenir de la situation et m’indiquant de la marche à suivre.
Selon Marie Gord, qui a participé à plusieurs reprises à la mise en place de la visite à distance, le versant technique de tout dispositif numérique, surtout s’il nécessite une connexion internet, implique un risque, une panne de réseau ou un dysfonctionnement du matériel. En tout cas, il faut anticiper des problèmes pour prévenir ces risques.
Les collections à l’écran
Etant une adepte des visites dites classiques en contact direct avec les collections, j’avais quelques réticences pour une expérience en ligne. Mais, si le rapport aux collections n’est pas le même, la visite en ligne n’enlève rien à la qualité du discours tenu. Peu présenté visuellement à l’écran, il laisse place aux collections. Bien entendu, le parcours a été pensé et plusieurs tests ont été nécessaires requis pour trouver le meilleur moyen de présenter les collections en direct sans qu’aucun élément ne vienne perturber la qualité de l’image. L’équipe a procédé à différentes prises de vues à plusieurs moments de la journée pour attester du rendu visuel des collections à l’écran (reflet du soleil sur les vitrines, tailles des objets, éclairages artificielles, positionnement de la caméra, résonnance, wifi, etc.).
Quant au caméraman, qui s’est présenté au début de la visite, il a pris soin de réaliser des mouvements de caméra lents afin d’éviter un décrochage de l’image. Les objets sontbien mis en valeur, avec des zooms. Le positionnement de la caméra a été pensé en amont et les plans sur les objets ont été pris avec leur cartel.

Capture d’écran de la visite à distance au Louvre-Lens
Louvre-Design ©Edith Grillas
L’interaction avec le public
Pour mettre en place ces visites à distances, deux médiateur·trice·s sont nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement du dispositif. Le·a premier·ère se pose en réalisateur·trice et assure le backup, modère les commentaires que peuvent laisser les publics. Tandis que l’autre mène la visite guidée. A propos du matériel, une tablette avec connexion, un pied et un support pour la fixer, un micro Bluetooth sont nécessaires. Et bien évidemment un logiciel de bureautique comme Zoom, Teams ou autre.

Capture d’écran de la visite à distance au Louvre-Lens
Louvre-Design ©Edith Grillas
Quant aux publics, une fois l’outil appréhendé et le stade de l’inconnu dépassé, ils prennent vite leurs habitudes de visiteurs curieux, posant des questions (ou non, chaque visiteur a sa propre personnalité) soit en direct ou via l’espace de discussion. Alors, même si le lien social peut être maintenu entre le⋅a médiateur·trice et son public par l’entremise des questions, le lien entre les différents individus que constitue un groupe de visite à l’ordinaire peut se faire difficilement, voire est impossible. Or, une visite guidée n’est pas une sorte d’entre-soi. Les visiteur⋅e⋅s se rencontrent, échangent, discutent, rient, partagent des anecdotes. Et c’est cette richesse apportée par les publics que les visites guidées prennent une saveur singulière.
Durant la visite à distance, il m’est arrivé que la connexion internet soit interrompue pendant quelques secondes, perdant alors une partie du discours tenu. C’est ce genre de problème qui pouvait me freiner.
Pour conclure, les institutions muséales ont su faire preuve de rapidité et d’ingéniosité pour garder le lien avec ses publics. Cette prise de décision ne découle pas seulement d’un besoin exprimé par les publics de retourner dans les musées, mais également du souhait des professionnel·le·s de la culture de simplement faire leur travail avec passion et conviction.
La diversité de ces nouvelles offres numériques permet à chaque public d’y trouver son compte. Mais quel(s) profil(s)s de public s’inscrivent aux offres à distances ? Des habitué·e·s qui voient dans cette programmation une manière de poursuivre leurs activités culturelles pré-Covid ? D’autres publics, surtout éloignés de la culture ? Est-ce plus difficile d’évaluer un projet quand les publics sont absents des espaces muséographiques ? Et question plus globale, ancrée dans les préoccupations culturelles de notre temps : le numérique contribue-t-il réellement à diffuser une culture pour tous ?
Edith Grillas
#Exposition #Numérique #Expérience de visite
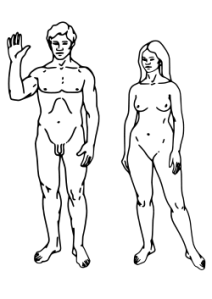
Le plus vieux moyen de médiation du monde
Le moyen de médiation muséal que nous vous présentons aujourd'hui est certainement le plus moderne de tous, sa modernité est intemporelle et indépassable.
HomoSapiens© N.A.S.A.
Le moyen de médiation muséal que nous vous présentons aujourd'hui est certainement le plus moderne de tous, sa modernité est intemporelle et indépassable. Pourtant son ancienneté dépasse largement l'existence des musées : 7 millions d'années environ pour le tout premier modèle, environ deux cent mille ans pour le modèle actuel après de nombreuses évolutions. Il fut aussi de l'aventure des tous premiers musées, il les créa et fut l'instigateur de toutes ses transformations.Nous vous le donnons en mille : l'humain.
Mais pas n'importe lequel : celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui est original de par son statut mais aussi sa raréfaction. Il ne se trouve que dans un seul type de musée : les musées associatifs, il s'agit des intervenants bénévoles.
Ceux-ci ne sont pas de nature des « moyens » de médiation, ils ne sont là que pour l'accueil et le bon fonctionnement du musée. Et pourtant ! Là où tant de musées dépensent des sommes faramineuses en équipements de médiation ultra-modernes,ou dans les salaires des professionnels de cet discipline indispensable, lesbénévoles accomplissent cet office gratuitement, avec une animation, une chaleur et un ton unique. Pour illustrer cela, nous nous sommes rendus dans un musée associatif : le Musée du Vermandois, situé dans l'Aisne, à Vermand ; petite commune de 2000 habitants proche de Saint-Quentin. Nous avons vu là-bas une intervenante qui à elle seule illumina notre visite et rendit ce musée plus vivant et parlant qu'aucun autre musée de ce type. Cette personne n'a aucune formation dans le domaine des musées, mais c'est une passionnée avec une culture très riche, variée. Elle a surtout toujours l'envie de partager ses connaissances avec les visiteurs, qu'elle accueille toujours avec un sourire puis avec une présentation du musée et de sa ville ; présentation très complète sans être scolaire.
Mais avant tout, mettons-nous d'accord sur la définition de « moyen de médiation », et précisons pourquoi une personne peut-en être un. D'abord parce que ces bénévoles font tout ce qu'un moyen de médiation doit faire, sans être ni des guides, ni des médiateurs agréé.
Ils présentent le musée, racontent l'histoire de ses collections, le parcours. Pour le musée du Vermandois, il s'agit notamment de mettre en avant la riche histoire de la cité depuis les celtes, pour mettre en valeur la collection archéologique issue des fouilles. Il faut aussi présenter les autres étages, leurs buts, intérêts et liens avec la ville de Vermand et sa région.
Puis ils deviennent vraiment des outils de médiation indispensables lorsque la médiation fait défaut dans le musée. Les musées comme celui-ci n'ont ni les moyens, ni la place, ni la possibilité de mettre en place une médiation et un affichage informatif exhaustif partout. Heureusement, pour toutes les questions possibles et imaginables les bénévoles sont là. Ils n'ont pas toujours les réponses, mais ont toujours une remarque qui indique la valeur de l'objet en question, le remet dans un contexte ou du moins donne au visiteur l’impression d'être avec quelqu'un comme eux.
Souvent cela ouvre sur une discussion, un échange qui permet au visiteur de faire naturellement le lien entre son expérience personnelle et la collection présentée, en même temps que d'apprendre quelque chose. Cet échange gratuit et chaleureux entre deux amateurs rend les bénévoles si spéciaux ; par rapport aux professionnels pour lesquels tout échange est une formalité avec un rapport donnant / recevant, et par rapports aux moyens de médiation artificielles.
Un diorama © Musée du Vermandois
 Dans ce musée comme dans tous ceux du même type, ils deviennent donc indispensables. Une visite avec ou sans leur intervention est radicalement différente. Le meilleur exemple se trouve dans la partie du musée consacrée aux « métiers d'antan ». C'est la partie ethnologique du musée, dans laquelle sont présentés de nombreux objets de métiers ou de la vie quotidienne du XXe siècle. Il y a d'abord eu un effort de mise en scène avec des dioramas, tel le musée de Frédérique Mistral. Mais grâce, ou à cause de dons nombreux, il y a eu un assemblage d'objets de plus en plus divers, sans qu'il soit possible de tout référencer, par manque de place il y a très peu de cartels et d'affichage. C'est devenue une véritable caverne d'Ali Baba très riche, peut-être même trop. Sans médiation, il est possible de reconnaître certains objets et de percevoir des évolutions (comme les machines à laver ou les télévisions), malheureusement on peut aussi être frustré et saturé de se retrouver face à une telle masse d'objets, cela peut être illisible.
Dans ce musée comme dans tous ceux du même type, ils deviennent donc indispensables. Une visite avec ou sans leur intervention est radicalement différente. Le meilleur exemple se trouve dans la partie du musée consacrée aux « métiers d'antan ». C'est la partie ethnologique du musée, dans laquelle sont présentés de nombreux objets de métiers ou de la vie quotidienne du XXe siècle. Il y a d'abord eu un effort de mise en scène avec des dioramas, tel le musée de Frédérique Mistral. Mais grâce, ou à cause de dons nombreux, il y a eu un assemblage d'objets de plus en plus divers, sans qu'il soit possible de tout référencer, par manque de place il y a très peu de cartels et d'affichage. C'est devenue une véritable caverne d'Ali Baba très riche, peut-être même trop. Sans médiation, il est possible de reconnaître certains objets et de percevoir des évolutions (comme les machines à laver ou les télévisions), malheureusement on peut aussi être frustré et saturé de se retrouver face à une telle masse d'objets, cela peut être illisible.
Mais avec l'intervention d'un bénévole, cela devient une expérience muséale unique. Surtout avec celle que nous avons vu, qui en plus de son charme naturel, sa classe, son sourire, a fait l'effort de se renseigner sur presque tout ce qui se trouve dans cette caverne, qui devient alors un lieu d'échange didactique incomparable.
On y apprend d'abord des choses, notre étonnement devant certains objets étranges se transforme en découverte de pratiques, aujourd'hui disparues. Certains objets qui semblaient insignifiants ou perdus dans la masse retrouvent leurs sens. Là où des cartels et panneaux seraient indigestes, surtout pour de si nombreux objets, la mémoire de l'intervenante et son talent de conteuse nous les rendent intéressants et vivants.
La section « métiers d'antan »© CDT02
 Puis, souvent, la leçon se transforme en discussion, en échange de connaissances, et mieux encore de souvenirs. Voilà qui est au cœur de la volonté de beaucoup de musées ethnologiques : faire le lien avec le présent. Chacun projet montre naturellement ce qu'il a connu ou ce qu'il pensait connaître dans cette caverne qui s'anime alors par la magie de l'imaginaire. L'échange est fructueux pour les deux parties, puisque l'intervenant n'est pas censé tout savoir et peux tomber sur un visiteur qui a connu tel ou tel objet. Une visite sans médiation, qui aurait pu durer quelques minutes et ne déboucher sur aucune connaissance, se transforme en rencontre chaleureuse entre gens curieux dans laquelle le musée retrouve son sens premier : la diffusion de connaissances, mais avec ce plus humain, et la possibilité de développer tout en gardant le visiteur concerné.
Puis, souvent, la leçon se transforme en discussion, en échange de connaissances, et mieux encore de souvenirs. Voilà qui est au cœur de la volonté de beaucoup de musées ethnologiques : faire le lien avec le présent. Chacun projet montre naturellement ce qu'il a connu ou ce qu'il pensait connaître dans cette caverne qui s'anime alors par la magie de l'imaginaire. L'échange est fructueux pour les deux parties, puisque l'intervenant n'est pas censé tout savoir et peux tomber sur un visiteur qui a connu tel ou tel objet. Une visite sans médiation, qui aurait pu durer quelques minutes et ne déboucher sur aucune connaissance, se transforme en rencontre chaleureuse entre gens curieux dans laquelle le musée retrouve son sens premier : la diffusion de connaissances, mais avec ce plus humain, et la possibilité de développer tout en gardant le visiteur concerné.
Alors que les musées modernes sont généralement dans une recherche de clarté, d'épuration, on voit que cette forme d'exposition qui tend à disparaître peut avoir un intérêt grâce à ces outils de médiation humains, amateurs et passionnés que sont les bénévoles. Cela pourrait même être un concept à reprendre dans certains grands musées.
Bien sûr, ces « appareils » ont de nombreux défauts, dus à leur nature humaine et leur statut non professionnel : le manque d'exhaustivité des connaissances, l'inconstance des sentiments et des humeurs de chacun, la disponibilité aléatoire selon la fréquentation du musée.
Mais songez que ce sont les seuls qui s'adaptent vraiment à chaque visiteur, à chaque type ou catégorie. Souvent, les outils de médiation mis en œuvre par les professionnels s’adressent à un type de public spécifique, ciblé, la plupart du temps scolaire. Ici, chacun à le droit à un accueil personnalisé, qu'il soit enfant, groupe de scolaire, personne âgée, professeur d'Histoire, passionné de tel ou tel sujet, simple passant, curieux ou même non curieux, sans qu'il n'y ait aucune stratégie basée sur des a priori dont les professionnels aiment à user lors de colloques.
Sans prétention aucune, ils permettent une approche des collections qui leur est propre et ne pourrait être imitée. Ils humanisent des choses sans vies, et impliquent le visiteur qui se transforme alors en invité privilégié dans une promenade à travers le temps, qui s'achève le plus souvent, grâce à une fréquentation moindre, en une sympathique discussion autour d'une boisson. Le personnel du musée apprend parfois autant de certains visiteurs que l'inverse, ce qui peut amener celui-ci à s'améliorer, ce qui rend en plus cette médiation participative.
Nous avons donc là un moyende médiation humaine inimitable et propre aux associations, original par son statut de bénévole et d'amateur, toujours et à jamais moderne car l'esprit humain est une machine indépassable en matière de technologie, avec la capacité d'adaptation la plus grande possible et cette possibilité d'impliquer le visiteur. Mais surtout original car chacun d'entre eux est spécial et rend chaque visite unique.
Daniel Bonifacio

Le respect du spirituel dans l'espace muséal
La reconnaissance de la dimension spirituelle des objets dans les musées est une préoccupation partagée par diverses cultures. Cette considération influence la manière dont les objets sont exposés, conservés et interprétés, en respectant les croyances et les pratiques des communautés d'origine. Comment les musées intègrent-ils ces considérations spirituelles dans leurs pratiques muséales ?
Une approche collaborative avec les communautés autochtones
Dans de nombreuses cultures autochtones, les objets conservés dans les musées ne sont pas seulement des artefacts matériels, mais des entités investies d’une signification spirituelle. Leur gestion dans les institutions muséales prend donc en compte ces particularités immatérielles pour éviter toute décontextualisation ou appropriation irrespectueuse.
Le soin des objets sacrés ou culturellement sensibles repose sur un partenariat entre les musées et les communautés autochtones. Selon les recommandations du Gouvernement du Canada, ces consultations permettent de comprendre des aspects comme le pouvoir intrinsèque des objets et leurs implications pour ceux qui les manipulent ou les exposent.Le concept maori de Mana Taonga, qui considère les objets comme des ancêtres vivants, exige un traitement adapté. Cette philosophie, adoptée par des institutions comme le Musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande, place les communautés au cœur du processus décisionnel. Elles participent progressivement depuis les années 80 à la définition des soins nécessaires pour les objets, qu’il s’agisse de rituels spécifiques ou de la mise en place de protocoles restrictifs. Cela inclut la gestion de masques ou d’autres objets cérémoniels, qui peuvent avoir été séparés de leur communauté d’origine pendant longtemps sans perdre leur pouvoir ni leur importance.

Espace sacré maori Rongomaraeroa, Musée Te Papa Tongarewa, Nouvelle-Zélande, 2019. © Johnny Hendrikus. Te Papa.
Ainsi, de nombreux musées mettent en place des restrictions d’accès et d’exposition. Certains objets ne peuvent être vus ou manipulés que par des personnes initiées, des chamans, ou des personnes d’un sexe spécifique. Par exemple, des restrictions interdisent l’accès à des femmes enceintes ou en période de menstruation. Les objets particulièrement sensibles sont placés dans des vitrines opaques ou dans des espaces restreints pour limiter leur exposition au grand public.
Respect et sacralité de certains objets asiatiques
L’exposition de certains objets provenant des traditions shintô et bouddhistes en Asie nécessite une attention particulière pour respecter leur caractère sacré et préserver
les sensibilités des pratiquants.
Les statues de Bouddha, incarnant les enseignements spirituels, sont souvent exposées dans des espaces dédiés aux distractions minimisées. Ces environnements recréent
parfois l’ambiance d’un temple, avec bougies, encens et coussins de méditation. Ces salles peuvent être réservées aux pratiquants ou nécessiter la présence de guides
spirituels. De plus, par souci de respect, il est tenu d’exposer et d’entreposer les statues de Bouddha de sorte que la tête dépasse les objets qui l’entourent.
Les thangkas, peintures bouddhistes tibétaines, servent de supports visuels pour la méditation et sont utilisées dans des rituels spécifiques. Elles sont également présentes
lors de rituels d’initiation ou de purification. Leur manipulation est restreinte aux pratiquants qualifiés ou aux moines, pour préserver leur intégrité spirituelle.
Les masques rituels d’Asie de l’Est, quant à eux, sont perçus comme des incarnations d’esprits ou de divinités. Leur exposition peut être temporaire, limitée à des cérémonies
spéciales, pour éviter toute profanation ou perte de pouvoir spirituel. De même, les statues de Kannon, déesse de la miséricorde dans le bouddhisme Mahāyāna, sont souvent présentées dans des espaces propices au recueillement, accompagnées éventuellement de chants ou prières.
Comme pour les cultures autochtones, les musées asiatiques consultent régulièrement des moines, prêtres ou praticiens pour s’assurer du respect des traditions spirituelles. Le musée royal de Mariemont, à l’occasion de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible (2024-2025), a notamment fait appel avant l’ouverture au public à des bouddhistes pour garantir une présentation respectueuse.
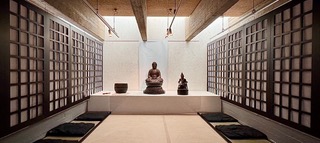
Vue de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible. Musée royal de Mariemont, Belgique,2024. © Paulette Nandrin.
Défis communs, solutions spécifiques
Les objets spirituels liés aux traditions africaines, comme ceux du vodoun, posent également des défis particuliers aux musées. Ces objets, tels que les masques et les fétiches, sont investis de pouvoirs sacrés, d’un rôle actif lors de cérémonies. D’où des solutions spécifiques : l’exposition dans des espaces dédiés, la tenue de rituels de
purification ou encore la restriction de l’accès à certains publics.

Un fétiche bizango en tissu rembourré. Le scanner révèle la présence d’une croix de cimetière, un crâne, des bouteilles renfermant des âmes. Exposition Zombis, musée du Quai Branly, France, 2024. © Léo Delafontaine.
Les objets des religions monothéistes requièrent aussi des protocoles de traitement pour les reliquaires catholiques ou pour les rouleaux de parchemin de la Torah des Juifs,
que les restaurateurs ne doivent pas réparer, à moins d’avoir suivi une formation spéciale et obtenu la sanction de la communauté. De même, l’exposition des rouleaux de la Torah est soumise à des conditions particulières. Ne sont exposés que les rouleaux ne pouvant plus être utilisés pour la lecture publique en raison de dommages ou d’altérations. Il est essentiel de présenter les objets religieux en évitant toute banalisation ou profanation de leur usage en les accompagnant de supports éducatifs appropriés.
La problématique de la spiritualité des objets dans les musées reflète une prise de conscience croissante de la complexité et de la diversité des cultures représentées. Qu’il
s’agisse d’objets autochtones, asiatiques ou africains, ces artefacts incarnent des dimensions immatérielles qui nécessitent des approches adaptées. En collaborant avec les communautés d’origine, en limitant l’accès aux objets sensibles, et en créant des environnements qui respectent leur sacralité, les musées parviennent à concilier leur mission éducative avec le respect des croyances spirituelles. Ces pratiques encouragent une compréhension plus profonde et plus respectueuse des cultures, contribuant ainsi à la valorisation des diversités culturelles et à la préservation des héritages spirituels.
Nina Colpaert
Pour en savoir plus :
Note d'information générale sur les politiques relatives à l'autonomie gouvernementale et aux revendications territoriales globales du Canada et sur l'état actuel des négociations PARIS, Camille, « Visions chamaniques. Arts de l’Ayahuasca en Amazonie péruvienne », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024. : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2519-visions-chamaniques-arts-de-l-ayahuasca-en-amazonie-peruvienne
PARIS Camille, « Musées et communautés autochtones, vers un partage des pouvoirs au musée ? », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024.https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2514-musees-et-communautes-autochtones-vers-un-partage-des-pouvoirs-au-musee
Tchénando Patrick Noukpo, Les masques africains : des patrimoines identitaires dans la diversité culturelle entre espaces profane et sacré au Bénin, thèse de doctorat en
Sociologie. Université de Lorraine, 2020.https://theses.hal.science/tel-03208608/
#muséographie #PatrimoineSpirituel #collaboration

Le skate urbanisme pour penser la ville de demain
Du 17 octobre au 20 octobre 2024, Bordeaux accueille la première édition du festival international Connect au cour Mably. Le festival est co-organisé par Léo Valls, skateur professionnel bordelais, l’association Skate Collective et l’agence Côte Ouest. Grâce à la collaboration entre Léo Valls et Brice Fauquet (directeur artistique chez Côte Ouest), la culture skate, née dans la rue, voit la création de sculptures 3D. Ces œuvres illustrent le skate urbanisme avec des praticables : module de skate, banc ou sculpture.
sculpture Arrow, béton imprimé 3D, © Sébastien Banizette
Un parcours skatable en libre accès dans toute la ville
Né dans les années 1990, en Scandinavie, le skate urbanisme est un mouvement activiste qui intègre la libre pratique du skateboard dans l’aménagement urbain. Bordeaux apparaît comme une ville avant-gardiste dans l’intégration de la pratique du skateboard ainsi que dans sa réflexion de l’urbanisme. En effet, Bordeaux est la première ville de France à développer le skate urbanisme montrant une dynamique pour les autres villes. Ce choix est à l’image d'autres villes européennes comme Malmö ou encore Copenhague. Il s’agit de réfléchir à plusieurs questions aux enjeux actuels comme la définition de la ville nouvelle, des réflexions climatiques et sociales.
En ce sens, au-delà de son aspect contemplatif, esthétique ou engagé, le skate urbanisme encourage des actions sociales. Tout le monde se mélange et partage ainsi les espaces publics. L’information devient alors la première démarche pour permettre cette cohabitation. À Bordeaux, la distribution d’un guide du skateboard, une démarche de médiation entre les pratiquants de skateboard et la population, ou encore la création d’événements culturels comme le festival connect sont les acteurs de cette information.
Le skate urbanisme montre une volonté pour les mairies de créer des échanges entre les citoyens. Cette dynamique citoyenne est permise par des événements culturels et sportifs. Le sport, plus précisément la pratique du skateboard, est encouragé par l’installation de structures. Ces projets d'aménagements pouvant être portés par les budgets participatifs montrent une volonté de rapprocher les riverains par une pratique sportive de proximité et l’organisation d'événements sportifs et culturels dans ses espaces.
Bordeaux voit déjà naître plusieurs œuvres en son centre depuis 2019 avec les sculptures en béton PLAY ! puis en 2021 de Bon voyage, en 2022 d’Hybrides puis en 2023 de Contact et ainsi, en 2024, de Union / Arrow / Hands.

Sculpture Hands, béton imprimé 3D, miroir d’eau © Sébastien Banizette
Ces installations resteront au moins jusqu’à l’année prochaine. Elles s'étendent dans le centre de Bordeaux cour du Chapeau Rouge, parvis des frères Pouyanne au Miroir d’eau. En espérant une deuxième édition du festival Connect pour 2025 et de nouvelles sculptures ? Ce parcours s'effectue en skateboard mais tout aussi aussi à pied, à vélo, en tram … Les œuvres sont pensées pour être visibles et utilisées par tous.
Quand le Patrimoine immatériel rencontre le matériel
Le festival permet un mélange de plusieurs arts. En effet, les conférences, projections de films et cours de skate se mêlent avec l’exposition des photographies de l’artiste japonais Lui Araki ou encore les maquettes de Lena Germanese, urbaniste et skateuse. Deux autres expositions, celle de Nicolas Malinowsky et “BOARDS” par Grégoire Grange, explorent les liens entre la culture du skateboard et le dessin. La pratique du skateboard est ramifiée aux arts visuels, à la photographie, à la musique, à l’architecture, au cinéma, à la mode, et aux moyens d’expression corporelle.
Cet événement international a permis des échanges entre skateurs, urbanistes, artistes et plus de 30 intervenant.e.s comme des médecins et des chercheurs. Un lieu de partage de mélanges, mais surtout témoin d’une inclusivité. Des cours spécialement pour handiskate sont proposés. La place des femmes mais aussi de toute personne est interrogée lors de conférences, ou lors de dialogues avec les associations sur place. Témoin de fortes valeurs, la communauté skate propose cette programmation gratuite et en libre accès. L’ensemble de ces actions (conférences, ateliers) a bénéficié d’une traduction simultanée de l’anglais au français et vice-versa.
Ces valeurs sont communes à la culture skate, diffusées au sein des écoles de skateboard, pour Bordeaux au Zoom ou encore Darwin et tous les lieux de pratique du skateboard.
La culture skate permet d’aborder des problématiques sociétales et environnementales. L’exclusion sociale et la pollution de l’air en ville sont traitées par des actions créant du lien social tout en favorisant les mobilités douces. Il s’agit de rapprocher les populations défavorisées, éloignées des centres culturels. Les infrastructures mises en place pour la pratique du skateboard s’étendent donc partout , en centre ou en banlieue. Bordeaux depuis 2020 a construit 4 nouveaux skatepark dans sa banlieue accessibles en transports en commun et par voie cyclable. Ces skatepark donnent aussi lieu à des événements avec musique, food truck et compétitions de skateboard.
L’installation des œuvres en centre ville de Bordeaux consolide la mise en lumière du skateboard, le plaçant au premier plan avec l’accueil de la première école supérieure reliée aux pratiques du skateboard : la Shifty School.
Événement organisé dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, Connect a proposé une visite guidée par Léo Valls et Laure Valette. Les skateurs/skateuses et le grand public étaient invités à découvrir le patrimoine matériel bordelais au travers cette visite guidée, créant un lien culturel entre culture skate, actrice et témoin de la ville, et histoire urbaine.

Sculpture Hands, béton imprimé 3D, miroir d’eau © Sébastien Banizette

échanges lors d’un atelier à Darwin, 2024 © Sébastien Banizette
Le partage de l’espace urbain, la clef pour la ville de demain :
Cette première édition montre le fort potentiel du skateboard comme culture mixte et sociale. Le choix du nom Connect n’est pas anodin, signifiant toute la dimension artistique et culturelle qui se cache derrière le skateboard, qui est plus qu’un sport. C’est un moyen de rencontrer, de créer du lien social, de démultiplier la dimension artistique en regroupant des artistes photographe, sculpteurs, graphistes, musiciens... Le festival Connect expose ainsi ce qu’est la culture skate.

Sculpture Hands, béton imprimé 3D, miroir d’eau photographié par © S.B
L’implantation depuis 2019 de sculptures pouvant être skatées permet de partager différemment l’espace public. Penser la ville de demain est donc au cœur des réflexions du skate urbanisme. “Ce mouvement s’inscrit dans un urbanisme circulaire, favorisant la mutualisation des espaces existants. En favorisant les jeux urbains, la mobilité douce et en renforçant la cohésion sociale, le skate urbanisme contribue à la transition vers des villes durables et inclusives.” © 2024 Connect Festival
Ceux qui étaient perçus comme des marginaux faiseurs de troubles, sont aujourd’hui des acteurs importants dans la conception de la ville de demain, qui se veut durable et inclusive.
Ces sculptures restent dans l’espace public et sont donc accessibles sans contrainte. Elles favorisent toutes les pratiques artistiques en laissant libre cours à la créativité, pratique hors les murs sur du très long terme.
Les sculptures sont principalement en centre-ville avec des points stratégiques : miroir d’eau et grand théâtre. Le dispositif vise également les autres quartiers en s’implantant à St Pierre et Nansouty. Le choix de parsemer les structures permet à tout à chacun d’y accéder mais aussi de valoriser les quartiers hors centre quand ils ne possèdent pas de skatepark ou de skateshop.
La culture skate porte des valeurs fortes. Ces valeurs qui semblent essentielles pour mieux penser nos sociétés, notre vivre-ensemble et nos villes de demain.
Charlotte Dollet-Cormac
Pour en savoir plus :
- https://connect-skaturbanism-festival.com/connect-sculptures/
- https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02090334v1/file/M1820193968_CERVANTESJonas.pdf
- https://bordeaux-skate-culture.org/
#skateurbanisme #festival #patrimoineimmateriel #villededemain

Le street art en mouvement : quelles actions culturelles ?
Né dans les rues de Philadelphie dans les années 1960, de mouvement marginal à phénomène mondial, le street art façonne désormais nos villes. Cet art de plus en plus reconnu trouve aujourd’hui sa place, porté par une multitude d’actions culturelles visant à le valoriser sous toutes ses formes.
Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Vers une valorisation des toiles urbaines ?
C’est dans les années 1960, aux États-Unis et plus particulièrement à Philadelphie, que le street art, d’abord appelé graffiti writing, est apparu sous l’égide de deux artistes, Cornbread et Cool Earl. En France, il est porté par Ernest Pignon-Ernest dans les années 1970 et n’explosera qu’à partir des années 1980. Depuis ses origines modestes sur les murs des quartiers marginaux, le street art a évolué pour devenir un mouvement artistique d’envergure mondiale. Se distinguant par sa nature éphémère, il transforme les espaces urbains en expressions artistiques, allant de fresques murales monumentales aux petites interventions cachées, graffitis et pochoirs. Maintenant démocratisé par des artistes phares, il reste néanmoins un art qui ne fait pas l’unanimité. Mais une profusion d’actions culturelles initiées par divers acteurs tels que des artistes, amateurs, associations, institutions culturelles, collectivités sont autant d’actes de reconnaissance. Ces initiatives visent à sensibiliser et à valoriser le street art sous de multiples formes.
Participation et inclusion
Au-delà de son aspect contemplatif, esthétique ou engagé, le street art est aussi une œuvre sociale, élaborée dans les échanges et rencontres. Les festivals et événements autour du street art se multiplient, offrant une possibilité aux artistes de créer et d’interagir directement avec le public. Des festivals de street art aux ateliers artistiques en plein air renforcent les liens sociaux et favorisent l’échange. Cette année le Street Art Fest Grenoble-Alpes, festival sensibilisant aux formes d’expression artistique urbaine telles que le graffiti, les fresques murales, les installations, et les performances en direct, lance sa 10ème édition. Transcendant le cadre d’un évènement artistique, il est porteur d’actions culturelles autour du street art dans près de dix villes partenaires favorisant la participation active des habitants. Les ateliers artistiques, les visites guidées et les conférences organisés dans le cadre du festival visent à sensibiliser le public au street art. Des projets collaboratifs et participatifs encouragent les habitants à s’approprier l’espace public et à contribuer à la création d’œuvres collectives. Ces activités permettent de mieux comprendre les techniques, les styles et les enjeux sociaux et culturels du mouvement, contribuant ainsi à changer les regards sur cet art souvent mal compris.


Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Un outil de sensibilisation, dialogue et contestation
Le street art est également devenu un outil important de sensibilisation sociale et environnementale. De nombreux artistes abordent des questions cruciales telles que les droits de l’homme, la justice sociale, ou encore la préservation de l’environnement. L’artiste et vidéaste italien Blu est connu pour ses multiples graffitis disséminés à travers le monde, notamment à Barcelone, New York, Varsovie, Londres et Rennes. Ses fresques abordent des sujets politiquement chargés, complexes et aux enjeux internationaux. Ici, une gigantesque bouche, dont les dents évoquent des immeubles, semble prête à dévorer un arbre aux feuilles verdoyantes. Cette représentation saisissante évoque le fléau de la déforestation.
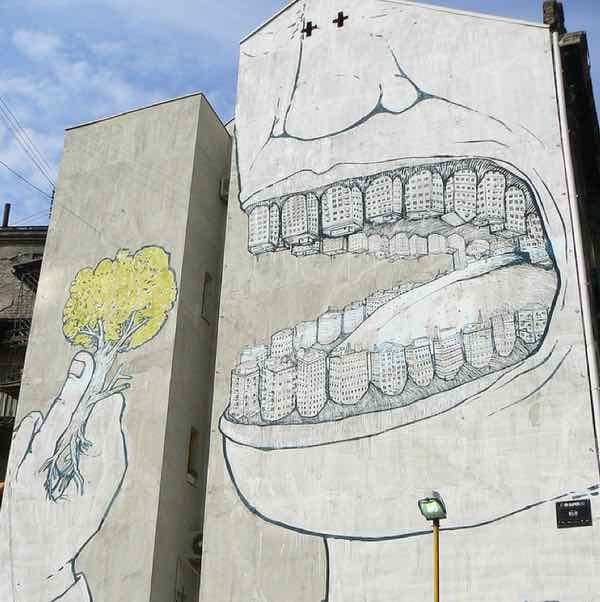
Peinture murale sur la déforestation réalisée par l’artiste Blu, en Serbie, crédits : La boite verte
Les artistes choisissent soigneusement leurs emplacements, tenant compte de l’architecture, de l’histoire locale et des dynamiques sociales. C’est le parti-pris que prend l’artiste JR en réalisant un projet artistique 28 Millimètres : Les Bosquets en 2004. Situé dans la banlieue parisienne, plus précisément à Montfermeil, Les Bosquets est un quartier marqué par les difficultés sociales et économiques. En 2006, en réaction à la stigmatisation médiatique de la jeunesse populaire, JR choisit de photographier les habitants des Bosquets, en leur demandant de se caricaturer et de se montrer sous un jour menaçant. Ce projet confronte les passants à des portraits caricaturaux des jeunes déployés vers divers quartiers de Paris, les invitant à réfléchir sur la représentation de la jeunesse des quartiers populaires. Né d'une volonté de donner une voix, JR engage ces habitants souvent marginalisés et stigmatisés dans un processus de création artistique qui démontre le potentiel du street art comme outil de collaboration et de dénonciation.
Une reconnaissance institutionnelle croissante
Face à l’engouement croissant pour le street art, de nombreuses institutions culturelles comme le Musée en Herbe avec l’exposition du graffeur Seth et le Grand Palais immersif présentant Loading. L’art urbain à l’ère numérique, reconnaissent désormais sa valeur artistique et sociale. Ce mouvement de reconnaissance témoigne de l’évolution de la perception de cette forme artistique autrefois marginalisée. En décembre 2023, le musée de l’Hospice Comtesse à Lille dédiait son exposition temporaire à l’artiste Jef Aérosol, un des pionniers du mouvement en France. Ses œuvres emblématiques furent exposées dans les salles historiques de cet ancien hospice, offrant ainsi un mélange surprenant entre l'art contemporain et le patrimoine historique. Cette exposition a attiré un large public, allant des passionnés d’art urbain aux visiteurs curieux. En présentant le travail de Jef Aérosol dans un cadre muséal, et en laissant les visiteurs investir une des cimaises de l’exposition, l’Hospice Comtesse contribue à son tour à la valorisation du street art en tant qu’expression artistique légitime. D’autres musées entièrement dédiés au street art émergent, comme le Art 42 à Paris ouvert en 2016 ou encore le Musée vivant d’Art Urbain et de Street Art à Neuf Brisach ouvert en 2018. En intégrant le street art en leur sein, les musées sensibilisent les publics plus sceptiques tout en valorisant ce mouvement soulevant généralement des questions sociales et politiques. Parallèlement, les villes collaborent de plus en plus avec les artistes pour intégrer le street art dans les projets de réhabilitation urbaine et de revitalisation des quartiers. C’est le cas de la ville de Charleville Mézières qui, en 2015, fait un appel à projet pour la création d’un parcours « art urbain » autour des poèmes d’Arthur Rimbaud. En réinvestissant les espaces vides, négligés ou abandonnés, le street art redonne vie à des murs amochés, invite les passants à redécouvrir leur ville et crée au fil des années un parcours de visite urbain, en lien avec Rimbaud, dans sa ville natale.


Vue aérienne de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Cimaise de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Des actions engagées
Les actions culturelles, événements et festivals autour du street art sont bien plus que de simples occasions de divertissement ou de contemplation artistique. Ils représentent des opérations dynamiques qui valorisent les différentes formes du street art. En favorisant la reconnaissance des artistes, ces initiatives enrichissent le paysage artistique contemporain et encouragent la diversité culturelle. De plus, en permettant aux artistes de créer directement avec le public, ces événements favorisent un échange culturel riche et stimulant, renforçant ainsi les liens sociaux et communautaires. Par leur capacité à sensibiliser aux enjeux sociaux, politiques et environnementaux, les actions culturelles deviennent également des outils de dialogue et de changement social. En encourageant l’inclusion, la créativité et l’expression individuelle, elles contribuent à façonner des sociétés plus ouvertes.
Léa Sauvage
#streetart #arturbain #actionsculturelles
Pour en savoir plus :

Le street-art s'installe à Clichy !
Entre le 19 mai et le 14 août 2021, une exposition présentait le travail du street-artist Sunset au Pavillon Vendôme, centre d’art et office du tourisme de la ville de Clichy. Le week-end du 3 et 4 juillet, l’association Co42 s’installait sur un terrain de sport municipal pour la première édition du C.A.P.S Festival, le Clichy Arty Playground Street Festival.
Regardons de plus près ces deux manifestations culturelles.
Image d'en-tête : Terrain de sport municipal, rue du 19 mars 1962 © rentingART
Post-graffiti, de la rue au musée
L’exposition Post-graffiti, de la rue au musée, s'est installée dans les salles du Pavillon Vendôme avec les toiles de l’artiste Sunset (sun7). Organisée par RentingART (société proposant la location d’expositions clé en main et l’organisation d'événements d’art contemporain) l'exposition se présente comme une rétrospective du travail de l’artiste.
Mais commençons par situer ce qu’est le post-graffiti.
Si le graffiti, c’est l’art de graffer dans la rue, le post-graffiti serait plutôt l’art de graffer pour exposer dans une institution (galerie ou musée). Une exposition de street art dans un centre d’art c’est donc exactement du post-graffiti, même si l’artiste vient d’abord du graffiti. Pour en savoir plus sur l’histoire du graffiti et son arrivée en institution .
Jonas Bournat, ou Sunset, graffe depuis les années 2000, en utilisant toujours les mots comme base de son travail. Le Pavillon Vendôme présente les trois périodes de l’artiste, à rebours. Le rez-de-chaussée expose les toiles de sa dernière série, Planosfear : des sphères formées de mots calligraphiés, la plupart dans différents tons de rouge.
A l’étage sont accrochées les portraits de personnages célèbres réalisés par Sunset depuis 2009 sous la forme de calligrammes graffés (Obama, Lady Di, Pierre Soulages...).
Ces portraits ne présentent aucun contour ou dessin, ils sont entièrement constitués de mots calligraphiés. La série est d’ailleurs appelée Calligrammes urbains, et elle est suivie des premiers travaux de l’artiste, les Abstractions urbaines. Cette dernière (ou première) série est notamment présentée à travers deux installations vidéos, dans les deux dernières salles. Une vitrine présente le matériel utilisé par Sunset, pour rappeler que s’il expose aujourd’hui dans un centre d’art, l’artiste vient avant tout du street art.

Steve, Sunset, 2015. © Maud Person
Malgré le parcours street-art de l’artiste, l’exposition est épurée, toute de blanc vêtue, ce qui rappelle les origines de RentingART, issu de l’art contemporain et des whites cubes. L’exposition est accompagnée de visites guidées et d’initiations au street art (quatre dates proposées sur la durée de l’exposition) et de rencontres avec l’artiste (deux dates proposées).
Cette ouverture vers le public est dans le même esprit que le C.A.P.S Festival, dont rentingART est partenaire.
C.A.P.S Festival, terrain de sport et hommage à l’art procédural
Si l’acronyme C.A.P.S a bien sûr un sens (Clichy Arty Playground Street Festival), c’est surtout une référence aux “caps”, le nom donné aux bouchons des bombes de peinture, auxquels on peut trouver mille usages ! La diversité des tailles de capuchons permet de varier la taille du trait, et un vieux bouchon peut par exemple servir de pochoir inversé pour créer de petits ronds.
Alors au C.A.P.S, que s’est-il passé ce week-end de juillet ?
Six artistes ont investi ce terrain de sport municipal durant la semaine précédant le festival : CharlElie Couture, Jo Di Bona, Poter, Tim Zdey et Sunset. CharlElie Couture a réalisé un long poème sur les murs et le sol du stade, alors que Jo Di Bona installait sa fresque colorée, agrémentée d’affiches à motifs noirs et blancs, sur le mur au fond du terrain. Poter et Tim Zdey décoraient le hangar accolé au terrain d’immenses motifs géométriques (colorés pour Poter, en hommage à l’artiste Sol LeWitt, et noirs et blancs pour Tim Zdey). Enfin, Sunset s’emparait du dernier mur, tout en longueur, pour réaliser sa propre fresque, mêlant les couleurs de Sol LeWitt et ses propres motifs en cercle, les Planosfear.
Si on parle autant de Sol LeWitt ici, c’est parce que le C.A.P.S Festival souhaitait lui rendre hommage par cet événement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette figure de l’art procédural des années 70, c’est par ici !
L’idée du C.A.P.S était de rapprocher le street-art des habitants, et on peut dire que cela a plutôt bien marché. Près de 1000 visiteurs sur le week-end, et la participation active des enfants et des jeunes lors de l’installation en semaine, et pendant les animations du week-end. En semaine, les enfants, curieux, venaient donner un coup de main aux artistes pour repeindre le terrain, et ils étaient présents tout le week-end pour s'entraîner au street-art sur des “murs” faits de film plastique tendu : pas la technique la plus écolo, mais particulièrement pratique et efficace.
Pendant le festival, on a vu une batucada, des dj-sets, et les animations à destination des plus jeunes illustrées juste ci-dessous (et des bières artisanales au nom du festival !).

© @caps.festival
Image vignette : Œuvres de la série Planosfear - Sunset © Maud Person
#streetart #capsfestival #expo

Les musées bruxellois ont la fièvre du samedi soir !
(Museum) Night fever, night fever
De 19h à 1h du matin, les musées profitent de cet évènement unique pour proposer aux visiteurs des animations inédites. Performances artistiques, spectacles de danse, concerts, les musées regorgent d’idées pour rassasier l’appétit des visiteurs d’un soir. Eh oui ! La Museum Night Fever, c’est l’occasion de faire venir au musée à la fois le public habituel et les petits nouveaux, curieux de vivre une nuit insolite au cœur des musées. L’évènement attire majoritairement des jeunes : 75% des visiteurs ont moins de 35 ans. Les musées font le pari de renouveler leur public en présentant un programme susceptible de raviver leur intérêt.
La nuit des musées bruxellois rassemble une grande variété de musées, cette année : Le Musée BELvue, le Musée de l’Armée, le MIMA, le Musée Juif de Belgique, la Fondation Boghossian, la Maison de l’Histoire Européenne, le Musée Wiertz … Si certains sont des habitués de l’évènement, c’est une première pour d’autres, à l’instar du Musée des Égouts ou de la KBR. Tout au long de la nuit, de jeunes artistes sont invités à investir les lieux et à faire monter la fièvre qui sommeille en vous !
We know how to do it
Les nocturnes des musées, c’est une tendance à la mode depuis les années 2000. En 1997, Berlin organise la première nuit des musées : la Lange Nacht der Museen. Le concept s’exporte ensuite dans toute l’Europe dès 2001, sous l’appellation de Printemps des musées. Non seulement les horaires sont plus larges que d’habitude, mais la MNF c’est aussi présenter aux visiteurs de nouvelles animations. C’est justement en cela qu’elle se distingue de simples nocturnes (la Ville de Bruxelles en organise d’ailleurs d’avril à juin) et s’apparente plutôt aux Nuits Blanches des musées de Paris. Cette année, le Musée BELvue a organisé des performances de slam, de pole dance et de poésie, tandis que le Musée de la BD offre des ateliers de dessin dans les salles du musée. Plus qu’une simple visite de nuit, l’idée est de mettre en valeur les collections permanentes grâce aux installations d’artistes et de découvrir le musée sous un nouveau jour (bien qu’il fasse nuit).
Gimme that (museum) night fever
Question tarif, la Museum Night Fever est accessible pour la somme de 13€ en prévente et 17€ sur place. Ce forfait permet d’accéder à l’évènement, de visiter un ou plusieurs musées participants et pourquoi pas, de danser ! Il est vrai que d’autres musées pratiquent la gratuité durant leurs nocturnes. Le forfait donnant l’accès illimité aux 29 musées, ce choix se justifie en partie bien que les horaires pourraient être étendus, afin de profiter au maximum des musées et des activités proposées. L’ASBL Brussels Museums, à l’origine du projet, déclare vouloir rendre la culture plus accessible en proposant un prix d’entrée démocratique. Cette position est néanmoins questionnable. La MNF étant essentiellement fréquentée par de jeunes travailleurs, il n’est pas certain à ce prix qu’elle touche toutes les catégories socio-économiques, tels que les étudiants, les demandeurs d’emploi...
Des navettes sont mises gratuitement à disposition des visiteurs pour qu’ils puissent se rendre d’un musée à l’autre. La moyenne du nombre de musées visités en une soirée est d’environ 3 à 4 musées, de quoi rentabiliser son entrée. Mais ce n’est pas tout ! Si vous n’avez pas eu le temps de vous rendre dans votre musée préféré, votre billet vous octroie l’entrée gratuite dans l’un des musées participants dans le mois qui suit l’évènement. Cet argument peut convaincre certains visiteurs, dont la présence est motivée par cette proposition alléchante. Toutefois il serait utile de savoir si les visiteurs sont nombreux à profiter réellement de cette offre.
There is dancin’ out there
Pour cette édition 2021, le Musée Wiertz s’associe à l’École de Cirque de Bruxelles qui se produit toutes les heures lors d’un spectacle de danse, de 19h à minuit. À l’origine, le bâtiment qui accueille le musée servait d’atelier à l’artiste. Wiertz y a peint de nombreuses toiles, dont des tableaux de grands formats. Dans leur prestation, les danseurs imitent les mouvements des personnages représentés par Wiertz, créant ainsi un dialogue avec les œuvres. Les toiles de l’artiste semblent prendre vie et sortent du tableau pour poursuivre leurs actions. Les ombres des danseurs se reflètent sur les toiles et offrent aux visiteurs une représentation poétique. Ce spectacle de danse contemporaine présente une interprétation différente des œuvres et permet aux visiteurs de les regarder autrement.

Les étudiants de l’École du Cirque de Bruxelles, Musée Wiertz. ©Marie Thérasse
Lors d’un tel évènement, les conditions ne sont pas toujours réunies pour observer attentivement les œuvres comme lors d’une visite en journée. L’obscurité rend l’exercice plus difficile et les spots utilisés pour éclairer les danseurs créent beaucoup de reflets sur les peintures. Le visiteur qui se rend au musée pour apprécier la qualité des œuvres pourrait être déçu, car ce n’est pas l’objectif premier de la soirée. Il faut donc voir la Museum Night Fever comme l’opportunité d’apporter un regard neuf sur les collections en assistant à des activités inédites.
Livin' on the music so fine
Changement de décor ! C’est une tout autre ambiance qui vous attend à la Fondation Boghossian. Construite en 1930 par l’architecte Michel Polak et restaurée entièrement en 2010 à l’initiative de la Fondation Boghossian, la Villa Empain abrite aujourd’hui un centre d’art qui met en valeur les relations entre l’Orient et l’Occident. Au rythme d’un concert de jazz, la villa Art déco s’expose au public, de nuit. Le lieu grouille de visiteurs qui déambulent dans les différentes pièces afin de profiter de l’exposition temporaire du moment : Icons. Elle raconte l’histoire des icônes, d’hier et d’aujourd’hui et remet en question leur statut. Les icônes chrétiennes côtoient les œuvres d’artistes contemporains : Wim Delvoye, Andy Warhol, Yan Pei-Ming ou encore Annette Messager. Certaines salles sont désertes, d’autres bondées, à tel point qu’il devient difficile de regarder les objets exposés. Les notes de jazz du Yellow Tones Quartet résonnent dans cet espace d’exception, à l’origine domestique. La villa retrouve sa vivacité durant quelques heures et le public se déhanche au milieu des œuvres. La contemplation des œuvres est mise de côté pour privilégier les animations. Pas complètement accessoire, elle passe néanmoins au second plan, car ce n’est pas l’objectif principal de la soirée.

Fondation Boghossian, vue arrière de la Villa Empain. ©Marie Thérasse
Makin’ it mine
Marie Thérasse
Pour aller plus loin :
-
Site internet de la Museum Night Fever : https://www.museumnightfever.be/fr/
-
Musée Wiertz : https://fine-arts-museum.be/en/museums/musee-wiertz-museum#
-
Site internet de la Villa Empain : https://www.villaempain.com/

Les tout-petits au musée d’art
Les tout-petits dérangent les visiteurs ? Mais que font-ils dans les musées ?
Entrée de l’exposition 1,2,3, Couleurs, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Ils pleurent, ils crient, ils courent puis ils rient aussi. Ce sont les tout-petits dans les musées. Nous, autres visiteurs, les entendons, tentons parfois de boucher nos oreilles en espérant que leurs parents les apaisent. Pour pouvoir profiter de notre visite. Mais pourquoi emmener son enfant au musée ? Les musées et les lieux culturels sont-ils des lieux appropriés à ces petits visiteurs ?
Qui sont les “tout-petits” ?
Les “tout-petits” sont originellement définis par la tranche d’âge de 12 à 36 mois. Dans les lieux culturels, les limites sont plus larges, elles englobent plus généralement les enfants de 0 à 6 ans. Cette tranche d'âge regroupe les petits ne sachant ni lire ni écrire, tout comme ceux qui ne savent pas encore marcher ou parler. Le parti-pris est ainsi de savoir délimiter les espaces, les activités et la médiation dédiées aux bébés et aux jeunes enfants. La médiation, bien différente pour ce public, devient un enjeu essentiel quant au fonctionnement et à la compréhension de ces espaces culturels.
Les liens entre le très jeune public et les lieux culturels ?
Le Musée en Herbe et La Cité des Sciences sont les lieux culturels précurseurs dans les propositions de programmation, de médiation et d’ateliers pour le jeune public et leurs accompagnants. A la suite de cette impulsion, les musées et lieux culturels français n’ont cessé de proposer différents dispositifs pour améliorer la visite libre des parents et des tout-petits. Le musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal, par exemple, laisse à disposition des flâneuses, des fauteuils mobiles pour déambuler avec les enfants dans les collections. Mais ces dernières années, les lieux culturels vont plus loin : ils créent des ateliers d’éveil à l’art et à la création au sein d’espaces bébés bien délimités, ils créent des visites guidées en poussettes appelées « Cosy Visite ».
Une volonté politique
Si cette programmation très jeune public grandit et se diversifie aujourd’hui, c’est en partie dû à la signature d’un nouveau protocole interministériel en 2017, entre le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Cette politique culturelle vise à développer, soutenir et accompagner l’éveil culturel et artistique de la petite enfance.
En 2019, Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille, alerte sur la détérioration des liens parents-enfants. Dans son rapport sur la Stratégie en Santé culturelle, elle aborde la nécessité d’ouvrir les politiques culturelles sur le champ de la petite enfance. La mission Marinopoulos est lancée : la mise en place de dispositifs de médiation très jeune public et des espaces dédiés aux tout-petits dans les lieux culturels.
Pourquoi ?
Le but est de familiariser l'enfant avec le musée. Lui donner les codes pour comprendre ce lieu et ainsi le rendre accessible dès le plus jeune âge. Cela permet de s'approprier le lieu qui sort du cadre quotidien et rassurant de l'enfant.
Le défi pour les musées est donc de rendre accessible la culture aux plus jeunes. L'objectif est de jouer avec ce qu'ils connaissent déjà pour appréhender de nouveaux éléments. Certains musées ou lieux culturels vont adapter des activités en jouant avec les sens : l’ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût ou s’amuser avec des objets rappelant l'environnement quotidien des jeunes enfants, tel que des hochets, des tapis d’éveils ou des jeux de construction.
C'est également l'occasion pour les musées de créer des activités entre parents et enfants. Les parents sont à la recherche d'un éveil culturel pour leur enfant tout en recherchant des activités permettant de mettre à l'aise toute la famille. Être dans ces espaces jeune public au musée permet à l’enfant et son proche d’interagir ensemble avec les œuvres. Les médiations proposées favorisent les relations entre enfants et leurs accompagnants, avec d’autres enfants, parents et professionnels de la culture. Ainsi, ils intègrent ensemble les codes du lieu pour qu'il devienne familier et entre dans le cadre quotidien de l'enfant.

Espaces manipulables d’Eltono, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Des espaces et des lieux dédiés aux enfants de 0 à 6 ans : exemple du dispositif “1, 2, 3 couleurs”
Le Palais des Beaux-Arts de Lille a ouvert en octobre 2023 un tout nouvel espace temporaire de 200 m2, accueillant de la création contemporaine, dédié aux tout-petits. Cet espace, accessible sur réservation, est gratuit pour tous, néanmoins les adultes doivent s’acquitter d’un billet d’entrée au musée. En partenariat avec le centre d'initiation de l'art Mille Formes situé à Clermont-Ferrand et le centre Pompidou, cet espace situé dans l'atrium du musée, accueille les enfants de 0 à 6 ans. Pour le Palais des Beaux-Arts de Lille : « L'art est un facteur d'inclusion pour les tout-petits et leur famille ». Autour de dispositifs de créations contemporaines, les enfants et leurs parents pourront découvrir l'art ensemble, sur réservation et gratuitement, grâce à une expérience haute en couleur et en mobilisant les sens.
Durant ce temps de découverte, deux médiatrices répartissent les enfants en deux groupes, ceux de moins de 2 ans et demi et les plus grands (ainsi que leurs accompagnateurs) pour les guider vers les différents espaces. Jeu-Minots (de Claude Como) est un espace immersif recréé à partir de matériaux laineux qui renvoie au monde végétal. Dans cet espace, l’enfant de moins de 2 ans et demi est invité à toucher, manipuler et à se rouler dans les créations textiles. Espaces manipulables de l’artiste Eltono permet aux enfants de plus de 2 ans et demi d’utiliser leurs mains et leurs corps afin d’assembler, déplacer et manipuler différentes formes selon leurs envies en jouant. “1, 2, 3 couleurs” propose également deux autres espaces : un petit atelier qui familiarise à la création artistique ; et une cabane à histoires, qui invite les enfants à imaginer à l’infini.

Jeu-Minots de Claude Como, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Des dispositifs pensés pour itinérer dans des lieux publics et ruraux
Les dispositifs des artistes Eltono avec Espaces manipulables et Jeu-Minots de Claude Como, sont loués à Mille Formes, Centre d'initiation à l’art dédié aux enfants de 0 à 6 ans, pour une durée de cinq mois. Mille Formes accueille et propose de faire itinérer les œuvres et ateliers 0 - 6 ans dans d’autres lieux - des médiathèques ou des crèches. Ces lieux d’itinérances invitent à faire le lien entre des lieux culturels et des parents parfois réticents. Grâce à cette expérience la confiance s'accroît et incite les parents à revivre eux-mêmes cette expérience dans un lieu culturel comme le musée. Au début de l’année 2023, plusieurs Stations bébés mobiles présentées à Mille Formes et au Centre Pompidou au sein de l’espace 0.2 itinéraient dans plusieurs villes du Pas-de-Calais, afin de rendre accessible ces dispositifs au très jeune public plus éloigné des musées.
À l’issue de la dynamique lancée en 2019 par Sophie Marinopoulos et pour prendre soin de la relation parent-enfant, le tout-petit obtient une place centrale dans les lieux culturels. Renforcer la relation enfant - accompagnant, éveiller la créativité et l’imaginaire, et familiariser l’enfant avec le lieu culturel, deviennent des enjeux de fidélisation. La diversité des propositions est large : ateliers d’éveil et de motricité, visites adaptées dans les collections, ou simplement espaces de jeu et d'accueil.
Léa Sauvage et Gaëlle Magdelenne
Pour aller plus loin :
- Site du Palais des Beaux-Arts de Lille :https://pba.lille.fr/Agenda/1-2-3-COULEURS2
- Article sur le blog Bébé au musée, de Elise Mathieu : Bébé au musée (formation-exposition-musee.fr)
#Action culturelle #Médiations #trèsjeunepublic
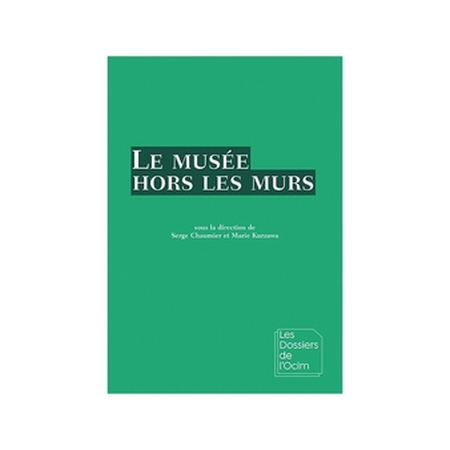
Lire Le musée hors les murs (partie 1/2)
L’impossibilité actuelle des musées d’accueillir leurs publics in situ modifie en profondeur leur offre de médiation. Le numérique, les réseaux sociaux en particulier, apparaissent comme des auxiliaires indispensables pour rendre le musée accessible au plus grand nombre. Cet état de fait conduit bien des analystes à déclarer que le musée post-confinement sera numérique ou ne sera pas1. Pourtant, dans un monde déconfiné, où le musée pourra à nouveau ouvrir à la Cité et s’ouvrir sur la Cité, la question du hors les murs dépassera largement celle des réseaux sociaux.
Un ouvrage récent intitulé Le Musée hors les murs2 explore la richesse des propositions muséales qui s’inscrivent actuellement dans ce vaste champ. Le panorama des actions hors les murs qu’il propose invite à une réflexion plus large sur le sens de l’action culturelle en milieu muséal. Comme le relève Serge Chaumier en introduction, dès les années 1970 les tenants de la nouvelle muséologie ont compris que s’extraire des murs du musée permet une réflexivité nouvelle sur l’institution muséale. Le hors les murs est ainsi envisagé dès ces débuts comme un formidable outil d’analyse institutionnel. Plus qu’une catégorie d’actions de médiation, il décrit alors davantage une philosophie qui engage un renouvellement profond des institutions muséales.
Se débarrasser des murs
Le concept s’avère un peu fourre-tout. En effet, les institutions font du hors les murs dès lors qu’elles (ap)portent du contenu hors de leurs enceintes physiques. Selon cette large définition, mallettes pédagogiques, expositions itinérantes mais aussi ressources en lignes, expositions virtuelles, plateformes collaboratives, réseaux sociaux, événements ou projets de médiations menés par le musée dans l’espace public, sont, au même titre, des formes de hors les murs.
Une telle variété se laisse difficilement appréhender comme un tout cohérent. C’est pourquoi, nous proposons de resserrer l’analyse aux projets culturels (co)initiés et/ou (co)menés par un musée à destination d’individus, sur un territoire donné. Nous excluons donc de notre champ d’observation le monde virtuel, qui nous semble appeler une analyse spécifique. Nous éviterons aussi l’emploi du mot public qui n’a pas grand sens dans le cadre d’actions hors les murs dont l’objectif est souvent précisément de s’adresser à des « non-publics » du musée. À partir de la question de « à qui l’on s’adresse » émerge une série d’oppositions « dans les murs » / « hors les murs », qui permet, en creux, de préciser la notion :
|
Action de médiation dans les murs |
Action de médiation hors les murs |
|
|
Individus concernés en priorité |
Visiteur·euses / public scolaire |
Exclu·es (parfois désignés par euphémisme comme « publics éloignés » ou « public du champ social ») |
|
Moyens matériels à disposition |
Objets / collections |
Pas (ou peu) d’objets / pas (ou peu) de collections |
|
Moyens financiers alloués |
Peu de moyens < fonctionnement sur le budget alloué au Service des publics |
Plus de moyens < recours plus évident à des financements extérieurs |
|
Moyens humains mobilisés |
Internes essentiellement |
Partenaires multiples dans les champs éducatif, social, culturel, artistique |
|
Forme de gouvernance |
Interne à l’institution |
Gouvernance partagée (comité de pilotage) |
|
Objectif général de la médiation |
Transmettre une connaissance |
Favoriser le dialogue, créer du lien social |
|
Forme de l’action de médiation |
Forme classique, qui ont fait leurs preuves |
Recherche de formes nouvelles, expérimentation |
|
Evaluation de l’action de médiation |
Rare |
Plus fréquente |
Ce tableau, dressé à la lecture de la vingtaine de contributions qui composent l’ouvrage mériterait quelques nuances. Beaucoup de professionnel·les n’envisagent pas le hors les murs dans une comparaison termes à termes avec le « dans les murs ». Il existe néanmoins une vraie difficulté à se passer complètement de cet horizon de référence géographique.
Pourtant, ce qui est en jeu dans le hors les murs est moins le fait de sortir le musée à l’extérieur que de trouver la bonne distance de l’institution à son territoire et aux individus qui la composent. Actions de médiations « hors les murs » et « dans les murs » peuvent donc être considérées comme plus complémentaires qu’opposées. Dans cette perspective, les murs du musée et ses collections deviennent des outils, des moyens d’action permettant à l’institution d’exercer son rôle social et culturel auprès des habitant·es d’un territoire.
Le hors les murs pour repenser le musée du 21e siècle
Pour exprimer toutes leurs potentialités, les actions de médiation hors les murs doivent s’inscrire dans un écosystème muséal favorable, ayant engagé une réflexion approfondie sur ses objectifs et les moyens financiers et humains engagés pour y parvenir.
Des objectifs
Les objectifs des contributeur·trices de cet ouvrage lorsqu’ils engagent des actions hors les murs peuvent être rassemblés en trois grandes catégories : objectifs de fréquentation, objectifs de communication et objectifs qualitatifs.
L’objectif de fréquentation se décline sous au moins deux formes : fidélisation et prospection. Pour les musées fermés, il s’agit de maintenir du lien avec un public déjà identifié. Dans d’autres cas, le but recherché est à l’inverse de s’adresser à des exclu·es du musée que l’on espère voir, à terme, passer les portes de l’institution. Soumis à l’une ou l’autre de ces finalités, le hors les murs n’est pas valable en soi, comme expérience de médiation d’un genre nouveau, mais comme un moyen d’abonder la relation traditionnelle de médiation qui se joue dans les murs du musée. Cette conception instrumentale du hors les murs explique que certaines institutions le réservent à des périodes de fermeture. Le musée de La Poste a ainsi mené, pendant les cinq années qu’ont duré son chantier de rénovation, une ambitieuse politique des publics hors les murs, développant, entre autre, une offre d’ateliers à destination des scolaires. Ces ateliers rencontrent un franc succès, notamment auprès des enseignants de maternelle qui apprécient « le confort de s’éviter la logistique lourde des transports en commun parisiens » (p.44). Le musée abandonne néanmoins ces ateliers à l’approche de la réouverture du musée, comme s’ils n’avaient plus lieu d’être au moment où le cadre normal de la médiation muséal devenait à nouveau disponible. Ce cadre n’est pas que celui des murs du musée, il est aussi le cadre conceptuel idéalisé de la médiation définie comme une rencontre entre un·e médiateur·trice et des publics-visiteur·euses. Dans cette perspective, le but premier de l’action hors les murs devient alors la transformation d’individus en publics d’une action de médiation puis en visiteurs autonomes du musée. C’est d’ailleurs l’objectif affiché de la nouvelle offre hors les murs développée par le musée de La Poste à destination des médiathèques et bibliothèques : « transformer les publics touchés dans ces structures en futurs visiteurs de musée » (p. 44). Si ce projet fait sens du point de vue d’institutions en mal de fréquentation, on est en droit de se demander quels sont bénéfices de cette transformation pour les individus concernés ? Que gagnent-ils à cette élévation ou réduction au rang de visiteurs ? Il y a là un impensé problématique.

Petit Cabinet de curiosités à la Mairie d'Ailly sur Noye, avril 2018 © Anne Megan - Musée de Picardie
Au contraire de l’exemple préalablement développé, d’autres musées choisissent de pérenniser leurs actions hors les murs. C’est le cas du Muséum de Bordeaux, qui poursuivra, au-delà de sa réouverture, l’exploitation de son dispositif itinérant Le Muséum chez vous. Ce dispositif aura vocation à proposer des ateliers de découverte scientifique aux « publics éloignés » (spatialement, physiquement et culturellement) mais aussi « [à] constituer pour les autres une accroche destinée à faire connaître le musée et à inciter à la visite. » (p.60). Dans la même logique, le cabinet de curiosités itinérant du musée de Picardie poursuivra, après la réouverture du musée, ses pérégrinations dans les établissements scolaires et hospitaliers d’Amiens métropole et de sa périphérie (p.154). Mais, constatant l’attractivité de ce mode de présentation de ses collections, l’institution a également installé un cabinet de curiosités permanent à l’intérieur de ces murs. Ces exemples divers témoignent donc que la visite dans les murs reste perçue comme le mode d’expérience à la fois caractéristique et supérieur, voire indépassable, du musée.
D’autres contributeur·trices évoquent un objectif en termes de communication. Investir des espaces extérieurs au musée permettrait d’assurer sa visibilité alors qu’il est fermé ; le dégager de son enveloppe physique étendrait sa notoriété sur un territoire défini. Or, le hors les murs pousse souvent les musées à sortir de leur répertoire d’actions habituel : l’écomusée de Margeride organise des ateliers de tricot dans un centre social (pp. 94-95), le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel monte un jeu de piste à l’échelle de la ville (p. 84 à 90) quand le Musée des beaux-arts de Quimper co-produit des œuvres de street art sur les murs du quartier Penhars (p. 143 à 153). Par ailleurs, ces projets impliquent souvent de nombreux partenaires extérieurs. Dans ces conditions, les publics-acteurs, n’associent pas spontanément un musée aux actions culturelles auxquelles ils prennent part. L’efficacité du hors les murs comme outil de communication est donc à relativiser. Le hors les murs peut en revanche assurer une certaine reconnaissance institutionnelle à la structure qui le porte. « Le Musée sort de ses murs », label du ministère de la culture créé en 2018, récompense les structures porteuses de projets innovants3. Le prix « Osez le musée ! », participe également de cette reconnaissance symbolique du ministère, motivante pour les institutions et leurs autorités de tutelle. Raphaëlle Julien, chargée de mission à l’écomusée de Margeride, lauréat du prix en 2017, souligne : « cette distinction met en lumière l’engagement des élus communautaires et de l’équipe de la structure, dans une politique volontariste et novatrice en faveur du lien social et des échanges intergénérationnels » (p. 88). Cette reconnaissance est surtout gage de pérennisation de la dynamique participative engagée par le musée pour la conception de son exposition temporaire annuelle (p. 97).
Au-delà de ces objectifs comptables, chaque structure se donne bien entendu des objectifs qualitatifs, plus difficilement mesurables. Certaines structures choisissent d’utiliser la culture comme un outil de socialisation ; l’objectif affiché est alors moins de transmettre un contenu que de créer du lien en se servant des ressources du musée. Les projets participatifs menés en 2016 et 2017 par l’écomusée de Margeride ont ainsi avant tout vocation à combattre l’isolement social des seniors dans un territoire rural pauvre où ils sont particulièrement exposés à toutes formes de précarité (économique, relationnelle, culturelle). D’autres institutions se donnent un objectif plus classique de « médiation de la culture » soit de transmission du savoir attaché à un patrimoine. Le hors les murs implique cependant de repenser le rapport aux objets de collection. Dégagés de leurs écrins muséaux, ces derniers deviennent secondaires par rapport aux discours qu’ils soutiennent ou aux échanges qu’ils motivent. Cette désacralisation du rapport à l’objet autorise les recours massifs aux reproductions. La création de pédagothèques – « collection à vocation pédagogique » (p.79) – ouvre le champ des possibles. Celle du Muséum du Havre permettra la création « d’ateliers de dégagement de fossile, de tri de microfossiles, la préparation de lames minces de géologie » (p.78). À terme, un service de prêts des collections de la pédagothèque permettra aux particuliers d’emprunter ces objets et d’en inventer de nouveaux usages.

Dans la pédagothèque du Muséum d’histoire naturelle du Havre, tous les spécimens sont rangés en bacs, mis en sachets et inventoriés © Nicolas Bansaye, Museum d’histoire naturelle du Havre
Ces deux objectifs, médiation par la culture et médiation de la culture ne s’excluent nullement l’un l’autre. Certaines institutions ont su les combiner de manière particulièrement pertinente. Le dispositif « Le Louvre à jouer » est à cet égard exemplaire. À première vue, ce jeu de rôle qui met les enfants dans la peau de divers professionnel·les de musées a davantage vocation à leur inculquer un savoir-être qu’un savoir théorique sur les métiers du musée. Pourtant, force est de constater qu’au cours du jeu, les enfants acquièrent, sans même s’en rendre compte, un vocabulaire muséal très spécifique.
Une partie de « Louvre à jouer » à l’accueil de loisir Eric Tabarly, Aulnay-sous-Bois Animation, août 2017 © Musée du Louvre
L’exemple du « Louvre à jouer » témoigne également du fait que les musées n’ont pas que des connaissances à partager : les professionnels qui y travaillent détiennent des savoir-faire qui peuvent également faire l’objet d’une transmission. Le projet « Marins à l’ancre » mené au Port-Musée de Douarnenez entre 2016 et 2018 avait ainsi vocation à former des volontaires à l’enquête ethnographique, à la prise de son et au traitement sonore des archives afin de travailler deux thématiques mal connues de l’équipe scientifique du musée. Cette démarche de recherche-action inclusive s’ancre dans une conviction de l’équipe du musée : « au-delà d’être un lieu de consommation culturelle, [le musée] se positionne comme un lieu d’éducation populaire donnant la possibilité aux aspirations légitimes de certains citoyens à travailler sur l’interprétation de leur territoire, à être associé à la construction d’un discours, de représentations » (p.110).
C.R
#horslesmurs
#actionculturelle
#engagement
1 Cela a été affirmé, par exemple, lors du webinaire « Coronavirus and museums : impact, innovations and planning for post-crisis » coorganisé par l’ICOM et l’OCDE. On peut en lire un compte rendu ici.
2Serge Chaumier, Marie Kursawa, Le Musée hors les murs, Les dossiers de l’Ocim, Editions universitaires de Dijon, Saint-Apollinaire, 2019. Les numéros de pages indiqués en corps de texte font systématiquement référence à cet ouvrage.
3https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Culture-et-territoires/Plan-Culture-pres-de-chez-vous/Label-Le-Musee-sort-de-ses-murs/Appel-a-projet-Le-musee-sort-de-ses-murs-2019
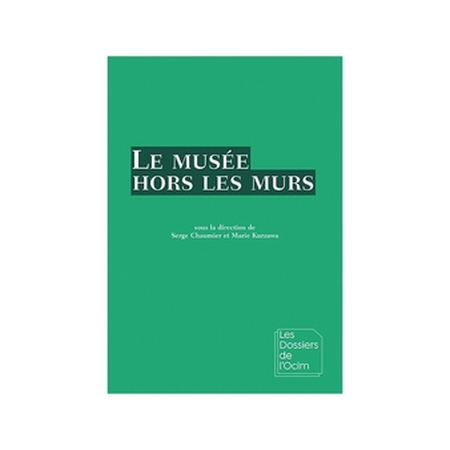
Lire Le musée hors les murs (partie 2/2)
Le hors les murs pour repenser le musée du 21e siècle (suite)
Des moyens
Si le hors les murs implique une réflexion sur les objectifs de l’action culturelle en milieu muséal, il exige aussi de repenser les moyens d’actions dont disposent les musées. Ces moyens sont d’abord financiers. Aujourd’hui, les structures publiques sont largement dépendantes des financements garantis par leurs autorités de tutelle. Ces financements sont limités et les services des publics sont rarement les mieux servis lors de la répartition du budget en interne. Aussi, pour mener des actions de médiation sur le long terme, incluant divers prestataires extérieurs, une recherche de financements supplémentaires est souvent nécessaire. La majorité des dix-neuf contributions rassemblées dans cet ouvrage mentionne ainsi la réponse à des appels à projet portés par différentes collectivités territoriales. Le projet « Marins à l’Ancre », déjà évoqué ci-dessus, a été en partie financé dans le cadre d’un appel à projets de la région Bretagne sur les « héritages littoraux ». Le musée des Beaux-Arts de Quimper a financé le projet « Pen’eyes » (p. 143 à 153) en l’élaborant en conformité avec les critères d’attribution du label « Le musée sort de ses murs » du ministère de la Culture et ceux du Projet éducatif local de la ville de Quimper.
Outres les moyens financiers, le hors les murs nécessite des moyens humains conséquents. Lorsqu’ils investissent de nouveaux territoires ou s’adressent à des populations qui ne font pas partie des visiteur·euses traditionnel·les, les médiateur·trices s’entourent de partenaires. Leur statut et leur rôle est éminemment variable d’un projet à l’autre. Dans certains cas, celui de « Marins à l’Ancre » par exemple, la gouvernance du projet est complètement déléguée à un prestataire extérieur - en l’occurrence l’association Emglev Bro Douarnenez. Plus souvent, les partenaires associatifs ou institutionnels co-élaborent et co-pilotent le projet. Néanmoins le rôle du·de la médiateur·trice du musée reste crucial : « [ille] est au centre de l’organisation du hors les murs » rappelle Hakima Benabderrahmane, responsable du service Politique des publics du Musée de la Poste (p.36). Les médiations innovantes dont il est question dans cet ouvrage nécessitent un fort investissement des personnels du musée qui apprennent à apprivoiser un nouvel environnement de travail et de nouveaux interlocuteur·trices. Ces apprentissages peuvent à terme constituer une vraie ressource pour les institutions qui les emploient. À condition bien sûr, que les médiateur·trices qui en sont dépositaires n’occupent pas un statut précaire qui conduise à un turn-over important du personnel. Le Musée de l’École rurale de Trégarvan a remarquablement su contourner cet écueil. En 2015, le musée engage une volontaire en service civique qui participe à ses projets de médiation culturelle. Cette volontaire se montre particulièrement intéressée par le public des personnes âgées dépendantes. Après son volontariat, elle effectue plusieurs stages en EPHAD pour mieux connaître cette population et acquérir des compétences en animation. En 2017, elle est embauchée au Musée comme médiatrice dans le cadre d’un contrat aidé, pérennisé par la suite en CDI. Ce recrutement permet au Musée de l’École rurale de mettre en place une véritable stratégie de développement centré sur ce public très spécifique. Il développe notamment une offre d’ateliers hors les murs proposé à tous les établissements situés dans un rayon de 50 kilomètres autour du musée (p. 63/64).
A l’instar du musée de Trévargan, bien des structures sont conscientes de l’importance de disposer, en interne, d’un service des publics solide. Elles développent pour cela des stratégies diverses. Le Muséum du Havre a opté pour une transformation des postes d’agents de surveillance en agents d’accueil et de médiation afin de développer ateliers et « visites flash » dans les murs du musée (p.71). Le Pôle Musée de la ville de Strasbourg a hérité d’un service éducatif et culturel municipal pionnier dans les années 1970. Il est aujourd’hui composé d’une équipe permanente de 18 personnes « dont 11 chargés de médiation qui fonctionnent par binôme ou par trinôme sur les projets » (p.114). À l’inverse, le Musée dauphinois, quand il dresse le bilan de son « Muséobus olympique », constate que son principal écueil réside dans les moyens humains mis à disposition ; une seule médiatrice devant assurer, pendant trois mois, itinérance et animation du bus, dans des conditions matérielles difficiles (p. 242).
Au-delà d’une nécessaire consolidation des services de médiation, le hors les murs incite à repenser en profondeur la gouvernance des institutions. Une longue tradition muséologique, entérinée par la « loi musée » de 2002, fait des musées des lieux de conservation avant d’être des lieux de partage. Cela induit, dans l’organisation interne des structures, une préséance des services dédiés à la conservation sur ceux dédiés à la médiation. Ajoutons que ces services fonctionnent souvent en vases clos, services des publics et services des collections ayant peu souvent l’occasion de travailler à des projets communs. La proposition du hors les murs n’est pas de renverser la hiérarchie de ces services mais de penser une nouvelle forme de gouvernance, plus communautaire. L’élaboration d’un cabinet de curiosités itinérant a ainsi été l’occasion pour le musée de Picardie d’instaurer une nouvelle dynamique en interne : « ce projet a été très fédérateur pour l’équipe du musée. Ainsi, un dialogue riche s’est noué entre les conservateurs, la régie des collections, les enseignants-relais et l’équipe de médiation mais aussi avec l’unité sécurité, les services administratifs et techniques. » (p.156).

Atelier « Feu » au Préhistomuseum de Ramioul, décembre 2018 © Art de Muser
L’exemple le plus abouti de cette réorganisation interne est sans conteste celui du Préhistomuseum, musée et parc d’aventure de la préhistoire1 situé à Flémalle, près de Liège en Belgique (p. 205 à 214). Pendant une période de fermeture de l’institution, de 2012 à 2016, l’équipe s’est attelée à la redéfinition du « projet scientifique, culturel et sociétal du musée » (p.206). Parallèlement, l’institution a élargi le champ des services proposés dans le cadre de ses actions hors les murs : au-delà des activités de médiation, le Préhistomuseum a proposé des services de fouilles et de conservation préventive. Ces activités ont progressivement conduit l'institution à « ne plus [se] définir uniquement pour les fonctions-missions muséales mais bien par ces fonctions et ce dans une perspective de bénéfice social et sociétal » (p. 207). Grâce à une analyse approfondie du territoire, de ses acteurs et de leurs besoins une typologie « d’usages et d’usagers de services hors les murs » a été établie par l’équipe. La diversité des services proposés - des animations/visites animées au conseil en gestion de projet - et des usagers de ces services a rapidement nécessité une organisation interne plus souple, plus flexible. En 2017, le Préhistomuseum a donc radicalement changé son mode de gouvernance pour expérimenter l’holacratie, système anti-pyramidale qui dissémine la prise de décision en cercles-départements largement autonomes. Chaque cercle a sa raison d’être qui est au service d’une « raison d’être » commune, de l’objectif global de l’institution. Le Préhistomuseum semble avoir exploité jusqu’au bout le potentiel du hors les murs, outil de réinvention du musée dans son rapport à un écosystème et à lui-même.
Quels bénéfices ?
Au terme de cette réflexion, quels bénéfices escompter de l’adoption du hors les murs comme démarche de repositionnement radical des institutions ? Cet ouvrage témoigne de résultats multiples, infiniment variables selon les situations. Malgré tout, quelques traits récurrents peuvent être dégagés.
Déjà, un mieux être humain à différentes échelles : celle du musée mais aussi celle du territoire-d’action de celui-ci. Pour autant, la philosophie du hors les murs n’exclut pas l’échec, le résultat en demi-teinte, le conflit. Les œuvres d’artistes contemporains installées par le musée Gassendi dans la réserve géologique de Haute-Provence sont parfois mal reçues par une partie de la population locale, l’incompréhension poussant parfois à la dégradation (p. 172). Cette hostilité a poussé le musée à repenser la communication des démarches artistiques qu’il impulse. Après l’expérimentations de plusieurs formules, il est apparu que la rencontre directe des locaux avec l’artiste constitue l’espace de dialogue et de conciliation le plus efficace. Ces actions de sensibilisation sont parfois à l’origine de nouveaux projets artistiques : la création Sentier Marcel est ainsi le fruit du dialogue qui s’est instauré entre l’artiste Till Roeskens et le berger Marcel Second.

Till Roeskens, Sentier Marcel,coll. Musée Gassendi. L’œuvre consiste en l’installation de stèles narrant la vie du berger Marcel Segond, le long de sentiers qu’il emprunta toute sa vie © CAIRN centre d’art
Sans doute faut-il conclure de cet exemple que tout projet de médiation hors les murs a pour résultat premier de produire une rencontre qui ne se serait pas opérée dans le cadre traditionnel de la médiation muséale. Les résultats en demi-teinte de l’action conduite par le musée Gassendi soulignent aussi, en creux, la nécessité impérative d’évaluer les projets de hors les murs, dans leur déroulé, pour pouvoir espérer maximiser leur impact positif. Il s’agit également de mesurer, rétrospectivement, la conformité des actions mises en place avec les objectifs initiaux.
Un autre bénéfice de ces expérimentations de terrain, identifié à plusieurs reprises dans les contributions de cet ouvrage, est celui de la montée en compétence du personnel du musée, mieux outillé pour se réinventer et être en prise avec les défis du présent. Le véhicule de médiation du Muséum de Bordeaux initié à la fin des années 1990 a ainsi vu son usage changer et se développer selon les contraintes propres au musée (fermeture du Museum pour rénovation entre 2009 et 2019) ou les sollicitations extérieures (proposer des ateliers pour les temps périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires). Comme le souligne Raphaëlle Julien, le développement du hors les murs permet et impose à la fois de « garder une réactivité face aux évolutions de la société » (p.97).
Ce dont témoigne, in fine, cet ouvrage c’est que le musée du 21e siècle a le potentiel de devenir plus qu’un simple espace d’exposition. Afin de se mettre pleinement au service de la société et de son développement, il peut se faire référent scientifique, animateur territorial, éducateur populaire, etc. Cela, en s’inscrivant dans un écosystème local et/ou en prenant part à un maillage culturel et scientifique plus large. Loin d’être un simple jeu d’aller-retour entre le dedans et le dehors, le centre et la périphérie, le hors les murs devient alors un engagement citoyen et humaniste : contribuer, dans la mesure de ses moyens, à construire une société plus juste, plus fraternelle, plus responsable. Avec le passé dans le rétroviseur, le futur en ligne de mire et le présent comme terrain d’action.
C.R
#horslesmurs
#actionculturelle
#engagement
1 Le site de 30 hectares regroupe un espace muséal, un restaurant et un « parc d’aventure » où diverses activités de découvertes de la préhistoire sont proposées, y compris une visite de la Grotte de Ramioul située dans l’enceinte du Préhistomuseum.

Main dans la main
Benoît Jouan au LAM anime ici un atelier particulier qui fait se recontrer les enfants et leurs parents autour de la création.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Amaury Vanet
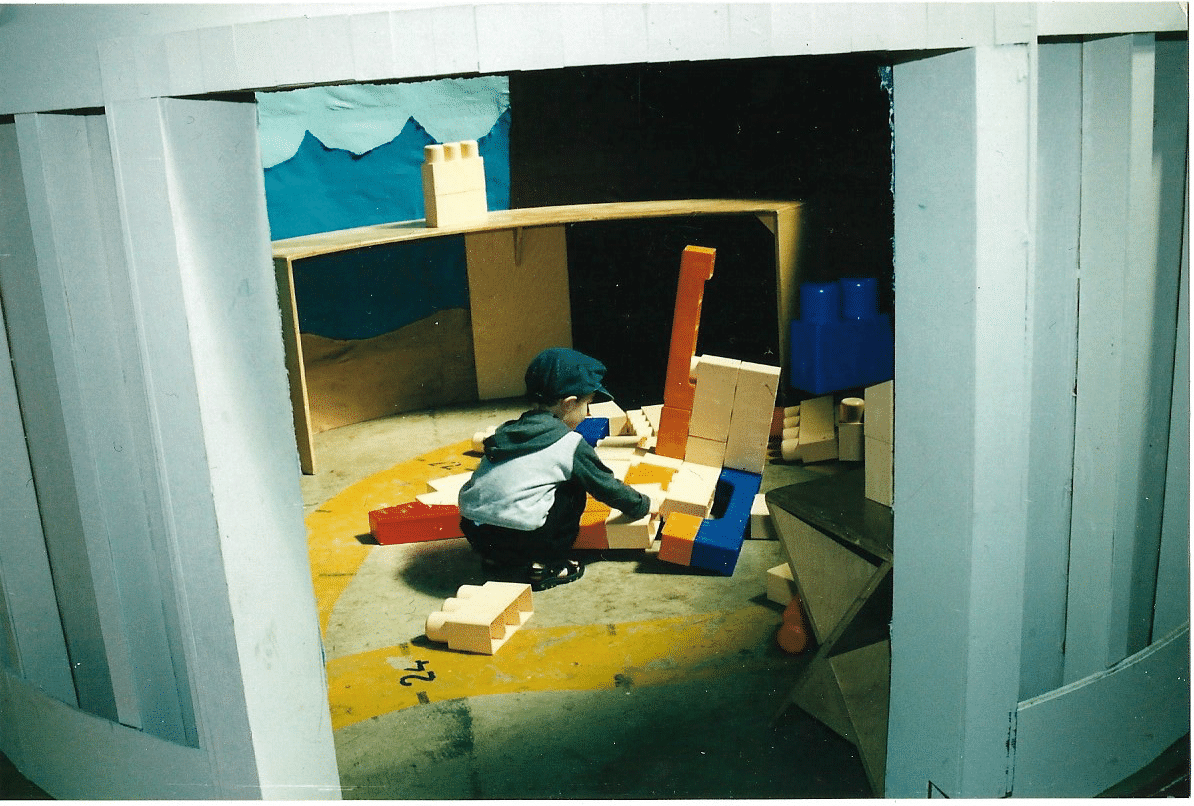
Mais où est notre âme d'enfant ?
Un musée qui nous appartient.
“Ne pas toucher”
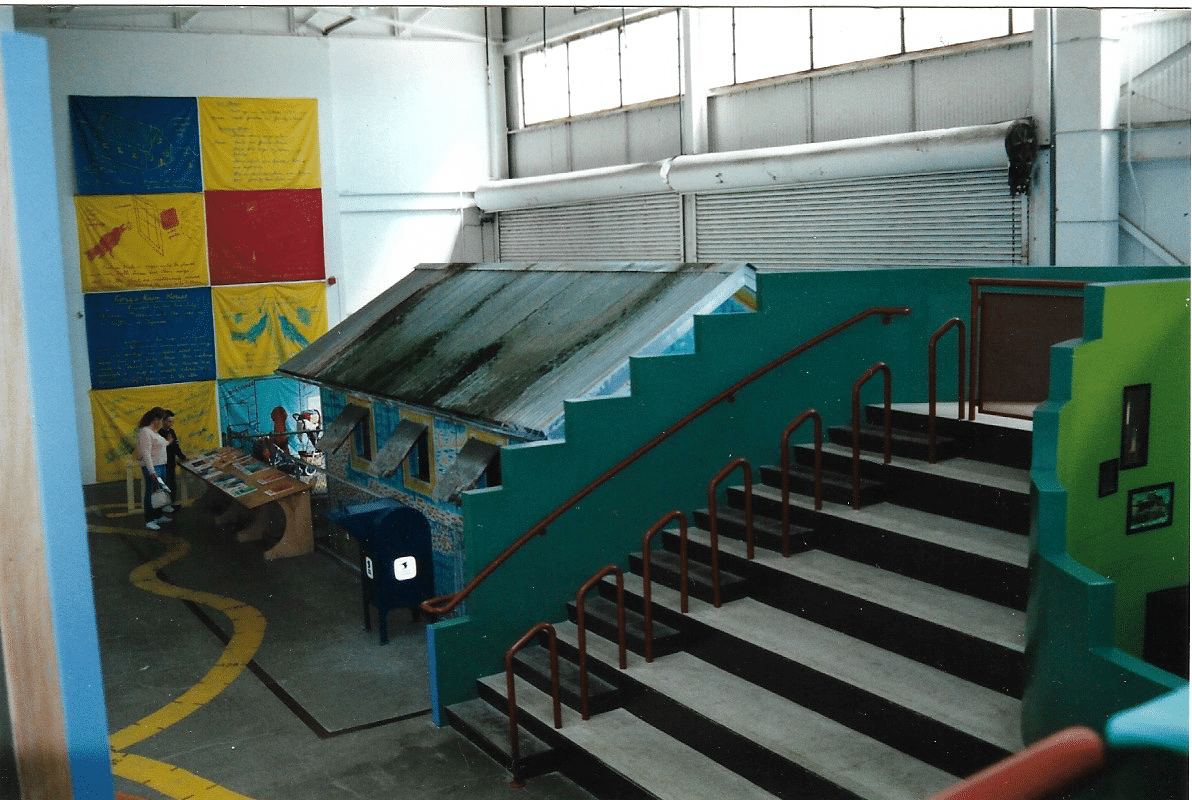
The Rain House par l’artiste Ernest Silva installé en 1993 © A. Savarino
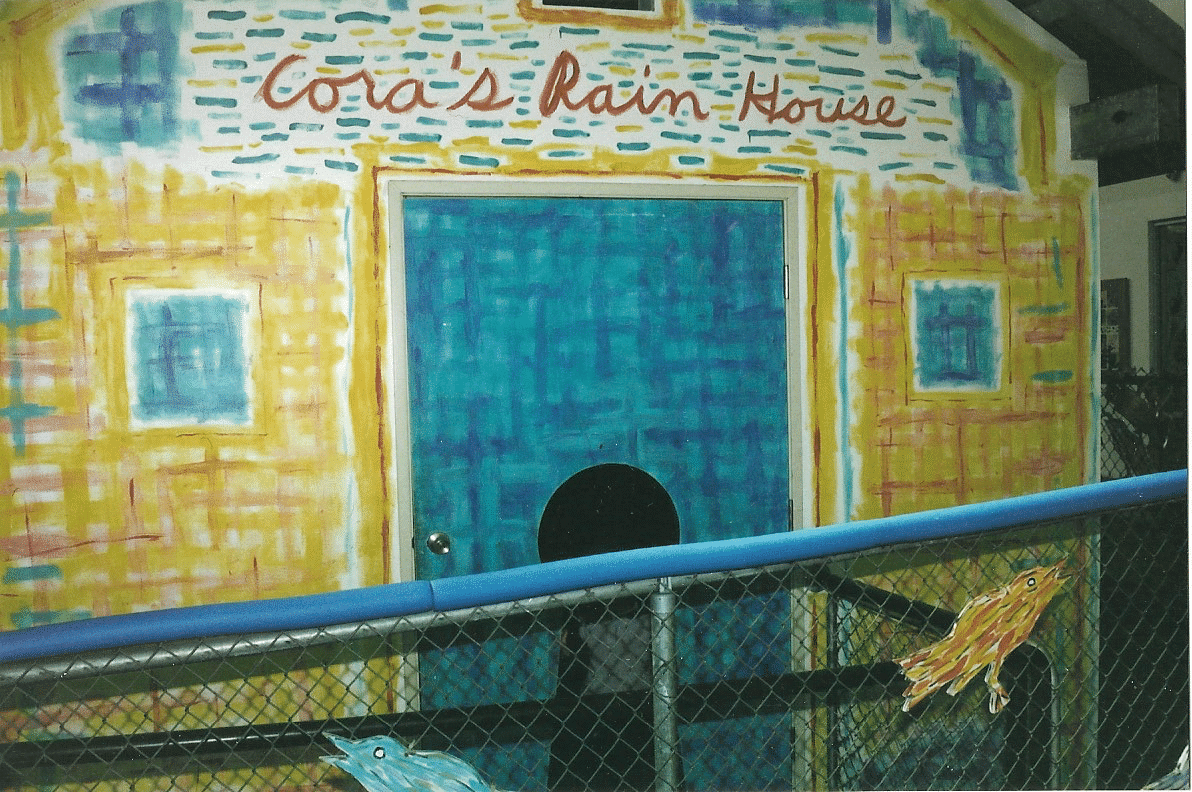
L’entrée pour les plus petits de la maison de la pluie, intitulé « Cora’s Rain House » © A. Savarino
Une Question d'échelle
Je ressens toujours que l’apprentissage est scolaire ou élitiste dans les musées français : Regarde, écoute, sois attentif mais ne touche surtout pas ! Tout cela me parait un peu “rabat-joie”. Le Musée en Herbe, encore à Paris, est une belle initiative, mais il reste conçu comme un musée d’art. Des œuvres sont accrochées aux murs, certes plus bas, mais toujours avec une délimitation et une sacralisation des pièces. Ce type de musée me semble important pour comprendre les codes de l’art, mais, est-ce le monde des adultes qui doit être ramené à l’échelle des enfants ou alors le monde des enfants qui doit être “mis en musée” pour eux ? Certes il est important d’observer, mais il me semble qu’on apprend mieux et qu’on retient mieux en vivant, en expérimentant, bref, dans le “faire” et ce d’autant plus chez l’enfant.
Du jeu et de l'immersion
Par ailleurs, la devise du San Diego Children’s Museum est « think, play, create » (cad. « pense, joue, crée »). L’importance du jeu et de l’épanouissement de l’enfant sont la clé dans les pays anglo-saxons. Mais comment ne pas tomber dans la création d’un parc d'attractions ? En fait, c’est l’exposition d’œuvres artistiques qui incitent autant à la contemplation qu’à l’amusement. L’accent est mis sur l'immersion et sur le ressenti. Les expositions immersives sont une tendance actuelle dans les musées à cible familiale, cependant, avec une touche plus “instagrammable” que participatives. L'accent est mis sur la qualité photographique et partageable à travers les réseaux sociaux. (ex. L’atelier des lumières…)
Des enfants glissant à travers le « Krohnoscope » crée par l’artiste Lisa Krohn © A. Savarino
D’autres formes d’apprentissage existent.
Je suis très intéressée par les systèmes d’éducation type Montessori qui remettent en question l’éducation descendante et compétitive, l’éducation classique. Certes, cette dernière qui prévaut, a fait ses preuves, mais dans un monde à son image. Il serait peut-être temps de privilégier de réelles alternatives éducatives pour faire émerger la créativité des enfants, favoriser leur imagination et le partage des connaissances et du patrimoine.
Le Children’s Museum de San Diego a été rénové en 2008 pour laisser place au New Children’s Museum. Le mot "nouveau" signifiant que le musée s'est concentré sur la commande d'artistes contemporains pour créer des installations artistiques à grande échelle pour que les enfants puissent s'y intéresser et les explorer. Leur modèle de musée pour enfants a pour mission de stimuler l'imagination, la créativité et l'esprit critique des enfants et des familles par le biais d'expériences inventives et engageantes autour de l'art contemporain.
Il existe plusieurs musées des enfants pour découvrir l’art aux États-Unis (le premier datant de 1899 à Brooklyn), à Bruxelles (création en 1978) et d'autres dans le monde. À quand un musée des enfants en France ?
Vue sur l’intérieur du musée et des dispositifs que les enfants peuvent manipuler librement © A. Savarino
Aphélie Savarino
#Enfants #Children’sMuseum #Education
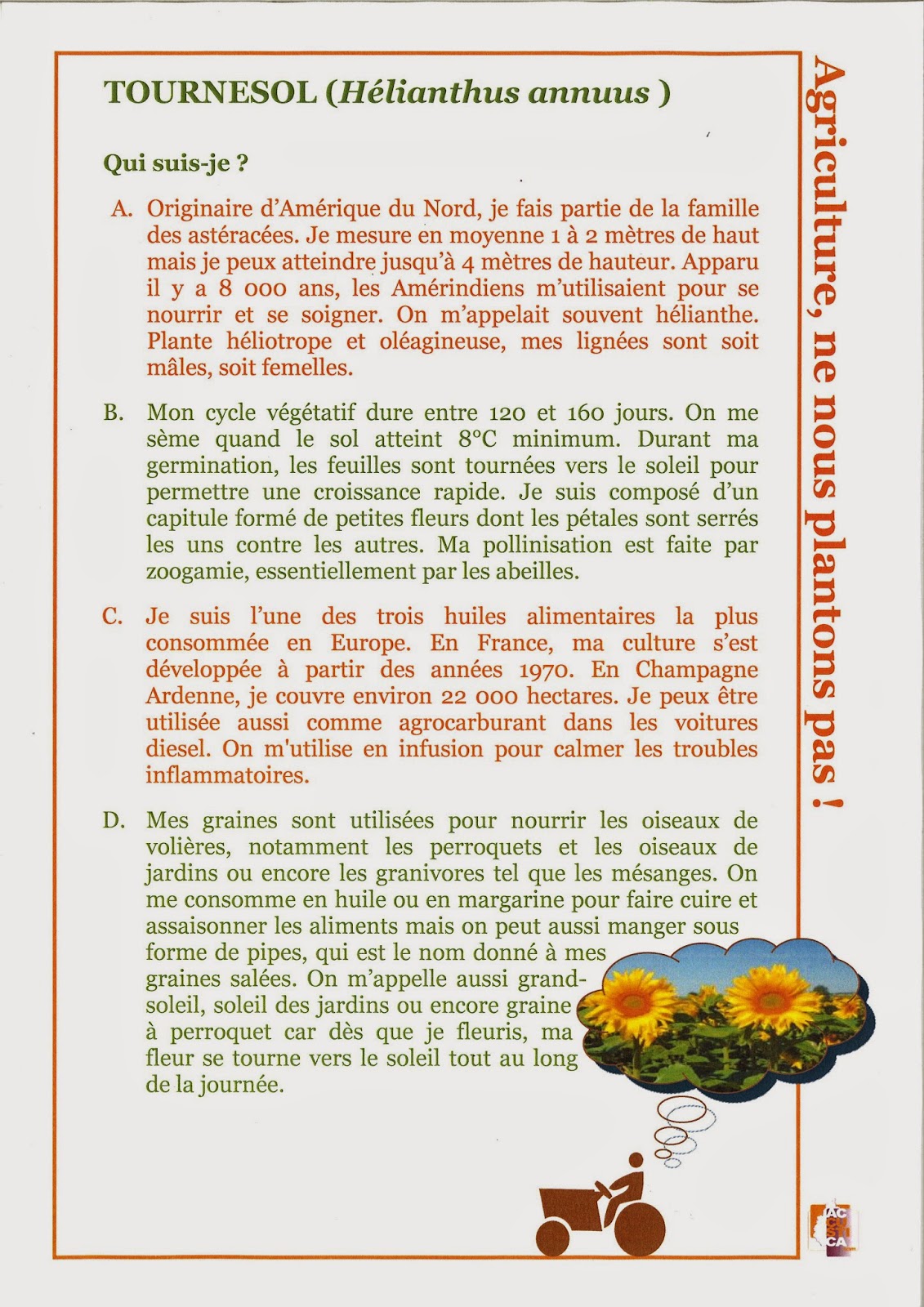
Mallette pédagogique, brève de stage
En première année du Master Expographie Muséographie, j’ai effectué mon stage à Accustica à Reims en tant que chargée de mission pour la création d’une mallette pédagogique sur l’agriculture. Il a fallu concevoir le contenu, penser les objectifs des outils, prévoir leurs formes et leur faisabilité mais aussi acheter le matériel en lien avec la malle ainsi que des livres et des jeux pouvant l’accompagner. Il s’agit de donner les clés à l’emprunteur de la malle pour qu’il comprenne l’agriculture.
Accustica, un CCSTI, une association
Créée en 2005, l'association Accustica est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Elle vise à promouvoir la culture scientifique en Champagne-Ardenne.Elle fut aussi nommée Pôle Territorial de Référence (PTR) en 2012 par le préfetde Région et le Président du Conseil régional. Par cette nomination, l'associationdoit animer le réseau régional des CSTI dans le respect de la diversité locale,proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives et inscrire lapolitique d'action culturelle régionale dans un projet global national pilotépar Universcience.
Les missions d'Accustica
- Rendre accessible au plus grand nombre les Sciences et les Techniques : enfants des écoles primaires, collégiens, lycéens, étudiants du supérieur et grand public.
- Favoriser la création et la diffusion d'outils de médiation et d'expositions itinérantes pour les professionnels et les amateurs de science.
- Mettre en place de nombreuses actions avec l'ensemble de ses partenaires, comme par exemple la Fête de la Science, organiser des conférences scientifiques et des visites d'industries ainsi qu'organiser des rencontres entre scientifiques et grand public (cafés des sciences, spectacles, portes ouvertes, Exposciences, Classes en Fac).
- Mettre en œuvre une politique globale de culture scientifique et technique en région Champagne-Ardenne en créant un réseau qui regroupe tous les acteurs locaux de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (industriels, laboratoires de recherche publics et privés, collectivités territoriales, milieux éducatifs, monde culturel et associatif,...), pour permettre une meilleure diffusion de cette culture scientifique, technique et industrielle sur l'ensemble du territoire régional.
Ma mission de chargée de médiation
J’avais pour mission de créer une Malle Doc sur le thème de l’agriculture, intitulée :« Agriculture, ne nous plantons pas ! ». Elle est composée de cinq outils pédagogiques. L’un des outils représentatifs de cette mallette, le « Qui suis-je » est un jeu qui consiste à deviner le nom d'une plante par le biais d'une courte biographie, d'une vingtaine de lignes, énoncée par l'animateur. Celle-ci commence toujours par des indices difficiles, puis de plus en plus faciles, de telle sorte que s'il est en général difficile de donner la réponse au début, tout le monde est susceptible de trouver la réponse à la fin de l'énoncé. Le candidat gagne de 4 points à 1 point selon la rapidité de sa réponse. Les habitués de Question pour un champion connaissent le principe…
Je vous propose de tester une énigme :
Qui suis-je ?
A. Originaire d’Amérique du Nord, je fais partie de la famille des astéracées. Je mesure en moyenne 1 à 2 mètres de haut mais je peux atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur. Apparu il y a 8 000 ans, les Amérindiens m’utilisaient pour se nourrir et se soigner. On m’appelait souvent hélianthe. Plante héliotrope et oléagineuse, mes lignées sont soit mâles, soit femelles.
B. Mon cycle végétatif dure entre 120 et 160 jours. On me sème quand le sol atteint 8°C minimum. Durant ma germination, les feuilles sont tournées vers le soleil pour permettre une croissance rapide. Je suis composé d’un capitule formé de petites fleurs dont les pétales sont serrés les uns contre les autres. Ma pollinisation est faite par zoogamie, essentiellement par les abeilles.
C. Je suis l’une des trois huiles alimentaires la plus consommée en Europe. En France, ma culture s’est développée à partir des années 1970. En Champagne Ardenne, je couvre environ 22000 hectares. Je peux être utilisée aussi comme agrocarburant dans les voitures diesel. On m'utilise aussi en infusion pour calmer les troubles inflammatoires.
D. Mes graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux de volières, notamment les perroquets et les oiseaux de jardins ou encore les granivores tels que les mésanges. On me consomme en huile ou en margarine pour faire cuire et assaisonner les aliments mais on peut aussi me manger sous forme de pipes, qui est le nom donné à mes graines salées. On m’appelle aussi grand-soleil, soleil des jardins ou encore graine à perroquet car dès que je fleuris, ma fleur se tourne vers le soleil tout au long de la journée.
La conception d’un outil pédagogique n’est pas facile : le contenant comme le contenu, à la fois ludique et pédagogique, donneront-ils envie d'utiliser l'outil et de comprendre le message que fait passer cette activité ? Tel est le défi.
Avez-vous trouvé ?
Si non, j’espère que vous avez appris des informations sur cette plante.
Si oui, bravo vous devez être un as de l’agriculture, j’espère que vous avez appréciéles explications pour la conception d’outils pédagogiques simples.
Voici la réponse :
L'une des fiches du jeu "Qui suis-je ?" - © Ludivine Perard
Ludivine Perard
#science
# brève de stage
# mallette pédagogique
Pour aller plus loin :

Manger au muser
La plupart du temps lorsqu’on mange au musée c’est à l’extérieur des expositions, dans des espaces spécifiques. De très nombreux musées disposent d’un restaurant ou d’une cafétéria dont les produits sont la plupart du temps sans rapport avec les expositions. En revanche certains musées essayent de lier les deux, le repas devenant une prolongation de la visite. C’est le cas du musée de la Piscine à Roubaix ou du LAM à Villeneuve d’Ascq: le musée et l’exploitant du restaurant se sont mis d’accord pour accorder la carte aux expositions temporaires, ou du moins à baptiser les plats en accord avec le propos. Le menu proposé à l’occasion de l’exposition sur Chagall en 2015-2016 à La Piscine est un bon exemple : plusieurs plats d’origine russes étaient proposés et d’autres nommés d’après des œuvres de l’artiste, telle que la salade caesar rebaptisée La fiancée au visage bleu.
Le Préhistomuseum près de Liège (Belgique) va encore plus loin, puisqu’il applique le principe de ses expositions à son restaurant. Tout comme dans les expositions où le visiteur est amené à comprendre la préhistoire et l’archéologie par les expérimentations, à “l’archéorestaurant” le visiteur est invité à remonter le temps en goûtant des plats de différentes époques (de l’antiquité à l’époque moderne). Les recettes ont fait l’objet d’une recherche scientifique de la part d’un spécialiste, l’historien cuisinier Pierre Leclercq.

Photographie issue de l’affiche de l’archéorestaurant © Préhistomuséum
L’Alimentarium de Vevey (Suisse) est confronté à une problématique encore différente, puisqu’il a pour thème l’alimentation. Le restaurant du musée a donc une place particulièrement importante puisqu’il permet d’associer expérience muséale et pratique culinaire. Avant la rénovation de 2016, un lien fort existait entre les deux puisque les visiteurs devaient aller chercher leur repas à la cuisine qui se situait dans l’exposition. Cette cuisine était une sorte de grande vitrine vivante, où les visiteurs pouvaient observer la préparation de repas qu’ils pouvaient ensuite manger s’ils le souhaitaient. Muséographie de l’alimentation et repas forment ainsi un tout et les messages sont transmis sur différents modes. Le musée a été totalement réorganisé depuis, mais les visiteurs peuvent toujours voir la préparation de leurs repas, au moment de choisir leurs plats.
Cuisiner, une action culturelle
L’Alimentarium souhaite que les expositions, démonstrations, repas et activités participent d’une même expérience globale. En effet des activités sont également proposées, principalement des ateliers culinaires et des visites guidées du musée et du jardin. La majorité de ses offres s’adressent aux enfants, le public de l’Alimentarium étant très familial. Au-delà de simple cours de cuisine, il s’agit aussi d’explorer l’alimentation par les cinq sens et de développer leurs capacités gustatives.
C’est aussi ce que souhaite développer Cap Science à Bordeaux avec son “Labo Miam”, un atelier où les enfants sont amenés à découvrir les principes scientifiques qui sous-tendent la cuisine. La préparation des aliments devient une véritable expérience scientifique. En avril et mai 2018 le thème est celui du changement de couleur à la cuisson : des cookies bicolores et du caramel sont réalisés.

Une des expériences proposées par le “Labo Miam” de Cap Sciences © Cap Sciences/ANAKA
Déguster
Une autre forme de mise en pratique, plus classique est la dégustation en fin d’exposition, pour des raisons pratiques. Dans les établissements accueillant du public les réglementations sont très strictes en ce qui concerne l’alimentation ce qui peut freiner la proposition d’une consommation sur place.
C’est d’autant plus complexe pour certains types d’aliments porteurs de problématiques spécifiques tel que l’alcool, or il existe de très nombreux musées dédiés aux boissons en France. Pour les musées de France particulièrement mettre en place une dégustation d’alcool est compliqué, une des solutions peut être la délégation à un service privé mais cela ne règle pas les questions d’ordre social et éthique. Le Musée du vin de Beaune a donc fait le choix de ne pas en proposer sauf occasions exceptionnelles (Journées du Patrimoine, Nuit des Musées…) conscient que si les visiteurs souhaitent goûter les vins, ils trouveront sans problème d’autres occasions en ville.
A contrario la Cité du Vin de Bordeaux même si elle sépare clairement les espaces d’expositions et de dégustations mise beaucoup sur ces dernières. N’étant pas un musée de France et dépendant d’une fondation, elle est de fait libérée de nombreuses contraintes.
Bethsabée Goudal
#Alimentation
#Ateliersculinaires
Dégustations
Déguster

Manifeste ORLAN. CORPS et SCULPTURES : accompagner un public enfant dans une exposition d’art contemporain
Les Abattoirs de Toulouse présente jusqu’en août 2022 une exposition manifeste consacrée à l’artiste française ORLAN. L’exposition propose un parcours de textes spécialement écrits pour les enfants. Qu’est-ce que cela implique pour la médiation de l’exposition ?
image d'introduction : Vue de la nef © M.B
Depuis le début de sa carrière dans les années 1960, ORLAN s’est emparée de nombreux medium : peinture, sculpture, photographie, robotique et bien sûr performance. Conçue en collaboration avec l’artiste, l’exposition présente son œuvre sous l’angle de la sculpture. Engagée dans l’art féministe et l’art charnel qu’elle a elle-même théorisé, son corps est au centre de son œuvre et de sa réflexion.
Au fil d’un accrochage de photographies et de la présentation de sculptures et autres objets, l’exposition revient sur plusieurs performances marquantes de ORLAN, des MesuRAGEs à ces célèbres chirurgies esthétiques en passant par le Baiser de l’artiste lors de la FIAC 1977.
Quelques vidéos sont présentes dans les salles, mais l’essentiel du discours est délivré dans les textes présents dans chacune des 8 salles du parcours. Dans certaines salles, aux côtés des textes principaux, des textes sont spécialement destinés aux enfants. Comment l’exposition s’est-t-elle rendue accessible à un jeune public ?
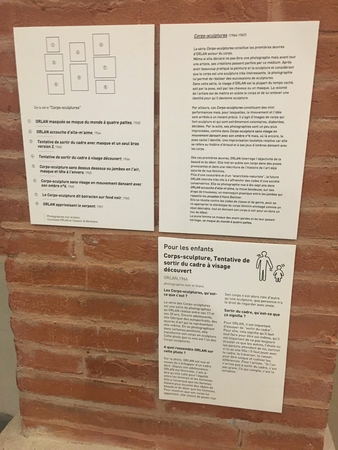
Le texte de salle principal accompagné du texte de salle pour enfants dans la nef © M.B
Le poids des mots, le choc des images
Envisager la visite du public enfant demande de s’interroger sur ce qu’il y a à voir et à dire, et si c’est adapté pour ce public.
Les œuvres et performances d’ORLAN sollicitent une conscience des problèmes sociétaux, des inégalités et des déterminismes mis en place depuis des siècles. Son œuvre est profondément engagée et politique. Elle aborde le féminisme, le racisme, la religion, les injonctions et stéréotypes de genre, les critères de beauté... ORLAN invite à réfléchir et à déconstruire les clichés et les codes ancrés dans la société, pour que chacun.e s’en émancipe.
Prenons en exemple les performances et détournements d’ORLAN au sujet de l’histoire de l’art. Pour apprécier pleinement le geste d’ORLAN, il faut un certain nombre de prérequis : connaitre les tableaux qu’elle détourne (ici Botticelli, Ingres ou Courbet en l’occurrence) ; avoir conscience de l’idéalisation et de la sexualisation projetées sur le corps féminin dans la peinture occidentale ; mais aussi de l’absence des femmes artistes dans l’histoire de l’art. Avec tous ces éléments en tête, le geste d’ORLAN de réinvestir tableaux et musées pour attirer l’attention sur la place des femmes (qu’elles soient modèles ou artistes) prend plus de sens et permet plus de réflexions.
Suivant le même principe, les performances chirurgicales pratiquées depuis 1990, plus spectaculaires, mobilisent également différents concepts. Ces opérations visent à interroger les normes et les diktats de beauté, qui touchent en particulier les femmes, la banalisation de la chirurgie esthétique ou encore le regard, voire le jugement que nous portons sur l’apparence d’autrui.
La présentation de l’œuvre d’ORLAN requiert donc une médiation importante pour donner aux publics toutes les clés de compréhension nécessaires.
Au-delà des mots, la forme même des œuvres présentées entre en jeu dans l’accessibilité de l’exposition pour les enfants. De par les thèmes travaillés par ORLAN, certaines œuvres ne sont pas des images qu’on montre spontanément à des enfants. De la nudité, du sang ou un visage tuméfié par les opérations chirurgicales, de telles images peuvent choquer les plus jeunes. Cela dépend évidemment de la sensibilité de chacun et de ce que les parents acceptent de montrer ou non à leurs enfants, mais l’impact visuel de certaines œuvres doit être pris en compte.

Vue de la salle « Musée ORLAN » © M.B
Rien à cacher !
Le musée a choisi de ne pas limiter la visite des plus jeunes. Ce sont les parents qui décideront de ce qu’ils montrent ou non à leur enfant, mais, théoriquement, rien ne leur est caché.
Seule la salle « Performances chirurgicales » est précédée d’un panneau avertissant les âmes sensibles que le contenu de la salle pourrait les heurter. Pour autant, il y a un texte dédié aux enfants dans cette salle, preuve que rien dans cette exposition ne leur est interdit d’accès.
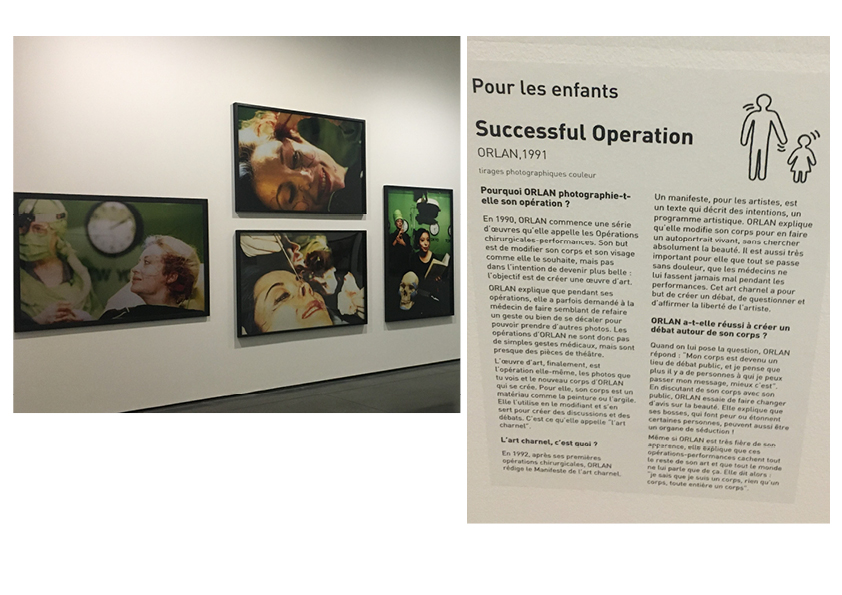
Vue de la salle « Performances chirurgicales » et son texte pour les enfants © M.B
Les textes « Pour les enfants »
Le musée a mis à disposition du public enfant des textes de salle spécialement adaptés à leur âge. Signalés par la formule « Pour les enfants » et par des pictogrammes représentant un enfant accompagné d’un adulte, ils donnent soit un contenu général sur une salle entière, soit une explication d’une œuvre précise, à la manière d’un cartel détaillé.
Ils fonctionnent avec un système de questions-réponses. Deux ou trois questions sont posées pour interpeler le lecteur et introduire la médiation sur l’œuvre et le message transmis par ORLAN. Les textes sont écrits avec des règles proches du FALC et tutoient le lecteur, pour installer un discours plus impersonnel et accessible.
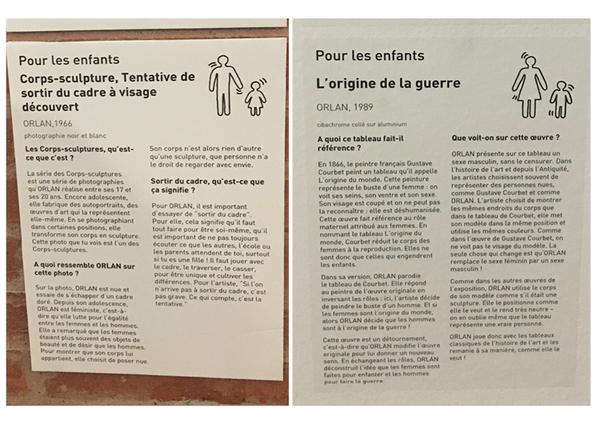
Textes pour les enfants sur les photographies Corps-sculptures et L’Origine de la guerre © M.B
Mais qu’en est-il du fond ? Nous avons évoqué plus haut que la médiation de l’œuvre de ORLAN supposait une compréhension, ou au moins une sensibilisation à divers concepts politiques, sociologiques voire philosophiques. Les textes pour enfants n’ont pas fait l’impasse sur cette médiation. Des notions telles que le féminisme, les critères de beauté, les diktats religieux, les stéréotypes de genre sont abordés. Les termes sont simples et l’explication va à l’essentiel, mais les enfants ont ainsi une base pour comprendre le travail de ORLAN. Ces explications sont certes simplifiées par rapport à la réalité de la situation, mais c’est suffisant pour sensibiliser un public jeune à l’art engagé de ORLAN à des problématiques sociétales contemporaines, auxquelles ils seront confrontés dans un futur plus ou moins proche.
Pour autant, cette initiative pèche par manque d’attractivité pour les enfants. La forme et le graphisme ne sont pas particulièrement attirants pour un jeune public. La lecture de ces textes n’encourage pas à l’interactivité et ne permet pas de dynamiser la visite, alors qu’un jeune public tire plus profit de sa visite quand il en est acteur par des activités diverses. Mais le musée propose également pendant les vacances des ateliers pour les enfants (ciblé 6 – 10 ans, probablement une tranche d’âge similaire à celle attendue dans l’exposition) pour explorer l’aspect sculptural et performatif de son œuvre.
De par leur proximité avec le texte classique, on peut cependant penser que ces textes serviront de base pour les familles pour visiter ensemble l’exposition, chacun ayant un niveau de lecture adapté à son âge. Les questions peuvent aussi servir à engager le dialogue entre les enfants et leurs parents. Le texte pour enfant permet également aux parents de s’en inspirer pour expliquer eux-mêmes le contenu si leur enfant ne veut ou ne peut pas lire. Le pictogramme semble aller dans ce sens. Il représente un parent et son enfant, invitant à une lecture du texte en famille, plutôt qu’à une activité en autonomie de l’enfant.
En dépit d’œuvres qui peuvent être difficiles d’accès par les problématiques qu’elles soulèvent, les Abattoirs proposent une médiation claire et facile d’accès pour les enfants, sans faire l’impasse sur des notions politiques et engagées, preuve que tous les sujets peuvent être expliqués, même aux plus jeunes.
Myrrha Bouly
Pour aller plus loin
-
Amandine Duclos, Franck Philippeaux et Marie-Sylvie Poli, « De l’utilité du « texte enfant » au musée », Lettre de l’OCIM, n° 132, 2010, pp 28 – 33.
-
Audrey Van Dorpe et Lucie Scamps, « Des livrets pour accompagner les enfants dans les musées », Lettre de l’OCIM, n° 120, 2008, pp 4 – 10.
#exposition #artcontemporain #médiationpourenfants

Médi’Actions, l’association des médiateurs culturels des Hauts-de-France
Après plusieurs mois de préparation, la première association des médiateurs culturels des Hauts-de-France voit le jour : une association pour les spécialistes des publics !
Bureau de l'association Médi'Actions © Médi'Actions
Que nous soyons issu(e)s de la Fonction Publique ou dans le secteur privé, en contrat à durée indéterminée, en vacation ou temps partiels, étudiant(e)s voire en recherche emploi, nous sommes tous médiateurs, médiatrices culturels et membres de la nouvelle association des médiateurs culturels des Hauts-de-France : Médi’Actions.
Le 9 janvier 2018 s’est tenue la première réunion de préparation du projet à l’initiative de Thomas Boucknooghe. Après un tour de table des présentations, la variété de nos structures, nos contrats et nos vécus annoncent l’expérience riche et prometteuse. Il est important de signaler que nous ne sommes pas là au nom de nos institutions mais en tant qu’individu pratiquant la médiation sous toutes ses formes. Il est néanmoins possible pour les musées, associations ou centres culturels d’adhérer à l’association en tant que membres institutionnels.
Lors de cette rencontre, il a été question de savoir qu’elle pourrait être la raison d’être de cette association. Il existe déjà une association des médiateurs à l’échelle nationale : Médiation culturelle, aux missions et enjeux similaires. Nous avons eu alors le choix de devenir une antenne de celle-ci ou de créer un nouveau projet. Après réflexions et discussions avec des membres de Médiation culturelle, nous avons décidé de lancer Médi’Actions, une association s’adressant aux médiateurs de la région Hauts-de-France.
Un premier bureau s’est alors constitué : Thomas Boucknooghe, le président ; Émilie Boucknooghe, Aurore Delaby et Lucie Taverne, vices présidentes aux différentes spécialités (partenariats, relations extérieures ou communication) ; Marieke Rollandi, trésorière ; Julien Rousseau et Adeline Offelman, secrétaire et secrétaire adjointe. Ensemble, nous avons alors réfléchi aux missions et statuts que souhaite défendre cette association en devenir. Trois actions possibles ont émergé entre les membres du bureau et lors d’une réunion ouverte aux futurs ou potentiels adhérents.
Les publics, d’abord !
La première mission de Médi’Actions est de faire reconnaître et promouvoir la médiation culturelle, ses conditions, ses missions et ses pratiques. Il est alors essentiel de préciser quels domaines placer derrière l’adjectif « culturelle ». C’est en ce sens que nous souhaitons reprendre les termes de la Déclaration des Droits Culturels (Fribourg, 2007) où le mot « culture » est compris dans son acceptation la plus large : « le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement ». En effet, l’association a pour objectif de s’adresser aux médiateurs quel que soit leur champ d’activité : les Arts, l’Histoire, la Science, la Nature, la Sociologie, l’Ethnologie… Nous défendons le fait qu’un médiateur n’est pas un spécialiste d’une thématique ou d’une question, il est un spécialiste des publics.
Une mise en réseau
Seconde mission : l’association a pour objet de créer et d’étendre un réseau de pratiquants à l’échelle des Hauts-de-France afin de faciliter l’échange d’expériences. Le choix est fait ici de ne pas mentionner à nouveau le terme de « médiateur » car aujourd’hui encore dans la profession, tous ne sont pas d’accord sur la signification de ce mot. Certains vont se considérer comme des animateurs ou des guides. C’est pour cette raison que Médi’Actions défend et s’intéresse aux pratiques liées à ces différents métiers dont les expériences sont communes.
Des actions à venir
Enfin, le troisième but a pour but de faciliter et d’organiser des actions sous différentes formes afin d’offrir aux membres des outils pratiques et de réflexion ; à l’image des pratiques utilisées dans la médiation.
Une attention toute particulière a été accordée à l’écriture de ces statuts. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser le terme de « professionnel ». En effet, tous les médiateurs et médiatrices ne sont pas a fortiori des professionnels, autrement dit certains n’ont pas la chance ou la possibilité d’exercer dans un cadre professionnel. Ainsi, Médi’Actions s’adresse à tous et aussi aux bénévoles qui participent à la vie des structures.
L’associatoin a été publiée au Journal Officiel le 16 juin 2018. Si vous souhaitez plus d’informations ou devenir membre de Média’Actions, n’hésitez pas à envoyer un mail à
Et n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook : Médiateurs culturels des Hauts-de-France / Média’Actions pour suivre notre actualité.
Lucie Taverne
#médiation
#association
#hautsdefrance

Médias(i)on
Emilie Wadelle est créatrice sonore, technicienne du son et formatrice en radio. Passionnée de sciences, d’art, de montagne et de médiation, elle réalise et produit des contenus sonores pour la scène culturelle grenobloise avec le souhait de travailler bientôt plus largement dans le monde francophone. Avec elle, nous discutons des potentialités du média sonore dans et hors les murs de nos institutions culturelles.
Emilie Wadelle en fieldrecording, Jardin de Ville de Grenoble, juin 2020 © Esther Kouadio
-
Émilie, vous avez fait vos armes à Radio Campus Grenoble, avant de vous lancer, il y a un peu plus d’un an, dans un projet d’auto-entrepreneuriat baptisé Skadi & Co. Pourquoi ? Quels étaient alors vos objectifs ?
Skadi c’est un personnage de la mythologie scandinave, en lien avec la montagne, la neige, un milieu qui me parle et dont je suis originaire. En novembre 2018, c’est le pseudonyme que je choisis pour le site Internet sur lequel je diffuse mes créations sonores. Je ne voulais pas utiliser mon nom personnel pour qu’on ne puisse pas associer mes propres productions à celles de radio Campus Grenoble, où je travaillais comme coordinatrice et formatrice pour les nouveaux bénévoles. J’occupais alors un emploi tremplin et je commençais à réfléchir à l’opportunité de me lancer dans une aventure plus personnelle : devenir documentariste pour développer mes propres contenus, sur diverses thématiques : la montagne, les sciences, la société...
Mais dans le monde des producteurs indépendants de médias, il faut cumuler plusieurs activités dans les premières années. J’ai eu la chance d’être recrutée en 2019 pour intervenir dans le master Diffusion de la culture, puis par le service Culture et culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes, pour former des adultes en radio, enfin par l’école de Courchevel, pour animer des ateliers pour enfants. À partir de septembre 2020, j’interviendrai dans le master Communication et Culture scientifique, dirigé par Mikaël Chambru, pour une initiation au podcast
La formation permet d’avoir un socle d’activité. Ensuite, j’espère avoir le temps de fabriquer beaucoup plus de contenus, toujours de manière indépendante, pour pouvoir travailler avec de multiples acteur·trices, de la radio associative à des chaînes nationales francophones. Mais cela ne veut pas dire pour autant que j’abandonnerai la formation parce que j’adore ça !
-
Vous utilisez la radio et le podcast comme instruments de vulgarisation scientifique. En quoi le son vous parait-il un bon outil de médiation scientifique ?
C’est même le meilleur ! D’abord, c’est un média immersif, qui laisse une place incroyable à l’imagination. Parce que c’est un média très complet où on utilise autant la voix de son inteviewé·e, que la sienne, que l’ambiance, que des sons d’archives…
Ensuite c’est un média qui n’est pas cher à produire : il n’y a qu’à comparer le coup d’un bon micro avec celui d’une bonne caméra ! Et il permet une expression par tout un chacun : pour « faire du son » un enregistreur à 90€ ou une micro-formation à un matériel un peu plus complexe suffisent.
Et puis, le son a un aspect thérapeutique. Quand j’étais à la coordination de radio campus, nous avons organisé un atelier pour des personnes en situation de handicap. À partir du moment où nous les avons installées en studio et qu’elles ont pu parler au micro, quelque chose a changé dans leur perception d’elles-mêmes, un truc s’est passé !
-
C’est aussi une forme d’empowerment le son alors ?
C’est complètement ça ! Et c’est aussi pour cela que je suis très attachée à mon activité de formatrice : transmettre, éduquer aux médias et surtout proposer à tout un chacun de produire des contenus citoyens et participatifs, c’est très important pour moi. La formation, ça permet aussi de rester humble, d’être au contact du public. On ne peut pas être journaliste, proposer des contenus pour tous, si on ne va pas à la rencontre des gens. Cela ne correspond pas à l’idée que je me fais de ma profession.
-
Parmi vos réalisations, on peut citer Echos de Sciences, un podcast scientifique bimestrielle édité par la Casemate, le CCSTI de Grenoble. Comment cette collaboration est-elle née et comment ce projet s’est-il structuré ?
Tout a commencé par une rencontre avec Pascal Mouttet [chef de projet web et responsable du média lab de la Casemate, ndlr] et Marion Sabourdy [chargée des nouveaux médias à la Casemate et responsable éditoriale d’Echosciences Grenoble, ndlr] lors de la remise du prix Diderot 2018. J’en assurais l’animation et le projet, Echosciences, qu’illes portaient pour la Casemate [le centre de culture scientifique de Grenoble, ndlr] a été lauréat à cette occasion. Illes m’ont recontactée quelques mois plus tard car illes étaient intéressé·es par le podcast. Ensuite je leur ai proposé plusieurs formes jusqu’à arriver à la structuration actuelle de l’émission
Dans la première moitié de l’émission, il y a un entretien de 15 minutes avec un·e chercheur·euse grenoblois·e, autour d’une thématique particulière, souvent d’actualité. Quand je mène ces interviews, je pense toujours à ma grand-mère : je n’en ai rien à faire de passer pour une imbécile, je fais répéter les scientifiques jusqu’à ce que j’estime qu’elle pourrait comprendre leur discours ! Je les laisse utiliser tous les termes techniques qu’illes veulent mais cette technicité, il faut l’expliquer. Les gens ne sont pas stupides : transmettre des sujets complexes c’est une question de médiation, de communication et d’information. D’ailleurs, pour ces entretiens, on a un partenariat avec radio Campus France. Ainsi, des formats plus longs, entre vingt et quarante minutes sont proposés à France culture conférences. Pour moi, c’est important que les gens qui aient envie d’aller plus loin puissent le faire.
Ensuite, il y a toujours une chronique biographique sur une femme scientifique - et une autre autour d’une notion scientifique. Puis une création sonore parce que le son ce n’est pas que de l’information, c’est aussi des choses qui dérangent, qui grattent, qui rendent heureux, qui posent question, qui touchent à l’imaginaire. Et pour finir, une rubrique sur l’actualité scientifique, du territoire mais pas seulement : on promeut aussi des contenus numériques, accessibles de partout.
-
Comment se déroule la réalisation ? Qui choisit les sujets abordés et les invité·es ?
La Casemate me délègue la réalisation et la production. En revanche, nous co-construisons la ligne éditoriale. La thématique générale est choisie par la Casemate, qui prend également contact avec les différents invité.e.s. Pour la création sonore comme pour la rubrique « femme scientifique », je suis très libre. Pour la rubrique « ça va arriver près de chez vous » la Casemate est force de propositions et je les suis.
-
Vous avez également collaboré avec l’INRAP ou encore la cinémathèque de Grenoble.
Les acteur·trices du secteur culturel sont-ils aujourd’hui particulièrement demandeur·euses de production sonore ?
J’ai l’impression que tous les acteur·trices du secteur culturel ne sont pas sensibilisé·es au podcast et à l’utilisation du son : c’est un média très récent et on a peu de recul sur le retour sur investissement. Contrairement aux vidéastes, nous, créateur·trices sonores, on ne va pas venir nous chercher. Il faut que nous allions vers ces acteur·trices et que nous les convainquions. Pour la Casemate, c’est un peu différent, il y avait un antécédent : le centre de Toulouse, le Quai des Savoirs, avait déjà un podcast que connaissait la Casemate.
Mais bien souvent, les podcasts des institutions culturelles sont « faits maison » par des salarié·es de ces structures qui aiment le podcast, qui en voient l’intérêt, mais qui manquent de budget ou d’écoute de leur hiérarchie.
-
Les acteur·trices du secteur culturel font-illes aussi appel à vos services de formation en podcast ?
Ce n’est pas encore arrivé mais c’est à moi de les démarcher. Souvent illes produisent de très beaux documentaires dont la qualité sonore est mauvaise. C’est là-dessus que je peux me positionner car à l’avenir, l’augmentation des écoutes se jouera sur ce critère. Il y a tellement de podcasts aujourd’hui ! L’offre va finir par se structurer autour de cet enjeu déterminant de la qualité sonore.
-
Savez-vous si le public des institutions pour lesquelles vous travaillez est réceptif aux contenus que vous produisez ?
Je n’ai pas vraiment de retour mis à part ceux de l’équipe de la Casemate ou de la Cinémathèque. Là, on a assez vite compris que le format court, de moins de vingt minutes, était à privilégier. Le rythme est très important aussi : en radio on dit que quarante secondes c’est le temps maximal pendant lequel un auditeur peut rester connecté à une seule voix sans avoir envie de zapper. Malheureusement, les gens n’ont pas le temps… Donc il faut s’adapter. Pour « À l’Écoute », par exemple, je ne pouvais pas proposer un format de soixante minutes, alors j’ai passé trois émissions avec le même chercheur. Je découpe l’interview pour rester cohérente avec ce que je défends de la médiation. Je ne pourrais pas bâcler en annonçant : « bon alors on a vingt minutes pour parler de trois sujets. ».
-
D’ailleurs ce podcast hebdomadaire que vous proposez depuis avril, À l'Écoute des paysages sonores, comme plusieurs de vos projets, mêle arts et sciences. Pourquoi ce parti pris ?
Ça vient sans doute de mon parcours universitaire. J’ai commencé par une fac de physique car j’avais une appétence particulière pour la science. Ensuite j’ai fait une licence d’histoire, qui a développé mon goût pour le patrimoine et enfin un master « Diffusion de la culture »
C’est peut-être aussi parce que je n’ai pas été formée de manière conventionnelle : j’ai appris sur le terrain, dans une radio associative avec des gens très créatifs. Grâce à cette expérience, je suis plus libre des formats : je fais de l’art sonore pour amener une information mais pas de la même manière que les journalistes traditionnel·es. Pour les radiophiles, la création sonore, c’est du documentaire, du reportage. Pour moi il y a aussi de l’art, de la poésie. Le rythme de la voix, la manière dont on amène les sujets sont tout aussi importants que la préparation des interviews ou que la maîtrise du sujet.
-
Avez-vous déjà - ou serait-il envisageable pour vous - de proposer vos créations sonores à des musées ?
Oui, complètement, même si je n’y ai jamais vraiment pensé. C’est la limite d’être auto-entrepreneur et d’être seule ! Le temps qu’on passe aux propositions commerciales est très restreint. Et le temps qu’on passe à la vente – ou même à la proposition non-commerciale – de nos créations est très, très restreint lui aussi.
-
Quel est votre plus grand rêve, sonore et culturel ?
Un des rêves que j’aimerais bien réaliser ces prochaines années, c’est de développer une carte sonore ludique et dans laquelle les gens peuvent se déplacer physiquement. Ce serait incroyable de voir les points qui se déplacent en même temps que la narration sur le territoire. Cette notion de géographie sonore, d’urbanisme sonore est très intéressante et va l’être de plus en plus. Pour l’instant, j’essaye de produire le meilleur son possible avec le matériel le plus basique : c’est une histoire de placement de micro au bon endroit. Et puis dans quelques années, je voudrais passer à du matériel plus perfectionné et commencer à me lancer vraiment dans cette vague incroyable qu’est le fieldrecording, ou l’enregistrement de paysages sonores.

Logo du podcast À l’Écoute © Emilie Wadelle
Propos recueillis par Camille Roudaut
#médiations
#podcast
#skadiandco

Médiation détonante à la Piscine de Roubaix
Dans la série des médiations singulières, Caroline et Juliette vous proposent une rencontre détonante avec un guide-animateur peu commun à La Piscine de Roubaix, Julien Ravelomanantsoa.
Regards et non-regards, écoute, odeurs, ressenti, plaisir, jeu, gestes…, quelques ingrédients pour une médiation peu conventionnelle mais sensationnelle !
Pour aller plus loin :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube"
Caroline Biondo et Juliette Gouesnard
#médiationsensorielle
#animation
#médiationsinguliere

Mmmmmmmmh !
Crédits : Virginie Potdevin
Trois temps, deux dynamiques
L’atelier est rythmé par trois temps ce qui permet de varier les activités et de garder l’attention des petits comme des grands.En entrant, des tables rondes présentent des mouillettes contenues dans des flacons. Chaque personne est donc invitée à reconnaître les odeurs de diverses huiles essentielles grâce à l’odorat. Cependant, la vue n’est pas en reste car les feuilles séchées au centre des tables sont de précieux indices, pouvant mener sur le chemin de la réponse que l’on obtient en soulevant un cartel. Ce temps, qui permet à la fois de déambuler dans l’espace et de se concentrer sur ses propres connaissances, laisse ensuite place à une dynamique de groupe. Situé au sein du parc de l’abbaye royale de Chaalis, l’atelier des parfums se déroule dans une ancienne écurie offrant ainsi aux participants un cadre agréable en lien avec la nature. En effet, l’atelier propose de découvrir les plantes par le biais de l’odorat.
Assis devant leur orgue à parfum, tous les participants sentent et tentent de reconnaître l’odeur des mouillettes que l’animatrice fait passer une à une. Une fois la fragrance reconnue, chaque mouillette est entreposée dans une des éprouvettes de l’orgue. Durant cette étape vivante, composée uniquement d’échanges, l’animatrice donne quelques renseignements sur les plantes ou encore sur la manière de procéder afin d’identifier au mieux une odeur, permettant ainsi une fluidité du discours. De même, elle divulgue des recommandations et des informations sur le déroulement de l’atelier au fur et à mesure de l’avancée de ce dernier. C’est donc tout en douceur, au fil des mouillettes, que l’animatrice va amener les participants à adopter une analyse de plus en plus fine.
Enfin, après une explication concise des trois notes (note de tête, de cœur et de fond), les participants doivent choisir les fragrances qui composeront leurs eaux parfumées. A l’image de cet atelier, très didactique, ce choix est facilité par la présence de couleurs sur les éprouvettes représentant chacune une note.
Entre fous rires et pédagogie
Crédits : Virginie Potdevin

L’atelier des parfums reste avant tout un moment de détente où les souvenirs se mêlent volontiers aux éclats de rire. En effet, il est toujours amusant de constater les diverses associations qui s’établissent entre une odeur et une idée. Ainsi, tout au long de l’atelier il est fréquent d’entendre « ça pue » ou encore « j’adore cette odeur, cela me rappelle ma grand-mère ». D’ailleurs, certaines remarques déclenchent facilement une euphorie générale, comme par exemple une dame qui en sentant l’eucalyptus s’est exclamée : « Ca sent le suppositoire ! ». Il est donc facile d’affirmer, avec ce genre de constat, que l’atelier met en éveil le sens que l’on développe le moins ainsi que la mémoire olfactive.
L’originalité de cet atelier est qu’il offre la possibilité de mettre en exergue une créativité immatérielle, une évasion, déclenchée par l’odorat. De plus, il valorise le travail de chacun puisque tous les participants repartent avec sa propre eau parfumée.
Outre le fait d’apporter des connaissances diverses et variées autour du thème des huiles essentielles, L’atelier des parfums sensibilise les participants à la nature et permet de prendre conscience que nous ne prêtons pas assez attention à sa richesse olfactive.
Un atelier qui rayonne
Crédits : Virginie Potdevin

Lieu emprunt de plantes, d’odeurs et de nature enchanteresses, le domaine de l’abbaye royale de Chaalis vous propose de participer à L’atelier des parfums toute l’année pour les groupes (sauf le vendredi et le samedi) et le dimanche à 15h pour les visiteurs.
Alizée Buisson
Abbaye Royale de Chaalis
60300 Fontaine-Chaalis
Mon truc.
Vous allez découvrir « le truc » d’une apprentie en médiation et conception de médiation au Musée portuaire de Dunkerque.
Voilà mon truc. © L.T.
Pour devenir déléguée de classe, maire ou présidente de la République, parrain ou marraine dans certaines religions, il faut que chaque personne aille chercher au plus profond d’elle et couche sur papier sa profession de foi. Moi en tant qu’individu, d’après mon vécu et mes ambitions, quels projets et quelles propositions suis-je prête à mener ou faire pour servir et défendre La cause ? Quelles sont mes motivations et serai-je à la hauteur ?
Lorsque vous décidez de vous lancer dans l’incroyable aventure de la Culture, vous n’avez pas assez de vos dix doigts pour compter le nombre de personnes qui vous disent : « mais c’est pas une voie bouchée ? », « tu sais, ce sont souvent des contrats précaires… », « 5 ans d’études pour gagner le SMIC, quand même ! », « mais d’où ça te vient cette idée ? »… Et pourtant, au bout de ces (minimum) cinq années d’études, peut-être ponctuées de crises existentielles, de remises en question pour savoir « mais oui, qu’est-ce que je fous-là ? », de moments de flottements et d’autres périodes dont je tairais le nom : vous êtes toujours là, toujours vivante, toujours debout. Bien que cela ne vous empêche pas de vous demander régulièrement pourquoi vous faites ça. Mais au fond vous savez…parce que, comme moi, vous avez trouvez votre truc, ce truc.
Je ne peux écrire votre profession de foi à votre place mais peut-être vous retrouverez-vous dans la mienne. Cette profession de foi n’est une liste de mes résolutions professionnelles 2018 car comme beaucoup, je ne tiens pas mes résolutions. Non, cette profession de foi est plutôt une définition de ce qu’est mon truc, voire une déclaration d’amour (en tout bien, tout honneur). À regarder les modèles de profession de foi des candidats aux élections de délégué de classe : mes motivations, mes projets et propositions, ma présentation, j’ai trouvé l’inspiration pour en créer un nouveau genre. Voici donc ce qu’est mon truc.
Ce truc, ce n’est pas ce qui me permet de me lever de bonne humeur tous les matins ou de m’empêcher de mettre six réveils... Ce truc, ce n’est pas ce qui va me rendre souriante et heureuse d’être collée à des inconnus dans le métro, de ne pas trouver de place libre dans le train ou d’être coincée comme chaque matin dans les bouchons… Ce truc, ce n’est pas ce qui va me permettre de ne pas finir mon mois le 15 ou de ne plus manger de pâtes à partir du 15… Non, définitivement, ce n’est pas ça mon truc. Bien sûr la liste de ce que n’est pas mon truc pourrait être plus longue mais je n’ai pas envie de me démotiver ou de laisser penser que finalement, ce n’est pas mon truc. Qu’est-ce donc alors ?
Mon truc, c’est de ne pas être découragée quand les gens me regardent avec de gros yeux parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est la muséographie ou la médiation culturelle. C’est d’être à chaque fois, oui à chaque fois, contente d’expliquer ce que c’est mon métier, de pouvoir faire découvrir et transmettre pour mon truc parce qu’au final, c’est ça aussi la médiation. Mon truc, c’est de ne jamais me lasser de raconter toujours la même explication à des membres de ma famille, des professionnels, des visiteurs quand on me demande ce que je fais et surtout de terminer en disant « j’ai trouvé mon truc ». Mon truc, c’est de rencontrer des gens de tout âge, de tout horizon social et géographique pour leur raconter une histoire pendant qu’ils me racontent la leur. C’est se sentir utile, tenter de faire des blagues qui ne fonctionnent pas vraiment…et pourtant ne jamais désespérer et croire que cela marchera un jour avec un autre groupe de visiteur. Mon truc, c’est accueillir les gens en souriant même si je n’ai pas le moral, commencer et finir une visite trempée par la pluie et bousculée par le vent. C’est entendre les gens me remercier et me dire qu’ils « se coucheront moins bêtes ce soir ! », c’est rire avec les enfants qui s’exclament que le corsaire dunkerquois s’appelle Jean-Luc ou Jean-Marc. Mon truc, c’est d’être sûre d’avoir le sourire en arrivant au bureau et de partager des moments avec des collègues qui ont le même truc que moi. C’est aussi de rêver la nuit des événements que j’organise, souvent des rêves qui se transforment en cauchemar…et de me rendre compte que je ne suis justement pas la seule au musée à qui cela arrive, non, c’est normal : « le métier qui rentre ». Mon truc est composé de mille trucs…
Alors, au terme de cette définition non exhaustive, je me rends compte que je ne suis finalement pas avancée et incapable de savoir ce que c’est ce truc. Or, le plus important à retenir est qu’il ne suffit pas de pouvoir mettre des mots mais d’en ressentir toutes les facettes car comme dans la vie, le bonheur est fait de petits trucs.
Lucie Taverne
#apprentissage#mediation#2018

Musée en miniature : la maquette dans l’institution muséale
Dans le cadre de deux expositions en 2021/2022 – respectivement Échelle et volume, la maquette d’aujourd’hui (Musée du Compagnonnage à Romanèche-Thorins (71), du 15 octobre 2021 au 31 mai 2022), et à l’occasion du festival de littérature jeunesse Des histoires pour l’histoire, une exposition sur « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » (du 1er au 27 octobre 2021 au Temps des Cerises à Issy-les-Moulineaux (92)) – la maquette est à l’honneur. Si l’une présente le métier de maquettiste, aujourd’hui considéré comme artisanat d’art, l’autre évoque les différentes casquettes de Léonard de Vinci, et notamment celles de l’ingénieur et du concepteur de machines. À la fois objet de médiation mais également thème d’exposition, la maquette a une place de choix dans les musées et autres institutions muséales.
L’origine de la maquette
À l’origine, ce n’était pourtant pas tout à fait son dessein premier. Née durant l’Antiquité, notamment au travers de jouets sumériens, une maquette comme l’indique la définition du CNRTL, est un « Modèle réduit à trois dimensions, respectant les détails et les proportions d’un décor de théâtre, d’une construction en projet (le décor, la construction devant être réalisée suivant ces données) ». Il s’agit donc le plus souvent d’une reproduction d’un bâtiment en devenir, ou déjà existant. La maquette a donc, au départ, un aspect scientifique et technique, puisqu’elle sert à vérifier si une construction est solide, ou bien à mettre en lumière un projet autour d’une future construction. Elle sert aussi à démontrer un propos, à obtenir un nouveau point de vue sur un bâtiment ou un objet qui n’est observable que grâce à la réduction.
Avec la réalisation de figurines et de dioramas – d’autres formes d’objet entrant également dans le champ du modélisme et de la maquette – il semble approprié de reconnaître un aspect pédagogique à cette dernière. Celle-ci peut effectivement servir à enseigner ou illustrer un fait, un événement - notamment historique – à montrer l’évolution topographique d’un lieu, la situation géographique d’une ville à une date donnée ou bien encore donner vie à des batailles célèbres. Le diorama de la Bataille de Waterloo créé par Charles Laurent et exposé au Musée de la Figurine historique à Compiègne en est un parfait exemple. Le Musée des Plans-reliefs situé à l’Hôtel des Invalides à Paris ou la collection du Palais des beaux-arts de Lille constitue également un socle solide de représentations de plans militaires et techniques sur des villes ou des zones données.
Ainsi, le rôle de la maquette est – de prime abord – militaire, technique, industriel, scientifique et pédagogique. Elle a toujours fasciné, en témoigne l’existence de France Miniature à Elancourt, Italia in miniatura à Rimini ou bien encore Bekonscot à Beaconsfield au Royaume-Uni, des parcs à thèmes autour des monuments historiques mondiaux miniaturisés. Mais comme son descriptif l’indique, il n’est question ici que de parcs à thème, centré uniquement sur le divertissement et le spectaculaire. Mais il aide à voir l’intérêt vif porté à cet objet, et l’attrait qu’il peut représenter s’il est utilisé au sein d’un musée.
Comme indiqué précédemment, c’est un support pédagogique idéal pour représenter, expliquer, étudier ou promouvoir. La maquette permet de faire revivre ce qui n’existe plus (un château détruit), de rendre visible ce qui n’existe pas encore (un projet urbain) ou encore de donner à découvrir des éléments minuscules. Il semble dès lors convenir d’utiliser cet aspect pédagogique dans des lieux culturels. Ce passage sur la miniature dans l’ouvrage La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique dirigé par Evelyne Thoizel et Isabelle Roussel-Gillet tend à corroborer cette idée: «Le modèle réduit permet ainsi d’accéder à une autre forme d'intelligibilité en modifiant l’échelle de la représentation. Dans bien des musées d’archéologie ou d’histoire de la ville, une maquette, modèle réduit d’un bâtiment, est le passage obligé de la visite guidée. Elle offre un potentiel de rassemblement pour les médiations, afin que les visiteurs puissent se grouper autour d’elle et la voir ensemble. Le guide l’utilise pour leur donner des repères, des connaissances historiques sur l’architecture et les évolutions d’un bâtiment. La maquette comme dispositif interactif est alors au service de la compréhension scientifique » (Introduction).
Maquettes de l’exposition Les drôles de machines de Léonard de Vinci. Crédits: PT
Fac-similé de boucle de ceinture par Michel Campana. Crédits: PT
L’imaginaire au service du discours scientifique
Si la maquette a une fonction plutôt technique au départ, elle trouve également sa place dans les musées et autres institutions muséales. L’article de Daniel Jacobi intitulé «La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques», qui est sous le prisme de l’exposition archéologique plus particulièrement, explique pourquoi un objet censé servir un but professionnel ou militaire est capable de servir une exposition, et pourquoi il y parvient aussi aisément. Si la maquette s’insère facilement dans un espace muséal, c’est qu’elle fait la part belle à l’imaginaire au sein d’un espace scientifique et historique. Support de médiation, elle permet d’expliciter un propos, de le démontrer tout en conservant un aspect ludique. La maquette ramène le visiteur à l’enfance, au jeu, à une part peut-être de spectaculaire, divertissant mais pour servir un propos scientifique. Cette recrudescence de l’usage de maquettes dans l’institution muséale provient, selon Daniel Jacobi, de l’arrivée de l’exposition temporaire lors de la refonte des musées durant les années 1980. Elle serait la première instigatrice de l’imaginaire au sein d’un discours muséographique. Dans son article, l’auteur explicite cette dimension scientifique de l’objet : « En tant qu’artefact muséographique, la maquette est sans aucun doute un dispositif pertinent pour donner à voir l’une des facettes majeures du discours scientifique archéologique : la reconstitution des édifices détruits et du mode de vie d’une civilisation disparue. Il permet, non seulement, de tester la validité d’une hypothèse scientifique […] mais aussi de la matérialiser concrètement ».
Il explique ensuite pourquoi il peut s’agir d’un dispositif muséographique attrayant et performant : « La maquette est une forme populaire. Plus encore, elle provoque une réaction presque jubilatoire en ce qu’elle évoque l’univers du jeu. Séduisante et attractive, elle suggère une posture de reconnaissance ludique et active. On l’observe, la commente, l’interprète comme une sorte d’énigme dans laquelle la solution est cachée. Et comme toute situation de jeu, la maquette incite à s’impliquer. Elle est en cela susceptible de devenir un support fantasmatique puisqu’elle est généralement associée, chez le visiteur adulte, aux souvenirs de l’enfance et à l’expérience d’une certaine liberté interprétative.». Dès lors, la faculté d’une maquette à communiquer et promouvoir, par exemple, un projet architectural en devenir se retrouve aussi dans une exposition muséale, où elle dévoile sous un nouveau jour ou tel qu’il a pu être un bâtiment ou une ville qui ne sont plus. Déchiffrable assez spontanément, elle est, pour reprendre les termes de Bourdieu, un art moyen. Il suffit de l’observer comme une saynète, d’en faire quasiment l’expérience empirique pour en comprendre, au moins une partie, l’interprétation scientifique dont on l’a imprégnée. Elle narre quelque chose visuellement. Elle donne également à voir l’objet original – sous sa forme réduite – comme un bâtiment sous un autre format, et on peut observer dès lors son organisation structurelle.
Elle se révèle ainsi comme un puissant dispositif cognitif : mettant en évidence ce qui est invisible, les détails qui semblent importants au maquettiste, les maquettes parviennent à illustrer de manière concrète le travail scientifique de l’exposition pour laquelle elle est utilisée. Par sa représentation de scènes, de monuments, de villes disparues ou appartenant au passé, la maquette matérialise et rend concret une hypothèse, un questionnement scientifique. L’exposition qui, pour Daniel Jacobi, est un nouveau média, permet aux chercheurs comme aux novices de s’approprier la maquette, s’approprier ce qu’elle retransmet. Ils se retrouvent conjointement autour du modèle réduit, qui est un plaisir partagé, un plaisir de l’enfance, plaisir qui se retrouve par ailleurs dans l’art de concevoir des modèles réduits – la confection de ces objets est devenu un loisir, un passe-temps pour nombre de personnes. Les maquettes ne sont après tout, selon l’auteur, « […] que de fragiles et éphémères constructions archéologiques imaginaires ».
La maquette, cœur d’expôt(sition), ou la maquette aujourd’hui
La maquette rentre donc aisément dans le champ muséal pour sa facilité à être comprise rapidement et à être un support de médiation. Tout d’abord, il convient de distinguer trois sortes de maquettes grâce aux éléments glanés précédemment. Il y a d’abord la maquette d’architecture, celle évoquée en première partie, qui est une œuvre d’art – et qui est exposée en tant que telle – et met à distance le visiteur, qui se contente de l’observer sans pouvoir la toucher. Ensuite, il existe la maquette conçue expressément pour la médiation comme la maquette de port fictif au musée portuaire de Dunkerque, qui permet aux visiteurs de découvrir comment fonctionne un port et son aménagement si particulier puis d’imaginer et construire à leur tour un port fictif et idéal. La Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais présente également une maquette du lieu qui montre la Cité telle qu’elle était auparavant et son évolution jusqu’à son apparence actuelle grâce à des éléments amovibles. Ce style de maquette s’explicite grâce à un médiateur qui en fait l’usage, la rend ludique tout en apprenant à son interlocuteur des données scientifiques, souvent à destination du jeune public. Enfin, il y a la maquette à actionner seule sans médiateur, et qui trouve sa place également dans le musée. Elle est alors considérée comme une manipe.
Dès lors, il apparaît évident que c’est un support modelable, malléable et qui rentre parfaitement dans le cadre muséal. Deux études de cas peuvent étayer ce propos : l’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci », qui fut exposée à la médiathèque Micro-Folie Le Temps des Cerises d’Issy-les-Moulineaux, et les maquettes du Musée portuaire de Dunkerque, où le nombre de modèles réduits conséquent, donnent à voir des méthodes de médiation variées.
L’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » comprend trois axes de contenu. Tout d’abord, une présentation des « Machines de Léonard », conçue par les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF-CVL), avec le concours de la Région Centre –Val de Loire grâce à des kakemonos. Puis, l’espace central d’exposition, situé sous une verrière, avec une série de maquettes et de fac-similés d’objets de travail et d’instruments qu’utilisait ou concevait l’artiste ingénieur toscan. Ces maquettes sont réalisées en bois par Claude Picoux, un ancien ingénieur devenu maquettiste à la retraite, ainsi que les instruments et mécanismes reconstitués de Michel Campana, réalisés en métal le plus souvent. Tous deux passionnés par Léonard de Vinci, leurs travaux respectifs sont mis au centre de l’exposition, où la muséographie présente et visualise réellement, et du mieux possible, les machines reproduites ou dessinées par l’artiste italien. Fondées sur les carnets de croquis de ce dernier, elles rendent vivantes les constructions de Léonard de Vinci. Lors des visites, les maquettes étaient utilisées (certaines sont amovibles et leurs mécanismes pouvaient réellement fonctionner) pour le plus grand plaisir des spectateurs de tous âges tout en expliquant comment elles ont été fabriquées et quelles machines elles représentaient. Ainsi, elles sont à la fois supports créés pour la médiation, objets pour illustrer une machine ayant ou n’ayant pas existé et expôt, puisqu’elles trônent au centre de la structure culturelle, et en deviennent dès lors des objets de collection.
L’autre étude de cas concerne le musée portuaire de Dunkerque, à la panoplie de maquettes de bateaux. Elles sont expôts, objets de collection au cœur de l’exposition mais aussi objets de médiation. Elles représentent des tranches de vie (il y a également des dioramas de moments de vie dans le port) avec des petits personnages dessus mais sont également des répliques de bateaux ayant navigué. Ces modèles réduits reproduisent fidèlement l’objet de départ – ou le faisant croire – et émerveillent le visiteur par son aspect ludique.
Toutefois, si ces maquettes rendent l’exposition ludique et bénéficient d’une médiation – en particulier celles de l’exposition sur les machines de Léonard de Vinci – elles restent tout de même des objets exposés sans réelle médiation pour les maquettes de Dunkerque. Par ailleurs, le trop plein de maquettes finit par desservir le propos ou surcharger le parcours visuel pour le visiteur.
Dès lors, s’il est vrai que la maquette peut offrir une médiation, son aspect ludique peut tout autant être moteur et frein à la compréhension. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’elle constitue la figure centrale d’une exposition. Le propos qu’elle sert ne peut être compris sous toutes ses coutures qu’à travers une explicitation de son fonctionnement. Mais étant souvent considéré comme un objet d’art, cet accès ne lui est, dans la majorité des cas, pas permis. Pour exploiter son potentiel à son maximum, la maquette doit peut-être se réinventer, et pousser ses capacités à être saisi à bras le corps par le visiteur en tant que manipe à son paroxysme. Elle ne serait plus seulement objet de médiation, ou objet de collection exposable mais partie intégrante de l’expérience de visite, sous toutes ses formes.

Maquette d’un navire au musée portuaire de Dunkerque. Crédits: PT
Pauline Tiadina
Pour aller plus loin :
- La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques, Daniel JACOBI, mai-juin 2009
- « Introduction : La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique » par Evelyne THOIZEL et Isabelle ROUSSEL-GILLET, 26 avril 2018
- La vraie-fausse nature des dioramas, Clémence de Carvalho, L’art de Muser, 20 octobre 2021
#maquette #DispositifMuséographique #imaginaire

Muséomix Kids au Musée de la Chartreuse de Douai
Des enfants créent leur médiation : le Tableau interactif animalier
Mesdames Messieurs, Museomix ! Ce marathon muséal créatif de trois jours a lieu une fois par an : des adultes viennent réinventer le musée, armés d’imagination et de café (beaucoup de café). Partout dans le monde, des musées participent à cet événement. Partout dans le monde, des musées participent à cet événement. En France la communauté « Museomix Nord », constituée par des passionné-es, permet l’organisation depuis 2014 d’un marathon Museomix dans un musée du nord de la France. (site de Museomix Nord)
Et depuis 2015, Museomix Nord a décidé d’impliquer des enfants ! S’il est compliqué de les faire participer pendant trois jours à ce rythme fou, on les convie à réinventer le musée à leur sauce, le temps d’une après-midi. Bien souvent ils et elles réalisent, en 3 heures et sans café, un prototype digne de ceux que les adultes présentent à la fin du marathon.
Les jeunes participants de Muséomix Kids et leurs parents ont découvert cet événement gratuit grâce à la communication sur les réseaux sociaux du musée, et des articles dans la presse locale. Ils et elles avaient entre 6 ans (âge minimum d’inscription) et 13 ans. Ils et elles ont investi le musée le 9 novembre 2019.
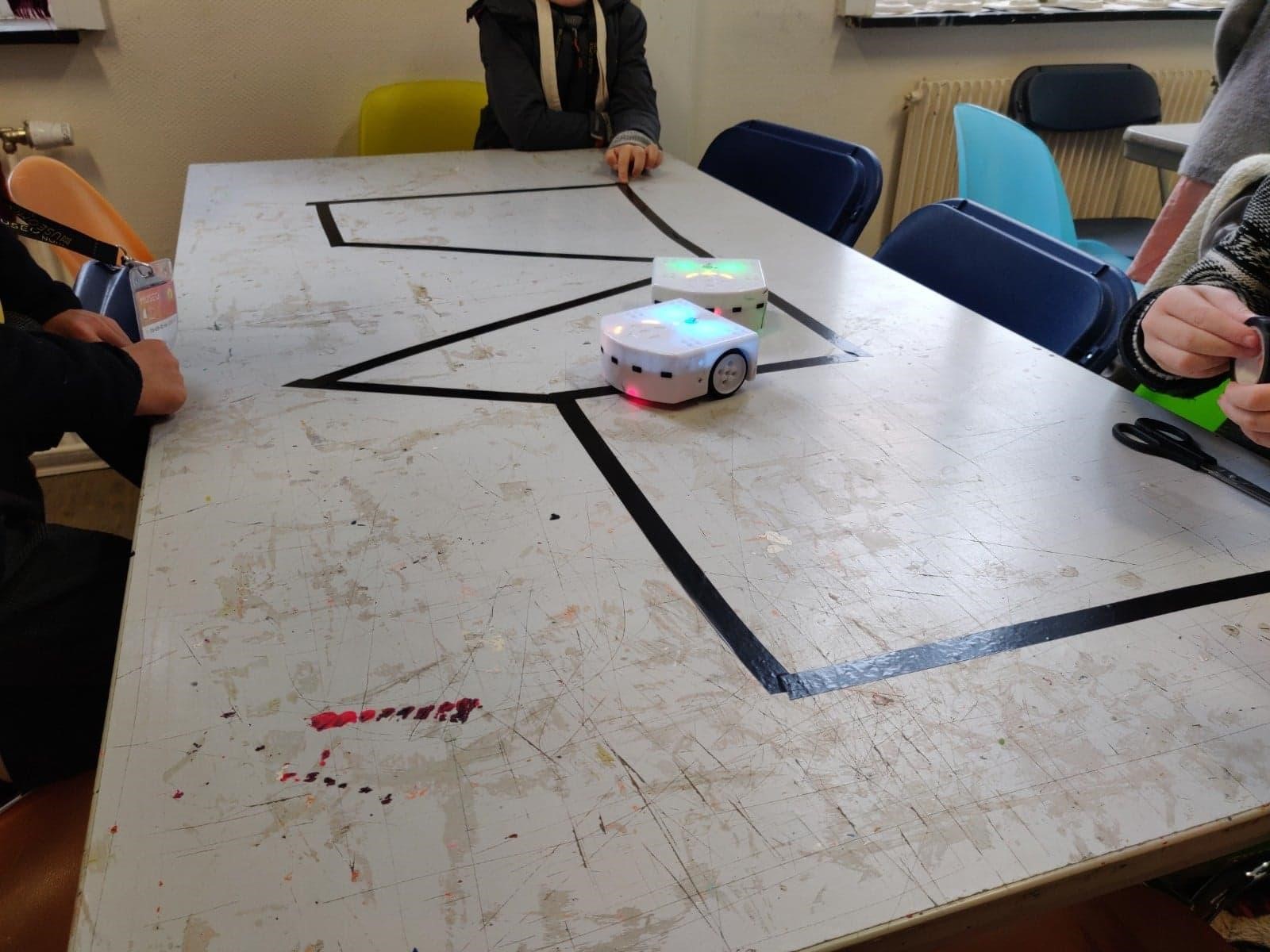
Thymio II, robot en open source pensé pour l'initiation des enfants à la robotique. © M. Q.
Pour Museomix Kids, les organisateur-rices mettent à disposition des enfants du matériel varié (des logiciels et des robots, des crayons et du carton…), des animateur-ices et le musée lui-même. Alors qu’est-ce qui fait la réussite d’une médiation inventée par des enfants ? Voici la recette !
Dans ce cas précis :
- Un musée : le Musée de la Chartreuse de Douai ;
- Deux animatrices ;
- Trois enfants (de 6 à 13 ans) ;
- Un concept : Les enfants ont proposé une idée : celle d’entendre le bruit des animaux que l’on retrouve dans le parcours de la Chartreuse de Douai. A partir de cette proposition, ils ont imaginé un tableau interactif, que l’on retrouve à la fin de la visite. L’idée serait d’avoir une application (par exemple), qui proposerait tous les animaux du musée et les cris associés. L’enfant sélectionnerait ceux qu’il souhaite garder en mémoire, en les glissant dans un tableau paysage, qui abriterait sa sélection unique, et qu’il pourrait conserver après la visite (en envoyant un lien par mail). Le paysage qui abriterait les animaux ne serait pas un tableau du musée, mais des tableaux prévus spécialement pour cette médiation. On pourrait imaginer mettre à disposition plusieurs paysages au choix.
Pour réaliser le prototype de cette médiation dans votre musée, puisque les prototypes sont en open source, il vous faut :
- 3 enfants motivés (survoltés parfois)
- Un grand carton
- Du papier
- Des feutres, crayons, etc
- Des attaches parisiennes
- Des pinces croco (petites, pas celles pour démarrer la voiture)
- Un ordinateur avec le logiciel MakeyMakey et le contrôleur
Etape 1 : Allez voir dans le musée quels animaux sont représentés.
Etape 2 : Dessinez avec les enfants les animaux qu’ils souhaitent voir apparaître dans le tableau final, sur des feuilles, et découpez les animaux. Conservez de côté (précieusement !).
Etape 3 : Dessinez le paysage sur le carton, coloriez (si les enfants décident d’ajouter des moyens de transport, suggérez de remplacer les voitures par des vélos !).
Etape 4 : Trouez le tableau-carton aux endroits où vous voulez mettre les animaux, trouez les animaux (les dessins, bien-sûr) ; fixez les animaux au tableau-carton grâce aux attaches parisiennes.
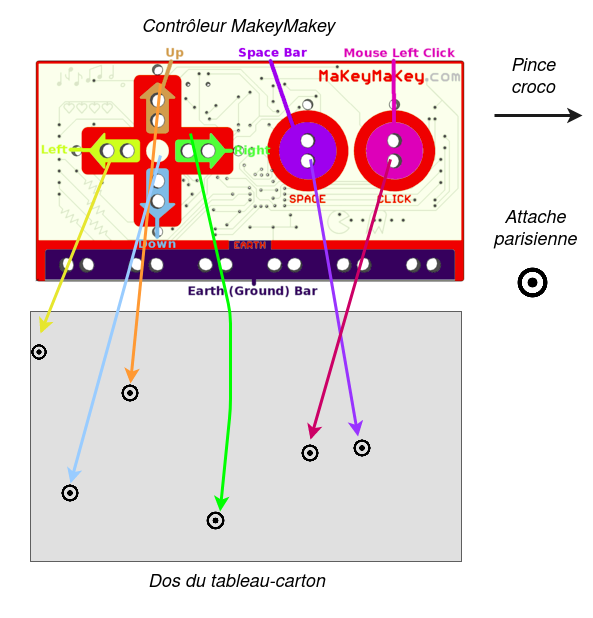
Schéma © M. P.
Etape 5 : Attachez les pinces croco d’un côté aux attaches parisiennes (au dos du tableau-carton), et de l’autre au contrôleur, lui-même connecté à un ordinateur.
Avec le logiciel MakeyMakey, programmez les sorties du contrôleur pour que chaque action (touche espace, haut, bas, etc) provoque le bruit de l’animal à laquelle la pince croco concernée est reliée.
Etape 6 : Attrapez la pince croco qui sert d’entrée d’électricité, touchez une attache parisienne : le corps est conducteur d’électricité, et le bruit de l’animal résonne dans les galeries du musée !
Il ne reste plus qu’à aller présenter aux museomixeurs adultes les prototypes réalisés avec nos petites mains.
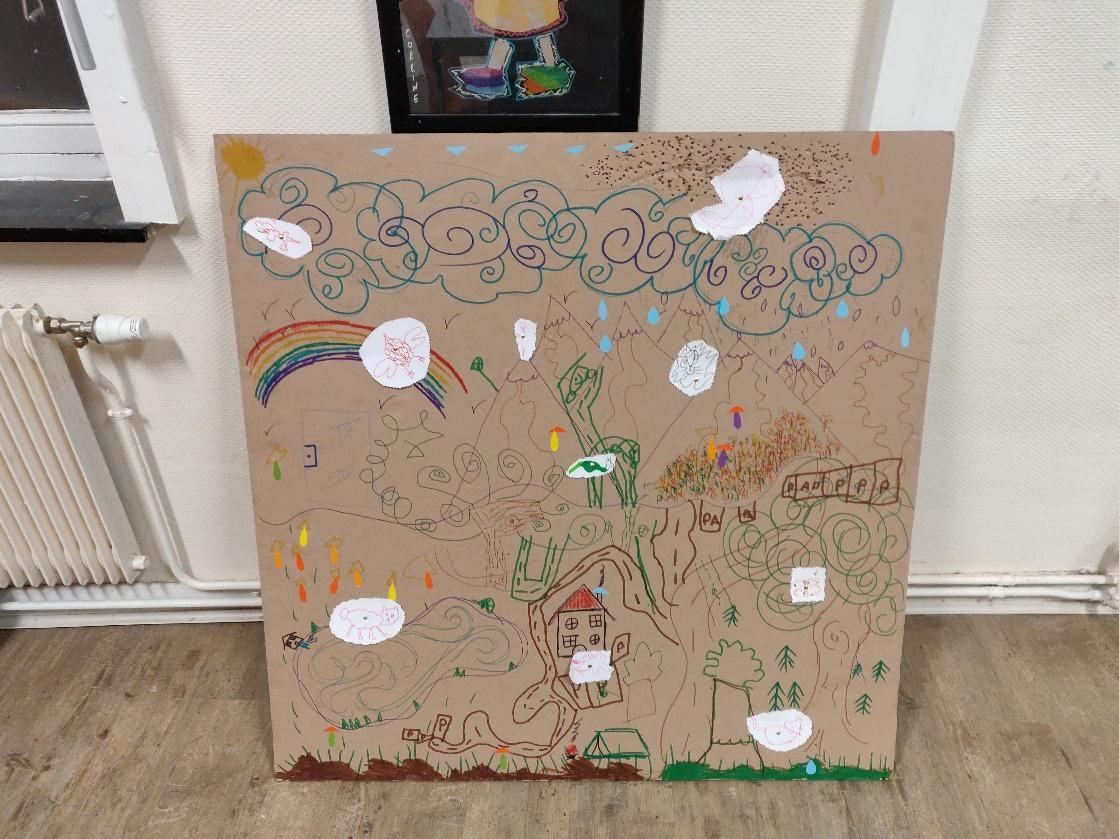
Le tableau final ! © M.P
Cette expérience amusante et enrichissante pour les enfants leur permet de regarder autrement le musée, et de les rendre acteurs et actrices de leur visite, et en plus de libérer un après-midi du week-end de leurs parents : le rêve !
Maud P.
#MuseomixKids
#Douai
#Médiation
Pour aller plus loin :
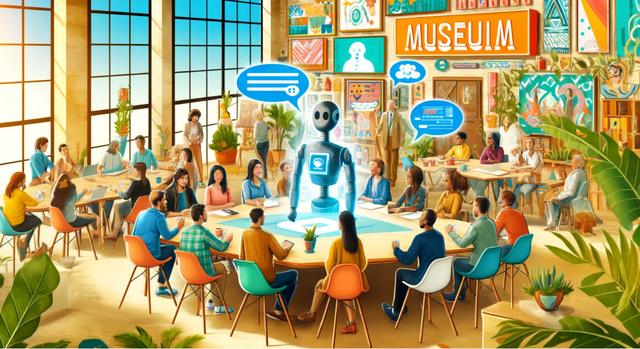
On a discuté de muséographie et de culture avec l’IA Chatpgt
L’intelligence artificielle est un champ de recherche en pleine expansion qui suscite de nombreux débats et qui voit émerger de nouvelles explorations dans tous les domaines d’expertises, notamment le milieu muséal. Ces nouvelles interfaces ont déjà commencé à trouver leur place aussi bien dans les collections permanentes que dans les expositions temporaires. Cela se matérialise par exemple avec le projet du centre Pompidou en collaboration avec l’association KADIST qui ont pu acquérir des premières oeuvres générées par IA pour un projet de réflexion sur les pratiques artistiques, aussi avec l’exposition “IA : double je” au quai des savoirs à Toulouse en co-production avec la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, ou encore au Nasher Museum of Art de l’Université Duke, où une intelligence artificielle a assumé le rôle de curateur pour une exposition.
Image générée par ChatGPT
Les intelligences artificielles sont des programmes algorithmiques complexes qui simulent certains traits de l’intelligence humaine tels que la capacité d’apprentissage ou de raisonnement. L’outil le plus répandu actuellement auprès du grand public est Chatgpt "Chat Generative Pre-trained Transformer", développé par OpenAI. Ce modèle de langage artificiel est alimenté à partir d’une base de données extraites de livres, d’articles, de sites web, de textes de tous genres ou encore de banques d’images.
Selon Nicolas d’Alessandro, ingénieur et designer chez Hovertone, ce qui fait la spécificité de ces nouvelles technologies, c'est la capacité de communiquer avec la machine à travers un langage naturel. Cette transition du "mot clé", comme avec Google, au prompt (un court texte entré par un utilisateur pour initier une conversation avec ChatGPT) ouvre de nouveaux horizons qui favorisent une interaction plus intuitive avec les logiciels mais soulèvent également de nombreuses questions éthiques, notamment en matière de créativité et de production de contenus.
Cet article ne prétend pas résoudre ces débats complexes mais plutôt de donner à voir le potentiel et les limites de ces nouveaux outils. Quel est réellement l’étendue des connaissances et des capacités de chatgpt ? Quelle intégration peut-il avoir dans nos milieux professionnels ? Pour éclairer ces questions j’ai proposé à Myrrha Bouly, muséographe à la Cité des Sciences à Paris, de se prêter pour la première fois au jeu de la discussion avec l’intelligence artificielle pour parler de ses sujets de prédilections :
Myrrha : A quoi servent les musées ?
Chagpt 3.5 :Les musées servent à préserver le patrimoine culturel de l'humanité, en conservant et en présentant des œuvres d'art, des artefacts historiques et d'autres éléments significatifs. Ils jouent un rôle crucial dans l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage uniques et en stimulant la curiosité intellectuelle des visiteurs. Les musées fournissent également des opportunités de divertissement et de loisirs, en proposant des expositions interactives, des événements spéciaux et d'autres activités engageantes. De plus, les musées soutiennent la recherche académique en permettant aux chercheurs d'étudier et d'analyser les objets de leur collection. Enfin, les musées contribuent au renforcement de l'identité culturelle en célébrant la diversité et en mettant en valeur les traditions et les réalisations des différentes cultures à travers le monde.
Myrtha : Je suis muséographe, comment concrètement peux-tu m'aider ?
Chagpt 3.5 : En tant que muséographe, je peux vous aider de plusieurs façons :- Conception et planification : Je peux vous aider à concevoir et à planifier votre exposition, en vous fournissant des idées créatives, des concepts thématiques et des suggestions pour la disposition spatiale des éléments de l'exposition.
- Recherche et contenu : Je peux vous aider à effectuer des recherches sur des sujets spécifiques liés à votre exposition, en vous fournissant des informations historiques, culturelles et artistiques pertinentes pour enrichir le contenu de votre exposition.
- Écriture et rédaction : Je peux vous aider à rédiger des textes d'interprétation, des panneaux d'exposition, des cartels et d'autres supports écrits pour votre exposition, en vous fournissant un contenu clair, précis et engageant pour informer et captiver votre public.
- Sélection des médias et des supports : Je peux vous aider à choisir les médias et les supports les plus appropriés pour présenter votre contenu, en vous proposant des idées pour l'utilisation de l'imagerie, de la vidéo, de l'audio, des objets physiques et d'autres éléments interactifs dans votre exposition.
- Évaluation et rétroaction : Je peux vous fournir des commentaires et des conseils sur votre projet d'exposition, en vous aidant à évaluer son efficacité et son impact potentiel sur le public cible, ainsi qu'en identifiant des domaines où des améliorations pourraient être apportées.
- Utilisation de la technologie : Je peux vous conseiller sur l'intégration de la technologie dans votre exposition, en vous proposant des idées pour l'utilisation de dispositifs interactifs, d'applications mobiles, de réalité virtuelle ou augmentée, et d'autres outils numériques pour améliorer l'expérience des visiteurs.
Myrrha : Comment choisit-on un sujet d'exposition?
Chagpt 3.5 : Le choix d'un sujet d'exposition peut être influencé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est souvent déterminé par la mission et la vision du musée, ainsi que par les intérêts et les objectifs spécifiques de l'institution. Par exemple, un musée d'art moderne peut choisir d'organiser une exposition sur un artiste contemporain émergent afin de promouvoir de nouveaux talents, tandis qu'un musée d'histoire peut opter pour une exposition sur un événement historique important pour commémorer un anniversaire ou une commémoration.
De plus, les musées peuvent tenir compte de l'intérêt du public et de la demande du marché lorsqu'ils choisissent un sujet d'exposition. Les expositions sur des sujets populaires ou d'actualité peuvent attirer un plus large public et contribuer à augmenter les revenus de billetterie.
Parfois, les musées collaborent avec des chercheurs, des conservateurs, des historiens de l'art et d'autres experts pour identifier des sujets d'exposition pertinents et novateurs. Ces collaborateurs peuvent proposer des idées basées sur leurs recherches et leurs connaissances spécialisées dans un domaine particulier.
Enfin, le contexte culturel, politique et social peut également influencer le choix d'un sujet d'exposition. Les musées peuvent choisir de traiter des questions contemporaines ou des problèmes sociaux importants à travers leurs expositions afin de stimuler la réflexion critique et de susciter le dialogue au sein de la communauté.
Dans l'ensemble, le choix d'un sujet d'exposition est un processus complexe qui peut impliquer une combinaison de facteurs, y compris la mission du musée, l'intérêt du public, les contributions des experts et le contexte culturel et social.
Myrrha : Quelle expo aimerais-tu voir en ce moment si tu étais humain ?
Chagpt 3.5 : Si j'étais humain, j'aimerais probablement voir une exposition qui explore l'intersection entre la technologie et l'art contemporain. Cette exposition pourrait présenter des œuvres d'art numérique, des installations interactives et des expériences multimédias qui explorent les possibilités créatives offertes par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Je serais également intéressé par une exposition qui met en lumière les cultures du monde, en mettant en valeur l'art et les traditions de différentes régions et communautés. Cette exposition pourrait offrir une perspective diversifiée sur la richesse et la diversité de la culture humaine à travers le temps et l'espace.
Enfin, une exposition sur l'histoire de la science et de la découverte pourrait également captiver mon intérêt, en explorant les grandes avancées scientifiques et les figures emblématiques qui ont façonné notre compréhension du monde et de l'univers.
Ces sujets d'exposition reflètent mon intérêt pour la technologie, l'art, la culture et la connaissance, et j'apprécierais certainement l'occasion de les explorer à travers des expositions captivantes et stimulantes.
Myrrha : Peux- tu citer 4 thématiques intéressantes pour une expo courte sur l’accouchement, avec un point de vue féministe engagé ?
Chagpt 3.5 : Si vous souhaitez adopter un point de vue féministe plus engagé dans votre exposition sur l'accouchement, voici quatre thématiques qui pourraient être explorées :
- Autonomie et empowerment des femmes enceintes : mettez en avant les droits des femmes enceintes à prendre des décisions éclairées sur leur propre accouchement, en mettant en lumière les choix de naissance respectueux, l'autonomie des patientes et l'importance du consentement éclairé dans les soins obstétricaux.
- Déconstruction des normes de genre et de la médicalisation de l'accouchement : explorez comment les normes de genre et la médicalisation de l'accouchement ont historiquement limité la capacité des femmes à contrôler leur propre expérience d'accouchement, en mettant en évidence les mouvements pour des soins de maternité centrés sur la femme et respectueux des choix des femmes.
- Défense des droits des femmes enceintes : abordez les enjeux contemporains liés aux droits des femmes enceintes, tels que les disparités en matière de soins de santé maternelle, les violations des droits reproductifs, la stigmatisation de la grossesse et les défis auxquels sont confrontées les femmes enceintes marginalisées.
- Solidarité et soutien entre femmes : mettez en avant l'importance de la solidarité entre femmes et du soutien communautaire dans le processus d'accouchement, en mettant en lumière les rôles des doulas, des sage-femmes et des réseaux de soutien entre pairs dans l'autonomisation des femmes enceintes et dans la promotion du bien-être maternel.
En adoptant un point de vue féministe plus engagé, votre exposition peut servir de plateforme pour remettre en question les normes patriarcales et médicales entourant l'accouchement, tout en faisant progresser les conversations sur les droits reproductifs, l'autonomie des femmes et la justice en matière de santé maternelle.
Myrrha : J’ai un budget de 500 euros, quels matériaux choisir ?
Chagpt 3.5 : Avec un budget de 500 euros, vous pouvez envisager d'investir dans des matériaux tels que du carton recyclé pour la construction de panneaux d'exposition, du papier et de l'encre pour l'impression de supports visuels, des matériaux de bricolage pour la création d'installations artistiques, et des fournitures de bureau pour la création de supports informatifs et éducatifs. Vous pourriez également envisager d'utiliser des matériaux recyclés ou récupérés pour réduire les coûts et adopter une approche écologique.
Myrrha : Que penses-tu de la restitution des œuvres dans les musées européens ?
Chagpt 3.5: La question des restitutions d'œuvres d'art dans les musées européens est complexe et soulève des questions importantes sur la propriété, la restitution historique et la justice culturelle. Voici quelques points à considérer :- Histoire coloniale et pillage culturel : de nombreuses œuvres d'art dans les musées européens ont été acquises pendant la période coloniale, souvent par des moyens contestables tels que le pillage, la confiscation forcée ou la transaction inégale. Ces acquisitions soulèvent des préoccupations concernant la restitution des œuvres volées ou spoliées à leurs pays d'origine.
- Justice culturelle et réparations : pour de nombreux pays d'origine, la restitution des œuvres d'art revêt une importance symbolique et culturelle significative, représentant la reconnaissance des injustices passées et la réparation des dommages causés par la colonisation et le pillage culturel.
- Débats éthiques et juridiques : les restitutions d'œuvres d'art soulèvent des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la propriété légale, les droits de restitution et les limitations de prescription. Les musées européens doivent naviguer avec précaution dans ces débats pour garantir des solutions justes et équitables.
- Dialogue et coopération : le dialogue et la coopération entre les musées européens et les pays d'origine sont essentiels pour aborder ces questions de manière constructive. Les musées peuvent travailler en partenariat avec les gouvernements, les institutions culturelles et les communautés locales pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques qui respectent les droits.
Myrrha : Fait une blague qui ferait rire un muséographe.
Chagpt 3.5 : Pourquoi les cimaises sont-elles toujours de bonne humeur au musée ?
Parce qu'elles savent toujours comment accrocher !
Suite à cette expérience, Myrrha indique que les réponses sont intéressantes mais génériques et neutres. Elle conclut qu’elle peut envisager l’outil comme un point de départ pour sa réflexion professionnelle, mais qu’il est important de vérifier les informations et d'apporter des perspectives originales afin d'aller au-delà des réponses standardisées.
On peut voir que les interactions avec ChatGPT n'apportent pas toujours de nouvelles connaissances (ni les meilleures blagues) mais elles donnent un condensé de recherche qui peut être intéressant sur certains sujets. Si on espère que les machines ne prennent pas le pas sur l’humain dans le processus créatif, elles peuvent être de bons alliés dans les pratiques professionnelles de demain.
C’est d’ailleurs un sujet abordé dans l’exposition “IA: Double Je”, actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse, avec la notion de métier remplacé et métier épaulé. Un quizz permet de découvrir quelles missions pourraient être automatisées, telles que des tâches répétitives avec une application stricte de règles et de consignes ne nécessitant pas la compréhension des émotions ou du langage non verbal. Ainsi, le dispositif met en avant le fait que peu de métiers disparaîtront, mais qu’ils sont plutôt voués à évoluer.
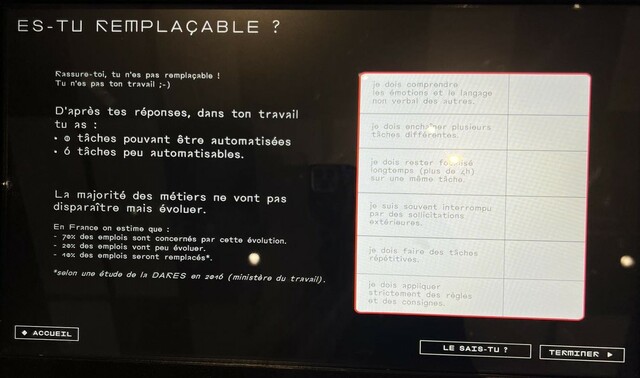
Quizz “Es-tu remplaçable ?”, exposition “IA: double je”, Quais des savoir et Cité des Sciences et de l’industrie
Dans cette évolution, il est important de reconnaître le potentiel des musées dans l’éducation et la sensibilisation à ces nouvelles technologies. En tant qu'espace de facilitations, il y a un rôle à jouer dans la compréhension de ce que sont les outils d’intelligences artificielles.
Pour aller plus loin :
- https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-ia-double-je/
- https://www.icom-musees.fr/ressources/et-demain-intelligence-artificielle-et-musees
#intelligenceartificielle #mediationinnovante #muséenumérique
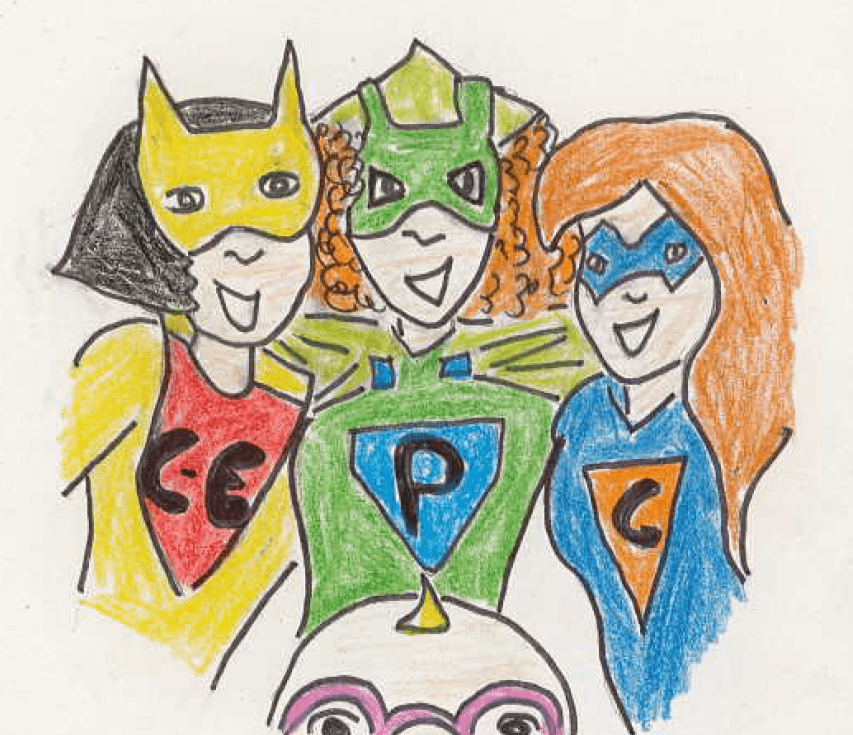
Participation, collaboration et co-élaboration
Sont les nouvelles super-héroïnes des structures culturelles. Mais qui sont-elles ? Comment les faire intervenir dans nos institutions ?
Le plus important quand on se lance dans la réflexion et que l’on veut faire appel à elles, c’est peut-être de se demander en premier lieu pourquoi on souhaite les voir apparaître ?
© Mathilde Pavaut
Pour savoir vers lesquelles se tourner, participation, collaboration ou co-élaboration, il faut se poser les bonnes questions et définir ses objectifs. La plus grande nuance entre toutes c’est le degré d’implication et d‘engagement du visiteur dans l’action, dans le projet. Ils sont tous bien sûr reliés à un autre protagoniste un peu plus caché malgré sa mise en lumière de ces derniers temps qui sont Les droits culturels :
© M.P
Tout d’abord nous allons tenter de définir les personnalités de ces trois personnages.
Participation :
© M.P
Il implique un engagement/acte physique ou mental du public. Il permet une intervention de celui-ci qui aura un impact ou non dans l’exposition ou le projet.
Collaboration :
© M.P
Implication par le fait d’être acteur / appropriation d’un sujet, d’un lieu / création collective / association à la création.
Co-élaboration :
© M.P
Elle suppose une plus grande implication du visiteur dans les projets. Présent à la naissance ou acteur de cette naissance un groupe défini (étudiants, locaux…) prend part à la mise en place d’un projet.
S’impliquer dans un projet avec l’une de ces super héroïnes permet au public de mieux comprendre tout d’abord les enjeux liés à un projet culturel. Par ailleurs, il permet au public d’exercer plusieurs de ses droits culturels comme celui de participer à la vie culturelle mais permet aussi de renforcer les liens de collaboration et la relation entre l’institution et la population locale. Ainsi ces super-héroïnes contribuent à renforcer le mieux vivre ensemble.
© M.P
Bien sûr chacune d’entre elle ne peut intervenir dans tous les projets. Il est donc bon de faire un choix, par exemple :
Je veux créer une exposition qui doit circuler hors les murs ma thématique est susceptible de croiser des thématiques de patrimoine local. Je peux faire intervenir la collaboration pour qu’une partie de l’exposition mette en valeur les archives locales.
Je souhaite créer un projet autour d’une culture définie et ses pratiques culturelles. Je peux faire intervenir la co-élaboration et construire avec une équipe projet faisant partie de cette communauté.
Je souhaite que le visiteur comprenne un mécanisme complexe d’un moteur. Je peux faire intervenir la participation et proposer par exemple un atelier de construction animé par un médiateur.
Ces différents exemples ne sont pas des injonctions. Pour définir la meilleure méthode adaptée à votre projet il convient d’analyser les différents outils à votre portée et le but recherché.
Enfin nos super héroïnes demandent du temps pour être intégrées au fonctionnement des institutions, le public est parfois difficile et doutera sûrement de son intérêt à participer. Prenez le temps de lui proposer des petites expériences avec celle-ci avant de vous lancer dans de grands projets.
Pour finir, il faut surtout prendre le temps dans ces projets car le public qui deviendra acteur n’est pas une machine et ne connaît pas comme vous les rouages des institutions, accompagnez-le en douceur !
Et si vous avez besoin d’aide tournez-vous vers les squats, tiers-lieu, communs peu importe le nom que vous leur donnez nos super-héroïnes sont déjà souvent présentes entre leurs murs !
Mathilde Pavaut
#participatif
#collaboration
#droitsculturels

Performance théâtrale pour découvrir l'art brut
La première chose que je remarque, ce sont ses pantoufles. Sous un costume noir très élégant et professionnel, le médiateur qui nous accueille à la Collection de l’Art Brut de Lausanne avec un regard qui brille d'intelligence, porte des pantoufles. D’accord, je pense en réprimant un sourire, ça doit être un exemple de la fameuse philosophie “take it easy” à la Suisse.
La visite démarre, et j’ai une deuxième surprise. Pas de contextualisation historique ou de digression artistique, pas de diligente pérégrination d’une œuvre à l’autre. Dès les premiers mots, il est clair que cette visite ne va rien avoir d’ordinaire ou de banal.
Ce jeune homme nous emporte tous (la dizaine très hétérogène de personnes qui constitue notre groupe), avec sa voix et son enthousiasme. Comme un moderne jongleur, il bouge frénétiquement d’un tableau à une sculpture, nous obligeant parfois presque à lui courir après pour ne pas perdre le fil du récit. Il parle des auteurs comme s’ils étaient des amis (le terme artistes est très controversé dans le milieu de l’art brut). Il les appelle par leurs prénoms, souvent avec une expression rêveuse ou amusée, comme s’il était en train d’évoquer des souvenirs partagés.
C’est comme cela, avec une grande douceur, qu’il nous raconte par exemple l’histoire d'Aloïse, de sa naissance en 1886, de son métier de couturière et de ses rêves de devenir cantatrice. Nous apprenons et presque vivons avec elle une passion autant brûlante qu’imaginaire pour l’empereur allemand Guillaume II et nous frissonnons en découvrant son enfermement dans un asile en 1918, suite à la manifestation d’une exaltation religieuse jugée pathologique. Pourtant ses dessins ne reflètent ni tristesse ni colère, ils sont des instantanées pris dans un univers parallèle de contes et d’amour où le rouge et les fleurs dominent le paysage.
A ce point, notre guide fait une pause et nous fait un signe de conspirateur. En se levant sur la pointe des pieds il atteint une enveloppe qui était posée au-dessus d’un tableau et il nous chuchote : “Une lettre d’Aloïse !”. Il invite alors un des visiteurs, une dame très émue, à la lire à voix haute pour tous. Pendant quelques minutes, nous pourrions ressembler à un groupe de fidèles qui se réunissent en silence dans un lieu sacré, tant la lettre et la voix qui l’accompagnent sont touchantes.
Cette première étape n’est qu’un avant-goût de l’incroyable visite qui nous est proposée. Un voyage de 45 minutes farfelu et un peu fébrile, constellé des personnages fascinants et enrichi d’éléments purement théâtraux : notre surprenant médiateur qui converse aimablement avec une chaise vide pour reproduire l’interview originale avec un des auteurs, ou une canne à pêche abandonné au dernier étage du musée par un des personnages (fictifs) de la narration.
Une fois la visite terminée, les chanceux participants n’ont pas seulement été sensibilisés à l’art brut et beaucoup appris sur plusieurs de ses représentants, mais ils auront vécu une expérience rare et, c’est le cas de le dire, magique.
Les créateurs de cette médiation sont Nicolas (metteur en scène) et Romain (acteur), futurs diplômés de la Manufacture de Lausanne (prestigieuse école de théâtre et danse). Ils ont été sollicités par La Collection de l’Art brut en occasion de la Nuit des Musées et ils ont imaginé cette déambulation extravagante. Le musée souhaitait présenter une médiation originale et n’a pas été déçu : le succès que cette médiation a rencontré est tel qu’aujourd’hui elle est insérée dans la programmation du musée. Croiser le spectacle vivant et les visites guidées n’est pas une expérience inédite dans le monde muséale, mais il est rare qu’une telle liberté soit accordée aux artistes de la part de l’institution accueillante. Nicolas et Romain travaillent pour l’imaginaire et parfois ont demandé des dérogations à l’exactitude “scientifique” : comme tromper les visiteurs en décrivant un tableau devant un autre, le cauchemar de tous les conservateurs !
Les visites de Monsieur Jean capturent et séduisent, guident dans un royaume enchanté et solennel. Seul avertissement, même si Nicolas vous quittera sans que vous ayez le temps de prendre congé des fantômes qu’il aura évoqués sous vos yeux, ils risquent de vous suivre pendant quelques temps.
Par rapport à d’autres médiations de comédiens dans un espace muséal, pourquoi est-ce plus pertinent et réussi dans ce cas ?
Lara Zambonelli
#incroyablevisite
#artbrut
#lausanne
En savoir plus :
- Collection de l’art brut de Lausanne
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne
- Les visites de Monsieur Jean
http://www.manufacture.ch/fr/2109/Les-visites-de-Monsieur-Jean
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Préhistomuseum, un musée dédié à son public
Véritable musée médiateur, le Préhistomuseum de Ramioul, situé près de Liège, privilégie l’expérimentation du visiteur dans le but « d’interroger le passé pour comprendre le présent et réfléchir au futur de l’humanité de manière systémique », selon Fernand Colin, directeur du musée.
Un apprentissage à l'âge du faire
Dans cette démarche, le Préhistomuseum propose aux visiteurs une douzaine d’ateliers faire et savoir-faire, par exemple un atelier permettant de faire l’expérience de l’allumage du feu à la manière de l’homme préhistorique. Après avoir mis à disposition le matériel, le groupe de visiteurs doit essayer d’allumer un feu, encadré par un médiateur. L’objectif de cet atelier est de faire comprendre le processus aux visiteurs par l’expérimentation et le travail d’équipe.
Pour chaque animation les concepteurs se demandent d’abord à quel type de public elle s’adresse. Les objets de la collection sont utilisés pour transmettre un message à leurs publics composés de 50% de scolaires et 50% d’individuels. Ils doivent servir de support d’apprentissage. Reprenons l’exemple de l’expérience de l’allumage du feu. Pour commencer, la médiatrice dispose plusieurs objets au sol et demande au groupe quel est leur point commun. Le groupe réfléchit, guidé par la médiatrice, pour parvenir à la réponse correcte : tous ces objets étaient utilisés pour allumer un feu par les hommes préhistoriques.
Différentes approches sont utilisées pour transmettre: systémique, immersive, sensorielle et cognitive. Dans le cas de l’allumage du feu, une approche cognitive est privilégiée : les participants sont amenés à réfléchir ensemble aux différents questionnements et au processus technique permettant d’allumer un feu.

La médiatrice a mis plusieurs objets au sol. Quel est leur point commun ? © Lisa Sécheresse
La pop-archéologie, moteur du musée
A travers le parcours permanent, le Préhistomuseum tente de sensibiliser les visiteurs à l’environnement en les poussant à se poser des questions sur leurs modes de vie et de consommation des ressources planétaires. En comparant l’impact de l’homme sur son environnement à l’ère préhistorique et aujourd’hui le visiteur prend conscience que l’homme contemporain respecte bien moins l’environnement qu’il y a des centaines de milliers d’années.
“L’humanité est passée de l’économie de l’harmonie à l’économie du déséquilibre. L’économie, c’est prélever, produire et échanger des biens et services. L’économie des peuples chasseurs-cueilleurs nomades est plus en équilibre avec l’écosystème et plus réactive que celle des peuples agriculteurs-éleveurs.”
Citation au sein de l’exposition permanente
En plus d’être un musée médiateur, Fernand Colin souhaite que le Préhistomuseum développe la co-construction avec le public. Le musée aurait alors un rôle d’encadrant et le public deviendrait acteur en co-construisant ensemble, à partir de la collection. Le musée de demain ? »
Lisa Sécheresse
#Préhistomuseum
#Préhistoire
#Poparchéologie

Prescriptions muséales, vers le soin ?
Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art et des musées dans l’amélioration de la santé et du bien-être ?
Prescription muséale © Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Dans le Dictionnaire de Muséologie, la muséothérapie est définie par la chercheuse en neuroesthétique Dorota Folga Januszewska et le précurseur de cette discipline en Pologne Robert Kotowshi, comme :
“ L’utilisation des collections, de récits, d’espaces et de dispositifs expographiques comme solutions thérapeutiques pour traiter certaines maladies. La muséothérapie vise à contribuer à l’amélioration du bien-être, de la santé physique et mentale et de la stabilité émotionnelle des participants, et à concourir à la quête d'identité par le contact direct avec la culture, l’art et l’environnement naturel.[1] “
Le développement des neurosciences, dont la neuroesthétique à la fin du XXème siècle, a contribué à faire du musée un lieu d’éducation multisensorielle et de développement de la perception[2].
La muséothérapie est aussi intimement liée à la neuromuséologie, qui a d’abord été étudiée en Pologne. Cette discipline est rattachée aux recherches à propos de la neuroperception, autrement dit aux liens créés entre la visite du musée et la perception multisensorielle et la réception émotionnelle des visiteurs[3].
C’est dans ce sillage que des établissements tels que le Musée national de Kielce (Pologne) et le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) (Canada) ont été les premiers, dans les années 2010, à intégrer parmi leurs actions culturelles des séances de muséothérapie.
Le MBAM a inauguré en 2016 l’Atelier International d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière[4]. Il s’agit du plus grand complexe éducatif dans un musée d'art en Amérique, et accueille chaque année plus de 300 000 participants grâce à la collaboration d’art thérapeutes, d’experts du milieu de la santé ou encore d’éducateurs[5].
La collaboration entre Nathalie Bondil, à ce moment-là directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, et l’association Médecins francophones a permis d’initier dès 2018 la prescription de visites gratuites du MBAM à des patients souffrant physiquement ou mentalement[6].
La muséothérapie fait l'objet de multiples expérimentations depuis les années 2010, et se développe au sein de plus en plus d’institutions muséales françaises.
Le point de départ des actions santé du Palais des Beaux-Arts de Lille (PBA) prend place dès 2008 avec un projet visant à accueillir des enfants, adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles de la sphère autistique. L’équipe projet était composée d’une chargée de médiation, d’une art thérapeute et de quatre artistes plasticiens qui ont mis en place des ateliers de pratiques artistiques et de découverte des œuvres suivant un rythme hebdomadaire de manière à assurer le bon suivi des séances[7].
Le 6 novembre 2023, le CHU de Lille et le PBA ont signé une convention de partenariat dans le but de développer à leur tour la prescription muséale. Sachant que dès 2012, deux art-thérapeutes avaient déjà intégré l’équipe et accueillaient des patients issus de services tels que l’oncologie, l’addictologie et la pédopsychiatrie. Ce partenariat avec le CHU de Lille permet de faire de la muséothérapie l’un des piliers de la politique d’accueil et d’implication des publics du PBA. Le musée propose depuis 140 ateliers d’art-thérapie par an, pour accueillir jusqu’à 1 400 patients issus des services du CHU de Lille[8]. Des séances sont aussi ouvertes aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer suivis au Centre Mémoire du CHU[9].
Inauguré en 2012, le Louvre-Lens a pour objectif d'ouvrir à tous l'accès aux collections nationales, et mène depuis son ouverture une politique d’actions singulières en matière de santé et de bien-être.
Des partenariats et des projets-pilotes sont co-élaborés depuis 2014 avec le Centre hospitalier de Lens, mais aussi avec des professionnels du monde médical, hospitalier, associatif, universitaire et muséal. C’est depuis 2023 que le Louvre-Lens a ouvert un nouveau programme de séances gratuites : le Louvre-Lens-Thérapie[10]. Les médecins du centre hospitalier peuvent aussi prescrire, sous la forme d’un bon, des visites au musée à leurs patients[11] avec l’accompagnement d’un art-thérapeute et une médiatrice culturelle.
L’exploration de la muséothérapie, notamment par le biais des prescriptions muséales, permet de faire du musée un laboratoire visant à stimuler des sensations de bonheur, d’introspection, la réduction du stress et s’attache à contrer l’isolement. Mais peut-on réellement aider les patients en leur proposant d’aller au musée ? Peut-on véritablement parler de soin, de cure ?
Nathalie Bondil considère la muséothérapie comme un outil de santé publique. Elle explique lors d’une interview pour le SITEM que les organisations internationales, telles que l’ICOM, l’OCDE et l’OMS ont validé cette approche, et soutiennent diverses recherches[12].
En effet, le rapport de 2019 de l’OMS intitulé « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being ? » [Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art dans l’amélioration de la santé et du bien-être ?] recense plus de 3 000 études scientifiques qui ont permis de conclure que les arts jouent un rôle important dans la prévention des problèmes de santé, la promotion de la santé, ainsi que dans la prise en charge et le traitement des maladies[13] tout au long de la vie des patients[14].
La muséothérapie s’inscrit dans une dynamique plus large d’inclusion sociale au sein des musées. Bien que cette discipline soit encore en développement, avec des recherches relativement récentes, les spécialistes s’accordent pour dire qu'une influence positive sur les patients est observée. Il est alors essentiel d'encourager la collaboration entre le monde de la santé et l'univers muséal, afin d’évaluer rigoureusement les nouvelles études de terrain qui confirmeront sans doute, à terme, les effets thérapeutiques des musées[15].
Solène Bérus
[1] F. MAIRESSE (dir.), 2022, Dictionnaire de muséologie, Paris, Armand Colin, p. 446. ↩
[2] Sztuka i Filozofia, https://artandphilosophy.pl/wp-content/uploads/2020/11/SZiF_42_05_Folga.pdf, publié en 2013, Dorota Folga‑Januszewska, Museum vs. Neuroesthetics [consulté le 17/10/2024]. ↩
[3] F. MAIRESSE (dir.), 2022, Dictionnaire de muséologie, Paris, Armand Colin, p. 457. ↩
[4] La Lettre de l’OCIM, https://journals.openedition.org/ocim/1896, publié en ligne le 01/01/2019, Mélissa Nauleau, Musée + Art-thérapie = Muséothérapie ? [consulté le 14/10/2024]. ↩
[5] Musée des Beaux-Arts de Montréal, https://www.mbam.qc.ca/fr/actualites/inauguration-nouveau-pavillon-paix-michal-renata-hornstein/, publié le 05/11/2016, Semaine d'inauguration du nouveau Pavillon pour la Paix [consulté le 14/10/2024]. ↩
[6] Médecins francophones du Canada, https://www.medecinsfrancophones.ca/un-projet-pilote-novateur-pour-le-mieux-etre-des-patients-par-lart-prescriptions-museales-mbam-mdfc/, publié le 30/10/2018, Un projet-pilote novateur pour le mieux-être des patients par l’art : Prescriptions muséales MBAM-MdFC [consulté le 15/10/2024]. ↩
[7] Palais des Beaux-Arts de Lille, https://pba.lille.fr/Visiter/Groupe/Sante-et-Art-therapie/Lancement-du-Guide-museal-pour-l-accueil-des-personnes-autistes, date de publication inconnue, Lancement du Guide muséal pour l’accueil des personnes autistes [consulté le 17/10/2024]. ↩
[8] Club Innovation & Culture CLIC France,https://www.club-innovation-culture.fr/palais-beaux-arts-lille-chu-lille-prescription-museale-convention/#:~:text=La%20prescription%20mus%C3%A9ale%20est%20un,%2C%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20chant%E2%80%A6 , publié le 09/10/2023, En signant une convention triennale, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le CHU de Lille vont développer la prescription muséale [consulté le 17/10/2024]. ↩
[9] Club Innovation & Culture CLIC France,https://www.club-innovation-culture.fr/palais-beaux-arts-lille-chu-lille-prescription-museale-convention/#:~:text=La%20prescription%20mus%C3%A9ale%20est%20un,%2C%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20chant%E2%80%A6 , publié le 09/10/2023, En signant une convention triennale, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le CHU de Lille vont développer la prescription muséale [consulté le 17/10/2024]. ↩
[10] Le Mag, Le Louvre-Lens des entreprises, https://lemag.louvrelens.fr/evenements/initiation-a-la-museotherapie-au-louvre-lens/#:~:text=En%202023%2C%20le%20Louvre%2DLens,nous%20renvoie%2Dt%2Delle%20%3F, publié le 16/05/2024, Initiation à la muséothérapie au Louvre-Lens [consulté le 16/10/2024]. ↩
[11] France Bleu Nord, https://www.francebleu.fr/emissions/fier-de-ceux-qui-font-bouger-le-nord-et-le-pas-de-calais/la-museotherapie-avec-gunilla-lapointe-chargee-des-mediations-au-louvre-lens-2770086, diffusé le 16/10/2023, La muséothérapie avec Gunilla Lapointe chargée des médiations au Louvre Lens [consulté le 17/10/2024]. ↩
[12] SITEM, https://www.sitem.fr/conferences/le-musee-therapeute/#:~:text=La%20%C2%AB%20mus%C3%A9oth%C3%A9rapie%20%C2%BB%2C%20un%20outil%20en%20sant%C3%A9%20publique&text=Ce%20concept%20consid%C3%A8re%20le%20mus%C3%A9e,les%20neurosciences%20et%20la%20m%C3%A9decine, publié le 15/09/2021, Le musée thérapeute [consulté le 14/10/2024]. ↩
[13] Art For Science, https://www.artforscience.eu/plus-de-900-publications-scientifiques-traitent-des-effets-de-lart-culture-sur-la-sante-selon-le-rapport-du-11-novembre-2019-de-loms/, publié le 06/07/2020, Plus de 900 publications scientifiques traitent des effets de l’art & culture sur la santé, selon le rapport du 11 novembre 2019 de l’OMS [consulté le 15/10/2024]. ↩
[14] Organisation Mondiale de la Santé, https://who-sandbox.squiz.cloud/fr/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019, publié en 2019, Daisy Fancourt, Saoirse Finn, Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art dans l’amélioration de la santé et du bien-être ? [consulté le 17/10/2024]. ↩
[15] Les cahiers d’études de l’observatoire de l’Ocim, https://www.calameo.com/read/0057770602ca344bce4cf, publié en 2021, Leslie Labbé, La muséothérapie, analyse des potentiels thérapeutiques du musée [consulté le 22/10/2024]. ↩
Pour aller plus loin, plusieurs journées d’études sont prochainement organisées à ce sujet :
- Les 52 minutes d’ICOM France - Des musées en leur temps : « Le musée qui soigne, du care au cure : la muséothérapie. » Le jeudi 31 octobre 2024 à 12h30 // En ligne. https://www.icom-musees.fr/actualites/le-musee-qui-soigne-du-care-au-cure-la-museotherapie
- Rencontres professionnelles Occitanie Musées : « Musée et soin : du care au cure ? »
Le 21 novembre 2024 à 14h30 // présentiel Université Paul Valéry Montpellier III, et en ligne. - https://www.mbam.qc.ca/fr/education/mieux-etre/
- https://pba.lille.fr/Agenda/LES-ATELIERS-D-ART-THERAPIE
- https://www.louvrelens.fr/activity/louvre-lens-therapie/

Réinventer le musée
Chaque année, de nombreuses structures muséales se lancent dans des rénovations, quand d'autres en sortent. Si chaque projet est unique, et que tous les musées ne poursuivent pas forcément le même but en commençant un chantier de rénovation ou d’agrandissement, une volonté revient souvent : celle d’ « améliorer le confort et l’expérience de visite ».
Dans le cadre d’une rénovation d’un musée ou de la création d’une extension, les institutions ont chacune une démarche qui leur est propre et qui relève du fonctionnement inhérent à la structure. Il existe donc autant de façons de réinventer le musée que de musées. A l’appui d’exemples de musées récemment visités par les étudiants du Master Expographie Muséographie, voici une courte synthèse de ce qui me semble important dans une « bonne » rénovation.
Réinventer… la mise en espace
Dans le cadre d’une rénovation ou de l’agrandissement d’un musée, plusieurs éléments sont remis en questions, repensés, retravaillés, réinventés. Lors de la réouverture, le plus frappant pour le visiteur est le changement de la mise en espace des collections et du propos. On pourrait considérer qu’une rénovation est réussie lorsqu’il est possible de constater une cohérence entre le fond et la forme, entre les contenus et les ambiances. Une mise en espace réussie doit présenter une théâtralisation adaptée, une ambiance particulière qui englobe le spectateur et le fait voyager, rêver, ressentir.
En principe, un projet de rénovation ou d’extension de site démontre une volonté de renouvellement, de changement et de nouveauté. Pourtant, toutes les institutions ne poursuivent pas ce but. L’exemple du Musée Carnavalet de Paris, qui a rouvert en 2021 après quatre ans de travaux, est assez parlant : malgré la rénovation du lieu, la mise en espace reste très classique. Certes, la scénographique s’adapte d’abord au bâtiment : dans le cas de bâtiments anciens et classés, tels que le Musée Carnavalet, créer une scénographie nouvelle et immersive peut s’avérer un défi de taille. De taille, mais pas impossible, puisque c’est le choix qu’ont fait d’autres musées qui présentent le même type de collections. Il en va ainsi du Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, avec ses nouveaux espaces consacrés aux XXème et XXIème siècles qui ont ouverts en 2021. Comme Carnavalet, il s’agit d’un bâtiment classé, avec de nombreuses contraintes et une collection variée.
Les collections d’Histoire, comme les collections ethnographiques sont « difficiles » à traiter : éviter la théâtralisation caricaturale, ne pas figer les objets derrière des vitrines… Comment agencer une collection comme celle-ci, et faire face à son aspect « pétrifié » dans le temps et dans l’espace ? Le Musée d’Aquitaine, pour son nouveau parcours, met en avant les mutations de la métropole bordelaise et les aspects attractifs de l'espace aquitain. Il invite à découvrir l'histoire récente de Bordeaux. Sculptures, peintures, objets d'ethnographie et maquettes se mélangent donc à des projections en grand format, des écrans interactifs et des ambiances sonores qui donnent au visiteur une véritable impression de « voyage ». Le tout est scénographié sobrement : les panneaux en bois prennent des formes variées qui rythment subtilement la visite.

Salle du Musée d'Aquitaine de Bordeaux dédiée au XXème siècle© L.G.L.
Une scénographie plus immersive est donc très appréciable aujourd’hui si elle est correctement construite. Le musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, qui présente lui aussi des collections variées allant des spécimens naturalisés aux œuvres d’art en tout genre (peintures, dessins, sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie, céramiques, armes, trophées, armures, meubles, installations, photographies, vidéos…) a fait le choix, tant pour l’étage rénové et rouvert en 2021 que pour les espaces plus anciens, d’une mise en espace immersive au sein de laquelle le visiteur est plongé dans un cabinet de curiosité XXL. Cette originalité fonctionne et fait d’ailleurs la renommée du musée, puisqu’elle laisse au visiteur un souvenir impérissable.

Ambiance « cabinet de curiosités » au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris© L.G.L.
Il est impossible d’évoquer la scénographie immersive sans dire un mot du Naturalis Biodoversity Center de Leyde, rouvert en 2021 après des années de travaux et l’installation des collections dans un bâtiment flambant neuf. Cette rénovation a permis de déployer un parcours immersif sur près de 6000 m², plongeant le visiteur dans une véritable expérience sensible. Naturalis représente le parfait exemple de ce que signifie un « musée d’aujourd’hui » : un musée qui fait la part belle à la scénographie, de plus en plus importante, mise en valeur en tant que telle (on admire autant la beauté du « décor » que la perfection des spécimens naturalisés ou la clarté du discours).
Ainsi, les nouveaux projets muséographiques qui, à l’instar de Naturalis, se veulent modernes, auront tendance à aller vers un parcours très immersif pour faire le lien entre le public et les collections. Cela peut être, on s’en doute, à double tranchant, car il faut toujours veiller à l’équilibre entre la forme et le fond, si l’on ne veut pas tomber dans « l’exposition spectacle » à l’anglo-saxonne, où le fond passe parfois totalement au second plan. Un musée rénové réussi est donc un musée qui donne à voir une scénographie réfléchie.
Réinventer… la médiation
La médiation est également repensée dans le cadre de projets d’extension et de rénovation. Le contact avec les publics est nécessairement remis en cause, et nécessite une réflexion quant au devenir du personnel de médiation.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, rouvert en 2021, propose un dispositif de médiation qui n’a, à première vue, rien de novateur, et qui n’est pourtant pas si courant dans ce genre de structure. En effet, le Muséum emploie, en contractuel, une équipe d’une quinzaine de jeunes médiateurs scientifiques, qui déambulent dans les salles du musée accompagnés d’un chariot de démonstration (contenant des spécimens naturalisés, fossiles, minéraux, etc.), et proposent aux visiteurs intéressés quelques explications supplémentaires. La création de ce contact est doté d’un tel potentiel que cette initiative semble être le plus gros atout du Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux.

Un médiateur scientifique et son chariot de démonstration au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux© L.G.L.
Rien ne remplace la médiation humaine et l’échange pour permettre la compréhension d’un contenu. La création de liens avec la collection au travers d’une personne est sans aucun doute ce qui rend l’expérience mémorable. Je pense notamment aux publics dits « éloignés », qui n’ont pas accès aux musées et à la culture et à qui une institution de ce genre peut paraître obscure, imperméable. La présence des jeunes médiateurs au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux est une solution pour répondre à cette problématique.
Pour autant, l’apport de la médiation numérique dans les musées n’est pas à négliger. Cela reste un bon moyen de faciliter l’entrée dans le contenu ainsi que son approfondissement. La démocratisation du numérique dans les musées est encore sujet très actuel, bien qu’il soit sur le devant de la scène depuis quelques années maintenant. Sans m’y attarder, j’aimerais pointer du doigt un exemple du « trop » de numérique. Le Muséon Arlaten, rouvert en 2021 après onze années de fermeture pour travaux, a en effet fait le choix de ne plus présenter les cartels des œuvres exposées dans les vitrines. Les informations concernant un objet sont désormais à aller chercher sur des tablettes numériques situées dans les pièces. S’il est évident que l’objet « cartel » peut être repensé dans le cadre d’une réfection de parcours, il semble important de garder, pour chaque objet, un cartel propre et auquel le visiteur peut avoir accès d’un coup d’œil. Cela favorise la découverte, quand l’élément de médiation mis en place par le Muséon Arlaten faillit selon moi à son rôle en favorisant la perte d’informations.
La salle « LivingScience » du Naturalis Biodiversity Center est un espace où sont présentées des collections, où sont organisées des projections, mais également où se trouvent des laboratoires « ouverts » où il est possible d’observer les chercheurs de l’institution en plein travail. Ouvrir ces espaces rarement accessibles aux publics constitue l’un des points forts de Naturalis avec sa pédagogie autour de laboratoires visibles et mis en scène. En misant sur des notions d’ouverture et de transparence, le musée met en exergue ses activités ainsi que les savoir-faire qui participent à leur mise en valeur. Bien plus qu’une vocation éducative, l’institution cherche à avoir un impact sur la vie culturelle, scientifique et sociale. Véritable laboratoire de recherche, Naturalis permet aux publics d’échanger avec ceux qui font la science. Ce procédé tend à valoriser l’implication des publics dans les innovations culturelles et scientifiques, et à créer un engouement pour des sujets hors du commun. La médiation s’insère donc dans un parcours de visite qui se veut participatif à l’aide de dispositifs permettant l’échange et le contact. Faire du visiteur un acteur à part entière, qui développe son propre regard critique, est essentiel.

Le laboratoire ouvert de l'espace "LivingScience" au Naturalis Biodiversity Center de Leyde© L.G.L.
Cet aperçu sommaire n’a pas vocation à servir de référence, mais à montrer que réinventer le musée n’est pas chose aisée. Évidemment, toutes les expositions ne posent pas les mêmes contraintes, spécifiques à chaque lieu. De même, les moyens et liens entre les différents acteurs d’un projet de rénovation ou d’extension sont propres à l’institution et à ses partenaires. Mais dans ces conditions, il convient de bien s’entourer, puisque l’on a constaté par exemple l’importance de la scénographie « médiatrice » et son influence sur le visiteur, l’état d’esprit de ce dernier et son appréciation globale de l’exposition. Une mise en espace intelligente constitue un premier contact réussi entre le public et les collections, mais élaborer des concepts plus modernes pour redonner un nouveau souffle à certains espaces ne suffit pas toujours. La médiation humaine reste indispensable au sein des musées. L’intégration des publics dits « éloignés » ne se fait que grâce au contact humain.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Compte-rendu de la journée de réflexion « Musée à rénover » du Museon Arlaten
#Rénovation #Muséographie #NouveauxMusées
Socratiser les musées ?
Cyril Blondel est fondateur de la maison d’édition de jeux Flip Flap Editions(2013) et de l’association in philo(2010). Il a été muséographe au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq de 2001 à 2014.
Aujourd’hui il est muséographe, concepteur de jeuxet animateur d’ateliers philosophiques, activités qu’il porte avec FlipFlap.
Depuis dix ans, Cyril Blondel mène une réflexion basée sur une approche socratique des musées, tant par l’animation que par la muséographie. Rencontre avec ce Socrate du XXIème siècle :
Que porte l’association In Philo ?
J’ai fondé l’association in Philolorsque j’étais encore au Forum des Sciences, en 2010. L’objectif était de créer une ouverture en proposant des visites à portée philosophique dans les écoles et dans les musées.
L’une des motivations à la création de ces visites était de trouver une valorisation au métier d’animateur, très peu reconnu à l’époque. La réflexion a été de trouver une méthode pour que les animateurs aient une identité propre et qu’ils ne soient pas remplaçables par des audioguides, comme le savoir peut l’être. L’idée était aussi de briser la routine qu’imposent les formats classiques des visites guidées.
Quel est le principe des « ateliers philo » ?
Le principe est d’arriver à mener des visites basées uniquement sur le questionnement. La contrainte de l’animateur est de n’utiliser que des questions. Aucune phrase affirmative. C’est assez radical, en lien avec une formation à l’art du questionnement.
Le choix de la philosophie donne du sens au fait demettre de l’humain dans les expositions. La capacité de répartie de l’Homme s’impose par rapport à la machine. De même, le fait d’être en groupe doit aussi être porteur de sens. Avec le groupe on peut jouer de l’altérité et se poser laquestion de ce que nous renvoie l’autre.
La grande force d’un animateur, hormis l’art du questionnement, c’est l’écoute. L’objectif étant d’avoir des visites les plus interactives possibles pour qu’elles soient impliquantes et ascendantes.
A qui s’adressent ces visites ?
Elles s’adressent à tous, quel que soit l’âge, même aux plus petits. En fait, c’est la réception qui varie en fonction des âges.
De 7 à 14 ans la réception est assez cool et naïve, il y a une propension à donner son avis assez naturellement. Ils se livrent facilement.
Vers la fin du collège, il y a un positionnement un peu plus politique vis-à-vis du groupe, on sent l’importance du regard de l’autre. Et il y a déjà un « formatage » de la pensée par le milieu scolaire : ils cherchent la bonne réponse.
Au lycée c’est un peu plus fluide, c’est assez facile de discuter, ils sont très à l’aise avec cette formule.
En revanche, chez les adultes, c’est drôle parce qu’on retrouve la crainte du groupe et la recherche des bonnes réponses.
C’est là que l’animateur joue un rôle clef, au-delà de la maîtrise du questionnement, il faut savoir rester un peu « fun » pour mettre le groupe à l’aise, il faut savoir animer ! C’est un vrai métier et fortement identitaire. Aujourd’hui si tu te dis animateur tu dois être capable d’aller n’importe où puisque ta connaissance serait de savoir animer, indépendamment du thème.
Comment prépares-tu la visite ?
Pour un animateur qui possède l’art du questionnement, le sujet qu’il traite est prétexte. Ce qui se prépare n’est pas forcément le Savoir mais plutôt le lieu et ce qu’il offre. Je cherche les « beaux problèmes ». Que peut-on faire dans un lieu, avec des gens, qui sera questionnant ?
J’aime bien jouer sur l’étymologie du mot question, questa, c’est clairement ça, on cherche la quête. Quelle quête vas-tu proposer aux gens qui soit suffisamment mystérieuse et énigmatique pour qu’ils acceptent d’y plonger sans trop de difficultés ? Ça prend du temps. Il faut se plonger dans le lieu ou dans l’exposition pour bien saisir le problème. En fait, je ne bosse quasiment pas le Savoir, pour garder une certaine égalité avec les visiteurs. Le but est plutôt de se demander s’il manque des choses, de trouver les petits paradoxes soulevés, etc. Bien sûr il faut que la structure joue le jeu et accepte que ce qu’elle montre ne soit pas "vérité".
Une autre étape de la préparation est de penser lagestion des flux et du rythme pour que ça ne soit pas trop statique. Comment utiliser les collections et l’espace ? Après, tout dépend de la dynamique du groupe et des personnes que tu as en face de toi. Par exemple, il y a certains groupes qui sont capables de rester une demi-heure à discuter dans la même salle ! C’est une des contraintes de l’animateur de savoir s’adapter aux personnes qu’il a devant lui.
Tu as fait des visites au Palais des Beaux-Arts, au LaM et au Musée d’histoire naturelle de Lille. Tu sembles bien ouvert à n’importe quelle thématique ! Quels sujets te plaisent en particulier, et pourquoi ?
Ah oui ! Moi je suis une vraie prostituée de la philo ! (rires)
En fait, dans la démarche philosophique, si on symbolise rapidement, il y a trois principes : problématiser, argumenteret conceptualiser.
La question que je me pose en permanence quand je cherche à problématiser c’est : Comment donner envie de faire de la philo ? Pour ça, on en revient à la base, c’est de trouver la bonne quête ! Au LaM on a traité de « L’art en question ». On tournait autour de la question « Que pensez-vous de l’art d’une manière générale ? ». En réalité la question portait surtout sur l’art moderne et contemporain, l’art brut soulève de lui-même ce questionnement, « Qu’est-ce qui est art ? ».
Au Musée d’histoire naturelle, c’était dans Identités, une exposition sur la représentation des différents continents. Il y avait une vitrine qui manquait, celle de l’Europe. On a donc travaillé à réfléchir aux objets que l’on mettrait dans cette vitrine si on devait représenter l’Europe. Cette réflexion ouvrait à de multiples questionnements très riches sur notre identité, en tant qu’européen. Chacun se sentait concerné. Dans chaque thème que je choisis, mon but c’est de faire raisonner le sujet chez lesvisiteurs, en eux-même.
J’ai beaucoup d’idées de thèmes comme ça que j’aimerais creuser au Musée d’histoire naturelle comme « Pourquoi classer ? », « L’exception confirme-t-elle la règle ? », « A partir de quand on sait que quelque chose est vivant ? » etc.
Globalement, je choisis des sujets qui sont assez drôles et poético-absurdes. En fait, quand tu es animateur tu recherches ce qui, dans ton cerveau, va te donner du plaisir en terme de pensée.
Comment se déroule une visite ?
En introduction de la visite je me présente aux personnes en leur disant « Je vous préviens je n’y connais rien, le but est de prendre le temps de se questionner sur ce qu’on va voir et sur ce que vous pensez de ce qu’on va voir ».
Je commence par la problématisation, avec un élément « perturbateur », problématisant. Au LaM par exemple, je choisis de mettre le public devant une œuvre « questionnante ». Souvent, j’essaie de mettre le public face à un choix binaire, assez fermé, pour qu’il y ait d’entrée de jeu une forme de positionnement qui divise le groupe. Avant ça, quand je faisais des visites je terminais toujours par un débat. Aujourd’hui, je commence par lui, comme ça il nous porte tout au long de la visite.
Ensuite, il y a le corps de la visite en elle-même qui consiste à travailler l’argumentation et donc de provoquer du questionnement perpétuel. Dès qu’il y a quelque chose qui est annoncé on va le rebasculer avec un autre exemple. C’est là qu’une forme d’improvisation entre en jeu et qu’on voit si on sait animer. C’est à l’animateur de s’adapter à ce que chaque groupe amène, c’est lui qui doit chercher comment il va le provoquer. Il doit sans cesse réalimenter la discussion par des nouvelles questions.
Tout au long de la visite je prends des notes, à la fin ça donne une sorte de carte mentale de toutes les problématiques que nousavons évoquées et on cherche alors à conceptualiser les idées.
Pourquoi avoir choisi le matériel « question » ?
Pour moi, quand tu amènes une belle quête, c’est plus facile d’impliquer les gens. Je pense d’ailleurs qu’on a tous un petit côté comme ça, Sherlock Holmes ou Indiana Jones ! Le travail c'est donc de trouver la plus belle quête et question possible.
La question c’est en même temps un objectif et un outil qui permet de provoquer beaucoup de choses. Bien sûr, rien de nouveau, c’est très socratique ! Ce qui est important, c’est d’avoir conscience de ce que tu peux provoquer.
Dans l’usage des questions il y en a, entre autres, deux types utilisés : les questions fermées et les questions ouvertes. Les deux présentent des intérêts. Les questions fermées sont clivantes, c’est intéressant pour le jeu dans l’espace. Par exemple si je propose oui ou non à un groupe et que je leur dis que ceux qui pensent oui se mettent à gauche et ceux qui pensent non se placent à droite, ça crée du mouvement, ça dynamise et surtout ça oblige à assumer un positionnement. La question clivante peut très vite être dérangeante, elle impose d’assumer une prise de position et elle peut vite révéler des choses de fond.
Quand on discute, on peut faire appel aux questions ouvertes, mais elles sont plus compliquées à gérer. En philosophie socratique, on dit que « c’est quand tu es contraint que tu réfléchis », donc plus je te mets de la contrainte, plus je t’oblige à réfléchir. La question ouverte est intéressante pour voir dans quel champ sémantique la personne a envie de s’émanciper, mais ensuite il faut refermer un peu. C’est un jeu de dosage et d’alternance entre questions ouvertes et fermées. C’est la bonne mesure entre liberté et contrainte qui fait que tu prends du plaisir.
La question a aussi une force assez poétique. Jetrouve passionnant de faire découvrir aux gens que simplement avec deux ou trois questions tu peux voir le monde sous un autre angle. Et ça peut changer une trajectoire, c’est ce qui s’est passé pour moi et j’espère pouvoir parfois le révéler chez les autres. J’étais très cartésien, très convaincu par la science et je suis passé de l’autre côté, le côté obscure de la force ! (rires)
Quels sont les objectifs des visites ?
S’élever, dans le sens d’une élévation de pensée. Et être confronté à ta propre opinion. Il y aussi l’appréhension de l’autre : en quoi ai-je besoin de l’autre pour m’élever ? Et une forme de complexité. Un des premiers chocs philosophiques fut La Complexité d’Edgar Morin. On est tellement habitué à tout découper en morceaux que finalement l’objectif c'est de remettre un peu de transdisciplinaire, de réussir à mettre du lien entre les connaissances. Comment donnes-tu de l’importance aux choses sachant qu’il y a un peu de tout dans tout ? C'est un vrai travail…
Redoutes–tu le silence ?
Non au contraire, je cherche le silence ! En fait c’est ce qu’on appelle les« blancs de pensée ». Quand tu arrives à un blanc c’est que le travail a été fait, la réflexion est en route. C’est à ce moment que se passe l’élévation.
En tant que muséographe, quelle est la place de la question dans les expositions selon toi ?
Là c’est vraiment la recherche de la quête qui s’impose (et oui,encore !), il faut chercher le meilleur objectif. Au début je prenais un thème, et même en trouvant quelques petites curiosités, on faisait plutôt du découpage pluridisciplinaire. C’est en 2007 que j’ai commencé à changer ma façon d’appréhender la conception d’exposition. Ce qui a changé c’est de penser l’objectif sous la forme de question, ça change vraiment tout !
En 2007 justement, je devais concevoir une exposition sur « le cycle de la vie » au Forum. Alors je bosse sur le sujet et je découvre que la notion de vie n'est pas définie précisément par la science ! Il y'a un faisceau de présomptions mais il y a aussi des inconnus…J’ai deux possibilités : soit je montre l’état de la science telle qu’elle est au stade où je travaille le sujet, c’est-à-dire une vérité temporaire, ou alors, et c’est là que j’ai changé ma manière, je fais de l’absence de définition, le jeu de l’exposition.Je suis donc passé à un nouvel objectif, sous forme de question : « A partir de quand peut-on dire que quelque chose est vivant ? ». Ensuite, quand tu crées, tu t’interroges sur les modules à créer pour que cette questionraisonne dans la tête des visiteurs. Ce qui doit s’inscrire c’est la question. Il faut donc trouver les modules devant lesquels les gens se disent « A partir de quand est-ce vivant ? ». Au début, dans la conception c’était : un module, un objectif. Dans cette nouvelle démarche c’est l’inverse, tous les modules révèlent une même question. Il faut alors réussir à définir un parcours général qui inscrit la question dans la personne. Le but est d’arriver à faire partir la personne avec la question, en conscience. La personne doit même pouvoir se dire « Waouh ! Quelle énigme ! ».
Muséographiquement parlant, la grande différence c’est que tu crées avec la volonté de faire repartir les gens avec la question et de manière impliquante, le graal c’est quand ils se disent « Waouh il y'a un de ces champs de recherches qui s’offre à moi ! ».
Une exposition réussie selon toi ?
Pour moi, une exposition réussie c’est quand tu as réussi à inscrire dans la personne une question de qualité et de provoquer une implication citoyenne : à minima d’induire une prise de conscience et à maxima de provoquer une implication concrète.
Si je devais résumer en un seul mot, c’est de créer une curiosité sur le sujet.
Et quelle différence entre le métier de muséographe et d’animateur ?
Finalement la démarche d’un muséographe est un peu la même que les artistes : on crée des modules pour révéler une question dans la personne.
L’exposition doit être questionnante, et l’animateur lui, vient s’enfoncer dans l’argumentation, il pousse les gens au plus profond de leur capacité à réfléchir.
Entretien mené par Juliette Gouesnard
En savoir plus :
Séminaire « Visitesaux musées » au LaM, tenu le 7 juin 2017
Cyril Blondel intervient parfois comme formateur dans le cadre des stages de l’OCIM, il intervient notamment dans des formations sur la place de la question dans la médiation et dans la conception de jeux pour les expositions.
Découvrez sa maison d’édition de jeu Flip Flap.

Supermaket Lady au musée ?
Cet article pose la question de la pertinence des actions culturelles hors les murs comme stratégie publicitaire des institutions muséales. Venir à la rencontre des publics : Où? Quand? Comment?

Stand d'action hors les murs “animaux fantastiques” au Westfield Euralille © Giulia Guarino
Lors d'une flânerie lilloise le 31 octobre, je m'engouffre, je dois l'avouer à contrecœur, dans le temple du capitalisme et de la fast-fashion décomplexée : Westfield Euralille.
En quête de faire quelques emplettes, je tombe nez à nez sur une signalétique intrigante. Des grosses pattes bleues collées au sol m'indiquent de poursuivre mon chemin afin de rencontrer les animaux fantastiques. Je comprends donc rapidement que je me dirige vers une action hors les murs inscrite dans la programmation du Louvre Lens dans le but de promouvoir l'exposition actuelle, Les animaux fantastiques. La curiosité me pousse à continuer jusqu’à ce que s'érige devant moi un stand assez important, s'inscrivant étrangement bien entre Primark et H&M.
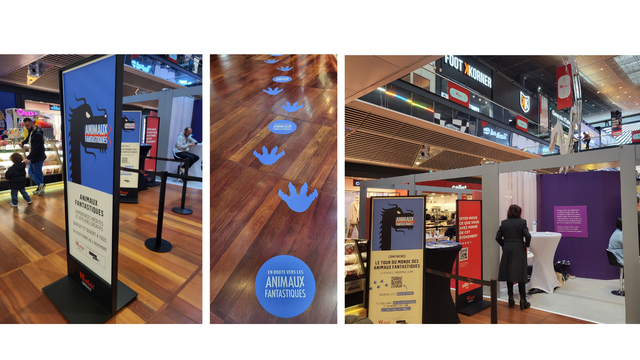
Signalétique de l’expérience « Animaux Fantastiques » au centre commercial Euralille © Giulia Guarino
Le panneau introductif permet aux visiteurs (qui sont avant tout consommateurs dans ce contexte centre commercial) de mieux comprendre la présence de ce stand « Expériences inédites et ateliers créatifs ». Trois activités distinctes sont proposées, visant différents publics et constituant ainsi un îlot assez important. L'ensemble se conjugue au travers d'une scénographie sommaire mais plutôt efficace au vu de la queue d'attente générée avant même l'ouverture des portes. Des agents accueillent les curieux, les renseignent et leur expliquent le contenu de l’expérience. Quatre casques de réalité virtuelle sont mis à disposition avec des assises afin d’offrir une expérience immersive autour d’une légende anglo-saxonne du monstre Beowulf. Afin de gérer au mieux le flux de participants, une liste d’attente est imposée pour s’inscrire à un créneau horaire précis. Un sentiment de rareté et de privilège naît alors chez le passant, de quoi susciter un engouement certain.
Grâce à un atelier créatif, dessins et coloriages permettent aux enfants (mais également aux parents et adultes) de s'approprier et de réinterpréter ce vaste imaginaire des Animaux Fantastiques. Un certain nombre de tables disposées ici et là offre feutres et papeteries.

Vues de l’îlot créatif et des cimaises de présentation © Giulia Guarino
L’expérience se finit par un Photo Booth gratuit pour immortaliser le moment et repartir avec un souvenir. Des cartels explicatifs proposant des focus ponctuent l’espace et exposent des images d’œuvres présentées au Louvre Lens
Après une demi-heure d’attente, je m’installe sur une assise et un responsable de l’activité m’explique précisément les consignes induites par l’utilisation du casque de VR. Le casque, par son option Hand Tracking, figure parmi les casques les plus avancés technologiquement. La fonction de suivi des mains dans la réalité virtuelle permet aux utilisateurs d'interagir avec des objets et des environnements virtuels, sans avoir besoin de manette comme sur les anciennes générations de VR. Cette expérience nous plonge dans un récit d’une dizaine de minutes à la rencontre de Beowulf, un gigantesque dragon tiré d’un poème épique datant du VIII siècle. Après avoir navigué dans un cabinet de curiosité mystérieux, le personnage que l’on incarne explore un sous-sol sombre où vit Beowulf. S’ensuit un affrontement épique entre ce dragon de feu et un chevalier, non s’en rappeler le mythe chrétien de Saint Michel terrassant le dragon. Bien que divertissante, l’expérience peut néanmoins devenir désagréable d’un point de vue optique dû aux graphismes qui ne sont pas des plus qualitatifs.
Bien des lieux culturels ont adopté cette manie d’introduire la réalité virtuelle au cœur des expositions et de leur programmation. Le Louvre Lens depuis sa création en 2012 mène une importante politique d'actions hors les murs afin de venir à la rencontre d’un non-public, qui semble important dans cette région. Ce dispositif de Réalité virtuelle a permis de réaliser ce stand en pleine période d’Halloween (période cohérente avec le sujet des animaux fantastiques) au sein de cet espace très particulier qu’est le Mall afin d’inciter des personnes non familières des musées à venir découvrir la future exposition du Louvre Lens. Cependant, mobiliser ce genre d’activité lors d’une action hors les murs peut être discuté. L’initiative d’une expérience de VR ne tue-t-elle pas dans l’œuf l’intérêt que le passant peut ressentir vis-à-vis de l’exposition à Lens ? Ce dispositif donne-t-il réellement envie de se déplacer au musée à la suite de l’expérience ? Offrir ce genre d’attractions individualistes peut-il encourager le visiteur satisfait à aller voir l’exposition ? Ou sera-t-il enclin au contraire à se satisfaire de cette seule expérience ? S’il franchit les portes du Louvre Lens, sera-t-il déçu de ne trouver aucun dispositif de ce type dans l’exposition ? L’enjeu n’est-il pas de s'inscrire dans une démocratie culturelle pour laquelle l’atelier créatif semble plus fertile en termes de réappropriation du sujet et d’occasion de créer du lien entre les participants?
La réalité virtuelle des Animaux Fantastiques s’est également imposée au sein du musée au travers de la programmation réalisée autour de l’exposition afin de diversifier l’expérience visiteur in situ et toucher alors un public potentiellement adolescent. Cependant, la place de ce genre de dispositif doit être réfléchie en amont. Est-ce un bonus ou une prolongation nécessaire au contenu et à sa compréhension ? L’expérience est inscrite dans l'exposition ou fait-elle partie des dispositifs de médiation?
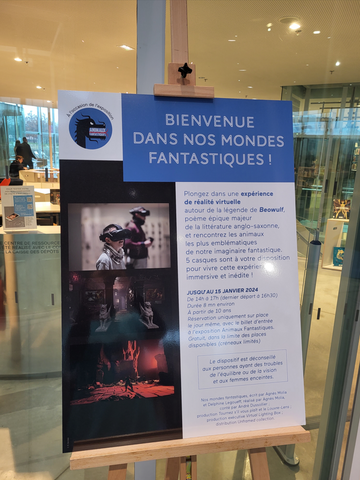
Panneau explicatif Réalité Virtuelle au sein du Louvre-Lens © - Giulia Guarino
La mise en autonomie du visiteur par le casque VR répond à une dynamique éminemment inscrite dans notre société moderne. L’expérience VR de La palette de Van Gogh au Musée d’Orsay pose également cette question centrale de l’introduction du numérique immersif. Le dispositif, proposant un tarif indépendant (6 euros supplémentaires) du billet d’entrée, semble vouloir prolonger l’expérience intime et sensorielle des usagers leur donnant l’impression de pénétrer dans la création de cet artiste maudit. Cependant, le casque de Réalité virtuelle me semble être un outil de médiation bien trop facilitant et souvent peu utile au sein du contenu. Certes, il est compréhensible et nécessaire que le monde de la culture s’ouvre à ces innovations technologiques afin de suivre les tendances de son temps. Dans notre cas, le numérique, implanté dans un centre commercial, permet de séduire des non publics en offrant des expériences nouvelles, sensationnelles et marquantes. Un autre défi est de jauger son utilisation et son utilité au sein des expositions.
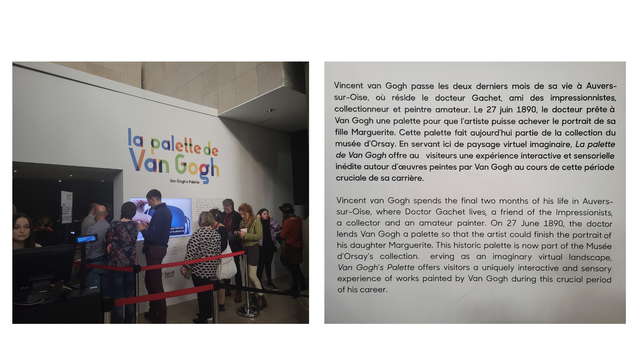
Texte de présentation de l’expérience La palette de Van Gogh, Musée d’Orsay © - Giulia Guarino
Giulia Guarino
#programmation #Réalitévirtuelle #Westfield
The revolutionary woman
« Je suis née avec le décoratif comme abstraction, et cet art n’a rien d’inférieur quand on voit dans les mosaïques la beauté des formes pures et la répétition comme une sorte de louange à cette beauté. La beauté est pour moi très spirituelle et a une réelle signification. La beauté est un plaisir que les artistes devraient réintroduire. » Ghada Amer
Il est des expositions dont on se souvient inévitablement des années après, tellement elles ont su nous marquer. Octobre 2012 : alors en voyage d’études dans le Val-de-Loire avec ma promotion de BTS, une étape nous mène à Tours. La pluie ayant eu raison de notre excursion à vélo, nous avons trouvé refuge au Centre de Création Contemporaine. Son exposition d’alors, « L’âge atomique » était consacré à Claude Levêque. Ce dernier avait conçu spécialement pour l’occasion une installation investissant l’entièreté de la salle d’exposition ; tel un lieu de retranchement en cas de guerre. Une découverte artistique frappante en raison de la puissance de l’œuvre qui traite des conflits armés et des menaces pesant en permanence sur le monde contemporain.
J’ai été d’autant plus marquée par le discours mis en œuvre autour de cette exposition. Accueillis par la responsable du Service des publics, nous avons bénéficié d’une visite qui s’est déroulée en trois temps. Premièrement, une introduction à l’exposition à travers une présentation de l’artiste et de son travail. Dans un deuxième temps, la découverte des œuvres durant une déambulation libre, avant de conclure par un échange autour de l’expérience vécue dans le cadre de cette visite. La raison pour laquelle cette exposition m’a tant marqué ? Avant tout, parce que je découvrais ce qu’était la médiation culturelle que je ne connaissais pas, et que j’allais moi-même pratiquer sans le savoir bien des années après.
Cette approche spécifique des publics m’a incitée à suivre l’actualité du CCC. En 2008, le centre d’art reçoit une donation de 159 dessins de l’artiste tourangeau Olivier Debré, s’ajoutant aux cinq toiles que le CCC lui avait commandé en 1992. Cette donation confirme l’ambition du centre d’art de se doter d’un bâtiment pérenne, d’après la volonté d’Olivier Debré : intégrer son œuvre au cœur d’un lieu en dialogue constant avec la création contemporaine afin d’apporter une nouvelle lecture de son art. Conçu par les architectes portugais Aires Mateus, le nouveau bâtiment (nouvellement nommé CCC OD) est érigé non loin de la Loire et inauguré le 11 mars 2017. A mon arrivée à Tours en septembre dernier, j’étais d’autant plus empressée de découvrir les nouveaux locaux. J’étais loin de me douter que j’allais y vivre un deuxième coup de foudre artistique.
Depuis le 2 juin 2018, les visiteurs sont invités à découvrir les dernières recherches picturales et sculpturales de Ghada Amer, artiste franco-égyptienne dont le centre d’art avait déjà consacré une exposition monographique en 2000. Née en 1963 au Caire, Ghada Amer emménage en France à l’âge de 11 ans, avant de poursuivre ses études entre Nice et Paris. Au milieu des années 1990, elle s’installe à New-York où elle réside encore à l’heure d’aujourd’hui. D’enfant née dans le monde oriental à adulte formée en France, le regard critique de l’artiste envers les droits des femmes et la société patriarcale se modifie. Consciente des évolutions en termes de conduite et de statuts imposés aux femmes en Occident, ces problématiques vont marquer le début de sa pratique artistique.
Deux salles du CCC OD ont été investies par Ghada Amer, dont la galerie noire qui y regroupe une vingtaine d’œuvres. D’une part, ses toiles brodées à l’esthétique unique qui a contribué à faire sa renommée dans les années 1990. D’autre part, ses récentes productions sculpturales où elle étudie le métal. Dark Continent : tel est le titre de cette première exposition, en référence à Freud qui qualifie la sexualité féminine de continent noir. Référence également à l’essai Le Rire et la Méduse de la philosophe Hélène Cixous. L’auteure y traite notamment de l’attribut féminin et de la nécessité de s’écarter des discours paternalistes en encourageant les femmes à découvrir leur sexualité bien trop souvent passée sous silence. Sexualité qu’elle nomme symboliquement : le continent noir.
Suite à son installation aux Etats-Unis, Ghada Amer emploie la broderie pour s’attaquer à la peinture et s’insère dans la tradition de ce médium, devenu, pour des femmes artistes, un instrument politique depuis les années 1970. Elle puise son inspiration à travers des sources aux domaines diversifiés : les contes enfantins, la mode, les poèmes médiévaux orientaux ou encore la pornographie. Sont représentés des sujets variés, allant de l’amour aux sentiments, en passant par les clichés préconçus de la femme. Corps féminins et mots sont brodés sur ses toiles, à la manière de revendications. Des citations minutieusement choisies et empruntées à des figures du féminisme, destinées à reproduire des prises de parole qui mettent en avant la place des femmes.
C’est uniquement en s’approchant que deviennent visibles les silhouettes féminines, laissant apparaître des figures dénudées aux poses lascives provenant de revues pornographiques. Les hommes sont volontairement absents de ses œuvres, odes à l’auto-érotisme féminin où ces héroïnes n’ont besoin de personne et encore moins d’un homme. Au fil de l’exposition se remarque un changement dans les toiles de Ghada Amer, évoluant vers la peinture abstraite. Dorénavant, l’enchevêtrement de fils brodés constituant la surface de ses compositions laisse place à des coulures de peinture, semblables à d’épais mouvements de brosses expressionnistes apposés sur la toile.
Parallèlement à ses compositions picturales, Ghada Amer réalise un travail autour des jardins depuis 1998. C’est en 2000 que le CCC de Tours l’invite pour sa première exposition personnelle. Dans Monographie et Jardins, elle conçoit trois formes de jardins répartis sur des sites distincts : le premier dans le parc du Musée des Beaux-Arts de Tours, le deuxième dans les jardins du Château du Rivau. Enfin, le dernier prenait place rue Marcel Tribut, au sein des anciens locaux du centre d’art. Aujourd’hui, ce jardin d’hiver fait l’objet d’une reconstitution dans la seconde exposition consacrée à Ghada Amer (Cactus Painting) où l’artiste investit cette fois-ci la somptueuse nef du CCC OD.
Cactus Painting constitue la production la plus hors-norme en termes de dimensions parmi celles ayant pris place jusqu’à présent au CCC OD. Cette installation horizontale de 24 x 7 mètres se compose de 16 000 plantes au total. Cinq jours de travail et une équipe de 25 personnes auront été nécessaires pour faire apparaître le motif, à partir d’un système de roulement. En partant d’un dessin de Ghada Amer, le sol de la nef a été quadrillé à la manière d’un enchevêtrement de fils de trames (apposés dans le sens de la largeur), et de fils de chaînes propres au tissage de tissu (apposés dans le sens de la longueur). Déployé tel un immense tapis de cactus et de plantes grasses formant des zig-zags, ce jardin se lit aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur à travers la vitrine du bâtiment.
Bien plus qu’un motif, ce parterre offre une tout autre lecture où se mélangent les tendres plantes grasses à l’aspect indéniablement phallique des cactus. Un message de revendication délivré par Ghada Amer suite au constat de l’absence des femmes dans l’histoire de l’art dictée par les ouvrages. A l’instar de la broderie, médium typiquement féminin qu’elle utilise pour s’attaquer à la peinture, l’artiste s’emploie ici à l’art floral comme moyen d’action pour détourner les codes de la peinture abstraite américaine d’après-guerre. Au-delà de la forme décorative et de la recherche esthétique, Ghada Amer s’appuie sur une activité féminine pour faire émerger des problématiques récurrentes liées aux relations entre les femmes et les hommes.
Pari réussi pour cette découverte des nouveaux locaux du CCC OD, qui a su m’époustoufler une seconde fois par la qualité de ses installations. Je demeure bluffée par Cactus Painting qui constitue le point d’orgue de l’exposition, magnifiée par la somptueuse nef. Ghada Amer est de ces artistes au parcours fascinant et au message inspirant en réponse au monde de l’art dominé par : « les mâles blancs et anglo-saxons. » A la manière d’un geste politique en réponse à l’exclusion des femmes, cette œuvre anti-machiste est plus que nécessaire à l’heure où tant de voix peinent encore à se faire entendre pour revendiquer les droits des femmes.
Expositions :
- Dark Continent : du 2 juin 2018 au 4 novembre 2018
- Cactus Painting : du 2 juin 2018 au 6 janvier 2019
Pour en savoir plus :
- Sur le CCC OD et les deux expositions : https://www.cccod.fr/

Transfert versus Le Chronographe : quand le musée s’invite dans un lieu hybride
Alors qu’on voit de plus en plus d’actions culturelles en tous genres s’implanter dans des lieux incongrus, le cas rezéen nous invite à nous plonger dans cette problématique : Bienvenue à Transfert & Co le temps de quelques lignes, aperçu sous l’angle muséal du Chronographe.
Deux lieux, deux dynamiques, deux publics
Transfert&Co, aussi appelé plus généralement Transfert, est un village inspiré d’une cité utopique. Il prend place au cœur d’un désert urbain : la friche immense des anciens abattoirs de Rezé, aux portes de Nantes. C’est une zone libre d’art et de culture, habitée d’architectures fantasques.
Transfert est un projet dédié à l’art, à l’expérimentation et à la rencontre. A la fois expérimental et évolutif, ce projet vise à réactiver cette friche industrielle, de 2018 à 2022, avant la construction du nouveau quartier de la ZAC Pirmil-les-Isles. Projet ouvert et partagé, Transfert souhaite à la fois accompagner les initiatives du territoire et impulser des projets innovants, dans lesquels chacun puisse trouver sa place. En y mêlant programmation artistique, jeux, bars et restaurant, le site souhaite questionner les capacités de la culture à inventer la ville de demain.
Les visiteurs viennent donc à Transfert pour une programmation très éclectique : qu’on ait envie de boire un verre entre ami.e.s, s’essayer à des vieux jeux de société ou d’équipe, manger un morceau street-food en famille, admirer une petite exposition photo ou venir se trémousser sous le chapiteau sur des rythmes de musiques actuelles, Transfert est un lieu idéal.
Le Chronographe
Centre d’interprétation métropolitain, Le Chronographe est situé au cœur du site archéologique de Saint-Lupien, à Rezé. Il propose aux visiteurs d’expérimenter l’archéologie et d'explorer l'histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol rezéen, et fouillé par les archéologues depuis 150 ans.
Au milieu d'un îlot de verdure de 2 Ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son millefeuille archéologique, ainsi que les vestiges de l'ancien quartier portuaire gallo-romain. A l'aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l'exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l'archeologie et partent a la decouverte de l'histoire de Ratiatum.
Il propose à tous les habitants de la métropole un lieu où l'archéologie révèle une histoire commune et interroge notre perception du territoire. Implanté sur le site archéologique de Saint-Lupien, le Chronographe propose un parcours de découverte de Ratiatum, port de la Gaule romaine, entre le 1er et le 3e siècle. Outil de valorisation, il est également un lieu de découverte, et d'expérimentation autour de l’archéologie, grâce à une programmation ouverte qui favorise le croisement des disciplines. Lieu de diffusion et de sensibilisation, il est le relais de l’actualité archéologique métropolitaine.
Plutôt dans une optique familiale, Le Chronographe est un lieu que l’on fréquente pour découvrir l’histoire antique du site et de la ville, venir profiter de la dernière exposition temporaire ou encore participer activement, en famille ou avec l’école, aux ateliers proposés liés aux métiers de l’archéologie.
Une opposition passé / futur, mais un objectif commun
Si ces deux lieux s’opposent l’un à l’autre par leur ancrage temporel, ils ont néanmoins un objectif de programmation commun : l’expérimentation.
Alors que l’un nous fait expérimenter une discipline, une profession et une réflexion autour du passé des sociétés humaines, l’autre nous fait expérimenter un territoire pour penser l’avenir.
Ces deux lieux se font quasiment face, à vol d’oiseau. Séparés par une route à quatre voie et une zone commerciale, ils partagent un même territoire, exploré sous des horizons opposés. Alors, n’y aurait-il pas quelque chose à jouer ? La réponse est bien évidemment oui, et c’est ainsi qu’est né un atelier fouille retravaillé, entre archéologie et interprétation urbaine.

Atelier Transfert Temporel © PickUp Productions – Transfert&Co
Transfert temporel : l’archéologie du futur entre vos mains !
Commence alors un jeu d’imagination : les visiteurs sont accueillis en 2250, dans la nouvelle ville de Rezo. Dans l’espace d’atelier, deux bacs de fouilles sont disposés, dans lesquels on trouve des objets qui nous sont contemporains. Une mission : trouver un sens à ces divers objets du quotidien, vus par des archéologues du futur.
Mais avant de commencer à creuser, quelques rappels ! Qu’est-ce que l’archéologie ? A quoi ça sert ? Qu’est-ce qu’on peut trouver dans le sol ? Qu’est-ce que la stratigraphie archéologique et sa signification ? Et que dire du territoire ? Toutes ces questions sensibilisent les plus jeunes à l’archéologie.
Au-delà de la sensibilisation, l’exercice se corse, puisqu’il demande un effort d’imagination. Nous savons tou.te.s identifier ces objets, mais dans le futur, comment les interpréter ? Cet exercice conduit à réfléchir sur la place de l’interprétation en archéologie, mais encore sur la légitimité de toute information.
Puis vient le moment de fouiller. Le moment que petit.e.s et grand.e.s attendent avec impatience ! Muni.e.s d’une pelle, d’une truelle et d’un pinceau, le public apprend les techniques de fouille comme de vrai.e.s archéologues. On ne doit pas pousser le sable n’importe comment, au risque de recouvrir les trouvailles des autres participant.e.s.

Fouilles à Transfert © PickUp Productions - Transfert&Co
Et alors, que trouve-t-on ? Parmi des objets en plastique, un drôle de récipient en or… C’est visiblement un contenant, mais pas un contenant permettant d’attraper quelque chose, car on ne peut pas y glisser la main. Visiblement, s’il est doré, c’est qu’il est précieux… Que peut-on en dire ?
En réalité, ce contenant est une cruche faussement dorée, très kitsch, qui aurait servie (selon la légende) au tournage d’un clip de Richard Gotainer…
Puis dans l’autre bac de fouille apparaît une bien étrange forme circulaire cernée de picots, accompagnée d’un instrument en bois et en métal. Cette forme circulaire nous fait penser à une couronne. Et cet instrument, il a un manche en bois, avec au bout un gros bloc de métal. Serait-ce une arme ? Sommes-nous sur la scène du meurtre d’un roi ou d’une reine ?!!
Cette couronne a en réalité été réalisée en pièces d’engrenages de voiture, et l’arme n’est qu’un simple vieux marteau rouillé. Mais en partant de ces éléments, les interprétations et hypothèses fusent, laissant place à la magie des histoires qu’on peut se raconter.
En partant de ces constats, les participant.e.s sont invité.e.s au débat et au questionnement sur les sociétés, qu’elles soient du passé, du présent ou de l’avenir. Ouvrir sur l’écologie est un autre engagement : aujourd’hui, certain.e.s archéologues spécialistes étudient la céramique, et sont appelé.e.s des céramologues. Avec l’apparition du plastique, qu’on sait polluant et très difficilement biodégradable, verra-t-on apparaître des plasticologues d’ici 250 ans ?
Julia Parisel
#archéologie
#médiation
#futur

Twitch apprivoise les musées
La présence des institutions culturelles sur internet n’est plus une exception. Depuis la fin des années 2000, grandes institutions nationales comme petits musées sont présents sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter en premier lieu, pour diffuser des information pratiques et annoncer leur programmation. Elles ont ensuite accompagné la montée en puissance d’Instagram au cours des années 2010.
Philippe Maillet, Etoiles et Squeezie dans la galerie des glaces du château de Versailles
© capture d’écran de la chaine Twitch d’Etoiles
Outre les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos type YouTube sont un autre moyen numérique pour diffuser du contenu.
Pendant le confinement, deux applications ont explosé : TikTok et Twitch. Si TikTok, dédié au partage de vidéos courtes, ne fait pas encore l’unanimité dans les institutions culturelles, certaines se sont prises au jeu (château de Versailles, musée du Louvre-Lens, musée d’Orsay…)
Twitch est au contraire délaissé par les musées. Par les musées peut-être, mais pas par les streamers qui connaissent bien les possibilités de la plateforme. Le fonctionnement de la plateforme est simple : proposer un contenu en live à des spectateurs (appelés les viewers) qui peuvent réagir dans le chat. Intéressons-nous à deux émissions diffusées sur Twitch qui ont lieu dans, et avec des musées.
Les nuits du Musée avec Etoiles
Sur Twitch, Etoiles est notamment connu pour ses Nuits de la culture, une émission hebdomadaire où il regarde et joue à Questions pour un Champion. Passionné de culture et amateur de musée, il confie plusieurs fois à sa communauté son envie de faire un live seul dans un musée.
Le rêve se réalise en février 2022. Avec l’aide de Beaux Arts Magazine et Point Parole, il propose la Nuit du Musée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Accompagné d’un autre streamer, Ponce, et de Philippe Maillet, guide-conférencier, il propose une visite-discussion du musée pendant près de 2 heures. La visite est assez classique : Philippe Maillet s’arrête sur quelques œuvres du musée et revient sur les grands enjeux de l’art du XXe siècle. L’ambiance est détendue, et le tout réunit plus de 30 000 viewers. La période suscite de belles discussions : Ponce et Etoiles soulèvent la question de la nature de l’art (« Moi aussi j’aurais pu le faire »), de l’évolution des sujets, des formes et des techniques ; mais aussi des propos plus inattendus : comparaison avec des Pokémons ou évocation de l’ « omelette » de Klimt, surnom donné par Etoiles au Baiser.

Ponce, Etoiles et Philippe Maillet au MAM © capture d’écran de la chaine Twitch d’Etoiles
Début juin 2022, Etoiles propose une deuxième édition de la Nuit du Musée, qui a lieu au château de Versailles, en compagnie de Philippe Maillet et du youtubeur Squeezie. Contrairement au MAM où l’équipe du musée n’était pas intervenue, Etoiles et Squeezie sont accueillis par le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Le reste de la visite ressemble à l’émission au MAM : Philippe Maillet emmène les deux streamers dans les endroits phares du château, mais aussi dans des endroits non accessibles, ouverts pour l’occasion. La visite se finit par exemple par les pièces par lesquelles a fui Marie-Antoinette en 1789, laissant le trio de visiteurs sur une note émouvante. L’histoire du château, la vie de la Cour, l’architecture, les œuvres d’art sont tant de thèmes abordés par Philippe Maillet pendant près de 2 heures de visite, en répondant également aux questions de Squeezie et Etoiles. Philippe Maillet parsème la visite de petites anecdotes sur la vie de la Cour ou les extravagances de Louis XIV, racontant comment le roi rendait justice depuis son lit d’apparat ou faisait stopper des combats pour acheminer du marbre jusqu’à Versailles.
Invité au talkshow PopCorn (émission hebdomadaire diffusée sur Twitch), Etoiles explique que son objectif était que ses abonné.es n’aimant pas les musées soient happé.es par le live et la visite. Son but est de montrer que la culture des musées n’est pas inaccessible. Il souligne également le rôle de Philippe (qui est celui de tous les médiateurs.rices culturel.lles) qui parvient à captiver tous les publics, y compris les plus réticents. Etoiles rapporte aussi que le directeur et les équipes du MAM ont adoré le live et ont conscience que c’est une bonne accroche pour le jeune public. Du côté du château de Versailles, même approbation pour l’émission, mêlée à la surprise de voir un tel engouement du public dans le chat.
L’exposition est tienne avec Samuel Etienne
La majorité du grand public connait Samuel Etienne en tant que présentateur de Questions pour un champion. Mais depuis le confinement, Samuel Etienne est aussi streamer sur Twitch ! Appréciant particulièrement Twitch pour le lien et le partage avec sa communauté, il a décidé de partager son envie d’aller dans de beaux lieux et son goût pour l’art à ses abonné.es.
Samuel Etienne a ainsi organisé 3 visites de musées ou d’exposition en direct : la collection Morozov à la fondation Louis Vuitton, le musée du Louvre et le musée d’Orsay. Les visites durent en moyenne 3 heures. Contrairement à Etoiles qui s’accompagne d’un guide-conférencier indépendant, Samuel Etienne reçoit au fil de sa déambulation plusieurs intervenants travaillant dans le musée : des médiateurs.rices et conservateurs.rices. Ils emmènent Samuel Etienne et ses viewers au fil des salles, présentant les œuvres, les mouvements artistiques…
Samuel Etienne veille également à faire participer le public dans le chat. Il lit des commentaires et relaie les questions à l’interlocuteur, permettant de créer plus de discussions autour de la visite. Certains interlocuteurs, comme Paul Perrin (L’exposition est tienne à Orsay), se prennent au jeu et font participer les viewers, que Samuel Etienne motive en proposant de faire gagner les œuvres aux plus rapides !

Samuel Etienne et Sylvie Patry au musée d’Orsay © capture d’écran de la chaine Twitch de Samuel Etienne
A quand les musées ?
Ces projets portés par les streamers sont des opportunités pour les musées. Ils profitent de la visibilité et du projet du streamer pour mettre un coup de projecteur sur leurs collections. Ils touchent le public jeune, majoritaire sur Twitch, qu’ils aimeraient reconquérir.
Les institutions culturelles pourraient-elles s’emparer de Twitch de manière autonome, sans le soutien des streamers ?
Twitch leur offre de multiples possibilités : visite des collections ou d’une exposition, conférence, table-ronde, rencontre… Les musées n’ont pas nécessairement besoin de créer du contenu directement pour Twitch : une diffusion en direct d’un événement organisé au musée suffit à attirer un public, ne serait-ce que celui qui ne peut se déplacer au musée, ou n’a pas (ou plus) cette habitude.
Les musées, sur le même modèle que les émissions proposées par Etoiles ou Samuel Etienne, peuvent aussi organiser un contenu exclusif à Twitch : une rencontre, une visite, un focus sur un objet de leur collection… Le nombre de spectateurs sur les lives d’Etoiles et Samuel Etienne parle de lui-même : il y a un public intéressé par ce type de contenu sur Twitch. Il faut évidemment prendre en compte l’effet de communauté autour des streamers : certains viewers sont là plus pour soutenir un streamer qu’ils apprécient que pour le contenu. Mais, passé cet effet, les spectateurs restent, s’intéressent au contenu pendant les 2 à 3 heures de visite et reviennent à l’émission suivante.
Les visites commentées, la découverte d’un lieu ou d’une exposition intéressent le public présent sur Internet. Même si Etoiles et Samuel Etienne donnent un ton léger à leur live, la visite ne perd jamais de sa qualité et de son sérieux. Que les musées se rassurent, pas la peine de déployer les grands moyens en termes d’animation et d’humour, une visite bien menée par un.e médiateur.rice passionné.e permet de capter son audience. Pour les plus à l’aise avec le live, il sera même possible de se détacher d’un format très calibré pour aller chercher l’interaction avec les spectateurs du chat.
Twitch est une chance de proposer une nouvelle forme de médiation, pour aller chercher les publics éloignés géographiquement, les publics numériques et évidemment les jeunes. Philippe Maillet l’explique lors de la visite du MAM : « Une des missions des musées c’est aussi d’aller vers tous les publics et les publics derrière leurs écrans c’est aussi du public, donc je pense que ce qu’on vient de faire là ce-soir […] c’est aussi une nouvelle forme de médiation que les musées vont peut-être explorer demain ».
Myrrha Bouly
Pour aller plus loin :
- Condensé de la Nuit du Musée au MAM
- Condensé de la Nuit du Musée au château de Versailles
- Chaine twitch de Etoiles (rediffusion des lives disponible gratuitement)
- Chaine twitch de Samuel Etienne (rediffusion des lives disponible gratuitement)
#MédiationNumérique #Twitch #visiteguidée

Une nouvelle aire de « jeux » au Palais des Beaux-Arts de Lille
Lille, une ville baptisée capitale européenne de la culture
Lille détient plusieurs lieux consacrés à l’exposition : le Musée de l’Hospice Comtesse, le Musée d’Histoire Naturelle, le Tripostal, l’Institut de la photographie, le musée Pasteur ou encore la gare saint-Sauveur. Depuis 2004, Lille est capitale européenne de la culture. Cette désignation permet à la ville d’offrir un programme culturel toujours plus complet et diversifié. Aujourd’hui, nous faisons arrêt au Palais des Beaux-Arts.
Le Palais des Beaux-Arts, un musée géré par la ville de Lille
Le Palais des Beaux-Arts est un musée municipal dirigé par la ville. Il a vu le jour le 6 mars 1892. Ce musée abrite des collections de l’Antiquité au XXème siècle. En tant que musée d’état, le Palais des Beaux-Arts possède un PSC, Projet Scientifique Culturel. Ce PSC est un document rédigé « opérationnel et stratégique qui définit l’identité et les orientations du musée », selon le Ministère de la culture. Il évoque les collections, la politique des publics… C’est un document de référence pour l’ensemble de l’équipe du musée.

Palais des Beaux-Arts de Lille©Céline Chevalier
Une institution au plus près de son public
Les PSC des musées de Lille, le Palais des Beaux-Arts, le musée de l’Hospice Comtesse et le musée d’histoire naturelle, est réécrit tous les 10 ans. Il présente le cahier des charges sur les accomplissements du musée, les événements produits, la stratégie adoptée envers les publics…
Celui du Palais des Beaux-Arts a le souci des publics, dans la volonté d’inclure l’ensemble des publics au sein de leur parcours.
Celui en cours d’écriture propose une refonte totale du parcours de visite. Il présente un réaménagement des collections afin de les rendre plus accessibles. De cette réflexion menée autour des collections et de ses enjeux tout en s’emparant de la politique de développement des publics, va naître un espace dédié aux enfants au sein du parcours.
Un projet de refonte avec un espace dédié aux enfants
C’est d’ici 2024 qu'un espace sera totalement dédié à l’accueil des enfants. L’espace en question est déjà défini par sa luminosité et est situé au balcon du premier étage, au-dessus de l’atrium. Il abrite pour le moment la galerie d’art moderne.

Galerie d’art moderne, balcon premier étage ©M. Catherine
Cet espace est fait pour accueillir des enfants à partir de 3-4 ans, de jeunes visiteurs lecteurs avec des cartels simplifiés afin de permettre une compréhension adaptée à leur âge.
Cet espace sera ludique et coloré, pour attirer l’œil des plus petits, donner envie d’être traversé. L’enfant en tant que visiteur sera acteur de sa visite par différentes manipulations et une approche multi-sensorielle : sentir, toucher, écouter… L’espace, co-créé avec le scénographe, sera rythmé par des zones interactives (tiroirs secrets, porte dérobée, etc)
L’équipe du musée souhaite disposer au total une dizaine d’œuvres, des originaux. L’enfant sera ainsi réellement mis au même rang qu’un adulte. Ces œuvres seront de différentes typologies avec des présentations à la fois de peintures, sculptures…, de différentes époques, art ancien, art contemporain… Elles seraient à 50 cm du sol et dans l’idéal sans barre de mise à distance afin de permettre leur contemplation. Cet espace s’axe sur la pratique de l’enfant tout en y intégrant un endroit consacré aux livres et à la détente afin de permettre une pause et prolonger la visite.
Un point fort sera la médiation. Quoique le parcours de visite soit libre, une médiation humaine est souhaitée. Elle permettra d’accompagner les visiteurs au besoin dans leur parcours actif et autonome, mais également de sécuriser l’œuvre. De nombreux outils de médiations seront présents afin d’activer une participation de l’enfant par le biais de mises en situation, d’expérimentation, de jeux d’approche multi-sensorielle. Ces outils de médiations auront pour objectif de permettre la compréhension des enjeux de l’artiste.
Un espace évolutif
Ce projet a pour objectif de faire intégralement partie du parcours de visite des visiteurs et de devenir un espace permanent dédié aux enfants où les thématiques et les œuvres seront modifiées tous les deux ans. Pour cette première apparition, la thématique tournera autour du jeu intitulé « À quoi tu joues ? ». Cette thématique verra le jour sous trois angles : Jeux de stratégies, Jeux symboliques et Jeux de plein air. Elle regroupera différentes œuvres, peintures, sculpture de l’Antiquité à nos jours, et présentera comment la thématique a évolué au sein des différentes périodes et l’histoire du jeu à travers le temps.
Par la suite, le musée envisage pour sa deuxième édition une thématique autour des douze mois de l’année où chaque œuvre représentera un mois de l’année et sera rythmé par des rituels marquant les enfants: noël, la rentrée des classes, les saisons…
Vivement 2024 pour découvrir cet espace dédié aux enfants.
Nos remerciements à Céline Chevalier, chargée des projets pédagogiques, Service de la médiation et de l’implication des publics pour les échanges sur ce projet.
Maryline Catherine
Pour en savoir plus :
#Lille #Palais des Beaux-Arts #espace pour enfants
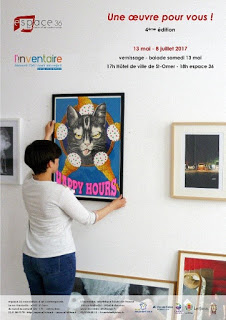
Une oeuvre pour vous ! (avec l'Artothèque)
Le 13 mai, les Audomarois(es) avaient rendez-vous à l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Omer pour découvrir la nouvelle exposition présentée par l’Espace 36, association d’art contemporain. « Une œuvre pour vous ! » est la quatrième édition de cette biennale organisée en partenariat avec l’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France. Le principe ? Les visiteurs ont la possibilité d’emprunter des œuvres d’art, puis de les exposer à leur domicile ou sur leur lieu de travail.
Affiche de l’exposition ©Nicolas Lavoye
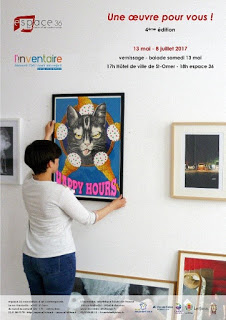 Ce vernissage célébrait les trente ans d’existence de l’Espace 36. Quatre adhérents de l’association ont ouvert leurs portes où étaient exposées des œuvres empruntées à l’Artothèque. Une balade dans la ville de Saint-Omer a conduit des visiteurs à découvrir les intérieurs de ces médiateurs d’un jour qui ont présenté leurs coups de cœur. Mais avant de débuter la visite, une petite présentation de l’Espace 36 s’impose.
Ce vernissage célébrait les trente ans d’existence de l’Espace 36. Quatre adhérents de l’association ont ouvert leurs portes où étaient exposées des œuvres empruntées à l’Artothèque. Une balade dans la ville de Saint-Omer a conduit des visiteurs à découvrir les intérieurs de ces médiateurs d’un jour qui ont présenté leurs coups de cœur. Mais avant de débuter la visite, une petite présentation de l’Espace 36 s’impose.
Depuis 2001, ce centre d’art associatif basé à Saint-Omer a mis en œuvre un projet de création unique dont la base est le soutien envers la création et la sensibilisation à l’art contemporain. Les actions majeures développées par l’association sont la conception d’expositions et le soutien à la diffusion de l’art contemporain, ainsi que l’élaboration d’outils de médiation et l’organisation de visites.
Espace36 – Exposition de Marie Hendricks © Benoît Warzée
L’association assume un rôle d’intermédiaire entre lesartistes et les publics grâce à une collaboration et une concertation auprès de différents acteurs territoriaux. L’Espace 36 met un point d’honneur à sensibiliser les publics qu’il reçoit dans le cadre de ces expositions. Le but étant de leur apporter des outils de compréhension pour les aider à développer leur réflexion personnelle. Une démarche axée sur la médiation participative, qui consiste à permettre à tout type de visiteur de s’ouvrir à ses propres ressentis et sentiments.
 A travers ces différents projets, l’association espère que les participants s’ouvrent à la culture et soient en mesure d’élargir leur raisonnement. La base des relations entre les artistes plasticiens et les publics repose essentiellement sur l’échange ainsi que l’écoute, et s’efforce de rendre les visiteurs acteurs de leur propre culture.
A travers ces différents projets, l’association espère que les participants s’ouvrent à la culture et soient en mesure d’élargir leur raisonnement. La base des relations entre les artistes plasticiens et les publics repose essentiellement sur l’échange ainsi que l’écoute, et s’efforce de rendre les visiteurs acteurs de leur propre culture.
Atelier-Visite avec le Musée de l’Hôtel Sandelin © Benoît Warzée
Venons-en à l’Inventaire. Basée à Hellemmes dans la métropole lilloise, L’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France a été fondée en 2009. Cette association propose aux habitants de la région un service itinérant et solidaire de prêts d’œuvres d’art sur le même principe qu’une bibliothèque. Autrement dit : chacun peut emprunter une à plusieurs œuvres originales par mois, qu’il expose ensuite chez lui. Au-delà d’encourager la présence de l’art au sein de lieux privés et professionnels, cette démarche aide à favoriser l’appropriation de la création contemporaine auprès des adhérents.
L’Inventaire Artothèque ©Clotilde Lacroix
Emprunter à l'Arthothèque
 Riche et diverse, la collection de l’Artothèque s’élève à 1200 œuvres, regroupant estampes, peintures, photographies et sérigraphies réalisées par de jeunes créateurs, ou des artistes reconnus sur la scène régionale et nationale, voire internationale. Cette collection s’enrichit au fil des ans par de nouvelles acquisitions, dans le but de valoriser la multiplicité des techniques artistiques actuelles.
Riche et diverse, la collection de l’Artothèque s’élève à 1200 œuvres, regroupant estampes, peintures, photographies et sérigraphies réalisées par de jeunes créateurs, ou des artistes reconnus sur la scène régionale et nationale, voire internationale. Cette collection s’enrichit au fil des ans par de nouvelles acquisitions, dans le but de valoriser la multiplicité des techniques artistiques actuelles.
Plus de 10 000 prêts ont été enregistrés depuis sa fondation, avec des œuvres qui circulent dans le cadre de projets mis en œuvre avec différents acteurs socio-culturels. D’une part, des expositions organisées dans des galeries d’art, et d’autre part des interventions effectuées au sein d’établissements scolaires. A travers ces actions, ces œuvres voyagent sur le territoire pour aller à la rencontre des publics les plus larges, et souvent peu adeptes de l’art contemporain.
En complément des institutions muséales et autres centres régionaux de diffusion, l’Inventaire soulève la question de la place de l’œuvre d’art dans la sphère privée, au-delà de la simple notion d’acquisition ou de consommation. Ainsi, les publics touchés nouent une relation approfondie à l’œuvre et posent désormais un regard nouveau sur la création contemporaine. En se basant sur des valeurs liées à l’économie sociale et solidaire, cette démarche de transmission amène une réflexion sur la fonctionnalité, et sur la manière de repenser l’économie dans un principe de développement durable.
© Clotilde Lacroix
Retour sur cette balade-vernissage, vécue comme une expérience originale. Le contact privilégié avec des œuvres d’art figure parmi les objectifs de l’Inventaire, qu’il nomme joliment : « intrusions artistiques ». Avec cette volonté de raviver une mécanique du désir, d’amener des particuliers à entretenir une relation décomplexée avec l’art, et plus spécifiquement, de se familiariser à l’art contemporain. « Ça permet de vivre plusieurs semaines avec une œuvre, de la voir différemment, ailleurs que dans un lieu de passage. » indique Ségolène Gabriel, médiatrice culturelle de l’Espace 36¹. Donc, quoi de mieux que de donner l’occasion à des membres de l’association d’exposer des œuvres à leur domicile et d’en ouvrir les portes à des visiteurs lambdas ?
Visiteurs du Vernissage-Balade ©Joanna Labussière
 La force de cette opération participative réside dans le rôle joué par les adhérents qui se sont glissés dans la peau de médiateurs le temps d’une après-midi. Un parcours informel en somme, dans une ambiance détendue, et qui a permis à la plupart de découvrir le patrimoine architectural au domarois. Cette démarche rejoint les fondements de l’Espace 36 en termes de médiation, où l’accueil du public ne se résume pas à expliquer les œuvres aux visiteurs, mais à apporter à ces derniers des clefs de réflexion propre à leurs émotions.
La force de cette opération participative réside dans le rôle joué par les adhérents qui se sont glissés dans la peau de médiateurs le temps d’une après-midi. Un parcours informel en somme, dans une ambiance détendue, et qui a permis à la plupart de découvrir le patrimoine architectural au domarois. Cette démarche rejoint les fondements de l’Espace 36 en termes de médiation, où l’accueil du public ne se résume pas à expliquer les œuvres aux visiteurs, mais à apporter à ces derniers des clefs de réflexion propre à leurs émotions.
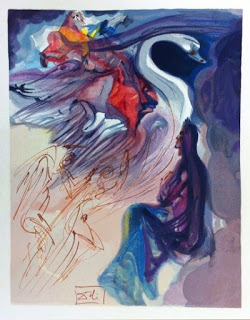 C’est ainsi que Thérèse, sculptrice autodidacte, nous a reçu en premier. Son choix s’est porté sur deux sérigraphies réalisées en 1960 par Salvador Dalí et inspirées du poème « La Divine Comédie » de Dante. D’après elle, ces sérigraphies donnent à voir un autre aspect du travail de Dalí, à l’opposé de ses œuvres surréalistes qui ont fait sa renommée en tant que peintre parmi les plus influents de son siècle.
C’est ainsi que Thérèse, sculptrice autodidacte, nous a reçu en premier. Son choix s’est porté sur deux sérigraphies réalisées en 1960 par Salvador Dalí et inspirées du poème « La Divine Comédie » de Dante. D’après elle, ces sérigraphies donnent à voir un autre aspect du travail de Dalí, à l’opposé de ses œuvres surréalistes qui ont fait sa renommée en tant que peintre parmi les plus influents de son siècle.
La Divine Comédie de Dante #1 et #2 ©Inventaire l’Artothèque
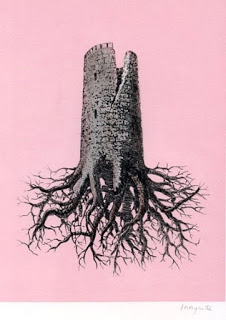 S’ensuivit la découverte d’un second appartement où nous ont accueillis Virgile et Aurélien, membres du Conseil d’Administration des Amis des Musées de Saint-Omer. La visite débuta avec Virgile qui nous présenta sa sélection : une héliogravure de René Magritte datant de 1973. Intitulée « La Folie d’Almayer »,cette œuvre s’inspire du premier roman du même nom de Joseph Conrad, dont le héros, Almayer, un jeune hollandais au destin tragique qui rêvait de partir à la découverte d’un trésor caché par des pirates. Ancien étudiant en gestion et valorisation du patrimoine, Virgile a choisi cette gravure qu’il considère comme étant la métaphore de notre héritage culturel qui constitue le fondement de nos racines.
S’ensuivit la découverte d’un second appartement où nous ont accueillis Virgile et Aurélien, membres du Conseil d’Administration des Amis des Musées de Saint-Omer. La visite débuta avec Virgile qui nous présenta sa sélection : une héliogravure de René Magritte datant de 1973. Intitulée « La Folie d’Almayer »,cette œuvre s’inspire du premier roman du même nom de Joseph Conrad, dont le héros, Almayer, un jeune hollandais au destin tragique qui rêvait de partir à la découverte d’un trésor caché par des pirates. Ancien étudiant en gestion et valorisation du patrimoine, Virgile a choisi cette gravure qu’il considère comme étant la métaphore de notre héritage culturel qui constitue le fondement de nos racines.
« La Folie Almayer » de René Magritte© Inventaire l’Artothèque
Aurélien lui, a sélectionné deux peintures de l’artiste Sylvain Dubrunfaut issues de sa série « Ados 3 » exécutée en 2012. La première représente un adolescent placé de profil, le visage encapuchonné, et aux traits graves. Aurélien a placé cette toile sur une étagère de sa bibliothèque, près de ses romans de vampires qu’il affectionne particulièrement. Selon lui, l’air assombri du jeune garçon s’accordait avec un sujet angoissant tel que celui des vampires. En parallèle, la seconde peinture a été installée à proximité de photos de familles. Notre hôte estimait que cette œuvre, aux couleurs chaudes et marquées par le sourire de l’adolescent avait davantage sa place auprès des photos de ses proches, synonymes de convivialité.
Sanstitre, série Ados 3 de Sylvain Dubrunfaut © Inventaire l’Artothèque
Pour conclure, les visiteurs ont achevé leur balade en se rendant à la maison de Florence, écrivaine audomaroise. Au total, ce sont deux sérigraphies œuvres qu’elle a empruntées auprès de l’Inventaire. L’une réalisée par Honoré, porte le titre « H2O ». Si Florence a décidé de l’exposer à son domicile, c’est parce qu’elle traite d’une thématique, à savoir le réchauffement climatique, qui lui tient particulièrement à cœur. Un sujetd’actualité qui la concerne personnellement, en lien avec ses problèmes de santé.
CO2 de Honoré © Inventaire l’Artothèque
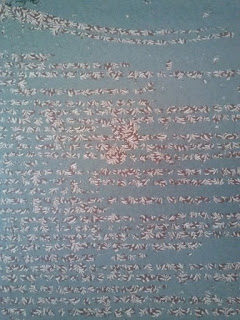 Dans un tout autre style, la seconde sérigraphie sélectionnée par Florence est signée Gérard Duchêne. Datée de 1990, elle s’intitule : « Papier Peint ». Connu pour son emploi des médias imprimés, le style de Duchêne est particulièrement reconnaissable à son travail de la peinture sur papier qui donne naissance à une écriture illisible, mettant ainsi en exergue la matérialité de l’écrit. Accrochée aux murs de sa salle à manger, cette œuvre renvoie aux créations de Florence qu’elle réalise sur des tapisseries.
Dans un tout autre style, la seconde sérigraphie sélectionnée par Florence est signée Gérard Duchêne. Datée de 1990, elle s’intitule : « Papier Peint ». Connu pour son emploi des médias imprimés, le style de Duchêne est particulièrement reconnaissable à son travail de la peinture sur papier qui donne naissance à une écriture illisible, mettant ainsi en exergue la matérialité de l’écrit. Accrochée aux murs de sa salle à manger, cette œuvre renvoie aux créations de Florence qu’elle réalise sur des tapisseries.
Papier peintde Gérard Duchêne,© Inventaire l’Artothèque
Comme expliqué précédemment : quel est l’intérêt pour l’Espace 36 et l’Inventaire de permettre à leurs adhérents de participer à une opération telle que celle-ci ? La particularité de cette manifestation réside bien au-delà du projet d’exposition en lui-même, et du principe de posséder une œuvre originale pour un temps déterminé. Le but premier ne consistait pas à expliquer ces œuvres via le prisme de l’histoire de l’art, ni à imposer un code de lecture définitif.
Au contraire, l’ambition première de ces deux associations est d’une part de faire découvrir des œuvres à travers le regard d’autrui, selon ses émotions, son ressenti et son propre vécu. D’autre part, leur volonté consiste à permettre à ces emprunteurs d’expérimenter une relation davantage intime avec l’art, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Une approche totalement différente qui a également permis de connaître ces personnes sous un angle différent, le tout dans un moment d’échange, d’écoute et de partage.
Vernissage-Balade©Clotilde Lacroix
L’exposition « Une œuvre pour vous ! » est visible jusqu’au 8 juillet 2017 à l’Espace 36, association d’art contemporain de Saint-Omer. Les modalités d’emprunt sont les suivantes : 5€ d’adhésion à l’Inventaire | Petit format : 10€ par œuvre et par mois, et15€ les deux œuvres parmois | Grand format : 20€ par œuvre et par mois. Penser à se munir d’une pièce d’identité et d’une attestation d’assurance habitation.
Joanna Labussière
#Brèvedestage
#Espace36
#Inventairel’Artothèque
#Artcontemporain
Pouren savoir plus sur l’Espace 36 : http://espace36.free.fr/
Plus d’informations sur l’Inventaire, Artothèque des Hauts-de-France : http://linventaire-artotheque.fr/____________________________¹ La Voixdu Nord, A l’Espace 36, empruntez une œuvre d’art pour chez vous, publié le 12 mai 2017, [en ligne] : http://www.lavoixdunord.fr/161574/article/2017-05-12/l-espace-36-empruntez-une-oeuvre-d-art-pour-chez-vous
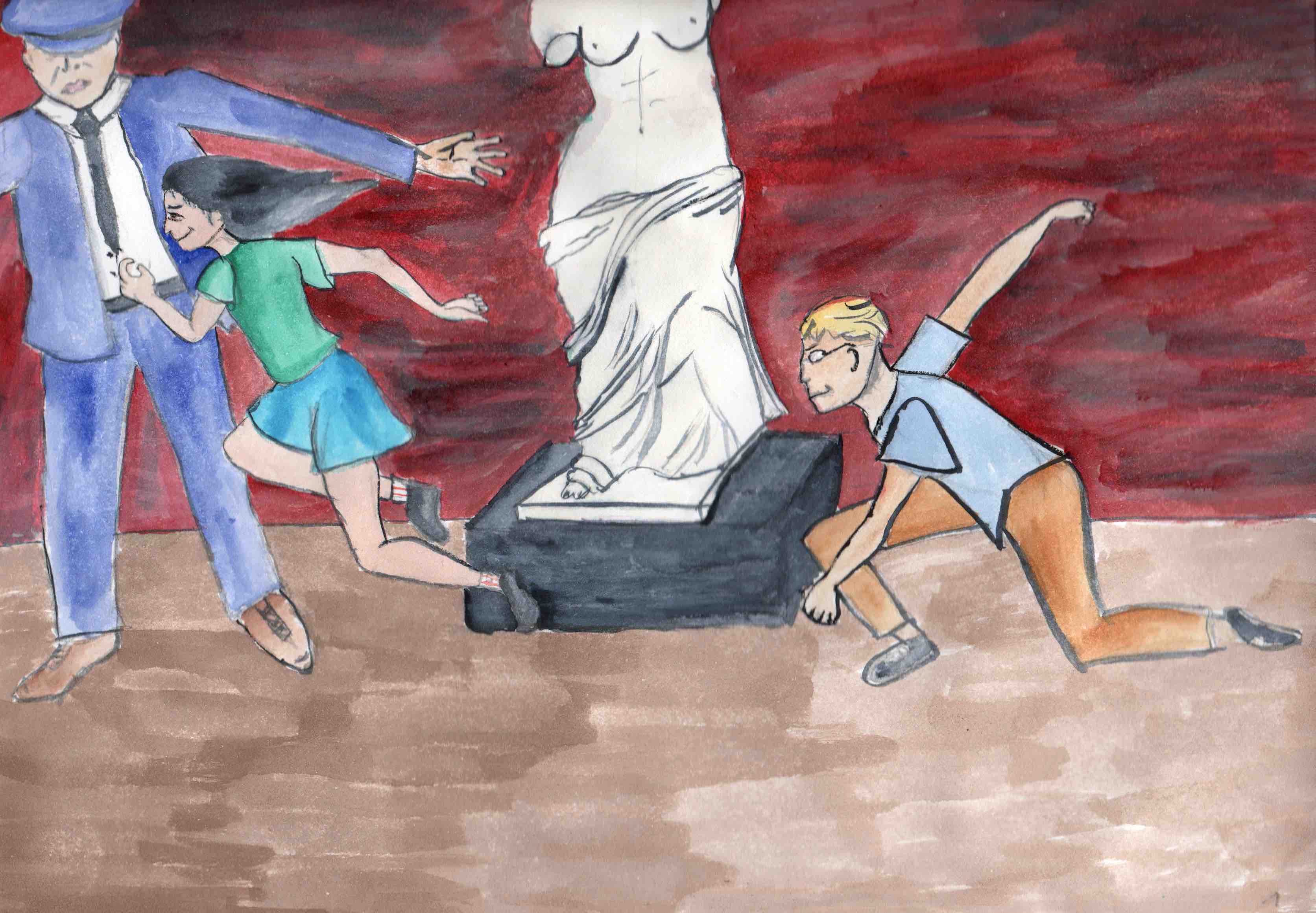
Une recette d'exposition pour enfants
Étant plus jeune, je me rappelle des musées comme étant des endroits ennuyeux où je devais suivre mes parents sans rien pouvoir toucher au risque de prendre un sermon de la part du gardien.
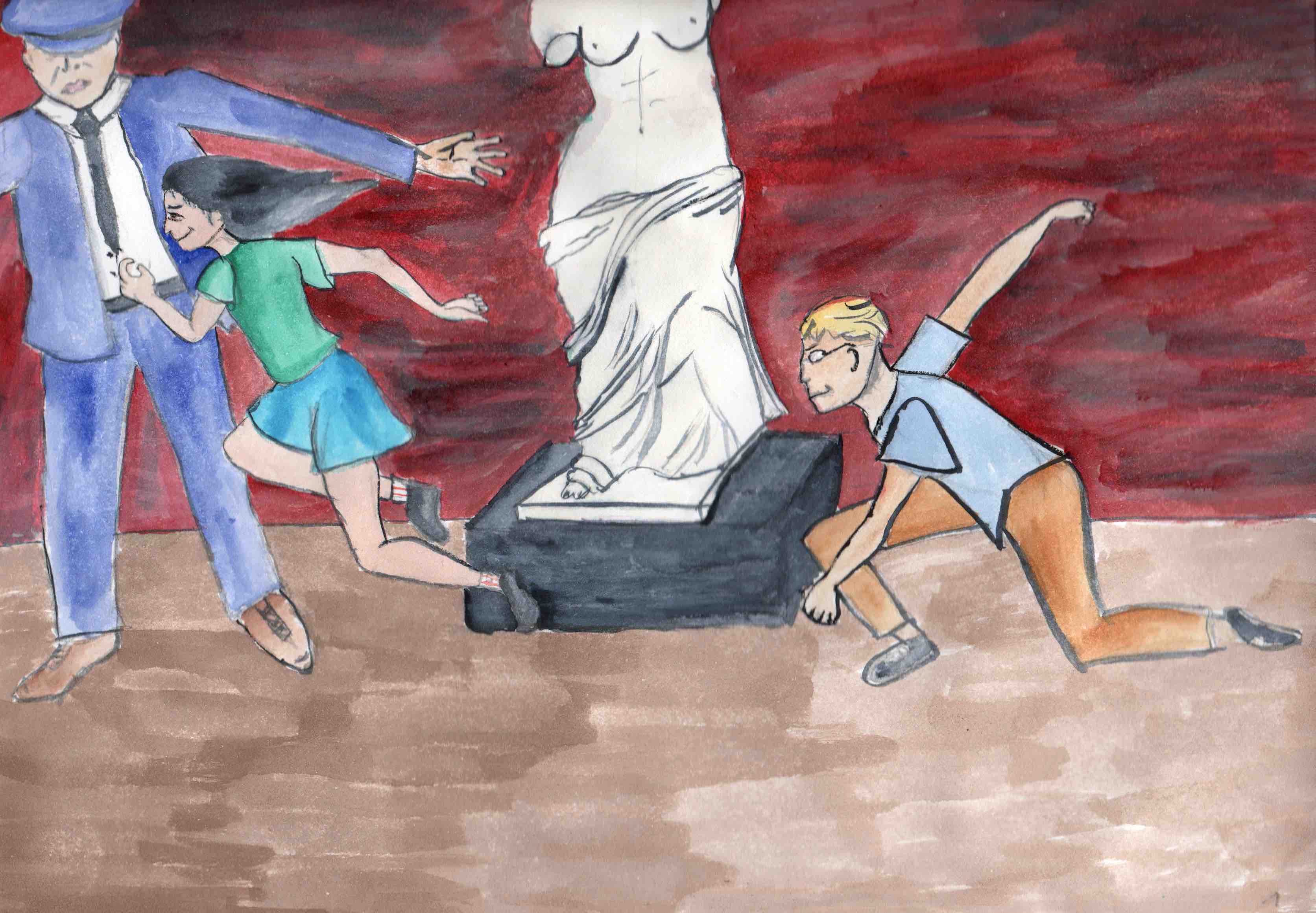
Dans les années 1980, des institutions comme la Cité des Sciences et de l’Industrie avaient commencé à prendre le problème à bras le corps pour proposer des solutions de visite pour ce nouveau public familial. La naissance de la Cité des Enfants a été une petite révolution dans l’univers de la muséographie. Inspirée des musées anglo-saxons, les enfants sont invités à expérimenter tout en s’amusant et en apprenant. L’espace est adapté avec différents jeux d’éveils correspondant à différents âges. La Cité des Enfants a subi des rénovations en 1992 ainsi qu’en 2005 pour s’adapter aux nouveaux codes d’apprentissage et d’éducation des enfants. Aujourd’hui, certaines institutions sont toujours frileuses dans la construction d’expositions dédiées aux enfants. La faute aux a priori…
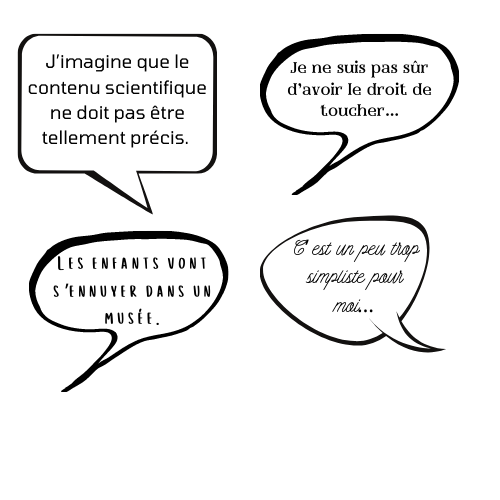
C’est donc en s’appuyant sur une étude de cas, l’exposition « La cathédrale d’Amiens : un jeu d’enfant », que nous proposons une recette de réalisation d’exposition pour enfant. Cette métaphore de la recette déjà adoptée par l’association Les Muséographes nous permet de mieux expliquer le travail de muséographe sur une exposition pour enfant en le différenciant des métiers de graphiste et scénographe.


Le travail des textes est un enjeu essentiel d’une exposition pour les enfants. Un premier travail de synthétisation a été nécessaire pour que les textes soient plus courts et plus impactants. Suite à cette étape, les textes ont été réadaptés pour leur donner un ton, parti-pris visible durant toute l’exposition. Nous avons choisi de nous adresser directement aux enfants en les tutoyant. Enfin, il a été nécessaire d’expliquer les mots plus compliqués au travers d’un lexique imager présent au centre de l’exposition.
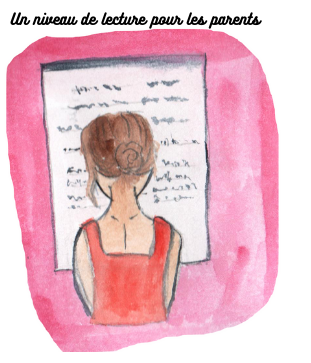
A contre-pieds de l’exposition classique qui propose un livret enfant, La cathédrale d’Amiens : un jeu d’enfant a décidé de proposer un livret destiné aux parents, pour « briller en société ». Le niveau de lecture supplémentaire permet de satisfaire les gros appétits d’informations.
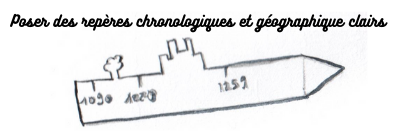
En fonction du thème abordé, il est important de poser des repères clairs pour les enfants, qu’ils soient chronologiques ou géographiques. Cela a été le cas pour cette exposition qui propose de replacer la cathédrale d’Amiens dans son contexte urbain et donc aux débuts de sa construction, au Moyen Age. Pour cela, une frise chronologique sur le Moyen Age a été installée, permettant aux petits visiteurs de comprendre où se place l’ère des cathédrales, ce qui a précédé et ce qui a suivi.
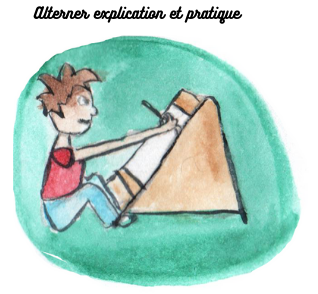
Pour ne pas perdre l’attention des petits visiteurs, il a été pensé d’alterner panneaux de textes et modules de médiation ludiques. Par exemple, après avoir lu le texte sur le chantier dans la ville, les enfants peuvent s’armer de tampons et créer à leur tour leur propre cathédrale sur papier.

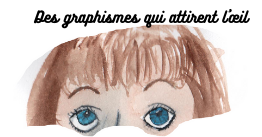
Le choix du graphiste est important puisqu’il conditionne pleinement l’identité de l’exposition et le souvenir visuel que gardera l’enfant une fois la visite terminée. Le choix ici s’est porté sur un graphiste ayant déjà travaillé sur du contenu pour les enfants.

La scénographie de l’exposition est également plus qu’importante. Elle met en espace toutes les idées proposées en muséographie pour obtenir une exposition ludique. L’idéal a été de proposer des modules à hauteur d’enfants ainsi que des espaces et recoins où ils puissent se cacher à l’abri du regard des parents pour entreprendre leur propre découverte de l’exposition.


Rendre le visiteur actif a été l’un des premiers challenges de cette exposition. Les modules devaient pouvoir rendre cela possible aux travers de diverses actions. Ici, l’accent a été mis sur la construction de la cathédrale. Les modules proposent donc aux enfants de construire un petit bout de cathédrale à chaque fois : le pavement, les vitraux, voire la cathédrale toute entière grâce à une maquette en bois présente au centre de l’exposition.
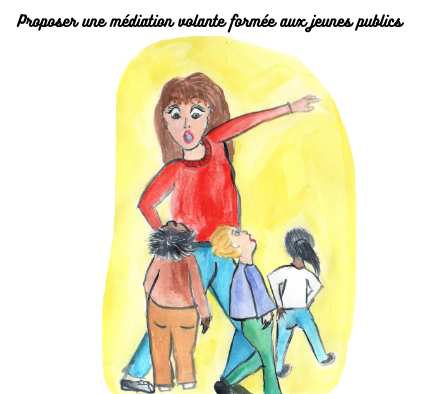
La présence d’un médiateur ou d’une médiatrice sur place pour répondre aux questions des visiteurs permet à la fois d’approfondir certaines connaissances des publics par rapport à l’exposition mais aussi de proposer des animations dans l’exposition. C’est le cas autour de la maquette en trois dimensions de la cathédrale, permettant de retracer toutes les étapes de sa construction du XIIIème siècle à aujourd’hui.

Un autre enjeu est celui de la programmation associée à l’exposition. La cible étant le public familial, et plus particulièrement les enfants, la programmation propose des activités d’éveil pour les bébés, de création pour les plus âgés et un escape-game pour les adolescents.
Cette recette a été expérimentée dans le cadre de la construction de cette exposition autour de la cathédrale d’Amiens. Ouverte en septembre, elle a su trouver son public. Comme souvent, les adultes également se sont mis à jouer dans les différents modules. Ce qui pose la question : si les expositions pour enfants étaient aussi pour les adultes ?
Textes et illustrations par Margaux Louët
#exposition
#enfants
#muséographie
Pour aller plus loin :
Expo La Cathégrale d'Amiens, un jeu d'enfants au CIAP d'Amien

Vi(d)e, les déserts
Comment faire une exposition sur un sujet où il n’y a, a priori, peu de contenu à exposer ?
C’est ce que le défi que s’est lancé le Muséum National d’histoire naturelle avec la nouvelle exposition au Jardin des plantes “Déserts”, du 2 avril au 30 novembre 2025. L’espace muséographique de 850m² prend peu à peu vie pour révéler les traces de vie des déserts actuels et l’adaptation de ses êtres vivants.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Parcours de l’exposition : du vide à la vie
L’exposition se découpe en 4 séquences : une première sur la définition du désert, une seconde sur les adaptations de la faune et de la flore, une autre sur l’adaptation des hommes et la dernière, plus courte, sur l’exploration scientifique.
L’entrée commence par la définition du désert choisie par le Muséum : il s’agit de zones émergées marquées par une grande aridité. Les précipitations y sont rares et irrégulières. Dans les déserts chauds, l’évaporation est intense, tandis que dans les déserts froids, l’eau se trouve sous forme de neige ou de glace. Ces lieux mythiques ne seront pas traités par ses imaginaires, l’histoire de sa formation ou de son exploration. C’est une approche contemporaine et scientifique qui est choisie. La mappemonde sur la première table situe les déserts chauds et polaires, qui sont évoqués tout du long de l’exposition. La seconde table, explique leur point en commun et une notion clef : l’aridité. Puis, une grande table avec des manipes et audio permet de comprendre la composition des déserts et une vitrine expose des roches sculptées par les éléments naturels. Ce premier espace est entouré d’une grande projection d’images désertiques vides, où panoramas et focus sur des grains de sables au ralenti défilent.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Pour quitter cette zone sableuse, il faut suivre des traces d’animaux et passer dans un couloir, évoquant un canyon. Alors, des cervidés, rongeurs et insectes font leurs apparitions… Au lieu de proposer de les exposer par zones géographiques ou espèces, le choix a été de les regrouper par moyen d’adaptation. Visuellement, cela se traduit par un jeu de couleurs dégradées allant du bleu ciel, au blanc, jusqu’à un beige sablé. Les tables sont thématisées : “ne pas en perdre une goutte”, “renaissance éphémère”, “attention à la surchauffe ”; “froid, moi ? jamais !”, “les sens en éveil”. Les différentes formes de vie sont voisines, parfois terrées dans le canyon, perchées dans un cactus, pour évoquer leurs habitats naturels et surprendre les publics.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Une dernière espèce trône fièrement pour faire la transition avec la section sur l’adaptation humaine : le dromadaire. Symbole du nomadisme, ce compagnon de route est accompagné d’une table numérique tactile de près d’un mètre pour zoomer sur les dizaines de caractéristiques qui en font un roi de la vie en milieu extrême. L’humain aussi essaye de s’adapter : par ses habitations avec la yourte ou la tente touarègue selon son degré de mobilité, ses objets nomades, sa garde-robe et le travail de la terre avec notamment la création d’oasis… Ces savoir-faire sont présentés à travers des objets, des multimédias et par la présence de témoignages vidéos de populations vivants dans différentes régions.
Enfin, l’exposition se clôt sur l’exploration scientifique actuelle, avec des témoignages de l’expérience sensible de 5 chercheurs , faisant aussi partie du comité scientifique.
Une médiation accessible et du low-tech
La présence d’éléments de médiation multisensorielle et parfois low-tech dans l’ensemble du parcours permet de rythmer la visite pour les petits et grands, et de s’arrêter pour rencontrer une espèce en particulier.
La première partie, commençant par deux cartes, une notion-clef complexe à comprendre (l’aridité) et une ambiance sonore très présente, est très bien compensée par la grande table de médiation pour continuer d’intéresser les publics. Les publics peuvent écouter au casque le chant des dunes, voir la palette étonnante des couleurs des sables ou faire souffler le vent sculpteur de dunes.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Chaque grande section a plusieurs bornes accessibles : carte du monde légendée tactile, stromatolites, pierres des déserts, empreintes de petits et grands animaux, et même couches de peau d’ours pour expliquer comment il garde sa chaleur.
© Tiphaine Schriver, Muséum National d’Histoire Naturelle
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Les dispositifs low-tech, par leurs illustrations, simplicité et efficacité, rappellent parfois la créativité de la littérature jeunesse. En tirant une feuille, une roche est sculptée par le vent. En tournant une manivelle, des fleurs éclosent grâce aux quelques gouttes de pluie tombées. Un lemming est dérangé dans son terrier si une plaque givrée est soulevée. En allumant une petite lumière, les veines d’un lapin aux immenses oreilles apparaissent. Il est même possible de sentir les vibrations du rat kangourou en posant une main sur une plaque !
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Un fil rouge “menaces” discret
Des focus “menaces” sont disposés dans chaque partie. Ce choix muséographique, de distiller ces alertes sur l’environnement dans l’ensemble des 4 séquences, permet d’éviter une section entière uniquement sur ce sujet (et encore moins en fin d’exposition): dès l’entrée, cela pourrait être anxiogène ou rude pour les publics.
Il n’y a pas eu de volonté assumée de fondre les menaces dans le discours et de ne plus en faire un sujet à part ou en plus. Cependant, leurs dispositions dans le parcours est discrète : la couleur marron de ces focus se détache peu de la direction artistique de l’exposition. De plus, certaines sont dans des recoins moins visibles. Ainsi, elles ne sont pas clairement identifiées par les publics.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Tiphaine Schriver
#désert #lowtech #Sciencenaturelle #accessibilité
En savoir plus
○ Site web de l’exposition : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-deserts
○ Catalogue : à venir
○ Du 2 avril au 30 novembre 2025

Visite déguidée au Musée national de l'histoire de l'immigration
Vous en avez assez des visites guidées classiques durant lesquelles vous relâchez votre écoute au bout de la première demi-heure ? Préférez les visites déguidées de Bertrand Bossard : rire, découvertes et variation des postures des visites. C'est insolite et intelligent.
Aénora Le Belleguic
#visiteguidée
#théâtre
#médiation
Pour en savoir plus :
http://www.histoire-
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Visite et revisite : des expositions en écho, hommage à l'illustre enfant du pays
Bédarieux : une ville culturelle enracinée dans son histoire
Petite ville de 6 000 habitants nichée en Occitanie, Bédarieux intrigue par son calme et sa discrétion. Au loin, le viaduc reliait au XIXe siècle le bassin minier au réseau ferré vers la Méditerranée. La ville, en plein essor industriel, prospéra pourtant jusqu’au milieu du XXe grâce à l’industrie textile, les tanneries, les fours à chaux, la chimie et la construction mécanique.
«L’endroit n’a rien d’une destination touristique, encore moins d’un bassin d’emploi dynamique. Les rares passants rencontrés le reconnaissent volontiers : la vie a déserté la ville depuis bien longtemps » affirme le rédacteur en chef de Libération, le 21 avril 2021. Bédarieux apparaît même comme une ville de « taiseux » …
Loin des destinations touristiques ou des bassins d’emploi, elle n’en affiche pas moins une belle ambition. Comme rétorque son maire avec humour : « Il faudrait que vous vous penchiez sur les villes comme la nôtre... pour montrer celles et ceux qui se battent pour redresser ces coins de France trop longtemps délaissés, mais pleins d’avenir ! ».
A présent, Bédarieux s’épanouit à travers l’art : ce renouveau passe par une dynamique culturelle forte. Nouveau cinéma, salles de spectacles, médiathèque, festivals… la ville propose une diversité d’activités. La Maison des Arts, située dans l’ancien Hospice Royal Saint-Louis classé Monument Historique, regroupe depuis 2003 un Espace d’Art Contemporain reconnu pour ses expositions d’artistes locaux et internationaux.
Bédarieux est aussi marquée par l’émergence d’espaces de création privés comme « Le 31 ». L’artiste Nicolas Bexon, tombé amoureux de la ville, s’y est établi et s’investit pleinement. Avec une vie associative dynamique et des habitants engagés, Bédarieux prouve qu’elle sait allier discrétion et créativité pour se réinventer.
Le peintre du pays à l’honneur : exposition “Pierre Auguste Cot - La Collection”
Pierre Auguste Cot, né à Bédarieux, a toujours gardé un lien fort avec sa ville natale malgré son succès parisien. Propriétaire du Mas Tantajo, il y passait ses étés à peindre, entouré de sa famille, organisant des soirées conviviales avec ses amis comme Alphonse Daudet. Il offrait également des toiles et réalisait des portraits pour les habitants. Depuis 1947, un buste sur la place qui porte maintenant son nom rappelle l’attachement de la ville à cet artiste emblématique.
En 2024, l’exposition « Pierre Auguste Cot – La Collection » célèbre son œuvre et son héritage en exposant plusieurs de ses toiles. Le vernissage a réuni plus de 500 personnes, et de nombreux élèves et visiteurs ont ensuite découvert ses peintures, enrichies par des prêts d’institutions régionales comme le Musée Fabre de Montpellier. L’exposition est dynamisée par les élèves du Lycée des Métiers de Fernand Léger qui ont participé à la reconstitution d’un salon semblable à celui de Cot. La collecte de dons pour restaurer les œuvres de Cot a été organisée par la Fondation du Patrimoine, représentée par Jean Lavastre, délégué territorial de l’Hérault.
Pour le maire, cet événement permet aux habitants de redécouvrir un artiste qui incarne à la fois l’ouverture et l’ancrage de Bédarieux dans son patrimoine.
Les femmes à l’honneur
L’exposition met en lumière les représentations féminines dans l'œuvre de l'artiste.
La première salle présente six portraits de femmes, soulignant leur place importante dans son travail, qu’il s’agisse de proches ou de Bédariciennes. Le « Portrait de Madame Gervais » témoigne de la délicatesse avec laquelle Cot peignait ses modèles féminins, souvent issus de la bourgeoisie. Le buste de Madame Cot attire également l’attention dans la première salle.
Espace d’Art Contemporain (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Ces œuvres témoignent de la formation rigoureuse que Cot a reçue auprès de ses maîtres, tels que Alexandre Cabanel.
Dans la seconde salle est exposée une peinture d’une prestance déroutante : “Mireille faisant l’aumône à la sortie de Saint-Trophime”, dans laquelle est représentée Mireille pleine de grâce et de grandeur, offrant quelques pièces à un mendiant dont le modèle était un jeune bédaricien.
Pierre-Auguste Cot revisité
L'exposition "Cot Revisité" se tient dans l’Atelier d’Art de Nicolas Bexon, où 25 artistes contemporains membres de l’association des 4CM (Créatrices et Créateurs du Caroux au canal du Midi) réinterprètent les œuvres de Pierre Auguste Cot.
Avec le soutien logistique de la mairie, cette exposition pose la question : que penserait Cot, l’artiste académique, des réinterprétations contemporaines de ses œuvres ? À l’époque, l’artiste répondait aux attentes ; aujourd’hui, il suscite réflexion et émotions.
L’exposition offre un parcours surprenant, où les artistes jouent avec humour et profondeur, toujours avec talent. Cette réinvention vivante de l’œuvre de Cot, après plus de 150 ans, réveille son héritage et invite les Bédariciens à découvrir ce grand artiste trop méconnu.
Parmi les œuvres, une jeune Ophélia, tablette tactile en main, observe silencieusement les visiteurs, tandis que sa robe (symbolisée par la robe de mariée de la mère de l’artiste) suspendue au mur ajoute un air mystérieux, nous faisant penser au travail de Sophie Calle.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Les artistes réinterprètent le célèbre "Printemps" avec des touches humoristiques ou provocatrices : des peintures retravaillées, des poupées Barbie mises en scène, une balançoire suspendue au-dessus d'un petit bassin…
Les femmes peintes par Cot sont au cœur de la question de l’émancipation féminine au fil des âges. L’artiste Catherine Philippe symbolise cette réappropriation par des éléments forts : un cintre portant un fœtus dénonçant les souffrances liées à l’avortement, et une autre œuvre, "La Prison Dorée", où une femme est prisonnière de barreaux d’or. “Mon travail créatif consiste à revisiter l’histoire de l’art avec un regard féministe, en utilisant des reproductions d’œuvres connues et reconnues sur lesquelles j’ajoute des éléments afin de rendre compte du vécu des femmes” explique l’artiste sur un cartel de l’exposition. Un hommage puissant à la lutte pour les droits et les libertés des femmes, brodé sur les œuvres.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
L’« Orage » de Cot a été réinterprété, avec l’ajout de l'article 213 du Code civil de 1804 : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Ainsi, la supposée Virginie devient l’otage de son compagnon, le toit du foyer se tissant peu à peu au-dessus de sa tête.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Revisiter une œuvre, c’est aussi revisiter l’Histoire de l’Art et réfléchir au rôle de l’artiste dans la société de son époque. De nombreux artistes participant à cette initiative ont évolué du figuratif vers l’abstraction ou le conceptuel, tout en abordant l’œuvre de Cot avec respect, et en l’ancrant dans les questions contemporaines mais déjà rencontrées dans le passé. Comme il l’est spécifié, l’art contemporain peut parfois déstabiliser, et certains visiteurs pourraient être surpris par ces interprétations modernes de l’artiste. Mais cette démarche est aussi une manière de s’approprier l’œuvre pour n’en retenir que l’essentiel, ce que chaque artiste a fait avec sa manière de percevoir les tableaux de Cot.
Un petit clin d'œil à David Beckham, qui, en arborant fièrement deux tableaux de Cot tatoués sur ses mollets, a permis à l’artiste bédaricien de conquérir des millions de fans de foot – et d’autres, probablement moins habitués des musées, mais tout aussi impressionnés par ses muscles !
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
La revitalisation des petites villes rurales est essentielle et à encourager. Bédarieux, avec Pierre Auguste Cot, dispose d’un héritage artistique précieux mais longtemps sous-exploité. Comme le souligne une commerçante qui a participé au jeu de piste “à la recherche des œuvres de Cot” en parallèle de l’exposition, pour beaucoup d’habitants, Cot n’était jusqu’à récemment que le nom de la place ou de l’arrêt de bus. Son œuvre restait largement méconnue car peu mise en avant par la ville. Pourtant, grâce à des expositions et des actions culturelles ambitieuses, Bédarieux exploite davantage ce patrimoine et l’affiche en tant que fierté. Ces initiatives permettent non seulement de reconnecter les habitants à leur histoire, mais aussi de dynamiser la ville, de s’ouvrir à la culture et d’attirer un nouveau public. Chaque commune, lorsqu’elle dispose d’un artiste local ou d’une richesse patrimoniale, peut saisir cette opportunité pour se dynamiser. L’art a ce pouvoir de transformer les territoires en leur redonnant vie et cohésion.
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
Extrait du journal municipal de décembre 2024, Bédarieux :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Journal-Municipal/2024/12/Journal-municipal-Decembre-2024-Webpdf.pdf
Dossier de Presse de l’Exposition :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Presse/2024/11/Dossier-de-presse-Exposition-PA-COTpdf.pdf
A propos de Cot, Association Résurgences, Bédarieux :
https://resurgences.weebly.com/pierre-auguste-cot.html
Autres actions culturelles en lien avec la thématique :
Du 21 au 30 novembre : jeu de piste à la recherche des œuvres de Cot à travers les différents commerces de la ville, permettant de gagner des bons d’achat et des places de cinéma.
Le vendredi 27 décembre à 18h30 : Conférence "Pierre Auguste Cot, le bédaricien" par l'association Résurgences, à l'Espace d'Art Contemporain.
Le vendredi 3 janvier à 18h30 : Concert d'orgue par Marc Chiron, à l'église Saint-Louis (hommage et improvisations sur des tableaux de Cot, en écho à l’exposition Pierre Auguste-Cot - La Collection).
Le samedi 11 janvier à 18h30 : Conférence "La restauration du Prométhée Enchaîné" par Roos Campman, à l'Espace d'Art Contemporain.
Autres expositions en lien avec la thématique :
Barbara Chase-Riboud : Quand un nœud est dénoué, un dieu est libéré
“Jusqu'en janvier 2025, huit grands musées parisiens honorent l'artiste américaine Barbara Chase-Riboud. L'exposition présente une quarantaine d'œuvres de bronze et de soie, explorant des thèmes tels que l'histoire culturelle et la représentation des femmes.” - Ville de Paris
Louvre Couture, objets d’art, objets de mode
“Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Musée du Louvre à Paris propose une exposition explorant les liens entre les chefs-d’œuvre de ses collections et des pièces de mode créées par de grands noms du milieu. Cette mise en miroir souligne l'influence des arts sur la création textile, avec une attention particulière aux représentations féminines.” - Toute l’Europe
#PierreAugusteCot #CotRevisité #Bédarieux #Revisit
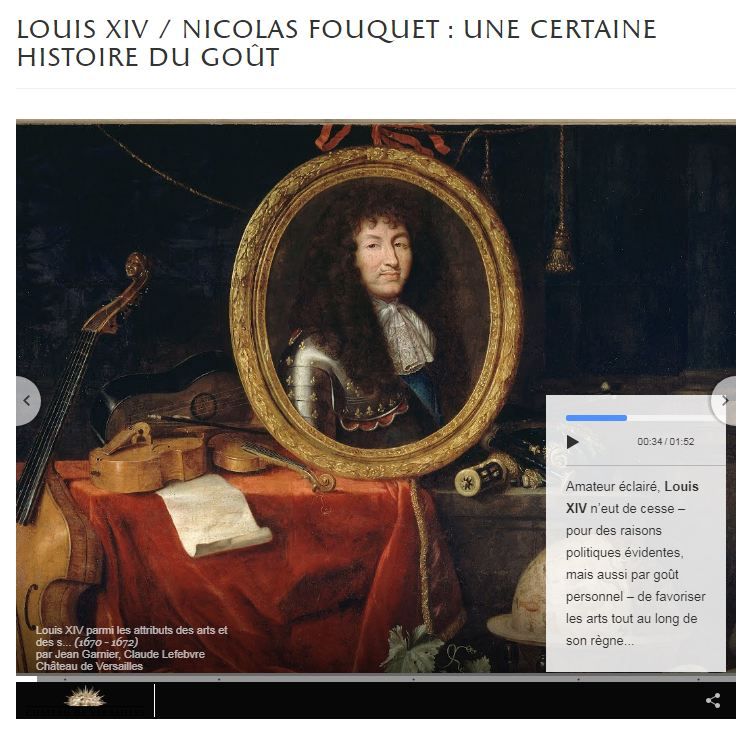
Zoom sur les expositions virtuelles
Ces dernières années ont été marquées par la ludification du musée. Entre les escape games,les chatbots et l’usage de la réalité augmentée, les nouvelles technologies n’ont pas fini de jouer avec le patrimoine.
Depuis le confinement causé par la pandémie du COVID-19, un autre dispositif ludique est plébiscité : l’exposition virtuelle. Par définition, il s’agit d’une exposition diffusée sur internet, mais selon les moyens employés, il existe une grande hétérogénéité des formes. Allant du simple « slide » aux reconstitutions immersives, voici quelques exemples :
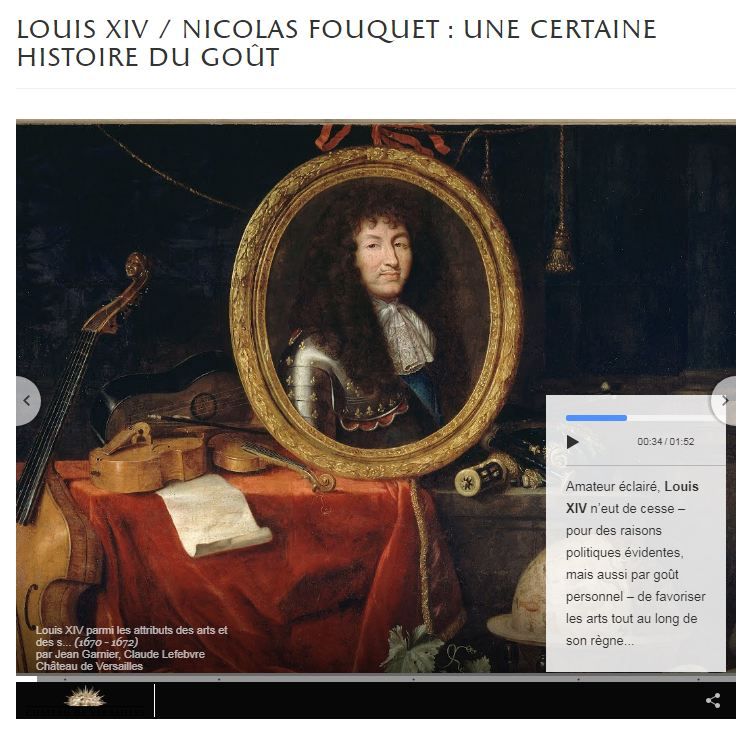
Exposition « Louis XIV et Nicolas Fouquet, une histoire de goût », du Château de Versailles, créé spécialement pour le web, sous forme de slide multimédia (images, textes, audio…)
©Château de Versailles http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-fouquet-:-une-certaine-histoire-du-gout

Exposition « L’Estuaire de la Seine, l’invention d’un paysage » par le Musée d’art moderne André Malraux. Un moyen de “faire perdurer” cette exposition en publiant sur le site du musée un corpus de textes et d’œuvres.
©MuMa Le Havre http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/lestuaire-de-la-seine-linvention-dun-paysage

Une mise en page dynamique pour l’exposition « Les Nadar, une légende photographique », de la BnF. Le contenu se « déploie » à mesure que l’on parcourt la page.
©BnFhttp://expositions.bnf.fr/les-nadar/
Il existe même des expositions dans lesquelles des environnements entiers sont simulés. C’est précisément le travail de l’UMA, l’Universal Museum of Arts, fondé par l’historien de l’art Jean Vergès : un musée fictif qui collabore avec les “ vrais musées ” pour réaliser des expositions gratuites sur internet.
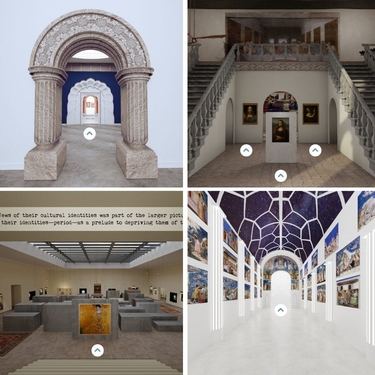
Captures d’écran de diverses entrées d’expositions © UMAhttps://the-uma.org/fr
La page d’accueil liste les expositions en cours et celles à venir. En cliquant sur l’exposition de notre choix, nous voici dans un environnement pensé par un architecte contemporain. Selon le propos de l’exposition, la scénographie va de la plus classique (type ancien palais réhabilité) à la plus ambitieuse (architecture totalement fantasmée). Pour naviguer dans l’espace, il faut maintenir le bouton clic enfoncé et bouger la souris, ou utiliser les flèches directionnelles qui apparaissent sur l’écran. Si l’on n’utilise pas souvent d’ordinateur où que l’on ne joue pas aux jeux en ligne, cette manipulation peut demander un petit temps d’adaptation.

Navigation dans un espace d’exposition © UMA
Lorsque nous cliquons sur une œuvre qui nous intéresse, une fenêtre d’information apparaît. Elle contient le cartel de l’œuvre, un commentaire descriptif ainsi qu’un propos lié à l’exposition.
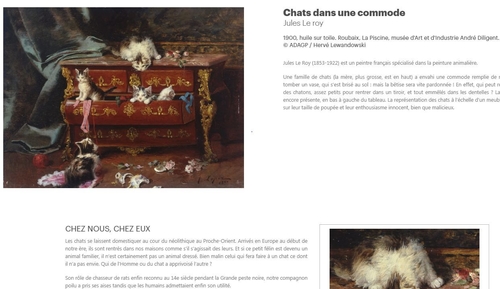
Fenêtre d’informations © UMA
L’implication d’un musée dans ce genre de projet varie. Ainsi, l’exposition « Chats dans l’histoire de l’art »lancée le 7 juillet 2018 a été imaginée par la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, alors qu’une des prochaines expositions intitulée « De la Renaissance au XXème siècle »nécessite pour les musées concernés, un simple envoi de photos à l’UMA. Dans tous les cas, les expositions de l’UMA ne sont pas un simple rassemblement d’œuvres en haute qualité car elles s’accompagnent bel un bien d’un propos scientifique. L’UMA fait appel à des spécialistes qui ont champ libre sur la sélection des œuvres.
Quel est l’intérêt d’exporter les expositions en ligne ? Le premier argument qui nous vient est celui de la démocratisation : avoir accès à une exposition gratuite, à tout moment. D’autant que la tendance actuelle défend de plus en plus le partage des biens communs, dont les œuvres d’art (les créations de Microfolies, les versements sur wikimédia…). Avec les expositions virtuelles, le musée se montre également garant de la qualité d’image, de la « bonne version » de l’œuvre, car les prises de vues retouchées sont nombreuses sur le net.
Sur un support numérique, il y a la possibilité de zoomer sur des détails tels que la touche d’un peintre. Vous ne verrez jamais la Joconde aussi près que depuis un écran, c’est un fait. « Le contact avec l’œuvre physique est unique et irremplaçable. Mais nous sommes convaincus que la reproduction d’une œuvre peut émouvoir, intriguer et enthousiasmer... Au même titre que l’écoute d’un artiste sur Spotify nous pousse à aller voir son concert ! »explique l’UMA.
Autre argument fort en faveur de l’exposition virtuelle, le pouvoir de créer une exposition sans les contraintes qu’imposent la matérialité : pas de problèmes d’espace, pas de convoiements, pas d’assurances, pas de risques de conservation préventive… On réunit ce qu’on veut ! Une utopie réalisée qui fera sourire les amateurs d’arts. « Cela n’a donc rien d’un musée ! » dirons les réfractaires. Encore une fois, l’UMA n’entend pas remplacer le musée mais « diffuser son image et renforcer l’affirmation de sa pertinence actuelle ».
Faire des expositions en ligne, est-ce vraiment une manière de démocratiser l’art ? Pas vraiment, puisque l’UMA précise jouer un rôle complémentaire. Ce qui veut dire que dans la réalité, ce concept tombe dans les mains d’un public averti. Autre exemple, le géant Google Arts & Culture, qui est une mine d’or de ressources, n’a jamais transcendé les foules, jusqu’à ce qu’ils lancent une fonction permettant aux gens de trouver leur sosie en peinture grâce à leur selfies. C’est plutôt ce genre d’actions culturelles qui « démocratisent »l’art et donnent aux gens l’envie de s’intéresser aux musées.
Un conseil aux établissements qui souhaitent développer des expositions virtuelles : exposez l'inexposable ! L’exposition « Chats dans l’histoire de l’art », aussi adorable soit-elle, peut être réalisée dans n’importe quel musée. Il serait plus pertinent d’exposer des sujets sensibles, complètement décalés, que les musées ne sont peut-être pas encore prêts à accueillir…
B.O
#expositionvirtuelle
#democratisation