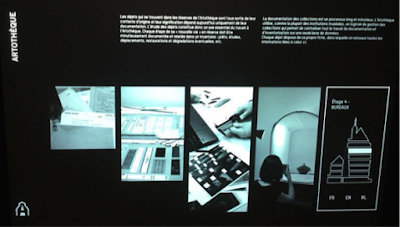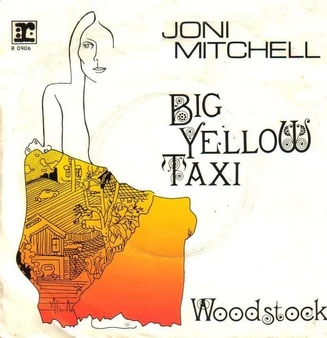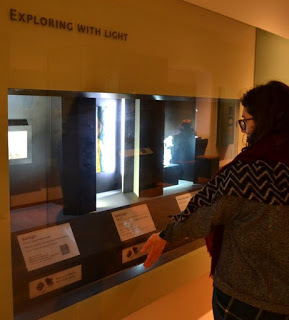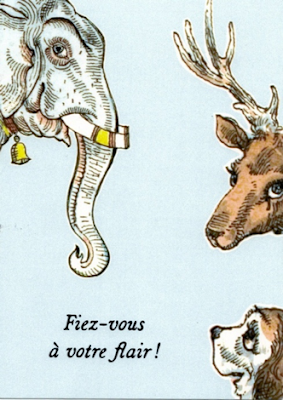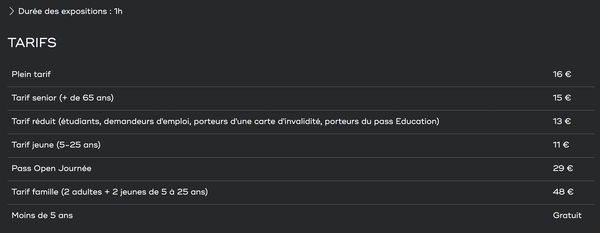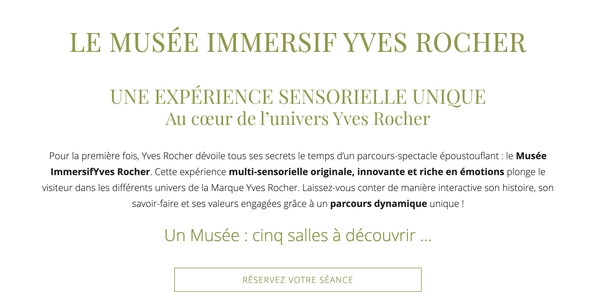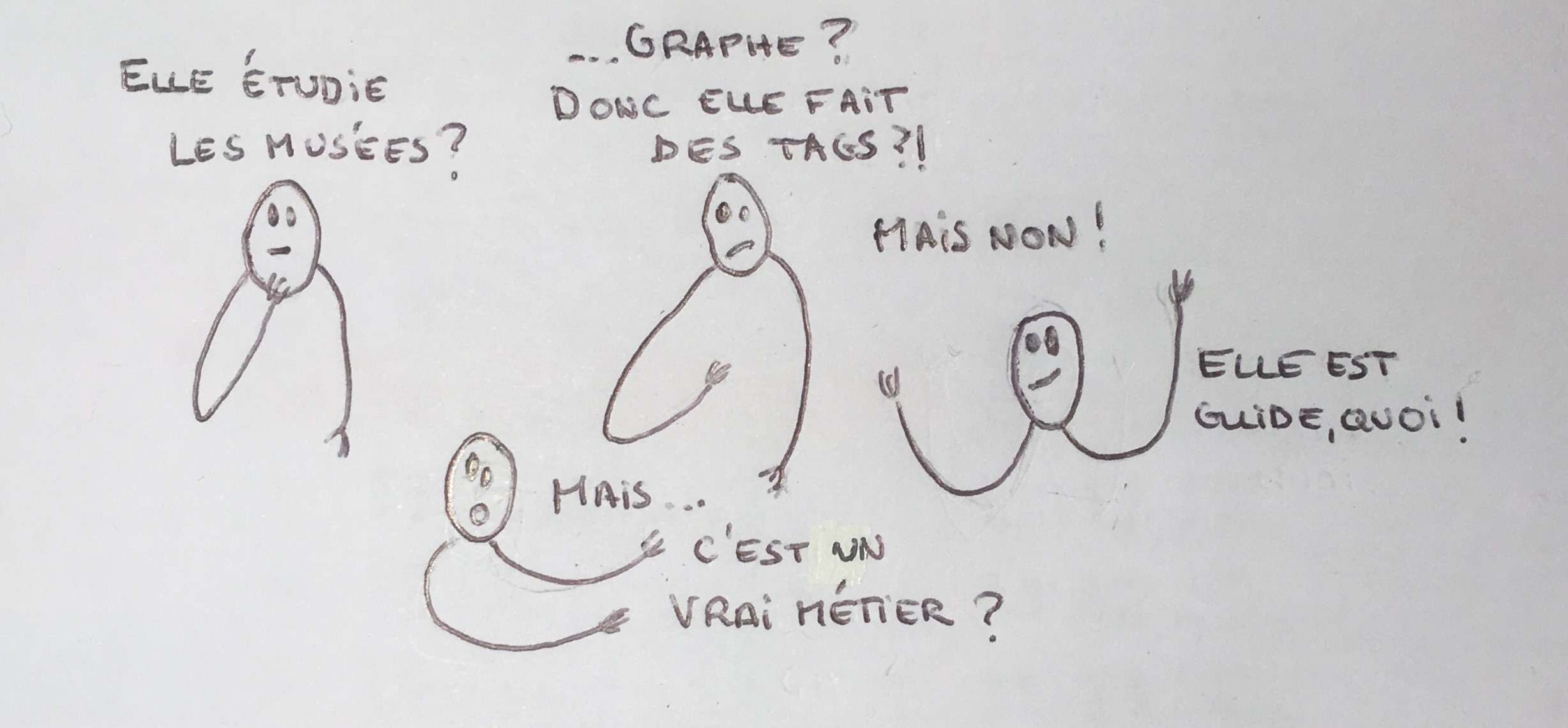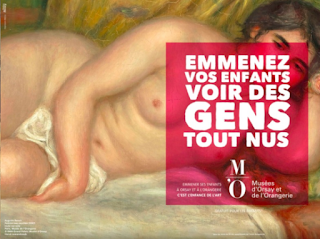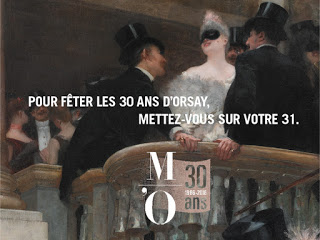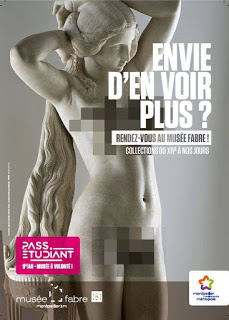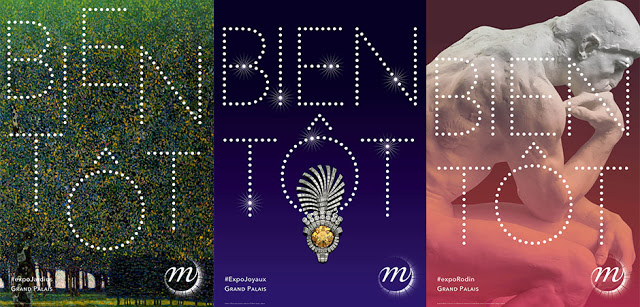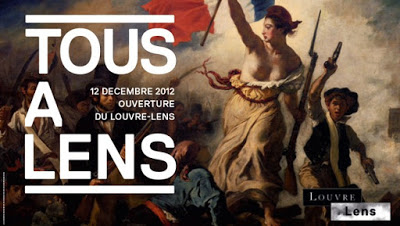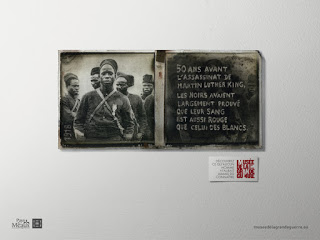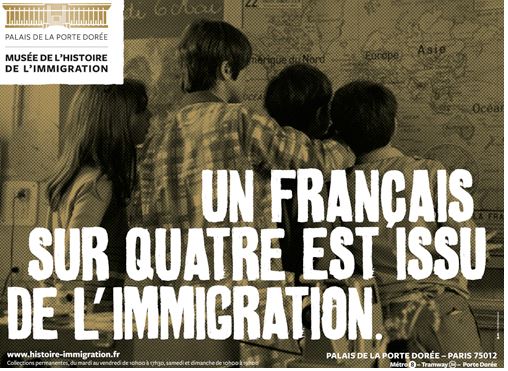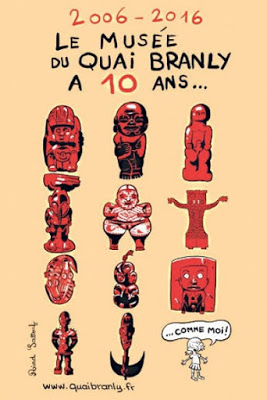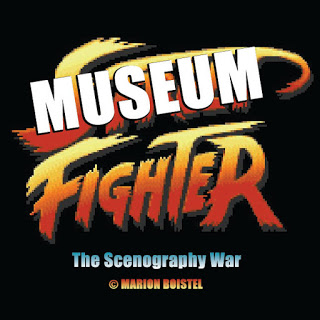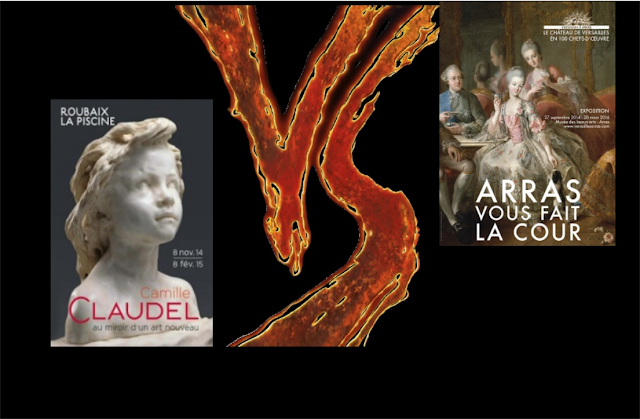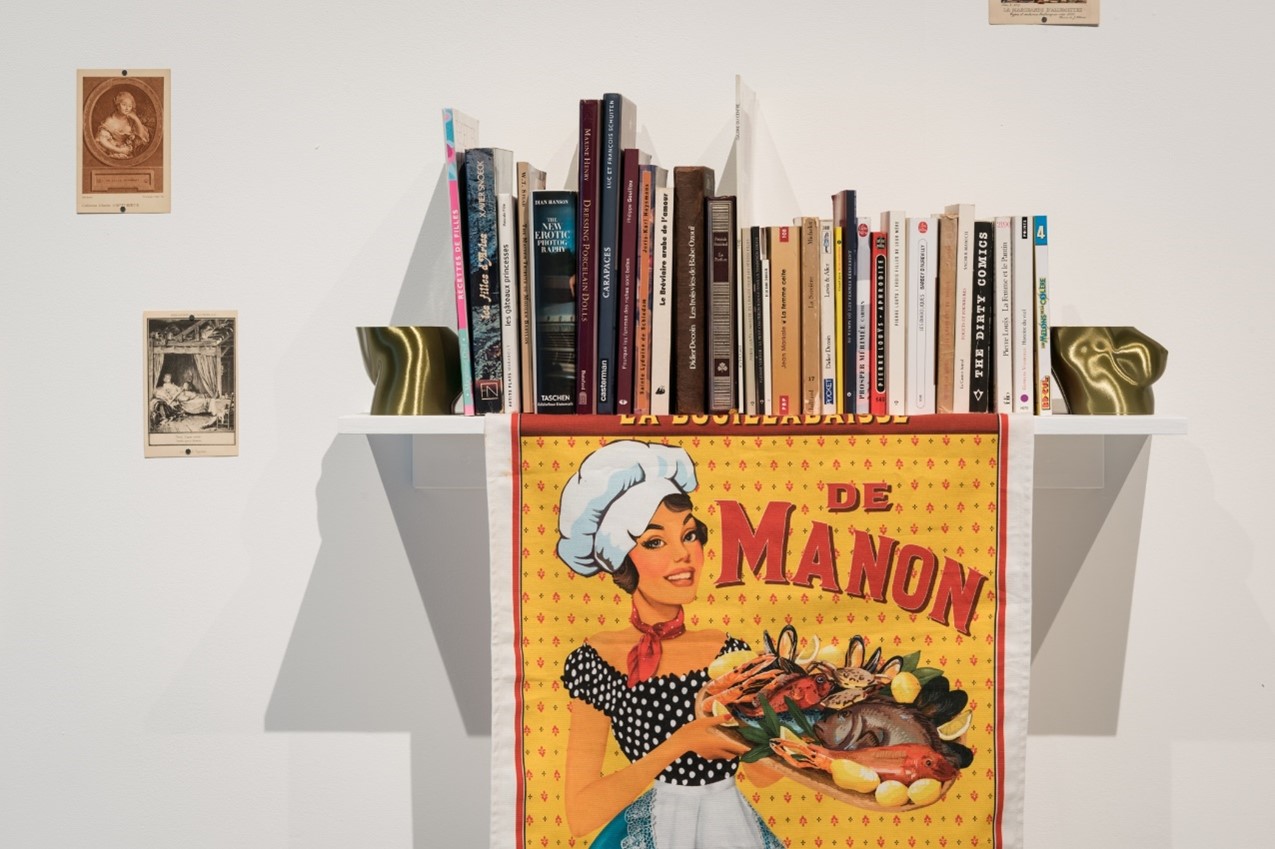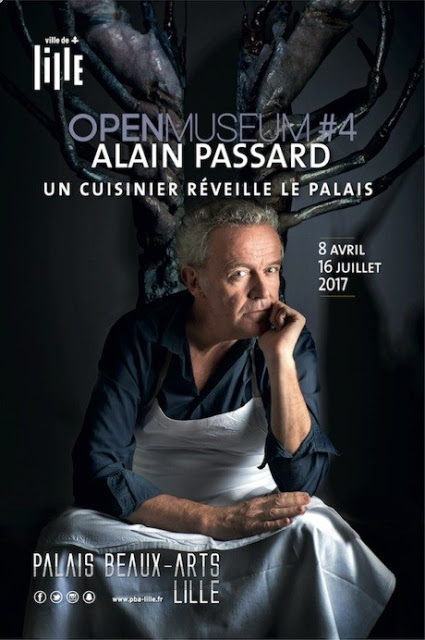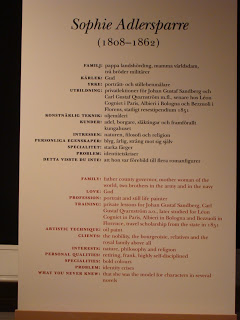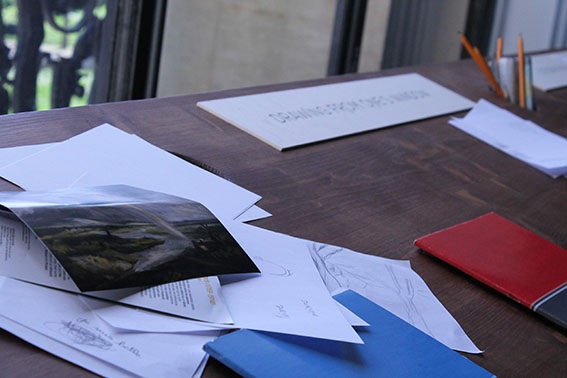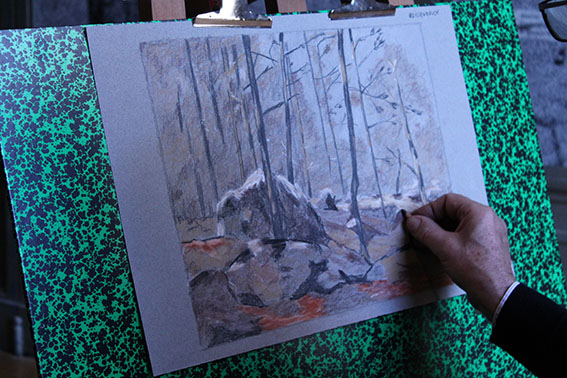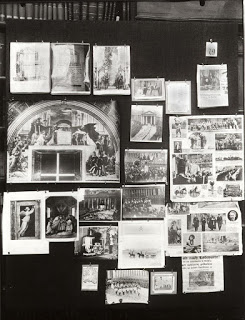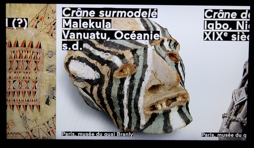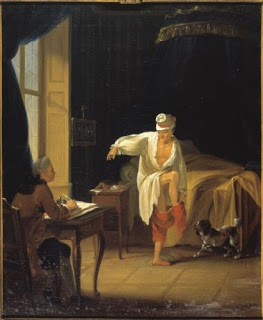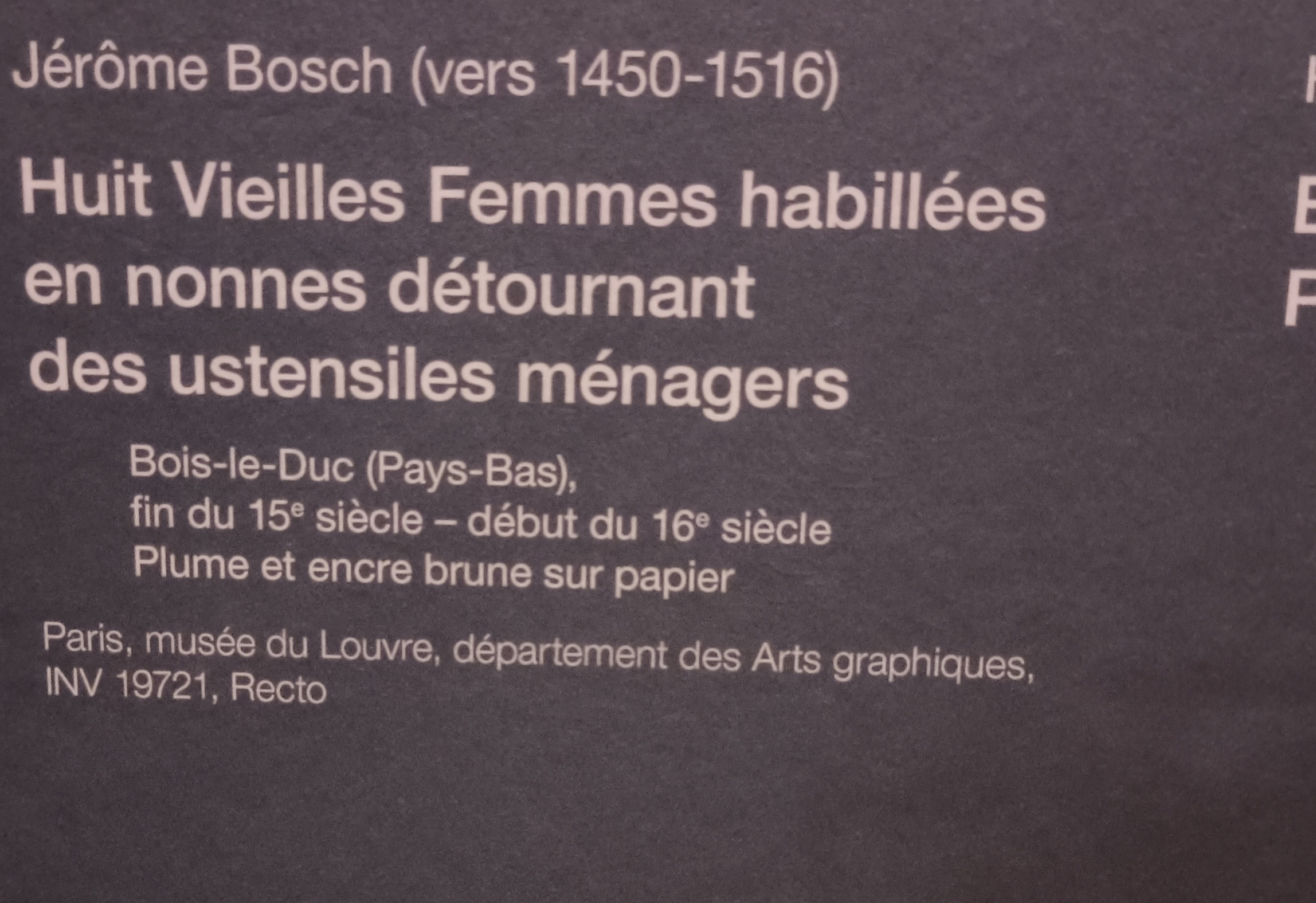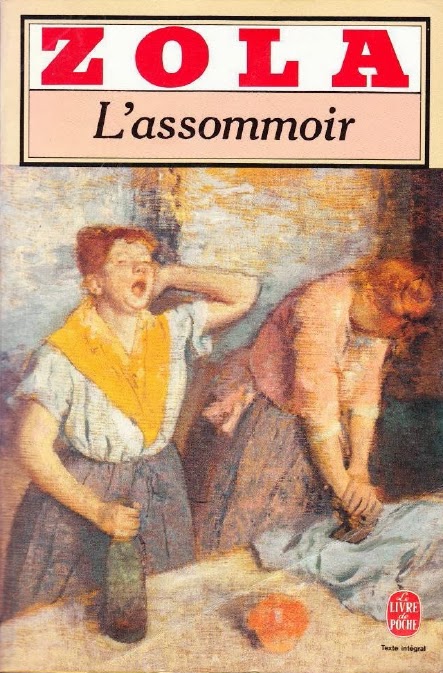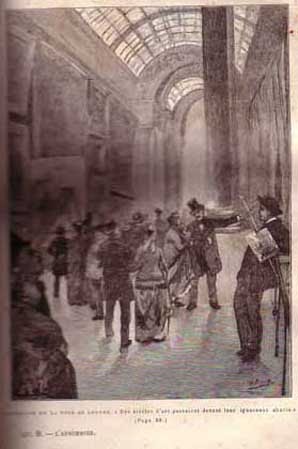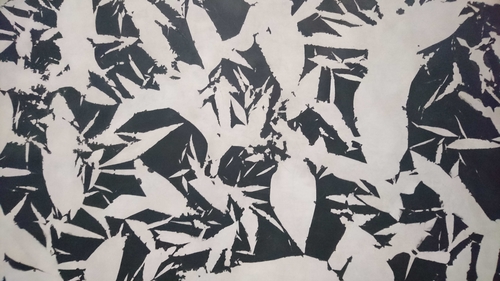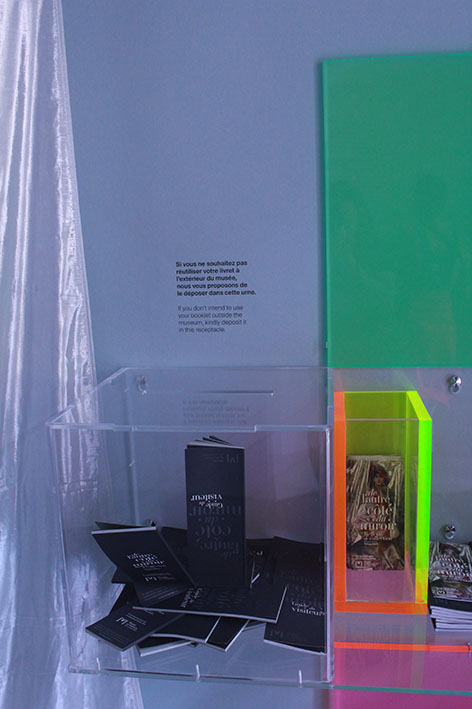Le musée mis en scène

À vos claviers !
Ça y est vous êtes face à votre ordinateur, face à cette page blanche. La barre de rédaction sur votre fichier clignote et le seul mot que vous avez réussi à écrire, assez rapidement sans y réfléchir c’est
PSC :
Au bout d’une heure vous avez envie de taper une déferlante d’injures en majuscules, en rouge, en gras sorti du plus profond de vos entrailles. Le sang monte, vous entendez votre cœur battre dans vos tempes et la migraine pointe le bout de son nez.
Pas de panique, vous n’êtes pas seul et nous allons trouvez des solutions. Vous voudriez être créatif, écrire comme Rimbaud que les mots coulent sur votre clavier. Pas besoin de vous mettre dans cet état vous pouvez trouver cette créativité chez les autres.
Une solution simple pour écrire son Plan Scientifique et Culturel : chercher dans la chanson française !
Expliquons cette technique : vous devez trouver une ligne directrice qui soit le fil conducteur de votre établissement « ce petit chemin qui sent la noisette » mais qui doit avoir une queue et une tête.
Ecrivez en premier la typologie de votre lieu. Vous êtes un musée scientifique tourné vers l’astronomie, simple. Vous voulez que votre public soit « un peu plus près des étoiles » qu’il voyage « plus loin que la nuit et le jour » et surtout « dans l’espace inouï » de votre planétarium. Et voilà de la programmation en pagaille à base d’immersion, d’atelier tourné sur le sensible, des nocturnes, des weekends et pourquoi pas des marathons de l’espace. Et tout ça sur un fond de Julien Clerc et de Véronique Samson « Volons Vers La Lune, Vers Saturne et ses anneaux, Volons vers Vénus et Mars, En capsule Apollo » un succès garanti.
Vous êtes plutôt Musée d’Histoire naturelle et vous voulez être innovant, rapprochez l’art et la nature « comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y’a des poissons tropicaux, pleins de piquants sur le dos » que les enfants se rendent compte que « le monde entier est un cactus ». Vous voilà dans une cascade d’ateliers entre art et histoire naturelle à coup de participation, de projets de collaboration, d’exposition géante « pour ceux qui ont un cœur d’enfant ».
Si l’Histoire avec un grand H est votre sujet, est-ce plus compliqué ? Point du tout, il y a des heures et des heures de chanson pour vous. Que ce soit sur la royauté et ce « sombre monarque débarque et étale son pouvoir » ou l’immigration et le fait « qu’être né quelque part c‘est toujours un hasard » et qu’il y a plein de choses en commun entres ses « deux étrangers au bout du monde » ou que vous êtes tourné vers ce « Sunday, bloody Sunday ».
Bref, vous n’allez pas déchanter, et vous vous demanderez peut-être si exposer des points communs entre l’histoire et la science-fiction est une pure fiction. Tout est possible ; suivre la vie quotidienne entre un habitant de Tokyo et un de Singapour, revisiter le poids de la musique rock dans l’histoire de l’Irlande. Bref vous êtes un établissement qui cherche à expliquer sa thématique principale par des pas de côté, notamment à travers les arts.
Et pour finir l’Ethnographie ! Bon ça se complique. Comment ne pas tomber dans les clichés des amoureux « d’une terre sauvage » qui demande si un « sorcier vaudou » va leur peindre le visage. Ou encore tout ceux qui vous disent « il paraît que les Chinoises ont de tout petit pied, il paraît que les Chinois ont les cheveux nattés ». Pas de panique ! Vous pouvez toujours axer sur une déconstruction des clichés, expliquer que « le dimanche à Bamako » non ce n’est pas toujours « le jour de mariage », qu’en Afrique ce n’est pas que « l’ambiance de la Brousse ». Allez-y ! Créer un axe sur la musique électronique aujourd’hui au Mali et quand est-il de l’art contemporain au Sénégal ? La culture Hip-hop à Tokyo ?
Alors si compliqué ? Non vous allez dire mais pas sérieux. Et ALORS ? au moins ça débloque, ça détend et on rigole un peu ! Tiens l’humour pourrait-il être une solution ?
Mathilde Pavaut
#PSC
#pageblanche
#chansonfrançaise

Faut-il renoncer aux expositions permanentes ?
Entre le permanent et le temporaire
Valérie Jouve au Petit-Palais (Paris) © Laurence Louis
Les expositions temporaires : un atout dynamique considérable
L’excès du temporaire contre la sécurité du permanent
La nécessité d’anticiper le changement
Laurence Louis
À lire :
JACOBI Daniel, « Exposition temporaire et accélération : la fin d’un paradigme ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 150 | 2013, mis en ligne le 29 novembre 2015, disponible sur http://journals.openedition.org/ocim/1295 ; DOI : 10.4000/ocim.1295, consulté le 12 décembre 2018.

"Arto" quoi ?
Une artothèque c’est quoi ? Communément elle peut se définir comme « un organisme pratiquant le prêt d’œuvres d’art ou de reproductions » (définition Larousse). Celle que je vous propose de découvrir a bien d’autres fonctions.
© L’art de muser
Une artothèque c’est quoi ? Communément elle peut se définir comme « un organisme pratiquant le prêt d’œuvres d’art ou de reproductions » (définition Larousse). Celle que je vous propose de découvrir a bien d’autres fonctions.
Inaugurée en avril 2015 à l’occasion de Mons 2015, l’artothèque définie ici comme « le musée des musées » se place au cœur du réseau muséal de la ville. Y sont réunies près de 50 000 œuvres d’art issues des collections communales des différents musées de la ville. Des collections, en somme éclectiques, prenant place au cœur de l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, bâtiment datant du XVIIIe, restauré à cette occasion. L’artothèque, réserve mutualisée pour les différents musées de la ville, se donne quatre missions : conserver, restaurer, étudier et communiquer les collections. Ici est offert aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans les réserves, de découvrir la face cachée des musées, et les différents métiers de l’ombre gravitant autour. Pensée comme un « Muséum Lab », l’artothèque abrite, en plus des réserves, un espace de numérisation et un atelier de restauration.
Pour des raisons évidentes de conservation la visite de l’artothèque ne consiste pas à mener les publics de réserves en réserves, l’expérience se vit autrement. Dés le hall d’entrée, les visiteurs touchent du doigt les collections, comme placées sous verre les œuvres se dévoilent sans pour autant s’exposer. Il s’agit d’une « vraie » réserve, un lieu où l’optimisation de l’espace est privilégiée et dans lequel les nouvelles technologies rendent visibles les collections. Grâce à la numérisation de nombreuses œuvres, l’artothèque s’est constituée une réserve virtuelle, là est expérimentée une nouvelle façon de valoriser les trésors habituellement cachés aux visiteurs.
©Amandine Gilles
Dispositif tactile présent à l’entrée permettant aux visiteurs d’explorer l’artothèque étage par étage afin d’y découvrir les différents espaces qu’elle abrite et les missions qu’elle se donne.
Pour accéder à cette réserve virtuelle il faut prendre la direction de la nef latérale pour y découvrir une salle où se côtoient différentes technologies. Parmi elles, un écran panoramique incurvé qui, grâce au procédé de la Kinect, permet aux visiteurs d’interagir physiquement avec les œuvres. D’un simple mouvement de bras, de main, le visiteur évolue entre les œuvres, en sélectionne certaines et, grâce à la numérisation HD, en découvre les moindres détails. En somme, le visiteur entre dans l’œuvre.
© L’art de muser
L’expérience ne s’arrête pas là, au centre de la salle sont placés différents mobiliers sur lesquels sont disposées des tables numériques. Trois modes d’exploration sont proposés, de la frise chronologique « Mons au fil des siècles », à la « Visite virtuelle de Mons », en passant par la « Visite de la chapelle », nous sommes amenés à découvrir la diversité des collections montoises. Là aussi le visiteur peut sélectionner une œuvre, puis zoomer pour en découvrir le moindre détail. Pour certaines œuvres l’expérience va plus loin, en les sélectionnant un plan de la salle apparaît, ainsi qu’un schéma du mobilier, des zones précises s’illuminent alors. En effet, certaines œuvres numériques ont leurs pans réels dans la salle, en explorant les différents tiroirs du mobilier les visiteurs découvrent des œuvres de toutes sortes.
© L’art de muser
©Amandine Gilles
© L’art de muser
Ce dispositif est aussi le moyen d’exposer de manière ludique les différentes étapes de la restauration d’un objet. Grâce aux différentes numérisations le visiteur peut ainsi contempler l’état d’un même objet à chaque étape de restauration. Ces technologies immersives et participatives permettent de plonger le visiteur dans l’univers des réserves, de lui donner accès aux œuvres, et de lui faire découvrir l’importance de certains métiers, qui lui étaient peut-être inconnus jusque là. L’intérêt est aussi scientifique, en effet, la qualité de la numérisation des différentes œuvres permet notamment la visualisation de détails alors invisibles à l’œil nu.
Pour les visiteurs souhaitant approfondir leurs connaissances, notamment sur une œuvre découverte plus tôt, un centre documentaire est mis à leur disposition au premier étage. Véritable outil au service des publics, on y retrouve une multitude d’ouvrages en lien avec les collections communales et le patrimoine montois.
© L’art de muser
L’artothèque de Mons est un lieu aux potentialités et à l’imagination sans limites. Pour l’inauguration les visiteurs étaient invités à se mettre dans la « peau » d’une pièce entrant dans les collections. Ainsi, à leur entrée dans l’artothèque, emballés telles de véritables œuvres d’art, les visiteurs étaient étudiés par le personnel afin d’évaluer leur état. Selon leur âge et bien d’autres critères, ils étaient ensuite répartis dans les différents services de l’artothèque, l’atelier de restauration pour « les plus abîmés », et les différents espaces de réserve pour ceux « en bon état ». A travers cette immersion originale, les visiteurs découvraient les différents parcours qu’une œuvre d’art pouvait emprunter en entrant dans les collections, et prenaient connaissance des différents métiers liés à la gestion des collections. Actuellement, différents projets de médiation, toujours plus inventifs, sont en cours de réflexion promettant bien d’autres expériences au cœur des réserves !
Amandine Gilles
#Mons2015
#artothèque
Pour en savoir plus : http://www.artotheque.mons.be/
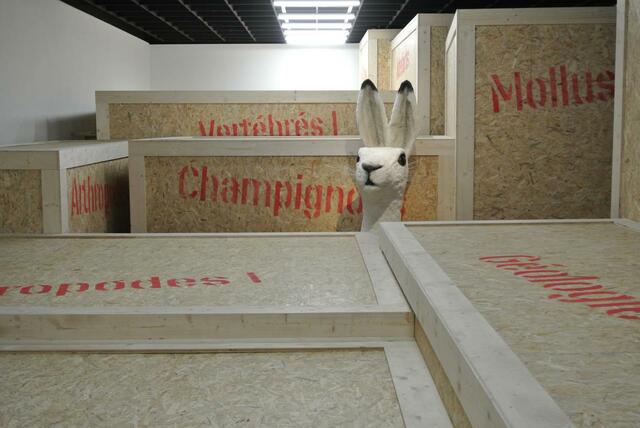
« Emballe-Moi » ou l’histoire d’un déménagement
Les musées de Neuchâtel doivent déplacer leurs collections dans de nouvelles réserves communes dans les prochains mois. Le Musée d’Histoire Naturelle dévoile les coulisses de ce projet dans l’exposition « Emballe-moi ».
Entrée du Musée d’Histoire Naturelle. Photographie : M.L.
Les musées de Neuchâtel doivent déplacer l’ensemble de leurs collections non exposées dans des réserves communes à tous les musées de la ville. Cette dernière souhaite créer un pôle muséal de conservation afin de stocker les objets dans les meilleures conditions possibles. Les réserves sont les lieux de dépôt des objets qui ne sont pas exposés : comme l’explique Brice Matthieu, c’est « un lieu de stockage, de transit et de travail », qui doit donc respecter les normes de conservation tout en étant fonctionnel pour permettre au personnel du musée ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses de travailler dans de bonnes conditions. Il explique également que depuis les années 2000, nombreux sont les musées qui repensent leurs espaces de réserves, en France, au Pays-Bas, en Angleterre et en Suisse. Bien penser les réserves fait partie du domaine de la conservation préventive, que l’ICOM-CC (Comité pour la Conservation) définit de la manière suivante : « L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. » La conservation préventive vise donc à conserver le mieux possible et à stabiliser au maximum les objets qui appartiennent aux collections. Les principaux facteurs pouvant impacter une collection sont les suivants : le climat, les nuisibles, la lumière, les polluants, les vibrations et la poussière.
Les bâtiments anciens dans lesquels sont actuellement installées les collections ne permettent pas de garantir de bonnes conditions de conservation, notamment au niveau de la régulation de l’humidité et de la température mais aussi de la sécurité globale. Par exemple au Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN), beaucoup de spécimens sont conservés en alcool dans les collections. Or en cas d’incendie, cela pourrait être dangereux tant pour les collections que pour les personnes qui les fréquentent. Des bâtiments sont aussi loués pour servir de réserves mais les conditions restent inadéquates. La location est onéreuse, des inondations ont eu lieu entre 2014 et 2019 et les réserves sont près de dépôt de meubles ou de nourriture ce qui favorise les infestations d’insectes, proliférations de moisissures… L’ensemble des réserves est aussi surchargé, ce qui les rend peu praticables.
Les nouvelles réserves sont installées à Serrières, une ville située juste à côté de Neuchâtel. Elles regrouperont les collections du MHNN, du Musée d’Ethnologie de Neuchâtel, du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel et du Jardin botanique. Le complexe d’une surface totale de 5676m2 est réparti sur trois niveaux, dont deux installés en sous-sol, ce qui facilite le respect des normes de conservation. Plus d’un million de pièces vont être déplacées lors du déménagement.
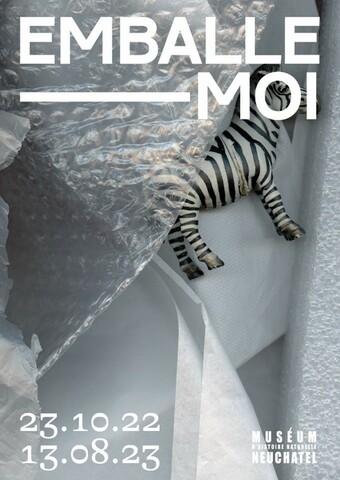
Affiche de l’exposition Emballe-moi © Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel
Dans ce contexte spécifique du chantier des collections, le MHNN a voulu mettre en valeur et montrer au grand public en quoi consistait les principes du conditionnement avec l’exposition « Emballe-Moi ». Toujours avec humour, l’équipe du MHNN lève le voile sur les coulisses du fonctionnement d’un musée. Les différents corps de métier sont expliqués, tout comme les étapes de conditionnement d’un objet.
Présenter les collections
L’exposition présente dans un premier temps un état des lieux des collections : mollusques, pierres, insectes, mammifères, etc, et indique quel pourcentage de la collection est présentée dans la pièce (par exemple, dans l’espace consacré à la géologie « Cœur de pierre », le texte de salle nous informe que seulement 0,008 % de la collection est exposée, ce qui permet de réaliser l’ampleur de ce qui est conservé en réserve). Pour chaque pièce, une ambiance sonore en lien avec les éléments est diffusée : toujours dans la salle géologique, on écoute des sons rocheux et métalliques alors que la salle consacrée aux coraux nous donne l’impression d’être plongé.es dans une ambiance sous marine mystérieuse. Dans chaque salle, sont expliquées les différentes méthodes de conservation et leur évolution au cours du temps : pour la conservation des insectes par exemple, ils pouvaient être piqués sur des épingles, en « papillote » c’est à dire dans des enveloppes de papier pour protéger les ailes des papillons par exemple, dans l’alcool ce qui permet de stabiliser les spécimens en les gardant hydratés et en préservant leur forme ou bien montés sur des « paillettes », des petits morceaux de cartons, pour les spécimens trop petits ou trop fragiles. Les plantes étaient plutôt séchées dans des herbiers ou lyophilisées : retirer toute l’eau supprime le risque de moisissure tout en gardant la forme intacte.
Vitrine qui présente le conditionnement en papillote. Photographie : M.L.
Toutes les méthodes sont expliquées par des cartels à la fois précis et très clairs. Une pièce du parcours présente aussi l’importance des archives qui constituent une part non négligeable des collections : 25 mètres linéaires d’archives, 9600 diapositives et 5,5 téraoctets de données. Intitulée « Souvenirs, souvenirs », cette pièce permet d’insister sur l’importance de conserver les objets mais aussi toutes informations qui s’y rattachent : provenance, condition de la donation, fonction originale. Un objet « sans histoire » et sur lequel on ne sait rien perd en valeur scientifique. Ainsi, malgré les difficultés à lire la graphie ancienne d’un.e scientifique, archéologue ou d’un.e passionné.e d’art et d’histoire, ces indications écrites parfois à la hâte au revers des prospectus de l’époque sont à conserver précieusement. Après avoir présenté les collections, l’exposition explique l’utilité et la nécessité de conserver autant d’objets, en expliquant les différentes valeurs qui leur sont attribuées : scientifique, artistique, historique, de rareté, financière, associative (un objet qu’on associe à une personne célèbre par exemple), pédagogique et commémorative.

Elément de scénographie expliquant la valeur financière des objets. Photographie : M.L.
Emballement : Mode d’emploi
Dans un deuxième temps, le parcours présente le projet de déménagement et explique les différentes actions qu’il faut mettre en œuvre pour le réaliser, avec la thématique principale : comment « emballe » - t-on des objets ? Dans une grande pièce qui ressemble à un atelier de travail des réserves, l’exposition présente la réalisation de châssis, de grands cadres en bois qui permettent de transporter les spécimens imposants ainsi que la fabrication de boîtes en carton de conservation, dans lesquelles va être emballée la majorité de la collection. Les matériaux utilisés pour les conditionnements sont aussi présentés, en insistant sur leur stabilité car si ces matériaux se dégradent, ils pourraient abîmer l’élément qu’ils conservent. Les étapes précédant l’emballage sont aussi expliquées, comme le dépoussiérage des spécimens conservés depuis des dizaines d’années dans les réserves, d’autant plus important qu’il permet de surveiller l’état, de vérifier qu’il n’y a pas d’infestation de ravageurs et d’éliminer la poussière qui contient des substances toxiques utilisées auparavant pour repousser les insectes notamment. Tout du long de la pièce, des vidéos jouent avec les codes de la culture télévisuelle et d’internet très contemporain : un « tuto » pour réaliser un châssis, une émission « Nouveau look, nouvelle vie de bocal » qui présente le relooking d’un spécimen conservé dans un bocal d’alcool ou bien un « unboxing » d’une boîte de conservation.

Le spectacle du zèbre. Photographie : M.L.
L’humour est un des atouts majeurs de l’exposition car il permet de faire passer beaucoup d’informations de manière claire et ludique. Les nombreux jeux de mots dès le titre de l’exposition mais aussi dans les titres des salles (« Sortir de sa coquille » pour l’espace consacré aux mollusques, « Je t’ai dans la peau » dans la salle des vertébrés mammifères ou encore dans la dernière pièce de l’exposition) permettent de désacraliser l’espace du musée afin de le rendre plus accessible. La dernière pièce, qui reprend les codes scénographiques d’un théâtre avec sa scène, son parterre de sièges pour les spectateurs et spectatrices et ses coulisses présentent les différents métiers et rôles dans le musée : la restauratrice, à ne pas confondre avec la « restauratrice » qui prépare les plats pour le restaurant du musée, le taxidermiste conduit en taxi par une chouette ou encore les conservateurs, à ne pas confondre avec les mauvais conservateurs qu’on met dans trop d’aliments industriels (vidéo disponible en ligne) !
Les « coulisses » du musée. Photographie : M.L.
Exemple d’une vitrine dans la salle consacrée à la géologie. Photographie : M.L.
Emballe-moi est une exposition vraiment réussie parce qu’elle présente un projet de déménagement complexe de manière très pédagogique : elle « dépoussière » l’image guindée et parfois ennuyeuse que peuvent avoir certains musées grâce à l’humour, l’autodérision mais aussi la poésie qui se dégage de l’atmosphère générale de l’exposition dont la scénographie, qui alterne entre ambition épurée et référence décalée, aide vraiment à porter le propos. Elle intègre un public très large grâce à ses textes clairs et ses références à la pop culture, que ce soit des émissions de télévisions, des publicités ou des formats courants sur les chaînes Youtube. Les visiteurs et visiteuses sont invité.es à prendre part à ce déménagement, en assistant en direct chaque mercredi au travail des conservatrices-restauratrices ou en participant à un atelier d’emballage, qui reprend le déroulement classique du conditionnement (constat d’état, dépoussiérer, concevoir la boîte de transport…). C’est une exposition accessible tant pour le public novice qui découvre avec plaisir les « coulisses », les espaces cachés auxquels il est difficile d’avoir accès habituellement, sinon pour les personnes plus spécialistes et les professionnel.les qui peuvent néanmoins redécouvrir sous un nouveau jour ce qui leur est familier.
Exemple de scénographie dans la salle présentant le conditionnement. Photographie : M.L.
Marine Laboureau
Pour en savoir plus :
- DAYNES-DIALLO Sophie, VASSAL Hélène (dir.), Manuel de régie des œuvres : gérer, conserver et exposer les collections, Paris, La documentation française, 2022.
- Conseil communal, Rapport concernant une demande de crédit pour la création d’un pôle muséal de conservation à Tivoli Nord (Neuchâtel) :
- https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/votre_commune/cg_rapports_objets /2023_Rapport_concernant_une_demande_de_credit_pour_la_creation_d_un_Pole_museal_de_cons ervation_a_Tivoli_Nord.pdf
- Présentation de l’exposition sur le site internet du MHNN : https://www.museum neuchatel.ch/expositions/exposition-temporaire-emballe-moi/
#conservation #chantier des collections #réserves #Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

« La santé d’abord », une exposition à effets secondaires à la Stapferhaus
Le 10 novembre 2024, la Stapferhaus ouvrait sa nouvelle exposition « Hauptsache gesund » autrement dit « La Santé d’abord ». Au cœur de la ville de Lenzbourg en Suisse allemande, ce musée est un lieu de dialogue et de réflexion sur les grandes questions de notre époque par une approche muséographique singulière. Comment traiter, dans un espace muséal, un sujet aussi vaste et complexe : sociétal, politique et intime que celui de la santé ?
Le musée comme grande scène ludique de réflexion
Fondée en 1960 par Pro Argovia, Pro Helvetia, le canton d’Argovie et la ville de Lenzbourg, la Stapferhaus était à l’origine un collectif organisant des réunions et des débats dans le château de la ville suisse. Ce n’est que 30 ans après sa création que la Stapferhaus organise sa première exposition : « Anne Frank et nous ». Dirigée par Hans Ulrich Glarner, elle questionnait le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale.
Depuis 2018, le musée dispose de ses propres locaux. Ce bâtiment face à la gare de Lenzbourg, est conçu pour être modulable et évolutif. D’extérieur c’est une grande boîte noire, mais ses murs, ses sols et ses escaliers sont mobiles, permettant d’adapter l’édifice au contenu, aux modèles de médiation et au public. Au travers de grandes expositions temporaires, la Stapferhaus interroge de grands sujets intemporels ou de notre époque, tels que le temps, l'argent ou la vérité. Ce lieu se veut un espace de rencontre et d'échange, où chacun, quel que soit son âge ou son expertise, peut explorer et dialoguer autour des enjeux contemporains. L’institution a d’ailleurs une approche participative, puisque pour chaque projet d’exposition elle prend le pouls de la population suisse, en interrogeant les institutions scolaires ou culturelles à proximité.
Le fonctionnement intrinsèque de ce musée de société est particulier. Environ tous les deux ans, le bâtiment est entièrement adapté à une nouvelle exposition. Toute la Stapferhaus se met aux couleurs de la thématique : le site internet, la carte de la cafétéria, la boutique, etc. C’est ainsi que depuis quelques mois, une nouvelle exposition habite les murs de la Stapferhaus : « La santé d’abord. Une exposition à effets secondaires ». Programmée jusqu’au 26 octobre 2025, cette nouvelle proposition interroge notre rapport contemporain à la santé, devenue l’une des grandes promesses de notre époque. Au fil d’un parcours poétique, social et scientifique, les visiteurs sont invités à réfléchir aux multiples facettes de la santé : de la quête du bien-être à la gestion de la maladie, en passant par les responsabilités individuelles et collectives, ainsi que les implications économiques du système de soins. Le circuit se structure autour de six étapes, mimant la logique d’un parcours de soin : la salle d’attente, l’examen, le diagnostic, le traitement, l’urgence et la sortie.
Entrer par la poésie et l’intime
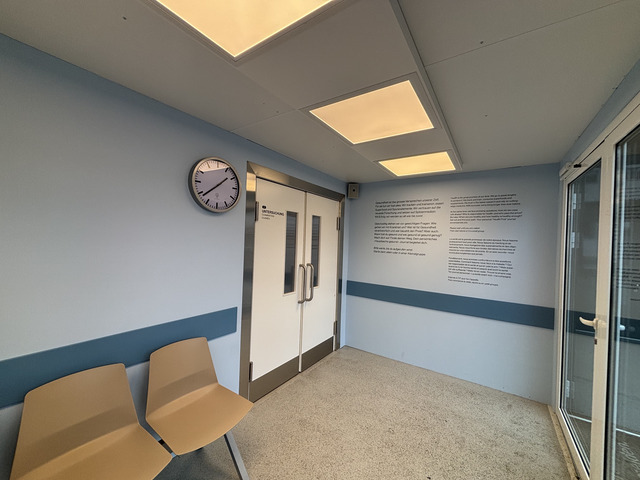
La salle d’attente, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
L’exposition conçue par Sibylle Lichtensteiger et Sonja EnzMuni s’amorce déjà dès l’extérieur du bâtiment : le visiteur pénètre dans une salle d’attente reconstituée. Loin de passer inaperçue, cette structure vitrée, en excroissance de l’imposant bâtiment sombre, capte le regard des passants et intrigue autant qu’elle invite à entrer. Muni de son petit « journal personnel » pour l’accompagner le long de sa visite, il prend place dans ce décor familier où une horloge bat lentement, toutes les deux secondes, instillant cette temporalité ralentie, presque oppressante, qui précède les rendez-vous médicaux. Lorsqu’une annonce vocale l’invite à rentrer, le visiteur quitte le sas et entame son parcours de visite par l’examen. Écouter ses battements cardiaques, tester son odorat et son souffle ou faire un rapide bilan émotionnel… Le long de ce couloir voilé, le visiteur prend un temps pour soi. Une incursion poétique et physique avant de pénétrer dans la salle de diagnostic.
Le diagnostic, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot
Libre de déambuler dans la vaste salle aux lumières tamisées, le visiteur est invité à écouter une série de témoignages, assis face à différents malades. À hauteur de regard, il constate, au fil des récits, la diversité des parcours médicaux, du vécu de l’annonce du diagnostic à la gestion du quotidien. Les voix sont multiples, tous âges, genres et origines confondus, et livrent des expériences poignantes, engagées et parfois surprenantes. Cette même salle permet un bref historique des progrès de la médecine, en mettant en lien des objets historiques de soins et des capsules vidéo animées retraçant la découverte de maladies communes telles que la dépression, la maladie d’Alzheimer ou l’endométriose. Suite à cette incursion dans les réalités personnelles, empiriques et diversifiées de la maladie, le visiteur se dirige vers la salle de traitement.
Se perdre dans dans le supermarché de la santé et explorer les possibles
Comment soigne-t-on aujourd’hui ? Dans la plus vaste salle de l’exposition, cette question sert de fil rouge à un parcours interactif où les traitements, les pratiques de soin, et les méthodes pour se maintenir en bonne santé sont abordés dans toute leur diversité. L’espace, structuré comme les rayons d’un supermarché, permet au visiteur de circuler d’un univers à l’autre selon une logique à la fois limpide et floue. Chaque section est mise en scène avec un décor évocateur, facilitant la compréhension du propos.
Les traitements, le supermarché de la santé, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
La visite débute dans l’arrière-boutique d’une pharmacie, où chaque tiroir se centre sur un médicament emblématique : son usage, ses effets et les débats scientifiques passés ou actuels. Plus loin, un bloc opératoire projette des vidéos non-censurées d’interventions chirurgicales courantes (extraction de dents de sagesse, trépanation, mastectomie, etc.). Une manipe adjacente invite le visiteur à se glisser dans la peau d’un chirurgien, réalisant un geste de précision sous la pression du chronomètre. Le défi révèle toute la difficulté et la rigueur de ce métier aussi familier qu’étranger. L'exploration se poursuit dans des dispositifs qui mettent le corps à contribution, comme cette barre de traction à laquelle il faut se suspendre pour voir s’afficher le texte vantant les bienfaits de l’activité physique. Dans d’autres « rayons » de ce supermarché, des objets de soin (respirateur, dialyseur, couveuse, etc.) sont mis en regard avec des récits de patients. Ces témoignages humains dépassent le statut de ces simples machines en leur attribuant des vécus réels. Ainsi, à côté d’un cartel évoquant le coma vécu par un patient anonyme, des écouteurs diffusent les musiques qui tournaient durant son séjour à l’hôpital.
Les traitements, santé mentale et art thérapie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
Cette grande salle accorde également une place centrale à celles et ceux qui prennent soin : aides-soignants, pompiers, ou même un robot conversationnel en maison de retraite, soulignant que le monde médical repose avant tout sur les relations humaines. Il ne s’agit pas ici de proposer un panorama des métiers de la santé, mais de mettre en lumière les liens humains inhérents aux pratiques de soin. En parallèle des thérapies médicales usuelles, l’exposition met en scène des pratiques alternatives que l’on mobilise dans cette « course à la bonne santé ». Une reconstitution d’un véritable supermarché passe en revue les régimes alimentaires en vogue : sans gluten, végan, riche en protéines… et décortique leurs origines, leurs buts et fondements scientifiques (quand il y en a !).
D'autres installations mettent en lumière l'importance des liens sociaux, et du « prendre soin » : un bureau pour écrire un courrier à un proche, une peluche géante qui délivre un message bienveillant lorsqu’on la serre dans ses bras, ou encore un « sas de décompression » où l’on ne pénètre qu’une fois débarrassé de son téléphone. Comme une bulle méditative, le visiteur est invité à prendre le temps et à déconnecter. Dans cette même quête du bien-être physique et intérieur, un espace massage (avec sièges massants et des outils d’auto-massage en bois) offre une pause relaxante pour reprendre son souffle dans ce long parcours d’exposition. Le fond de la salle est consacré intégralement à la psyché. Les murs ornés d’œuvres d’art-thérapie créent une échappée artistique autour de la santé mentale. Dans cet espace, un jeu de cartes conversationnel incite les visiteurs à dialoguer avec leur prochain, ami ou inconnu, à briser la glace et à se confier. Ce dernier espace rappelle, là encore, que la santé est une affaire de corps, d’esprit et de lien avec les autres.
Au cœur du « supermarché de la santé », une estrade attire l’attention : celle des urgences. Dans cette salle d’hôpital aux tons bleutés, le visiteur adopte la posture d’un interne, debout face à un brancard, observateur privilégié du malade examiné : le système hospitalier suisse. C’est ici seulement que l’exposition traite du système de santé du pays, et pas n’importe comment : par le prisme de sa crise. Autour du lit, une nuée d’écrans diffuse des interviews d’hospitaliers, de chercheurs et de responsables institutionnels qui livrent un état des lieux. Qui est responsable ? Qui paie, et à quel prix ? Comment s’organise concrètement l’hôpital aujourd’hui ? Ce dispositif ouvre une incursion politique, au cœur d’un sujet jusqu’ici traité essentiellement par l’humain et le médical. Il rappelle que la santé d’un pays est le reflet de ses politiques de santé publique.
Sortir par la poésie et la douceur
Pour clore le parcours, le visiteur emprunte un large couloir, un écho au premier traversé en entrant dans l’exposition. Ici, les murs sont tapissés d’oreillers et de banquettes molletonnées, dans une palette de couleurs douces et chaleureuses. Quelques phrases brodées sur la literie délivrent des messages bienveillants, invitant au lâcher-prise et à la douceur.
La sortie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)
Par endroits, des témoignages audio de soignants viennent ponctuer ce dernier espace. Ils partagent des expériences professionnelles sur la vie et la mort, ces deux passages inévitables, qui sont ici abordés sans tabou, avec humanité. L’un d’eux, par exemple, donne la parole à une infirmière en soins palliatifs racontant comment elle a accompagné un patient dans ses derniers instants, comment la vie a quitté la pièce progressivement. A côté, le témoignage d’une maïeuticienne décrit les premiers cris d’un nouveau-né en salle de naissance. Puis, au bout du couloir, sur le dernier mur, un message essentiel vient refermer l’expérience : « Prends soin de toi. »
Loraine ODOT
#santé, #interactif, #sujetdesociété

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » : un rendez-vous manqué ?
Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac présente l’exposition « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». Si une exposition sur les Olmèques avait déjà été présentée aux États-Unis (« Olmecs, colossal masterworks of Ancient Mexico », Los Angeles County Museum of Art, octobre 2010 – janvier 2011 ; de Young Museum, San Francisco, février – mai 2011), ce sujet est encore inédit en Europe. Dédiée à la mise en lumière de civilisations encore peu connues, du grand public et même des archéologues, cette exposition présente le brassage culturel qui a caractérisé le Golfe du Mexique durant près de trois millénaires.
Un parcours qui met en lumière ces cultures…
L’exposition commence dès le hall d’entrée du musée par la présentation d’une tête colossale, caractéristique de l’art Olmèque. Présentée sur un socle de couleur bleu canard, cette œuvre invite le.a visiteur.euse à emprunter la rampe pour en découvrir davantage.

Tête colossale présentée dans le hall du musée © E. V-P
En entrant dans l’exposition, présentée sur la mezzanine Est du musée, le.a visiteur.euse découvre alors le début du parcours. Celui-ci commence par une courte présentation du propos de l’exposition : les Olmèques, et leur influence sur les autres cultures de cette région mésoaméricaine. Le texte informe aussi le.a lecteur.rice de ce qu’il va voir : des objets exceptionnels, jamais montrés en France.
La première séquence, au fond bleu canard, est dédiée plus spécifiquement aux Olmèques, la période durant laquelle ils se sont développés mais aussi leurs caractéristiques, comme l’organisation en ville ou la statuaire monumentale. À côté de ce texte introductif, une frise rappelle la chronologie mésoaméricaine et les différentes périodes – préclassique, classique et postclassique. Des objets illustrent alors les caractéristiques de cet art olmèque, comme le groupe des monuments 7 à 9, dit « Ensemble des Azuzules », retrouvé sur le second site de San Lorenzo. Cette séquence présente aussi plus en détail les villes de San Lorenzo et de La Venta, considérées comme les capitales olmèques. Un film diffusé au milieu de cette séquence retrace de manière assez romancée l’histoire de la culture.

Texte de la section « Les Olmèques », frise et carte © E. V-P
La deuxième séquence, sur murs jaunes, aborde la question centrale de l’écriture et de la linguistique dans la culture olmèque. Si les populations n’ont développé une forme d’écriture que tardivement, celle-ci va considérablement influencer les cultures qui la suivent, jusqu’aux Mayas et aux Aztèques. Les stèles présentées sont décryptées sur le mur leur faisant face, des dessins soulignant les photographies des glyphes.
La séquence suivante, intitulée « femmes et hommes du Golfe », sur fond blanc, présente l’influence de l’art olmèque sur les autres cultures du Golfe. Au centre de la pièce est placée une sculpture olmèque, entourée d’autres pièces de cultures contemporaines ou suivantes. Seulement une seule d’entre elle est mise en avant : les Huastèques, dont un court texte présente l’origine et le développement.
La quatrième séquence, avec des cimaises et des murs de nouveau bleus, « Offrandes », présente des groupes d’offrandes retrouvés sur des sites archéologiques comme les sculptures en bois d’El Manatí ou le dépôt de La Merced. Cette section met en lumière les fouilles et le contexte de découverte des différents objets, ainsi que l’importance des rituels pour les cultures du Golfe.

Section « Offrandes » © E. V-P
L’avant-dernière séquence, aux murs rouges, met en avant les interactions qu’ont entretenues les cultures de la côte du Golfe avec les régions voisines. Les recherches ont montré que les populations possédaient des caractéristiques communes comme la linguistique, les motifs architecturaux ou le jeu de balle.
Enfin, l’exposition se conclut sur le site de Tamtoc, cœur du développement huastèque, et la sculpture dite « La femme scarifiée ». La scénographie de cette section évoque le contexte de découverte de l’œuvre. Celle-ci fut découverte dans un réservoir d’eau.

Présentation de la « femme sacrifiée » © E. V-P
… mais une muséographie et un propos difficilement compréhensible
« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » est une exposition très dense, tant au niveau du nombre d’œuvres présentées, appartenant aux Olmèques et aux cultures du Golfe, que de la quantité d’informations délivrées aux visiteurs. Si la division des séquences est perceptible grâce au code couleur mural dans l’exposition, le propos l’est parfois moins.
Les Olmèques sont une culture encore mal connue, d’abord à cause du peu d’objets qui nous sont parvenus, mais aussi à cause de la lecture soit raciste, soit eurocentrée et évolutionniste des témoins culturels qu’ils ont livrés. Si aujourd’hui la théorie d’un peuple éthiopien qui se serait perdu dans l’océan est abandonnée, les chercheur.euse.s ne sont pas tous d’accord sur le foyer de développement de la culture. Certains s’accordent à dire qu’il s’agit d’une culture qui s’est développée sur la côte du Golfe, d’autres formulent l’hypothèse d’une population venue de la côte pacifique et qui aurait ensuite voyagé.
La culture Olmèque est donc identifiée par le développement de cités avec une organisation spécifique. Il est néanmoins difficile de déterminer précisément l'organisation de ces villes : est-ce qu'il y avait un chef.fe commun ? est-ce qu'ils s'agissaient plus de cités-états ? est-ce qu'ils s'agissaient de capitales ? L’exposition n’aborde pas toutes ces incertitudes qu’ont les chercheur.euse.s, par exemple en présentant les villes de San Lorenzo et La Venta comme des capitales, alors qu’il est difficile de l’affirmer ou de l’infirmer. Les Olmèques sont aussi identifiés par ce qu'on appelle le « style olmèque ». Celui-ci est caractérisé par une bouche aux commissures tombantes, des lèvres charnues, un nez épaté, qui a longtemps été décrit comme des « traits négroïdes » et qui a fait dire que les Olmèques étaient un peuple africain. Cette théorie est aujourd’hui abandonnée. Ce style, et l’organisation en cités, ont influencé des cultures contemporaines et postérieures, appelées les épi-olmèques, comme les Huastèques, culture épi-olmèque la plus connue et la mieux identifiée. Néanmoins le terme « culture » est lui aussi soumis à des controverses. Il s'agit de villes ou de sites où l'on a retrouvé des traces d'une influence olmèque, mais il est difficile de dire s'il s'agissait véritablement d'une culture. L’exposition ne montre pas les difficultés qu’ont les chercheur.euse.s et archéologues d'identifier ces cultures.
En raison le manque de connaissances de ces cultures du Golfe, leur distinction n’est pas claire. En effet, l’exposition ne présente pas que des objets olmèques, c’est d’ailleurs là tout son propos. Néanmoins, les objets assimilés aux Olmèques ne sont pas différenciés de ceux appartenant à d’autres cultures. Ainsi, dans la première séquence, le.a visiteur.euse peut avoir l’impression que toutes les œuvres proviennent des Olmèques, ce qui n’est pas le cas. Cette difficulté d’appréhension brouille d’ailleurs la compréhension de la culture olmèque, allant dans le sens opposé du but de l’exposition. Cela est d’autant plus vrai dans la séquence intitulée « femmes et hommes du Golfe », présentant des œuvres de différentes cultures. Sur les cartels, aucune mention de ces cultures n’est faite. La seule différence de traitement réside dans le fait que l’œuvre olmèque est au centre, et les autres sont positionnées autour. Cette mise en avant muséographique est claire pour un néophyte, mais l’est-elle autant pour un.e visiteur.euse moins averti ? Ce n’est que dans l’avant dernière section que des cartels feront mention d’une autre culture : maya ou aztèque.


Stèle 6 du site de Cerro de las Mesas et son cartel, mentionnant le terme épi-olmèque, sans que celui-ci ne soit explicité © E. V-P
Pourquoi ne pas mentionner le nom de ces différentes cultures ? Un.e visiteur.euse non averti va-t-il comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’œuvres olmèques ? L’absence de mention de ces cultures peut être due au fait qu’encore aujourd’hui nous les connaissons très mal. Il est donc difficile d’affirmer avec précision de quelles populations il pouvait s’agir. Pourtant, il aurait été pertinent d’en faire mention. Pour une exposition se targuant de célébrer « les résultats de plusieurs missions archéologiques », la mise en lumière de la recherche actuelle semble cohérente dans le propos. La mention « culture inconnue » aurait probablement pu aider les visiteur.euse.s à mieux se repérer et à comprendre cette influence.
Enfin, les dernières sections sont assez complexes et leur présence dans l’exposition n’est pas claire. En effet, après la séquence « femmes et hommes du Golfe », dédiée à l’influence olmèque, la section « offrandes » revient sur la culture et les rituels caractéristiques. La séquence, « interactions », aborde de nouveau la question des échanges, déjà évoquée en section « femmes et hommes du Golfe ». Enfin, la dernière séquence, ainsi que la conclusion sur le site de Tamtoc, est sûrement la plus complexe. En effet, elle fait appel à des connaissances extérieures à l’exposition, notamment sur le site de Teotihuacan. Ces séquences sont plus dédiées à un public spécialiste, et n’ont peut-être pas leur place tout à la fin de l’exposition, après une heure de visite et une certaine fatigue accumulée.
Plus largement, comment comprendre le terme culture ? La mention des « cultures du Golfe » dans le titre permet d’englober l’aire géographique, sans que ces cultures ne soient clarifiées. Mais, l’exposition participe à la confusion entre styles et cultures. L’exposition mentionne plusieurs fois les « traits olmèques », qui est un style qu’on retrouve au-delà du Veracruz, et du Golfe même. Dans le monde épi-olmèque, c’est-à-dire après les Olmèques, les styles sont plus locaux, par site presque. À la fin de l’exposition, comment le visiteur définirait-il les « cultures du Golfe » ?
Si cette exposition a le mérite de mettre en lumière des cultures peu connues, et de montrer une richesse d’objets, elle garde un regard empreint de pratiques occidentales et un discours au niveau de lecture parfois difficilement compréhensible.
E. V-P
Pour aller plus loin :
#exposition #MuséeQuaiBranlyJacquesChirac #Olmèques
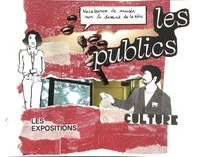
A l’ombre des musées : les agent·es vacataires.
19 mai 2021, les musées ont enfin ré-ouverts. Face au public retrouvant les salles, c’est tout un corps de métier qui reprend du service. Souvent oublié·es, peu considéré·es et pourtant essentiel·les au bon fonctionnement du musée, les agent·es d’accueil vacataires ont été peu entendus dans les discours des institutions pendant la fermeture.
Nous vous proposons un petit tour des expériences et des perspectives de la vacation au musée, auprès de Marco et Manon.
Image d'en-tête : @Manon Deboes
Bonjour Marco et Manon, merci d’avoir accepté notre invitation. Rentrons directement dans le vif du sujet, Pourquoi et comment avez-vous postulé comme agent d’accueil et de surveillance en musée ?
Marco : Comme pour beaucoup, par nécessité financière. Je devais financer un gros bénévolat à l’étranger pendant l’été. Au dernier moment, j’ai été pris dans un site patrimonial grâce à une recommandation : j’ai l’impression que le bouche-à-oreille est important dans ce milieu. J’étais très content que cela corresponde à mes études, et c’était ma première vraie expérience dans le patrimoine. J’ai ensuite continué pendant un semestre, pour payer mon loyer. Mais l’emploi du temps est devenu plus contraignant, donc j’ai arrêté dès que j’ai pu me passer de ce salaire.
Manon : Moi aussi, payer mon loyer est une des raisons pour laquelle j’ai postulé en tant qu’agent d’accueil et de surveillance. Mais, ce n’est pas la principale cause. Je souhaitais avant tout me faire une première expérience dans la culture. J’ai donc répondu à une offre d’emploi pour un poste dans un musée durant l’été. J’ai rapidement été contacté pour un entretien et j’ai pu intégrer l’équipe fin septembre pour un contrat d’un an .
Et une fois engagé.es, comment avez-vous été formé.es ?
Manon : J’ai été convoquée pour une matinée de formation incendie puis une journée entière pour me former en surveillance. Cela s'est fait en compagnie d’un agent titulaire que j’ai dû suivre et observer durant sa journée de travail habituelle. Je me suis vite rendu compte qu’il fallait bien plus pour nous présenter les ficelles du métier et toutes ses nuances... En somme, ce fut une formation assez expéditive et j’ai vite été lancée dans le grand bain en apprenant directement sur le tas. Les premiers jours, j’ai passé le plus clair de mon temps à questionner mes nouveaux collègues sur la marche à suivre, chaque situation étant différente. Cela nécessitait des connaissances bien particulières qui n'avaient pas pu être évoquées durant ma formation car elle ne s’était pas présentée sur le moment. Mais, en fonction du titulaire que l’on interrogeait, on n'avait pas forcément la même réponse. Certains et certaines étant plus investi.es, tandis que d’autres ont leurs méthodes bien à eux. Je me suis finalement adapté en drainant des informations par ci par là, et en me créant une posture de travail la plus proche et la plus fidèle à celle qui nous ait demandé d’avoir. Evidemment, chaque structure à sa propre organisation et manière de faire, je vous fais seulement part de ma propre expérience.
Marco : Dans mon cas, ça a été encore plus expéditif ! J’ai été appelé avant le début de mon contrat pour un remplacement : on m’a plongé directement dans le bain, à aller pêcher des informations sur les procédures à suivre, qui ne sont pas toujours très logiques ! Cela tient surtout du hasard dans mon cas précis. Mais cette rapidité de formation tient souvent à l’urgence dans laquelle les structures sont pour embaucher des agent.es.

@MarcoZanni
Vous nous avez dit être agent.es “vacataires” : pouvez-nous expliquer ce qu’implique ce statut ?
Marco : Alors, le statut de vacataire diffère de celui de fonctionnaire ou de contractuel.le. Le contrat de vacataire ne donne pas droit à la formation, à des congés payés ou à des évolutions de carrières. Et pour cause, normalement le recrutement se fait pour des missions ponctuelles et rémunérées à la tâche. Mais dans les musées ou les monuments publics, les vacataires comblent souvent le manque de temps ou de budget pour le recrutement des contractuel·les. Ah et autre chose : dans la surveillance et l’accueil, on parle aussi parfois de “contrats étudiants” : il ne s’agit pas d’un type de contrat spécifique mais d’une mention ajoutée sur le contrat. Il peut s’agir d’un CDD, CDI, une vacation … qui précise souvent que l’institution s’engage à respecter l’emploi du temps étudiant, même si les termes peuvent dépendre d’une institution à l’autre.
Même si vous êtes payés à la mission, pouvez-vous quand même donner un ordre d’idées sur vos horaires et votre salaire ?
Marco : Ah, ces appels du dimanche matin … (rires) C’est vrai que cela peut changer rapidement. Pendant l’été, je travaillais entre une vingtaine et une trentaine d'heures par semaine, et j'obtenais un peu moins d’un Smic. Avec la reprise des cours, c’est devenu plus sporadique, autour d’une dizaine d’heures par mois … Comme c’était plus contraignant niveau horaire, j’ai décidé de ne pas poursuivre pour trouver un travail au salaire plus avantageux.
Vous évoquez les titulaires, y a-t’il une grande différence avec vous, une sorte de hiérarchie ?
Marco : Encore une fois, c’est spécifique à chaque institution, et globalement aux institutions publiques. Dans mon cas, les titulaires effectuaient les mêmes tâches, avec quelques responsabilités en plus, mais nous travaillions ensemble en profitant de leur expérience. Outre l’ancienneté, la grande différence se trouve dans les droits salariaux : formation, salaire fixe, congés,...
Manon : Il me semble que sur ce point nous avons à peu près les mêmes réponses. J’ajouterais que la hiérarchie se fait surtout avec d’autres membres de la structure. Bien que j’ai eu vent de certaines querelles entre titulaires, l’équipe de surveillance, y compris les vacataires, était plutôt soudée. La grande majorité d’entre nous étant ouvert.e aux échanges de postes pour que le planning conviennent à tout le monde.
Comment se passent vos journées en tant qu’agent.es de surveillance ? Il y a cette image du gardien qui attend toute la journée sur une chaise...
Manon : Je crois qu’avant cet emploi j’avais aussi cette image du surveillant attendant dans un coin ! (rires) J’ai très vite compris que le temps peut être notre allié ou notre pire ennemi. Tout dépend de la zone à laquelle j’étais assignée. Certaines demandaient d’être aux aguets, comme le contrôle des sacs ou des tickets. D’autres restaient plus tranquilles, on y croisait peu de visiteur.es. Mon meilleur ami quand j’étais de surveillance dans ces salles, c’était un bon livre dans lequel me plonger. Avec cet emploi, j’ai redécouvert mon amour pour la lecture. Avec les études, le temps a fini par me manquer, au musée il est omniprésent.
Marco : J’ai moins subi le temps, j’ai l’impression que mon travail était plus diversifié et j’étais en plein air la moitié du temps. J’étais posté à chaque étape d’un circuit de visite : accueil, contrôle des tickets, surveillance, organisation des circulations. Loin de l’image du vieux gardien sur son tabouret, j’étais au contraire souvent en sueur à cause des escaliers ou de la canicule. De plus, mon site était très touristique, j’étais rarement seul : distrayant mais pas toujours reposant !
Manon : Au-delà d’apprivoiser le temps, être surveillant nous place en première ligne face au public. Souvent, nous sommes le premier contact qu’ont les visiteur.es avec le personnel du musée. Nous sommes ceux vers qui ils.elles se tournent pour poser leur question, souvent pour demander où se trouvent les toilettes. Vous pouvez me croire, c’est vraiment la question qui revenait le plus ! (rires) Hormis, certaines remarques désobligeantes de personnes mécontentes, j’ai quand même pu avoir des échanges très intéressants avec des visiteur.es. Une simple question peut parfois déboucher sur de jolies rencontres.

@Marco Zanni
Vous parliez tout à l’heure du statut vacataire et de l’emploi du temps variable : comment gérez-vous le fait de ne pas avoir de revenu fixe, l’organisation des horaires de travail ?
Vous semblez dire que ce n’est pas toujours facile, que vous avez aussi des rapports conflictuels avec le public.
Marco : Cela change en fonction du lieu, de la qualité d’accueil, de la fréquentation, des postes ou même de l’humeur des deux parties … Du côté du public, très nombreux sur mon site, l’absence d’informations, la foule ou l’attente échauffaient les esprits. Et nous étions en première ligne, avec une tendance à être rapide et distant pour rester efficaces. Dans mon établissement, il y avait surtout un manque de communication sur l’absence d’ascenseurs et sur l'obligation de réservation. Pas facile d’expliquer à des personnes qu’elles ne peuvent rentrer, surtout pour leur dernier jour en France : certaines sont juste déçues, d’autres s’emportent... C’était parfois blessant … (il hésite) mais avec le recul, j’ai pu travailler mon répertoire d’insultes étrangères en étant leur cible (rires). Cela fait partie de la pénibilité du métier, la gestion de publics parfois difficiles pour des raisons sur lesquelles nous n’avons pas prise.
Manon : Tout comme Marco, il y a des postes où l’on doit davantage être concentré et le contact avec le public est parfois difficile. Cela dépend vraiment du contexte. Dans le musée où j’ai travaillé, il pratiquait la gratuité les premiers dimanches du mois, cela attirait évidemment beaucoup de monde, engendrant, le plus souvent, quelques situations tendues.
 @Marco Zanni.
@Marco Zanni.
Pénibilité renforcée en temps de Covid, j’imagine ? Comment avez-vous vécu cette période, la perte d’activité ?
Manon : Après l’annonce du confinement et donc de la fermeture des lieux culturels, le 17 mars dernier, tous les agents d’accueil et de surveillance titulaires ont été mis en chômage partiel tandis que nous, vacataires, avons eu quelques difficultés pour comprendre notre situation. Le musée dans lequel j’ai travaillé n’a pas su nous dire immédiatement les mesures qui allaient être mises en place pour nos salaires. Après quelques semaines d'attente, nos indemnités ont été calculées à partir d’une moyenne haute d’heures que l’on a effectué les mois précédent le confinement. A la réouverture des institutions culturelles, nous avons quelques jours de formation pour assimiler les mesures sanitaires mises en place dans l’accueil du public. De toutes nouvelles manières de travailler pour un poste déjà bien compliqué. Enfin, s’est posée la question du renouvellement. Pour beaucoup de vacataires, leur contrat arrivait à terme, or la période de confinement ne leur a pas donné la possibilité de bénéficier des mêmes rémunérations et des mêmes expériences que les vacataires précédents. Afin de réparer ce “préjudice”, mes collègues vacataires ont revendiqué un renouvellement auprès de la DRH. Après plusieurs relances de leur part, la mairie a pu leur proposer ce fameux renouvellement. Je n’ai pas pu profiter de ce renouvellement car mon entrée dans une nouvelle formation ne me permettait plus d’avoir le temps d’occuper un poste étudiant à côté
Marco : Personnellement je ne travaillais plus pendant la période Covid (j’ai arrêté un poste d’agent de bibliothèque juste avant). Mais par d’ancien·nes collègues, j’ai suivi la situation tout au long de 2020, forte en revendications. Il y avait déjà les grèves au Louvre suite à la loi Travail, mais c’était surtout un mouvement de contractuel·les. Dans ce contexte, un mouvement de vacataires s’est formé à Paris Musées : il dénonçait la précarité des contrats et l’existence d’une économie de la vacation visant à combler les manques des équipes contractuelles. L’action syndicale est peu courante chez les vacataires : beaucoup sont là pour un temps limité, ou ont peur de ne pas se faire reconduire. La situation a donc dû être extrêmement difficile pour que les vacataires prennent position. Puis la crise COVID a accentué la précarité et la pénibilité du métier. A Paris Musées, beaucoup avaient peur de se retrouver sans travail et sans indemnisations. Les vacataires sont très exposé·es, comme les agent·es d’entretiens ou techniques d’ailleurs, à la réduction du volume de travail imposé par la fermeture des établissements culturels.
Après nous avoir parler de votre expérience, et notamment dans ses limites, quel regard portez-vous sur la vacation dans les lieux culturels ? Est-ce forcément un poste ingrat ?
Marco : Difficile oui, ingrat non : j’ai eu beaucoup de plaisir à accueillir des publics ou à travailler dans des lieux patrimoniaux. Mais le cadre ou les expériences positives ne peuvent pas cacher la précarité des vacataires en accueil et surveillance, sur qui repose l’ouverture de nombreuses institutions. Pourtant, d’autres modèles seraient possibles : j’ai lu que le Louvre a par exemple arrêté le recours à des contrats de vacation pour n’utiliser que des contractuel·les. Outre le recours à des contrats plus stables, il faut une véritable reconsidération de ces petites mains des lieux culturels. De mon expérience, je pense que les gardien·nes de salle, les surveillant·es, … peuvent être une première ligne de médiation, souvent sous-estimée.
Manon : Je partage ton point de vue. La crise sanitaire n’a fait que révéler au grand jour la précarité de ces postes, ouvrant la voie à des revendications. Qui sait si cette crise ne débouchera pas sur une toute nouvelle considération des vacataires et de manière générale de toutes personnes œuvrant pour l’accueil et la sécurité dans les lieux culturels. Peut-être qu’il serait intéressant d’inclure davantage ces personnes dans la vie de ces institutions. Elles qui sont en contact direct avec le public et qui sont les plus à même d’observer leurs réactions, ne serait-il pas pertinent de se tourner vers les agents pour des retours d’expérience sur des programmations ou actions culturelles ?
Manon Deboes & Marco Zanni
Pour aller plus loin : quelques articles sur les revendications concernant les vacataires en musée/bibliothèque :
Nous sommes Millie, Denis, Maxime, Silvia, les vacataires précaires de la BPI | Le Club de Mediapart
Carnavalet : les méthodes de la direction contestées - Le Parisien
#Vacataires#AgentsD’accueil#Témoignage

À la chasse aux œuvres
Prenez une salle qui rappelle les cabinets d’amateurs du 18ème siècle : tapisserie violette à motifs en velours, meubles et objets d’époque, tableaux de chasse à cadres larges dorés. Ajoutez à cela des animaux naturalisés. Puis de l’art contemporain.
Salon de Compagnie © Méline Sannicolo
Bienvenue, vous êtes arrivés au Musée de la chasse et de la Nature, un des plus beaux exemples de décloisonnement des techniques et époques artistiques. Le mélange des disciplines et des époques, bien sûr ne relève pas de la simple recette que j’énonce en préambule, il est si subtil et bien amené que lorsque l’on visite ce musée pour la première fois, il est bien délicat de remarquer tout de suite que chaque salle a son lot d’œuvres contemporaines. Cela vient du fait que celles-ci, souvent produites par des artistes contemporains invités à intégrer les collections, font réellement écho aux œuvres du musée. C’est là qu’est tout le jeu. Dès que l’on comprend que toutes les œuvres d’une même pièce ne proviennent pas de la même époque, un phénomène très étrange se produit : on se met à la recherche des œuvres contemporaines et des éléments décalés et cachés de chaque salle. Et c’est ainsi que chaque visiteur devient, le temps la visite, un chasseur traquant ces particularités.
« Bien sûr, il y a les merveilles sorties des collections du musée. Mais elles ne sont pas seules. Un monde s’est créé autour d’elles. »
Frédérique Paoletti & Catherine Rouland, architectes DPLG, scénographes du parcours permanent
Un coup de génie me direz-vous, car pour trouver ces éléments, il faut alors examiner minutieusement chaque œuvre, chaque cartel, chaque bout du musée. Même le sol peut cacher des surprises, comme des traces de pattes ou un trou de souris. Le musée devient alors le terrain de chasse du visiteur. En ce moment, c’est au tour de l’artiste Miguel Branco de venir investir à la fois la cour du musée et les collections permanentes (jusqu’au 12 février 2017). Ses œuvres s’éparpillent le long du parcours et il faut bien ouvrir l’œil pour les remarquer.

Salon Avifaune © Noé Robin
Ainsi, en arrivant dans la salle Avifaune, vous remarquerez le grand grand mur d’études d’oiseaux. Jusque-là rien d’extraordinaire. En regardant d’un peu plus près ces peintures, au milieu de tous ces oiseaux vous trouverez deux représentations d’avions, plus exactement des drones militaires : cette fois c’est bon, vous êtes sûr d’avoir repéré une des œuvres contemporaines de Miguel Branco ! En examinant ces œuvres, vous constaterez qu’elles sont dans les mêmes cardes que les oiseaux, qu’elles ont également le même cartel, le même nom d’artiste, … Vous êtes alors saisi d’un doute… Serait-il possible que ce peintre du XVIIIème ait peint à la fois des études d’oiseaux, très réalistes et les avions dans un tout autre style ? Au vu des dates, c’est difficile d’y croire, mais c’est encore plus difficile de se résoudre à remettre en cause une chose affirmée dans un musée ! Quelle étrange sensation ! Dans ce musée, nous sommes tous amenés à remettre en cause le discours de vérité de l’instance muséale, à questionner chaque œuvre et éléments présentés. Tiens donc, regardez au plafond, regardez les caméras de surveillance. Êtes-vous sûr que ce sont de vraies ?
« Le jeu est enfin devenu ce qu’il voulait être, humours, légèreté́ ; un jeu d’autant plus frais qu’il n’est pas un jeu d’enfant. Car ce n’est pas une anecdote que ce jeu. Il est la dernière œuvre inaugurée ici : la grande installation contemporaine qu’est le musée lui-même. »
Frédérique Paoletti & Catherine Rouland
Alors que d’autres musées essayent de décloisonner les périodes de l’histoire de l’art, à travers une architecture et un choix scénographique qui se débarrassent réellement des cloisons murales (comme dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens), le Musée de la Chasse et de la Nature, lui, propose un parcours bien défini, aves des salles ayant toutes quatre murs bien existants. Le décloisonnement est ici d’autant mieux réussi qu’il amène de visiteurs à être actifs et conscients lorsque son regard passe d’une œuvre de beaux-arts classique, à un ours blanc naturalisé, à une tapisserie du XVIème siècle, à une œuvre contemporaine de Jean Fabre ou Jean-Michel Othoniel. Ici les œuvres et objets de toutes les périodes communiquent entre elles et surtout avec le public.
Méline Sannicolo
#musée
#chasse
#décloisonnement
#miguelbranco
Pour en savoir plus :Musée de la Chasse et de la Nature : http://www.chassenature.orgArtiste invité jusqu’au 12/02/2017, Miguel Branco : http://www.chassenature.org/miguel-branco-black-deer/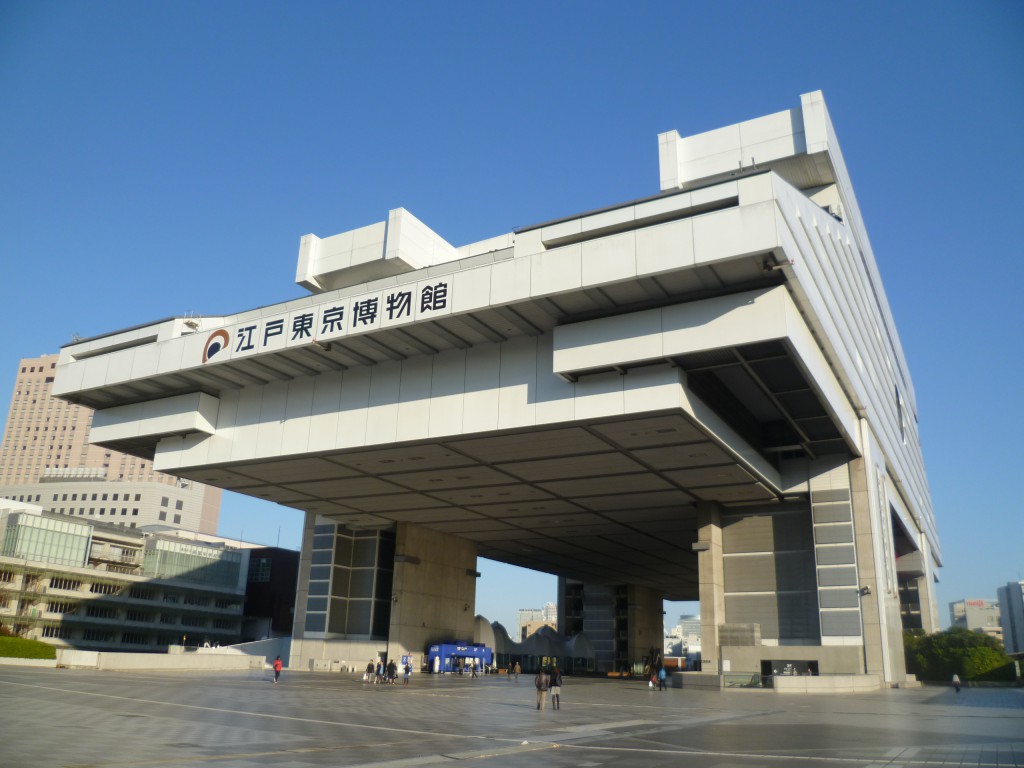
A la découverte du Musée Edo-Tokyo
Aujourd'hui, l'Art de muser s'est rendu à Tokyo et il vous propose de partir avec lui à la découverte d'un musée dédié à cette ville : le musée Edo-Tokyo ( 江戸東京博物館, Edo Tokyo Hakubutsukan).
Vue extérieure du musée. ©Sytuki
Histoire d'une ville, histoire d'un musée
Il s'agit d'un musée d'histoire situé dans le quartier de Ryogoku dans l'arrondissement de Sumida à l'est de la ville. Le sujet de son exposition permanente est la capitale du Japon depuis la période d'Edo jusqu'à l'actuelle Tokyo. L'époque d'Edo commence avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu en 1603 après sa victoire à la bataille de Sekigahara les 20 et 21 Octobre 1600. Elle se termine avec la restauration Meiji en 1868 ; l'ère Meiji met fin à la politique volontaire d'isolement du pays et l'ouvre à la modernisation. Celle-ci se termine en 1912 avec la mort de l'empereur Mutsuhito et est suivie par l'ère Taisho marquée notamment par la Première Guerre Mondiale qui s'achève à la mort de l'empereur Taisho en 1926. L'ère Showa débute avec l'empereur Showa, plus connu en Occident comme Hirohito, et se termine à sa mort en 1989. Celle-ci est marquée par la montée du militarisme national, la Seconde Guerre Mondiale, la douloureuse défaite et la reconstruction du Japon. Commence alors l'ère d'Heisei sous le règne de l'empereur Akihito avec une longue période de paix et de modernisation pour le pays qui finit par s'imposer sur la scène internationale. Cette dernière prend fin le 1er Mai 2019 avec l'avènement de l'actuelle ère Reiwa dont le nom symbolise la « vénérable harmonie » souhaitée entre les êtres par le nouvel empereur Naruhito. Le musée d'Edo-Tokyo retrace l'évolution de la capitale depuis 1603 jusqu'à nos jours, période qui a vu l'avènement de six ères ponctuées de nombreux bouleversements sociaux, politiques et culturels.

Une vue aérienne duquartier Fukugawa Honjo après avoir été rasé par les flammes, 1945, Photographie ©Tokyo, Edo-Tokyo Museum
Son emplacement au quartier de Ryogoku ne fut pas choisi au hasard, en effet, en plus d'être un quartier populaire, il porte le nom du pont qui s'y tient depuis presque 400 ans, Ryogoku-bashi. Celui-ci enjambe le fleuve de Sumida et, d'une longueur de plus de 150 mètres, il permettait de rejoindre la province de Shimosa à l'est. Le Ryogoku-bashi fut rendu célèbre par ses nombreuses représentations au fil des siècles, certaines réalisées par de grands artistes : Kuwagata Keisai, Utagawa Hiroshige et même Hokusaï. En plus de ces éléments, le quartier de Ryogoku est le quartier des lutteurs de sumo considérés par la population comme des dieux vivants incarnés – le musée se trouve d'ailleurs à deux pas du célèbre Ryōgoku Kokugikan, stade qui accueille les tournois nationaux chaque année. Ainsi, la localisation du musée dans un quartier populaire connu de tous et très « en vue » lui permet d'assurer sa visibilité autant sur la scène culturelle que populaire. Le musée fut baptisé « Edo-Tokyo » afin de souligner l'importance de remonter le temps à la découverte des évolutions de la ville depuis plus de quatre siècles.
L'architecture, miroir du projet
Une exposition ludique au service du didactique
L'exposition permanente prend place sur deux niveaux et est divisée en deux zones : la zone Edo et la zone Tokyo. Dans la première est racontée toute l'histoire de la ville depuis l'arrivée d'Ieyasu Tokugawa à Edo en 1603 jusqu'en 1868, date à laquelle la ville a pris le nom de Tokyo. En effet, 江戸 (Edo) signifie littéralement « porte de la rivière » mais lorsque l'empereur Mutsuhito s'y installe, elle la rebaptise 東京 (Tokyo) « capitale de l'Est » afin de se distinguer de l'ancienne capitale 京都 (Kyoto) littéralement « ville capitale ». C'est un message fort puisque le Japon entre justement dans l'ère Meiji cette même année. La muséographie intègre donc cette distinction afin de permettre au public de comprendre son importance.
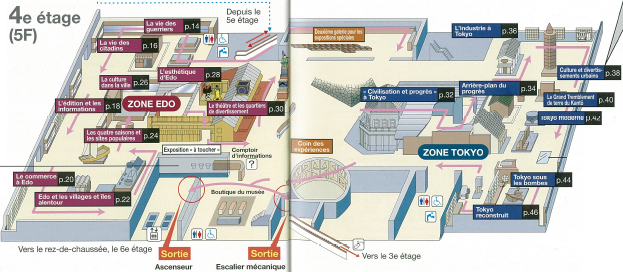
4e etage (5F), NAKANO, Yoshiro, Le Musée d'Edo-Tokyo ©Tokyo Metropolitan foundation for History and Culture, 2010, p. 4-5
Le musée propose de très nombreux dispositifs interactifs, fruits du travail des responsables du musée. C'était leur volonté d'initier le toucher et l'expérimentation chez le visiteur afin d'éviter que la visite ne soit qu'une expérience abstraite. La visite débute par la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi littéralement « le pont du Japon ». Celui-ci « marquait le point de départ des cinq principales grandes routes qui conduisaient aux quatre coins de l'Archipel. La reproduction visible dans le musée a la même hauteur et la même envergure que l'original. Sa longueur (51 mètres à l'origine) a néanmoins été réduite de moitié » peut on lire dans le catalogue d'exposition. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers de visiteurs l'empruntent pour partir à la découverte de la ville.

Vue sur la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi ©Elise Mathieu

Reconstitution d'un intérieur traditionnel japonais ©Elise Mathieu
Une perspective participative forte
Cette dimension participative se traduit par différentes propositions : des reconstitutions de pièces et d'objets qui peuvent être touchés par le public. Celui-ci se voit alors proposer d'entrer dans un palanquin, de soulever des seaux lestés du même poids qu'à l'époque, de porter des paniers à légumes, de soupeser la caisse contenant des pièces d'or et même d'agiter un matoi (纏) de brigade de pompiers. En se baladant dans la partie « le commerce à Edo », il peut rencontrer la reproduction d'un étal à sushis de la fin de l'ère Edo qui lui permet de comparer les pièces de sushis exposées à celles qu'il a très probablement déjà rencontrées ultérieurement dans sa vie. Il remarque alors que le riz n'est pas blanc mais rouge, ce qui est du au vinaigre utilisé en ce temps-là. De plus, les pièces sont plus grosses qu'aujourd'hui et les poissons différents car les prises venaient uniquement de la baie de Tokyo. La zone Tokyo propose également ses reproductions avec deux types de maisons pendant l'ère Meiji : celle avec une influence occidentale et celle traditionnelle qui se font face pour une meilleure comparaison. Enfin, l'exposition comporte deux autres espaces : « l'exposition "à toucher" » et le « coin des expériences ». La première propose diverses reproductions qui, si elles sont manipulées, émettent les sons produits lors de la fabrication d'éléments artisanaux locaux. La seconde abrite une maison de l'ère Showa entièrement visitable. A condition d'enlever ses chaussures – tradition très courante au Japon afin d'éviter de salir les sols – le visiteur peut entrer dans la maison et se promener au gré des pièces. Il appréhende ainsi, sans mal, la taille, l'espace et le confort de celles-ci. La volonté du musée de créer des expériences finit par créer de la vie. Le fait de pouvoir s'amuser, parler, aller où bon lui semble en profitant des œuvres permet au visiteur de visiter ce musée comme une véritable ville.
Elise Mathieu
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en
#Tokyo
#Exposition
#Ludique
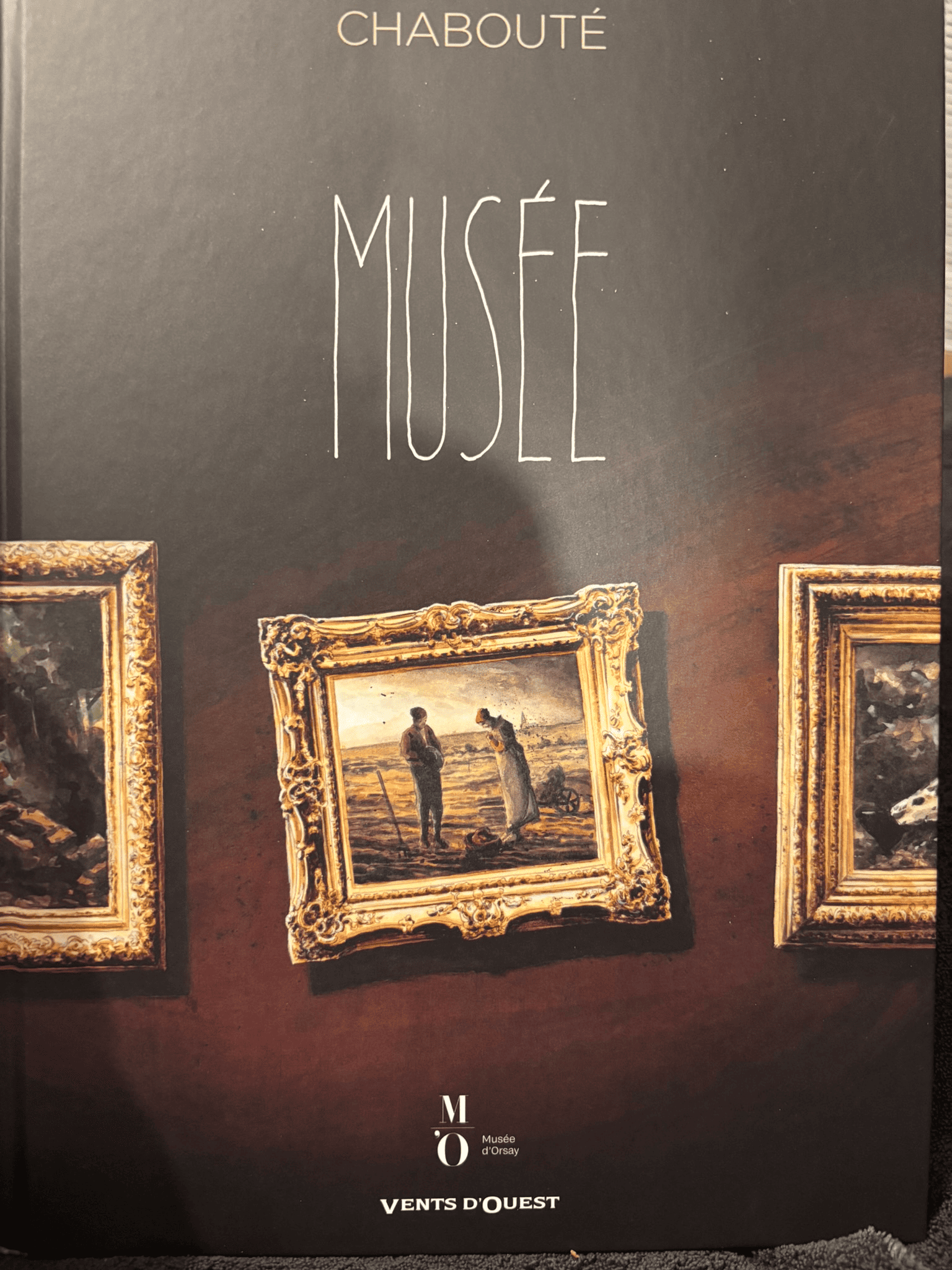
À quoi pensent les œuvres du musée d’Orsay ?
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passait lorsqu’un musée se vide de ses visiteurs ? Plongez dans l’univers en noir et blanc de Christophe Chabouté et de la vie nocturne des œuvres d’Orsay. Les œuvres ont aussi des choses à raconter.
Édité par le label Vents d’Ouest du groupe Glénat, en 2023, Christophe Chabouté invite le lecteur à visiter les riches collections dans les différentes galeries de l’ancienne gare d’Orsay. Plongez dans le quotidien des œuvres d’art ! Tout comme le réalisateur Shawn Levy, dans la série de films La Nuit au musée (voir article sur le sujet : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1208-la-nuit-au-musee-ou-la-solution-miracle), qui redonne vie aux collections du Museum d’histoire naturelle de New York, l’auteur de cette BD fait de même avec les collections d’art d’Orsay. Cette BD graphique est entièrement en noir et blanc, et majoritairement sans dialogue, destinée à être contemplative des différentes situations entre les visiteurs et les œuvres d’art.
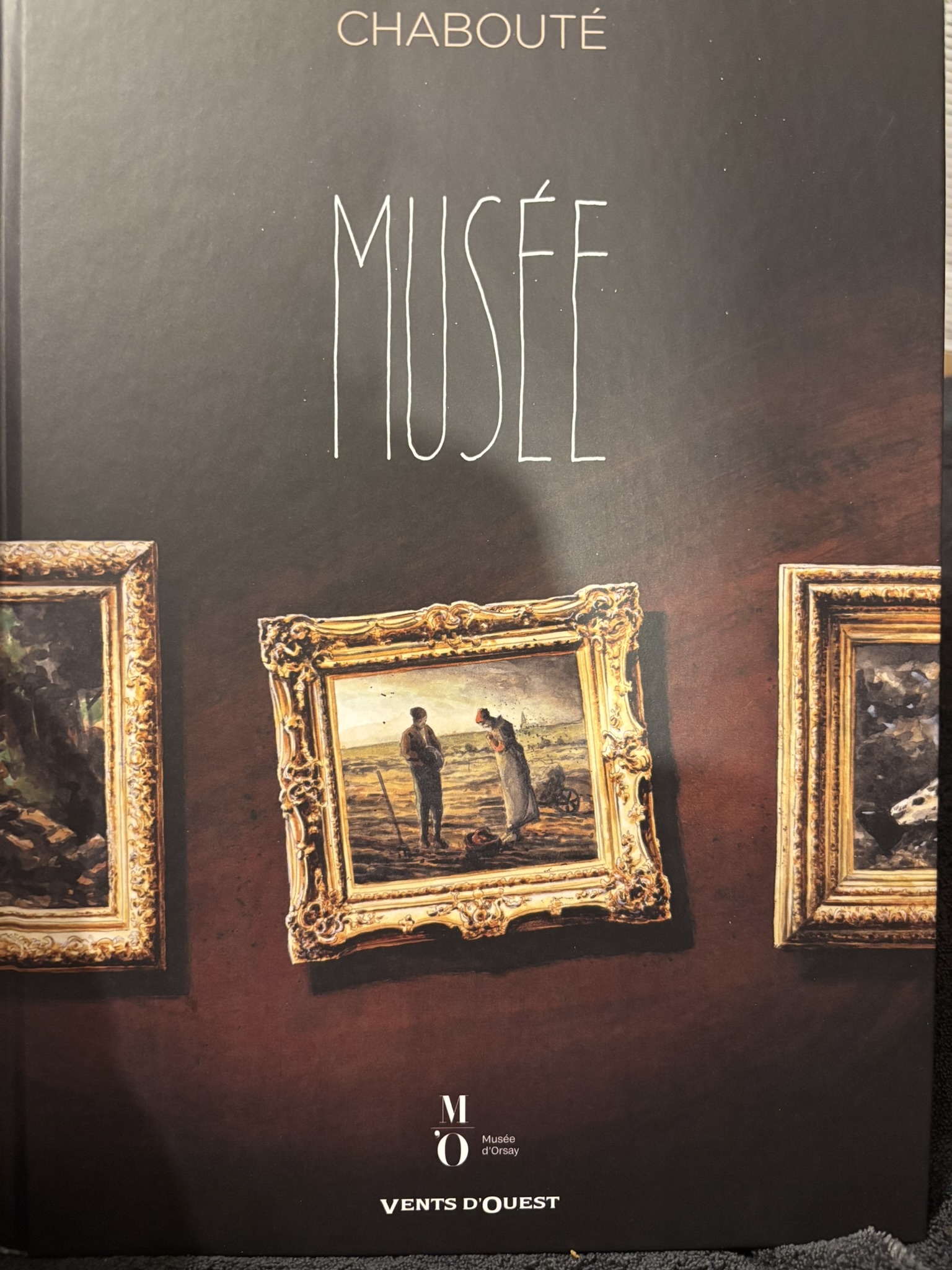 Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix
Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix
Le choix des œuvres par Christophe Chabouté a été simple selon lui : ce sont toutes les œuvres qu’il préfère à Orsay comme Les parlementairesde Daumier, Pompon l’ours, Héraklès, Anacréon, La Liseuse, Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, Persée, Le Prince Impérial et le chien Néro, le portrait de Berthe Morisot, ou encore le Gladiateur du monument à Gérôme. Pourquoi étaient-elles ses préférées ? Parce qu’il parvenait à leur trouver un rôle et une fonction lorsqu’il les observait.
Une double narration
Le lecteur fait face à une double narration. D’une part, la journée, le musée est principalement vu par les différents types de visiteurs qui se succèdent au fil des pages. En tant que visiteurs, nous n’observons pas tous de la même façon les œuvres. Nous les découvrons différemment. L’auteur de la BD présente quelques scènes amusantes, comme celle où deux dames discutent de la façon de cuire des asperges devant le tableau de Manet L’asperge (p. 71-72). Mais des scènes aussi douces et émouvantes, avec une petite fille qui fait visiter le musée à son grand-père aveugle. Elle choisit de lui faire « écouter les tableaux » pour les lui décrire (p. 87 à 99). Nous avons tous une sensibilité différente face à une œuvre, il est possible de lui donner une interprétation avec nos propres mots ! Pas besoin d’être un fin connaisseur pour admirer une œuvre d’art, ou de discourir avec langage soutenu ! Une double page (p. 52 et 53) en est le parfait exemple : un homme décrit un paysage en utilisant une vague de mots complexes pour la décrire tout en triturant sa barbe, à ses côtés une dame décrit le tableau ainsi « Cette douceur… ce calme…cette sérénité…on entend le doux et léger frottement de l’herbe contre les robes ». L’homme accueille ces paroles en silence. La description émotionnelle l’emporte sur le discours pompeux et élitiste. Une autre scène se renouvelle au sein de la BD, quand le lecteur prend la place d’un tableau et peut observer les réactions des visiteurs lorsqu’ils l’observent : rire, dispute, pudeur…Quel est ce tableau qui intrigue ? La réponse est à la fin de la BD : L’origine du monde de Courbet. D’autre part, la narration se poursuit la nuit avec les œuvres d’art qui décident d’évoquer certaines scènes vues au cours de la journée, comme celle d’un homme non-voyant touchant une œuvre, probablement le grand-père de la petite fille. Ou encore les parlementaires de Daumier qui font des commérages sur les amourettes de Louis un surveillant du musée d’Orsay.
En figurant le surveillant, Christophe Chabouté permet aux lecteurs de découvrir les coulisses du musée avant son ouverture : dépoussiérage, déplacement ou dépôt d’une œuvre. Des métiers qui peuvent être invisibles aux yeux des visiteurs mais essentiels à l’entretien de nos œuvres préférées !
Plongez dans la vie intime des œuvres !
Figées dans l’espace et le temps, elles sont destinées à observer chaque visiteur les contempler et les critiquer. Lorsque la nuit tombe et que le musée se vide de ses visiteurs, les œuvres se mettent à vivre leur propre vie. Elles aussi ont une âme, des envies de découvertes, des émotions, après tout ne sont-elles pas le reflet de ce que l’artiste souhaitait faire transparaître ? « On en profite, on savoure. On vit. » (Extrait d’une discussion entre deux sculptures sur la question : pourquoi leur est-il possible de bouger ? p. 111)
Christian Chabouté souhaite montrer que les œuvres aussi ont des choses à raconter et leur propre sentiment et histoire. L’Héraklès Archer de Bourdelle se questionne et est intrigué par les toilettes, chaque nuit, il cherche leur mode d’emploi. Il analyse les lavabos, les sèche-mains et la chasse d’eau. Même immobiles la journée, les œuvres sont attentives aux discussions des visiteurs, ces dernières influent leurs actions la nuit et leurs discussions. La Liseuse d’Henri Fantin-Latour et Anacréon d’Eugène Guillaume, amoureux, se lamentent chaque nuit sur leur éloignement en journée. La nuit, les tableaux se vident. Berthe Morisot passe ses nuits à observer un homme promener son chien, un amour à sens unique ? À la fin de la BD, cet homme observe son portrait et acheter une reproduction par la suite. Qui a dit qu’il était impossible d’avoir un coup de foudre pour un portrait ? Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, et Persée passent leur temps à s’interroger sur la vie humaine et les agissements des visiteurs.
Questionner le visiteur au musée ?
Par ses décalages et variation de points de vue, l’auteur permet de questionner également l’utilisation des téléphones portables au sein des musées, présentant de nombreuses planches où les humains regardent à peine les œuvres et les prennent seulement en photo. Les œuvres ne comprennent pas et se demandent pourquoi les humains leur tendent ces objets rectangulaires (p. 123). On ne regarde plus, on accumule des photos d’œuvres dans le téléphone, comme pour passer à la prochaine œuvre, ainsi cette scène où une femme presse son mari alors qu’il contemple une œuvre en lui disant « De toute façon, je l’ai pris en photo. Tu pourras la regarder à l’hôtel ce soir » (p. 70-71). Notre volonté d’aller trop vite et d’utiliser la technologie à tout moment, ne détruit-elle pas notre expérience de visite ?
Le surveillant est un autre personnage à part entière. Lorsque nous nous baladons dans un musée, nous observons les œuvres, le lieu, mais voyons-nous les agents qui font vivre le musée ? Un questionnement possible après une confidence déposée auprès d’une statue : « Il m’a dit : tu as de la chance, toi…Tout le monde te regarde, te dessine, te contemple…Nous, on n’existe pas. On est transparents, on fait partie du décor… Invisibles… ». L’art évince les gardiens, peut-être les humains de façon plus large, mais les œuvres leur redonnent toute leur importance, en devenant leur interlocuteur.
En lisant cette bande dessinée, vous redécouvrirez les musées autrement ! Et lors de votre prochaine visite, demandez-vous comment les œuvres vous voient-elles ? Que ressentez-vous ?
Laurie Dereix
« Musée » Par Christophe Chabouté. Editions Vents d’Ouest (23€) – Paru le 19 avril 2023
#ArtGraphique #BD #Musée d’Orsay

À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ?
Le musée est un lieu très représenté en littérature jeunesse. A travers quelques albums choisis selon une méthodologie hasardeuse et de manière totalement non exhaustive, nous verrons quel portrait du musée est dressé par des illustrateurs et auteurs d’albums pour enfants.
La sélection comprend quatre ouvrages illustrés à destination des 3-6 ans ainsi qu’un livre à jouer sous forme de bande-dessinée qui s’adresse aux 8-11 ans.
Ces livres sont exclusivement occidentaux, les auteurs / illustrateurs étant tous belges, français ou anglo-saxons. Ils ont été écrit entre 1985 pour le plus ancien et 2006 pour le plus récent.
Les albums en question :

Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent - 1985
Lorsque Célestine perd Ernest, une course effrénée commence à travers les couloirs calmes du musée, ce qui a le mérite de distraire les gardiens qui semblent s’ennuyer.
- Pardon, Monsieur, est-ce un bon métier, gardien de musée ?
- Oui et non, Monsieur : on ne se fatigue pas mais on s’ennuie beaucoup !
Quelques pages plus loin :
- Si ça pouvait arriver plus souvent, la vie des gardiens de musée serait quand même plus amusante !

Lulu et les bébés volants, Posy Simmonds - 1988
Lulu rechigne à aller au musée, elle aurait préféré rester jouer au parc. Alors qu’elle est occupée à bouder, ses parents commencent la visite sans elle. Seule sur un canapé, deux bébés volants tout juste sortis d’oeuvres d’art se mettent à lui parler, avant de l’entrainer parcourir le musée. C’est l’occasion pour Lulu de découvrir les tableaux de l’intérieur. Cet album donne à voir un ressort classique de la littérature et du cinéma en donnant vie à des oeuvres d’art ou bien en faisant évoluer des personnages à l’intérieur des toiles.

Solange et l’ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben - 1997
Solange vit seule. Elle aime peindre et aussi se rendre au « Grand musée » pour observer un petit ange dans un tableau. Ils se lient d’amitié et déambulent ensemble dans les galeries sans se faire voir des autres visiteurs. Le petit ange lui montre chaque recoin du musée, qu’il ne peut quitter. Pour ne plus être séparés, Solange devient gardienne du musée. La découverte approfondie du musée se fait, comme dans le livre précédent par le biais d’un tiers.

Poka et Mine au musée, Kitty Crowther - 2006
C’est samedi, Poka emmène Mine visiter le « musée d’art tribal ». Rapidement, Mine veut aller aux toilettes, mais rapidement elle se perd. Finalement, son aventure se déroule davantage hors de l’espace muséal à proprement parler puisqu’elle s’est égarée dans les couloirs annexes, réservés au personnel du musée. Le musée n’est qu’un prétexte et l’histoire aurait tout à fait pu se dérouler ailleurs.

La Peur du Louvre, Yvan Pommeaux - 1986
Peu enthousiasmé par sa sortie scolaire au Louvre, la visite du personnage principal prend une toute autre tournure lorsqu’il s’aperçoit que des oeuvres disparaissent. Ici, le vrai héros de l’histoire, c’est le lecteur : il est amené à se mettre dans la peau du personnage afin de percer le secret du pharaon et trouver (ou non) le mystérieux voleur. Le lecteur est impliqué dès le début du récit puisque c’est à lui de choisir des objets qui le serviront ou le desserviront pour progresser dans l’intrigue. Il sera également amené à prendre des décisions à de nombreuses reprises. Plusieurs solutions existent et le livre peut être joué de nombreuses fois.
Comment sont représentés les musées à travers ces livres ? Quels protagonistes y évoluent ? Quels sont leurs rôles ? Et surtout quelles clefs de lecture donnent-ils à l’enfant pour s’approprier le musée.
Musées figés ?
Force est de constater que parmi ces ouvrages, les musées de Beaux-arts sont très majoritairement représentés, particulièrement le Louvre. Il l’est non seulement parmi cette sélection, mais également dans les rayons consacrés à l’art et aux musées des espaces jeunesses des bibliothèques. D’ailleurs, Louvre éditions publie régulièrement des bandes-dessinées et des albums jeunesse à partir de ses collections, surfant ainsi sur son image de marque. Rares sont les musées à disposer de leur propre service d’édition et d’un tel réseau de distribution.

Capture d’écran du catalogue de Louvre éditions ©Louvre
Parmi la sélection, le Louvre n’est expressément nommé que dans La peur du Louvre d’Yvan Pommaux. Dans Solange et l’Ange, le lieu de l’intrigue est reconnaissable à la pyramide qui trône en page de garde et que l’on retrouvera au fil des pages. Pourtant, les auteurs préfèrent parler du « Grand Musée » où Solange, le personnage principal se rend tous les jours.

Solange et l’Ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben © Gallimard Jeunesse
Ernest et Célestine, quant à eux, se rendent dans un musée qui semble être le Louvre, de par l‘architecture et les tableaux exposés, dont la Joconde. Mais, c’est un musée créé de toutes pièces par l’autrice, qui rassemble dans une exposition des copies de tableaux célèbres, ce qui donne l’occasion d’expliquer à l’enfant ce qu’est une copie. Par certains détails, les tableaux sont identifiables, à condition de les connaître. Dans les musées d’art, la question de l’accrochage est centrale. Ici, la mise en espace trahit une vision assez traditionnelle des musées, puisqu’accrochés dans certaines salles sur deux niveaux.
Dans l’album de Posy Simmonds, Lulu est trainée par ses parents dans un musée où se croisent squelettes de dinosaure, sculptures classiques, peinture d’histoire, natures mortes, toiles romantiques ou encore naïves. Ce joyeux mélange est placé dans un décor très rococo avec tapisseries anciennes et dorures au plafond.
Pour Poka & Mine c’est un peu différent, puisqu’ils se rendent dans un « musée d’art tribal », exposant des masques, des ossements et des fresques murales rappelant celles des grottes préhistoriques. Contrairement aux autres livres, les oeuvres présentées ne sont pas réalistes et encore moins reconnaissables.
L’accrochage est, dans ces livres, assez conventionnel voir caricatural. La présence des gardiens, identifiables à leur uniforme - complet-vestons et casquettes vissées sur la tête - vient renforcer cette vision archétypale des musées, et notamment des musées de Beaux-arts. Ces gardiens, qu’ils soient sympathiques ou non, veillent à faire respecter l’ordre et les oeuvres d’arts. L’enfant découvre toutes les règles de comportement qu’il est « convenu » de respecter dans un musée. Dans les dessins, des jeux d’échelle rendent les personnages très petits par rapport à l’architecture des lieux, renforçant cette idée d’un espace intimidant, voire inaccessible.

De gauche à droite : Solange et l’Ange, La peur du Louvre, Lulu et les bébés volants, Poka et Mine au musée.
Maintenant que le décor est planté, voyons ce qui se joue dans ces histoires et les expériences vécues par les protagonistes.
Partir à l’aventure : quand l’ennui fait prendre le large
Les histoires qui s’y déroulent reprennent des topiques de la littérature jeunesse :
1 - l’anthropomorphisme
Les animaux sont présents dans trois des albums de la sélection. D’une manière générale et ce depuis Les Fables de La Fontaine, les animaux occupent l’espace littéraire, même si « Aujourd’hui il y a de moins en moins d’animaux parmi les personnages, et de plus en plus d’enfants. » (Alban Cerisier). Le recours aux animaux, qui incarnent une certaine authenticité tout en étant séduisants, permet d’attirer les enfants dans les histoires : « Les premiers amis des enfants sont les animaux sous toutes leurs formes, peluche, doudou, mousse, plastique etc. […] L’animal est un passeur […] c’est souvent lui qui attire le tout-petit dans l’univers du livre. ».
2 - l’aventure
Dans quatre de nos cinq histoires, le ou la protagoniste échappe à la surveillance (des parents, de l’accompagnateur, du groupe d’élèves…). Certains choisissent de partir à l’aventure, que ce soit par ennui ou par défi, quand d’autres se perdent simplement en chemin. Dans le document pédagogique de la BnF intitulé « Ces immortels compagnons de nos enfances », nous pouvons lire : « Il y a deux types d’aventuriers : ceux qui sont projetés dans l’aventure par des évènements extérieurs et ceux qui partent en quête d’aventures. ». Enormément de livres de littérature jeunesse reposent sur cette mécanique de l’égarement, dont Alice au Pays des merveilles est certainement l’un des exemples les plus connus.
Les personnages principaux de Ernest et Célestine au musée, de La peur du Louvre et de Lulu et les bébés volants trouvent dans un premier temps le musée ennuyeux. Soit ils rechignent à y aller soit ils ne souhaitent pas s’y attarder. Parmi les livres de la sélection, seule Solange s’y rend de bon coeur et de son propre chef. D’ailleurs, c’est la seule qui n’est pas accompagnée par un adulte et il est écrit qu’elle vit seule. Elle a donc une autonomie que les autres n’ont pas.
L’aventure commence lorsque le calme et l’ennui sont troublés par l’inattendu. Le musée, malgré sa rigueur classique devient rapidement un terrain de jeu ou de découverte. Dans tous les cas, le personnage principal, et donc le lecteur avec lui, est amené à sortir du cadre de visite traditionnel. C’est l’occasion pour les héros en herbe d’affronter l’inconnu et de braver des interdits. L’aventure peut-être simplement de retrouver sa route dans un musée présenté comme labyrinthique.
Ces livres reprennent certes une vision traditionnelle du musée, mais certains parviennent à montrer qu’il peut s’y passer des choses amusantes. En complément ou en préparation d’une visite au musée, ils permettent de familiariser l’enfant avec un environnement, des codes spécifiques et ainsi d’aiguiser son oeil et de stimuler son attention. La mécanique est toujours la même, il s’agit de montrer au lecteur-récepteur que le musée n’est pas seulement l’endroit ennuyeux et poussiéreux qu’il n’y parait.
La spécificité du rôle éducatif des musées et des expositions fait consensus c’est pourquoi, la sortie au musée est bien souvent un passage obligé de la scolarité. Elle s’insère dans les programmes scolaire sous l’appellation « éducation artistique et culturelle ». Son but est de favoriser l’accès à tou·te·s les élèves à l’art et la culture. Elle relève donc d’une pratique encadrée, qu’elle soit réalisée avec l’école, avec les parents ou avec des animateurs sur le temps périscolaire.
Même lorsque l’histoire est réaliste et que le recours à l’imaginaire est limité (c’est le cas dans Ernest et Célestine et dans Poka et Mine), le protagoniste est confronté à une ou des situations qu’il doit démêler. Il est d’une certaine manière contraint de faire preuve d’autonomie et de sang froid qui sont extrêmement valorisés dans les livres pour enfant.
L’accessibilité à ce type d’ouvrage en question
Il convient cependant de préciser que les enfants n’ont pas tous accès à ce type d’album qui peuvent couter cher et ne se trouvent pas dans toutes les bibliothèques des écoles ou collèges. Ils sont généralement le fruit d’une politique d’acquisition orientée des institutions, et ne sont pas à disposition de toutes les bourses. Par ailleurs, ils sont parfois peu mis en avant dans les librairies et médiathèques non spécialisées.
La discrimination par la lecture est un phénomène bien connu des sociologues. Bernard Lahire parle même de « genèse des inégalités ». Comme pour les affinités avec les musées, « le rapport au livre, à la lecture, est déterminé par le rapport qu'y entretiennent les parents eux-mêmes. ».
AG
#littératurejeunesse
#découverte
#musée
Références :
Faire un détour par la « littérature de jeunesse » ?
La représentation du musée dans les albums jeunesse
Livres :
Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent - 1985
Poka et Mine au musée, Kitty Crowther - 2006
Lulu et les bébés volants, Posy Simmonds - 1988
Solange et l’ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben - 1997
La Peur du Louvre, Yvan Pommeaux - 1986

Al-‘Ulâ : une exposition qui donne envie de plier bagage
Dernier jour pour voir une exposition. J’y vais. C’est après une bonne demi-heure de queue que je découvre l’exposition « al-‘Ulâ : Merveille d’Arabie ». Entre le bruit, les piétinements et la vieille dame qui passe devant tout le monde, je me demande ce que je fais là. Mais … à l’entrée de l’exposition, mon agacement s’efface.
Une immersion réussie
L’espace est totalement plongé dans le noir. Devant moi un dispositif audiovisuel saisissant me transporte à al-‘Ulâ en Arabie Saoudite. L’exposition s’ouvre avec cet imposant écran partant du sol qui happe quiconque s’en approche. Je me transporte dans les magnifiques prises de vue de Yann Arthus-Bertrand qui a eu la chance de filmer ce site exceptionnel. Ces vues aériennes me mettent en apesanteur au-dessus du désert. Le monde s’arrête, je suis déjà loin. Les merveilles d’Arabie s’ouvrent à moi.
Ce site archéologique de 7 000 d’histoire se laisse découvrir grâce à un autre dispositif. Une table au centre de la pièce nous permet de comprendre les différentes phases d’occupation de la vallée d’al-‘Ulâ. Le dispositif est ingénieux, la table est un fait un plan-relief en résine de couleur blanche sur lequel est projetée depuis le plafond l’évolution d’al-‘Ulâ. En quelques minutes 7 000 d’histoire s’offrent à voir, le tout de façon claire et efficace. Je suis conquise. Dans cette salle un dispositif scénographique m’interpelle : la reproduction de gravure rupestre sur une cimaise. Ce dispositif tactile très réussi, permet de se rendre compte des entailles dans la pierre de ces lointains ancêtres.

Vue de la « table-relief », exposition al-‘Ulâ, IMA. ©Axelle Gallego-Ryckaert
Je ne suis pas au bout de mes surprises lorsque j’entre dans la salle dédiée aux oasis d’al-‘Ulâ. Une nouvelle plongée immersive dans les images de Yann Artus-Bertrand est encore plus saisissante qu’à l’entrée de l’exposition. Devant moi des plantes caractéristiques de l’oasis continuent de sécher tranquillement sous leur vitrine. Mais surtout je suis transportée par une douce odeur. Un dispositif olfactif m’emporte dans ses jardins verdoyants à la senteur enivrante de datte, de grenade et de figue. Mes sens sont en alerte.
De surprise en surprise
Je quitte cette agréable atmosphère pour en apprendre plus sur l’histoire de la vallée d’al-‘Ulâ. D’imposants vestiges archéologiques témoignent de la richesse des royaumes qui ont fait prospérer cette vallée. Une table tactile me permet de découvrir par l’intermédiaire d’un guide saoudien, les différentes peuples et royaumes de la vallée. L’image couplée des paysages et du guide donnant des explications me donnent la sensation d’y être.

Vue d’un dispositif audiovisuel, exposition al-‘Ulâ, IMA. ©Axelle Gallego-Ryckaert
Cet art millénaire et parcellaire dans ce coin de désert est une belle découverte. Des colosses en grès rouge témoignent de l’influence de l’Égypte antique et du carrefour commercial qu’était la vallée d’al-‘Ulâ. Cette salle est aussi l’occasion de découvrir les croyances des habitants de la vallée avec ces dieux païens oubliés.
Avec les échanges commerciaux, les habitants d’al-‘Ulâ s’inspirent de l’architecture funéraire rupestre de Pétra. C’est l’occasion de comprendre comment ils ont creusé des tombeaux dans les falaises abruptes du désert. Une petite animation montre comment les tailleurs de pierre partaient du haut des falaises pour y tailler en négatif la façade de la tombe monumentale.
Puis je me retrouve en tête à tête avec un squelette de femme soigneusement protégé derrière une vitrine. C’est le moment de parler de rites funéraires. Projetée au mur, une animation montre les différentes étapes de préparation du corps avant d’être déposé dans son tombeau. Devant le mur, une projection sur une table montre les méthodes de fabrication ancestrale des éléments constitutifs du rite funéraire comme la fabrication d’un collier de dattes.
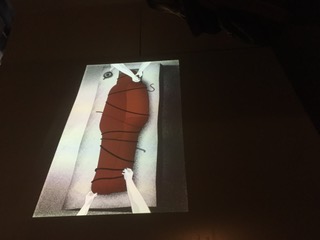
Vue d’un dispositif audiovisuel présentant les rites funéraires nabatéens, exposition al-‘Ulâ, IMA. ©Axelle Gallego-Ryckaert
Puis vient le moment de tester mes connaissances en alphabet arabe. J’apprends alors que la vallée d’al-‘Ulâ et le peuple des nabatéens qui y habitaient ont joué un rôle dans la constitution de la langue arabe. C’est l’interview de la co-commissaire de l’exposition qui nous l’apprend. Dans le même temps est projeté sur un mur un film sur l’évolution de l’écriture arabe à partir du mot « paix ».
A mi-parcours, une salle aborde l’époque des pèlerinages. La vallée d’al-‘Ulâ se trouve sur la route entre la Jordanie, La Mecque et Médine, s’est donc un important lieu de passage où les pèlerins pouvaient se réfugier dans des caravansérails et venir se rafraîchir dans les oasis d’al-‘Ulâ. Une nouvelle vidéo présente la ville ancienne d’al-‘Ulâ et ses ruelles étroites. Un autre guide explique les techniques de construction des maisons, l’histoire de la construction de la forteresse, la distribution de l’eau aux habitants grâce à un cadran solaire, etc.
Désenchantement
A ce stade de mon parcours tout va pour le mieux, même si je sens la fin arriver. Je m’engage dans un long et trop large corridor. Ce dernier présente à travers une longue frise des villes-gares, dont al-‘Ulâ fait partie, qui desservaient la voie ferrée entre Damas et Médine. En effet, l’empire ottoman installé dans cette région de l’Arabie depuis le XVIe siècle avait besoin d’infrastructure pour relier les grandes villes de son territoire. Une histoire qui aurait pu beaucoup m’intéresser si la muséographie et la scénographie avaient été plus abouties. Les cartels étant mal placés, ils étaient difficiles à relier à chaque photographie qu’ils présentaient.
Enfin, j’arrive dans la dernière salle nommée « Une région vivante » je comprends alors que l’exposition fait partie d’un plan de communication de l’Arabie Saoudite pour mettre en valeur son patrimoine riche et millénaire. Puisque l’Arabie Saoudite prépare « l’après pétrole » en voulant développer le tourisme.
Le parcours se clos avec un dispositif de bornes audiovisuelles, qui montre des interviews des acteurs du tourisme de la vallée. Ils expliquent, entre autres, comment le site a été aménagé pour être accessible, quel a été leur plan d’action pour développer le tourisme, etc. Au mur, les sites les plus remarquables sont présentés à la façon d’un guide du Routard. Entre les lignes, l’exposition encourage donc les visiteurs à devenir de futurs touristes. L’exposition « al-‘Ulâ : Merveille d’Arabie » était donc le fer de lance de ce pays en quête de reconversion économique.
Je ressors de l’exposition avec un sentiment mitigé, à la fois éblouie par les dispositifs de muséographiques très réussis, par l’éclairage magistral des pièces archéologiques, par mon immersion totale dans cette oasis verdoyant grâce aux images de Yann Arthus-Bertrand, mais à la fois déçue par une fin de parcours inaboutie et par la conscience d’avoir été à mon insu spectatrice d’une publicité expographique pour me donner envie d’aller découvrir cette splendeur du désert. Ce qui m’énerve encore plus, c’est que ça a marché ….
Axelle Gallego-Ryckaert
#expositional-ula
#institutdumondearabe
#voyage
Comme je vous l’ai dit au début de l’article, l’exposition est désormais finie, je vous laisse quand même en compagnie de Yann Arthus-Bertrand pour vous présenter la vallée d’al-‘Ulâ.
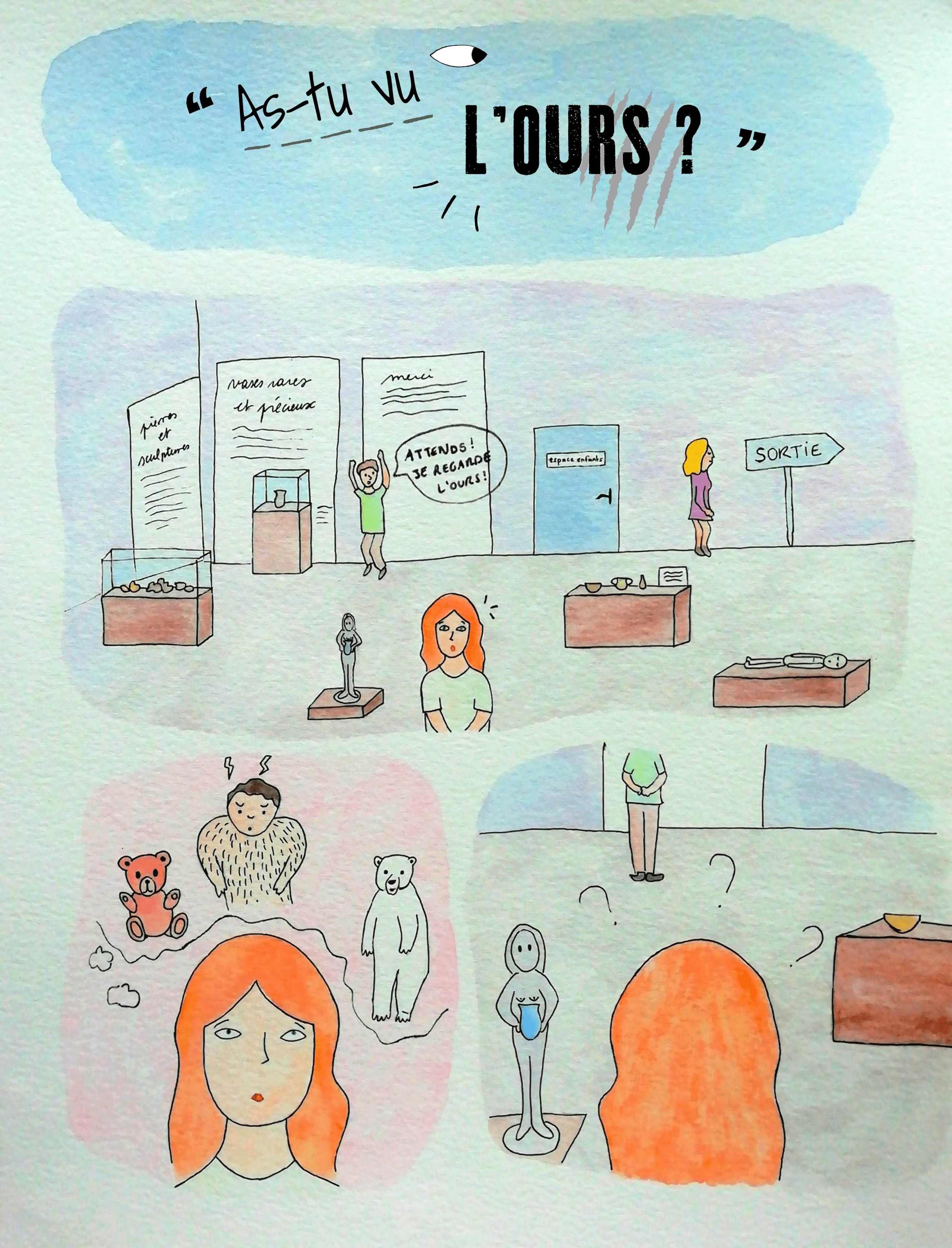
As-tu vu l'ours ?
- Grand mammifère plantigrade de la famille des Ursidés, à fourrure épaisse, le plus souvent carnivore.
- Fig. et fam. Homme solitaire, qui fuit la société. Un ours mal léché, un homme bourru, aux manières rudes.
- PRESSE. Fam. Liste des responsables d’un journal ou d’une revue, qui doit légalement figurer dans chaque numéro.
© Académie française, 2019
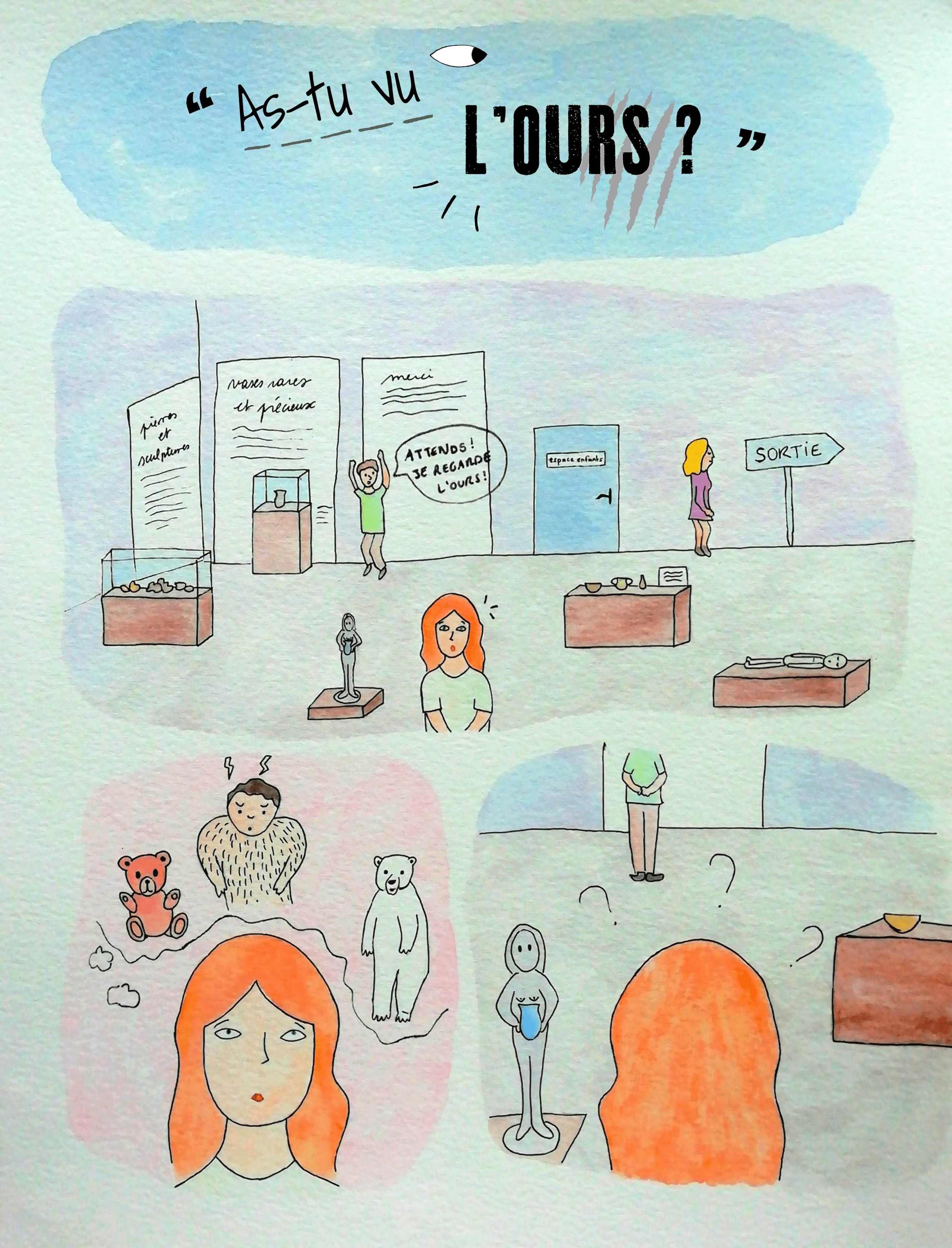
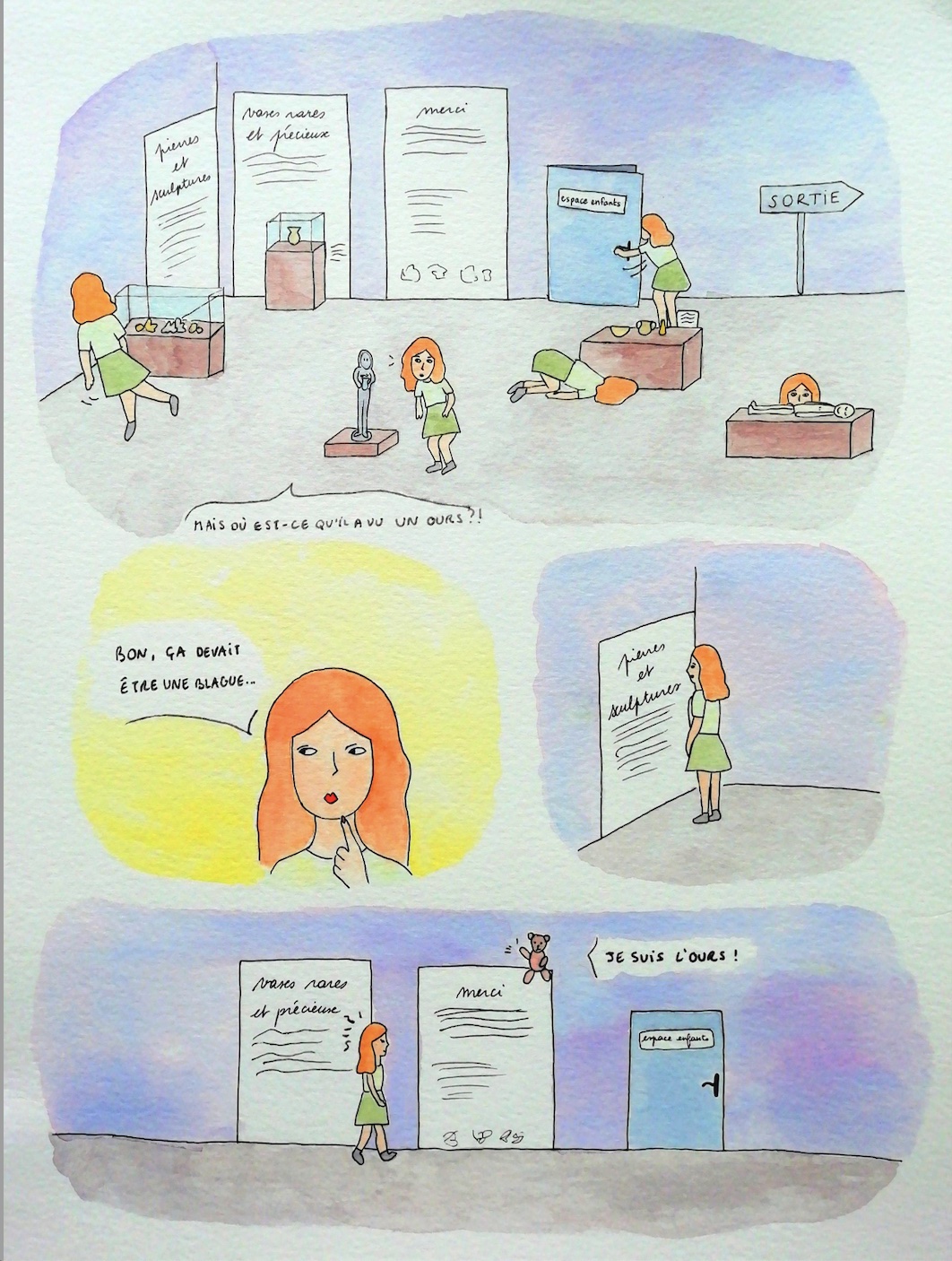
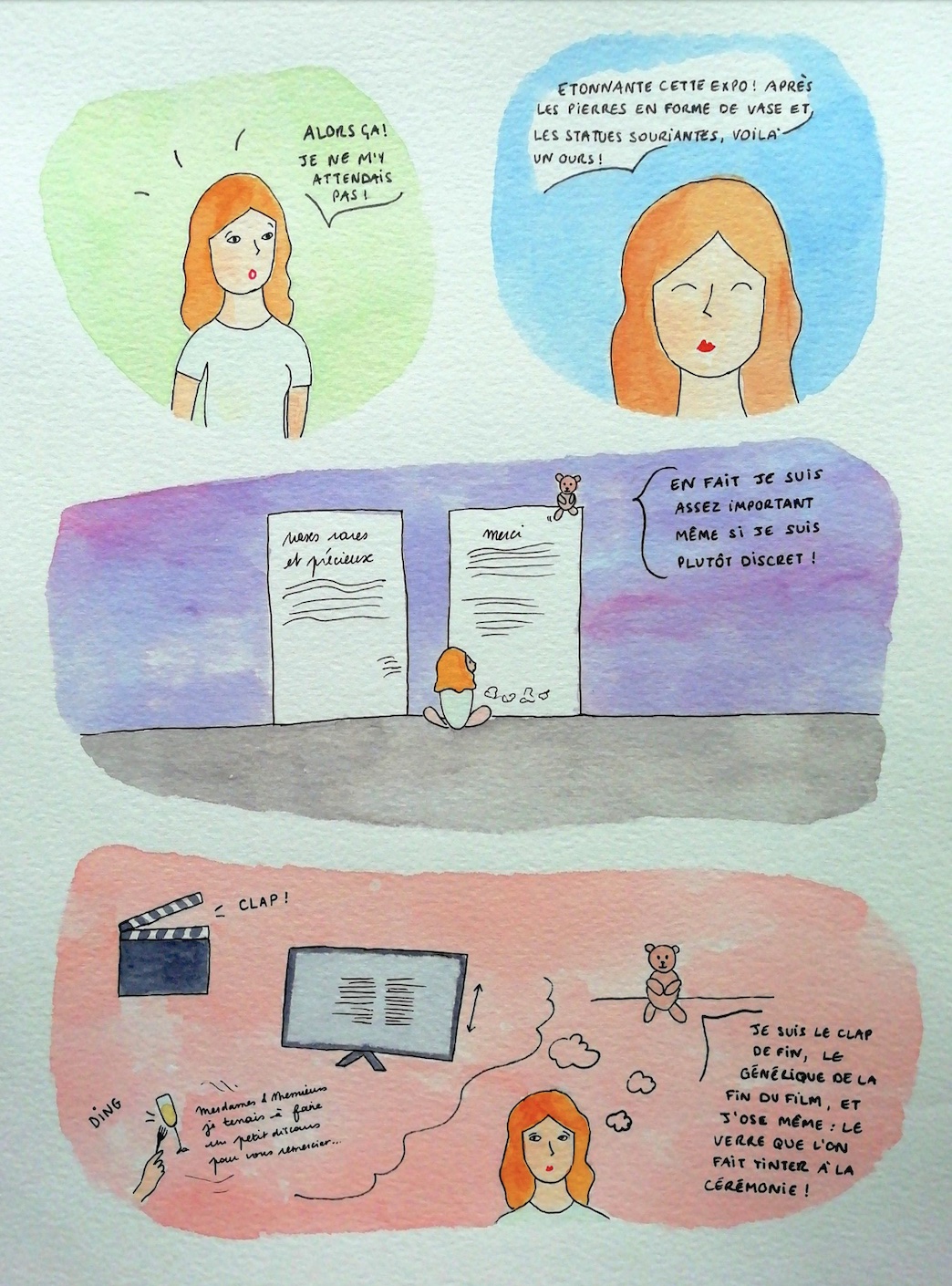
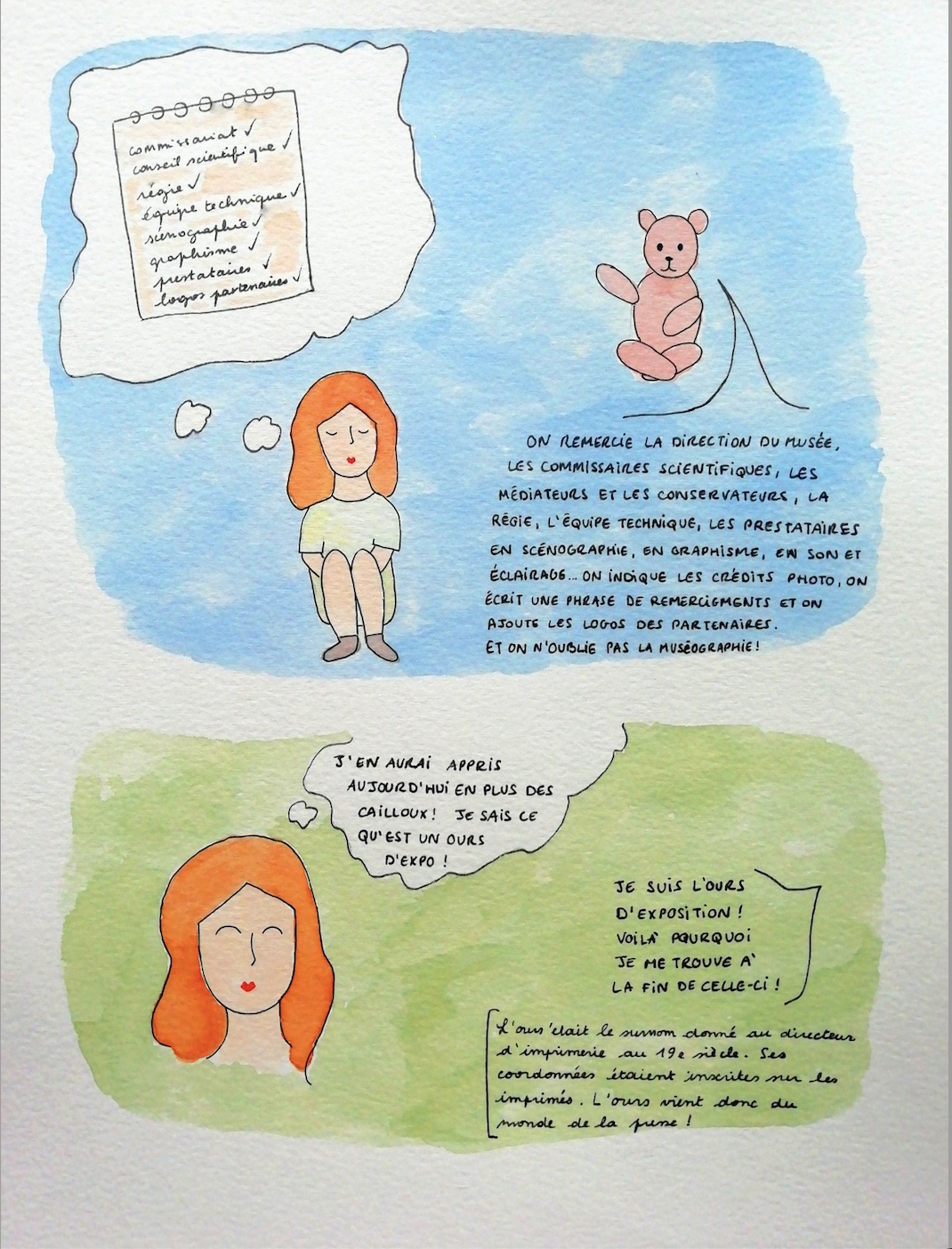
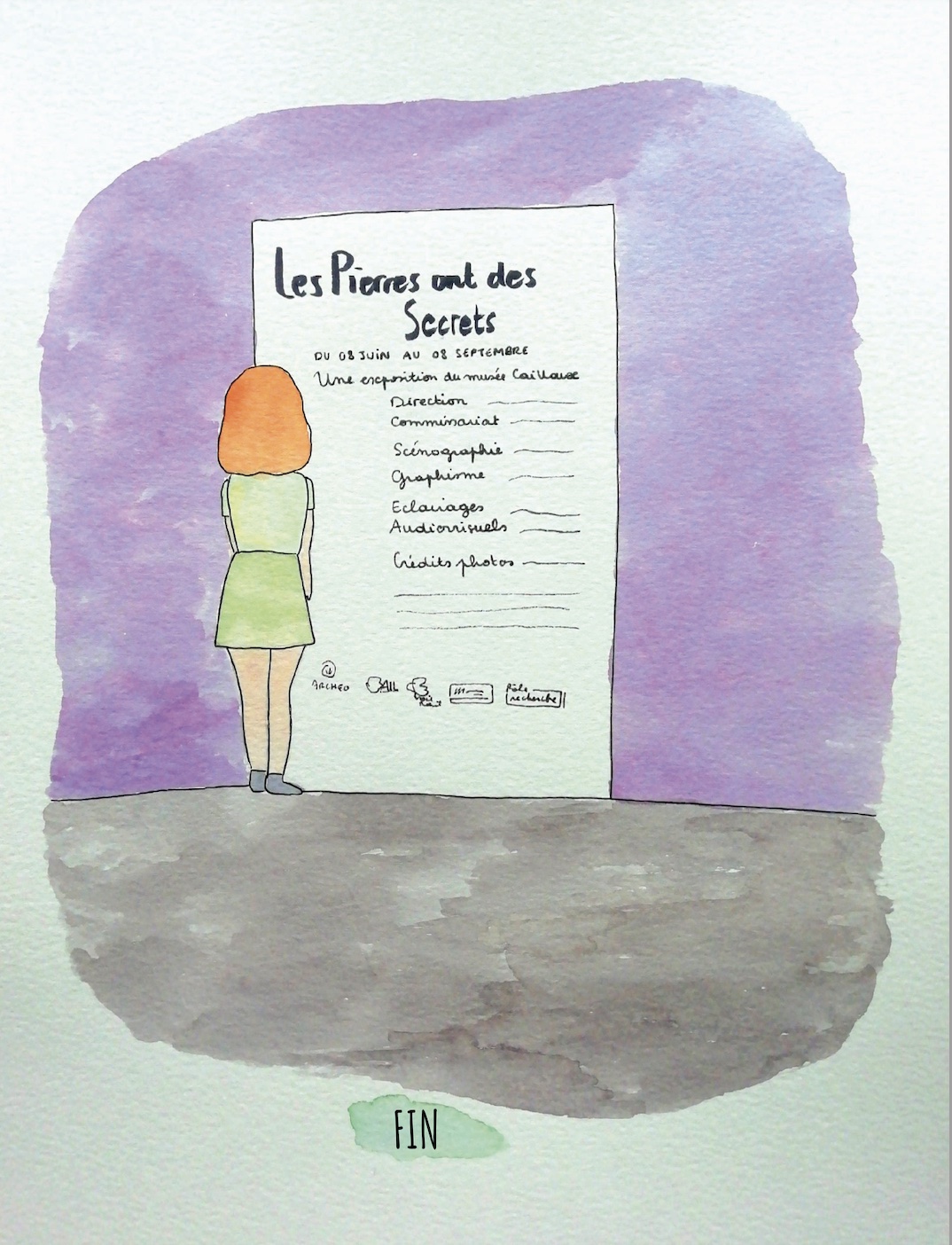
L.L
#oursdexposition
#remerciements
#museographie

Barbie, la poupée controversée
Barbie Fashion, Joseph Condé © photo A. Erard
C’est avec un regard curieux et loin de mes a priori sur la poupée Barbie que je décide de mettre des mots sur mon expérience. Si certains dénoncent le modèle féminin de la Barbie, c’était une toute autre vision que nous proposait l’exposition Barbie au Musée des Arts décoratifs de Paris de mars à septembre 2016. Exposition ayant été conçue par Anne Monier (conservatrice du département des jouets), assistée d’Aurore BAYLE-LOUDET, et scénographiée par Nathalie Crinière. Depuis les années 60, Barbie s’est imposée comme une figure phare, une icône pour la jeunesse, qui fascine aujourd’hui toutes les générations.
Et quelle bonne surprise que de pouvoir se replonger dans son univers féerique le temps d’une visite ! Les adeptes n’avaient qu’à bien se tenir car c’est une réelle redécouverte qui nous attendait dans ce « Barbieland ». Strass, froufrous et paillettes étaient au rendez-vous, mais qui connaissait réellement sa gigantesque famille, son évolution physique au fil des décennies, sans parler de sa carrière fluctuante digne des plus grandes figures de ce monde ? « À travers ses tenues, nous dessinons ses carrières, les étapes de sa vie, et plus largement toute l’histoire de Barbie » disait Robert Best, directeur en chef du design de Barbie. La poupée a inspiré les plus grands artistes et l’exposition leur rend hommage.

Barbie Karl Lagerfeld © photo A. Erard
Je démarre donc cette visite sans a priori sur l’image idéalisée par la société Mattel, de la femme moderne qui a souvent fait parler d’elle. L’exposition prend tout son sens en ce qu’elle nous présente la Barbie dans un parcours de vie des plus complets. La maison Mattel est mise en lumière à plusieurs reprises, on retrouve notamment ses ateliers de fabrication en version miniature qui évoquent la conception du jouet qui sera bientôt idolâtré.
Décor de l'atelier Mattel © photo A. Erard
Des Barbie en veux-tu ? En voici en voilà ! C’est un défilé de Barbies auquel nous assistions, pour cette figure de mode qui a inspiré les plus grands, tels Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Agnès B, Cacharel ou encore Christian Louboutin. Chacun habille la Barbie à son image ou bien la représente une icône de la mode. On ne cherche donc pas à toucher un public exclusivement jeune ou féminin mais également les amateurs de mode et toute personne curieuse de l’évolution de la poupée dans son aspect historique et dans les modes qu’elle a représentées au fil des décennies.
Car la Barbie a connu de multiples changements physiques, c’est un jouet en constante évolution. Longtemps critiquée, elle arbore fièrement ses nouvelles formes et ses couleurs de peaux. 14 visages, 23 couleurs de cheveux, 8 couleurs de peau, une diversité qui ne satisfera que partiellement les plus sceptiques et même 4. Certes, un certain canon esthétique demeure. Dans la salle dédiée à l’évolution du jouet, je ne peux m’empêcher de sourire en voyant la transformation du mécanisme de la Barbie dont les articulations s’assouplissent au fil du temps pour la rendre de plus en plus maniable. Barbie s’inscrit donc dans une évolution historique riche en rebondissements, et c’est certainement l’aspect socio-culturel du jouet qui est mis en avant dans cette exposition. On constate notamment l’évolution des rôles joués par Barbie au fil du temps, si la première Barbie incarnait le phénomène « girly », Mattel a lancé la production de barbies exerçant des métiers initialement appréhendés par les hommes (cosmonaute, footballeuse, présidente …). En ce sens, elle représente l’image de la femme indépendante dans un monde qui ne serait idéalement pas dominé par l’homme. Robert Best disait que « Barbie doit être représentative de son époque mais surtout nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout d’un jouet pour enfants. » Je m’attache alors à comprendre l’enjeu d’un tel phénomène dans l’époque dans laquelle elle s’inscrit. Dois-je comprendre que la poupée serait une inspiration plus qu’un modèle à imiter ? En nous laissant penser cela, le créateur cherche sûrement à camoufler l’image initiale qu’il a cherché à transmettre au travers de ses poupées, soit la superficialité d’un jouet et de son image. Je peux néanmoins m’amuser de la voir déclinée dans plus de 150 tenues représentant le même nombre de métiers qu’elle a pu exercer au cours de sa vie.
La visite se déroule le sourire aux lèvres. Nul besoin d’une ambiance des plus silencieuses, car Barbie c’est avant tout le jeu et la joie de vivre. J’entends en fond sonore la chanson « Barbie Girl », musique ayant traversé des booms générationnelles. Une salle est consacrée au jouet, à ses aventures et ses publicités télévisées. Je déambule le long de ces écrans qui passent en boucle les images de la poupée animée, et qui nous rappellent que le phénomène va au-delà de la simple représentation physique du personnage.
Salle des vêtements © photo A. Erard
Afin de contenter les plus adeptes de mode, l’exposition nous plonge dans une nouvelle salle dédiée à la garde-robe de Barbie. Une déclinaison d’habits, un arc-en-ciel de couleurs et des centaines de vêtements et accessoires miniatures sont fixés aux murs de cet espace de transition. Créativité et diversité sont au rendez-vous dans ce dressing que l’on voudrait avoir chez soi.
Je poursuis ma visite en entrant dans une salle consacrée à l’entourage de Barbie, un arbre généalogique sans fin, des amis que l’on ne compte plus, une famille représentative de la prétendue famille américaine « modèle » et bien sûr ses conquêtes amoureuses. L’arbre généalogique nous présente ces personnages fixés aux murs pour faciliter sa lecture, ce qui s’avère plutôt nécessaire vu le nombre de membres dans son entourage proche.
La visite se termine sur une déclinaison de plusieurs Barbies réalisées par des étudiants en Ecole de design textile. Ces représentations démontrent l’inspiration irrémédiable de la poupée, qui voyage à travers les temps, marque les esprits et s’impose à la manière d’un mythe universel. Elles donnent à voir le potentiel de futurs créateurs et clôturent la balade sur une touche de créativité.
L’exposition Barbie aura-t-elle réussi à convaincre les plus sceptiques de l’univers de la poupée ? La muséographie aura-t-elle participé à une surenchère de critiques sur le caractère superficiel de la Barbie ou aura-t-elle épousé des mouvements de société ou de la mode ?
Anna Erard
#barbie
#artsdécoratifs
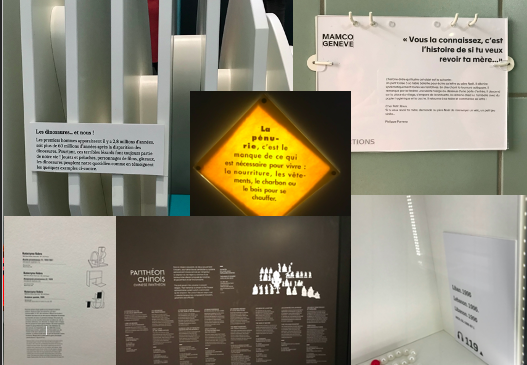
Cartel : un support en questionnement ?
Les cartels sont omniprésents, ils font l’objet d’une attention particulière dans une grande partie des musées. Pendant mon apprentissage aux musées du Mans, une discussion revenait très souvent lors des montages d’expositions : celui des cartels. Le texte est trop long ? Il gâche l’œuvre ? Ils sont trop visibles, trop bas, trop hauts ? Il existe de nombreux types de cartels, chaque institution à ces habitudes et énumérer des exemples n’est pas mon objectif, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir à ce support.
Le cartel : avant tout un outil d’identification
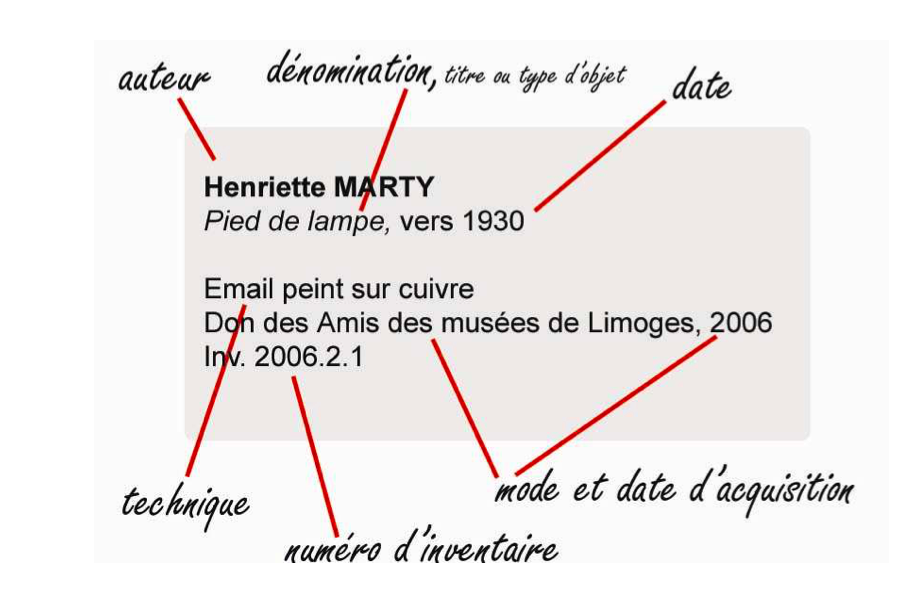
Documentation musée des Beaux-Arts de Limoges.
Avant toute chose, le cartel dans les espaces d’expositions permanents ou temporaires a une fonction bien précise.
Cartel : « ce sont les étiquettes qui accompagnent et documentent chaque œuvre ou objet. »
A cette définition, j’ajoute qu’il permet d’identifier l’œuvre, l’objet que les visiteurs observent. Très souvent, il se constitue pour une œuvre d’art du nom de l’artiste, de son titre, des dimensions, du numéro d’inventaire et si c’est un prêt ou un dépôt le nom de l’institution. C’est une sorte de carte d’identité pour œuvres et objets.
Cependant, il ne s’arrête que très rarement à ces informations. Ils peuvent être accompagnés d’un texte de présentation ou même d’une analyse développée de l’œuvre. Cela devient une zone de texte à part entière. Le ministère de la culture précise les objectifs de cet outil : « objectifs de communication, c’est-à-dire par le choix du niveau d’interprétation de l’étiquette (uniquement pour identifier, étiquette autonyme, ou décrire, expliquer, être une aide à l’interprétation, étiquette prédicative). »
Quel rôle pour ce format précieux ?
J’écris précieux sans demi-mesure. Proche des œuvres, il peut être un intermédiaire, une médiation entre les œuvres et les visiteurs. Il invite le visiteur à la découverte de ce qu’il ne pourrait pas voir/comprendre. Selon les scénographies, il s’intègre plus ou moins bien dans l’espace et il peut aussi faire l’objet d’un graphisme particulier.
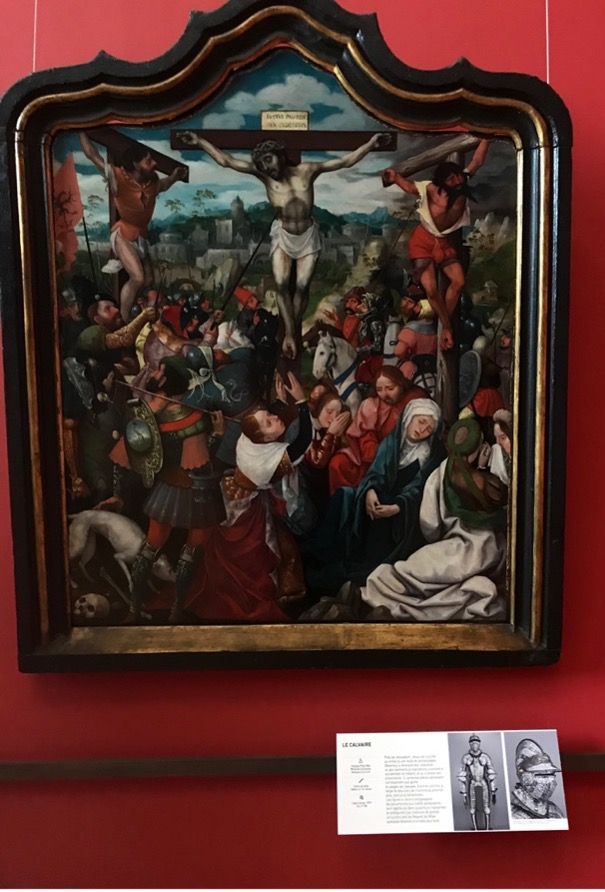
Exemple des cartels familles PBA, juin 2021 ©AV
Lors de ma dernière visite au Palais des Beaux-Arts de Lille (PBA), une première partie des « cartels famille » ont été installés auprès des collections médiévales. Ici, il est utilisé pour faire des liens avec le reste des collections. Ce n’est donc plus un cartel « traditionnel ». Des images y sont intégrées, ce qui peut interpeller les visiteurs et les amener à lire le cartel pour son contenu et non que pour connaître le titre de l’œuvre.
Écriture des cartels : quelles voix s’expriment ?
De nombreux avis s’affrontent. Qui doit finalement écrire ces cartels ? L’équipe scientifique, c’est-à-dire les responsables de collections, les conservateurs, ou des chercheurs, les médiateurs, les visiteurs etc.
Plusieurs essais sont réalisés par de nombreux musées. James Bredburne, directeur de la Pinacothèque de Brera, a laissé la place à des enfants pour écrire certains cartels du musée. En parallèle, des cartels scientifiques ont été posés. Sur l’étude menée, le directeur remarque que les visiteurs passent plus de temps auprès des œuvres lorsqu’ils lisent les cartels rédigés par les enfants. James Bredburne prend l’exemple du cartel consacré à Cézanne, il avait été écrit par une jeune fille de 13 ans. Plus court, plus interprétatif, le cartel attise la curiosité des différents visiteurs.
Là encore, il ne s’agit pas de supprimer définitivement les cartels scientifiques mais plutôt de rythmer les voix qui mettent en lumière les œuvres.
Autre aspect qui peut changer la lecture d’un cartel : le ton de l’écriture. Toujours dans les cartels familles du PBA, le tutoiement du visiteur est introduit, le cartel amène aussi des intrigues à résoudre en découvrant les œuvres. Le fait de questionner, de donner le temps au lecteur de s’interroger permet une visite plus riche et de devenir acteur de sa visite. Et pour ceux qui recherchent un discours plus soutenu, plus scientifique, le cartel de l’œuvre est encore présent. Le visiteur a donc le choix de découvrir l’œuvre par le contenu qu’il souhaite.
Cartels simples, développés, ont-ils encore un avenir ?
Je ne compte plus les cartels interminables, illisibles vus et lus dans certaines expositions. Il n’existe pas de règles propres pour écrire des cartels. Très souvent, son écriture est confiée aux équipes scientifiques. Cela peut produire des cartels développés aux références et explications complexes, voir incompréhensibles, soit par le vocabulaire employé, soit par sa longueur. Écrire des cartels courts ou avec plusieurs niveaux de lectures peut rendre la compréhension plus fluide.
Outre l’aspect technique, la forme du cartel me pose réellement question. À l’ère du tout numérique avant nous encore envie de lire des cartels collés aux murs ? Peut-être qu’il est temps de nous interroger sur notre rapport à cet outil afin qu’il ne disparaisse pas. Comment pourrions-nous découvrir ces informations par un autre biais que celui du cartel strict ?
Plusieurs institutions font le choix de supprimer les cartels de l’espace de visite. L’exposition « Memento Mons. Cabinet de Curiosités » au Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) en avait fait l’expérience tout en laissant le visiteur se procurer un livret de visite détaillé.
D’autres, tels que la Fondation Custodia, ont d’ailleurs aussi complétement enlevé ces outils des espaces d’exposition pour les écrire directement dans des livrets. Cela devient un réel gain pour le visiteur qui car s’il le souhaite il peut le ramener chez lui, s’il le souhaite.
Toutefois, tout le monde ne désire pas chercher dans son livret de salle en salle à quel numéro correspond l’œuvre pour lire son cartel. Intégrer dans les espaces d’expositions des cartels réduit cet intermédiaire. Mais d’autres formats ont pris la main pour diffuser du contenu. Le numérique peut jouer un rôle clé tant avec des formes matérielles qu’immatérielles avec l’apparition des QR codes, d’applications, des tablettes de visites etc. Il a apporté une nouvelle manière d’appréhender le contenu textuel dans les expositions.
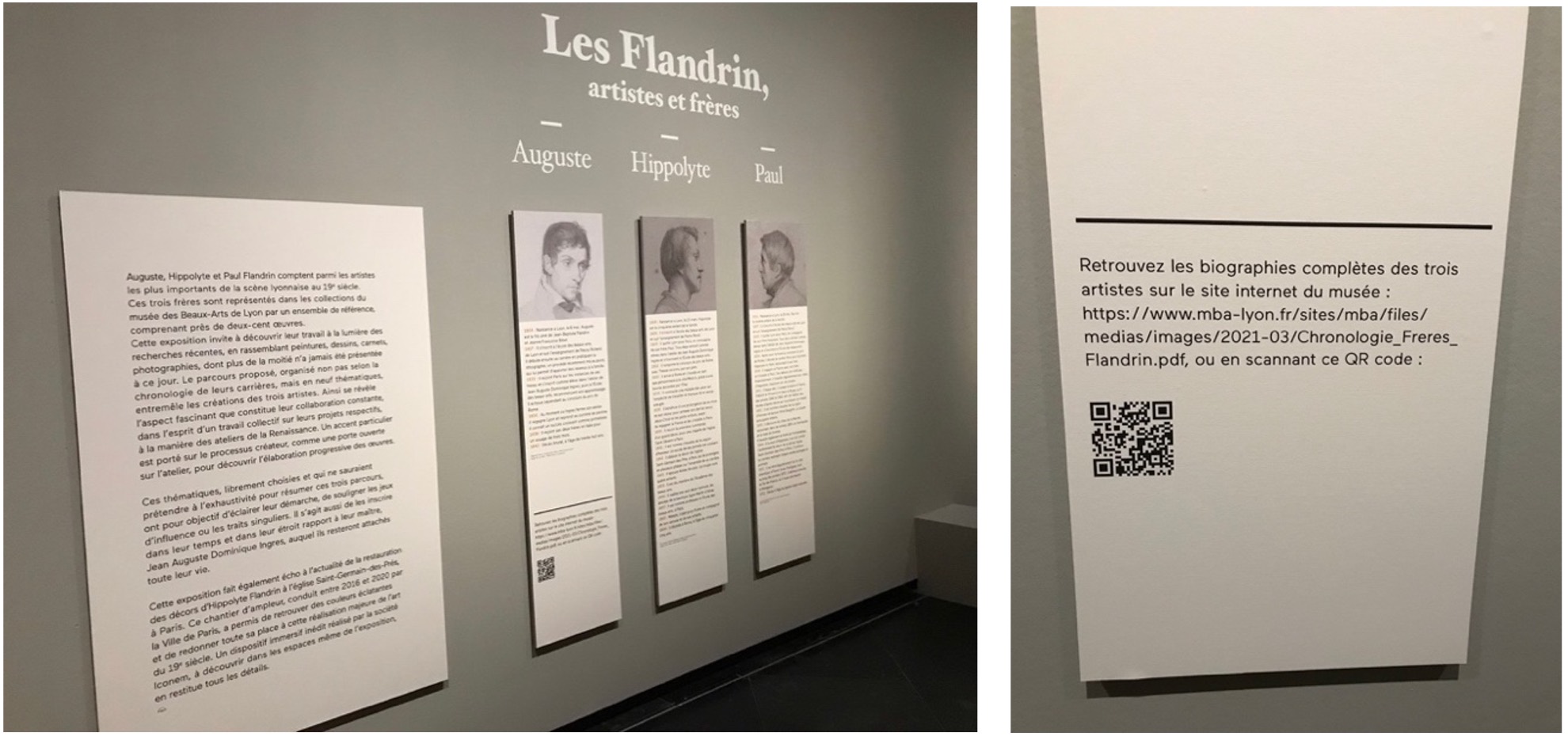
Exposition Les Flandrins, artistes et frères, entrée de l’exposition, Musée des Beaux-Arts de Lyon, juillet 2021, ©AV
L’apparition des QR codes n’est pas nouvelle dans les musées, ils sont mêmes récurrents. Au musée des beaux-arts de Lyon, pour l’exposition consacrée aux peintres et frères Flandrin, plusieurs QR codes étaient disposés. Tant pour certains cartels, qu’en compléments de textes, ou pour retrouver le livret de visite. Pour ne pas désavantager les visiteurs qui n’ont pas de smartphones ou pour ceux ne souhaitant pas les utiliser les textes étaient toujours présents dans l’exposition.
Autre forme, pouvant prendre le relais des cartels : l’audio. Pendant le confinement, la production des podcasts dans les institutions culturelles et particulièrement dans les musées s’est fortement accrue. (Voir Les musées dans nos oreilles : les podcasts au musée et sur les musées) Nombre d’entre eux se penchaient directement sur les collections exposées. Pourquoi ne pas les intégrer directement dans les parcours permanents ? Vous me direz que pour ceux qui le souhaitent, une grande partie des musées proposent des audioguides mais pourtant ce sont des formats bien différents. Les podcasts offrent l’opportunité d’apporter un ton différent, soit avec une touche d’humour, ou une touche de narration.
Dans tous les cas, les cartels ne doivent pas être négligés, ce sont des supports qui font parties des murs tellement nous pouvons y être habitués. Au point que nous pouvons leur accorder peu d’attention. Et des cartels trop longs, « mal intégrés », trop soutenus voire même quelquefois incompréhensible nuisent à mon expérience de visite. Partant de ce principe, le fait d’accorder un sens et un rôle à ces outils peut nous permettre de valoriser les œuvres et les expôts. Leur donner une nouvelle forme et nouveau rôle peut permettre de réellement les intégrer au parcours de visite. Comme le dit James Bradburne, il n’existe pas une vérité, ni un seul cartel.
Pour aller plus loin :
« 5 exemples de cartels », publié sur Exposcope : https://exposcope.wordpress.com/2021/04/06/cartel/
« Delacroix et Eugène. Des cartels sensibles », publié sur Exposcope : https://exposcope.wordpress.com/2019/04/29/delacroix-eugene-cartels-sensibles/
Conférence Les cartels au musée : La voix des œuvres, intervention de James Bradburne et Jean-Luc Martinez en 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=g3OI4OSEMwI&t=1s
L'ouvrage de Daniel Jacobi : Textexpo : produire, éditer et afficher des textes d’exposition aux Editions OCIM. Voir https://ocim.fr/ouvrage/textexpo-produire-editer-afficher-textes-dexposition/
#cartels #musées #discours

Changements climatiques et musées, quel(s) lien(s) ?
Le titre de cet article peut faire peur, tant le sujet est large. Mettons donc les choses au point. L’objectif n’est pas d’alerter sur le changement climatique en cours et ses conséquences, à l’échelle globale comme pour les institutions muséales. Il ne s’agit ni d’être moralisateur envers les pratiques des musées et de leurs professionnels, ni de lister des « bonnes pratiques ». Le but est de se demander en quoi les musées sont concernés par la crise climatique en cours, et surtout quels sont leurs moyens d’action, leurs compétences, pour participer aux évolutions nécessaires à faire dans notre société.
Qu’est-ce que cela implique pour tous les organismes membres de l’ICOM ? Les institutions muséales sont-elles vraiment concernées par les ODD ? Et comment participer aux efforts face à la crise climatique ?
Pourquoi et comment les musées sont-ils concernés ?
“In addition to their deep view of time, museums are eminently qualified to address climate change for a variety of reasons. They are grounded in their communities and are expressions of locality; they are a bridge between science and culture; they bear witness by assembling evidence and knowledge, and making things known; they are seed banks of sustainable living practices that have guided our species for millennia; they are skilled at making learning accessible, engaging and fun, and last, they are some of the most free and creative work environments in the world.”
De plus, les musées forment un réseau mondial très dense – plus de 55 000 institutions dans le monde, essentiellement dans les pays développés, il faut bien le noter – qui peut avoir un impact sur les engagements en faveur de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, à condition bien sûr que toutes s’y mettent et que les engagements pris soient significatifs.
Agir en tant que réseau

L’entrée du Musée du changement climatique à la Chinese University de Hong Kong. © Hoising, CC BY-SA 3.0, via
Wikimedia Commons.
Exposer le changement climatique
Donner l’exemple, entre adaptation et atténuation
- Protéger le patrimoine culturel et naturel mondial, dans les musées et en général ;
- Participer à la diffusion et l’éducation aux ODD ;
- Rendre la culture accessible à tous ;
- Favoriser le tourisme durable ;
- Permettre la recherche pour soutenir les ODD ;
- Adopter une gestion interne en accord avec les ODD ;
- Adopter une gestion externe en accord avec les ODD.
1 Voir la page dédiée au développement durable sur le site de l’ONU.
2 Robert R. Janes, « Museums in perilous times », dans Museums Management and Curatorship, Volume 35, Issue 6: Museums and climate action, ICOM, 2020, pages 587-598.
3 Pour plus de détails sur ce concours : https://www.museumsforclimateaction.org/.
4 Une liste non exhaustive mais très fournie des expositions sur le thème du changement climatique est
disponible ici. D’autres articles sur le blog présentent aussi des expositions : « Le vent se lève » : récit d’une
déambulation écologique au MAC VAL et La biodiversité exposée.
5 Pour une présentation de ces musées, voir l’article de J. Newell, Climate museums : powering action, dans
Museums Management and Curatorship, Volume 35, Issue 6: Museums and climate action, ICOM, 2020, pages
599-617.
6 Deux articles du blog traitent déjà très bien ce sujet : Des expos recyclées et L’avenir écologique de la
scénographie d’exposition – post Covid.
Chim CHOLIN
A lire : Serge Chaumier et Aude Porcedda, sous la direction de, Musées et développement durable, La Documentation française, 2011.
#ChangementClimatique
#ObjectifsDéveloppementDurable
#TousConcernés
Pour aller plus loin : le dernier numéro de la revue de l’ICOM Museums Management and Curatorship, (Volume 35, Issue 6) : Museums and climate action, qui regroupe de nombreux articles intéressants.
Et ne pas hésiter à visiter les sites des institutions citées, et d’autres encore !
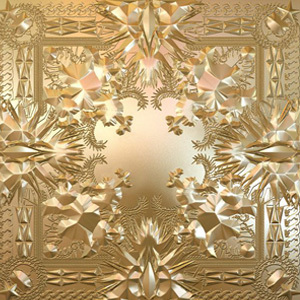
Chanter le musée
Rien de plus enivrant qu’un bon morceau de musique. Les mélomanes le savent : les yeux qui se ferment, le son qui se propage dans un corps rendu lâche ou prêt à bondir, l’anticipation d’un refrain qui va résonner dans le cœur, un éventuel solo qui se fait désirer et un dénouement qui fait l’effet du calme après la tempête. Que ce soit pour danser, se détendre, rester concentré, méditer, pogoter, avoir un bruit de fond ou faire le ménage, tout le monde y trouve son compte. Nombreux sont les genres, nombreuses sont les thématiques abordées.
Parmi ces chansons majoritairement anglophones (car il y a très peu de chansons françaises à ce sujet), en existent t-il qui évoquent les musées ? Peu, mais certainement. J’en ai choisis selon leurs paroles et non leur mélodie. Libre à vous d’attraper vos écouteurs ! Il y a des chansons qui mentionnent brièvement le musée (Chéri.e, des fois je ne te comprends pas, tu es l’art abstrait dans mon musée moderne - Moly Nilsson dans I hope You Die) et d’autres qui délivrent un message en utilisant le fameux établissement. Ce sont ces chansons qui m’intéressent : quelles images renvoient-elles du musée ?
Sans surprise, l’image du musée qui revient le plus souvent est celle de la caverne aux trésors. Ce stéréotype remonte à bien longtemps. Quand ont émergé les premiers musées ? “Officiellement”, lors de la Renaissance italienne où l’on a constitué des galeries d’art antique. Mais avant ? Il y avait les Mouseîon, ces temples grecs dédiés aux muses des arts contenant accessoirement des collections. Et encore avant ? Eh bien, il y avait les trésors de guerre, qui sont peut être les premières collections d’objets précieux. Synonymes de richesse, ces objets confèrent pouvoir et crédibilité. Dans le milieu très bling bling du hip hop, il n’est pas étonnant de voir des rappeurs comparer leur richesses à ce qu’on peut trouver dans les musées.
Illest Motherfucker Alive, Jay-Z et Kanye West (2011)
Basquiats, Warhols, serving as my muses
My house like a museum so I see 'em when I'm peeing
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Des Basquiat, Warhol me servant de muses,
Ma maison est un musée donc je les vois quand je suis en train de pisser
Good Morning, 2 Chainz (2013)
Inside of the car is like a damn computer
Inside of the crib is like a damn museum
-----------------------------------------------------------------------
L’intérieur de la voiture est comme un ordinateur
L’intérieur de la maison est comme un musée
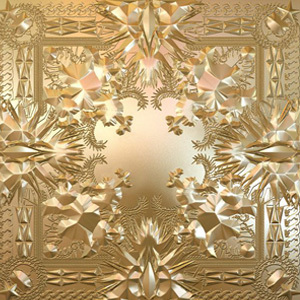
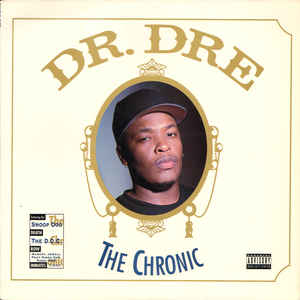
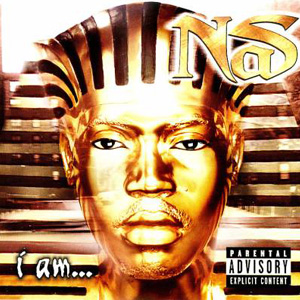
Des pochettes d’albums pour le moins luxueuses : Watch the Throne (Jay-Z), The Chronic (Dr. Dre), I Am (Nas)
Retour à l’histoire. Cette collectionnitesera capitalisée et aboutira aux cabinets de curiosités. Ce sont des intérieurs généralement privés où l’on pouvait trouver des choses rares et singulières : restes d’animaux, manuscrits, minéraux, végétaux, meubles, bijoux, armures... le tout provenant de contrées préférablement lointaines. Pour en mettre plein les yeux, on n’hésitait pas à fausser la réalité (la corne de narval présentée comme une corne de licorne, les compositions à partir de plusieurs squelettes pour créer une bête hybride….)
Museum song, Barnum (1992)
Everything about my museum was spectacular,
Quite a lotta
Roman terra cotta
Livin' lava from the flanks of Etna
[...]
A pickled prehistoric hand
A strand of Pocahontas' hair
Crow and Sioux
Who're going to
Be showing you
Some rowing through
A model of the rapids on the Delaware.
--------------------------------------------------------------------
Tout de mon musée était spectaculaire,
Un bon nombre de
Terres cuites romaines.
Lave vivante des flancs de l’Etna
[...]
Une main préhistorique en conserve
Une mèche de cheveux de Pocahontas
Crow et Sioux
Qui vont vous montrer
Un peu d’aviron à travers
Une maquette des rapides sur le Delaware
Cette image de providence est toujours bien ancrée dans la conscience contemporaine, même si certains commencent à s’interroger sur l’obligation inhérente du musée à montrer des objets authentiques...
Un autre cliché découle de ce foisonnement d’objets : celui du musée poussiéreux rempli des fantômes du passé. Au mieux, nous avons affaire à une douce mélancolie qui regrette un autrefois, au pire, au spectre de la mort qui rôde dans les couloirs.
Le gardien du musée, Les Blaireaux (2013)
Je m'appelle René
J’suis gardien d’musée,
Galerie d’la Renaissance italienne;
Depuis 30 ans qu’ça dure,
J’fais partie des murs,
J’ressemble à une momie égyptienne.
Edison Museum, They Might be Giants (1999)
The Edison Museum, not open to the public
Its haunted towers rise into the clouds above it
Folks drive in from out of town
To gaze in amazement when they see it
[...] So when your children quarrel and nothing seems to quell them
Just tell them that you'll take them to the Edison Museum
------------------------------------------------------------------------------------------
Le musée Edison, fermé au public
Ses tours hantées s’élèvent dans les nuages au-dessus
Les gens arrivent de la province
Pour regarder avec admiration quand ils la voient
[...] Alors si vos enfants se querellent et rien ne semble les calmer
Dites leur simplement que vous les emmènerez au musée Edison

Visuel tiré de la version deluxe de l’album « No ! » de They Might Be Giants
Dans cette vision lugubre du musée, nous ne sommes pas à l’abri de nos frayeurs. Ce qui est drôle, c’est que si l’on regarde les films proposés chaque année pour Musé(em)portables, la majorité ont pour sujet le meurtre au musée. Mais d’où vient cette tentation ? D’abord, exposer des objets dont on doit parfois encore percer le secret, c’est ouvrir la porte à tous les fantasmes. Le mythe de l’objet maudit a été traité maintes fois au cinéma, qui n’a pas voulu devenir archéologue après avoir vu Indiana Jones ! Ensuite, tout ce qui a attrait à la mort s’accompagne naturellement d’une série de superstitions (fantômes, spiritisme…)
Mais l’image la plus effrayante, c’est celle du musée qui a vendu son âme au capitalisme.
Big Yellow Taxi, Joni Mitchell (1970)
They took all the trees, put 'em in a tree museum
And they charged the people a dollar and a half just to see 'em
---------------------------------------------------------------------------------------
Ils ont pris tout les arbres, les ont mis dans un musée d’arbres
Et ont facturé les gens 1 dollar et demi pour les voir
Le musée est devenu grotesque, car il exhibe indécemment le triste spectacle de la vie pour faire du bénéfice. Entre les personnalités glorifiées à tort et les œuvres volées, on vient souligner la difficulté (le refus ?) du musée à se défaire d’un passé problématique.
Dear England, Lowkey (2011)
People are humans, not mindless animals
This violent tyrannical system is fallable
Hand in a looter the minute you see 'em
But the biggest looters are the British museum
---------------------------------------------------------------------
Les gens sont humains, pas des animaux dénués de sens
Ce système tyrannique violent est faillible
Qui dénonce un voleur dès qu’il le voit
Mais les plus grands voleurs sont le British Museum
Complètement “déconnectés” de la réalité, les murs du musée s’ouvrent à des expôts dont le public a du mal à s’emparer (oui je parle de l’art contemporain), renvoyant ainsi le reflet d’une vanité.
Museum of Stupidity, Graham Parker (1991)
One day there'll be a museum of stupidity
We'll fill it up with exhibits of idiocy
[...] Look at the walls of the museum of stupidity
You're bound to find there every advert on american tv
And every page of the british gutter press
-------------------------------------------------------------------------
Un jour il y aura un musée de la stupidité
On la remplira avec des expositions d’idiotie
[...]Regarde les murs du musée de la stupidité
Vous y trouverez toutes les publicités de la télé américaine
Et toutes les pages de la presse de caniveau britannique
Mais ce serait dommage de terminer sur une note si négative. Vous prendrez bien un peu de romantisme ? Interprétée par le grand Tony Bennett, je vous laisse avec cette jolie chanson évoquant quelques splendeurs terrestres dont le musée.
You're All the World To Me (1951)
You're all places that leave me breathless,
And no wonder: you're all the world to me.
You're Lake Como when dawn is aglow,
You're Sun Valley right after a snow.
A museum, a Persian palace
-----------------------------------------------------------
Tu es tous les endroits qui me coupent le souffle,
Ce n’est pas étonnant : tu es mon monde,
Tu es le Lac Como quand l’aube rayonne
Tu es Sun Valley juste après la neige
Un musée, un palais perse
B.O
#chanson
#musique

D’entrée de jeu : le rôle des halls d'accueil de musées
Entrer dans un musée n’est pas chose aisée. Les barrières sociales, culturelles et symboliques à enjamber sont nombreuses. Pénétrer dans le hall d’entrée constitue déjà une petite victoire : ça y est, nous y sommes, le seuil est franchi. Le hall est une zone qui sert une double fonction, de séparation et de communication avec le monde extérieur. Essayons de mieux comprendre cet « espace liminaire » à travers l’étude de quatre institutions muséales bordelaises.
Image d'introduction : Envol au Musée d'Aquitaine © Barbara Goblot
Quel rôle joue le hall d’entrée dans l’expérience muséale ?
L’expérience muséale commence dès le hall d’accueil. Comme son nom l’indique, il doit jouer son rôle d’accueil,de réception du public. S’y trouve la billetterie, tenue par des agent.e.s ; parfois une boutique, un vestiaire, un café, des assises qui créent un espace de détente et de discussion. Il arrive qu’il présente un aperçu de la collection, par des objets isolés ou des vitrines. Les signalétiques y sont très importantes pour que le visiteur se repère dans les différents espaces, et sache par où commencer la visite, que ce soit vers les collections permanentes ou les expositions temporaires.
Dans son article « De l’espace public au musée. Le seuil comme espace de médiation » (Culture & Musées, 2015), Céline Schall explicite l’importance du passage de l’extérieur à l’intérieur du musée. C’est un espace physique, qui coupe les visiteurs des mouvements de la vie quotidienne pour l’inviter dans le monde des arts, des sciences, de la culture. Il joue également un rôle symbolique, que Schall identifie à la seconde phase des rites de passage décrits par Arnold Van Gennep (Les rites de passage,1909) : lorsque l’individu s’apprête à changer d’état, quand il devient adulte ou se marie par exemple, il est séparé du groupe, puis vit une phase de mise à la marge (dite « liminaire ») avant d’être réintégré avec son nouveau statut. De même, lorsque l’on pénètre dans un musée, on laisse derrière soi son statut de passant, de touriste, de consommateur pour endosser l’identité de visiteur. En tant qu’espace liminaire, le hall du musée doit aider à cette métamorphose.
Cette rupture semble impliquer une certaine violence envers le public. Selon Monique Renault (« Seuil du musée, deuil de la ville ? », La Lettre de l’Ocim, 2000), le musée d’art « veille à déposséder le visiteur de ses repères spatio-temporels coutumiers ». De là à demander à ce qu’il ait les yeux bandés et fasse trois tours sur lui-même avant d’entrer dans les salles, il n’y a qu’un pas ! Le visiteur doit vivre la rupture, la « décontextualisation » qu’ont connu les objets présentés lorsqu’ils sont devenus des objets de musée, pour en comprendre le sens et atteindre leur portée esthétique. Cet argument se fonde sur l’idée que l’expérience esthétique des œuvres advient non pas grâce à des connaissances préexistantes ou des outils de médiation, mais par une mise en situation radicale, un état de recueillement et de contemplation foncièrement intime, en rupture avec la temporalité du quotidien. Le visiteur, en plus de perdre tous ses repères, ressent donc un sentiment d’échec personnel, de manque de sa part s’il ne vit pas ce bouleversement esthétique. Proposant une approche plus nuancée, Céline Schall définit plutôt le seuil comme un « espace de médiation », qui ne coupe pas seulement le visiteur de son mouvement quotidien, mais l’accompagne dans sa métamorphose et prépare la découverte des objets présentés.
La première impression compte pour beaucoup dans l’image que nous construisons d’un musée. Du premier espace qui nous accueille, nous inférons, consciemment ou non, l’identité du lieu. Avant même d’avoir exploré les collections, nous imaginons ce qu’il contient, et l’expérience que nous allons y vivre. Céline Schall identifie le hall d’entrée du musée comme un paratexte. Tout comme ce qui précède et accompagne la lecture d’un ouvrage (titre, réputation de l’auteur, quatrième de couverture, préface…), le hall donne les clés de lecture du musée dans son ensemble, de ses objets et de son discours. Il partage ce rôle avec toutes les informations dont dispose le visiteur avant son entrée dans l’institution : communication, architecture extérieure… Le paratexte met également en place le contrat de communication entre l’émetteur du message, le musée, et le récepteur, le public. Ce contrat engage le musée, il crée l’attente d’un certain type de collection, d’un discours, d’une ambiance, et doit être honoré par l’expérience de visite, sous peine d’une perte de confiance de la part du public.
Comment ces rôles sont-ils incarnés par les halls d’entrée des musées ? En décembre, le Master MEM s’est rendu à Bordeaux pour un marathon muséal. Je propose ici une analyse des halls d’accueil de quatre institutions bordelaises, qui présentent une grande variété d’architectures. Certains se sont installés dans des bâtiments historiques, d’autres ont donné lieu à la construction d’un lieu spécifique. Des halls d’accueil majestueux, d’autres plus intimes, des propositions innovantes, des architectures symboliques : ouvrons la porte des musées bordelais et arrêtons-nous là, dans le hall d’entrée.
Le Musée d’Aquitaine et la MECA : quand l’architecture s’impose
Le Musée d’Aquitaine s’installe en 1987 dans les locaux de l’ancienne faculté des lettres et des sciences, construite dans les années 1880 par l’architecte Charles Durand. Le hall d’entrée présente un volume très large, et une architecture inspirée de l’Antiquité classique (colonnes corinthiennes, frontons triangulaires, médaillons…). L’espace monumental, imposant et solennel, correspond à l’image traditionnelle du musée-temple, institution de la culture légitime abritant des collections sacralisées. Le musée d’Aquitaine conserve en effet une collection extrêmement riche, traversant l’histoire de Bordeaux et de sa région de -400 000 à nos jours. Le musée ne s’inscrit pas organiquement dans le tissu urbain, c’est un lieu de recueillement à l'écart de l'agitation du quotidien. Des escaliers monumentaux mènent à ce hall, et participent du même effet. Ils créent ce que Renault nomme un « seuil ascendant », qui engage les visiteurs à un effort physique, un cheminement mental, un « oubli de soi » pour laisser place à l’expérience esthétique. Le rite d’initiation dont nous parlions plus haut est acté : se joue là une « cérémonie du franchissement » marquant nettement la métamorphose du passant en visiteur. Le musée et les visiteurs sont dans un rapport traditionnel de transmission des savoirs unilatéral.
Le Musée d’Aquitaine a pour volonté de nouer des liens forts avec les habitant.e.s actuel.le.s de la région, à travers des conférences, des ateliers, des évènements, notamment sur le rapport entre Bordeaux et le reste du monde. Cette position affirmée par le musée n’est pas transmise par le hall d’accueil. L’architecture n’encourage pas le lien au sein de la communauté. L’immense espace de pierre, à la grande hauteur de plafond, crée un environnement froid, dans lequel on ne souhaite pas s’attarder. Aucun espace avec des assises ne propose de se reposer, de discuter, d’utiliser le musée comme un lieu de détente ou d’échanges. Le hall est avant tout une zone utilitaire, qui permet d’acheter son billet d'entrée, de prendre des livrets-jeux pour les enfants, et de consommer dans la boutique. Les stands qui présentent les produits sont disposés de part et d’autre du hall, ce qui permet une déambulation agréable. Il est également un lieu de passage, de distribution des flux entre les différents espaces du musée.
Des éléments annexes en lien avec les expositions temporaires animent un peu le lieu et donnent une idée des objets que la visiteuse pourra découvrir à l’intérieur. Pour l’exposition Hugo Pratt - Lignes d’Horizon(mai 2021-février 2022) des bannières suspendues, décorées de dessins de l’artiste et de mouettes, dynamise le bâtiment classique. Ce sont les éléments de médiation et de paratexte les plus efficaces du hall.
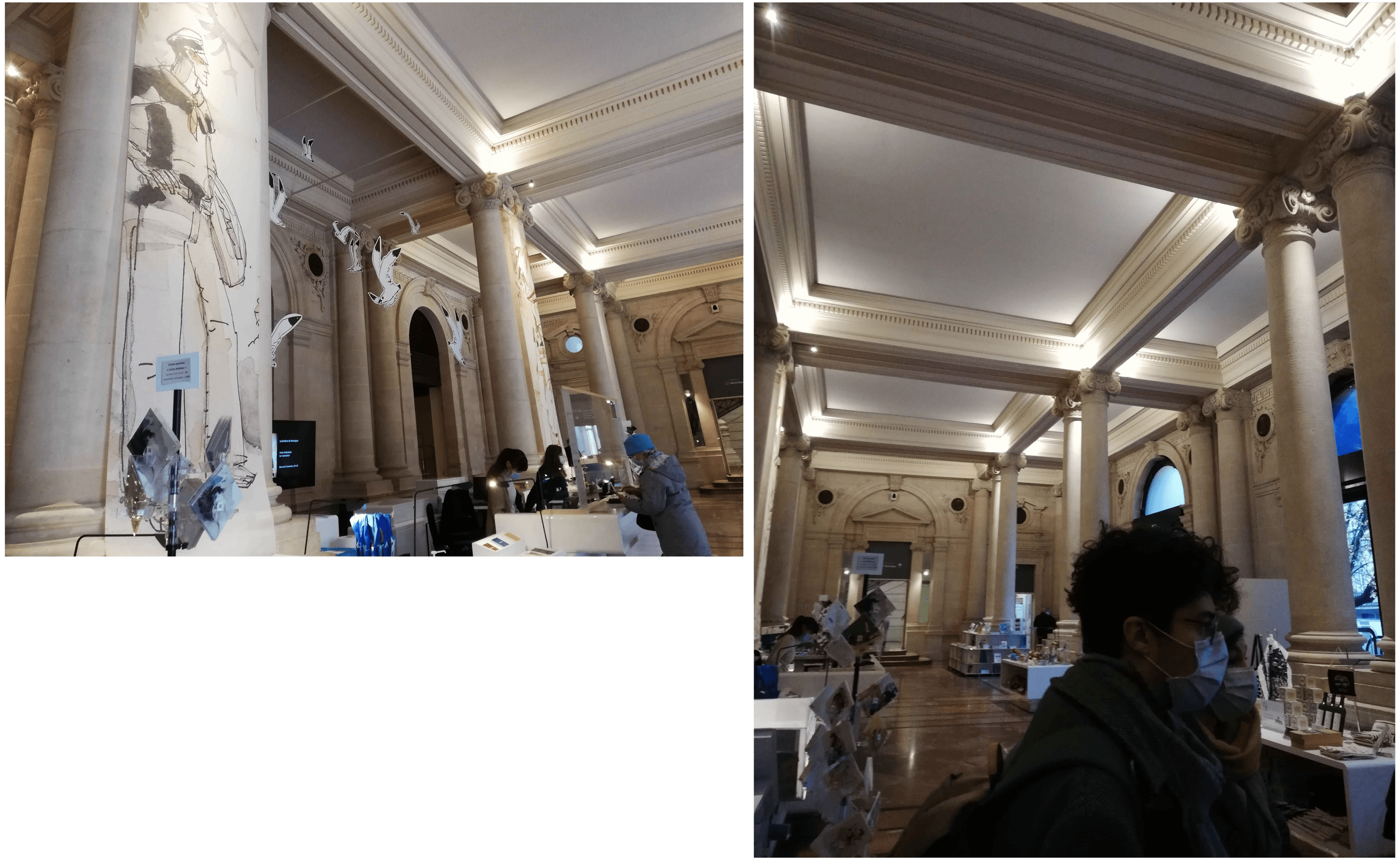
Le hall d'accueil imposant du Musée d'Aquitaine © Barbara Goblot
La MECA a été conçue par l’agence BIG en 2019. Le bâtiment héberge plusieurs agences culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine (le FRAC, l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) et l’Agence Livre Cinéma Audiovisuel (ALCA)). L’aménagement du hall, grand espace ouvert, est le résultat d’une réflexion sur les formes géométriques. A l’entrée, une sorte d’amphithéâtre circulaire accueille le public. La billetterie du FRAC, située devant les ascenseurs qui permettent de monter aux espaces d’exposition, est triangulaire. Enfin, la table du café-bar est en forme de croix symétrique. Le hall d'accueil sert bien sa fonction de distribution des flux entre le FRAC, l’OARA et l’ALCA : une signalétique claire indique les espaces occupées par chaque institution. L’espace est large, lumineux ; l’amphithéâtre et le café offrent au public des zones de repos et de discussion. Ce n’est pas seulement un lieu fonctionnel ou de passage, mais bien un espace pensé pour être vécu. Quelques œuvres d’art contemporain offrent un aperçu des collections conservées par le FRAC.
Cependant, l’espace est rendu froid et inhospitalier par les choix architecturaux opérés. Le béton brut est le matériau le plus présent, sans aucun décor ou ajout d’une matière plus chaleureuse. Ce manque est flagrant dans l’amphithéâtre, où aucun tissu ou coussin ne rend les assises confortables. Les formes géométriques, rigoureuses et austères, si elles témoignent d’un geste architectural fort, ne participent pas à faire du lieu un espace agréable, dans lequel les visiteurs ont envie de s’arrêter. Le hall de la MECA joue avant tout un rôle paratextuel : il donne les clés pour appréhender la visite, par la présence de l’architecture et de l’art contemporains. Cependant, il ne parvient pas à devenir un espace de médiation au sens où l’entend Schall.
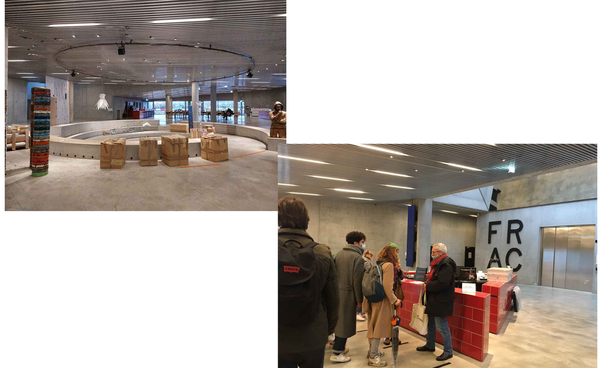
Un accueil mitigé à la MECA © Florie Gosselin / Marion Roy
Cap Sciences et le Muséum : des halls accueillant pour une entrée en douceur
Le bâtiment de Cap Sciences a été construit en 2002 par l’architecte Bernard Schweitzer spécifiquement pour le centre d’interprétation. Le hall d’entrée est spacieux mais à taille humaine, et d’une grande sobriété. Les couleurs neutres (gris, beige), les lignes géométriques et une lumière uniforme dominent. Le seul mobilier important du hall d’accueil est la billetterie, c’est un espace fonctionnel avant tout. Cependant, quelques éléments visuels en font un réel espace de médiation. Les différents espaces sont indiqués par des panneaux signalétiques qui reprennent les codes visuels du tableau périodique des éléments, ce qui nous plonge dès l’entrée dans le thème des sciences et des techniques. Le mur face à l’entrée est entièrement adapté à chaque nouvelle exposition, selon son identité visuelle. Cette signalétique et cet avant-goût de l’exposition jouent un rôle paratextuel, en nous préparant à la lecture des expositions du musée. Elles accompagnent également la métamorphose du passant en visiteur d’un musée de science, dont on attend esprit critique et curiosité.
Cap Sciences ne conserve pas de collections permanentes, ce sont les expositions temporaires qui donnent vie à l’institution. Celles-ci sont présentées et accessibles dès le hall d’accueil, de plein pied. Il y a peu de paliers entre la rue et l’exposition, qui donne l’impression d’une institution ouverte, accessible, bien loin d’un musée-écrin comme le musée d’Aquitaine. Cela contribue à l’image que le musée véhicule de la science comme terrain de jeu et d’exploration, qui ne nécessite pas le recueillement souvent attendu dans les musées d’art.

Curieux dès l'entrée à Cap Sciences © Barbara Goblot
Le Museum de Bordeaux est installé dans un ancien hôtel particulier. Il a rouvert en 2019 avec un bâtiment rénové, de nouveaux parcours d’exposition, et notamment un hall d’entrée entièrement reconstruit. Le projet a été mené par le cabinet d’architecture Basalt. Derrière la porte du musée, un sas d’entrée présente aux visiteurs deux spécimens empaillés, un adulte et un petit de la même espèce, changés régulièrement. Selon la conservatrice Nathalie Mémoire, ce sont des « éléments d’appel » qui servent d’introduction à la visite. Ainsi, le musée met en avant plusieurs caractéristiques : sa grande collection d’espèces naturalisées, et son « espace des Tout-petits », conçu pour les enfants de moins de six ans. C’est une manière intelligente d’accueillir le visiteur et de créer une entrée douce dans l’institution.
Cette volonté se poursuit dans le hall d’accueil proprement dit. Comme à Cap Sciences, l’architecture est d’une grande sobriété : couleur blanche, lignes simples légèrement courbes… Un carré central tient lieu de billetterie et de boutique. Sur les murs, des vitrines présentent des spécimens de la collection, sous l’angle de la diversité des espèces : des oiseaux, insectes et pierres précieuses sont rangés par couleur, un éléphant côtoie un rongeur de quelques centimètres. Ainsi, sans faire appel dès l’entrée aux fonctions cognitives des visiteurs, le musée met en valeur ses collections et suscite l’émerveillement et la curiosité du public, ce qui le place dans un bon état d’esprit pour commencer sa visite. Il se présente comme un espace de découverte et de plaisir, accessible à tous.tes, car chacun.e peut reconnaître les ressemblances et s’amuser des différences entre les spécimens présentés. Il devient ce que Schall appelle un « espace de concernation », qui « [interpelle] les visiteurs et ainsi les [fait] entrer dans les contenus scientifiques et leur [donne] envie de rencontrer ce contenu ». Le musée utilise également des vitrines traversantes, ce qui permet une transition naturelle vers la suite de la visite, puisque les objets du hall sont visibles depuis les couloirs qui l’entourent et réciproquement. Dans la salle menant aux escaliers, d’autres formes de diversité du vivant, de matières, donnent lieu à des dispositifs tactiles.
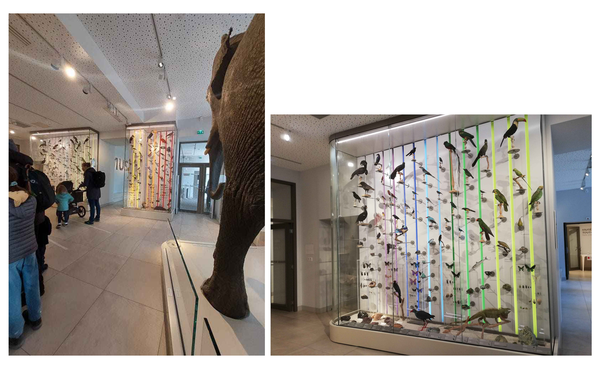
The elephant in the room nous accueille au Muséum de Bordeaux © Barbara Goblot
Le hall d’entrée du musée donne une image aux visiteurs de l’institution toute entière, il établit avec lui un contrat de communication sur lequel il est difficile de revenir. Il installe le public dans un certain état d’esprit : curieux, à l’aise, ou au contraire repoussé, agacé. Il est un espace essentiel de l’expérience muséale. Son rôle n'est pas seulement d'opérer une rupture avec le quotidien et d'inspirer le respect. Il doit également aider à surmonter les barrières qui s’imposent dans ces institutions encore élitistes. La métamorphose en visiteur se fait alors sans violence, avec enthousiasme et apaisement.
Barbara Goblot
Pour aller plus loin :
- L’article de Céline Schall, « De l’espace public au musée. Le seuil comme espace de médiation », Culture & Musées, 2015
- L’articlede Monique Renault, « Seuil du musée, deuil de la ville ? », La Lettre de l’Ocim, 2000
#muséesbordelais #accueilmusées #architecture

Dans les éclats du miroir : les musées au regard du pays des merveilles.
La saison dernière, les musées de Strasbourg consacraient une exposition au chef d’œuvre de Lewis Carroll. Retour sur une exposition qui vous fera, sans hésitation, donner votre langue au chat.
Image d’introduction : L’entrée par la gueule du chat, une œuvre de Monster Chetwynd / Photo : P. Dancin
Surréalice, Musées de la ville de Strasbourg, du 19 novembre 2022 au 26 février 2023
Du 19 novembre 2022 au 26 février 2023, l’eurométropole strasbourgeoise se mettait à l’heure anglaise en associant la programmation de deux de ses musées autour de la figure d’Alice et de son univers merveilleux, nés sous la plume de Lewis Carroll avec deux romans successifs Alice au pays des merveilles (1865) et De l’autre côté du miroir (1871). En écho à ces deux romans répondaient deux expositions croisées : Illustr’Alice au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration et Lewis Carroll et les Surréalistes au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS). Pour ces deux expositions, une même volonté : montrer l’influence d’Alice par-delà les frontières temporelles et géographiques. Jusqu’à présent, les expositions consacrées à Lewis Carroll en France avaient essentiellement eu lieu dans des bibliothèques avec les Images d’Alice, au pays des merveilles à la Bibliothèque des Champs Libres de Rennes (2011) et les Visages d’Alice à la BPI (1983). Ces deux expositions d’envergure s’intéressaient déjà à la postérité de Lewis Carroll. Fruit d’une organisation concertée et centralisée des musées de la ville de Strasbourg, l’exposition Surréalice fait entrer l’œuvre littéraire de Lewis Carroll dans l’univers muséal.
Poétique du fragment, quand 1 est 1000
Le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’illustration, présente la fascination des illustrateurs pour les aventures d’Alice et la longue postérité du personnage. En couvrant un large spectre temporel et géographique, des premières illustrations britanniques aux interprétations récentes et internationales, l’exposition donne à voir le devenir mythe de l’œuvre de Lewis Carroll.
Illustr’Alice est placée sous le signe de la pluralité, que ce soit par le nombre d’œuvres exposées – près de 150 – et leur origine diverse, ou par la multiplicité des angles d’approche. Au seuil de l’exposition, à la fois préambule et conclusion, un premier espace ouvre sur les esquisses de Icinori, les graphistes de l’affiche ainsi que sur plusieurs projets éditoriaux récents à la croisée du livre d’artiste, de l’album et de l’objet d’art. Cet espace préliminaire donne à voir une création toujours bouillonnante et ancre l’influence d’Alice dans le présent des visiteurs. La première séquence permet de recontextualiser Alice au pays des merveilles. Elle présente une sélection des chapitres-phares, et les plus souvent illustrés, afin de brosser à grands traits l’histoire d’Alice. Pour chacun des chapitres, plusieurs artistes sont convoqués. Cette approche comparative introduit le fil rouge de la diversité des interprétations. Elle met aussi en avant une unité : un consensus autour des épisodes à illustrer émerge de la diversité des styles.
La deuxième séquence prend du recul. Il ne s’agit plus d’observer des différences dans les interprétations individuelles d’un même épisode mais de souligner des tendances propres à des aires géo culturelles. Les artistes et leurs œuvres sont rassemblés par origines géographiques. D’un côté les Britanniques et leur lecture satirique, de l’autre les Français attachés à une Alice enfantine, ou encore les artistes d’Europe centrale et leur lecture fantastique, voire absurde, du personnage. La séquence suivante revient sur les premières illustrations d’Alice avant de laisser cet angle chronologique pour se tourner vers le thème de l’humour et de la satire. La franchise de la jeune fille face à l’absurdité fait d’elle un support satirique pour les dessinateurs de presse. Enfin, la dernière séquence, monographique, présente la série de gravures réalisées par le dessinateur Barry Moser en 1982. Le choix de la technique le place dans la lignée directe des premiers illustrateurs d’Alice au pays des merveilles présentés plus haut dans l’exposition.
La diversité des approches n’est pas signe d’incohérence, quoique le fil directeur disparaisse quelque fois au profit d’un collage légèrement confus sur la fin. Les jeux d’échos avec l’annonce, dans la première séquence, d’artistes qui seront exposés dans les séquences suivantes, affirment une certaine logique, par-delà la fragmentation.
Parti-pris de l’exposition, le texte en lui-même est peu présent, à l’exception de la première séquence – bien que cette dernière s’attache davantage à la structure de l’œuvre plutôt qu’à ses mots –, et des quelques extraits cités dans les cartels. L’exposition vise moins à donner une connaissance précise du texte de Lewis Carroll qu’à faire appel au mythe encore vivace dans l’imaginaire collectif. Ce n’est pas un hasard si la première vitrine ouvre sur l’image d’Alice diffusée par Walt Disney. Ce choix dit aussi la volonté de l’institution d’affirmer le statut d’œuvre originale des illustrations, souvent minorées de par leur subordination à une œuvre première. De fait, la scénographie épurée, façon white cube, reprend les codes de l’art contemporain. Les cimaises semblables à de grandes pages blanches, feraient passer les illustrations, à s’y méprendre, pour des créations ex nihilo déliées de l’œuvre littéraire.
L’exposition donne une vision kaléidoscopique d’une œuvre dont les illustrateurs eux-mêmes ne montrent jamais que des fragments. Les romans de Lewis Carroll apparaissent, ainsi, en filigrane, par les interstices laissés entre la centaine d’œuvres exposées. La discrétion du discours scientifique – les textes de salles comme les cartels restent succincts – laisse toute la place à l’investissement des visiteurs, invités à leur tour, à habiter ce texte ouvert1.
Poétique de diffraction
L’exposition du MAMCS resserre le champ temporel pour présenter la réception de l’œuvre de Lewis Carroll par un mouvement artistique spécifique : le surréalisme. A l’inverse, elle élargit le spectre à l’ensemble de l’œuvre littéraire et poétique de Lewis Carroll, bien qu’Alice reste la référence majeure.
Partant du constat de la fascination des surréalistes pour Lewis Carroll, l’exposition interroge les raisons de cette inscription au panthéon des maîtres. La première séquence ancre la réflexion dans les textes théoriques des surréalistes. Elles donnent à voir des éditions du Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) de Breton et Éluard, des revues telles que Le Minotaureou les traductions de Henri Parisot illustrées par Max Ernst : autant de textes qui, par leur analyse de l’œuvre de Carroll, ont contribué à sa reconnaissance et à sa postérité. Les quatre séquences suivantes sont une plongée dans le raisonnement des surréalistes. Thématiques, elles mettent en regard une notion présente dans l’œuvre de Lewis Carroll et sa mise en œuvre dans les tableaux surréalistes. In fine, peu d’artistes exposés ont revendiqué l’influence directe de Lewis Carroll, si bien que la mise en relation reste parfois un peu théorique et que l’accumulation d’œuvres perd Lewis Carroll de vue au profit des seuls surréalistes. L’exposition construit son propos autour de trois thèmes, trois comme dans les contes : le merveilleux, le corps imprévu et l’absurde.
Le discours de l’exposition est porté par une scénographie audacieuse qui opère un vrai travail de transposition spatiale de l’univers de Lewis Carroll. L’entrée monumentale mène le visiteur tout droit dans la gueule du chat de Cheshire. Avec son pouvoir de disparition et d’apparition partielle, ce personnage emblématique est le maître des seuils. Cette œuvre de l’artiste Monster Chetwynd place l’exposition sous le signe du collage, du fantastique et de la disproportion autant que de l’humour. Les deux salles suivantes poursuivent sur la même veine avec une caverne-tunnel artificiellement prolongée par des miroirs qui reproduit la chute infinie d’Alice. Les parois saillantes ainsi que le motif de grille d’échiquier au sol participent à cette illusion de profondeur. Mythe de la caverne inversé, la salle relativement obscure propose de retrouver un peu de naïveté et l’incrédulité nécessaire au travail de la fiction. Seul bémol, l’éclairage insuffisant sur les textes de salle, parfois denses, en rend la lecture fastidieuse.
Passé de l’autre côté du tunnel, le visiteur revient avec son regard neuf, au point de départ des aventures d’Alice : au pied de l’arbre. Avec sa structure circulaire, il dessine un espace concentrique régi par une logique d’imbrication plutôt que de linéarité. Pour cet espace consacré au merveilleux et notamment au rêve, thème cher aux surréalistes et à Lewis Carroll, le visiteur découvre un espace parcouru d’échos, de résonances, de forces centrifuges et centripètes.

Au pied de l’arbre, dynamiques circulaires / Photo : P. Dancin![]()
Le rêve travaille par condensation et déplacement pour reprendre les termes de Freud. Le feuillage de l’arbre est remplacé par un textile où sont reproduites, entre continuité et discontinuité, plusieurs toiles de Magritte. Plusieurs séries sont exposées comme l’ensemble de 12 héliographies Alice’s adventures in Wonderland (1969) de Dalí ou quelques-uns des 34 frottages rassemblés sous le titre Histoire naturelle (1926) de Ernst, ou encore une sélection de 26 planches entomologiques (1860) d’Henri Buchecker. Pour souligner le goût partagé de Lewis Carroll et des surréalistes pour les sciences naturelles, et l’interdisciplinarité de leurs créations, les collections empruntées au Musée zoologique de Strasbourg se mêlent aux œuvres d’art. Plusieurs spécimens empaillés sont mis en regard de la série de Max Ernst et accompagnés d’extraits d’Alice au pays des merveilles. Les catégories disparaissent au profit d’un rassemblement d’éléments hétérogènes. Cette attention portée à la présence du corps animal dans l’œuvre de Carroll et sa personnification annonce le thème du corps imprévu.

Effets sériels avec les planches entomologiques de Henri Buchecker / Photo : P. Dancin
La séquence suivante s’attache à la plasticité du corps. Si Alice subit les transformations de son corps plus qu'elle ne les choisit, elle apprend petit à petit à les maîtriser. La séquence aborde d’abord la réification du corps féminin, omniprésente dans les œuvres surréalistes, et notamment son assimilation à la poupée avec l’œuvre de Hans Bellmer. Mais elle ne s'y cantonne pas. Murs rouges, miroirs et fauteuils transforment la pièce en antichambre de la Reine Rouge, ce personnage qui manifeste son emprise sur le corps de ses sujets, en faisant planer sur leur tête la menace de décapitation. Plus que montrer l’assujettissement du corps féminin aux désirs masculins, la séquence ouvre sur son émancipation. Une place importante est donnée aux artistes féminines telles que Claude Cahun, Meret Oppenheim, Toyen, Jane Graverol qui ont utilisé l’intimité du corps pour transgresser les codes et les normes établis. Le corps se donne à voir sous toutes ses coutures et tous les médiums, de la peinture à la photographie en passant par les poèmes de Gisèle Prassinos lus par Guendoline Hénot que le visiteur peut écouter.

L’antichambre de la Reine Rouge, le corps entre pouvoir et intimité / Photo : P. Dancin![]()
Entre rupture et continuité, la salle suivante, avec ses murs verts marqués des enseignes des cartes à jouer, contraste fortement avec le rouge de la salle précédente et annonce le thème du jeu. Le visiteur quitte les appartements de la reine pour le terrain de croquet. La salle poursuit le thème du corps avec la métamorphose et le miroir déformant. Moins spectaculaire et plus évasive, la scénographie s’épuise un petit peu. Les références parfois très succinctes à Alice et l’étendue des thèmes abordés diluent la référence à Lewis Carroll sous une profusion d’œuvres.
Un grand miroir fragmenté accompagne la traversée du visiteur vers la dernière séquence dédiée à l'absurde et au nonsense. Elle met en avant le goût des surréalistes pour la langue, manifeste dans les titres comme à l’intérieur des œuvres. Pirouette finale, l’exposition revient aux mots par l’intermédiaire d’œuvres qui les donnent autant à lire qu’à voir, explorant leur nature graphique et signifiante. Ainsi, elle présente la couverture-objet Esquissons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis(1968), ou Le Poichat qui navole (1964) de Victor Brauner. Plus largement, la séquence développe le thème du jeu, de sa mise en scène à l’intérieur des œuvres à son investissement comme médium artistique. Quoique spectaculaire, le grand ciel bleu ponctué de nuages est moins directement signifiant, bien qu’on puisse percevoir la référence à Magritte, figure tutélaire de l’exposition.

Une exposition sous la figure tutélaire de Magritte / Photo : P. Dancin
L’exposition s’est ouverte par une salle obscure au sol-échiquier, elle se clôt sur L’Échiquier surréaliste (1934) de Man Ray, plongé lui aussi dans la pénombre. Il est temps de quitter le rêve pour revenir à la réalité. Le photomontage fragmenté et composite de vingt portraits de surréalistes s’inscrit dans une grille, cette unité close mais potentiellement extensible à l’infini. Ouverture et fermeture, unité et pluralité, l’exposition Lewis Carroll et les surréalistes donne à expérimenter la tension entre une œuvre finie et son influence infinie, plus ou moins explicite et revendiquée. En donnant à comprendre et expérimenter un univers pluriel et merveilleux, elle invite le visiteur à s’approprier l’œuvre de Lewis Carroll et à prolonger la grille de ses héritiers.

Ouverture et fermeture, le retour de l’échiquier avecL’Échiquier des surréalistes de Man Ray / Photo : P. Dancin![]()
Au fil des mots, le littéraire fait lien
Où est le début ? Où est la fin ? Si Alice a le pouvoir de surplomber et déborder les frontières temporelles et géographiques, elle a aussi celui de pousser les murs. Géante, elle enjambe la ville pour réunir les deux musées. Minuscule, elle entraîne l’agitation au cœur même du musée, prolonge l’exposition Lewis Carroll et les Surréalistes au-delà d’elle-même, infiltre les salles alentours et bouleverse l’ordre établi. A la suite de l’exposition, le MAMCS présente un nouvel accrochage des collections nommé D’Absurde à Zibou. Des citations empruntées au Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) sont mises en regard d’une sélection d’œuvres diverses dans leur forme et leur temporalité, de la toile La Fille à l’arrosoir (2010) de Françoise Pétrovitch à l’affiche His Majesty(1897) de Dudley Hardy jusqu’à la sculpture Développer sa propre peau (1970) de Guiseppe Penone. Peu orthodoxe, le Dictionnairese présente comme un collage de citations tant théoriques que littéraires, écrites par les surréalistes et leurs maîtres. Ces dernières sont associées à quelques œuvres des surréalistes. L’exposition propose une transposition du Dictionnaire abrégé : les rencontres hétéroclites d’œuvres adaptent la poétique régissant le Dictionnaire aux collections d’art moderne et contemporain du MAMCS. La reproduction des lettrines, dans la même typographie que celle de l’ouvrage, étend l’espace de la page aux dimensions des cimaises. La scénographie sage et épurée, type white cube, rappelle l’uniformité des pages de dictionnaire. Pourtant, la régularité de la mise en espace avec la lettrine surplombant une à trois citations, le tout aligné dans une même colonne soulignée par l’éclairage vertical, contraste avec l’éclectisme des rencontres et le met en valeur. La lettre fait repère. Plus, elle est un point de ralliement entre des œuvres d’univers mental et géographique différents. Bouleversant l’habituel accrochage chronologique sans pour autant s’assimiler à une organisation thématique, la forme fragmentée du dictionnaire donne à voir une nouvelle lecture de l’histoire de l’art, non plus linéaire mais poreuse.

La lettre comme trait d’union,D’Absurde à Zibou au MAMCS / Photo : P. Dancin![]()
Le bouleversement poursuit sa route à l’étage, avec le dispositif ExpériMAMCS #3 Dans les rêves d’Alice… un espace expérimental et créatif en partie dédié aux familles.
Un espace préliminaire prépare le visiteur à plonger dans l’univers d’Alice avec La Chambre d’Ame, une illusion d’optique reposant sur une perspective truquée. Le dispositif joue avec la perception du visiteur. Voyeur, il observe, par le trou de serrure, ses acolytes subir les mêmes déformations que la jeune fille : grandir et rapetisser. Son regard déséduqué, le visiteur est prêt à commencer son voyage initiatique dans le pays des merveilles. Le premier espace, antichambre de la création, obscure et théâtrale, est dédié au langage poétique et à la liberté lexicale des habitants que croise Alice. Différents jeux de langue sont mis à disposition. La seconde station invite le visiteur à peupler le pays en maniant le crayon de couleur. Le dernier espace se présente comme un terrain de jeux où les maillets côtoient un jeu de l’oie.

Changer son regard, l’illusion de la Chambre d’Ame, ExpériMAMCS#3 / Photo : P. Dancin![]()
Les deux dernières séquences s’ancrent dans deux épisodes du roman : la mare aux larmes et le terrain de croquet de la Reine Rouge. La scénographie immersive donne à voir et à ressentir ces différents lieux par le travail des couleurs, des matières et des surfaces, par la sonorisation discrète de la mare où se fait entendre le bruissement des insectes, et surtout par les illustrations d’Amandine Laprun. Conçu en collaboration avec l’illustratrice, cet espace féerique aux allures d’album jeunesse transforme l’imaginaire d’une artiste contemporaine en porte d’entrée dans la fiction. Œuvre spatiale qui mobilise les corps, œuvre ouverte qui en appelle à créativité des visiteurs, le dispositif favorise la porosité des imaginaires.

Le terrain de croquet de la Reine selon l’illustratrice Amandine Laprun, ExpériMAMCS#3 / Photo : P. Dancin![]()
« Voyons un peu : 4 x 5 font 12 »… et 5 x 1 font 1
Illusion d’optique ou déformation arithmétique, Surréalice rassemble sous un même titre cinq expositions : trois au MAMCS, une au Musée Tomi Ungerer et une à la médiathèque André Malraux. Indépendantes, les expositions se visitent librement, sans ordre préétabli. Mais, l’autonomie ne signifie pas séparation. La réunion des institutions autour d’une programmation commune n’est pas artificielle, elle ne se limite pas au partage d’une même thématique. Entre unité commune et singularités individuelles, les institutions se réunissent autour du même angle, celui de la réception et l’adaptent à la particularité de leurs collections.
Mais le lien se fait aussi par la prise en compte de la réception des visiteurs. Des échos discrets dessinent des ponts entre les expositions, créent des espaces de porosité dans l’expérience de visite. Les illustrations sexualisées d’Alice par Antoine Bernhart leur rappelleront peut-être la séquence dédiée au corps transgressif au MAMCS, tandis que le wall-paperreproduisant l’Alice à la Neige de Roland Topor dans les derniers mètres de l’exposition ne manquera pas d’évoquer les croquis préparatoires de l’artiste présentés au Musée Tomi Ungerer, tout comme l’espace ExpériMAMCS#3 s’inscrit dans la continuation d’Illustr’Alice. Ces liens – non explicités – évitent tout effet d’exclusion et suscitent des effets de reconnaissance voire d’étrange étrangetéchez les visiteurs découvrant un deuxième volet de Surréalice. Une des réussites de cette programmation repose bien dans la finesse de ce jeu d’échos, de coïncidences, de rencontres qui mobilise la mémoire des visiteurs et dessine dans leur inconscient un espace ouvert et fluide. Discrètement, elle donne à vivre ce que Lewis Carroll donne à lire dans ces deux romans.
Ainsi, plus que la somme de ces cinq expositions, Surréalice englobe tout l’espace interstitiel, laissé ouvert aux cheminements des visiteurs. Si l’exposition dans son ensemble présente la diversité des réceptions d’une même œuvre, elle trouve avec ces cinq expositions autonomes mais néanmoins reliées, la forme juste pour porter ses intentions.
Pauline Dancin
1Umberto Eco, Lector in fabula, 1985
Lewis Carroll et les surréalistes, MAMCS
Commissariat : Barbara Forest conservatrice en chef du patrimoine et Fabrice Flahutez spécialiste du surréalisme.
Scénographie : Martin Michel
Identité visuelle : Tandem, Costanza Matteucci et Caroline Pauchant
Illustr’Alice, Musée Tomi Ungerer
Commissariat : Thérèse Willer, conservatrice en chef honoraire
Pour en savoir plus :
- Catalogue : Fabrice Flahutez, Barbara Forest, Thérèse Willer (dir.), Surréalice, Musées de Strasbourg, 2022
- Vidéos de présentation des expositions par leurs commissaires
L'article est aussi disponible sur le site Littératures modes d'emploi : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/surrealice-musees-de-strasbourg/
#Alice au pays des merveilles #Surréalice #Lewis Carroll

Déambuler dans les marges, et oublier Ronsard : le prieuré saint Cosme
Contre la fatigue muséale, pourquoi ne pas prendre le temps de déambuler dans les jardins ?
Overdose muséale… et littéraire
Travaillant dans un musée depuis plusieurs mois, j’ai parfois l’impression de manger musée, dormir musée, lire musée. Chaque weekend, je ressens davantage une fatigue muséale, qui retire une partie du plaisir de la découverte de nouveaux lieux : comment apprécier la visite de centres d’interprétation, musées et autres sites patrimoniaux, quand toute déambulation se mue en observation fine des vitrines, cartels, degré d’accessibilité des textes ? La tête remplie de tous ces critères d’évaluation, comment apprécier « simplement » la visite ?
Lorsque, à l’occasion d’une sortie entre amis, ces derniers proposent de quitter la ville de Tours pour visiter le Prieuré Saint-Cosme à La Riche, petite commune des alentours, j’appréhende. Je n’ai cette fois aucune envie de lire des textes, or nous allons vers une maison d’écrivain, la demeure de Ronsard…
J’imagine alors un vieux bâtiment religieux, remis au goût du jour alternant vieilles pierres et espaces d’interprétation un peu daté, saturé de textes, des guirlandes de poèmes envahissant les murs. J’imagine un personnage grisonnant accompagnant la visite, ponctuant les murs de citations pseudo-inspirantes. J’imagine des roses tapissant les murs, mon seul souvenir de l’écrivain étant ces vers issus des Sonnets pour Hélène(1578) croisés pendant mes études : « […] Vous serez au foyer une vieille accroupie // Regrettant mon amour et votre fier dédain. / Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : / Cueillez des aujourd’hui les roses de la vie ». Me revient en mémoire alors l’indignation ressentie devant ces vers empreints de sexisme, le poète affirmant que la femme qu’il courtise ferait mieux de s’abandonner à lui dans sa jeunesse, car elle sera bientôt vieille, et donc selon lui fatalement laide et non désirable, regrettant l’attraction dont elle faisait jadis l’objet. Comme si la beauté de cette femme se résumait à sa jeunesse, comme si une femme était un consommable doté d’une date de péremption.
Avec la plus grande méfiance, et persuadée de détester cette visite, j’entre dans le prieuré.
Pour, finalement, me laisser surprendre.
Entrer…
L’hôte d’accueil nous propose dès l’entrée un jeu de piste pour accompagner notre découverte des lieux. Sur une planche, un classeur de quelques fiches successives nous invitent à deviner l’emplacement d’« indices ». Disséminés dans le parc et les bâtiments, ces indices gravés nous révèlent chacun un mot, à reporter sur la planche pour deviner les mots manquants d’un poème. La visite jouée nous est proposée spontanément, et ne semble pas destinée à un public enfant. Tout au long de la visite, nous chercherons donc ces indices, ce qui ravivera régulièrement notre intérêt.
L'aménagement du prieuré est assez récent : d'importantes fouilles archéologiques ont été menées entre 2009 et 2012, permettant de mettre au jour des bâtiments inconnus auparavant, comme l'église construite aux alentours de l'an Mil. Le site a pu rouvrir en 2015 avec un nouveau parcours de visite, qui comprend des salles d'interprétations, dont la réalisation scénographique a été confiée à In Site, mais également une succession de jardins mêlant inspirations médiévales et contemporaines, aménagés par Bruno Marmiroli, architecte et paysagiste.
En quittant l’accueil, une grande salle nous fait ainsi découvrir l’histoire du site, qui était autrefois une île de la Loire, et les découvertes archéologiques dont il a fait l’objet, notamment les tombes des moines ayant fréquentés le prieuré. Les objets sont peu nombreux et présentés très sobrement, en vitrine, et comme posés sur une sorte de sable noir. L’essentiel de la pièce est consacré à un dispositif numérique (réalisé par MG Design et 100 millions de pixels) : une reconstitution 3D du prieuré, qui permet d’en comprendre l’évolution sur plusieurs siècles, ainsi que la fonction des différents espaces que nous nous apprêtons à visiter (ou non, car tout n’a pas été restauré). Si cet effet 3D semble un peu daté malgré sa réalisation récente, les technologies de modélisation 3D évoluant souvent plus rapidement que le temps nécessaire à la réalisation d'un parcours muséal, la présentation est claire et la manipulation intuitive. Elle l’est d’autant plus que, même si une seule personne manipule la tablette, le contenu de l’écran est repartagé sur le mur du fond par une projection. Les autres personnes se trouvant au même moment dans la salle peuvent donc en profiter sans nécessairement attendre leur tour.

Vue du dispositif. (Photo : SN)
Déambuler
En sortant de cette salle, nous arrivons dans le parc. La signalétique, discrète, indique sobrement les différents bâtiments, sans qu’un ordre clair nous enjoigne à partir dans une direction précise.
Le temps est doux, il a plu les derniers jours et l’herbe est grasse autour de nous. Nous avançons, des hamacs se balancent entre les arbres et nous invitent. Nous nous y installons quelques minutes, avant de reprendre notre déambulation.

Vue des jardins. (Photo : SN)
Des bornes présentant des poèmes de Ronsard sont disséminées dans le parc, sans que nous nous sentions obligés de les lire. Nous avons simplement lu en arrivant que Ronsard avait été prieur dans ce lieu. A la direction du Prieuré Saint-Cosme, il s’est occupé de ses jardins et de sa rénovation pendant quelques années, tout en restant aumônier pour le roi Charles IX. Nous ne nous sentons pas obligés d’aller plus loin dans la compréhension de son œuvre, en revanche nous apprécions de pouvoir lire le paysage et comprendre l’esprit qui a guidé ses écrits et accompagné les dernières années de sa vie.
Les jardins odorants et colorés sont à la fois utilitaires (verger, potager, plantes médicinales) et « profanes » (jardin des parfums, espace dédié aux roses…), comme ils l’étaient de son vivant. La végétation ponctue notre visite, nous incitant aux pauses régulières.
L’espace se comprend de façon intuitive : certains espaces sont restaurés ou reconstruits, d’autres simplement suggérés. Une construction en bois symbolise l’ancien plan de l’église, dont il ne reste que les vestiges du chœur, au sein desquels fut inhumé Ronsard. Découverte au XXe siècle lors de fouilles, sa dépouille y a été réinhumée après identification. Nous nous arrêtons quelques instants devant sa tombe gravée d'une épitaphe qu'il avait lui-même choisie. Nous longeons le jardin du cloître jusqu’au miroir d’eau, censé évoquer les ablutions rituelles liés aux rites de purifications.

Vue des jardins, avec les vestiges de l’église et le plan d’eau. (Photos : SN)
Contempler
Après cette pause printanière, nous entrons dans le réfectoire. Cet espace est régulièrement occupé par des expositions temporaires, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le lieu est vide, et en même temps, il semble rempli d’une présence. Des couleurs inhabituelles se projettent sur le sol et les murs. En levant la tête, les vitraux ressemblent davantage à des glaces peintes, mais peintes à l’encre de Chine. En 2010, Zao Wou Ki a ainsi installé 14 vitraux dans cet espace. Les formes esquissées sur les vitraux sont discrètes, et laissent apparaitre en transparence les arbres, des morceaux de ciel et les murs extérieurs du réfectoire.

Vitraux de Zao Wou-Ki pour le réfectoire. (Photos : SN)
En ressortant, nous croisons une forme étrange plantée dans l’herbe. Nous l’avons déjà vu à deux reprises dans le parc, sans l'identifier. Le livret de visite nous indique son utilité : il s’agit d’une installation de Bruno Salay, intitulée Contemplations.Constituée de sept assises réparties dans le parc, cette œuvre propose d’expérimenter le paysage. A la façon des plantes, qui poussent différemment en fonction de l’endroit où elles ont été plantées, Bruno Salay nous propose d’expérimenter ce que produit sur nous et en nous le fait d’être « ici et maintenant ». Face à cette brise, à l’ombre de cet arbre, ou en plein soleil au milieu des pierres, qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce que je sens, qu’est-ce que je ressens différemment ? L’emplacement des assises est régulièrement modifié par les jardiniers, qui les sélectionnent avec soin au fil des saisons. Un QR code nous renvoie à une consigne sonore : « S’assoir. Regarder avec soin autour de soi. Mémoriser autant que possible les végétaux, les matières, les éléments architecturaux. Le temps nécessaire. Procéder lentement, avec un esprit paisible. »

Contemplations, Bruno Salay. (Photo : SN)
Créer à quatre mains
Le corps et l’esprit reposés, j’accepte finalement de bonne grâce d’entrer dans l’exposition littéraire située dans la cuisine du prieuré. La muséographie est minimaliste et très rudimentaire : quelques panneaux de textes, des vitrines alignées, des numéros renvoyant à des cartels groupés. Nous regrettons ce jeu de renvois par numérotation, mais apprécions les ouvrages qui y sont présentés : il s’agit de la collection de livres pauvres du prieuré : des feuilles pliées en quatre, sur lesquelles se déploient la collaboration d’un poète et d’un artiste plastique. Ces créations réduisent le plus possible le nombre d’intermédiaires classiques en évitant les imprimeurs, graveurs, ou relieurs. Chaque feuille est différente, métamorphosées par ces créations à quatre mains, qui réduisent parfois le papier à ses plis.
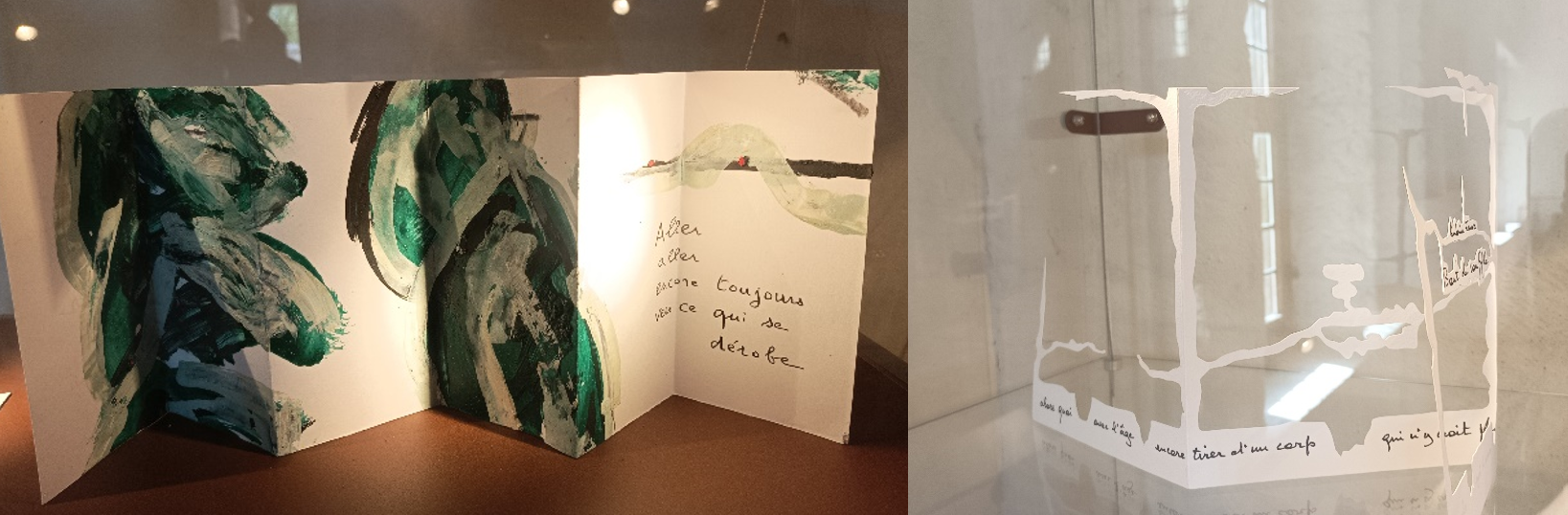
Livres pauvres de la collection du Prieuré. (Photos : SN)
Loin de se consacrer uniquement à Ronsard, le Prieuré donne ainsi à lire et à regarder quelques-uns de ses 2500, livres pauvres en éditions limitées réalisés par des auteurs et plasticiens tels que Daniel Leuwers, Michel Butor, Andrée Chedid, Annie Ernaux, Pierre Alechinsky, Michel Nedjar, Vladimir Velickovic… Et ici la littérature se fait discrète, modeste, qu’elle ponctue les jardins de quelques vers ou s’expose entre deux traits d’encre.
Elle m’envahit moins que ce que je craignais, elle ne me fait pas peur et se laisse aborder plus simplement. L’espace du Prieuré est lui-même poésie : tout comme l’espace laissé blanc est essentiel dans cet art, les espaces liminaires de la demeure sont tout autant travaillés que ceux qui exposent véritablement des contenus scientifiques, historiques ou littéraires. La place est faite au corps comme à l’esprit, par le recueillement, la déambulation, le rien qui n’est pas « rien ». Elle nous incite à regarder ce rien et y voir quelque chose.
Et pour Ronsard, on verra plus tard ?
Nous quittons les lieux un peu précipitamment. A tant errer dans les jardins, il est déjà un peu tard pour visiter le logis, lieu d’exposition des éditions originales de Ronsard, de reconstitutions de son espace de travail. Nous y passons rapidement, en se promettant de revenir les explorer davantage.
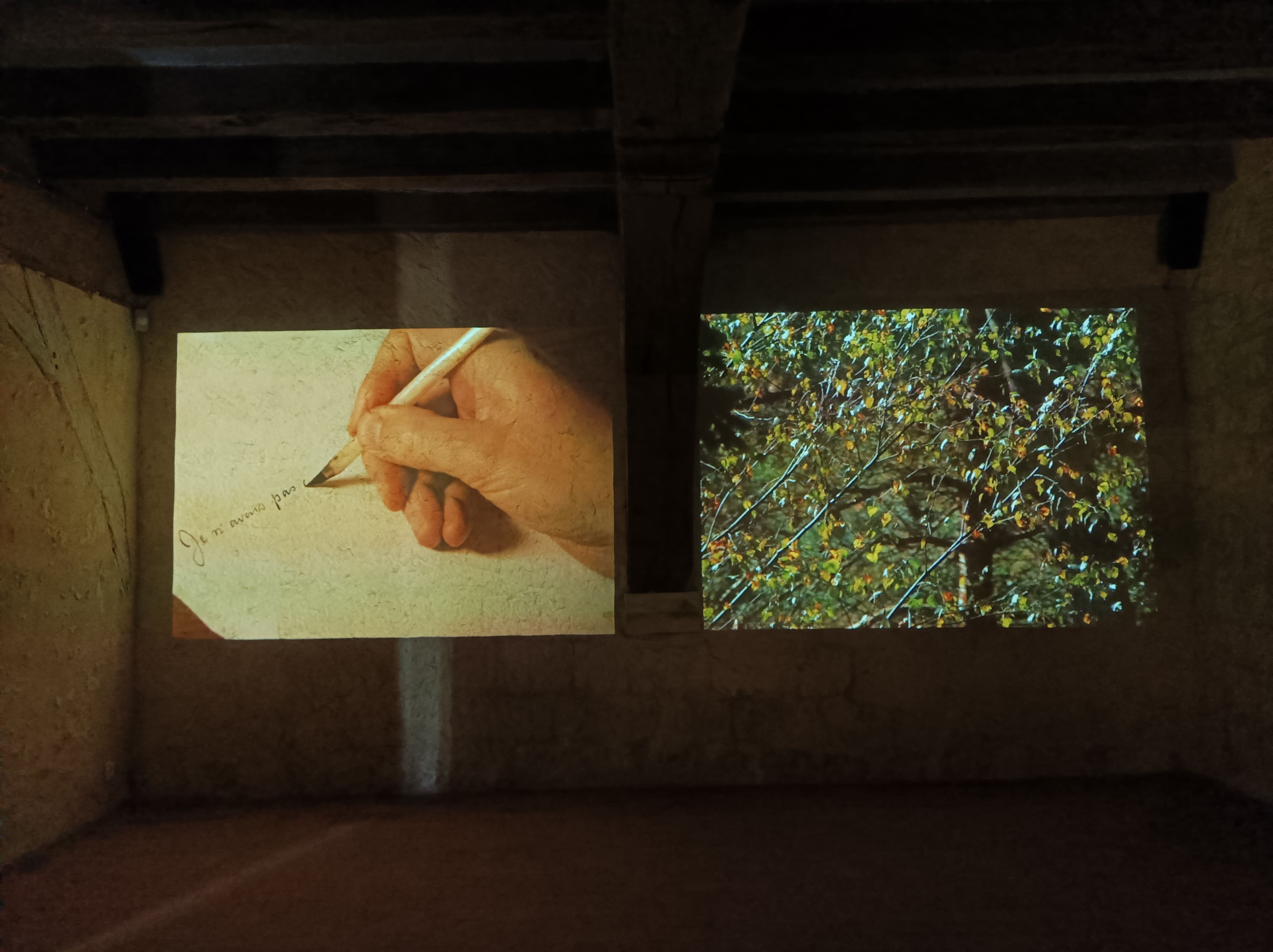
Film de présentation de la vie de Ronsard, réalisation : Compagnie Stasimon. (Photo : SN)
Je suspens pour l’instant mon jugement sur Ronsard. Je n’en connais finalement que des bribes, et si j’ai parcouru des murs qui lui sont consacrés, ce n’est finalement pas tant son œuvre que je retiens de ma visite mais davantage l’esprit du lieu, sa présentation tout en simplicité, et l’accueil fait au visiteur dans son entièreté, prêtant la même attention à son esprit, son corps et ses sens.
Sibylle Neveu
Pour en savoir plus :
- https://www.prieure-ronsard.fr/
- FlorenceCaillet-Baraniak, « Médiation numérique un site archéologique : à la rencontre entre réalité et virtualité », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 172 | 2017, mis en ligne le 01 juillet 2018, consulté le 13 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/ocim/1811 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ocim.1811
- Vincent Guidault, « Le renouveau des jardins du Prieuré Saint-Cosme : Demeure de Ronsard », Jardins de France.org[en ligne], consulté le 13 juin 2023. URL : https://www.jardinsdefrance.org/le-renouveau-des-jardins-du-prieure-saint-cosme-demeure-de-ronsard/
#ronsard #prieuré #jardins
Découverte du musée du Folklore de Tournai par le biais d'une visite atypique à but créatif
Cet article a été rédigé à la suite de ma première visite de cette institution municipale, à l’occasion de l’opération Musées(em)portables, concours de film courts organisé par le SITEM. Dans ce cadre 3 étudiantes du MEM sont responsables du jumelage entre le Musée du Folklore de Tournai (lieu de tournage) et les étudiants de l’HELHa qui créent leur film sur place. Simple accompagnatrice de mes camarades, je n’ai été qu’observatrice des interactions et de la découverte des lieux par les septante étudiants (présence en territoire belge oblige je ne dirai pas soixante-dix par respect de la culture wallone).
Devant l'entrée du Musée du Folkore après avoir sonné la cloche © J. D.
Installé dans une maison tournaisienne derrière la Grand’Place, les collections du musée sont abritées derrière des façades datant du XVII et épargnées par les bombardements. Après que l’on ait fait sonner la cloche de la porte d’entrée, Jacky Legge responsable du lieu depuis septembre nous accueil. Il est une personnalité phare de la vie culturelle de Tournai puisqu’il est aussi coordinateur de la maison de Culture, et chargé de cours auprès des étudiants participants.
Crée en 1930 sous la direction du conservateur Walter Rivez, le Musée du folklore de Tournai en Belgique fut novateur notamment par la récolte importante des dons de la populations, pratique muséale que l’on retrouve aujourd’hui dans des institutions de plus grande échelle tel que le Musée national de l’Histoire de l’Immigration1.
Toutefois comme le concède le nouveau responsable des lieux à ses étudiants, l’ensemble est resté dans son jus. En parcourant les 23 pièces du musée nous découvrons effectivement dioramas, vitrines et maquettes qui évoque la vie quotidienne la région tournaisienne entre 1800 et 1950 aussi bien par les expôts que par-là scénographie.
Ce retour dans le temps c’est aussi bien la force et la faiblesse de ce musée (au point que cela en ferait presque un cas d’école). Les effets en sont donc multiples pour l’expérience du visiteur dépendant bien évidemment de son profil. La visite gratuite est un point fort car elle permet une visite plus « légère » sans pression de rentabilité du temps passé sur place. De même en cassant la barrière financière on révèle davantage les autres barrières d’entrées au musée. De par son sujet non élitiste, le musée du folklore de Tournai n’est certes pas concerné par l’inconfort que certains groupes qualifiés tantôt de « public empêché », « champ social » voir « non public » peuvent ressentir dans des lieux de culture dite légitime. Au contraire ces individus peuvent prendre goût à leur visite par le caractère authentique des lieux des artefacts présentés. D’autant plus s’ils reconnaissent des objets, décors, particulièrement si le groupe de visite est intergénérationnel. L’ancrage territorial du musée, ainsi que sa longévité renforce ce type de visite. En effet aux mémoires préservés dans les lieux par les collections s’ajoutent celles des visiteurs qui venaient enfants avec leurs parents, aujourd’hui adultes ils peuvent prendre plaisir à retrouver les liens tel qu’ils les ont connus et, évoquer leurs souvenirs de visite.
D’un autre coté si le groupe ne possède pas les codes de référence des époques traités, on pense aux jeunes non accompagnés par leurs familles ou enseignants, le ressenti est tout autre. C’est d’ailleurs ce que j’ai pu observer lors de cette visite, certes dans un cadre scolaire mais dont le but était la production d’un contenu créatif s’inspirant des lieux, collections, sujets. Aussi a aucun moment il n’y a eu à l’intérieur du musée de transmission traditionnel délivré par un « savant » à un « non-initié ». La classe s’est de suite dispersée, à la recherche d’un point de départ d’une fiction. Ils n’ont pas été déçu par l’image du musée figé et des éléments de mise en scène « un peu flippant »2 (voir les photos ci-dessous) car pour eux c’était la matière nécessaire à leur créativité.
Ce sont souvent les mannequins et poupées qui sont perçues de manière négatives par nos jeunes visiteurs.
Sentiments que nous étudiantes du MEM partageons. © J. D.
Aussi plus qu’au statut et au contexte d’utilisation des objets, c’était l’effet du visuel qui était recherché au prime abord par ces étudiants. Jacky Legge s’est d’ailleurs étonné qu’ils ne soient pas venus demander de renseignements complémentaires sur les objets alors qu’il avait spécifié qu’il était disponible et volontaire à ce sujet. Ce constat n’est pas pour autant négatif, il montre juste que leurs imaginations n’ont pas besoin (pour la plupart) d’être nourries par des faits scientifiques sur les sujets filmés. Il est fort probable qu’ils reviennent par la suite, lors du développement de scénario demander le contexte d’utilisation d’un objet particulier par exemple. Cette visite alternative en groupe peut aussi susciter la même curiosité qu’un visiteur individuel peut avoir, c’est à dire qu’il choisit l’objet qu’il souhaite approfondir en termes de connaissance.
Cependant le musée du Folklore de Tournai étant très chargé malgré ses 1000m2, la documentation n’est pas toujours accessible librement, aussi c’est souvent une personne physique qui est dans la capacité de renseigner le visiteur. C’est par ailleurs une chose que le personnel permanant (trois personnes au total sur place) réalise d’une manière remarquable. Sylvain passionné par son lieu de travail et les mémoires qu’ils conservent, n’a pas hésité à me faire une visite spontanée. Agissant comme un médiateur volant qui s’ignore. Les actions envers le public m’ont semblé du même acabit. Simples, tout en étant efficaces et sensibles, ici les défauts sont tellement flagrants, les actions de renouvellement de l’exposition tellement faites « mains » que l’on ait touché par ce nouveau souffle apporté au musée…
© J. D.
 C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
Par ailleurs comme on peut le voir sur le cliché ci-haut cette intervention de l’artiste est signalée par un fil rouge noué. Il s’agit d’une table d’accouchement liée à une photo en noir et blanc d’une toile d’araignée (Bénédicte Hélin). Ce rapprochement permet de nombreuses interprétations : le fil serait cité comme une allusion au cordon ombilical. A cette association s’ajoute le texte « Si j’étais un fil je serai un filou philanthrope et je donnerai du fil à retordre » de Eric qui peut entrer en résonnance avec l’ensemble, si l’on pense par exemple qu’un accouchement peut donner du fil à retordre à la femme allongée sur la table ainsi qu’au gynécologue. Suivre cette idée conduit à des questionnements sur le contexte d’utilisation de l’objet valorisé, « A quel point cette table d’accouchement a-t-elle été bénéfique en terme pratique ? Est-ce que cela a été une révolution dans les arts obstétriques ? Est-ce que cela a permis de minimiser les risques ? ».
La liberté et surtout la présence du travail d’un artiste de manière temporaire dans un musée de société tel que le musée du Folklore de Tournai est à saluer. Ce sont des initiatives de ce genre que Jacky Legge peut poursuivre de manière plus fréquente, qu’à l’occasion de la programmation culturelle de la ville, dont le festival d’art contemporain l’Art dans la Ville3 (3ème édition en 2017) utilise le même principe de disposition d’œuvres en complicité avec des éléments, de l’espace urbain, de commerces et d’équipement culturels. Cette année, en octobre c’était Nicolas Verdoncq et sa proposition nommée L’île Noire qui s’est prêté au jeu au sein d’un musée du Folklore.
On peut imaginer que la participation du Musée du Folklore au projet Musées(em) portables grâce au jumelage avec les septante étudiants de l’HelHa pourra être valorisée tout en éclairant les collections grâce à la projection des films in situ.
Julie D.
#muséedufolklore
#tournai
#musées(em)portables
#HELHa
_________________________________________________________________________
1 Voir la galerie des dons du musée2 Citation de plusieurs élèves qui ont utilisé des objets dans leurs films pour faire un film reprenant les codes des films d’horreurs.3 https://artville.tournai.be/

Des assassins aux Invalides

L’expérience Assassin’s Creed a été accueillie à trois reprises par le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides. À elles seules, les deux premières éditions (vacances de Toussaint et de Noël 2018) ont réuni plus de 11 000 participants. Il s’agit là d’un jeu immersif basé sur l’univers d’Assassin’s Creed, un des jeux vidéo phares d’Ubisoft. L’agence Cultival, spécialisée dans la médiation culturelle, s’est chargée de l’élaborer à leurs côtés. Par le biais de cet « escape game » à demi-ciel ouvert, les participants découvrent ou redécouvrent le lieu, ayant même accès à des parties habituellement interdites au public au cours du jeu. Celui-ci, après les explications et modalités énoncées, leur laisse 1h30 pour venir à bout de leur mission et ainsi parcourir ces bâtiments historiques en renouvelant leur regard. Seuls ou accompagnés, ils errent guidés par leurs smartphones (un pour deux, maximum), et force est de constater que le collectif est plutôt préféré …
Attendez. Et si on présentait tout ça autrement … ?
Signe distinctif de participant facilitant l’accès à l’Église du Dôme © Emeline Larroudé
« Dans le tombeau de l’aigle,
Caché sous un autre ciel
Sur lequel les anges veillent
Le fruit défendu attend »
L’année 2018 a vu renaître un conflit historique : celui des descendants d’assassins et de templiers (ou serait-ce les rosicruciens du XXIe siècle ?). Une première vague a vu plus de 11 000 d’entre eux s’affronter, bizarrement un peu avant la Toussaint succédant à la fête des morts … Coïncidence ? De mi-juin à début juillet 2019, ils ont lancé une nouvelle offensive, toujours empreinte de discrétion, à l’ombre de nombreux regards, dans les coulisses de l’Hôtel national des Invalides. Guidés par les astres tant solaires que lunaires, de nuit comme de jour, ils se sont mobilisés pour percer un des secrets les plus énigmatiques de Napoléon 1er : l’emplacement de la Pomme d’Eden. Héritée de la Première Civilisation, on lui prête des pouvoirs inestimables qui auraient, par ailleurs, servis à l’empereur … La détenir reviendrait alors à avoir accès à une puissance incommensurable.
Mais, n’y a-t-il pas là comme un petit problème ? Rien ne vous titille ?

Vues intérieures de l’Eglise du Dôme © Emeline Larroudé
Cette deuxième version est, indéniablement, romancée. Elle mêle fiction et réalité si bien que sa lecture en est floue : comment prendre la mesure de cette porosité ? Qu’est-ce que le lecteur doit vraiment prendre en compte ? C’est peut-être là toute l’ambiguïté de cette expérience. « Enquête très stimulante, mi-historique, mi-fiction », nous dit Le Parisien. J’irai plus loin encore. Trois niveaux de lecture sont possibles : ce qui relève de l’univers Assassin’s Creed créé par Ubisoft ; ce qui relève de l’adaptation de l’univers Assassin’s Creed au lieu et à son histoire ; ce qui relève de l’histoire du lieu. Une fois ce constat établit, comment les distinguer de fait ? L’exercice semble bien ardu. S’il ne paraît pas nécessaire d’avoir déjà parcouru le dit jeu-vidéo pour avoir envie de participer, le faire, et réussir la mission à temps, les amateurs peuvent avoir certaines clés de compréhension supplémentaires qui manqueront aux participants lambda (symboles, univers, … et plus largement ce qui relève de la citation du jeu, notamment AC II ou encore AC Unity). Comment donc cette visite peut-elle alimenter sa culture personnelle lorsque, malgré le bon temps passé et l’attention portée aux différentes énigmes, l’on ne sait pas ce que l’on doit vraiment en retenir ?
Arrêtons-nous sur la devise des Assassins : « Rien n’est vrai, tout est permis ».

Hôtel national des Invalides, et modalités de jeu sur l’application dédiée © Emeline Larroudé
Qui plus est, qui sont ces assassins et templiers des temps modernes ? A l’inverse des institutions culturelles prônant généralement le « tout public » à tel point qu’elles finissent parfois par ne s’adresser à personne, le game design s’attache véritablement à cette question. Il propose alors des projets pertinents qui touchent le public visé, déterminé bien en amont, au lancement. Ici, même si l’expérience est ouverte à tous, il semblerait que le public visé soit plus particulièrement celui des jeunes adultes voire adolescents, adeptes de jeux-vidéos mais pas seulement. Pour résumer, le type de public qui se fait rare dans ces institutions culturelles qui n’arrivent pas à le mobiliser et ne savent comment l’attirer. L’univers emprunté, la durée de l’expérience, le niveau de difficulté des différentes énigmes … Tout est pensé pour eux. Le cadre « ludique », cependant, nuit lui aussi à l’apprentissage. Globalement, le but de ces joueurs est de gagner (c’est aussi le but des organisateurs), qu’ils soient bons ou mauvais perdants. Mais cette quête de la réussite amène parfois à privilégier l’efficacité, la rapidité, à l’attention qui ne se porte alors que peu sur le contenu quant à lui toujours ambigu.

Vues extérieures de l’Hôtel national des Invalides © Emeline Larroudé
Pourquoi, cependant, l’objectif serait-il d’apprendre ? Ne pourrait-on pas se contenter de la venue de milliers de personnes qui, peut-être, ne s’étaient jamais rendues en ce lieu auparavant, voire ne s’y étaient jamais intéressées ? Ces visiteurs, conquis par l’expérience, s’y rendront peut-être à une autre occasion pour tenter de percer ses véritables mystères … Soit. A cet égard, le score de plus de 11 000 participants en seulement deux sessions est remarquable. Par ailleurs, le fait que le Musée de l’Armée ait accueilli trois fois l’expérience est significatif : la plupart des séances (limitées à 20 personnes, mais proposées toutes les demi-heures environ) ont affiché complet, ce qui témoigne d’un engouement réel. Soulignons cependant que, si c’est là le résultat attendu (à savoir de nouveaux visiteurs conquis qui auraient moins de scrupules à pousser les portes du lieu une prochaine fois), malgré une bonne expérience, ludique, ce but est rarement atteint par les organisateurs. Pourquoi ? Peut-être parce que la visite classique n’est pas en mesure de leur apporter les sensations promises, elles, par un escape game ou un de ses cousins, et donc perd de l’intérêt pour eux.
Quoi qu’il en soit, l’expérience a le mérite indéniable d’être singulière et de conquérir les cœurs des participants, primo-visiteurs pour la plupart, qui s’en souviennent comme d’un moment très agréable et qui y associent le lieu, devenant décor 4D du jeu.
Voir la vidéo :
Emeline Larroudé
#museedelarmee
#cultival
#assassinscreed
#experienceassassinscreed
#escapegame
#ubisoft
Liens internet :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur notre chaîne youtube

Dons, quelle politique d'acquisition ?
Légende photo de couverture-vignette : Centre de conservation et de ressources © Yves Inchierman, Mucem
Légende photo d’intro de l’article : Les réserves visibles du Louvre Lens © Louvre Lens
Qui dit musée dit collections, sauf rares exceptions, à mettre en valeur et qui dit collections dit acquisitions et enrichissement de celles-ci. La valorisation du musée et de ses collections passe en partie par une politique d’acquisition définie. Les musées sont généralement fiers de présenter à leur public les nouvelles acquisitions, qui peuvent être le résultat d’achats ou de dons prestigieux. Au contraire, ils ne parlent jamais des dons refusés, de ces objets que des particuliers souhaitent offrir à titre gratuit aux musées de leur choix pour les voir valoriser. Il n’y a en effet pas de raison pour que les musées mettent en avant à travers leur communication les dons refusés, qui n’entrent pas dans les collections, puisque par définition ils ne font pas partie du musée. Pourtant, l’acte même de refus est particulièrement intéressant à questionner. Il offre une réflexion sur la démarche des musées, sur leur Projet Culturel et Scientifique (PSC) et la politique d’acquisition qu’ils suivent. Aussi analysons les politiques d’acquisition des musées pour comprendre ce qui définit l’entrée ou non des dons en collection, et la gestion qui s’en suit.
Le caractère inaliénable des collections de musée
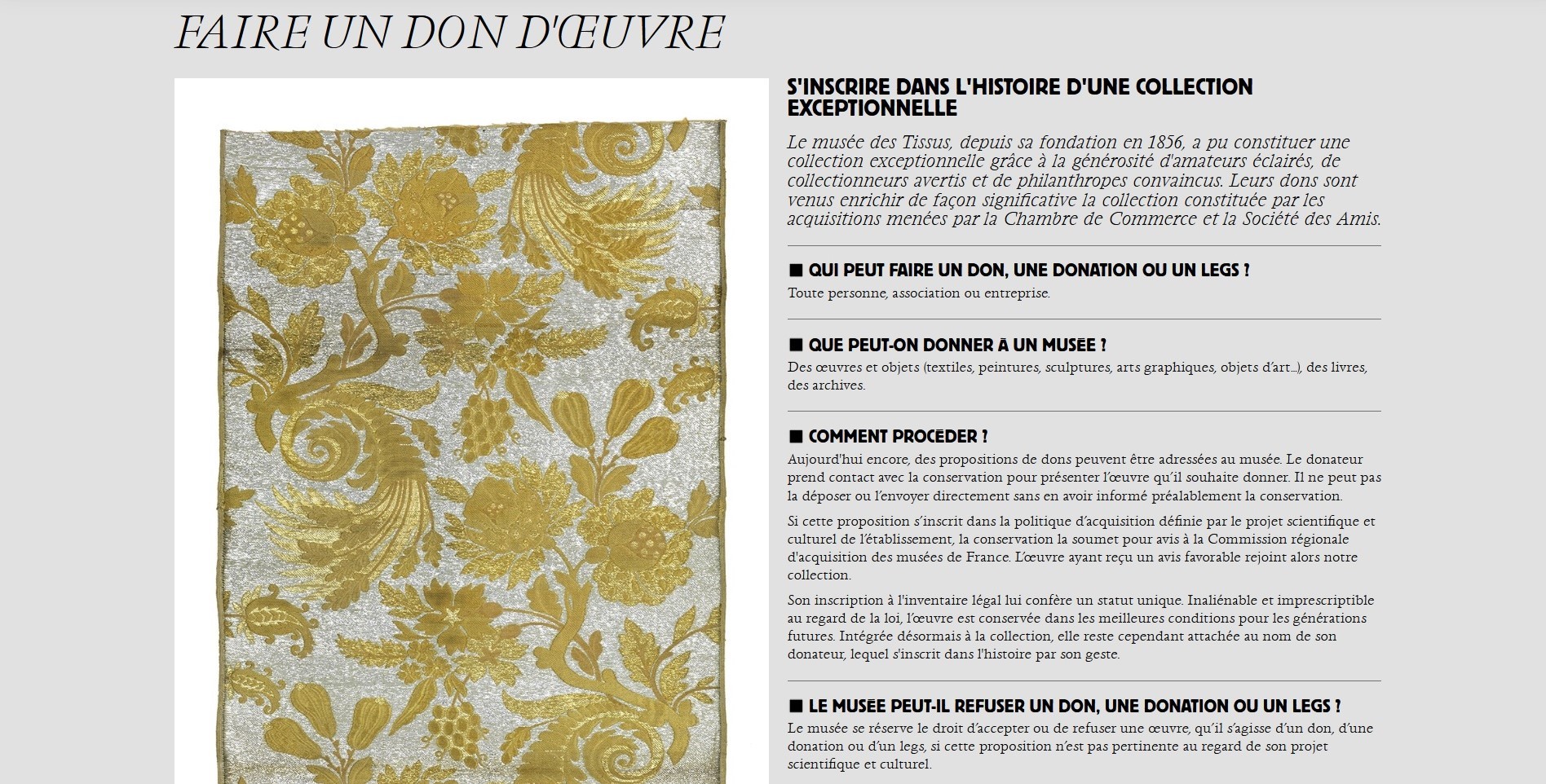
Page Internet du Musée des Tissus (Lyon) : faire un don d’œuvre
Préconisation sur les politiques d’acquisition
Élaboration des politiques d’acquisition
Il est donc primordial pour tout musée de bien définir sa politique d’acquisition afin d’être en mesure de savoir si les dons peuvent intégrer les collections ou bien s’ils doivent en être écartés. Elles sont mentionnées et explicitées dans le PSC des musées, lui-même élaboré tous les cinq à dix ans. La durée de vie d’un PSC met déjà en avant une difficulté : celle d’élaborer une politique qui dure dans le temps. Les recherches et objectifs d’un musée à un moment donné, établis dans le PSC, ne sont plus forcément les mêmes à la fin de sa validité. La mise à jour de ce dernier est donc indispensable pour poursuivre la bonne cohésion de la collection et continuer à acquérir ou non les œuvres de la façon la plus pertinent possible. De plus, elle détermine si la politique d’acquisition est une priorité pour le musée ou non, et dans le cas des dons cela peut grandement aider de fixer les axes à suivre dans l’intégration ou le refus de dons par l’équipe de conservation.

Vitrine de la Galerie des dons du Musée national de l’histoire de l’immigration © Anne Volery, Palais de la Porte Dorée, 2019
- Ainsi, il faut privilégier des objets dont la valeur scientifique est importante et qui justifie d’un intérêt public dans les domaines d’histoire, art, ethnologie, science etc. Mais comment comprendre l’expression valeur scientifique ? Pour appréhender la valeur d’un tel objet, il faut dans un premier temps avoir une très bonne connaissance de sa provenance et de ses propriétaires. Au-delà de cet aspect, la valeur scientifique se comprend à partir de l’intérêt apporté par l’objet dans l’enrichissement des collections. Tous les dons ne se valent pas et n’apportent pas le même savoir pour le musée qui le possède.
- À partir de là, se développe l’idée de la continuité des collections qui fait partie intégrante de la politique d’acquisition. Il est difficile en effet pour un musée de justifier l’acquisition d’un don qui n’a rien à voir avec les collections. Il s’agit alors d’accepter des dons qui sont en rapport avec les collections, mais surtout qui viennent les compléter et combler des lacunes sur une période historique ou un courant artistique, un·e artiste, un fonds ou une collection précise.
- Les refontes d’espace ou chantiers des collections peuvent également amener à des précisions de la politique d’acquisition. L’évolution d’une approche dans un musée, nouveau discours scientifique, changement muséographique amènent en effet le besoin d’enrichir les collections et de compléter l’existant selon les nouvelles intentions scientifiques et muséographiques.
Traitement des dons
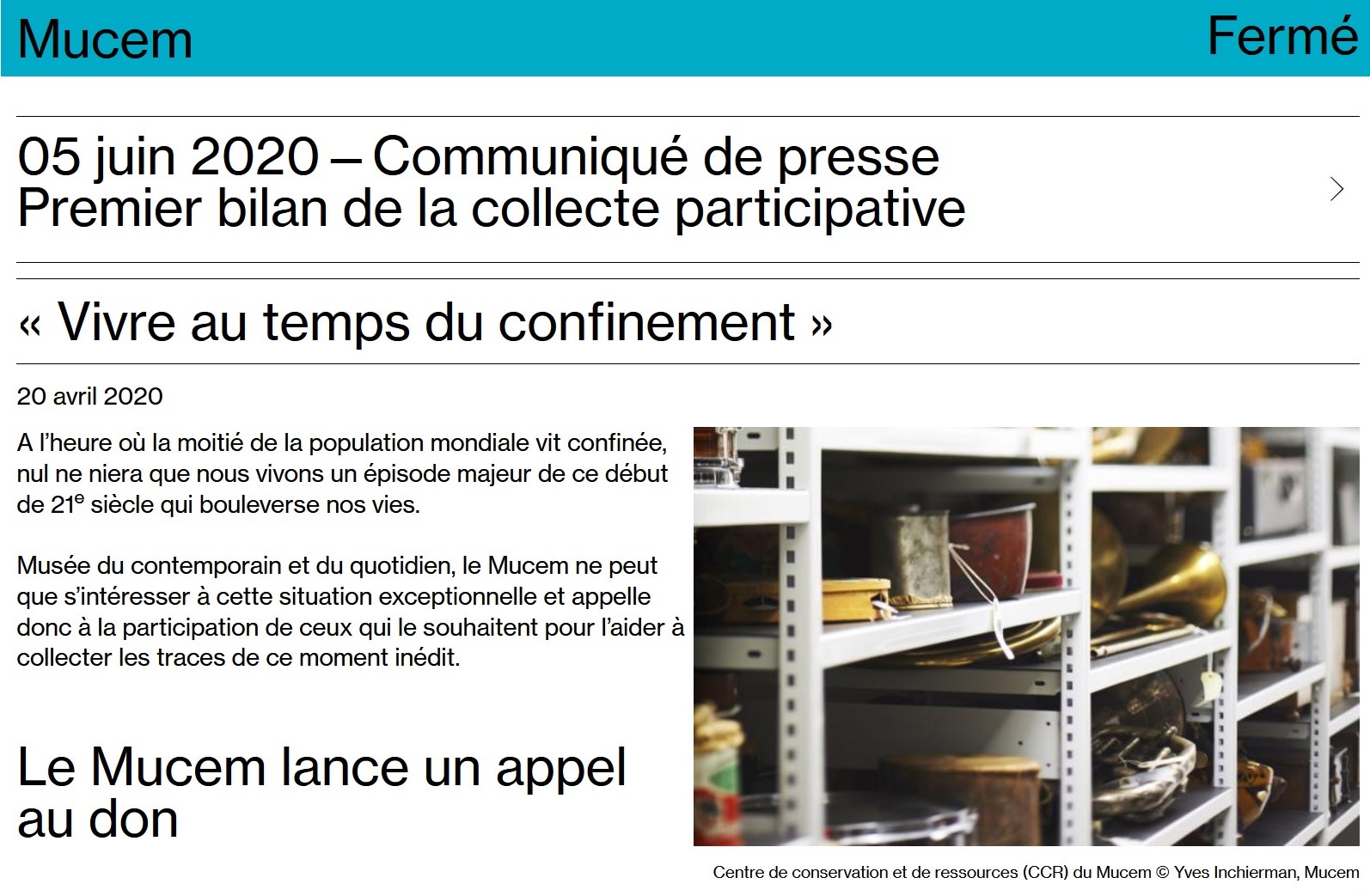 Page Internet du Mucem : collecte participative « vivre au temps du confinement » en 2020
Page Internet du Mucem : collecte participative « vivre au temps du confinement » en 2020
Les dons viennent bien souvent de particuliers, attachés à un musée et souhaitant donner de la valeur à un objet, enrichir les collections ou bien transmettre un patrimoine. Leur démarche est soit subjective et personnelle, motivée par un lien affectif avec le musée et ne va pas toujours dans le sens de la politique scientifique établie par l’équipe de conservation, soit elle s’inscrit dans le cadre d’une collecte définie par le musée lui-même. Dans ce cas-là, la démarche est encadrée et les dons doivent être en lien avec la thématique annoncée, il arrive cependant que des dons ne soient pas toujours en accord avec celle-ci. De ce fait, la conservation est en droit de refuser des dons qui ne lui semblent ni cohérent avec le reste du musée, ni pertinent au regard de la valeur scientifique de l’objet. En effet, la valeur scientifique vient déterminer l’entrée ou non de l’objet au registre d’inventaire. Une autre raison justifiant le refus d’un don peut être son passé juridique. Il peut être difficile selon les objets de déterminer l’origine et les différents propriétaires du don, rendant selon l’objet et la période concernée le propos difficile à justifier pour le musée acquéreur. Pour cette raison et pour éviter d’éventuels soucis juridiques, les musées peuvent refuser l’entrée de dons malgré leur intérêt scientifique. En ce sens la valeur juridique peut prévaloir sur la valeur scientifique.
Alors que nous avons vu que le cas des objets qui ne sont ni conservés ni exposés doit être défini, les PSC précisent peu ce qu’il advient des dons écartés. Différentes pistes sont envisageables. L’objet peut tout de même intégrer le musée, pour le service pédagogique, qui l’utilise lors d’ateliers avec du jeune public ou du public en situation de handicap. Une autre possibilité est de tout simplement laisser l’objet à son propriétaire, lui expliquant que malgré l’intérêt qu’il porte à l’institution son objet n’a pas sa place dans les collections. Enfin, si l’équipe de conservation estime que l’objet a sa place dans un autre musée ou dans une autre collection, il peut proposer un transfert vers cette institution.
Politiques d’acquisition et PSC sont des documents indispensables pour la bonne gestion des collections d’un musée. Ils donnent les axes de réflexion à suivre, les clés pour une gestion cohérente d’une institution muséale. Le musée étant par nature un lien qui collecte des objets ou des œuvres d’art, dons sont soumis à une politique bien précise justifiant ou non de leur entrée en collections. Celle-ci doit donc à la fois définir ce qui peut entrer en au registre d’inventaire, mais aussi les façons de traiter les dons qui n’y ont pas leur place.
Clémence Lucotte
Pour aller plus loin :
Le manuel « Comment gérer un musée » de l’ICOM
La vie des collections des musées de France
Le Vademecum des acquisitions à l’usage des musées de France
Exemples de pages Internet de musée dédiées aux modalités pratiques des dons : Musée des Tissus à Lyon et Musée de l’Armée à Paris
#don #acquisition #ICOM

Eclairer l'art contemporain
La lumière dans les musées est un paramètre essentiel et pourtant souvent négligé. L'éclairage a plusieurs rôles, il doit garantir la préservation des œuvres, créer une ambiance, aider à l'interprétation tout en assurant le confort des visiteurs. C'est l'éclairagiste ou le.la concepteur.rice lumière qui assume cette lourde tâche. Les institutions ont conscience des enjeux d'un bon éclairage mais marginales sont celles qui se dotent de concepteur.rice.s lumières dans leurs équipes. Les musées de beaux-arts et d'art contemporain sont parfois frileux pour innover en matière d'éclairage, convaincus que l'œuvre se suffit à elle-même et doit bénéficier de l’éclairage le plus sobre qu’il soit. Cependant certaines institutions misent sur la lumière comme le centre d'art Jean Paul Blachère, à Apt, dans le Vaucluse. J'ai échangé avec Eric Gomez, qui travaille sur l'éclairage des expositions de ce centre d'art depuis presque vingt-ans. Il m'a éclairé sur les différentes facettes de son métier et partagé ses souvenirs d'exposition.
Nb : Les termes spécifiques au matériel ou à la technique d'éclairage sont explicités en fin d'article.
Image d'en-tête : Exposition Sumegne / Ngaparou 2, 2021 © Fondation Jean-Paul Blachère
L'art de médier par la lumière et la mise en scène
Implanter un centre d'art contemporain africain dans une zone industrielle à Apt est un pari ambitieux. Pourtant, le centre d'art accueille 18 000 visiteurs par an, brasse un large public, pas nécessairement familier de l'art contemporain et bénéficie d'une grande visibilité. L'effort qui est fait sur l’éclairage et la mise en scène est un des éléments qui peut expliquer le succès de l'institution.
Il faut dire que la Fondation Blachère émane de l’entreprise Blachère Illumination spécialisée dans les décorations lumineuses festives. Le centre d’art mise donc sur ce savoir-faire en matière d’éclairage et de scénographie. “On veut que les gens rentrent et qu'au bout de cinq pas ils soient transportés dans un autre monde.” explique Eric Gomez. Ces mises en scène contribuent à la médiation des œuvres car la lumière est vite captée par le cerveau. Cela apporte des clés de lecture aux visiteur.rices. Les équipes du centre d’art Jean-Paul Blachère aiment utiliser la lumière pour donner envie aux publics éloignés de l'art contemporain de découvrir les expositions. “Je pense que l’esthétisme peut aider à ce que la fondation ne soit pas réservée juste à un public de connaisseur.euse.s. On veut mettre le visiteur dans un état où il va prendre le temps de regarder les œuvres”. L'enjeu reste cependant de trouver un équilibre: “C'est l'œuvre qui est importante. Il ne faut pas l'embellir, ni la dénaturer, lui laisser la place centrale”.
Souvenir d'expo: Hans Silvester, Tribu de l'omo
En 2004, le centre d'art inaugure sa première exposition dédiée à Hans Silvester. Eric Gomez fait équiper le centre d'art de projecteurs de découpes. Ce sont de petits projecteurs à quatre couteaux qui peuvent s'ouvrir et se fermer pour créer des formes géométriques. Grâce à ce dispositif, l'éclairage cadre les œuvres au millimètre près. C’est un éclairage localisé cadré. Cela convient bien au médium de cette exposition, la photographie. Le centre d'art est plongé dans le noir, et l'éclairage permet au visiteur d'être au plus près de l'œuvre. Cette technique deviendra la marque de fabrique du centre d’art.
Un éclairage théâtral
Eric Gomez vient initialement du monde du spectacle et n'avait pas de formation ou d'expérience particulière dans les institutions muséales lorsqu'il a fait ses débuts au centre d'art Jean Paul Blachère. C'est également le cas de Pierre Jaccaud, le premier scénographe du centre d'art. Ensemble, ils pensent la lumière comme un élément central de la scénographie permettant d'être au plus proche du propos des artistes. En effet, le centre d'art accueille ses artistes en résidence et c'est l'occasion pour le concepteur lumière d'échanger avec eux.elles, de comprendre leur démarche afin que la lumière raconte la même histoire qu'eux.elles. Comme un éclairagiste au théâtre a besoin du texte, du scénario pour penser l'éclairage d'une pièce, Eric Gomez a besoin de comprendre l'œuvre pour trouver l'éclairage adéquat.
Un jour, alors qu'il analyse un tableau, pour définir son éclairage, il ressent quelque chose d'étrange dans la manière de peindre de l'artiste sans pour autant comprendre d'où vient ce sentiment. L'artiste lui explique alors qu'il a peint cette série uniquement à la lampe à pétrole ou à la bougie car à cette période, les coupures d'électricité étaient fréquentes dans son atelier au Sénégal. C'est à partir de cette discussion que le concepteur lumiére a pu trouver la bonne température de couleur sur ses projecteurs et être au plus proche de la création originale de l'artiste.
Souvenir d'expo: Hommage à Mustafa Dimé, “Je ne rêve que de Lumière” 2008
La conception des lumières de cette exposition est partie du souvenir de Pierre Jaccaud après son voyage au Sénégal pour voir la galerie de Mustafa Dimé. Le scénographe garde en mémoire la vue sur la mer à travers le voilage, depuis sa fenêtre d'hôtel. Il a une vision précise des couleurs de ce paysage. Lors de la conception de la scénographie, Pierre Jaccaud décide de reproduire la fenêtre géante et son voile pour donner les œuvres à voir par ce prisme. Eric Gomez joue avec ses projecteurs pour trouver la luminosité et les couleurs adaptées à ce souvenir, collant au parti pris scénographique.

Exposition hommage à Mustafa Dimé, “Je ne rêve que de Lumière” 2008 © Fondation Jean-Paul Blachère
Le.la concepteur.rice lumière: 50% physicien 50% peintre
Un.e concepteur.trice lumière, doit prendre en compte un certain nombre de contraintes techniques comme l'explique Eric Gomez: “Il y a la température, l'hygrométrie, les UV qui sont malheureusement projetés sur les œuvres. Nous avons réglé le problème en mettant du LED partout, mais au début c'était quelque chose auquel nous devions faire attention.” Pour rappel, une intensité lumineuse de 300 lux est recommandée pour des œuvres constituées de matériaux comme les métaux ou le verre, qui sont peu altérés par la lumière. On privilégie entre 150 et 200 lux pour les peintures et 50 lux pour des objets particulièrement sensibles comme les dessins, les photographies ou encore les textiles.
Eric Gomez précise qu'il existe aussi des normes en termes de niveau de luminosité pour accueillir du public. Effectivement, la performance de lecture est un paramètre essentiel. Il faut éviter aussi les luminances parasites : reflets, brillances, éblouissement du public... Mis à part ces contraintes de conservation des œuvres et de sécurité des visiteur.rice.s, le concepteur lumière de la Fondation Blachère peut laisser libre court à son âme d'artiste. “Je n'ai pas de règles, on ne s'interdit rien du moment qu'on a le rendu voulu”. Il définit la source de lumière. Il joue avec ses projecteurs pour trouver la température de couleur juste en fonction du propos de l'œuvre et du médium. Entre 3200 et 6000 Kelvin le champ des possibles est presque infini. Plus la quantité de Kelvin est élevée, plus la lumière est "froide" et blanche. A l’inverse, quand la quantité de Kelvin est faible, la lumière est plus jaune, plus ambrée. Pour une exposition de photographies, il préfère les couleurs froides et les éclairages plutôt neutres. Eric Gomez joue aussi avec sa palette de gélatine. “Il faut faire des expériences, il m'arrive d'empiler quatre filtres sur le même projecteur pour obtenir l’effet souhaité." Il y a effectivement une grande part d'expérimentation : “Il y a une phase de discussion avec les artistes et scénographe, la création de plan à partir des photos des œuvres. Une fois qu'on a arrêté un choix, je fais des essais.” Néanmoins, par expérience, Eric Gomez connaît les bonnes combinaisons et il lui est plus facile d'arriver à l’effet escompté.
Souvenir d'expo: Esprit Guerrier Freddy Tsimba, 2008
Eric Gomez se souvient de l'éclairage de l'exposition Esprit Guerrier mettant à l'honneur l'artiste Freddy Tsimba. L'exposition traitait d'un sujet difficile : les conflits au Congo et notamment les répercussions sur les civils. Freddy a travaillé à partir de douilles et autres métaux glanés sur les champs de batailles de son pays pour constituer des sculptures de corps défunts. Les œuvres sélectionnées pour cette exposition créent une unité oppressante ; et Eric Gomez se rappelle avoir cherché à traduire cela par la colorimétrie et autres choix en matière de lumière en évitant que cela soit trop anxiogène pour les visiteurs. Il a donc choisi des lumières froides. Une des installations était possiblement choquante pour le public. Le concepteur a décidé de l'éclairer en douche, pour un effet “drama”. Avec le scénographe, ils installent un cercle en aluminium au plafond auquel ils suspendent un filet de camouflage militaire qui enveloppe l'œuvre. Cela met le visiteur dans une posture particulière par rapport à l'installation, il est libre de l'observer ou non à travers ce filet ajouré. “On a voulu préparer le visiteur, le mettre dans une posture plutôt que lui balancer cette image en pleine figure.” Le visiteur peut jouer avec le filet projetant des ombres et donnant à voir l’œuvre différemment.

Exposition sur Freddy Tsimba“Esprit Guerrier” 2008 © Fondation Jean Paul Blachère
A quand des musées mieux éclairés ?
Au même titre que les cimaises ou encore le mobilier d’exposition, la lumière structure l’espace, dirige le regard et aide à l’interprétation des œuvres. Jean-Jacques Ezrati conçoit l’éclairage muséographique comme un moyen d'expression. Il est donc surprenant que l’éclairage soit encore aussi secondaire dans les musées. Deux raisons peuvent l’expliquer. Premièrement, la mise en place d’un éclairage efficace demande un budget matériel dédié (projecteurs, rails, câblages…) et la rémunération d’un.e professionnel.le. Même si cela représente un budget conséquent, il reste proportionnel à l’ensemble des coûts de la création d’exposition. La deuxième explication est la méconnaissance ou le manque de reconnaissance du métier d’éclairagiste en musées. Cela est visible au faible nombre de formations dédiées en France. Si les centres de formations aux techniques du spectacle sont nombreux, il existe peu de formations spécifiques à l'éclairage muséal
Mieux éclairer c’est aussi réfléchir à des systèmes d’éclairage plus respectueux de l'environnement. La Fondation Blachère a par exemple fait le choix de passer aux ampoules LED. Pour donner un ordre d’idée, une ampoule LED de 8 Watts éclaire à la même intensité qu'une ampoule halogène d'une puissance de 75 Watts. De plus, les ampoules LED ont une durée de vie très importante. Un éclairage à ampoules LED est donc dix fois moins énergivore qu’un éclairage classique.
Précis de vocabulaire sur l'éclairage
- Température de couleur : La température de couleur correspond à la chaleur de la lumière : chaude ou froide. Elle s’exprime en unité Kelvin (K).
- Gélatine de filtre : Les gélatines sont les films colorés appliqués sur les projecteurs pour en modifier la lumière.
- Éclairage en douche : Une lumière en douche est un effet d’éclairage placé au-dessus du sujet.
- Luminances parasites : Ezrati définit les luminances parasites comme une attraction du regard sur “une plage sur-éclairée non significative”.
- Lux : C’est une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Il caractérise l'intensité lumineuse reçue par unité de surface.
Sources
Concevoir et réaliser une exposition, Carole Benaiteau, Olivia Berthon, Marion Benaiteau, Anne Lemonnier
L’éclairage muséographique Jean-Jacques Ezrati, Lettre de l’OCIM numéro 95, septembre-octobre 2004
Site Internet de Jean-Jacques Ezrati: https://ezrati-eclairage.weebly.com/
Collection Jean Paul Blachère :http://www.fondationblachere.org/
#lumière #artcontemporain #fondationblachère

Éco-conception et réutilisation du mobilier d'exposition, ou écrire des histoires originales avec des phrases analogues…
Montage Tano Lops
- Développer la sobriété (en matériaux et consommation), en lien avec les artistes, des scénographies et spectacles,
- Produire des matériels scénographiques démontables pour faciliter la réutilisation ou le recyclage des éléments, et éviter d’avoir un principe constructif à usage unique,
- Promouvoir l’approvisionnement en matériels d’occasions, nécessitant en amont d’identifier les lieux où se procurer en biens de réemploi. Il faut aussi utiliser des matériaux intégrant une part de matière recyclée.
- Une incertitude sur leur qualité de réaction au feu au regard de l’absence de documentation ;
- Une incertitude sur le maintien des performances évaluées dans le cadre des essais réalisés lors de leur mise initiale sur le marché pour leur nouvel emploi, selon la durée de vie précédente et les éventuelles modifications subies.

Espace d’exposition temporaire, Palais des Beaux-Arts de Lille

Jacques Averna, Les Régies, crédit : Jacques Averna
Tano Lops-Maitte
POUR EN SAVOIR PLUS :
- Réemploi des éléments de scénographie et règlementation ERP : le défi juridique du secteur de la culture, Elisabeth Gelot : https://skovavocats.fr/reemploi-elements-scenographie-et-reglementation-erp/
- Association Les Augures : https://lesaugures.com/L-association
- Définir des modes de production écoresponsables dans les différents secteurs : l’éco-production et le réemploi dans les décors et la scénographie, Ministère de la Culture :
- https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/transition-ecologique/definir-des-modes-de-production-ecoresponsables-dans-les-differents-secteurs-l-eco-production-et-le-reemploi-dans-les-decors-et-la-scenographie
- Retour sur l’exposition « Matière grise – matériaux, réemploi, architecture », Ville de Nice :
- https://cultivez-vous.nice.fr/exposition/forum-durbanisme-et-darchitecture/retour-sur-lexposition-matiere-grise-materiaux-reemploi-architecture/
- La Forêt magique, une exposition écologique pensée comme une ode à la forêt ! https://www.grandpalais.fr/fr/article/la-foret-magique-une-exposition-ecologique-pensee-comme-une-ode-la-foret#:~:text=à%20la%20forêt%20!-,La%20Forêt%20magique%2C%20une%20exposition%20écologique%20pensée,une%20ode%20à%20la%20forêt%20!&text=Nous%20plonger%20au%20coeur%20de,jusqu'au%2019%20septembre%202022%20!
- PDF RESTITUTION DU WORKSHOP, CONSTRUIRE LA DURABILITÉ DE NOS MUSÉES, Ville de Lille https://pba.lille.fr/content/download/6162/71025/file/WORKSHOP_Programme+complet.PDF
- DOSSIER TECHNIQUE DE STANDARDISATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCORS DU COLLECTIF 17H25 : https://www.uniondesscenographes.fr/documentation/eco-conception/dossier-technique-de-standardisation-delements-de-decors-du-collectif-17h25/
[1] The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition Francis Haskell
[2] Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées Métropolitains-Rouen Normandie
[3] Éco-conception : effort de conception portant sur l’ensemble de la chaîne de production d’une exposition (commissariat, scénographie physique et digitale, communication, action et accueil du public, édition, outils numériques) visant à réduire son impact environnemental et à maximiser son impact social en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des matériaux mobilisés.
[4] Article R*123-5 - Code de la construction et de l'habitation : Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
[5] Adeline Rispal, Architecte scénographe (Ateliers Adeline Rispal), Présidente d’XPO, Fédération des Concepteurs d’Expositions
#réemploi #scénographie #création

Et si on exposait des oeuvres dans des conteneurs?
C’est le projet lancé par l’entreprise L’Atelier Pandore, située sur Strasbourg et spécialisée dans la valorisation du patrimoine historique, qui réutilise d’anciens conteneurs pour valoriser des collections de musées dans les rues strasbourgeoises, permettant ainsi une accessibilité plus grande à la culture.
Des boîtes originales
Ces « boîtes de Pandore » de 18m2, qui sont en réalité d’antiques conteneurs maritimes réexploités en espaces muséographiques, investissent l’espace public en présentant et faisant vivre des œuvres venant d’une exposition d’un musée local ou faisant référence à la région. C’est ainsi qu’un des conteneurs, qui a renfermé l’exposition Post Mortemdu 17 septembre au 30 octobre dernier, est placé dans le quartier de Koenigshoffen, où des vestiges de nécropole romaine ont été découverts l’année dernière. Produite par l’Atelier Pandore cette expo présente des copies de ces objets romains et met en avant les rituels humains post-mortem.

Exposition Post Mortem dans le quartier de Koenigshoffen, source : Coline Gutter.
Visibles uniquement en extérieur, ces installations répondent aux critères de conservation des collections par la prise en compte des conditions de température optimale, d’hygrométrie et de luminosité, notamment par la mise en place d’une façade vitrée et d’un auvent.
Démocratiser la culture
Le premier objectif de la mise en place de ces installations est de démocratiser la culture en amenant l’art dans la rue et en touchant une population plus éloignée à la fois géographiquement et socialement, des musées. C’est pourquoi le quartier Koenigshoffen, qui se situe en périphérie de Strasbourg, a été choisi.
Ces « boîtes » cassent ainsi les codes muséographiques des institutions classiques en aspirant à une démarche plus moderne et accessible. Pour autant elles ne se présentent pas comme des musées mais davantage comme un outil de mise à disposition des musées, aussi disponible pour tout autre organisme qui souhaite démocratiser et partager sa culture et savoirs.
« La boîte de Pandore est un sachet de thé. Elle diffuse simplement un élément culturel dans une population de façon temporaire. Chacun est libre de la croiser, de s'en inspirer ou d'apprendre de son message ». - L’Atelier Pandore
La première exposition intitulée Athènes Cronenbourgqui s'est déroulée en 2018 dans l’écoquartier La Brasserie à Cronenbourg, a permis d’identifier un réel enthousiasme autour de ces boîtes. En effet, les habitants qui découvraient quatre « boîtes » au pied de leur immeuble ont pu profiter d’animations permettant de les fédérer autour du « Vivre ensemble ».
Néanmoins la boîte du quartier de Koenigshoffen n’est aujourd’hui encore qu’un prototype qui permet de « tester » les retombées en matière de conservation des objets, avant de pouvoir faire voyager le conteneur dans la région.
Qu’est-ce que L’Atelier Pandore ?
Dirigées par Anatole Boule, archéologue de formation, les missions de l’Atelier Pandore s’axent essentiellement sur la mise en valeur du patrimoine historique. Il propose des services de démonstration avec ces fameuses boîtes de Pandore, transformées au Port du Rhin, misent à disposition par la vente ou la location, et qui sont adaptables selon les envies de l’institution. Ainsi cette dernière est libre de choisir l’emplacement, le type de public, la médiation voulue autour de la « boîte ».
Par ailleurs la réalisation d’expositions et d’animations grâce à des partenariats avec graphistes, scénographes ou designers est aussi au cœur des réalisations de l’atelier.
Enfin l’entreprise propose aussi des conseils et études pour trouver des solutions, afin de répondre ensemble à des problématiques de volonté de valorisation d’un patrimoine historique.

Exposition Athènes Cronenbourg dans l‘écoquartier de La Brasserie, source : atelier-pandore.fr.
Retrouvez l’Atelier Pandore sur Facebook.
Image de couverture : Exposition Athènes Cronenbourg dans l‘écoquartier de La Brasserie, source : atelier-pandore.fr.
Tiffany Corrieri
scenographie #accessibilite #strasbourg

Exposer le vivant : entre attraction et curiosité
L'attrait du vivant
Le vivant est indéniablement un atout pour les musées et les centres de science qui en exposent. L’exposition temporaire Venenum, un monde empoisonné (Musée des Confluences) présentait par exemple entre autres 64 spécimens de 12 espèces venimeuses et vénéneuses pour appuyer son propos. Il s’agissait d’une première pour le musée, qui n’avait encore jamais exposé de spécimens vivants, car les spécimens naturalisés que possède le musée sont en trop mauvais état. Mais il s’agissait de démythifier des animaux fantasmés, et l’équipe connaissait aussi et surtout la force d’attraction du vivant. Il n’y a qu’à regarder les chiffres : à sa clôture, l’exposition Venenum, un monde empoisonné était l’exposition la plus visitée du musée, avec 600 000 entrées enregistrées. Le succès est aussi bien quantitatif que qualitatif. Une enquête a été menée en interne par le service de l’évaluation et des études du musée en mêlant entretiens avec les visiteurs et observations dans l’exposition. Les résultats démontrent que le vivant est effectivement un produit d’appel, mais qu’il ne fait pas écran à l’acquisition de connaissances. Les agents de surveillance, quant à eux, ont été valorisés : formés pour gérer les pensionnaires vivants de l’exposition, ils se sont retrouvés plus d’une fois en situation de médiateurs.

Des grenouilles qui fascinent : voilà tout l’intérêt du vivant dans l’exposition Venenum, un monde empoisonné. ©AFP – La Croix
Comme les reptiles, des insectes aussi communs que les fourmis peuvent déplacer les foules : à la fin des années 1980, Luc Gomel – ingénieur agronome de formation et actuel directeur du parc zoologique de Lunaret - a monté une exposition sur les fourmis, où six fourmilières était présentées. L’exposition, qui ne devait tourner que quelques mois dans la région toulonnaise, a finalement itinéré une quinzaine d’années dans une vingtaine d’endroits en France, en Suisse et en Belgique. Le Palais de la Découverte a également loué l’exposition, qui a été la plus fréquentée du site, après Autour des dinosaures, datant de 2015.
Cet attrait pour l’animal vivant ne se dément pas, et devient même un argument pour augmenter la fréquentation de certains espaces. Le Muséum-Aquarium de Nancy propose ainsi un espace doté d’aquariums contenant des espèces exotiques et locales, ainsi qu’une galerie de zoologie plus classique à l’étage. Dans les années 1970 le musée, ne contenant auparavant que des expôts classiques de muséum, décide de faire un grand tri et transformer la moitié de ses espaces en aquariums, réduisant d’autant son espace de présentation pour les spécimens naturalisés. Ce succès ne se dément pas. Il n’y a qu’à se balader dans le musée pour se rendre compte de l’attrait : les espaces dotés d’aquariums sont pleins en période de vacances scolaires, tandis que la galerie de zoologie connait une fréquentation plus classique. Dans la programmation annuelle, les aquariums sont tout autant mis en avant que les spécimens naturalisés. La page Facebook du musée relaie quant à elle aujourd’hui encore des articles relatant les poissons les plus connus du muséum.

Sur les réseaux sociaux comme dans le musée, les poissons sont à l’honneur. ©C.dC - MAN
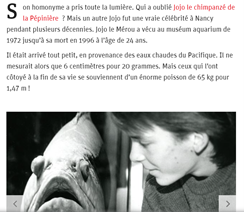
Même la presse locale se passionne pour eux. ©C.dC – L’Est républicain
Exposer des animaux vivants dans un musée se fait depuis des décennies et le succès ne se dément pas. Pour des raisons évidentes, les animaux présentés se résument souvent à des spécimens de taille modeste (comme les insectes et les arthropodes) et qui sont relativement faciles à entretenir (il est plus facile de s’occuper de poissons et de reptiles que de grands mammifères). Pourtant, l’arachnophobie et la peur des serpents sont la plupart du temps classées comme les peurs les plus communes dans le monde occidental. Cette relation d’attraction-répulsion joue aussi dans l’attrait que peuvent provoquer ces espaces. Les musées et les centres de sciences peuvent alors travailler sur ces a priori pour changer l’image de ces animaux. De nombreux centres proposent ainsi des médiations où les animaux sont sortis de leurs espaces pour être présentés au plus près du public. Le musée d’histoire naturelle de Lille sort régulièrement les phasmes de leurs vitrines pour les présenter aux plus jeunes et à leurs parents. Sous la surveillance du médiateur, le visiteur peut, s’il le souhaite, porter l’insecte sur sa main, tandis que le médiateur lui en apprend plus sur l’animal. Ces présentations sont très régulièrement couronnées de succès et font du moment un souvenir important pour le visiteur. De la même manière, le musée d’histoire naturelle et vivarium de Tournai a proposé en 2019 un stage alliant danse contemporaine et découverte des insectes. Au musée, les enfants ont pu ainsi toucher et porter des insectes. L’opération a été un franc succès : le côté tactile de la médiation est un véritable atout, mais cela apparente également le musée au parc zoologique*, qui s’en rapproche déjà avec les différentes autorisations que le musée doit posséder pour gérer les animaux.
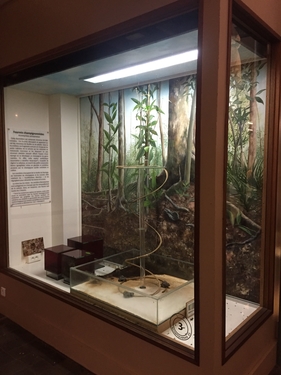
La vitrine des fourmis champignonnistes du musée d’histoire naturelle de Lille, qui fait souvent de l’ombre à ses congénères naturalisés ©C.dC
Plus encore, les centres spécialisés font de ces a priori le véritable fer de lance de leur discours. « Développer des attitudes positives à l’égard des insectes » fait partie des missions principales de l’Insectarium de Montréal, qui explique sur sa page Internet :
« À l’instar des autres institutions d’Espace pour la vie, l’Insectarium souhaite accompagner l’humain pour mieux vivre la nature, tout particulièrement pour reconsidérer sa relation aux insectes.
En plus de présenter l’extraordinaire diversité de formes et de comportements des insectes, le musée met en lumière leurs rôles essentiels dans l’équilibre écologique de la planète et, par extension, leur importance pour le devenir des humains.
[…] Pour changer durablement le regard des humains envers les insectes, l’Insectarium mise sur des approches intimistes, expérientielles et riches en émotions. »
Cette démarche s’inscrit dans une mission plus large que se donnent les muséums et les centres de sciences. Le fait d’exposer des animaux vivants est l’opportunité aujourd’hui de porter un discours sur la biodiversité et de sensibiliser le public à ces questions. L’animal vivant est une porte d’entrée pour aborder ces problématiques, qui deviennent concrètes à l’aune de ces présentations. Elles sont alors un tremplin vers des actions de plus grande ampleur. En ce sens, l’insectarium de Montréal produit de nombreuses missions avec ses publics pour la sauvegarde de l’environnement. Il propose au public des missions de sciences participatives, comme Les sentinelles de Nunavik, ou encore La nature près de chez vous. Un onglet complet est dédié à ces missions sur le site internet de l’Insectarium. Dans la même veine, le Vivarium du Moulin (Lauthenbach) travaille avec le public sur la réhabilitation des insectes locaux. Créé en 1991 sur le modèle de l’Insectarium de Montréal, le Vivarium du moulin se donne pour mission d’être le médiateur entre les scientifiques et le public. :
« Les insectes ont souvent mauvaise réputation. Pourtant ils jouent un rôle indispensable dans l’équilibre écologique. Afin de leur redonner la place qu’ils méritent, un jardin aux insectes spécialement aménagé à leur intention a été conçu au pied de la roue à aubes. Dès le printemps, empruntez le sentier de découvertes jalonné de refuges à insectes : mare, tas de vieux bois, haie champêtre, talus ensoleillé, compost, prairire fleurie, etc. Autant de micro-habitats facilement reproductibles dans votre jardin et qui offrent le gîte et le couvert à un cortège d’insectes dont la richesse vous étonnera ! »

L’Insectarium de Montréal présente à la fois des spécimens naturalisés et vivants. ©Claude Lafond
Exposer le vivant est sans aucun doute un atout pour les musées et les centres de sciences, qui accroissent ainsi leur fréquentation. Mais les animaux peuvent également être le support de discours de sensibilisation comme un première étape pour soulever les a priori négatifs qui les entourent. Néanmoins, conserver du vivant dans un espace aussi contrôlé qu’un musée n’est pas chose aisée.
Un atout contraignant : l’exemple de Venenum, un monde empoisonné
Bien qu’étant un produit d’appel phare pour les musées qui possèdent du vivant, les législations qui entourent son exposition sont complexes et importantes. L’exposition Venenum, un monde empoisonné au musée des Confluences en est un bon exemple. L’exposition présentant des espèces venimeuses et vénéneuses, le musée a été soumis à une réglementation très lourde administrativement. Celui-ci a dû produire un dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de 130 pages pour la Direction Générale de la Protection et des Populations (DDPP). Pour toute la durée de l’exposition, le musée a été soumis à la même règlementation que les parcs zoologiques et les aquariums. Cela présente de nombreuses contraintes : nettoyage des eaux usées, pas de nuisances sonores et olfactives, gestion des déchets à la suite du décès d’un animal… La liste est longue. Le musée s’est entouré de deux capacitaires, qui l’ont aidé à préparer le dossier et à gérer les animaux durant la totalité de l’exposition. La venue d’animaux vivants a également demandé la formation du personnel d’accueil et de surveillance, et la mise en place de protocoles pour envisager tous les incidents. Enfin, le musée a dû se doter de protocoles de sécurité stricts, comme du double vitrage pour les terrariums et l’équipement des salles de travail avec les animaux de digicodes et de serrures à clé. Un message d’avertissement au début de l’exposition ainsi que des stickers sur les vitrines ont enfin été mis en place à destination du public pour les prévenir et leur expliquer la position à adopter face aux animaux. Pendant l’exposition, le musée a également été contrôlé deux fois par la DDPP pour vérifier dans quelles conditions étaient exposés les animaux.
Malgré tous ces efforts, l’exposition reste une source de tension. Le personnel est toujours sur le qui-vive, et le musée a connu une fausse alerte : un serpent s’étant échappé de son terrarium. Le personnel a alors enclenché une procédure lourde, faisant évacuer l’exposition et avec l’intervention d’un des capacitaires pour retrouver l’animal.
L’exemple de l’exposition du musée des Confluences présente les principales difficultés face auxquelles les musées peuvent se retrouver confrontés s’ils décident d’exposer du vivant. Mais plus encore, cela demande une véritable logistique. Qui nourrit les animaux ? Comment expliquer l’achat de grillons sur les lignes de comptes d’un musée ? Quelle formation et quels recrutements à long terme pour assurer le bien-être des animaux ? Quel statut pour ces animaux ?
Exposer le vivant reste donc une situation contraignante pour les musées, qui doivent bien réfléchir avant de se lancer dans ce type de projet. Dans le cas des musées de sciences, les animaux exposés sont le plus souvent passifs, et présentés à des fins contemplatives. Mais les muséums et autres centres de sciences ne sont pas les seuls à présenter le vivant. L’art contemporain se sert régulièrement d’animaux, ce qui pose d’autres contraintes.
Le cas du vivant dans l'art contemporain
L’exposition d’animaux dans le cas d’œuvres d’art contemporaines posent tout d’abord les mêmes contraintes que dans les musées de sciences. Le musée doit assurer le bien-être de l’animal en suivant les mêmes protocoles stricts. Le musée d’art de Nantes a présenté quatre œuvres utilisant des animaux ces vingt dernières années. Parmi elles, l’œuvre de Laurent Tixador, Potager, en 2018 sur le parvis du musée. L’œuvre utilise le modèle de l’aquaponie pour questionner les nouveaux modes de production. Il fallait donc acheter des poissons pour activer l’œuvre. Exposée six mois, l’œuvre a présenté quelques difficultés, notamment pour le nourrissage des poissons et l’ajout d’eau. De même, le parvis étant en plein soleil, il a fallu refroidir l’espace pour le bien-être des poissons. A la fin du projet, les équipes, d’accueil, au départ réticentes, ont jugé la présentation trop longue au vu de l’entretien que demande l’œuvre. De même, à la fin de la présentation de ce type d’œuvre, que faire des animaux ? Dans le cas de Potager, le musée avait préparé une convention avec les services de la ville pour que les poissons rouges soient disposés dans la mare d’un parc municipale à la fin de l’exposition.

Potager de Laurent Tixador, sur le parvis du musée d’arts de Nantes. ©Laurent Tixador

©Musée d’arts de Nantes / C. Clos et M. Roynard
La question du bien-être animal enfin, est souvent reproché à l’art contemporain. Dans le cas du musée d’art de Nantes, la conservatrice a reçu plusieurs lettres attestant du mécontentement de visiteurs face à Potager, mais aussi à l’œuvre d’Aki Inomata Why Not Hand Over a « Shelter » to Hermit Crabs ?, qui présentait des bernard-l’hermites possédant des coquillages reproduisant des villes, créés grâce à une imprimante 3D. Les lettres fustigeaient les œuvres, en reprochant au musée l’utilisation d’animaux, mais aussi de plastique dans le cas de l’œuvre d’Aki Inomata. Ici, la conservatrice a tout de suite répondu à ces lettres pour expliquer le parti pris du musée d’accepter ce genre d’œuvre d’art. Mais il arrive que les protestations soient telles que le musée retire les œuvres en question. C’est ce qui s’est passé au Guggenheim Museum de New-York. Dans le cadre de son exposition Art and China after 1989: Theater of the World présentée en 2017, le musée a fait face à des menaces de violences qui l’ont contrainte à retirer Theater of the world (Un théâtre miniature où serpents, reptiles et insectes devaient cohabiter, laissant clairement entrevoir le destin funeste de certains animaux présents), Dogs that Cannot Touch Each Other (une vidéo où des pitbulls sont attachés à un tapis roulant et ne peuvent pas se jeter l’un sur l’autre pour se battre) et A Case Study of Transference (une vidéo où des porcs s’accouplent devant les spectateurs). Ces trois œuvres remettant en cause le bien-être animal dans leur forme, ont essuyé de vives critiques.

Why Not Hand Over a Shelter to Hermit Crabs ? , Aki Inomata. ©Musée d’arts de Nantes / C.Clos
La réflexion autour du bien-être animal est une question qui n’est pas prête de disparaître. En 2002, le MAM souhaitait acheter l’œuvre de Marcel Broodthaers Ne dites pas que je ne l’ai pas dit, mettant en scène un perroquet en cage et un magnétophone répétant constamment la même phrase, de sorte que le perroquet finisse par l’apprendre et la répéter inlassablement. Bien que le musée ait reçu l’autorisation de la part des élus et de la ville pour l’achat, la vente ne s’est finalement pas faite, car le musée fit face à trop de véhémence de la part d’élus de l’opposition et d’associations en faveur des animaux.
Le vivant est donc un véritable atout pour un musée, même s’il présente des contraintes certaines pour l’espace dans lequel il est exposé. Le public est généralement ravi de cet apport dans un musée, mais le bien-être animal est un facteur à ne pas oublier. Ainsi, si les animaux présentés dans les centres de sciences ne font généralement pas d’émules, des présentations trop poussives dans le cadre de l’art contemporain peuvent facilement déclencher de vives réactions.
Clémence de CARVALHO
#museum
#vivant
#animal
*Pour approfondir le rapprochement entre parc zoologique et parc d’attraction, un autre article du blog est disponible :
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2092-les-zoos-vont-ils-se-transformer-en-parcs-d-attractions
Pour en savoir plus :
- Journée d’étude de l’association des élèves-conservateurs de l’INP : Plus vif que mort ! L’animal en patrimoine, le 16/04/2019
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/Plus-vif-que-mort-!-L-animal-en-patrimoine
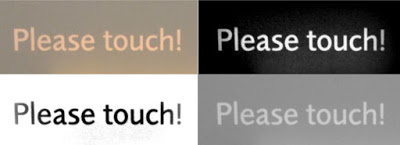
Faire l’expérience de la conservation-restauration à l’Ashmolean Museum d’Oxford
Lors de notre visite à l’Ashmolean Museum nous avons découvert, dans les sous-sols du musée, un espace d’exposition dédié à la présentation des collections et à l’explicitation de la pratique de la conservation-restauration. En plus de donner de la visibilité à une action généralement méconnue du grand public, tout ce qui fait l’attractivité de ce parcours est qu’il est également doté de plusieurs dispositifs interactifs et de manipulations.
© A.G.
L’Ashmolean Museum d’Oxford
L’actuel Ashmolean Museum d’Oxford a été fondé au tout début du XXe siècle sur la fusion des anciennes collections du musée éponyme et des collections d’art de l’Université de la ville, jusqu’alors présentées dans la Bodleian Library. Le musée compte une grande variété de départements : d’antiquités, d’art oriental, d’art occidental (du Moyen-âge à nos jours), de numismatique ou encore de moulages. Toutefois, nous nous intéresserons ici plus spécifiquement à la façon dont le musée évoque au sein même de ses espaces d’expositions deux de ses missions essentielles : la conservation et la restauration.
Sensibiliser les publics
« Merci de ne pas toucher », « Flashinterdit »…sont autant de recommandations auxquelles sont confrontés les visiteurs. Une fois sortis des réserves les objets sont en effet exposés à un certain nombre de risques, autant liés aux visiteurs qu’à l’atmosphère ou encore à la température de la pièce. D’une certaine manière les réserves restent encore les lieux les plus sûrs pour assurer leur bonne conservation, mais cela est loin d’être une solution à long terme. Ainsi, il est légitime de se demander si dicter de simples consignes aux visiteurs est vraiment la seule solution pour garantir à la fois la bonne préservation des objets et leur exposition au public ?
Grâce à ces différents dispositifs, le parti pris de l’Ashmolean Museum est plutôt de donner des clefs de compréhension aux visiteurs afin de les sensibiliser aux enjeux de la conservation-restauration.
« Objects are fragile »
© A.G.

Faire entrer les publics dans les coulisses du musée
En pénétrant dans les « coulisses » du musée, les visiteurs expérimentent par eux-mêmes les techniques et les méthodes de la conservation-restauration.
« Exploringwith light »
© A.G.
Face aux visiteurs se présentent trois objets, placés dans des vitrines. En dessous de chacune d’elles sont disposés des capteurs devant lesquels les visiteurs sont invités à passer leur main. Par cette action, ils activent différents types de lumière sur l’objet. Leur est aussi explicitée par de courts textes, la fonctionnalité de chacune. Pour exemple la lumière UV qui révèle les différences de matériaux, permet potentiellement de découvrir des restaurations antérieures. Les visiteurs sont sollicités pour trouver par eux-mêmes si la sculpture a été réparée ou non par plusieurs questions : « Do you think this piece might have been repaired ? ».
« Conservation Lab »
© A.G.

À l’aide d’un petit carnet et de deux loupes les visiteurs sont conviés à examiner les objets sous vitrine. Pour chaque objet ils sont guidés dans leur expertise grâce à plusieurs questions qui leurs sont posées : « What other colours do you see ?What materiel do you think this knife is madeof ? ». Cesdispositifs permettent aux visiteurs de comprendre les gestes qu’implique la conservation-restauration. Ils ne font cependant pas qu’expérimenter. En effet, par différents questionnements qui leurs sont directement adressés, ils sont également amenés à établir leur propre réflexion sur les enjeux de la conservation-restauration et à prendre conscience de son rôle crucial dans la transmission du patrimoine.
Certaines institutions vont même plus loin dans la démarche notamment en réalisant des restaurations face aux visiteurs. Comme en 2009-2010, au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing (MUba Eugène Leroy) où des restaurateurs effectuaient leur travail directement dans les espaces d’exposition, confrontant ainsi les visiteurs à la réalité de ce type d’intervention.
D’autre part, que cela soit à l’Artothèque de Mons ou encore au Louvre-Lens, les institutions tendent de plus en plus à ouvrir leurs réserves ou simplement à les rendre visibles au public. Un argument d’attrait qui est indéniable pour les visiteurs, toujours désireux de voir ce qui est habituellement gardé secret.Le choixde ce parcours réalisé par l’Ashmolean Museum s’apparente également à une tentative de dévoiler l’invisible au visiteur et à lui faire littéralement toucher du doigt les problématiques de conservation et de restauration auxquelles l’institution fait face. D’une certaine façon aussi, un tel parcours au sein du musée est une sorte de préambule à la visite et contribue à donner aux publics un autre regard sur les collections du musée. Acteur pendant sa visite, il prend autant conscience de la fragilité des pièces conservées que de la manière dont il faut les préserver.
Mais au-delà de la fonction pédagogique première, ces initiatives permettent également de proposer une nouvelle expérience de visite, pour toujours plus d’interactions entre les publics et les œuvres.
#Ashmolean
#Oxford
#Restauration
#Conservation
#Interaction

Faut-il crier au génie quand les artistes deviennent commissaires d’exposition au MAH ?
Il y a un an, c’est l’artiste Suisse Ugo Rondinone qui présentait « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP » et dans quelques mois, c’est l’artiste belge Win Wenders qui va présenter son exposition entre le mois de janvier et juin 2024, mais à quel prix ?
Surmontant la ville de Genève, le Musée d’Art et d’Histoire (MAH) est à la recherche d’un nouveau souffle à la suite au projet de rénovation de Jean Nouvel, qui fut révoqué par la population genevoise en 2016.
Suite à la prise de poste de Jean-Olivier Wahler le 1ᵉʳ novembre 2019, l’ancien directeur du Palais de Tokyo et du MSU BROAD MUSEUM, (Michigan State University, East Lansing, Etats-Unis), souhaite créer une nouvelle vision du MAH par le biais d’un nouveau programme culturel, modifiant complément l’identité du musée.
Dans son programme, fort critiqué par la population genevoise et tout particulièrement le comité scientifique, le directeur axe sa politique sur trois sujets : la rénovation et l’agrandissement du musée, les expositions (et plus particulièrement les cartes blanches) et l’implication du public dans les espaces muséaux par le biais d’évènements, d’afterworks, de conférence et de projets pluridisciplinaires et collaboratifs.
Le premier grand projet fut le lancement de ses « Cartes Blanches » d’exposition. Concernant cette typologie d’exposition du MAH, la « Carte Blanche » se définit comme une exposition XL, « mobilisant plusieurs champs de la collection, le plus souvent confiés à un.e commissaire invité.e, et appelées à modifier une large part des espaces. »[1]. Au bout de trois éditions, la première datant de 2021 avec l’artiste Jakob Lena Knebl, la seconde avec Jean Hubert Martin en 2022 et Ugo Rondinone en 2023, la saison 2024 de l’exposition « Carte Blanche » est confiée à l’artiste belge Wim Delvoye. En quoi ce concept d’invitation des artistes est-il pertinent pour la collection du MAH ? et le projet scientifique du musée ?

Vue de l’exposition, La chambre, Ramsès II, Genève, Musée d’Art et d’Histoire © MAH / J. Grémaud
Un projet scientifique et culturel uniquement lier à ses collections
Suite à deux ans de travail, le nouveau directeur du musée a souhaité recentrer son P.S.C (Projet Scientifique et Culturel) sur les collections du MAH, contenant plus ou moins 650 000 objets de tout genre, la question est donc la suivante : pourquoi ? et comment ?
En 2021, la première édition des « Carte Blanche » définit les règles : mise en avant des collections de tout genre (beaux-arts, archéologie, art graphique), des objets présents dans les réserves (sois 99% de la collection), scénographique dessinée par l’artiste, transformation de la totalité du 1ᵉʳ étage en espace d’exposition, publication d’un catalogue d’exposition et billetterie entièrement gratuite ou « Pay as you wish ».
Or, la première édition fut aussi celle des questionnements et de la réception du public, qui a l’habitude des expositions monographie et thématique et non pas d’une « carte blanche », un terme trop vaste pour le grand public.
L’exposition de Jakob Lena Knebl, première commissaire d’une série de grandes expositions « Carte Blanche » était ouverte du 28 janvier 2021 au 27 juin 2021, or suite aux restrictions sanitaires, l’exposition ne fut visible qu’à partir de mars, ce qui n’a pas empêché à 27 173 curieux d’explorer cette exposition, à la scénographie, étrange, métallique et tumultueuse.
En 2022, c’est le commissaire d’exposition Jean-Hubert Martin, reconnu pour son exposition le « Magiciens de la terre » en 1989 qui questionne et redistribue les cartes de la collection du MAH. Entre le 28 janvier 2022 et le 18 juin 2022, le commissaire renouvelle la présentation des collections du MAH, regroupant les objets par couleurs, une salle par couleur, tel un arc-en-ciel, des formes dans un accrochage ressemblant à un salon du 19ᵉ.
Il y a un an, c’est l’artiste Suisse Ugo Rondinone qui prend les rênes du projet pour présenter « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP », une exploration esthétique des collections autour des œuvres de deux figures suisses : Felix Vallotton et Ferdinand Hodler, et des créations contemporaines de Rondinone.
Dans quelques mois, c’est l’artiste belge Win Wenders qui va présenter son exposition entre le mois de janvier et juin 2024, à quel prix ?
Une présentation renouvelée, une collection renouvelée, mais temporaire.

Ugo Rondinone, salle “Espace rythmique. Dix piliers”, exposition When the sun goes down and the moon comes up, MAH, Genève, 2023 © Musée d’art et d’histoire de Genève, Ph. Stefan Altenburger
Dans le cadre de ces « carte blanche » annuelle, plusieurs questions se posent. Tout d’abord la temporalité de l’exposition, la première version de l’exposition se déroulait de janvier 2021 à mai 2021. Or, depuis la seconde version, l’exposition commence en mars pour se conclure en juin-juillet. Est-ce un changement d’agenda pour éviter la période creuse du musée ? ou rajouter des précieux mois aux artistes et aux équipes du musée pour finaliser ce projet ? Dans les deux cas, le fait d’avoir une exposition de plus ou moins 4-5 mois permet au public de revoir l’exposition, et en soit les œuvres méconnues du musée. La réalité est tout autre, souvent la scénographie de ce genre d’exposition prend énormément de temps, d’autant plus qu’en moyenne 300-500 objets, de toute taille et genre sont présentés, donc 600-1000 constats d’état, des litres de peintres, des milliers d’outils et, peut-être, peu de personnel. En dehors de ses objets, il y a aussi leurs états sanitaires, faut-il les restaurer, les préparer à leurs accrochages, etc.
D’autre part, la scénographie et la muséographie à plusieurs problématiques, dans aucune des nouvelles « carte blanche » il y a eu une réutilisation d’élément, aucune reprise d’assises, de socle, de couleur des salles, des cimaises ou des soclages. Or, tous ses éléments pourraient mettre des objets en avant dans d’autres expositions du musée, ou, encore mieux dans les collections permanente. En parlant de collection permanente, rares sont les œuvres qui reprennent la direction des collections, la plupart reviennent en réserve, ce qui pose la question de l’utilité technique et de conservation des œuvres, mais aussi du travail scientifique du projet.
En dehors de ces divers aspects, la communication des expositions est, dans ce cas, une bonne nouvelle. Que ce soit dans les flyers, les affiches, et tout support utilisé pour la promotion externe de l’exposition, le musée suit sa ligne graphique créée par le studio de graphisme zurichois Hubertus Design. Depuis 2019, celui-ci crée une nouvelle unité graphique, qui, de surcroit, est différente des autres musées genevois, mais semble trop contemporaine pour un musée d’art et d’histoire, selon la représentation classique que l’on s’en fait.
La question des liens, entre le musée et le marché de l’art
Dans le cas de ces expositions, une question éthique subsiste : quels sont les aspects juridiques conventionnés entre le plasticien et le musée ? Des droits du musée d’utiliser les œuvres (les droits à l’image dans la communication par exemple), à celui de l’artiste non censé vendre une œuvre via un musée public présentée durant l’exposition.
Lors de l’exposition « carte blanche » d'Ugo Rondinone, « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP » que penser de la galeriste qui le représente, la galerie Eva Presenhuber. Selon de nombreuses sources journalistiques, la galeriste a envoyé à ses bons clients la documentation de l’exposition actuelle du MAH, avec la liste complète des prix. Vous pourrez donc vous offrir un « showcase », le MAH, qui ne recevra aucune redevance des ventes. Le minimum serait de remercier le MAH par un don d’une ou deux des œuvres présentées au MAH, par exemple… ce qui ne fut jamais le cas depuis l’introduction des « carte blanche ».
GASGAR Lucas
#Suisse #Exposition #Contemporain
[1] https://www.mahmah.ch/sites/default/files/pdf/2023-06/Web_N.MAH_concept-musee_MAH_DEF.pdf
Fiez vous à votre flair!
Le mélange subtil entre Beaux-arts, Art contemporain et la multitude d’animaux naturalisés, est ce qui fait tout le charme du Musée de la Chasse et de la Nature, situé en plein centre de Paris.
Afin de rendre le parcours permanent encore plus vivant et attractif, un artiste contemporain est invité chaque saison à investir le musée, avec ses créations se fondant dans la collection. C’est le cas actuellement pour l’artiste Marlène Mocquet, du 7 mars au 4 juin 2017, qui présente une cinquantaine d’œuvres de son univers imaginaire peuplé de créatures fantastiques aux allures enfantines mais en réalité moqueuses et cruelles.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui ce n’est pas seulement cette nouvelle artiste. En effet, le musée a complété son parcours : une « nouveauté » qui se marie à merveille avec les collections. Mais de quoi peut-il bien s’agir ? Un conseil : « Fiez-vous à votre flair ! »
Mais avant de vous révéler cette nouveauté, voyons un peu comment sont sollicités les cinq sens dans ce musée. C’est parti !
Quels sens sont sollicités lors d’une visite d’exposition ? Facile, me direz-vous : principalement la vue ! Et c’est tout à fait juste, bravo. D’autant que le Musée de la Chasse a une collection très riche et il faut mieux garder les yeux grand ouverts pour remarquer la multitude de détails étonnants et détonants tout au long de la visite.
☑ LaVue, Ok !
L’ouïe peut être sollicitée ponctuellement lorsque des films sont projetés par exemple. C’est plutôt commun dans les expositions, rien de bien innovant. Dans son parcours, le Musée de la Chasse a déjà mis en place des éléments renforçant l’utilisation de ce sens : on trouve en effet, dans le cabinet des oiseaux de proie, des chants et bruits de forêt qui nous plongent dans un univers forestier. Dansla salle des trophées, le sanglier albinos de Nicolas Darrot nous surprend par son rugissement inquiétant.
☑ L’ouïe c’est fait !
Passons maintenant au toucher.
Là encore, ce sens est déjà sollicité dans de nombreux musées, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ici, les « armoires » font très bien l’affaire : le visiteur peut ouvrir les différents tiroirs et découvrir les spécificités de chaque animal. De plus, dans la salle des armes, les très nombreux tiroirs peuvent également être manipulés par les visiteurs les plus téméraires ou ceux qui ont eu le conseil de la part du gardien. Ces tiroirs impliquent le visiteur dans sa visite mais pour plus d’information sur la thématique des tiroirs dans le musée, je vous renvoie à un autre article du blog : Tirer, ouvrir et soulever
☑ Le toucher c’est bon aussi !
Donc on a : vue, ouïe, toucher. Jusque là, facile. Mais quant est-il du goût et de l’odorat ? C’est déjà beaucoup plus difficile à mettre en place.
Pour le goût, les événements gustatifs dans les musées se font de plus en plus. Le Palais des Beaux-Arts de Lille a invité un chef étoilé, Alain Passard, lors de l’Open Museum #4 . Le musée de la Chasse a également voulu tester : « Mange-moi », une visite comestible, a eu lieu le jeudi 4 mai 2017. Créée en lien avec l’exposition de Marlène Mocquet et son monde imaginaire, l’artiste scénographe Brigitte de Malau a réalisé une dégustation face aux œuvres. Il faut dire que dans les œuvres de Marlène Mocquet, on trouve bon nombre de pommes, fraises et autres œufs au plat…
☑ Le gout : check !
Finalement, qu’est ce qui peut être mis en place pour l’odorat ? Quelle est la grande nouveauté du Musée de la Chasse ? Je vous le donne en mille : le « Sentiment de la licorne » qui est un parcours olfactif ! Enfin « parcours », plutôt une ambiance olfactive créée dans quatre salles du musée : la salle des armes, le cabinet du cheval, le cabinet de Diane et le cabinet de la licorne. Il a été mis en place en collaboration avec la Maison Trudon, Manufacture Royale de Cire. Les « fragrances » ont été créées par Antoine Lie de la Maison Takasago.
Je me suis adonnée à un jeu simple : j’ai décrit les odeurs que je m’attendais à trouver selon les salles avant de comparer avec le parfum réellement diffusé.
Voici le résultat de la première étape. Mes attentes :
Salle des armes : une odeur de poudre, de feu éteint et de métal refroidissant. Quelque chose qui pique un peu le nez et qui remonte bien dans les sinus. Et puis quelque qui reflète la chasse àl’animal donc quelque part la mort.
Cabinet du cheval : le foin, le crottin de cheval. L’écurie en fait, l’odeur du box de cheval.
Cabinet de Diane (des chouettes) : une forêt mais fraiche, un peu l’odeur de la forêt la nuit, peut être également l’odeur de lapluie et puis bien sûr la fiente de pigeon (parce que je ne connais pas d’autre odeur de fiente, désolé).
Cabinet de la licorne: alors là il faut que ça sente les paillettes, la magie, l’arc-en-ciel ! J’imagine une odeur très sucrée, comme une barbe à papa. Oui, quelque chose de doux et sucré.
Une fois cet exercice accompli, je me suis rendue dans les différentes pièces, et les yeux fermés, j’ai pris une grande inspiration.
Salle des armes : ça sent le vieux, le renfermé. C’est un peu l’odeur de chez ma grand-mère tiens… mais finalement ça correspond assez bien avec l’agencement de cette salle qui est composée de grande armoires renfermant plusieurs dizaines d’armes. Et en reniflant bien, je sens l’odeur du métal, et puis un peu celle du coup de feu ou en tout cas celle de la poudre. Et c’était d’ailleurs la volonté de l’artiste-nez, Antoine Lie, qui voulait retranscrire l’odeur de « la poudre à canon / bête blessée » et a utilisé pour cela de la graisse à fusil ainsi que de la poudre à canon.
Cabinet du cheval : Je perçois légèrement la senteur de l’écurie, mais assez subtilement (voir trop) pour ne pas prendre au nez commeune réelle écurie. On sent bien avec cette salle que le but n’est pas de reconstituer une réelle odeur conforme à la réalité maisque c’est un vrai travail créatif, avec une interprétation propre. En regardant le cartel, je suis quand même tout à fait ravie de voir qu’il a réellement du crottin de cheval dans le parfum ! Malgré cela, plus l’on s’approche de la source de diffusion, plus l’effluve s’éloigne du crottin pour devenir du patchouli, également présent dans la composition. En recherchant également dans ma mémoire olfactive, cela me rappelle l’odeur de l’église, plus précisément l’eau bénite. Allez savoir pourquoi, peut-être que le cheval est en odeur de sainteté.
Cabinet de Diane (des chouettes) : dans cette petite salle c’est un parfum frais et fruité que ce discerne. C’est acidulé, citronné même, et me donne vraiment l’impression de me trouver dans un sous-bois un beau jour de printemps. C’est une « chouette » odeur ! Dans la fragrance, on retrouve entre autres : de l’épicéa, de la mousse de chêne, du humus.
Cabinet de la licorne : Ah, c’est doux, chaud et sucrée. Une odeur tout à fait mystérieuse qui colle bien avec la figure de la licorne. C’est très subtil mais également très enveloppant, un peu comme un nuage. Cela me rappelle très fortement l’odeur du parfum de ma mère lorsqu’elle sortait le soir quand j’étais petite et que je ne savais pas où elle pouvait bien aller : c’est ça, c’est l’odeur du mystère ! L’ingrédient principal de ce parfum est le beurre d’iris.
Donc l’odorat aussi : ☑
Solliciter les cinq sens (ou quatre, puisque le goût n’est sollicité que très ponctuellement) dans une exposition est tout à fait intéressant. Cela permet une expérience complète et l’odorat, récemment arrivé dans ce musée, permet de parfaire l’ambiance générale d’une salle. Ce dispositif sert vraiment le propos des salles out en restant délicat et non agressif pour le visiteur, qui peut-être n’en a même pas conscience et qui se fait mener par le bout du nez.
#museedelachasse
#odorat
#cinqsens
#parfum

Green Cube, le jardin comme espace d’exposition pour l’art contemporain : écueil ou révolution ?
Les institutions culturelles et les artistes s’efforcent en permanence de renouveler leur approche de l’exposition par la recherche et l’innovation en matière d’écriture du récit, de scénographie et de spatiologie. L’une des tendances est de faire sortir l’exposition des murs de l’institution pour l’ouvrir sur l’extérieur. Cette proposition – sur le papier – semble être prometteuse : valorisation de l’espace naturel, renouvellement du contexte du récit, accessibilité revisitée pour les publics, etc. Toutefois, quelle valeur ajoutée apporte-t-il aux œuvres et à l’exposition ? Est-ce une innovation, un défi ou une facilité pour les institutions ?

Vincent Mauger, Géométrie Discursive, Festival international des jardins, Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2019. ©Eric Sander
Art et jardin : une longue histoire
Le jardin permet de donner un autre regard sur les œuvres (voir les articles La scénographie du jardin et Un promenoir infini) avec le décalage produit par ce contexte d’exposition remis « au goût du jour » au regard d’un long héritage. Dès l’Antiquité les jardins se parent des plus belles œuvres d’art comme celles de la Villa d’Hadrien à Tivoli (117 à 138 av. J.-C.). Au XVIIe siècle, le travail de Le Nôtre aux jardins de Vaux-le-Vicomte, des Tuileries et surtout de Versailles marque l’avènement du jardin à la française. Les alignements de sculptures accentuent et magnifient les perspectives et les lignes pures de cette nouvelle façon de concevoir le jardin. L’association nature et art est d’autant plus réussie quand les deux s’esthétisent l’un l’autre. Le jardin avec ses allures d’espace naturel, pourtant bien contrôlé par la main du jardinier, offre un écrin verdoyant et plaisant aux promeneur·euse·s et aux œuvres.

Vue des jardins à la Française du Château de Versailles - Image libre de droit, Pixaday website
Cette osmose entre art et jardin va peu à peu s’effriter avec l’affirmation de la notion de patrimoine et de la nécessité de sa préservation pour les générations futures qui se théorise tout au long du XIXe siècle. Cette démarche va mener les œuvres à quitter peu à peu leur contexte de monstration originel (églises, jardins, etc.) pour rejoindre le giron des institutions muséales. L’approche est dans une certaine mesure compréhensive du point de vue de la conservation, les œuvres étant soumises aux éléments naturels, cependant cette coupure nette avec son contexte originel fait perdre une partie de son sens à l’œuvre.
Dans les institutions beaux-arts, les espaces d’exposition sont souvent pensés de façon à être le plus neutre possible afin de laisser le plus de place possible au « choc esthétique ». Cette recherche de neutralité est fortement liée à la révolution picturale du début du XXe siècle avec notamment les travaux de Malevitch Dernière exposition futuriste de tableaux 0.10 (1915-1916) ou ceux de Lissitzky Espace Proun (1923). Le processus d’aseptisation de l’espace d’exposition connaît son apogée avec le white cube qui a pour but de magnifier les œuvres qui y sont présentées.
Qu’est-ce-que le white cube selon Brian O’Doherty ?
Le white cube est un concept théorisé par Brian O’Doherty dans White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie en 20081. Le white cube résulte d’une recherche artistique pour les peintres de l’avant-garde qui cherchaient à rompre avec la présentation type « salon » qui était fortement répandue encore au début du XXe siècle.
D’abord utilisé par les artistes de l’avant-garde, le blanc ou blanc cassé donne aux œuvres un espace tridimensionnel neutre où elles expriment tout leur potentiel métaphysique sur un arrière-plan « infini ». Ensuite, cette couleur a été reprise par les institutions et galeries marchandes dans un souci pratique. L’espace blanc standardisé facilite le travail des institutions de présenter des œuvres hétéroclites qui doivent dialoguer entre elles. Ce modèle s’impose dès la fin de la Seconde Guerre mondiale sous l’impulsion des États-Unis, nouvelle place forte de l’art moderne.
Le cube blanc coupe l’œuvre du monde extérieur comme le rappelle l’auteur : « L’œuvre est isolée de tout ce qui pourrait nuire à son auto-évaluation2 ». Tout est fait pour que ce qui rentre dans le white cube devient art. En résumé, à l’instar du concept d’autoréflexivité de la peinture de Clement Greenberg 3 où la peinture ne doit renvoyer visuellement qu’à elle-même, le white cube selon Brian O’Doherty est un espace qui ne renvoi qu’à l’art dans sa plus grande « pureté ».

Exemple d’une scénographie d’exposition type « white cube ». Un autre monde // Dans notre monde, 2020-2021, Frac Grand Large, Dunkerque, France. - ©AGR
Ainsi, la pureté de l’espace d’exposition en tant que cube blanc exclut tout ce qui est extérieur à l’œuvre d’art. C’est ce qui a été reproché au modèle du white cube, dont l’espace est si dépouillé que les possibilités de médiations entre les spectateur·rice·s et l’œuvre sont quasi inexistantes. Le modèle du white cube plonge l’institution muséale dans une impasse, elle qui doit permettre la rencontre et le dialogue entre l’art et les visiteur·euse·s.
Dès lors, l’une des réponses les plus virulentes à cette nouvelle théorie de l’exposition s’est manifestée avec le mouvement du Land Art dans les années 70 qui marque une rupture avec les murs tous les murs. Ces œuvres isolées qui ne sont pas pensées ou intégrées dans une exposition collective, n’étaient pas de facto destinées à être vues in situ par le public, mais bien à être visibles grâce à la documentation (photographies, vidéos, etc.) que les artistes en donnaient.
Le jardin comme extension des salles d’exposition
Le white cube a été perçu par certains artistes comme un défi dans la façon de présenter leur œuvre au monde à l’instar des artistes du Land Art ou du Body Art. D’autres modèles sont venus en contre-pied du white cube, c’est le cas de la black box, où les œuvres plongées dans un espace sombre sont présentées par un éclairage individualisé. Les institutions muséales vont se saisir de la question. Certaines se dotent d’un jardin ou se dotent d’une architecture délibérément ouverte sur l’extérieur.

Vue du parc du LaM avec l'œuvre de Richard Deacon, Between fiction and Fact, 1992. - © AGR

Vue du jardin de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. - © Paris info
En clin d’œil au concept de white cube théorisé par Brian O’Doherty, le green cube désigne à la fois le jardin lorsqu’il est pensé comme une salle d’exposition voire même comme un « musée à ciel ouvert » et le jardin comme espace d’exposition « aseptisé » si un lien n’est pas fait entre l’œuvre et son contexte d’exposition, si une institution mise uniquement sur la nouveauté d’exhiber des œuvres d’art dans un jardin sans approfondir le discours curatorial ou de médiation. Par exemple, le centre d’art Chasse Spleen ou le Château Lacoste sont des exemples de green cube, où la rencontre les visiteur·euse·s et les œuvres n’est pas au cœur du discours de l’exposition. Les œuvres sont accompagnées de cartels plus ou moins détaillés, ce qui ne constitue pas une médiation aboutie. Dès lors, les œuvres retombent dans une simple fonction d’ornementation et d’embellissement pour le lieu qui les expose.
La nouvelle possibilité de muséographier et scénographier autrement l’art contemporain en le déplaçant dans un contexte paysager type green cube doit être transformé en un véritable atout pour la démocratisation culturelle. Par son cadre de visite moins institutionnel et sa proximité avec le musée, le jardin offre un tremplin vers des visites dans les institutions. La dimension multi sensorielle du jardin est un atout majeur afin de créer une approche renouvelée entre l’œuvre et les visteur·euse·s. D’autant plus que les parcs ou jardins de musée sont pour la plupart accessible gratuitement ce qui donne l’occasion aux institutions de toucher un public plus élargi.
Toutefois changer de contexte ne suffit pas, si la médiation de l’art contemporain n’est pas au centre du processus de rencontre avec le public. Il ne sera pas constructif de « poser » une œuvre dans un jardin en attendant que le « choc esthétique » fasse effet sans qu’il n’y ait eu un travail de médiation. Ce cadre insolite ne peut se suffire à lui-même, il doit permettre de renouveler la façon dont les institutions font de la médiation, réfléchissent leur programmation, conçoivent leur exposition et conservent les œuvres. Par exemple, les résidences d’artistes sont un des moyens de créer à la fois des œuvres in situ et d’incarner la médiation avec l’aide des artistes. Vent des forêts, le centre d’art contemporain « à ciel ouvert » mise sur un lien fort entre les artistes en résidence et le territoire rural de la Meuse.
Cette réflexion globale concerne aussi le choix des œuvres exposées à l’extérieur. Assurément toute la pertinence du green cube réside dans la façon dont il est curaté. Dans le cas où les institutions choisissent d’exposer des œuvres conçues in situ (et par la même occasion de soutenir la création contemporaine) le green cube n’en aura que plus de sens.
Il nous invite aussi à repenser le rapport des institutions muséales à l’écologie. La course aux expositions temporaires blockbusters à une empreinte carbone non négligeable. Proposer des expositions alternatives en extérieur qui respectent des normes environnementales. C’est le cas par exemple des expositions à Mosaïc, le Jardin des Cultures où les artistes utilisent des matériaux naturels qui se fondent dans leur environnement. C’est ce genre d’initiative qui renforce le rôle du musée au sein de la société en contribuant à la transition écologique4.
Axelle Gallego-Ryckaert
1Il s’agit de la traduction d’une série d’articles mythiques parus dans Artforum en 1976
2Brian O’Doherty, « Notes sur l’espace de la galerie » (1976), White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, 2008, Paris, La Maison Rouge, p. 36.
3Clement Greenberg, Art en théorie, 1900-1990, Paris, Hazan, 1997
4Voir définition des musées par l’ICOM en 2019.
#greencube #whitecube #artcontemporain

Immersion au musée municipal d'Helsinki
Il fait chaud pour un mois d’août à Helsinki, la ville est pleine de touristes ce qui contraste avec les autres villes de Finlande. En flânant entre la cathédrale et la place du marché, un bâtiment siglé « MUSEE », m'attire.
Je pénètre sans le savoir dans le musée municipal d'Helsinki, ouvert en 2016 et qui se revendique être avant tout un lieu de vie, ouvert à tous les visiteurs. Le grand hall, point central de ce lieu constitué d'un groupement de 5 bâtiments et 3 cours intérieures, est plein de groupes, d'enfants, de touristes, attirés par une entrée libre et une ouverture tous les jours. Je m'approche du guichet, on me distribue le plan et je commence l'exploration de ce lieu peu banal, pour découvrir l'histoire de la capitale finlandaise et la vie de ses habitants.
Au rez-de-chaussée, la découverte de la ville commence grâce à une machine à remonter le temps qui fait revivre l’Helsinki d’il y a cent ans à travers des scènes de la vie urbaine capturées par la photographe Signe Brander et qui s’animent grâce à des lunettes de réalité virtuelle : ainsi défile l’évolution des paysages de la capitale au fil des années.

Projection de la ville interactive, à droite, les casques de réalité virtuelle © Cloé Alriquet
Au premier étage, le retour dans le passé n’est plus virtuel.
La visite commence par l'obtention du journal "Helsinki Echo" qui en plus d'avoir l'allure d'un quotidien, est un plan du musée et donne des informations supplémentaires sur les différentes zones d'exposition. On explore ainsi plusieurs "morceaux choisis" du quotidien des habitants - d'où le titre, Helsinki Bites-, d’une rue passante restituée, en passant par un appartement des années 1950 où l'on peut s'installer et écouter la radio, un bar des années 70 où l'on peut découvrir sur un juke box les musiques finlandaises populaires de cette époque mais aussi un téléphone public qui sonne où l'on entend en décrochant le témoignage sonore d'habitants de la ville. La scénographie très immersive, l’ambiance sonore constante et l’utilisation du numérique par exemple par des projections de personnes dans des environnements comme le bar, apportent beaucoup de stimuli à la visite de cette exposition qui comporte peu de texte mais beaucoup d’images et qui relève plus de l'exploration et de l’expérience. La dernière salle consacrée au skateboard à Helsinki depuis l’ouverture du musée, a vocation à changer régulièrement car elle est imaginée avec des associations et des habitants sur des thématiques en lien avec la ville.


Une rue finlandaise vs une salle sur la pratique du skateboard à Helsinki © Cloé Alriquet
Reparti entre le premier et le deuxième étage, Children's Town, invite les jeunes visiteurs (et les plus grands !) à une expérience immersive. Ils peuvent jouer dans un bateau, dessiner, passer des déguisements, suivre une leçon sur les bancs d’une école du siècle dernier recréée à l’identique et même entrer dans un appartement des années 1970 où chaque week-end, une médiatrice du musée y joue la grand-mère. Les salles, en plus de présenter des jouets à manipuler, expose des objets en lien, ainsi à côté d'une maison de poupée gigantesque, se trouve en vitrine des maisons de poupées d'époque. On retourne en enfance avec l'envie de tout toucher, de tout explorer !


Jouer aux poupées ou découvrir un appartement ancien, des livres au transistor à Children’s town © Cloé Alriquet
Le troisième et dernier étage du musée est un espace réservé aux expositions temporaires. Les expositions réalisées depuis l'ouverture du musée ont toutes un point commun : raconter la vie des habitants d'Helsinki sous le prisme de l’émotion, du sensible.
Ainsi, la première expo qui s’y est tenue s’intitulait « musée des relations brisées » (Museum of Broken Relationships) pour laquelle de nombreux Finlandais ont fait don anonymement d’un objet ou d’une histoire évoquant l’une de leurs relations qui se sera soldée par une rupture. Se sont ainsi retrouvés exposés entre autres des bagues, des vêtements divers, des cartes routières... Les donateurs de ces objets ont écrit eux-mêmes les quelques mots destinés à présenter leur objet au public. Pour une autre exposition intitulée Smell, le musée a demandé aux habitants d’Helsinki quelles odeurs incarnaient le mieux la ville. La dernière en date, intitulée Helsinki Hobo, s'intéresse aux sans-abris, aux prostituées et à toutes personnes habituellement invisibles dans la rue à travers le récit d’un écrivain finlandais.
Quel meilleur moyen pour attirer des visiteurs que de mettre en avant leurs émotions ou de parler de leur ville sous un angle inattendu ?
De retour au rez-de-chaussée, de multiples activités s’offrent à moi : boire un café ou manger un bout, visiter la boutique pour y acheter des objets design, me prélasser dans des canapés ou visiter les archives du musée accessibles librement et qui comptent plus d’un million de photographies d’Helsinki, que l'on peut admirer sur place et même imprimer contre quelques euros !

La photothèque du musée, en libre accès ! © Cloé Alriquet
En conclusion, la posture assumée du musée municipal d’Helsinki est de mettre en avant la vie quotidienne des Finlandais hier et aujourd’hui, sans trop de texte avec des visuels, de l'interactif et en attirant les enfants. Ce lieu est une vrai bouffée d'air frais dans la ville : grand, aéré, ouvert et surtout en phase avec son époque.
Cloé Alriquet
Le site du musée : https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/en/
#musee
#helsinki
#finlande

L'Artothèque de Mons, ou la réserve qui s'expose
« Un jour mon visiteur viendra ». Les belles œuvres dormantes de Mons n’ont plus à s’inquiéter d’un sommeil éternel. Les emprunteurs les émergent d’un monde à part et intemporel. Souvent inconnue des visiteurs, la fonction mystérieuse des réserves nourrit les fantasmes et mystifie les musées. Mettant au défi la ville de valoriser ses collections, elle dévoile désormais ses secrets.
L’Artothèque est installée dans la Chapelle du couvent des Ursulines, elle mutualise les collections communales qui ne sont pas exposées de manière permanente dans les autres musées de la ville : il s’agit d’une réserve à la fois centralisée et partagée. Elle a pour rôle de conserver, communiquer et rendre visible les métiers de la conservation auprès du public. Ce bâtiment rassemble un centre de réserve, de restauration, d’étude et de gestion du patrimoine.
Exposer une réserve, c’est créer l’ambiguïté entre lieu d’exposition et lieu de conservation. L’Artothèque de Mons en Belgique nous révèle la face cachée d’une partie des musées montois, là où les œuvres semblent toujours sommeiller. Révéler ce qui est dissimulé, c’est offrir au grand public une rencontre privilégiée et personnelle avec les œuvres.
Une collection vivante grâce au public et au personnel

Artothèque de Mons - © Estelle Brousse
La transmission des savoirs sur ces œuvres et leur accessibilité sont l’une des priorités de l’artothèque. Etendue sur un total de six étages, c’est au rez-de-chaussée que la réserve s’ouvre au public. Elle y est visible au travers d’une vitrine et se visite sur demande. Attirant les Montois, les scolaires et les professionnels, cet espace a longtemps été perçu comme une institution décalée dans la ville.
Mais le nombre de prêts en confirme le succès. Le prêt et la circulation des œuvres est un moyen de démocratiser et de faire connaître la richesse, la diversité, et les pratiques artistiques du patrimoine communal. Le nombre de prêts étant en constante croissance, les œuvres circulent hors-les-murs du musée et de la réserve. L’artothèque élargit également ses usages et devient Artothèque « Pop-Up » : elle ouvre ses collections pour la création de nouvelles expositions thématiques. Lieu central du patrimoine communal, elle est vecteur d’échanges entre structures culturelles. C’est par exemple le cas du Musée royal de Mariemont à Morlanwelz pour son exposition Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens de septembre 2020 à avril 2021, déclinée à l’Artothèque de Mons et à Tournai. Le BAM collabore également avec l’Artothèque pour l’exposition École de Mons. 1820-2020. Deux siècles de vie artistique de mars à août 2020. Mais la réserve ne vient pas seulement mettre en lumière les œuvres, elle valorise aussi des métiers bien souvent méconnus du grand public et révèle le travail de conservation préventive.
La médiation et l’accompagnement du visiteur y sont essentiels. Puisque la réserve a encore souvent une fonction méconnue et reste dissimulée auprès du grand public, l’implication du personnel dans la médiation vient renforcer cette volonté de transmission, et l’appropriation du lieu par tous. Agents d’accueil et gardiens s’investissent dans l’accompagnement du public, ils lui donnent les clés pour qu’il prenne en main sa visite.
Un lieu de conservation, un espace d’innovation


Artothèque de Mons - © Estelle Brousse
L’espace immersif accessible aux visiteurs, appelé l’«Artothèque virtuelle», cherche à faire comprendre le fonctionnement réel d’une réserve, bien qu’il reste avant tout une vitrine où l’interactivité prime. La réserve au rez-de-chaussée facilite l’observation et la contemplation des œuvres pour son public, tandis que le reste des réserves, accessibles uniquement par les professionnels concernés, privilégie l’optimisation d’espace et la praticité du rangement pour une conservation optimale des collections.
Le numérique invite à la participation, il autonomise le visiteur dans sa découverte des collections. Les œuvres exposées sont régulièrement remplacées, et les dispositifs mis à jour. Tous ces moyens mis en œuvre ont pour objectif de faire vivre le patrimoine.
Dans la partie des réserves visitables du Louvre Lens, l’emploi des outils interactifs offre la possibilité pour le musée de mettre en valeur ses missions centrales : celles de l’enrichissement, de l’étude, de la restauration, de la conservation et de l’exposition des collections. Mais c’est aussi l’occasion d’aborder des thématiques allant au-delà de la réserve comme le transport d’œuvres, l’histoire des collections, le montage, la scénographie ou encore les techniques de restauration. L’ouverture de ces espaces qui se veulent représentatifs de la réalité propose une meilleure compréhension des coulisses, mais lève aussi le voile sur d’autres missions méconnues du musée.
La visibilité des collections de l’Artothèque de Mons offre par ailleurs l’occasion de faire avancer le travail de recensement : la numérisation des œuvres va nourrir le catalogue et l’inventaire, et apportera de précieuses informations pour d’éventuelles restaurations. L’artothèque a été pensée et conçue de telle sorte que l’espace soit le plus optimisé possible, tout en assurant une traçabilité physique et virtuelle des objets.
Véritable lieu de ressources et outil au service du public, l’artothèque partage ses locaux avec un centre de documentation. Ce centre participe au réseau des bibliothèques publiques et interagit avec les collections communales et le patrimoine montois.
Par ailleurs, l’Artothèque renouvelle la représentation académique de l’histoire de l’art. Dans la base numérique et dans l’espace de mise en vitrine, les œuvres ne sont pas cloisonnées dans leurs époques mais mélangées de la Préhistoire à l’Art Contemporain, tel un cabinet de curiosités.
Cet espace invite le public à ne pas être un simple spectateur durant sa visite. Au centre des services qui lui sont proposés il est invité à chercher, observer, comparer les œuvres et nourrir sa curiosité. Par ailleurs l’accessibilité à une partie des réserves et la transmission des connaissances sur le patrimoine communal cultive une relation de confiance entre les habitants, leur patrimoine et les structures culturelles. Le développement de ces espaces sur les territoires est primordial pour donner la possibilité à chacun de s’approprier collections et patrimoine.
Coline Declercq
#artothèque
#conservation
#innovation
Sources
Visite de l’Artothèque présentée par Xavier Roland, Responsable du Pôle muséal de la Ville de Mons et directeur du BAM, et par Sophie Simon, Conservatrice adjointe des collections communales montoises.
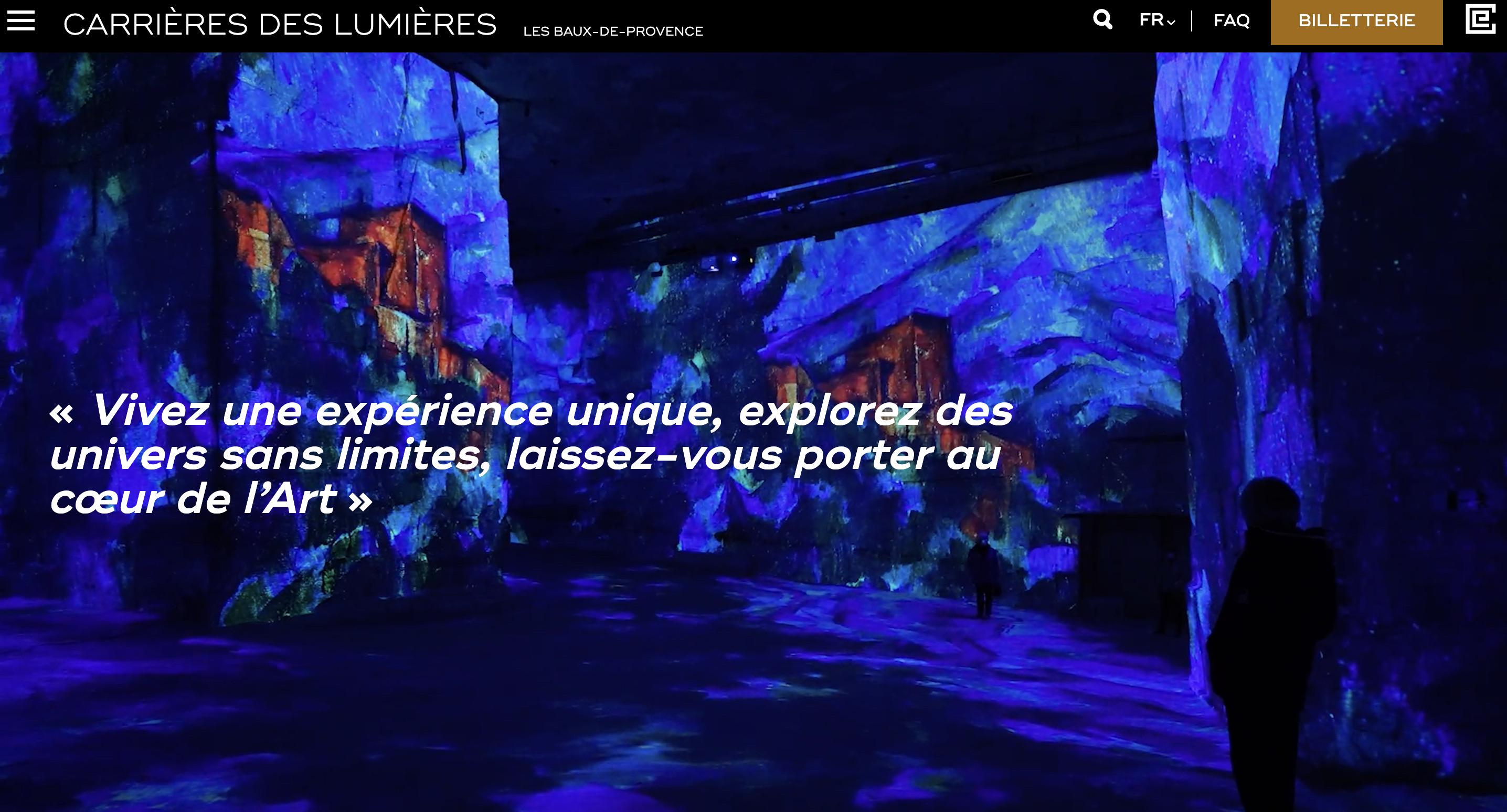
L'immersif, un appât des publics
Certains de mes amis « n’aiment pas » l’Art. Face à ma mine déconfite, ils concèdent souvent qu’ils préfèrent le « vrai Art », à savoir celui du réalisme, de la précision, du détail, de la technique et de la beauté — au sens kantien du terme. Pourtant, ils se surprennent eux-mêmes à s’émerveiller devant des expositions d’un genre nouveau : l’Art Immersif. Sorties de leurs cadres, la peinture et la photographie se métamorphosent en immenses projections sont les yeux ébahis de leurs nouveaux publics. La sculpture n’a rien à leur envier : elle invite à présent le visiteur à la traverser au lieu de la contourner. Parfois à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, l’image et le son remplissent l’espace et enveloppent le spectateur. Les cinq sens sont occasionnellement mobilisés.
Image d'intro : site web de la Carrière de Lumières
Un succès commercial
L’entreprise privée Culturespaces, cinquième acteur culturel français pour les monuments, musées et centres d’arts, se décrit comme un « pionnier des centres d’art numérique et des expositions immersives dans le monde ». Les chiffres attestent de leur succès : leur premier espace la Carrière des Lumières à Baux-de-Provence accueillait 239 000 visiteurs à son ouverture en 2012. Aujourd’hui, ils sont près de 770 000 chaque année. En 2017, l’espace obtient le prix de « la meilleure expérience immersive au monde », décerné par l’association à but non-lucratif Themed Entertainment Association qui récompense majoritairement… des attractions de parcs à thème.
Après le succès de l’Atelier des Lumières (le premier centre d’art numérique de Paris, 1 400 000 visiteurs/an, 2018), du Bunker des Lumières (Jeju, île sud-coréenne, 2018), du Bassin des Lumières (le plus grand centre d’art numérique au monde, 14 500 m² de surface de projection, 2020), leurs espaces d’expositions immersives se multiplient et s’exportent à l’étranger. Entre 2021 et 2022, Culturespaces inaugurera quatre nouveaux lieux à Dubaï, New-York, Séoul et Amsterdam.
La société produit deux types d’exposition : des « expositions temporaires classiques » dans les musées dont elle assure la gestion (Musée Jacquemart-André, Musée Maillol, Hôtel de Caumont…) et des « expositions numériques immersives » où se succèdent des peintres du XIXe et du XXe siècles (Van Gogh, Monet, Chagall, Gauguin, Klimt, Dali, Picasso…) et de la Renaissance (Michel-Ange, De Vinci, Raphaël, Bosch, Brueghel, Arcimboldo…). Dans un format plus court, elle propose aussi des expositions sur Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein… voire des créations d’artistes contemporains. On ne saurait leur reprocher que toutes leurs expositions numériques soient quasi-identiques d’un espace à l’autre : il est plus simple de transporter une exposition numérique qu’une exposition faite de chefs d’œuvre uniques et aux valeurs inestimables, surtout à l’international.
Ces expositions ne sont-elles donc pas l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les travaux des peintres les plus célèbres ? C’est en tout cas la volonté affichée par la Fondation Culturespaces dont la mission est de « permettre aux enfants les plus fragilisés d’avoir accès à l’art et au patrimoine pour éveiller, développer et révéler leur créativité […] afin de lutter contre les inégalités d’accès à l’art et au patrimoine ». Une initiative louable et sans doute bienvenue lorsque que l’on s’intéresse aux tarifs de l’Atelier des Lumières.
Source : site web de l’Atelier de Lumières
Dans leur Sociologie de la démocratisation des musées (2011), Jacqueline Eidelman et Anne Jonchery donnent les chiffres suivants concernant les visiteurs des musées parisiens : « Sous l’angle de leur inscription sociale, les 18-25 ans sont […] en majorité issus des classes moyennes (45 %) et de la classe supérieure (30 %), mais le quart d’entre eux provient d’un milieu modeste : ce sont ces derniers qui s’avèrent les plus mobilisés par la gratuité. […] Au total, les visiteurs âgés de 18 à 25 ans pensent que la gratuité constitue un « coup de pouce » ou un « plus » à leurs pratiques culturelles (85 %). »
La logique commerciale de Culturespaces n’est cependant pas à décrier pour autant. La majorité des expositions immersives affichent des tarifs similaires, et présentent au moins l’avantage d’être plus intuitives et accessibles que les expositions dites classiques. L’exposition teamLab : Au-delà des limites présentée à la Grande Halle de la Villette en 2018 proposait ainsi une belle entrée en matière d’art numérique contemporain. Cette dernière plongeait ses visiteurs dans un univers psychédélique et les rendaient acteurs de l’immersion : toucher la cascade numérique pour qu’elle s’écarte, s’assoir sur le sol et contempler les fleurs pousser autour de soi…
L’immersif au musée
Pour autant, il ne faut pas confondre œuvre et expérience de l’œuvre. Pour Isabelle Cahn, historienne de l’art « on doit pouvoir avoir la liberté d’interpréter les œuvres […] Mais il faut trouver un juste équilibre entre pédagogie et divertissement. Les procédés immersifs, la 3D ou la réalité virtuelle peuvent réellement aider à mieux regarder les œuvres ». Vincent Campredon, directeur du Musée national de la marine à Paris confie ainsi au Monde : « Un musée a une mission de conservation des œuvres. Mais il doit aujourd’hui parler aux jeunes, être plus accueillant, plus collaboratif. Les publics doivent être au cœur de nos préoccupations ». Dans le même article, Constance Guisset, scénographe, explique : « Si on veut que les expositions ne soient pas réservées aux “sachants”, il faut aujourd’hui les mettre en scène un peu comme un spectacle ».
De nombreux musées tentent donc de développer leur attractivité en proposant des expériences immersives, même partielles, au sein de leurs expositions. Parfois, ce sont quelques œuvres qui sont placées en début de parcours, ce qui a l’avantage de marquer la visite. Prenons l’exemple de l’exposition — très instagrammable — Colors qui a récemment pris fin à Lille3000. L’une des œuvres, First Light de Georg Lendorff, invite le visiteur à traverser ses milliers de fils suspendus pour entrer dans un espace spatio-temporel hypnotique, mobilisant simultanément la vue, l’ouïe et le toucher. Effet garanti.
Certaines institutions semblent se lancer un défi de plus grande envergure. En janvier 2021, la Banque des Territoires, au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat, et VINCI Immobilier annonçait la création de Grand Palais Immersif, une « nouvelle filiale spécialisée dans la production, l’exploitation et la diffusion d’expositions numériques, pour le public parisien, national et international ». Pour l’instant, en France en tout cas, les expositions et musées entièrement immersifs sont donc l’affaire de grands groupes internationaux, comme le prouve encore le musée immersif de la marque Yves Rocher situé à La Gacilly en Bretagne.
Source : site web du Musée immersif Yves Rocher
Fun fact : en 2019, l’ICOM a demandé à chacun de ses pays membres de donner une ou plusieurs propositions de re-définition du musée. Parmi les 269 définitions formulées, le Qatar était le seul pays à inclure la notion d’expérience immersive.
L’immersif est probablement un appât pour un public friand de spectacle, mais il ne faut pas pour autant le condamner. Ces nouvelles mise-en-scène numériques ont l’avantage de proposer un contenu accessible qui ne nécessite pas de connaissances préalables ou de sensibilité particulière. Elles se laissent apprécier en toute simplicité. Dans le cas des productions Culturespaces, peut-être piqueront-elles la curiosité de nouveaux publics pour les musées ?
Il ne s’agit pas de remplacer les œuvres par des expériences : ce n’est pas la vocation de nos musées et de toute façon, nos institutions n’en ont pas les moyens financiers. Les professionnel.le.s des musées doivent trouver un équilibre entre le fond et la forme. Trop de fond, c’est lourd ; trop de forme, c’est vide.
Emma Levy
Pour aller plus loin :
-
Eidelman, J. & Jonchery, A. (2011). Sociologie de la démocratisation des musées. Hermès, La Revue, 61, 52-60.
-
L’exposition Team Lab de la Villette (2018)
-
Lesauvage, Magali. (2019, 15 mars). Les expositions immersives : in ou out ? Le Quotidien de l’Art.
-
Pietralunga, Cédric. (2021, 3 novembre). Expérience immersive et objets parlants : les musées innovent pour attirer un nouveau public. Le Monde.fr
-
Propositions de définitions du musée par l’ICOM
-
Sonveau, Aimé (2022), Expérience sensorielle, sensationnelle ou sensible ? L'art de Muser
#immersif #experience #numérique
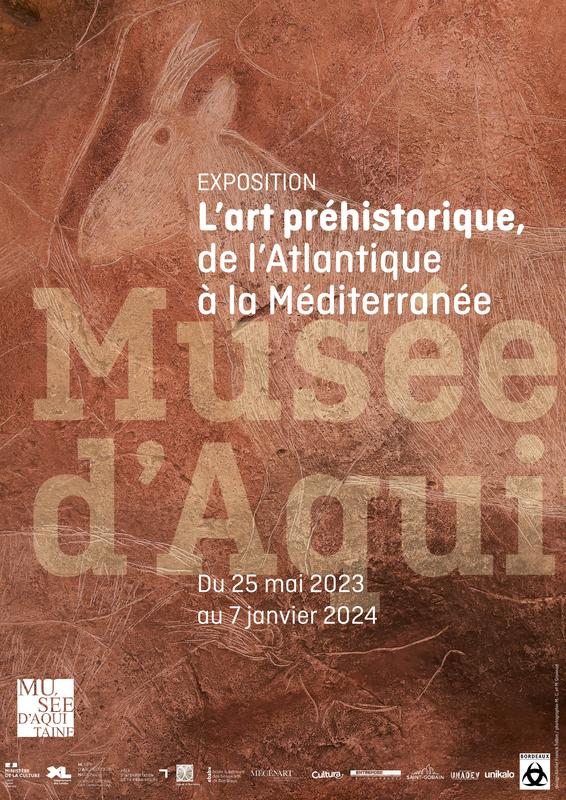
L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée
Une exposition (pré)historique
L’Art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée est une exposition produite par le musée d’Aquitaine, en collaboration avec un comité scientifique international. Cette exposition a pour ambition de tenter de répondre à des questions telles que : « A quoi sert cet art ? Qui l’a fait ? Est-ce seulement de l’art ? » grâce aux nouvelles méthodes d’étude et de restitution, comme les fac-similés ou encore la 3D, mais aussi à partir d’un nombre exceptionnel d’artefacts préhistoriques inédits ou rarement montrés au public. A travers le prisme géographique de la chaîne pyrénéenne, l’exposition présente l’art préhistorique sous toutes les formes connues. Le but n’est pas tant de fasciner le visiteur mais de le faire s’interroger sur le rôle de l’art, sur ces artistes, voire même sur la définition de l’art.
Si les questions autour de l’art préhistorique agitent les esprits depuis qu’on a découvert les premières pièces du genre au XIXe siècle, le musée d’Aquitaine, installé dans l’ancien palais des Facultés et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, apporte aujourd’hui des éléments de réponse. De la parure aux instruments de musique en passant par les grottes ornées, le musée d’Aquitaine propose une thématique qui n’avait pas été traitée depuis près de 30 ans et passe les arts préhistoriques pyrénéens au crible.
Une exposition internationale
Si l’événement est transfrontalier par la trentaine de prêteurs privés et institutionnels français, espagnols et portugais, il l’est aussi dans sa conception avec un comité scientifique venant des mêmes horizons. Grâce à ces collaborations, ce sont près de 600 pièces qui sont réparties sur 800m² au musée d’Aquitaine. Un tiers d’entre elles sont en réalité des moulages ou des reproductions. C’est une caractéristique courante dans les expositions préhistoriques pour plusieurs raisons. D’une part, ces pièces sont aussi exceptionnelles que fragiles au vu de leur ancienneté, elles ne peuvent donc pas toutes voyager. D’autre part, bien que certaines pièces soient conservées en réserves, voire, pour certaines, jamais montrées au public, d’autres sont dans les vitrines des parcours permanents des musées préteurs, et l’on ne peut pas se permettre de vider leurs vitrines ! Enfin, certaines conditions de donations aux musées ne leur permettent pas de sortir les artefacts de leur enceinte. C’est le cas de l’exceptionnelle collection Piette, donnée au Musée national d’archéologie. Elle a été mise en scène par E. Piette, et la scénographie n’a plus le droit d’être modifiée, et ce, sans prescription.
L’art paléolithique est présenté dans l’exposition dans sa réalité géographique : l’écrasante majorité de la production artistique européenne qui nous est parvenue se situe dans l’extrême sud-ouest du continent, soit entre la France et la péninsule Ibérique.
Cette exposition est aussi conçue pour être itinérante. Sa présentation à Bordeaux jusqu’au 7 janvier 2024 n’en est que le premier acte, elle partira ensuite à la rencontre des visiteurs espagnols, à Saint-Sébastien du 1er mars au 2 juin 2024, avant de se partager durant l’été entre le musée archéologique de Santander et le musée national d’Altamira. Puis elle se déplacera au musée de Foz Côa au Portugal à l’automne 2024, avant de revenir en France entre avril et septembre 2025 à l’Abbaye d'Arthous dans les Landes. Elle fera un passage en 2026 aux Eyzies, en Dordogne, avant de finir son périple en 2027 à Bilbao, de nouveau en Espagne.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Des thématiques variées et complémentaires
Le parcours aborde le sujet de manière à ce que le visiteur ait une vision d’ensemble du phénomène. Il se développe en plusieurs thématiques, en commençant par la difficile reconnaissance de l’existence de l’art préhistorique par les scientifiques de la fin du XIXe siècle. Mais c’est aussi l’actualité de la recherche qui est développée : des méthodes d’études du siècle passé jusqu’aux dernières avancées techniques (fac-similé, photogrammétrie, impression 3D).
L’exposition s’interroge sur le cadre climatique et environnemental dans lequel vivaient les artistes et sur la place qu’ils ou elles avaient dans la société. Malgré la barrière géographique que sont les Pyrénées, il existe des points de passage et l’on voit bien des circulations, des échanges, des influences très nettes sur plusieurs centaines de kilomètres du nord de la chaîne, jusqu’au nord du Portugal. Cet espace dépassait d’ailleurs largement les limites actuelles, puisqu’au Paléolithique récent, le niveau de la mer était jusqu’à 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui. A présent, toute la frange littorale est submergée et des sites exceptionnels sont engloutis, comme l’a été par exemple la grotte Cosquer.
Qu’il se développe sur du petit mobilier ou sur de vastes parois dans les grottes, cet art préhistorique fait la part belle aux animaux. Les pièces exposées sont réparties par biotopes, avec les cerfs, biches, ours et carnivores dans le biotope forêt, ou encore les phoques, poissons et grues dans un biotope aquatique. Les représentations humaines, bien que moins connues, sont toutes aussi remarquables. Mais dans l’art paléolithique, ce sont aussi les signes abstraits et codifiés qui sont omniprésents, sans que leur sens nous soit accessible.
De par la grande variété de techniques, de supports, de pigments et d’outils, l’art préhistorique c’est aussi la parure et la musique. Les nouvelles technologies permettent de voir à quel point le geste est maîtrisé. On sait actuellement restituer l’ordre des traits de gravure - de la tête de l’animal, qui est toujours première, jusqu’à l’intérieur du corps -, dire si le graveur était droitier ou gaucher, et si plusieurs mains sont intervenues. L’exposition questionne aussi l’art du jeu grâce à des reconstitutions d’empreintes de main d’enfants dans l’argile à côté desquelles ont été retrouvées des boulettes d’argile projetées contre les parois de la grotte de Fontanet (Ariège).
L’exposition donne l’occasion au visiteur de comprendre le « comment ? » de l’art préhistorique. Cependant, en ce qui concerne le « pourquoi ? », depuis la reconnaissance de l’art pariétal, toutes les interprétations avancées ont donné lieu à autant d’arguments les invalidant, et il existe désormais un certain consensus sur le fait qu’il faut renoncer à interpréter ! Aujourd’hui, on peut simplement dire que cet art était certainement un marqueur social et territorial, et qu’il n'était pas toujours fait pour être vu, comme l’indiquent certaines représentations placées à des endroits qui n’offrent aucun recul, à très grande hauteur ou dans des espaces très difficiles d’accès, réduisant à un nombre assez limité les personnes pouvant les voir.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Chacun y trouve son compte
Chaque espace de l’exposition comporte un module multisensoriel qui permet à tous les visiteurs de découvrir l’exposition, non pas seulement avec la vue, mais aussi grâce au toucher, à l’ouïe ou encore à l’odorat.
Le sens du toucher est particulièrement sollicité, grâce à la reproduction en relief d’un cerf de la grotte de Las Chimineas (Cantabrie) permettant l’accès de l’art pariétal aux non-voyants, mais aussi de reproductions en taille agrandie de mobilier remarquable tels qu’une statuette d’ours en position assise, la dame de Brassempouy, ou encore, deux bouquetins sculptés sur une dent de cachalot. La plupart des matières premières que pouvaient utiliser les groupes paléolithiques peuvent aussi être vues et touchées grâce à un module dédié. De plus, tous les textes de ce parcours sont traduits en braille. Le visiteur peut aussi familiariser son oreille aux sons que peuvent produire la baleine, le cerf, l’ours ou encore le renard, tout comme aux sons des premiers instruments de musique paléolithiques : sifflet de la grotte de Bize, flûte d’Isturitz, rhombe de la Laine, et conque de Marsoulas. Enfin, le visiteur a l’occasion de se plonger dans une grotte, une steppe, ou bien une forêt grâce à son odorat et aux boites à odeurs du module de contextualisation environnementale.
Ce parcours multisensoriel est aussi composé d’une maquette topographique, en bois, de la zone géographique mise à l’honneur par l’exposition. Les visiteurs peuvent toucher les reliefs pyrénéens.
Une imprimante 3D, outil incontournable d’une exposition composée d’artefacts aussi fragiles et rare, est exposée et imprime avec un filament biosourcé fait d’amidon de maïs et de coquilles d'huîtres, pendant toute la durée de l’exposition des pendeloques en ivoire imitant la forme d’une cyprée (coquillage) de la grotte de Pair-non-Pair. Ces impressions sont distribuées sous forme de goodies lors de visites guidées ou d’ateliers.
Afin de préserver au mieux la surstimulation sensorielle de certaines personnes, deux périodes par semaine sont identifiées comme « temps calme ». Le son et la lumière de l’exposition sont abaissés, et les visiteurs ont pour consigne de s’exprimer à voix basse.
Par ailleurs, un parcours famille est accessible tout au long de l’exposition. Il s’adresse au public libre, en premier lieu aux enfants et accompagnants de tout âge, mais aussi à tout visiteur friand d’une visite ludique de l’exposition. Le fil rouge de ce parcours correspond à l’aventure d’un archéologue qui va d’abord découvrir une grotte préhistorique fictive, puis en étudier les artefacts et manifestations symboliques qui s’y trouvent grâce à des quizz, des manipulations de reproductions 3D ou encore des jeux d’association.
Ce parcours a pour but de proposer une visite complémentaire ou alternative aux visiteurs, selon leurs besoins ou envies. Il se veut avant tout ludique, mais aussi pédagogique, afin de faire passer des concepts clés de l’art préhistorique et de son étude. Cela se fait au travers d’une quête au cours de laquelle les visiteurs remplissent de tampons un passeport d’archéologue avec lequel ils pourront repartir. Ces derniers peuvent aussi choisir de profiter du parcours sporadiquement, les contenus et l’amusement n’en sont pas moins au rendez-vous.
Pour ces raisons, et bien d’autres, l’exposition L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée s’adresse à la fois au public familial et individuel, aux érudits, aux amateurs ou aux curieux, aux personnes valides autant qu’aux personnes porteuses de handicap.
Alors n’attendez pas et revenez 40 000 ans en arrière, découvrir toute la complexité et la variété des arts de la préhistoire !

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Coline Favreau
Pour en savoir plus :
- Site de l’exposition – Musée d’Aquitaine : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/exposition-lart-prehistorique-de-latlantique-la-mediterranee
#exposition #préhistoire #médiation #tout public

L’exposition photographique en plein air : enjeux et limites d'un modèle d'exposition contemporain
Alors que les événements de photographie en plein air se multiplient chaque année, quelles nouveaux paradigmes met en place ce type d'exposition ?
Vue de l’exposition « Les expérimentales #2 » proposée par le festival Photo Saint-Germain sur le quai de Solférino en novembre 2023 ©J.N
Photographie en plein air : une offre de plus en plus récurrente
S’il n’est pas nouveau, le succès des expositions de photographie en plein air se confirme. Le Festival photo de La Gacilly par exemple, créé en 2004, accueille désormais 300 000 visiteurs annuels dans une expérience immersive et déambulatoire au cœur du village breton. Dans son texte de présentation, l’événement argue que “l’espace public devient un espace scénique, partagé et accessible à tous, gratuitement. Le Festival peut ainsi se prévaloir d’être suivi par un public de fidèles connaisseurs autant que par un public de complets néophytes.”

Visiteurs au Festival de la Gacilly ©Jean-Michel Niron
Quand la photographie s’installe dans l’espace urbain
Où placer une exposition de photographie en plein air ? Le choix des lieux d’implantation de ce type d’expositions est également intéressant à analyser. On observe bien sûr une forte préférence pour les lieux de passage ou d’affluence : parc, rues fréquentées, quais, gares…

Exposition “Club Ivoire" de François Prost sur les grilles du jardin Villemin lors des Rencontres Photographiques du 10ème en 2023. ©J.N
Le lieu de passage quotidien “ultime”, le métro parisien, est aussi régulièrement utilisé par la RATP elle-même dans le cadre de la programmation “La RATP invite”, en collaboration avec des institutions comme le Jeu de Paume, des festivals comme Circulation(s) ou des magazines comme Fisheye. Créé en 2013, ce programme expose régulièrement des photographes variés ; sur la page consacrée de son site internet, la RATP décrit le choix du médium photographique par le fait qu’il s’agit d’un “art communautaire et d’une forme d'expression artistique accessible au plus grand nombre”. Argument souvent mis en avant dans les programmations liées à la photographie, et complété par les nombreux avantages concrets induits par le médium. L’exposition de photographie en plein air permet en effet de s’émanciper des contraintes habituelles de conservation : reproductibilité des œuvres, techniques résistantes, affranchissement du cadre, accrochage facilité, souvent sur des grilles ou en utilisant des pupitres lestés, qui peuvent être disposés à peu près n’importe où tant que l’autorisation en est donnée. Les événements mettent d’ailleurs généralement en place des partenariats directement avec les collectivités locales, ce qui permet de faciliter largement cette question de l’accrochage dans l’espace public. C’est par exemple le cas de la Biennale de l’Image tangible, soutenue à la fois par la Mairie du 20ème arrondissement et la Mairie de Paris.

Exposition de photographies sur les quais du RER B dans le cadre du Festival Circulation(s) en 2022. ©Hamdi Chref
Certains événements peuvent même investir les supports publicitaires dans l’espace public : c’est le cas de la Biennale de l’Image Tangible qui proposait, à l’automne dernier, des photographies dispersées dans l’est parisien sur des panneaux d’affichage, dans le cadre d’un partenariat avec Clear Channel. Ce type de collaboration peut d’ailleurs poser question, tant un partenariat avec un magnat de l’affichage publicitaire semble éloigné des valeurs d’accessibilité mises en avant par la Biennale autour de cette programmation.

Un panneau d’affichage Clear Channel dans la cadre du projet in situ de la Biennale de l’Image tangible en 2023 ©BIT20 2023
Des expositions réellement accessibles ? Publics et évaluations
Comme vu précédemment, la gratuité est souvent un argument mis en avant dans la communication des expositions de photographie en plein air. De même, ce mode d’exposition peut résoudre le problème de l’effet de seuil, enjeu majeur pour bon nombre de musées. Mais paradoxalement, ce type d’exposition - en dehors des festivals dédiés - n’intègre que très rarement des médiateurs : difficile à mettre en place, la médiation se résume généralement aux textes et aux cartels.

En novembre 2023, le festival Photo Saint-Germain proposait une exposition sur les quais de Seine ©J.N
Autour de cette question, deux visions de ces manifestations peuvent être mises en regard : l’exposition comme un médium, un moyen d’apprentissage ou d’ouverture d’esprit d’une part, et une approche plus sensible d’autre part, où le but n’est pas forcément d’apporter des informations mais de distiller de l’art dans l’espace public. En ce sens, l’exposition photographique en plein air est un médium idéal : relativement simple à mettre en place, se découvrant au détour d’une promenade ou d’un trajet quotidien, elle permet, sinon de sensibiliser, d’habituer les regards à l’observation de la photographie et de désacraliser des pratiques encore élitistes. L’image est là, appartient à chacun, et se prête à autant d’interprétations que de regardeurs, et ce sans la pression “d’être visiteur” impliquée par le cadre du musée.
Jeanne Nicolas
Pour en savoir plus :
- La page dédiée à RATP invite x Festival Circulation(s) : https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/la-ratp-invite-le-festival-circulations-sur-son-reseau
- Le partenariat entre la Biennale de l’Image tangible et Clear Channel : https://bit20.paris/edition-2023/projet-in-situ
- L’exposition de Photo Saint-Germain au Quai de Solférino : http://www.photosaintgermain.com/editions/2023/parcours/quai-de-solferino
#photographie #pleinair #hors-les-murs

L’Odyssée muséale
A l’occasion de la 25e Conférence générale de l’ICOM, qui se tiendra à Kyoto en septembre 2019, un appel à contribution a été lancé en mars dernier pour repenser la définition du musée. Le parfait prétexte pour s’interroger sur la nature du musée, tel qu’il était à ses débuts antiques et tel qu’il se veut 2500 ans plus tard… Avaient-ils tout compris jadis ?
Si la définition actuelle du musée place l’acquisition et la conservation des objets en tête de ses missions, il n’en a pas toujours été ainsi. Dans l’Antiquité classique, des biens précieux sont effectivement rassemblés auprès des temples, et bien qu’ils soient destinés aux dieux, ces trésors composés de donations et d’ex-voto, étaient exposés à la délectation des pèlerins et touristes. Ces temples-musées témoignent de l’affection des sociétés pour les beaux objets, et plus encore s’ils sont chargés d’une symbolique religieuse ou spirituelle. Or, si l’on vient aux temples, c’est avant tout pour rencontrer les entités divines qu’ils abritent et qui inspirent des générations d’artistes et de curieux.
La naissance des Mouseîon
Les mères du musée sont en effet les Muses, déesses grecques des arts, que l’on célèbre dans les Mouseîon, temples qui leur sont consacrés. Il existe neuf déesses personnifiées pour neuf arts antiques.
Calliope, muse de l’éloquence distinguée par son goût pour la poésie épique, tandis que sa sœur Erato préfère la poésie lyrique,
Melpomène et Thalie, respectives muses du théâtre tragique et comique,
Euterpe et Terpsichore inspirent elles la musique et la danse,
Polymnie est la muse de la rhétorique et du chant, grâce auquel sa sœur Clio raconte l’histoire,
Et enfin Uranie, muse de l’astronomie, dont l’homonyme n’est autre qu’une planète.

Parnassus, Anton Raphaël Mengs
Ces muses sont des sources d’inspiration pour les poètes, artistes, dramaturges et scientifiques. Elles sont les descendantes de Zeus et Mnémosyne, la déesse de la Mémoire. Nous comprenons mieux le lien solide qui unit les musées, les arts et la mémoire. Le « musée » est la colline où elles chantent, dansent et jouent, sur l’Hélicon, non loin de leur Olympe natal. Le Mouseîon est le lieu terrestre où l’on convie les vivants à célébrer tous les arts.
Cette conception du musée s’exporte en Egypte, avec le Mouseîon d’Alexandrie, fondé par le roi Ptolémée Ier en 280 avant J.-C. Il se situe dans l’enceinte de son palais et c’est un lieu consacré aux arts et à la recherche, vitrine des richesses intellectuelles de l’Egypte. C’est tout à la fois un laboratoire, observatoire astronomique, jardin botanique, parc zoologique, institut de recherche, bibliothèque, réfectoire et salle de colloques… Le musée accueille les savants qui travaillent ensemble à la production de savoirs et à sa diffusion au travers de conférences. Il se pense comme un lieu vivant d’invention plutôt que de conservation, l’exception étant la fameuse bibliothèque d’Alexandrie. Sa politique d’acquisition n’a rien à envier aux pratiques actuelles. Chaque navire qui mouillait à Alexandrie était tenu de laisser ses manuscrits le temps d’une copie, pour être stockée à la bibliothèque. Cette démarche impressionnante a fait de ce lieu un temple du savoir universel où s’accumulait quelques 700.000 rouleaux de parchemins.
La culture pour tous… mais si affinités !
La description des musées antiques ne sonne-t-elle pas étrangement familière à nos oreilles contemporaines ? Depuis plusieurs dizaines d’années, le musée est en réinvention permanente, cherchant le rôle qu’il doit jouer dans un monde capitaliste où les richesses matérielles supplantent les œuvres de l’esprit.
Un des éléments les plus marquants dans l’histoire des politiques muséales actuelles est d’abord l’accent mis sur la démocratisation culturelle. Le premier pas en ce sens a été franchi dans les années soixante, sous l’impulsion du tout premier Ministre des Affaires culturelles, André Malraux. La politique mise en place à cette période avait pour but de permettre un plus grand accès des citoyens à la culture, au travers notamment de la création de Maisons de la Culture. Ces lieux ont pour vocation de faire se rencontrer les individus et l’art dans toutes ses formes, sans autre support de médiation.
« La confrontation qu’elle suscite est directe, évite l’écueil et l’appauvrissement de la vulgarisation simplificatrice […] La première forme de ce qu’on appelle d’ordinaire, par un mot d’ailleurs magique, « l’initiation » aux arts est une rencontre intime. » nous dit Pierre Moinot, conseiller d’André Malraux.
Cette tentative maladroite d’éveiller l’individu à l’art par une rencontre directe et crue n’a pas eu le succès escompté. La démarche engagée nous permet néanmoins de réfléchir à deux choses. La première est que la culture doit être accessible à tous sans distinction de classe sociale, c’est un bien commun qui appartient à la société dans son ensemble. La seconde est que l’appréhension de la culture ne va pas de soi, et nécessite un recours à des médiations de diverses natures, ainsi qu’à une prise de distance par rapport aux objets.
Des musées-temples aux musées-spectacles
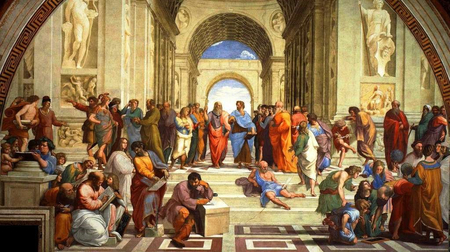
L'École d'Athènes, Raphaël
Certains musées ont fait de la distanciation vis-à-vis des objets le principe même de leur établissement, comme les centres d’interprétations, même s’ils se cantonnent encore à des champs réduits de la muséographie. Une démarche décentrée des objets encourage forcément à rechercher d’autres modes de médiations, davantage tournés vers l’humain et conçus spécifiquement pour illustrer le discours, en contrepied d’une logique inverse où le discours est au service de l’objet. Et quels objets ? Les musées brillent au travers des chefs-d’œuvre qu’ils recèlent et conservent parfois jalousement. Mais en termes de culture matérielle, une canette de soda n’est-elle pas plus représentative de notre société que le plus beau joyau qu’elle pourrait produire ?
Le musée du 21e siècle ne peut plus se contenter d’être le dépôt des œuvres de l’humanité. Sa fonction éducative et divertissante est à réaffirmer, à la manière des musées américains qui associent aisément l’entertainment à l’activité pédagogique et proposent une diversité de pratiques culturelles. Plutôt que des « musées-temples », le nouveau paradigme est aux « musées-spectacles », lieux de recherche et de loisirs transdisciplinaires, dans lequel la course aux trésors n’a plus lieu d’être. Dans mon musée imaginaire, il n’y a pas d’objets, seulement des individus, acquittés des considérations de temps et d’argent, qui échangent ensemble dans un lieu de vie conçu avec eux et pour eux.
Bref, tout un art… de Muser !
Laurie Crozet
#ICOM2019
#Antiquité
#Muséeimaginaire
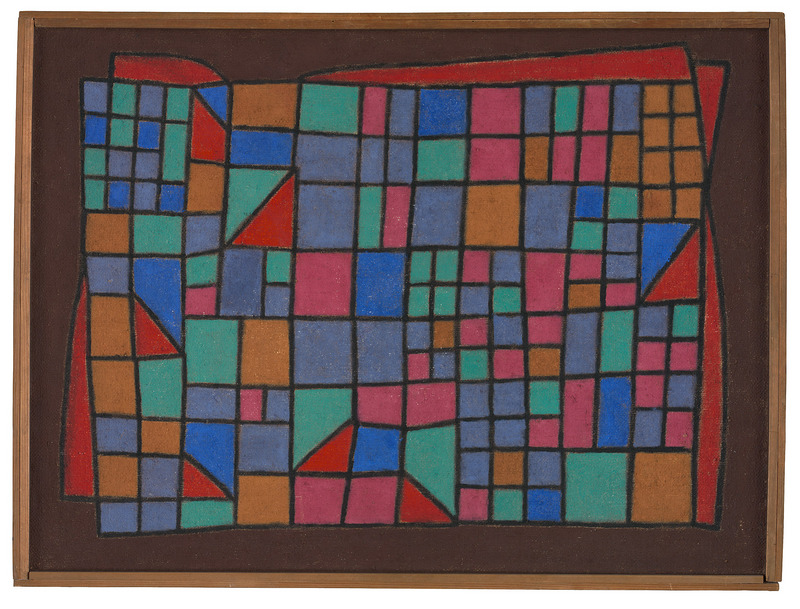
L’œuvre d’un homme, sans cesse renouvelée
Le Zentrum Paul Klee de Berne (Suisse) nous montre, comme chaque année, une nouvelle perspective sur sa collection de plus de 4 000 œuvres : à quel point cette présentation est-elle novatrice ?
Dans le cadre d’un travail sur la collection du musée, l’équipe du Zentrum Paul Klee et sa directrice, Nina Zimmer, ont cherché à renouveler la perception de l’œuvre de Paul Klee en invitant des enfants. Ce souci du public enfant est coutumier du lieu : le Zentrum Paul Klee cohabite avec « Creaviva » un musée pour les enfants, où des offres d’ateliers, gratuites ou payantes, permettent aux enfants et aux adultes d’approcher l’œuvre de l’artiste germano-suisse par sa technique et l’expérimentation des matériaux.
Cette action crée un lien plus fort entre ses deux institutions et laisse, pour une fois, des voix non professionnelles en charge de la présentation de l’œuvre de Paul Klee. Pour se faire, une équipe interne au musée et au centre « Creaviva » fut créée pour piloter le projet. Elle est composée de Martin Waldmeier (Commissaire), Eva Gradel (Responsable de la participation culturelle), Alyssa Pasquier (Assistante de Martin Waldmeier), Pia Lädrach (Responsable Kindermuseum Creaviva), Katja Lang (Assistante du Kindermuseum Creaviva), ainsi que 13 enfants âgés de 8 ans à 13 ans. Ils ont œuvré ensemble pour créer « Un secret lumineux. Klee exposé par des enfants » (22.05.2022 – 04.09.2022).
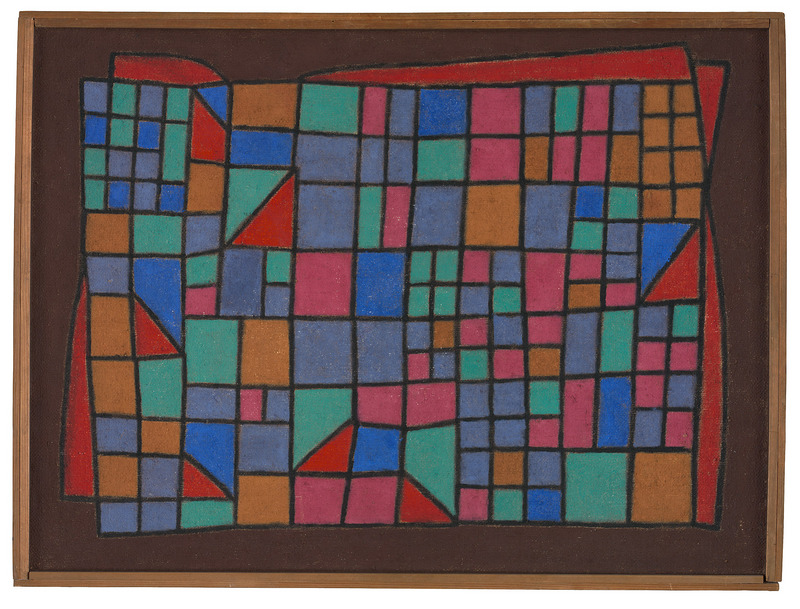
Paul Klee, Glas-Fassade [Glass-Facade], 1940, Wax paint on burlap on canvas, 71,3 x 95,7 cm,© Zentrum Paul Klee, Bern
Suite à de nombreuses activités avec l’équipe de travail, autour de l’écriture et de l’alphabet de Paul Klee ainsi que des techniques qu’il utilisait, le moment est venu de créer une exposition, un propos et donc une histoire autour de l’œuvre de l’artiste.
Le projet présente les nombreuses activités, recherches et adaptations faites sur une période de 13 mois, ce qui est présenté dans l’espace d’exposition avec des sections créées par des cimaises parallèles et horizontales et des œuvres variées telles que des œuvres graphiques, mais aussi des peintures, des archives et des photographies.
Cette aventure qui va au-delà de la figure de Paul Klee fut décidée avec un tableau commun « Glas-Fassade » de 1940. Cette grande toile tardive de l’artiste, faite de formes colorées dans un quadrillage abstrait, ouvre l’exposition sur une cimaise au ton aubergine, accompagnée d’une introduction du projet qui présente la nouvelle approche muséographique dont le but est d’impliquer les enfants dans la création d’une exposition.

© Martin Waldmeier, Zentrum Paul Klee
Dans le parcours, nous observons des différences notables entre les expositions des collections précédentes et celle-ci. En premier lieu, les cimaises s’habillent de tons colorés, allant du rouge, au jaune et à l’aubergine, des bancs à foison jalonnent les cloisons ainsi que des assises colorées qui imitent la couleur de l’œuvre « Glas-Fassade ».
Malgré ces ajouts colorés, aucun élément flagrant ne démontre la collaboration entre les enfants et les professionnels des musées « Créaviva » et le Zentrum Paul Klee. À côté de chaque œuvre exposée dans les 19 sections (l’église, l’architecture, du brisé et du recomposé et bien d’autres) il y a un cartel décrivant le titre, la technique, ainsi que la taille de l’œuvre, le tout traduit en français, allemand et italien comme il en est coutume dans un établissement cantonal et suisse. Sachant que le propos fut écrit et inventé avec des enfants, il aurait été judicieux de créer des textes simplifiés et/ou illustrés par un illustrateur, pour faire comprendre au public les différentes approches de l’œuvre de Paul Klee en fonction des âges.
Le seul ajout fut des boîtes de contreplaqué entre chaque section, qui diffusent des discussions des enfants autour de l’exposition. Or, le contenu est décousu car l’histoire de création de l’exposition, ne montre qu’un documentaire et un atelier participatif en fond de la salle, ne la mettant pas en valeur au centre de l’exposition, et in fine du processus.
Le processus de l’exposition en tant que tel est à souligner tant il est régulier et créatif. Lors des workshops, les enfants se sont concentrés sur de nombreuses approches plastiques autour de l’œuvre de l’artiste : création d’un alphabet, recherche d’un titre pour l’exposition, sélection des œuvres ainsi que leurs divisons par sections, question de l’histoire dans l’exposition. Or, au-delà de cette approche créative, le commissaire d’exposition a repris le pas pour l’accrochage, aucun enfant n’a donné son avis pour l’accrochage, la hauteur des œuvres, le texte d’introduction, les cartels, ou le guide de visite, qui de surcroit n’est pas adapté aux enfants.

© Martin Waldmeier, Zentrum Paul Klee
Alors, quelles sont les choses à garder de cette exposition « Un secret lumineux
Klee exposé par des enfants » (22.05.2022 – 04.09.2022) ? Comme le dirait Paul Klee lui-même « Car nous voyons tous la même chose, même si c’est sous des angles différents », la perception d’une œuvre et d’une exposition dépend largement d’un avis subjectif et lorsqu’un musée porte son discours à travers l’œil d’un commissaire ou d’un directeur, celui-ci est principalement historique et comparatif. Or, le visiteur, touriste ou local, a une perception tout autre, amateur, et souvent enfantine, il connait très peu la figure de Klee. Devant des œuvres, il manque d’une vraie explication, que ce soit du processus de création, des matériaux utilisés et de son contexte de création. Le but était d’imbriquer ces deux visions dans une exposition, où les enfants jouent un rôle central pour la présentation, la médiation et la sélection des œuvres, alors que le commissaire a pris la casquette d’un organisateur, d’un passeur entre l’équipe du musée et la vision des enfants.
Ce processus de partage, de sensibilisation et de liberté, a permis aux enfants et aux équipes des deux institutions de souffler un nouvel air sur l’œuvre de l’artiste ainsi que sur le rôle d’un projet lié à la collection/exposition et son lien avec le public. Alors que le public appréhende l’œuvre de Paul Klee lors de cette visite, il n’est pas si simple d’étudier ses lignes, sinueuses qui naviguent entre les lettres et les aplats colorés.
Ses œuvres ne sont pas réellement abstraites et figuratives, or les explications données restent généralistes, et ne discutent pas du contexte et des problématiques de la guerre. Une question persiste : comment tenir un discours universel et compréhensif par tous, cette exposition devait en être une réponse, or elle pose une autre question : celle de la hiérarchie des contenus. Le récit historique créé par les historiens de l’art prévaut sur celui des enfants ou du public, or les deux peuvent coexister dans le même espace, pour fournir des clés de lecture différentes, et donc, permettre à tous d’appréhender l’œuvre de Paul Klee.
Informations pratiques
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
3006 Berne
Tél. +41 31 359 01 01
Fax +41 31 359 01 02
Horaires
MAR—DIM 10h—17h
LUN fermé
LG
Pour en savoir plus
#Exposition #Suisse #Curator
La fable d’un éveil à l’art
L’Enfance des Lumières se présente comme la nouvelle fable du musée Cognacq-Jay. Cette« expo pour s’éveiller à l’art »s’est installée sous les combles de la structure du 12 avril au 29 juillet 2018. Paris Musées en est l’initiateur, soucieux de participer à l’éducation du jeune public et d’aller à sa rencontre. Pour ce faire, cet établissement public a entrepris de créer une série d’expositions qui leur sont adressées. Destinées à l’itinérance, elles entendent présenter des thèmes en lien avec les musées et institutions dans lesquels elles s’implantent. Ces parcours, conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, sont confiés au commissariat d’Anne Stephan. Muséographe chargée des projets de médiation, elle s’emploie vivement à coordonner ces initiatives avec l’aide des équipes de Paris Musées et des structures d’accueil elles-mêmes. Fruit d’échanges entre multiples acteurs, L’Enfance des Lumières veut avant tout répondre aux attentes d’un public trop souvent délaissé.
Tapis de jeu de l'oie géant en l'honneur de M. Cognacq et Mme. Jay ©Emeline Larroudé

A l’instar des enfants du XVIIIe siècle, explorons l’exposition à travers les personnages des fables de La Fontaine, auteur du XVIIe, qui ont bercé les enfants du siècle suivant.
Salle d'exposition et modules ©Emeline Larroudé
La Cigale et le Musée
« Nuit et jour à tout venant, Je chantais, ne vous déplaise.»- La Cigale et la Fourmi, Jean de La Fontaine

Recomposition de visages enfantins issus de tableaux ©Emeline Larroudé
Le Lion et les Lumières
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi. »- Le Lion et le Rat, Jean de La Fontaine

Activité proposée dans le dernier tiroir du module éducation ©Emeline Larroudé
Le Renard et les Modules
« Et toi, Renard, a pris ce que l’on te demande. »- Le Loup plaidant contre le Renard par devant le Singe, Jean de La Fontaine
 De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
Vitrine comparative du module jeu ©Emeline Larroudé
Comment mieux impliquer le visiteur, d’autant plus lorsqu’il est avide d’interactivité et d’expériences, qu’en le rendant acteur ? L’Enfance des Lumières, initiatrice d’une série d’expositions lancée par Paris Musées, répond parfaitement aux attentes probablement insoupçonnées d’un public auquel peu s’adressent. Une multiplicité d’accès à l’information s’offre à lui afin qu’il saisisse et s’approprie le contenud’une exposition riche par le ou les biais qui lui conviennent. Tout comme le XVIIIe siècle s’est intéressé à l’enfant et son développement en lui consacrant une place nouvelle, cette initiative se place en digne successeuse de ces considérations en en faisant l’interlocuteur principal. De même, si le jeu s’est avéré être un élément constitutif du développement de l’enfant au siècle des Lumières, il est ici mis en exergue. Cohérence et pertinence se mêlent avec brio pour transmettre un message tout en exploitant le plus de sens possible.
#enfants
#jeunepublic
#jeu
Pour en savoir plus :http://www.museecognacqjay.paris.fr/fr/les-expositions/lenfance-des-lumieres
https://www.facebook.com/museecj/
http://www.parismusees.paris.fr/fr/expositions

La fatigue muséale : pour une visite du musée décomplexée
Visiter un musée est fatigant. Même si l’on adore les musées, il faut admettre que leur visite est souvent source d’inconfort. Loin d’être un concept neuf, la fatigue muséale est étudiée depuis le début du XXème siècle.
La fatigue muséale, un syndrome étudié par les études de publics
En 1916, le conservateur du Boston Museum of Art, Benjamin Ives Gilman, publie un article intitulé Museum Fatigue. Il se base sur une observation des postures parfois... sportives des visiteurs et visiteuses du musée cherchant à regarder certains objets. Ces efforts causés par la scénographie sont immortalisés par des photographies. Ils amènent le public à être moins concentré au fur et à mesure de la visite. Après s’être penché ou agenouillé plusieurs fois, le visiteur ou la visiteuse serait moins volontaire pour lire les cartels ou regarder les expôts. Cette étude pionnière est à placer dans un contexte où la la scénographie n’était pas pensée en termes de confort, mais afin de placer le plus d’objets possible dans une mise en scène héritée des cabinets de curiosités.
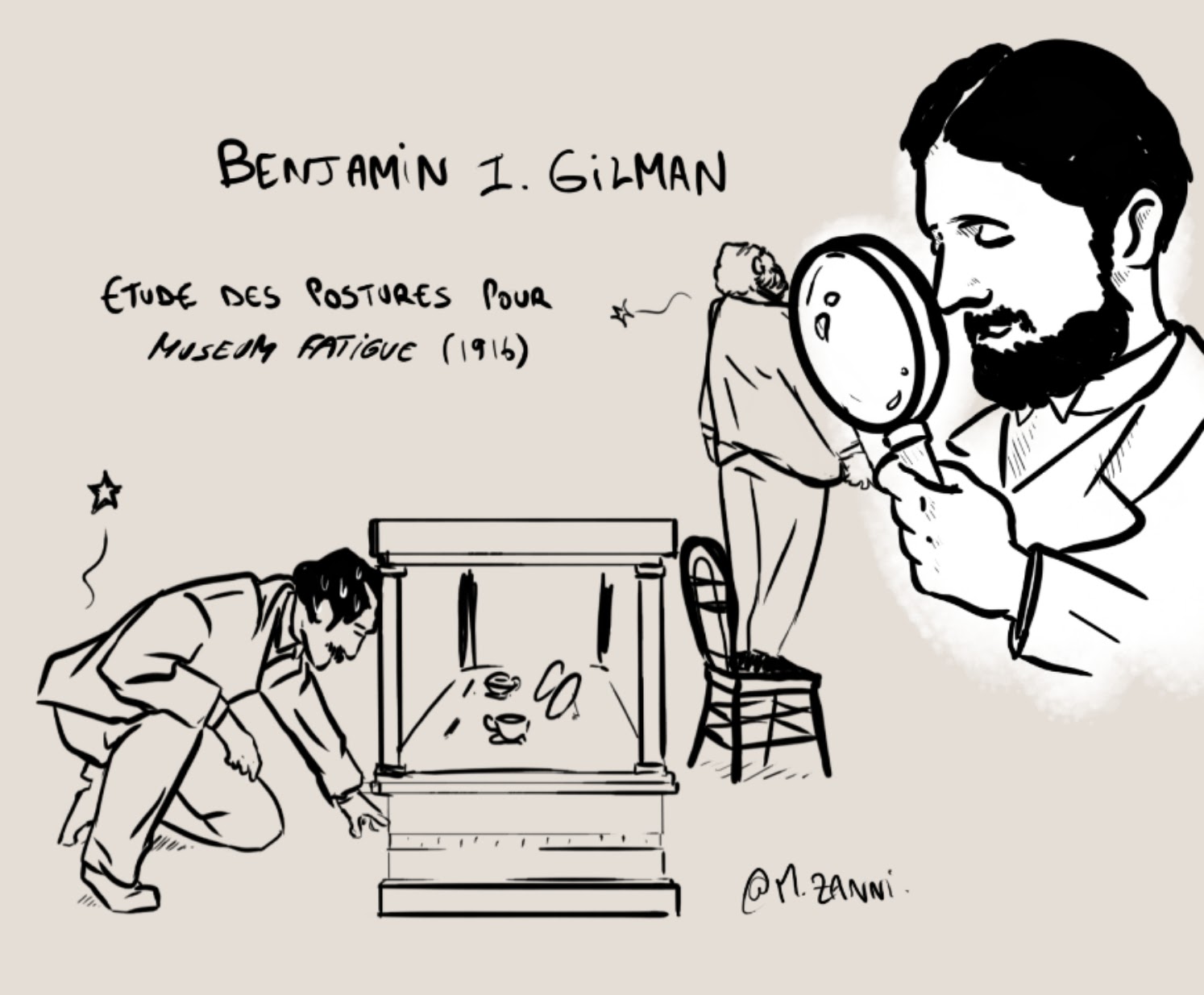
Etude des postures pour Museum Fatigue par Benjamin Ives Gilman, visuel non contractuel, @Marco ZannI
Dans les années 1980 et 1990, John H. Falk, entre autres sociologue des musées, observe un phénomène particulier. D’abord dans des parcs zoologiques puis dans différents musées, ses études collectives montrent des débuts de visite concentrés, avec des déplacements lents qui suivent plus fidèlement le parcours … Puis le public accélère en sélectionnant des points d’intérêts et en sautant certaines parties … Cette tendance est à peu près uniforme, quels que soient les expôts présentés ou la longueur du parcours. La fatigabilité serait donc une donnée intrinsèque à la visite. Cela donne des déambulations très diverses auxquelles ne s’attendent pas toujours les commissaires d’exposition. Mais pour Falk, l’intérêt n’est pas uniformément décroissant, il connaît des pics au cours de la visite.
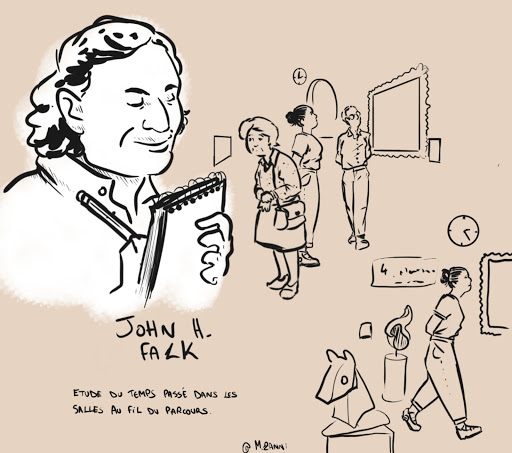
Étude du temps passé dans les salles au fil du parcours par John H. Falk, visuel non contractuel, @Marco Zanni
Entre fatigabilité et tranquillité corporelle
Améliorer le confort de visite, de l’ergonomie à la visite décomplexée
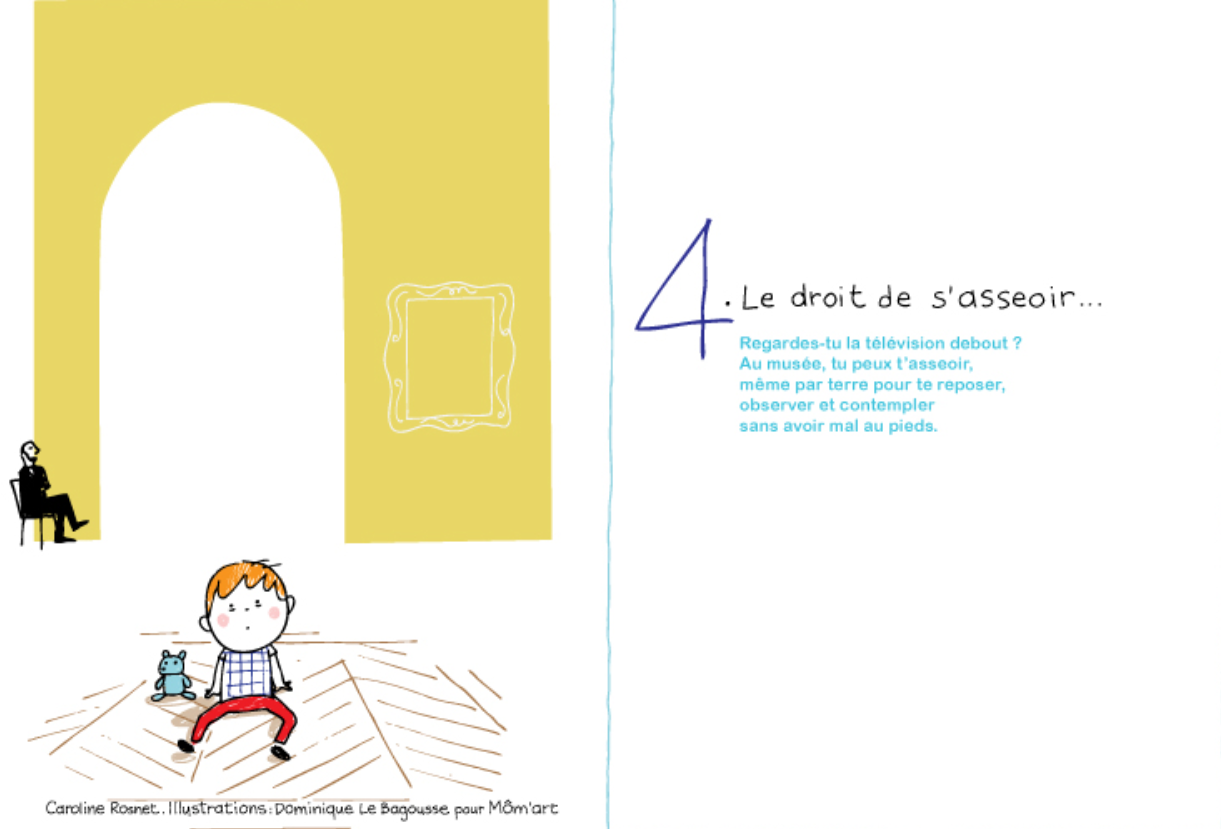
Droit 4 des Dix droits du petit visiteur, Caroline Rosnet et Dominique Le Bagousse pour Môm’Art, @Môm’Art Association
Evidemment, l’assouplissement des mœurs muséales est passée par là, permise par le développement de la médiation et des courants muséologiques attentifs au public. Le monde professionnel y contribue, souvent en ciblant des publics (enfants, familles, scolaires) ou types d’institutions (musées de sciences, écomusées, etc). Parmi de nombreuses actions, on peut citer les Dix droits du petit visiteur de l’association Môm’Art. Sa charte, signée par une partie du réseau muséal, insiste sur la liberté de visite de l’enfant et mentionne la fatigue. Des contenus à destination du grand public abordent également ce point, comme l’ouvrage Comment visiter un musée et aimer ça (2015), qui propose des remèdes aux “jambes de musées”. Joham Idem nous conseille : “arrivez reposés, n’essayez pas d’assimiler tout en même temps, asseyez-vous de temps à autre, buvez régulièrement et n’oubliez pas de vous restaurer”. Et l’auteur de rappeler que si le musée “est un excellent stimulus, [...] il nécessite un temps de récupération”.
Tenir compte des fatigues muséales reviendrait donc à décomplexer le visiteur ou la visiteuse. Accepter et traiter la fatigabilité de façon plus globale est un pas vers la pérennité de l’attractivité des musées et de leurs missions.
Marco Zanni
Pour aller plus loin :
Davey Gareth, 2005. “What is Museum Fatigue”, Visitor Studies Today, Vol. 8, n°3, pp. 17-21 : https://www.academia.edu/1093648/What_is_museum_fatigue.
Lebat Cindy, Maroun Johnny, Moreau Philippe, 2017.La fatigue muséale: le musée peut-il être confortable ? (Rencontres Muséo de l’Association Metis, 28/11/17), voir la chaîne Youtube de l’association Metis : https://www.metis-lab.com/evenements/fatigue-museale-le-musee-peut-il-etre-confortable
Lebat Cindy, 2018. Les personnes en situation de handicap sensoriel dans les musées : réalités d’accueil, expériences de visite et trajectoires identitaires (thèse dirigée par F. Mairesse), Université Paris III, Paris : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02542710.
#Fatigue muséale #Ergonomie #Publics

La haute couture s'invite aux musées
La mode est à la mode, et ce ne sont pas les musées qui diront le contraire. De Dior aux Arts Décoratifs, de Balenciaga au musée Bourdelle à Jean Paul Gaultier au Grand Palais, les expositions de mode n’ont jamais autant déplacé les foules. Rien qu’en 2018, l’exposition Dior, organisée pour les 70 ans de la marque comptait 70 000 visiteurs.
Même si dès le XIXe siècle on exposait la mode lors des grandes expositions universelles, dans des pavillons d’élégance, c’est au Metromopitan Museum of Art (MET) que l’on doit les expositions d’envergure qui se développent aujourd’hui. Une des prochaines en date Louboutin aura lieu au Palais de la Porte Dorée à partir de février 2020.

Exposition Dior aux Arts Décoratifs @juliette dorn

Armani Silos @juliette dorn
Ces expositions imaginées par le conservateur ou suggérées par les maisons elles-mêmes ont bien sûr un intérêt marketing pour la marque. Exposé, le vêtement, n’est plus seulement un objet, il atteint le statut d’œuvre selon les propos de Sonia Rykiel. Il est doté de sa propre histoire, hors des défilés et des collections. En exposant leurs collections privées, les maisons de luxe donnent à voir leur savoir-faire, elles créent leur propre mythe. Ce sont les concernés qui financent ces expositions. Lorsque Dior expose aux Arts Déco, à Londres ou à Moscou, ce n’est pas anodin : dans ces grandes villes sont implantées ses boutiques de prêt à porter, c’est un moyen pour la marque de fidéliser sa clientèle tout en essayant de toucher au plus large. C’est aussi un moyen de se rapprocher d’une future clientèle, puisque ces expositions s’adressent à des visiteurs mais aussi à des clients potentiels. Nous parlons jusqu’ici d’expositions temporaires. Le lien de leur monstration n’est pas anodin non plus, entre une exposition au sein même du magasin newyorkais Prada et une autre organisée dans une institution muséale, qui de l’exposition en magasin, du défilé, ou encore de l’exposition muséale s’inspire de l’autre ?
Mais un autre fait marquant retient notre attention : de plus en plus de maisons de couture ouvrent leur propre musée. En 2017 Yves saint Laurent ouvre non pas un mais deux musées, alors que jusqu’alors, ses collections privées faisaient l’objet d’expositions événements à travers le monde. Armani à Milan a quant à lui réinvesti tout un quartier mêlant collection de mode et expositions temporaires. Citons aussi Gucci qui depuis 2018 a intégré son propre musée au Palazzo della Mercanzia à Florence. Dans ces deux cas, le directeur artistique de la marque est le créateur de l’espace et de la muséographie.
Enfin, la maison Chanel: Le Palais Galliera, premier musée de la mode à Paris va rouvrir en cette fin d’année. La maison Chanel a mécéné les travaux pour l’ouverture de leur tout nouvel espace d’exposition permanente, avec des salles consacrées spécialement à Gabrielle Chanel. La maison Chanel ne possède pas son propre musée, mais en subventionnant le palais Galliera et en faisant prêt de pièces de sa collection privée, elle s’offre une visibilité et un public autre que ses habituels acheteurs, met sa la marque en avant.
Les maisons de couture offrent ainsi une autre vision que ce que l’on peut voir lors des défilés, réservés à des initiés. Le musée offre un espace plus intimiste, le vêtement est visible de plus près, il est rarement sous cloche, pour donner l’illusion d’être accessible. Le lieu, la scénographie et le parcours concourent à cette dimension émotionnelle. D’un point de vue scénographique, la mode a une culture du grandiloquent, elle réadapte ici l’événement créé pour les défilés et principalement la fashion week.
Si la mode est un sujet proche du public, qui porte des vêtements tous les jours, les voit dans la rue et les magazines, c’est une culture qui s'acquièrt spontanément, la haute couture a ses codes.
En exposant la mode, on peut se permettre des scénographies extraverties. Pour Dior, Nathalie Crinière crée une scénographie événement, au point que le vêtement perd de son attrait tellement l’œil du spectateur est attiré par le décor qui l’entoure La salle remplie de fleurs en papier rappelle les créations de Christian Dior, avec ses défilés aux milliers de fleurs. Au contraire, le musée Armani présente ses collections dans un univers épuré, sublimé simplement par la lumière, là aussi un écho à ses créations et aux défilés.

Défilé Automne Hiver 2014-2015 au musée Rodin @ Dior
Lorsqu’une exposition de mode se concentre sur une marque ou un couturier en particulier, c’est l’univers décidé par le directeur artistique qui transparaît. Cela devient plus compliqué lorsqu’une exposition mélange les styles et les maisons de couture : la Cité de la dentelle et de la mode présente en parallèle des pièces du XIXème comme des vêtements plus contemporains, le créateur n’est plus l’attrait principal du vêtement, c’est sa technique qui est mise en avant. L’ambiance choisie est donc plus neutre pour s’adapter aux différents vêtements exposés, qu’ils soient l’œuvre d’un couturier ou du prêt-à-porter.
Alors alliance de marketing et de parcours sur le stylisme singulier de chacun, ces expositions mécénées sont-elles glorification de la marque ou ultime reconnaissance d’un couturier ?
Un élément de réponse réside dans l’exposition “Sonia Rykiel Exhibition” dédiée à la créatrice en 2008 aux Arts Déco, pour l’anniversaire de la maison. Cette exposition retrace le parcours créateur, en présentant notamment des dessins, les premières créations et les différentes collections. C’est avant tout un hommage envers le caractère charismatique et iconique de Sonia Rykiel.
Balenciaga exposé au musée Bourdelle, c’est un hommage post mortem au couturier et à son œuvre, un moyen de montrer le génie créateur en faisant dialoguer les robes de haute couture avec les sculptures de l’artiste du XXeme.
Dans ces exemples, le couturier est au premier plan, on glorifie non pas la marque qui découle de ces illustres noms mais son œuvre. L’accent est mis sur la personnalité du couturier, sur son talent. Exposer Coco chanel, ce n’est pas exposer Karl Lagerfeld, son successeur à la tête de la maison, mais l’aspect innovant des pièces de la créatrice pour son époque.

Exposition Cristobal Balenciaga, l’oeuvre au noir @musée bourdelle
Bien sûr lorsque le nom du créateur présenté est lui-même le patronyme de la marque, même si son œuvre est avant tout mise en avant, la marque en retire une certaine gloire. Pour une marque, posséder sa propre exposition ou mieux encore son propre musée est un moyen d’affirmer son influence dans le monde de la mode mais aussi dans la société.
L’exposition Dior est un parfait exemple de réalisation à la gloire de la maison. Le parcours d’exposition n’est pas chronologique ni divisé selon les différents directeurs artistiques de la marque, mais est présenté par grands thèmes, le Style Dior, ce qui fait l’essence même de la marque et sa reconnaissance mondiale.
Ainsi, entre grandiloquence et minimalisme, l’exposition de mode a autant un aspect marketing lorsqu’elle est centrée sur un créateur et sa marque en particulier, qu’une reconnaissance artistique pour le couturier. En adoptant les codes de la haute couture pour créer l’événement, ce type d’exposition est à présent ancré dans l’univers muséal et place le vêtement et son couturier au même titre qu’une œuvre d’art et son artiste: iconique.
Juliette Dorn
# Mode
#Hautecouture
#Couturier
Pour aller plus loin :
Christian Dior, couturier du rêve : https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/expositions-terminees/christian-dior-couturier-du-reve/
Back side : dos à la mode au musée Bourdelle, jusqu’au 17 novembre 2019
http://www.bourdelle.paris.fr/fr/exposition/back-side/dos-la-mode
Christian Louboutin, l’exposition : du 25 février au 26 juillet 2020
https://www.palais-portedoree.fr/fr/christian-louboutin-l-exposition

La littérature jeunesse s’infiltre au muséum...
Tranquillement blotti dans votre fauteuil préféré, vous ouvrez votre livre et soudain, vous voilà transporté dans les salles d’un muséum pour y mener l’enquête. Fiction ou réalité ? Plongez dans la collection d’ouvrages jeunesse , Enquêtes au muséum !
Sélection de 10 titres de la CollectionEnquêtes au muséum de Laurence Talairach illustrée par Titwane et publiée aux éditions Plume de carotte © Pauline Dancin
Subrepticement, la fiction et notamment la fiction policière a investi l’univers du musée. Escape games, jeux d'enquête, audioguides et podcasts construits autour d’une énigme à résoudre par des visiteurs transformés en enquêteurs-amateurs font aujourd’hui florès dans les programmes de médiation. Mais si cette rencontre du musée et de la fiction policière se noue désormais sur les sites mêmes, elle s’est longtemps tissée sur le terrain de la fiction seule, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. De la série télévisée L’Art du crime (2017), au best-seller de Dan Brown Da Vinci Code (2003) en passant par L’Exposition (2008) de Nathalie Léger, le musée se pose comme le lieu d’une recherche qu’elle soit résolution d’un crime, quête existentielle ou scientifique. La littérature jeunesse ne fait pas exception à cette intrication de l’enquête et de l’univers muséal. La collection Enquêtes au muséum de Laurence Talairach installe ses intrigues dans les muséums de France et d’Europe. Commencée en 2017 et aujourd’hui composée de 26 titres, cette collection dédiée aux jeunes lecteurs de 8 à 12 ans met en scène les aventures de Zoé, accompagnée de sa meilleure amie Alice et de son petit frère Clarence – sans oublier Archibald, le fidèle chinchilla du garçonnet –, dans la recherche de ses parents, deux ornithologues disparus lors d’une mission en Nouvelle Zélande. Chaque nouvelle aventure entraîne le trio dans la découverte et l’exploration d’un nouveau muséum d’histoire naturelle.
Un projet singulier pour une pluralité de muséums
La quête de Zoé commence au Muséum de Toulouse. Laurence Talairach, professeur à l’Université y mène entre 2008 et 2014, en collaboration avec l’équipe du muséum, un projet de recherche, Explora, consacré aux représentations des sciences du vivant dans les arts et la littérature. Zoé et ses amis font leur entrée en scène dans deux titres, En piste, Punch ! et Le Collectionneur de Sirènes, tous deux situés dans l’établissement toulousain. D’abord soumis à Francis Duranthon, directeur du muséum, le projet de collection est ensuite proposé à la CPMF, la Conférence Permanente des Muséums de France, un réseau formé en 2011, rassemblant aujourd’hui 44 muséums franco-européens dont le Luxembourg et la Suisse.
Le projet est à la fois solidaire et participatif afin que tout muséum, quels que soient sa taille et son budget, puisse y trouver sa place. Il repose sur un financement participatif : les muséums qui le souhaitent, contribuent à hauteur de leurs moyens, entre 500 et 5000 € par an. En échange, ils bénéficient d’une remise sur le stock d’ouvrages à vendre dans leur boutique. Quelle que soit leur mise de fonds, chaque membre de la CPMF a la possibilité de lancer une invitation à Laurence Talairach. C’est ainsi que la quête de Zoé se poursuit depuis 2017 dans quinze muséums de France, de Lille à Marseille, en passant par trois musées européens, Oxford, Luxembourg et Neuchâtel.
Si le titre de la collection met en avant un singulier générique, une des raisons d’être du projet est pourtant bien de mettre en avant la diversité des muséums et de leur patrimoine. Chaque titre installe l’intrigue dans un nouveau site. Si certains se déroulent dans des lieux imaginaires, huit sur les vingt-six titres actuels, ils n’en restent pas moins très inspirés de lieux réels.
Chaque titre repose sur un schéma narratif identique. Une énigme se présente d’abord à Zoé que ce soit un étrange message codé glissé sous le paillasson dans Les Animaux du roi, la mort étrange et simultanée de plusieurs animaux du jardin d’acclimatation dans La Malédiction du gecko ou le soupçon d’un trafic animalier dans Le Monstre marin. Pour résoudre le mystère, Zoé entraîne ses amis dans les couloirs et les salles d’un muséum. Chaque exploration est donc prétexte à une description fine et détaillée de l’architecture et de la géographie des sites. Ainsi, dissimulés dans le MOBE dans Alerte en pleine forêt, les trois amis constatent que « sur chaque mur, des panneaux expliquaient comment participer à des projets de recherche scientifique, comment observer et agir pour défendre et protéger l’environnement, donnant l’exemple d’associations qui militaient pour la sauvegarde de certaines espèces et collectaient des informations. Ici, l’observatoire des vers de terre invitait tout un chacun à recenser les vers ; là, les murs exhibaient l’impact des activités humaines sur l’élévation du taux d’extinction de certaines populations. » Le détail de la description permet aux lecteurs informés, visiteurs ou futurs visiteurs des lieux, un effet de reconnaissance et de familiarité.

Le « 4 Tiers », 4ème étage du MOBE visité par Zoé et ses amis dansAlerte en pleine forêt © Pauline Dancin
La précision de l’ancrage s’explique par le travail préparatoire mené en collaboration avec les établissements. L’invitation reçue, Laurence Talairch engage un premier travail de recherche sur l’histoire du musée et de son patrimoine. Cette étape préliminaire est suivie d’une visite des lieux, notamment des collections permanentes et des réserves, au cours de laquelle l’autrice rencontre l’équipe du muséum et échange avec elle. Cette immersion, d’une journée à une semaine, permet de dessiner et valider le parcours du trio à travers les salles et les couloirs, y compris les espaces réservés au personnel du musée et donc inaccessibles aux publics, afin de dévoiler les coulisses tout en préservant la sécurité des lieux.

Pénétrer les réserves… Vue de l’exposition « Bien conservés ! » au Musée d’Histoire Naturelle de Lille – du 21 octobre 2022 au 03 juillet 2023 © Pauline Dancin
Pourtant, malgré le désir d’ancrage, les muséums sont anonymisés et les indications géographiques gommées. L’identité du lieu n’est révélée que dans le paratexte, le court dossier qui suit la fiction permettant de revenir sur des notions, de les expliciter et de les approfondir. Cette mise à distance de la réalité maintient les muséums dans l’imaginaire, évitant tout effet de vitrine promotionnelle. Il résulte pourtant de cette association entre le détail des descriptions et l’ambiguïté géographique, un sentiment paradoxal d’unité et d’unicité : d’un côté, l’affirmation d’une appartenance à une seule et même identité et d’un autre côté, la revendication de leurs particularités. Cette tension est représentative du statut des muséums dont l’appellation générique regroupe des collections très diverses : zoologie, géologie, botanique, paléontologie, préhistoire, archéologie, ethnographie, anthropologie, médecine, astronomie, pharmacie, physique-chimie, etc. Plus qu’un ancrage dans des lieux, chaque titre ancre l’intrigue dans une collection à partir des objets ou thématiques emblématiques et représentatifs du muséum. Le Palais des Glaces souligne la spécificité ethnographique des collections du Musée de l’Homme et met en avant la statuette de la Vénus de Lespurge ainsi que les cires anatomiques que les trois enfants rencontrent au cours de leur enquête.
A l’entre-deux entre le muséum générique et les muséums pluriels, entre le muséum réel et le muséum fictif, la collection des Enquêtes au muséum entraîne ses lecteurs sur les pas de Zoé, à la découverte de ces lieux de patrimoine. Elle les invite à franchir les seuils, pousser les portes, bref, à pénétrer les musées.
Entrée par les portes dérobées de la fiction
Issues de secours, portes dérobées, entrées de service, tous les chemins sont bons pour pénétrer les muséums et explorer leurs coulisses. Quand les portes principales lui résistent, le trio emprunte des voies détournées, des passages privés et réservés et défie les interdits. C’est là tout l’avantage de la fiction, de permettre cette entrée privilégiée et privée, ce pas de côté pour contourner l’obstacle que représente, peut-être, la porte du musée. Car la fiction joue bien ici un rôle de médiation, de passerelle comme nous le raconte le personnage de Clarence. Le benjamin de la bande, est parfois réticent voire effrayé à l’idée de pénétrer le muséum. Pourtant, sa propre interprétation imaginaire de l’énigme et son désir de résoudre le mystère le poussent à affronter ses peurs et à se confronter à l’inconnu. Ainsi, le petit garçon, persuadé d’une invasion de Luniens, extraterrestres venus de la lune, pénètre seul dans le muséum de Montauban, à la suite de Zoé et Alice parties à la recherche de la météorite écrasée.
Si les enfants pénètrent comme des voleurs, des intrus, obligés de se cacher à la vue des gardiens et des adultes en tout genre, ils ne transforment pas moins le muséum en un lieu familier. Leur statut d’« étrangers » ne résiste pas longtemps à leur capacité à s’approprier les lieux. Ils s’orientent avec facilité dans le dédale des salles. Aucun interdit ne vient les freiner dans leur exploration frénétique : de la cave au grenier, des combles aux réserves, des laboratoires aux bureaux, tous les espaces sont pénétrés, fouillés, inspectés. Au fur et à mesure de leur enquête, les trois enfants font du musée leur maison, leur repère. Seuls dans le muséum, ils ont tous les passe-droits. De manière générale, peu d’obstacles se présentent à eux. Les gardiens sont rares voire inexistants – ils demeurent une menace latente mais rarement réelle –, les portes sont rarement fermées à clef, ni caméras ni alarmes ne dénoncent leur présence : le muséum, tel que le découvrent les enfants, n’est pas une forteresse mais plutôt un lieu ouvert à l’exploration, de jour... comme de nuit.
Bien souvent en effet, Zoé, Alice et Clarence infiltrent le muséum à la nuit tombée, en catimini, lorsque les portes se ferment au tout public. Laurence Talairach joue avec notre imaginaire collectif, celui de l’animation nocturne des collections inanimées. La série de quatre films à grand succès La Nuit au musée, sortis entre 2006 et 2020, a en effet contribué à inscrire dans nos représentations, l’image du muséum comme un être biface et fantastique, présentant aux visiteurs diurnes un visage sage et immobile et laissant tomber le masque dès les portes refermées. Le muséum de Laurence Talairach révèle bien un monde « fantastique », mais ce n’est plus le fantastique chimérique et imaginaire de La Nuit au musée. Certes, le merveilleux demeure par l’intermédiaire de Clarence et de son imagination impétueuse, mais ses fantasmes d’invasion extraterrestre, de savant fou et de fantômes sont vites balayés par le rationalisme de Zoé pour qui le muséum est avant tout un lieu de science et de savoirs. Ainsi, pénétrant dans le muséum, les trois enfants découvrent la fantastique réalité de la nature et du vivant. Ni les animaux empaillés, ni les squelettes qu’ils rencontrent ne s’animent, mais le trio leur découvre un passé, une histoire, un discours qui leur donnent vie et qui font d’eux bien plus que des statues. Chaque enquête mène le trio à se frotter à des problématiques muséales tels que les enjeux de conservation ou la constitution des collections. Ainsi dans L’Énigme de la patte de chat, les enfants sont confrontés aux problèmes de conservation des collections naturalistes liés aux insectes et aux parasites. Dans Les Animaux du roi, ce sont les différentes techniques de naturalisation à travers l’histoire qui sont mises en valeur. La dimension coloniale est développée dans Le Monstre marin et La Malédiction du gecko.

Vitrine pédagogique sur la technique de taxidermie au Musée d’Histoire Naturelle de Lille © Pauline Dancin
Les collections ont une histoire et une vie, certes, mais les lieux aussi sont habités. Au cours de leurs enquêtes, les trois enfants découvrent l’activité cachée des muséums en dehors des expositions permanentes. Dans les coulisses, nombre de personnes œuvrent : techniciens et régisseurs montent et démontent les expositions dans Le Palais des glaces, les conservateurs tiennent l’historique et documentent les collections dans Le Fragment d’étoile, scientifiques et laborantins poursuivent leurs expériences dans Le Roi des rats… Le muséum se donne à lire comme un lieu de vie inconnu, dépaysant et déroutant mais délicieusement attirant puisque sa découverte nécessite d’enfreindre un interdit : pénétrer la nuit, sortir des sentiers balisés…
La fiction invite les lecteurs à pénétrer le muséum par ses petites portes, à la suite de Zoé, sans même quitter son lit. Ce premier seuil franchit, comment ne pas avoir envie de pousser les grandes portes ? C’est le pari que lancent plusieurs muséums dont celui de Toulouse. Ce dernier s’est emparé des Enquêtes pour proposer un programme de médiation à destination des scolaires de cycle 3. Le projet se structure en plusieurs sessions au cours desquelles il s’agit d’abord de découvrir l’œuvre littéraire, de se familiariser avec le muséum de papier avant d’aller rencontrer le muséum de pierre. La collection permet d’engager un dialogue autour de notions-clés liées à l’activité muséale et aux sciences du vivant. Mais plus encore, l’écrit devient un lien fort reliant les élèves au muséum, grâce à l’entretien d’une correspondance avec le médiateur. La fiction ouvre la porte à la découverte du muséum, permettant de tisser des liens qui ne sont pas seulement érudits, scientifiques mais aussi oniriques, poétiques, émotionnels, affectifs.
Parents et patrimoines naturels : une histoire de filiation
Un fil rouge relie les différents titres de la collection : la disparition des parents de Zoé lors d’une mission scientifique en Nouvelle Zélande. Leur métier d’ornithologue permet d’articuler au fil rouge de la parentalité celui de la biodiversité et de l’environnement. Si chaque titre apporte une preuve supplémentaire de la vie des parents de Zoé, il le fait au travers d’une nouvelle intrigue mettant en jeu des problématiques environnementales liées aux collections des muséums.
La spécificité de cette collection est aussi de mettre en valeur les missions contemporaines des muséums. Leur rôle de conservation des patrimoines naturels et culturels ne se limite pas à la protection d’une collection mais aussi à celle de la biodiversité. La protection des espèces menacées (Le Monstre marin), les programmes de recherche (Le Roi des rats), le développement des sciences participatives (Alerte en pleine forêt) sont autant de missions aujourd’hui assumées par les muséums que découvrent Zoé et ses amis. Plus largement, la collection joue un rôle de vulgarisation des savoirs liés aux théories de l’évolution et à la formation du vivant. Le Fragment d’étoile aborde au travers des météorites le mystère de l’extinction de masse des dinosaures quand Le Secret de Mélusine introduit la théorie de l’évolution au travers du plésiosaure.
Le choix du genre policier permet de souligner la valeur et la préciosité de ce patrimoine qu’est la biodiversité, à la fois dans sa dimension économique avec les spécimens protégés par la CITES saisis par les douanes dans Le Monstre marin mais aussi dans sa dimension existentielle. Les différents titres soulignent la fragilité de ces espèces éteintes ou menacées d’extinction et leur participation à l’équilibre de la chaîne du vivant. L’importance de ce patrimoine est aussi illustrée par son articulation à la parentalité : retrouver la trace de ses parents et préserver les traces du vivant sont finalement une seule et même quête.
Le muséum devient un espace névralgique où se rassemblent ces différents fils. Il se donne à voir à la fois comme un lieu de savoirs et de mémoire des évolutions passées, mais aussi comme le gardien d’un patrimoine vivant toujours en mouvement. Le muséum nous relie au monde, que ce soit au microcosme familial ou au macrocosme de notre environnement.
Le muséum de Laurence Talairach est un lieu de réponses et de résolutions plurielles, à la différence de nombreux ouvrages jeunesse, romans et escape books, qui font du musée le lieu d’une énigme dont la solution se trouve à l’extérieur, dans la ville et la rue. Ainsi, dans Mission dinosaure : Vol au musée d'Histoire naturelle de Lille (2016) de Nancy Guilbert, les trois amis Ylan, Nell, Théo, accompagnés de leur chien Mozart, partent à la recherche du squelette d’iguanodon, dérobé dans la nuit. Point de départ de l’intrigue, le muséum restera un lieu mystérieux et inexploré : empêchés par les policiers d’entrer dans le muséum, les trois enfants suivent les indices à travers la ville, jusqu’à la découverte du pot aux roses, dans un appartement lillois. Le muséum disparaît petit à petit au profit de l’enquête et de sa résolution. Une fois le mystère levé, rien ne ramène les enfants dans l’enceinte du musée. Le musée pose des questions, mais ne les résout pas. La réponse se trouve au dehors.
D’une façon similaire, Timothée et Liv, les jeunes détectives du Mystère de l'Alcyon (2020) écrit par Philippe Declerck, se heurtent, lors d’une visite scolaire au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, au problème d’une toile : qui est son vrai propriétaire ? Aurait-elle été volée ? Leur enquête les mène à l’extérieur du musée, dans la maison de monsieur Rubinstein, jusqu’aux archives départementales. Une fois de plus, le musée se pose comme un lieu de questionnements et non comme un lieu de réponses. Mais à la différence de Mission dinosaure, la résolution du mystère permet aux enfants de réinvestir le musée avec un regard informé.
Ces deux exemples esquissent les traits d’un paradigme de la représentation du musée dans la littérature jeunesse : le musée fait énigme – et peut-être n’est-ce pas un hasard s’il apparaît majoritairement dans la littérature policière –, il pose question, titille, intrigue, stimule, il fait naître une envie de connaissance. Mais le mouvement qu’il impulse est toujours dirigé vers le monde extérieur.

Le musée fait question mais la réponse est au dehors… Couverture de deux romans jeunesse
En posant le muséum comme un lieu de réponses à des quêtes plurielles, Laurence Talairach façonne dans l’imaginaire des jeunes lecteurs une nouvelle représentation du muséum. Il n’est plus uniquement le lieu du problème et de l’incompréhension, le lieu à quitter pour pouvoir avancer, mais il est un lieu qu’on pénètre, un lieu qu’on explore, un lieu qu’on investit. En devenant lieu de réponses, le muséum devient un espace habitable tant pour la fiction qui peut y dérouler son intrigue que pour les lecteurs d’aujourd’hui et futurs visiteurs. C’est aussi parce qu’il est un lieu de réponses que le muséum cesse d’être indifférent et détaché du monde. En peignant un muséum conscient et à l’écoute des enjeux contemporains, la fiction peut aborder des sujets engagés, tels que la biodiversité, et représentatifs des défis qui se présentent aujourd’hui aux muséums. Alors, plus besoin de preuves, partez à la recherche des Enquêtes au muséum… !
Pauline Dancin
Merci à Laurence Talairach d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Sources
- Charon Patrice, « Les collections des muséums d’Histoire naturelle en chiffres », La Lettre de l’OCIM, 25 juin 2014, no153.
- Cpmf, « Une définition inadaptée », La Lettre de l’OCIM, 1 novembre 2019, no186, p. 18-20.
- Duranthon Francis, « Point de vue : Enquêtes au muséum, un projet d’édition collectif original », La Lettre de l’OCIM, février 2019, no 181, p. 59-61.
- Declerck Philippe, Le Mystère de l’Alcyon : Drôle d’affaire au musée de Dunkerque, Aubane éditions, coll. « Polars du nord junior », 2020.
- Guilbert Nancy, Aventure au musée de l’Institut Pasteur de Lille, Villeneuve d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2018.
- Guilbert Nancy, Mission dinosaure : Vol au musée d’Histoire naturelle de Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2016.
Pour aller plus loin
- AG, « À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ? », L’Art de Muser, décembre 2020.
# Enquêtes au muséum # Laurence Talairach # littérature jeunesse
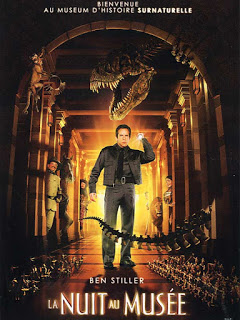
La Nuit au Musée ou la solution miracle
« Tout ce qui est dans ce musée n’est-il pas supposé être plus ou moins mort ? » Larry, futur gardien de nuit du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York.
2007, j’ai 12 ans. Mon objectif dans la vie : réussir mon interro’ d’anglais et convaincre mes parents d’avoir un téléphone portable. L’histoire, les musées, l’art, le patrimoine…c’est intéressant, oui, mais vite barbant. Je n’ai jusque-là que très peu fréquenté les lieux de culture. J’ai même du mal à me souvenir de ma première visite dans un musée, comme quoi celle-ci ne m’a pas marquée.
Le 7 février de la même année sort dans les salles ce film où les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de New York prennent vie à la nuit tombée… Vous savez, ce blockbuster américain où Ben Stiller est le nouveau gardien qui fait face à des papis malfrats en plus de ce phénomène mystérieux. Déjà à cette époque, j’avais été conquise par le principe du film… Qui n’a jamais rêvé de voir des animaux naturalisés, des miniatures ou des statues s’animer et danser sur September d’Earth, Wind and Fire ?
Aujourd’hui, j’ai 22 ans. Mon objectif dans la vie : réussir à écrire cet article et convaincre que l’avenir de la Culture se trouve dans les médiations originales et innovantes. Ma fréquentation et mon esprit critique vis-à-vis des lieux culturels se sont largement accrus. Non, l’histoire, les musées, l’art, le patrimoine ne sont pas barbants, bien au contraire, ils seraient à mon sens aussi intéressants qu’un film américain au pitch déluré et bourré d’effets spéciaux.
En retombant un soir sur Night at the Museum, je me suis demandée si le film donnait une vraie image des musées. Pas d’inquiétude pour ma santé mentale, je sais bien, hélas, que les collections du Muséum de New-York ne prennent pas vie la nuit, quoi que... Tout l’intérêt de la réflexion est le questionnement sur la place et l’image du musée dans le film : le musée comme personnage à part entière, comme prétexte au scénario ou comme simple décor ? C’est aussi l’occasion de donner le premier rôle au gardien, le plus souvent laissé à la discrétion de l’ombre et de la nuit. Grâce à Larry, celui-ci n’est plus le potiche statique et impassible.
La tension entre réalité vécue et fiction tient à l’imaginaire, à l’inconscient collectif. Bref à l’image que l’on se fait du musée. La représentation commune que nous nous faisons se reflète évidemment dans le cinéma où les musées sont présents mais ne sont que rarement utilisé comme la base d’un scénario. Avec La Nuit au Musée, c’est plutôt parlant. Ici le musée est le personnage central du film.
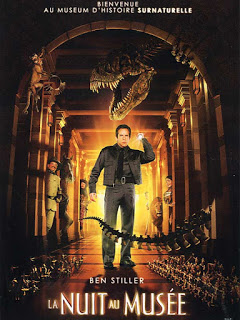
Crédit photo : Allociné
« Tout ce qui est ici est vieux » Cecil Fredericks, ancien veilleur de nuit du musée.
Bien sûr, ce ne sont pas des muséographes qui ont écrit le scénario du film. Celui-ci, réalisé par Shawn Levy, est inspiré du livre éponyme de Milan Trenc. Les deux scénaristes, Thomas Lennon et Robert Ben Garant, sont deux New-Yorkais qui rêvaient étant petits de donner vie aux collections du Muséum qu’ils fréquentaient assidument. Alors, le film s’inscrit pleinement dans l’imaginaire collectif donc dans les idées reçues et les stéréotypes qui collent à la peau du monde muséal.
Après tout, penser à ce qui fait parfois dresser le poil à nous autres, muséologues en herbe, est obligatoire. Tout est une question d’identité et de reconnaissance du musée. Voir dès le début du film son architecture monumentale, ses grands escaliers, ses colonnes, ses immenses salles recouvertes de marbre ou ses œuvres impressionnantes pose le décor. Demandez à la première personne que vous croisez dans la rue de vous décrire l’aspect physique d’un musée… Déjà par son cadre prestigieux et ses colletions qui semblent inaccessibles (incompréhensibles ?) le musée exclut. Avez-vous remarqué comment Larry (le personnage de Ben Stiller) défie le musée et hésite à y entrer ? Écoutez la musique choisie pour ce passage. Oui, pour beaucoup, les musées sont des temples réservés aux élites et ne sont pas faits pour eux.
Deuxième constat : une fois notre personnage passé le pas de la porte, il règne une ambiance très calme, trop calme. Hormis les quelques enfants en visite, les personnes âgées ou les visiteurs perdus, le musée est vide. À croire que cela ne serait pas qu’un phénomène français, surtout lorsque l’on apprend que le Muséum de NY n’a pas de politique tarifaire fixe, chacun est libre de donner ce qu’il veut. Mais, nous ne tarderons pas à avoir l’explication de la crise du musée au moment où le Professeur McPhee, le directeur, fait son entrée sur un agressif « on regarde, on ne touche pas ! ». Cette fois, ce sont les conservateurs de musée qui en prennent pour leur grade et ils ne seront pas déçus. Voyez son accoutrement, un costume trois pièces en tweed marron et d’une chemise pastel rehaussée par une cravate violette. Voilà un look très british, très sage, très coincé. Et son côté acariâtre se révèle de plus en plus lorsqu’il maugrée contre la « populace » ou s’adresse à un parent gentiment « surveillez votre progéniture enfin ! ». Le cadre est donc posé : le public quel qu’il soit n’est pas le bienvenu au musée, tout comme le rêve ou l’humour.
Troisième constat : l’arrivée de Larry comme nouveau gardien s’explique par la volonté de remplacer les trois précédents, nos papis malfrats, par un seul homme. L’un des agents explique alors que le musée se vide de son public (pas étonnant vu le directeur) et perd de l’argent. Triste réalité. Grâce à ces pépés gardiens, le spectateur en apprend un peu plus sur les métiers et pratiques du musée. Bien qu’il ne soit pas en contact direct avec le public, Larry, veilleur de nuit, revalorise l’image des gardiens de musée en général. D’accord, tous les surveillants n’ont pas un aussi joli uniforme ou un si beau matériel (les clés du bâtiment, le manuel de fonctionnement et la torche – pratique pour un gardien de nuit). Il fait aussi la connaissance de Rebecca, la guide du musée qui rédige une thèse sur Sacagewea entre plusieurs visites à des scolaires. Ou encore, lorsque les œuvres se sont échappées dans Central Park, Robin Williams (Théodore Rooselvet) procède à l’inventaire des collections : une autre pratique essentielle dans les institutions muséales.
Après avoir épuisé les stéréotypes qui malgré tout parlent à tout le monde, l’équipe du film s’est aussi permis quelques petits arrangements avec la réalité. Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre qu’aucune scène n’avait été tournée au sein même du vrai Muséum d’Histoire Naturelle ! Eh oui, la production n’en a pas eu l’autorisation. Les quelques passages en extérieur ont bien été pris aux abords du musée mais toutes les scènes en intérieur ont été tournées dans des studios à Vancouver où le musée a été reconstitué grandeur nature. Bien que la ressemblance soit frappante quelques petits couacs, volontaires ou non, sont visibles. L’aspect général des salles est plus ou moins fidèles, certaines œuvres / objets s’inspirent des collections mais ne sont pas pour autant des copies. Par exemple, le petit singe Dexter n’a rien à faire dans la salle des mammifères d’Afrique puisque les capucins sont originaires d’Amérique du Sud, la statue de l’île de Pâques (Gum Gum) n’est pas à sa place et s’inspire seulement de la véritable, la zone des pyramides, elle, s’inspire de celle du MET…
« Saisissez-votre chance Larry ! » Théodore Roosevelt, statut de cire du 26ème président des États-Unis.
Finalement, l’équipe n’a fait que construire son musée idéal pour le film et pour le monde. Plus La Nuit au musée se poursuit, plus les spectateurs font face à une image positive du musée. D’abord par les collections prestigieuses mises en valeur par le cadre de la caméra ou par l’intérêt que leur porte Larry lorsqu’il veut apprendre à les connaître. On le voit alors éplucher des livres d’histoire, suivre une visite… Quoi de mieux que de savoir qu’Attila Le Hun était fasciné par la magie pour l’apprivoiser ? Le musée est vu comme un lieu de savoir, de transmission où dialoguent les cultures : au sens propre comme au figuré lorsqu’on assiste à de féroces batailles entre soldats romains et Cow-boys. De plus, dans la philosophie-même du film, on comprend que grâce au musée, l’histoire reste vivante : la statue de cire de Sacagewea ne va-t-elle pas raconter son histoire à celle qui lui dédie ses recherches ?
Visiblement, tout est bien qui finit bien au musée… Le vol (autre fantasme du musée) des papis malfrats est résolu, Larry trouve sa vocation grâce à son ami de cire Théodore Roosevelt, personne n’a été réduit en cendre ou presque... Mais mon passage préféré reste la résolution involontaire de toutes ces péripéties. Lorsque New-York s’éveille le lendemain de la fuite des œuvres, tous croient à un coup de pub du musée. Les traces de Tyrannosaurus Rex dans la neige, les peintures rupestres dans les stations de métro, l’homme des cavernes sur le toit … ont fait venir une foule impressionnante au musée qui se presse pour voir les collections. Cela ne serait-il pas un présage pour l’avenir des lieux culturels ? Voilà que le film souligne l’importance de l’événementiel qui est présenté comme un remède à la crise des musées. Il faut donner envie aux gens d’aller au musée, rendre ces lieux plus attrayants sans tomber dans le spectacle. Face aux nombres de visiteurs se massant dans le hall, le directeur McPhee est d’ailleurs obligé de reconnaitre le succès accidentel de Larry et lui rend son travail. Ne serait-ce pas là la légitimation de l’événementiel au musée ? Tout est une question d’équilibre : ici, le gardien a réussi à attirer les gens au Muséum de façon ludique et originale sans dénaturer le propos scientifique et l’offre culturelle du musée. D’un musée imagé et stéréotypé, nous voici passé à un musée idéal où le public est au rendez-vous, où les gens s’épanouissent et ont soif de savoir. Un musée comme je les aime.
Alors, on fait moins les malins ?
Vous l’avez compris, La Nuit au musée, film populaire, peut être regardé d’un point de vue plus sérieux et ancré dans l’actualité muséale. Je me suis en dernier lieu intéressée à l’acteur qui incarne le musée du film, le Muséum américain d’Histoire Naturelle, afin de savoir si cette production avait changé sa vie. J’ai été ravie de découvrir que oui, le musée a en effet développé son offre culturelle depuis la sortie du premier film…
Depuis deux ans environ, il propose de passer une vraie « Night at the museum ». Plusieurs fois dans l’année, le musée ouvre ses portes à 300 enfants de 6 à 13 ans (accompagnés d’un adulte) à qui il propose (de 18h à 9h) une exploration des collections à la lampe torche, un Live animal Show et une nuit dans le Milstein Hall of Ocean Life sous la grande baleine bleue. Il suffit de se munir de sa brosse à dent, son oreiller et de 145$. Pour les plus peureux, le musée a mis en place un parcours spécial de visite, le Night at the Museum Tour qui invitent les visiteurs à découvrir les œuvres du film ou celles dont il s’est inspiré. Sans aucun doute, les films de Shawn Levy ont eu un impact plus que positif sur sa fréquentation, la programmation du Muséum mais aussi sur la vision globale que l’on peut avoir des musées. Il faut cependant souligner qu’un musée d’histoire naturelle comme un musée de Beaux-Arts se prêtent plus au jeu qu’un musée des techniques…

Crédit photo : Julian Jourdès pour The New-York Times
Pour ma part, le premier musée que je visiterai à New-York sera sans nul doute celui-ci : grâce à La Nuit au Musée. Et vous ?
Lucie Taverne
#Nuit au musée
#Cinéma
#Événementiel
BULLOT Érik, DALLE VACCHEAngela, MICHAUD Philippe-Alain et JOUBERT-LAURENCIN Hervé, « Cinéma et musée : nouvelles temporalités », Perpectives [En ligne], n°1, 2011.
VAN-PRAËT Annie, « L’image du musée dans le cinéma de fiction », Hermès, La Revue, n°61, 2011, p. 61-63.
La place du radiateur et la place de l'oeuvre
Le musée de la photographie de Charleroi est un beau musée.
Si on pouvait installer le chauffage au plafond par toile tendue, le musée de la photographie de Charleroi serait un très beau musée.
Oui, voilà, tout est beau, tout est propre, tout est lisse mais les radiateurs, eux, font tâche. Parfois peint, caché derrière une grille ou perché au dessus de nos têtes, le radiateur est et doit absolument être dissimulé. On pourrait en déduire une formule infaillible : belle collection + radiateur caché = beau musée.

Radiateur peint au Musée de la photographie, Charleroi.
C’est le cas, à Charleroi. Installé dans un ancien cloître, le musée s’est agrandi en 2008. Une belle réalisation architecturale est venue se greffer à l’ancien pour accueillir les nouvelles œuvres photographiques, dont les tirages sont de plus en plus grands.
Cette extension est pour le musée l’occasion de repenser l’organisation, le flux des visiteurs, leurs déplacements dans chaque espace d’exposition, l’accueil, la cafeteria, l’auditorium, la bibliothèque et même le parc. Tout est pensé pour faciliter une circulation fluide, sans obstacle, où l’on ne pense qu’aux œuvres. Mais voilà, les radiateurs c’est plus compliqué, toujours là où on ne les attend pas ceux-là. La place du visiteur, OK. La place de l’œuvre, OK. La place de la technique, derrière.
Pourtant, ce qui fait la richesse d’une mise en exposition, temporaire ou permanente, c’est davantage l’interaction entre ces trois acteurs que la place de chacun. Ainsi, dans chaque partie du musée, l’œuvre fait face au visiteur. Celui-ci la regarde, celle-ci le regarde. Droit dans les yeux, face à face, comme figés dans le même cadrage, le visiteur et l’œuvre sont en tête à tête.
Le musée en tant que contenant est pourtant bien loin d’être une simple boîte à chaussure, ou même un « white cube » idolâtré par les musées d’art contemporain. L’ancien cloître a été rénové avec soin, son charme est intact. Les parquets qui craquent sous nos pas nous rappellent au temps passé, comme une vieille maison qui grince et dans laquelle on retrouve de vieilles photos jaunies. La partie récente du bâtiment offre tout autant aux usagers. Les jeux de volumes et de lumière, créent des espaces riches et travaillés.
Mais voilà, reste l’obsession du « lisse » et du « beau ». A force, le musée semble figé comme placé sous son plus beau profil en attendant qu’on lui tire son portrait. Paradoxalement celui qui bouge là-dedans c’est lui, le fameux, le gênant ; le radiateur. Contrairement à l’œuvre fixée inexorablement au milieu du mur blanc, le radiateur explore l’espace muséal.
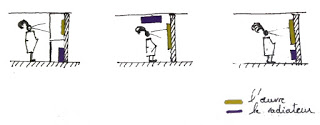 Le radiateur explore l'espace tandis que l’œuvre reste fixe.
Le radiateur explore l'espace tandis que l’œuvre reste fixe.
Et si c’était l’inverse ? Si on réinventait chaque fois, la relation entre l’œuvre et le visiteur. Si l’œuvre bouge et que le radiateur reste fixe ? lequel des deux sera le plus mis en valeur ?
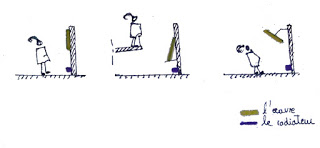 L’œuvre explore l'espace muséal tandis que le radiateur reste fixe.
L’œuvre explore l'espace muséal tandis que le radiateur reste fixe.
Cette question bien qu’anecdotique révèle une obsession de la perfection, du beau. A l’origine, le musée et les beaux-arts étaient des notions fondamentalement liées. Malgré l’élargissement de la notion d’art et le renouvellement des musées, une « tenue correcte exigée » semble persister dans les espaces d’exposition. Belle réalisation, le musée de la photographie, pourrait presque être un lieu de vie et d’animation. Le parc du musée, où l’on peut se promener, mais où l’on ne peut pas amener de musique, ni d’animaux, montre que ce beau musée n’est pas prêt à se transformer en lieu d’action culturelle plus que d’exposition.
L’extérieur est présent à chaque recoin du musée mais rien ne semble bouger à l’extérieur, fixe comme les paysages captés sur pellicule. Les possibilités sont là, le carcan aussi. Alors, les radiateurs rebelles du musée de la photographie de Charleroi sont des précurseurs d’une libération créatrice, saccageant la pureté et libérant les espaces d’exposition !
Oiseau en sticker collé sur une vitre dans la cage d’escalier, musée de la photographie, Charleroi.
En 1929, au Bauhaus de Dassau, un radiateur était exposé, comme chef d’œuvre du génie moderne et industriel, dans la cage d’escalier principal de la prestigieuse école d’art. Les révolutions prennent parfois du temps !
Margot Delobelle
#scénographie
#photographie#musée

La reconstitution historique, vers de nouvelles pratiques muséales ?
Fêtes antiques de Bibracte, fêtes d’Arkeos, fêtes galantes de Chambord, ces structures culturelles ont fait le choix de la reconstitution historique pour valoriser leur patrimoine. De plus en plus nombreuses chaque année, ces manifestations de l’« histoire vivante » se déclinent sous un large panel, de la fête, au marché en passant par les spectacles et les ateliers. Bien que fort plébiscités par les publics et connaissant un fort succès, ces événements de valorisation du patrimoine historique sont considérés par de nombreux experts comme des événements folkloriques qui desservent les sciences historiques. La reconstitution historique médiévale se développe majoritairement dans les châteaux ou centres d’interprétation, peu dans les musées, là où la reconstitution historique de la grande guerre s’y développe largement. Faisons un tour rapide de ces pratiques et de ce qu’elles révèlent d’une nouvelle approche de la médiation du patrimoine.
image d'intro : Reconstitution historique au parc archéologique d’Arkéos, (Source : Cédric Arnould pour département du Nord)
Qu’est-ce que la reconstitution historique ?
Issue d’un mouvement anglo-saxon de la fin des années 1960, la reconstitution historique est une pratique de mise en avant du patrimoine, de manière vivante, en faisant vivre aux visiteurs des moments de l’histoire. La reconstitution historique joue sur le sensible et la mise en scène auprès du visiteur. Dans le cadre des visites de musée, elle sert d’appel aux publics peu habitués des musées qui participent alors activement à la médiation qu’elle représente. Souvent issus du milieu associatif, les reconstitueurs sont des bénévoles passionnés d’une époque donnée, intervenant en fêtes historiques à la demande des musées ont pour objet la réintégration de l’espace (architecture, collections, musée, bâtiment architectural …) dans son époque (sa chronologie réelle ou d’évocation par la fête médiévale).
Le souci archéologique dans ces manifestations historiques s’éloigne à mesure que l’endroit où il prend place s’éloigne des lieux de conservation du patrimoine (MH, musées…), poussant le principe de la reconstitution historique jusque dans ses limites, en reniant parfois l’historicité.
A la reconstitution historique, s’opposent ainsi aux mouvements moins scientifiques que sont l’évocation, ou encore le grandeur nature (GN), à ne pas confondre avec la reconstitution historique. L’évocation désigne les compagnies qui cherchent à restituer l’ambiance d’une époque donnée, parfois au détriment de l’historicité des objets restitués. Le GN désigne quant à lui une rencontre entre des personnes, qui interagissent physiquement dans un monde fictif à travers le jeu de personnages. Le GN n’a pas de teneur historique.
Toucher un nouveau public, faire rentrer de l’argent

Carriers, château de Guédelon (Source: château de guédelon, tous droits réservés)
Cette visée de rentabilité de la reconstitution historique tient particulièrement au succès du Puy-du-fou, célèbre parc à thème historique vendéen. Ce parc donne l’impression de reconstituer l’histoire pour les visiteurs qui ne connaissent pas le milieu, pour autant, il ne s’agit pas là de reconstitution mais de divertissement. Au sein des reconstitueurs, le Puy-du-fou fait débat, son manque de rigueur historique lui est reproché, alors que selon ses propres termes, le parc ne vise pas l’exactitude historique mais a plutôt pour objectif de mettre en scène une image collective d’une époque selon la manière dont elle est imaginée par les visiteurs. Là où les reconstitueurs cherchent à déconstruire des préjugés, le Puy-du-fou les renforce.
Ces démarches au sein des musées français restent marginales, en comparaison avec la croissance qu’elles connaissent dans les châteaux français, et plus encore dans les musées américains. C’est ce que rapporte Maryline Crivello, professeur d’histoire à l’université Aix-Marseille. Elle insiste sur le fait que la plupart des musées américains ont mis en place cette dimension ludique qui mêle parc d’attraction et reconstitution. Entre l’argument patrimonial et l’argument économique, le compromis est au service d’un “tourisme ludo-économique”.
Cet attrait de la reconstitution historique a bien été repéré, notamment par de nombreuses collectivités et structures culturelles qui succombent au charme des événements de reconstitution historique plus “classiques”. Elles ont la plupart du temps pour objectif d’attirer un nouveau public dans leurs structures muséales, notamment le « non public » (qui ne va pas au musée), ou ceux qui s’y rendent peu.
Entre 2016 et 2017, Jacqueline Eidelman, conservatrice générale du patrimoine a mené la mission “Musées du XXIe siècle”. Il en ressort que sur les visiteurs interrogés, 91% estiment que les musées sont insuffisamment adaptés au jeune public. La reconstitution historique permet de renouer le lien avec le public d’une manière informelle, sans visite guidée. Lors des camps ou de reconstitution, organisés par les associations, les reconstitueurs vivent selon les principes de l’époque restituée. Les visiteurs sont invités à découvrir un camp médiéval par exemple, dans ses moindres détails, des tables aux tentes, en passant par la nourriture ou encore l’artisanat. En déambulant dans le camp, l’expérience du visiteur est alors enrichie par l’apport d’informations de la part des reconstitueurs sous la forme de discussion ou de médiation informelle. Les reconstitueurs d’histoire vivante comme ils se définissent parfois dépoussièrent ainsi l’histoire et les périodes parfois boudées par les Français (ex : les périodes médiévales jugées sombres et sales) pour en débouter les préjugés.
Comme le souligne Thomas Dunais, président de l’association de reconstitution les Ambiani, les événements de reconstitution ressemblent à du spectacle pour le public peu habitué, ils sont le « néon qui clignote », pour attirer du public à se rapprocher de l’histoire, de l’archéologie, en se rendant par la suite dans des structures culturelles spécialisées.
Cette logique est bien comprise par les élus des collectivités. Des objets d’appels sont alors largement valorisés sur les affiches correspondant à ces évènements, tels que les chevaliers, ou encore des sorcières pour des évènements médiévalisant autrement moins historiques.
Michel Rouger, directeur du muséoparc d’Alésia partage cette idée que la reconstitution historique permet d’attirer du public si les professionnels qui la réalisent sont bons et sérieux. Ce site appuie fortement sa programmation culturelle sur cette idée. Dans sa communication, le site promet aux visiteurs une “immersion dans la vie gallo-romaine”., que ce soit par des visites guidées théâtralisées ou des week-ends de reconstitution historique. Il insiste que tant que les informations transmises dans ces événements sont véridiques, alors la forme peut être aussi ludique et innovante que souhaitée d’autant plus que les tutelles des musées et structures culturelles publiques leur demandent d’attirer plus de publics : alors le renouvellement des médiations est encouragé. Le muséoparc d’Alésia apparaît comme pionnier en la matière.

Fêtes romaines du Muséoparc d’Alésia (Source: Le bien public)

Visite théâtralisée au Muséoparc d’Alésia (Source: muséoparc Alésia)
Un rendez-vous avec l’histoire ?
La reconstitution historique joue un rôle de médiation culturelle en tant qu’elle sert d’intermédiaire entre un contenu culturel et le public. Le reconstitueur est ainsi par extension un médiateur du contenu qu’il transmet, habitant ainsi ce contenu pour mieux le rendre tangible par le public. Evelyne Bouchard conforte cette idée du reconstitueur comme médiateur en faisant une analogie entre un guide et un reconstitueur. Le guide apprend ainsi ses informations, puis les communique au public, là où le reconstitueur les apprend et les met en pratique, donnant ainsi une plus-value au public lors de ses échanges.
Dans un musée historique, les cartels, aussi bien décrits et expliqués soient-ils, ne prennent de sens que lors de leur réception par le récepteur, selon ses connaissances, sa compréhension des variations de la langue et sa culture personnelle. Le message peut être mal interprété. Lors d’ateliers en costume, les musées peuvent trouver leur intérêt en la présence de reconstitueurs capables de faire découvrir au public la fonction de telle ou telle clé, en la mettant en action, là où le cartel peut se révéler insuffisant. La reconstitution historique dans les salles des musées, agit ainsi en activateur du médium textuel ou iconographique (textes de section, cartels …), réveillant aussi la curiosité d’un visiteur, là où l’intervention d’un guide ne donne pas nécessairement envie d’en savoir plus.
C’est cette démarche qu’a choisi le château de Foix, où les animations enrichissent le contenu textuel mais aussi déclenchent un échange avec le public.
Quelle démarche pédagogique derrière ces évènements pour les structures culturelles ?
Comme pour tout événement culturel propre à une structure culturelle, les reconstitutions historiques répondent à un objectif précis émis par un musée, comme celui de transmettre des connaissances sur une période donnée, ou une société donnée. Ainsi, les fêtes médiévales pour grand public et touristes juxtaposant des périodes et aires géographiques éloignées renforcent les clichés et à priori des visiteurs sur une époque en multipliant les raccourcis malheureux.
Une bonne reconstitution historique doit équilibrer scénario et historicité, cet équilibre entre message des historiens, de l’institution muséale et de la compagnie concernée doit être véritablement réfléchi. Ainsi, une définition précise de l’objectif de l’événement est nécessaire : s’agit-il d’un divertissement culturel pour le grand public, d’une manière d’attirer un maximum de touristes, ou d’un événement de reconstitution historique à vocation scientifique ?
Dans le cas d’un événement à vocation scientifique, plusieurs médias sont convoqués, à savoir, des objets médiateurs, des ateliers pédagogiques et des expositions faites de décors ou de costumes, qui transposent le discours scientifique des historiens pour le rendre accessible aux visiteurs.
Cette transposition se fait par plusieurs biais :
⦁ La linguistique : discours historique
⦁ L’analogie : représentation des techniques de l’époque via des reconstitutions
⦁ La métonymie : témoigner d’une époque par les objets
⦁ Les objets médiateurs
Entendre et oublier, voir et se souvenir, faire et comprendre. Cet adage, qui a fait naître cette réflexion sur la reconstitution historique au parc Le Bournat résume l’intérêt cognitif de la reconstitution historique pour transmettre un contenu culturel. Les objets reconstitués, qu’on appelle « objets médiateurs » aident ainsi à vulgariser, ou du moins à simplifier le discours linguistique porté par les reconstitueurs.
Les reconstitueurs s’appuient également sur des éléments emblématiques des époques restituées, telles que les chevaliers, épées ou armures. Ces « objets d’appel », comme ils sont qualifiés, attirent et de fixent l’attention d’un visiteur, là où une fois suffisamment impliqué dans la découverte, un contenu plus fin est injecté. Cette technique permet à la personne d’aborder des aspects variés d’une époque donnée à partir d’un élément emblématique.
Associer événement de reconstitution historique et mission éducative et scientifique du musée, un gage de qualité
Pour bien organiser un événement de ce type, et apporter un contenu scientifique au public, trois aspects sont à prendre en compte avec attention par le professionnel de musée qui les organise.
Tout d’abord, essayer d’associer un scientifique ou un historien à la sélection de la compagnie et aux dialogues avec elle. Bien qu’il s’agisse d’une pratique gourmande en temps, elle est souvent garante d’un événement de reconstitution réussi. D’autant que le travail conjoint entre reconstitueurs et chercheurs des musées a permis de faire gagner en sérieux à la discipline, comme le souligne Thibaut Hycarius, reconstitueur et vidéaste.
Les partenariats entre le monde muséal et le monde de la reconstitution historique ne se nouent pas uniquement au niveau des responsables de services des publics, mais gagnent de plus en plus l’intérêt des directeurs de musées. Laure Barthet, directrice du musée Saint Raymond de Toulouse partage cet engouement : « Les deux mondes communiquent enfin et s’interpénètrent. Il y a une génération de professionnels de musées qui sont aussi reconstitueurs. […] L’histoire vivante, ça fait toujours un carton. On casse la distance avec les objets et avec la matière historique. On établit un lien direct, réel. »

Les fêtes romaines du théâtre antique d’orange (Source: le dauphiné libéré)
Également, les villes antiques d’Orange et de Nîmes accueillent chaque année des reconstitutions de jeux romains dans leurs amphithéâtres, en sous-traitance avec Culture Espace. Pour garantir une crédibilité à ces événements rassemblant plusieurs centaines de reconstitueurs, l’entreprise s’entoure d’experts et de scientifiques du sujet, majoritairement universitaires
Ensuite, il est très important de recruter la compagnie sur dossier et références, comme cela se ferait pour un artisan. Comme le souligne Laura Barthet, directrice du musée Saint Raymond de Toulouse, il y a des bons et des mauvais reconstitueurs, certains ont un très bon matériel et de beaux costumes mais sont de mauvais médiateurs, d’autres, au contraire sont capable d’être très bons en spectacle mais mauvais d’un point de vue scientifique. C’est pourquoi il faut bien cadrer la demande lorsqu’on la réalise et qu’il est nécessaire de connaître le milieu de la reconstitution pour savoir quoi surveiller.
Alors comment reconnaître une compagnie sérieuse dans sa démarche ?
Un premier élément à prendre en compte est l’ancrage historique et géographique porté par la compagnie. Les évolutions techniques dans l’histoire médiévale ou encore contemporaine transforment régulièrement les modes de vie . Ainsi, une compagnie sérieuse ne peut pas prétendre reconstituer cent ans de l’époque, sans quoi, les sources historiques utilisées par la compagnie concernée seront floues, comme le discours qui en résulte. Il en va de même pour l’aire géographique choisie, pour les mêmes raisons.
Conformément aux missions du musée, - concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation -, le musée ne peut contribuer à la diffusion d’idées reçues ou fausses sur une période donnée. Une bonne compagnie de reconstitution sera en mesure de fournir au musée des sources appuyant les animations ou ateliers qu’elle mettra en place.
Des ateliers de démonstration sont souvent proposés par les associations de reconstitution, pouvant porter sur du tissage, des ateliers de cotte de mailles … Pour autant, comme un médiateur construit un atelier pédagogique, une bonne compagnie sera en mesure de construire la trame de son atelier selon des objectifs pédagogiques ou d’apprentissage qui lui seront propres, et selon des ressources historiques. Ainsi, un atelier sur la cotte de mailles sera l’occasion d’immerger progressivement le visiteur dans l’artisanat médiéval et d’évoquer tant la place du chevalier que de l’artisan, là où une animation sur l’alimentation fera prendre conscience aux visiteurs de l’importation massive des légumes actuels. Dans ces ateliers, l’histoire est ainsi mise en avant au-delà du spectaculaire et de la fiction. L’intérêt historique pour les musées de faire appel à ce type de médiations vivantes se joue principalement dans l’équilibre trouvé ou non entre ateliers sourcés et démonstrations spectaculaires, où des ressources archéologiques et historiques sont utilisées pour évoquer des combats mais qu’une chorégraphie de démonstration transforme en spectacle. L’imagination dépasse ainsi bien souvent l’historicité du moment.
Basée sur des bases archéologiques réelles, une adaptation spectaculaire de l’histoire peut ne pas basculer dans la fiction, l’issue de la bataille de Bouvines par exemple est respectée. Aussi faut-il apprendre à faire la différence entre évocation, reconstitution et GN (grandeur nature).
Claire Hammoum–Faucheux
Pour aller plus loin :
- EIDELMAN J. (dir.) Musées du XXIe siècle, Ministère de la Culture et de la Communication, 2017
- MATIAS S. La reconstitution historique : une médiation pour parler de l’histoire. Sciences de l’Homme et Société. 2020.
- Sphères 4, Les reconstitueurs, janvier 2021
#Reconstitution #Histoire vivante #Médiation

La vraie-fausse nature des dioramas
En 2017, le Palais de Tokyo inaugure Dioramas, une exposition faisant la part belle à ce dispositif muséographique. Mêlant œuvres anciennes et contemporaines, l’exposition s’attachait à présenter les différentes facettes des dioramas. Objets de fantasme, les dioramas incarnent dans l’imaginaire collectif le charme un peu désuet des musées du XIXè siècle. Ces compositions en trois dimensions et généralement grandeur nature mêlent à la fois sculpture, peinture, objets et parfois vitrine. Ils illustrent un écosystème, un événement historique ou le mode de vie de populations proches ou éloignées. Ces reconstitutions tridimensionnelles sont souvent conçues comme les miroirs du monde dans lequel ils ont été créés : ils permettent de comprendre ainsi l’état des connaissances scientifiques lors de leur création et témoignent aussi du mode de pensée d’une époque. Très appréciés par le public familial, les dioramas sont néanmoins souvent vieillissants, et plus forcément représentatifs des modes d’expositions actuels. Retraçons son histoire pour en comprendre les évolutions, son intérêt dans les représentations de notre environnement et ses renouvellements.
Image de couverture : ©S.C – « Bête noire », Kent Monkman, Palais de Tokyo
Aux origines du diorama
Ce mode d’exposition prend racine en 1822 avec la création par Louis Daguerre, peintre en décors de théâtre, de ce qu’on appellera le daguerréotype. A cette période, le diorama se résume à une toile tendue légèrement translucide, qui s’anime grâce à des jeux de lumière. Au fil des années, il s’enrichit avec l’apparition d’objets en trois dimensions.
La fin du XIXè siècle marque un tournant dans la muséographie moderne : le public constitué d’élites laisse peu à peu place aux scolaires, et les musées doivent s’adapter. Les objets amassés dans les vitrines disparaissent pour laisser place à des espaces plus aérés. L’objectif est alors de démocratiser l’accès au musée, et la médiation en devient un instrument majeur. Le diorama, mettant en scène la nature, devient très rapidement une norme moderne et novatrice pour accueillir ses nouveaux publics, notamment en Amérique du Nord. Les modèles de cires et les animaux naturalisés figent un moment, un lieu, que de nombreux visiteurs ne pourraient voir en temps normal. A l’American Museum of Natural History de New-York (AMNH), des dioramas représentant des animaux d’Afrique en pleine chasse ou l’arrivée des colons en Amérique sont installés au sein du musée. Ce changement pour des espaces plus aérés et des connaissances scientifiques actualisées interviendra en France bien plus tard, dans les années 1920-1930.
Les muséums ne sont pas les seules institutions à intégrer des dioramas dans leurs nouvelles présentations. A la fin du XIXè siècle, la présentation des folklores traditionnels inspire : pour l’exposition universelle de Paris en 1878, les Pays-Bas présentent dans leur pavillon l’intérieur Hindenloopen, un habitat hollandais traditionnel, qui passionne les visiteurs. L’intérieur comporte des objets traditionnels donnés par les locaux, et la possibilité d’entrer dans la pièce apportait un caractère immersif très apprécié à l’époque. L’intérieur remporte le diplôme d’honneur du jury et un vif succès critique. Ce type de présentation influence grandement les musées d’ethnographie : de nombreux musées s’emparent du concept pour l’intégrer dans leurs muséographies, à l’image du Museon Arlaten qui ouvre en 1899.

Une représentation de l’intérieur d’Hindeloopen, lors de l’Exposition Universelle de 1878 à Paris ©Worldfairsinfo
Paradoxalement, bien que le diorama cherche à rendre compte de la réalité la plus pure, celui-ci n’est bien souvent qu’une nature arrangée, normalisée et il joue sur le caractère spectaculaire pour attirer les foules.
Le diorama, à la fois spectaculaire et normalisateur
Pour intéresser le public, le musée peut s’appuyer sur ses collections, en présentant des pièces qui attirent la curiosité des visiteurs. Le diorama, grâce à son aspect théâtral et immersif, joue sur ces codes pour toucher un plus large public.
A de nombreux égards, le diorama peut être comparé à une scène de théâtre. En effet, la création de ces espaces nécessite l’intervention de nombreux corps de métiers ayant traits au théâtre, comme les décorateurs et les peintres en décors. En intégrant des animaux naturalisés, le diorama apporte cette touche étrange qui fait entrer la scène dans une nouvelle dimension, plus spectaculaire. L’objectif est de donner au visiteur le sentiment d’être à l’intérieur de la scène, d’oublier le monde moderne. Ce dispositif avant tout muséographique devient un véritable objet culturel, fascinant. Dans un entretien réalisé par Noémie Etienne pour évoquer son travail en tant que commissaire de l’exposition « Dioramas » présenté au Palais de Tokyo en 2017, Laurent Le Bon évoque cette fascination : « Je crois qu’il y a une fascination pour ce dispositif. C’est aussi un retour dans le monde de l’enfance. Le temps d’un parcours, on peut avoir la sensation de dominer le monde, mais aussi d’être comme Alice au pays des merveilles. »1.
Toutefois, cette recherche de spectaculaire et d’immersion a pu avoir un effet néfaste sur la rigueur scientifique de ces présentations. En 1884, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro présente la Salle de France, regroupant des intérieurs typiques de différentes régions de France. Parmi eux, la vitrine « Bretagne » est très appréciée. Ainsi, Eugène Oscar Lami écrira « Dans une grande salle bien éclairée, quelques femmes bretonnes et frisonnes, et un intérieur breton de grandeur naturelle, frappant de vérité. Tout y est, pots, lits en forme d’armoires de bois ouvragé, et le vieux grand-père, toujours gelé, assis dans l’âtre même du foyer. Ce décor, très bien réglé, a le don d’attirer la foule »2. Ici, c’est le patrimoine, le visuel qui a été mis en avant, comme un discours pour la conservation des traditions. L’aspect scientifique n’est pas la motivation principale de ces vitrines. *
En ce qui concerne les dioramas naturalistes, un biais anthropocentriste affecte également la rigueur scientifique de certaines présentations. Loin de vouloir présenter une vérité scientifique, les naturalistes cherchent parfois à montrer leur supériorité face à la nature en la maîtrisant à travers le diorama. Cette maîtrise s’exprime de plusieurs manières. Les animaux naturalisés sont tout d’abord souvent issus de chasses effectués dans l’optique de trouver le spécimen le plus beau, le plus fort, le plus esthétiquement représentatif de son espèce. Une fois les spécimens rapportés en Occident, les animaux sont naturalisés pour les rendre le plus vivant possible. On nettoie les peaux en les débarrassant de la poussière et des puces, on masque les coutures, on fait disparaître les possibles cicatrices visibles sur la peau… L’être humain maîtrise alors la nature, en la rendant plus esthétique.
La mise en scène choisie théâtralise également la nature. En 1936, l’AMNH accueille l’African Hall, créé par le naturaliste Carl Akeley. Le naturaliste est parti lui-même en expédition pour capturer les animaux et s’imprégner des lieux afin de le reproduire au mieux dans ses dioramas. A son retour, Carl Akeley crée des scènes prises sur le vif, où l’animal prend une pose parfois dramatisée. Loin de la réalité, le fond du diorama représente le plus souvent une nature paisible, fantasmée, loin de la réalité. Le diorama des gorilles en est un exemple marquant. La scène, construite telle un tableau, présente un gorille mâle triomphant face à deux femelles accroupies en contrebas. La toile de fond, digne du jardin d’Eden, rend la scène hors du temps et onirique, sans aucun rapport avec la réalité. En parlant du diorama des gorilles, la chercheuse Anne Haraway écrit : « Bouleversant la logique muséale classique, Akeley expose des tranches de vie dans le jardin vierge d’une Nature aseptisée, parfaite et morale, expurgée d’animaux malades, difformes, âgés ou lâches » 3.

Le diorama des gorilles, dans l’African Hall du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©maaachuuun sur Flickr
Un art au service des idéologies
Objet culturel par excellence, le diorama reste une création humaine, et par conséquent est à son image. Ainsi, dans le même temps que leur popularité grandissante, les dioramas vont séduire et distraire les masses. Véritable outil éducatif dans le monde occidental de la fin du XIXè siècle, le diorama propose alors un discours qui n’a pas toujours de lien avec la réalité. Pour certains, il s’agit même de faire passer une idéologie représentant la pensée de l’époque, eugéniste et patriarcale.
Un exemple frappant se trouve (encore !) à l’AMNH. Le diorama des lions présente un groupe de lions avec un mâle debout et regardant au loin, tandis que les femelles sont allongées pour la plupart. Bien qu’ayant été sur le terrain, Carl Akeley propose ici un discours à l’image de son temps en transposant une idéologie humaine à un groupe animal. Ainsi le lion, représentant la force, la noblesse, est droit, debout, tandis que les femelles adoptent une position bien plus passive, à l’image de ce qui est attendu du statut de femme à la fin du XIXè siècle. Il aurait été bien plus rigoureux scientifiquement de présenter une scène de chasse où les femelles sont en action.

Le diorama des lions du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©AMNH
Ce discours est également rattaché à la pensée eugéniste de cette période. Les animaux, capturés comme étant les plus beaux spécimens de leur espèce, sont une recherche d’un idéal. Noémie Etienne résume le contexte idéologique de cette période dans un entretien pour France Culture : « il s’agissait de trouver le spécimen le plus représentatif de sa 'race', quitte à en abattre plusieurs jusqu’à obtenir celui qui serait naturalisé pour être transporté à New York. On construisait ainsi une image de l’espèce conformément à des critères relativement abstraits et qui ne reflétaient pas la diversité des animaux. La même ambition sous-tendait les représentations humaines sous forme de mannequins : elles sont ainsi problématiques car elles prétendent montrer une vision scientifique de types 'raciaux' - construisant ainsi une image factice et préconçue de l’altérité. » 4
Bien évidemment, les dioramas ethnographiques sont également touchés par les préjugés de cette période. Proposant une image biaisée de la réalité sur fond de roman national, les dioramas ethnographiques sont souvent directement rattachés aux zoos humains présentées dans les Expositions Universelles de la fin du XIXè siècle. Ces représentations sont de véritables outils de propagande à l’attention des scolaires. Ainsi, l’AMNH présente en 1939 le Old New York Diorama, une scène montrant l’arrivée des colons néerlandais sur le sol américain. Représentatif des clichés et de la volonté de créer un roman national fort sur la création du pays, le diorama présente des incohérences historiques importantes. Par exemple, la tribu Lenappe fait les frais des clichés sur les populations autochtones tandis que les colons blancs sont présentés comme arrivants pacifiques.

Le Old New-York Diorama, de l’AMNH, lors de sa création en 1939 ©Capture d’écran de la vidéo « Behind the Updates to Old New-York Diorama » de l’AMNH
Un exemple plus récent nous vient de l’Australian War Memorial de Cambera. Durement touché lors des combats de la Première Guerre Mondiale, l’Australie reste néanmoins loin des champs de batailles. Une partie des dioramas présentés ont été créés par Charles E. W. Bean, historien et correspondant de guerre durant le premier conflit mondial. Les dioramas de cette période manquent de recul sur la situation. Le diorama de Lone Pine présente par exemple une offensive australienne. La scène est centrée sur un soldat fauché par une balle, tandis que ses camarades reconquièrent des positions ennemies. Cette représentation, entre la scène de théâtre et celle de cinéma, sert le discours populaire présentant l’Angleterre indifférente au sort des Australiens, menant à terme à l’indépendance de l’Australie.
Le diorama Lone Pine de l’Australian War Memoria (1924) ©AWM
Et aujourd’hui ?
Un peu oubliés dans la seconde partie du XXè siècle car considérés comme désuets, les dioramas n’en restent pas moins très présents dans les musées, à travers des présentations d’époque ou plus récentes. A l’aune du XXIè siècle, les critiques ont été entendues, et de nombreux changements s’effectuent autour de ces dispositifs.
Les anciennes représentations ont pour la plupart été retirées des parcours permanents dans les musées de grande envergure, mais il arrive que certains aient été amendés, pour porter un nouveau discours. C’est notamment le cas du Old New-York Diorama, cité plus haut. En 2018, l’AMNH a fait le choix de présenter le diorama en ajoutant sur la vitrine de nombreuses informations. Cet ajout permet de recontextualiser la scène et d’évoquer les erreurs historiques portées par le diorama, en précisant par exemple le rôle des femmes chez le peuple Lenappe ou en évoquant la violence dont ont pu faire preuve les colons à leur arrivée.
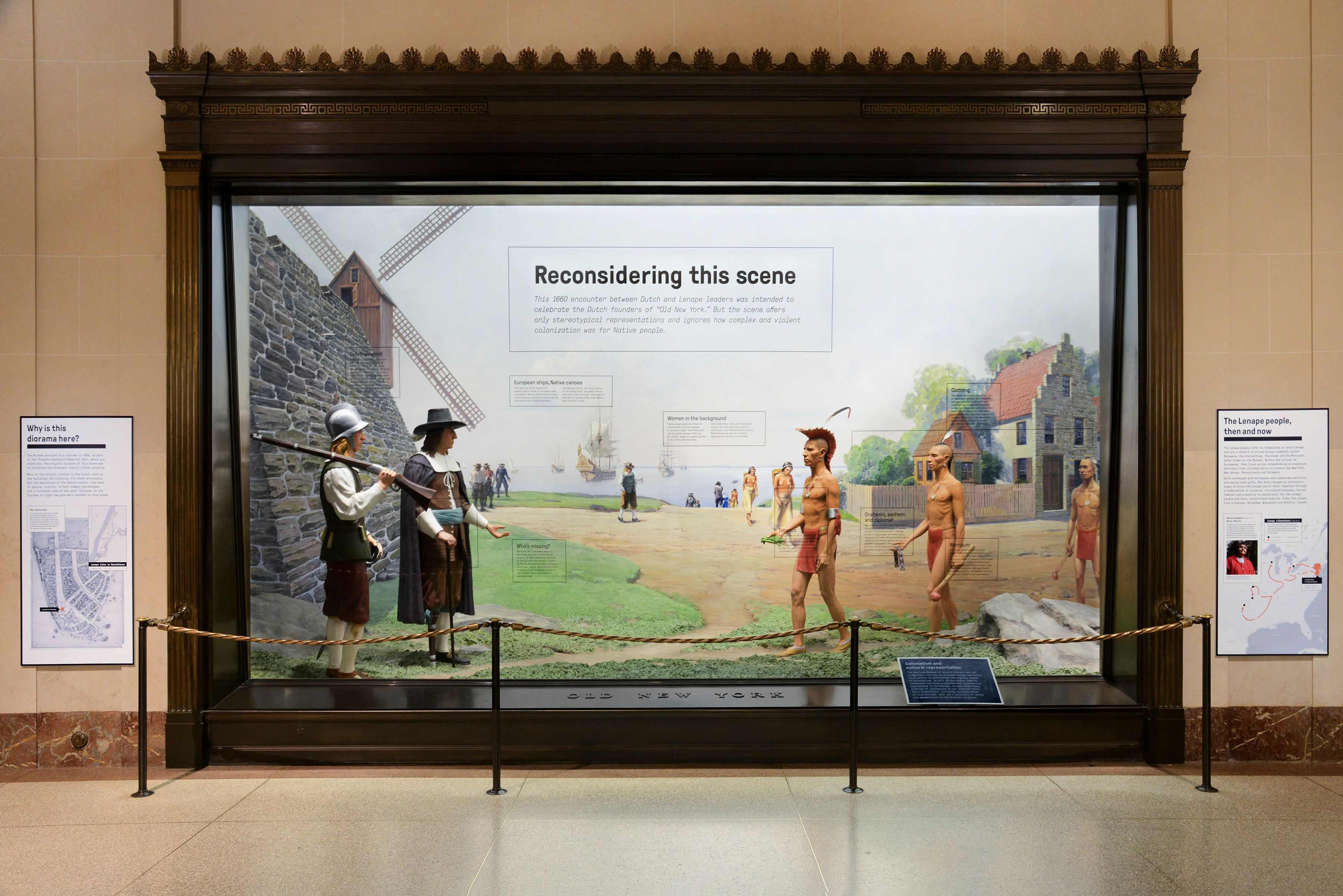
Le diorama Old New-York accompagné de ses cartels explicatifs depuis 2018 ©Hermes Creative Awards
Loin des visions caricaturales de l’époque, les dioramas produits aujourd’hui sont toujours conçus dans un objectif pédagogique, tout en portant sur des sujets différents. Les dioramas animaliers sont le plus souvent tournés vers la biodiversité, la dégradation des espaces. Cela permet d’apporter un contenu visuel pour les publics jeunes et scolaires, pour inviter à la prise de conscience sur ces thématiques. Plus qu’un simple dispositif pédagogique, le diorama devient alors un véritable support à la médiation. Dans le cadre de la refonte de son parcours permanent, le Musée d’Histoire de Lyon a fait le choix d’introduire un diorama dans la partie « Les pieds dans l’eau ». L’équipe de scénographie a recréé un lône, un espace retravaillé en bordure du Rhône pour réintroduire des espèces. La scène présente les espèces typiques des lônes (martin-pêcheur, castor…) cohabitant avec les déchets. Le diorama abrite plusieurs outils de médiation, comme une « hutte », dans laquelle les plus jeunes peuvent s’installer pour écouter des récits sur le sujet.

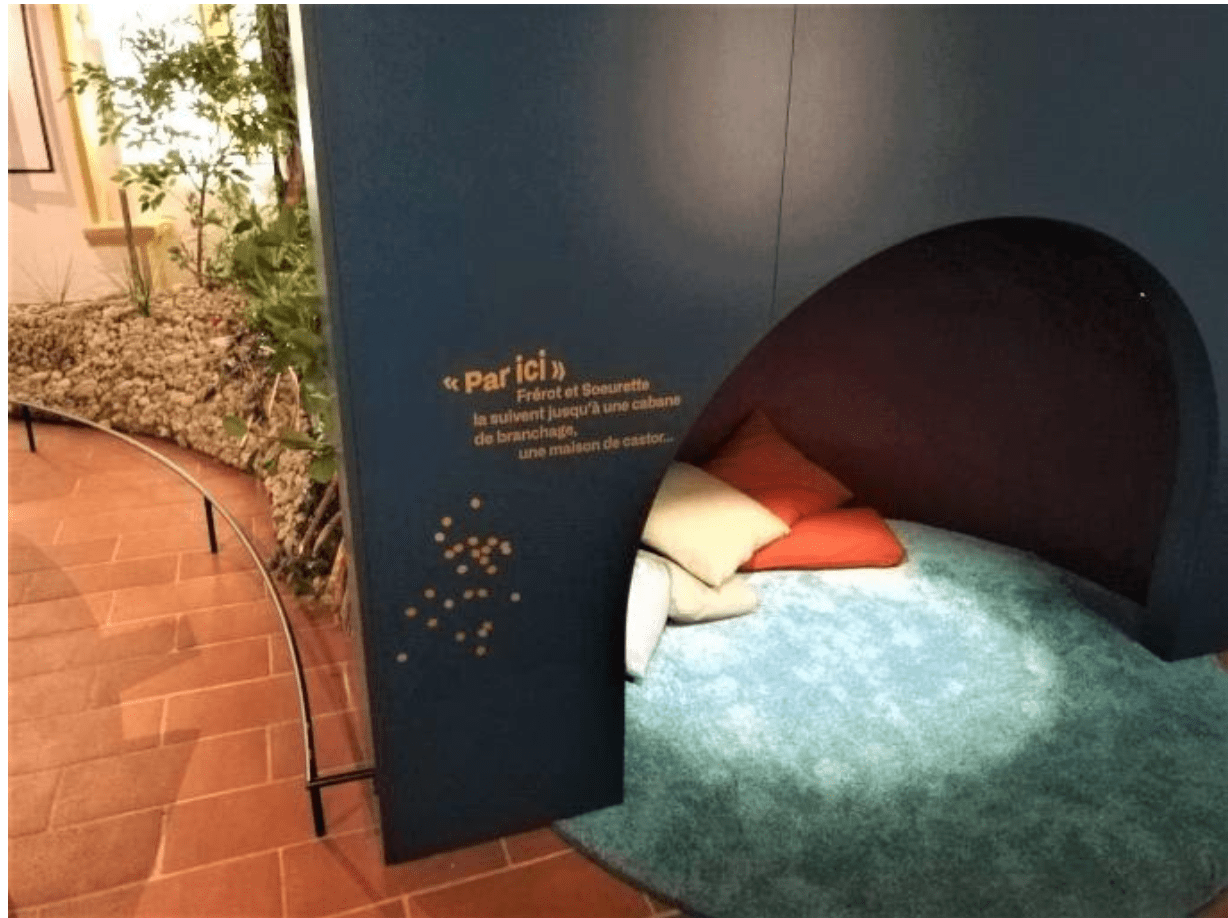
Le diorama du Musée d’Histoire de Lyon, conçu par Scénorama en 2020 ©J.G
Depuis sa création objet de fantasme et du spectaculaire, le diorama est représentant de sa période de faste, en présentant souvent une image biaisée de l’Histoire. Pourtant, il est toujours aussi plébiscité, principalement par le jeune public, car son caractère théâtral et immersif n’a de cesse d’émerveiller petits et grands. Désormais, le diorama n’est plus l’outil de médiation, mais simplement le support, sur lequel les médiateurs et/ou les dispositifs associés apportent un nouveau discours plus en accord avec son temps.
Image vignette : ©C.dC – Diorama « Un village néolithique en Haute-Provence » au musée de la Préhistoire de Quinson
Clémence de CARVALHO
1 Laurent Le Bon et Noémie Étienne, « Entretien avec Laurent Le Bon », Culture & Musées [En ligne], 32 | 2018, mis en ligne le 16 janvier 2019, consulté le 9 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/2651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/culturemusees.2651
2 Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels, publié par Eugène Oscar Lami, tome VI, Paris, 1886
*L’image de la vitrine Bretagne n’étant pas libre de droit, je vous invite à la visionner ici : https://www.photo.rmn.fr/archive/07-534152-2C6NU0JLYIBS.html
3 Modest Witness@ Second Millennium. Femaleman Meets Oncomouse : Feminism and Technoscience, Donna Haraway,1997
4 Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, consulté le 9 mars 2021.
Pour en savoir plus :
-
Publics et Musées, n°9, 1996. Les dioramas (sous la direction de Bernard Schiele), accessible ici : https://www.persee.fr/issue/pumus_1164-5385_1996_num_9_1
-
Culture et Musées, n° 32, 2018, L’art du diorama (1700-2000) (sous la direction de Noémie Etienne et Nadia Radwan), accessible ici : https://journals.openedition.org/culturemusees/2197
-
Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, accessible ici : https://www.franceculture.fr/histoire/le-musee-dhistoire-naturelle-de-new-york-temple-mondial-du-diorama
-
L’AMNH présente le diorama Old New-York amendé : https://www.youtube.com/watch?v=ndj59hGuSSY
-
Sur la fascination pour les intérieurs : https://brill.com/flyer/title/36506?print=pdf&pdfGenerator=headless_chrome
#diorama #mediation #museographie

Laissez-vous tenter par une pause gourmande au musée
Les cafés et restaurants des musées sont-ils des services à vocation exclusivement commerciale ? Ces activités occupent une place importante et témoignent de l’ouverture des musées, désireux d’être des véritables lieux culturels et sociaux.
Salon de thé Rose Bakery, au musée de la Vie romantique © Sophie Robichon / Ville de Paris.
Prenant part au grand projet d’attractivité et d’accessibilité des musées, le développement des cafés et restaurants attenant ou au sein des institutions est un phénomène peu étudié. Ils sont pourtant nombreux, absolument incontournables pour les musées de grande envergure, et se présentent sous toutes les formes. Etoilé, bon marché, à concept, authentique, guindé, douillet, citoyens, ces lieux permettent d’améliorer l’accueil des publics ainsi que l’image rébarbative ou intimidante de certains musées.
Sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, ils ont une popularité presque aussi importante que les musées associés. Dans les grandes villes, le phénomène grandit avec la parution d’articles élogieux de la part de guides touristiques.
Ces espaces dédiés à la consommation de boisson et de nourriture ont évidemment un intérêt financier, mais ne peuvent être réduits à cet aspect car ils participent au grand effort des musées pour s’insérer dans la vie culturelle et sociale ainsi que leur ouverture aux publics les plus variés.
Lieux liminaires ou voisins de l’enceinte muséale, commerces à part entière et piliers des financements des musée, ou outils de communication et de médiation ? Quels sont les buts et usages de ces équipements ?
Un moyen d’autofinancement des musées
Pour s’assurer de rencontrer leurs publics et le succès de l’opération, ces restaurants appliquent un marketing identifiable, notamment en optant pour une image soignée et dans certains cas - s’agissant surtout de musées d’art, en faisant appel à un chef de renom proposant une cuisine raffinée, voir gastronomique. Le but étant d’attirer une clientèle aisée, familière d’établissements de ce standing, pour leur offrir une cuisine supérieure, frôlant l’art. C’est par exemple le cas de l’Atelier du Cerisier (musée du Louvre Lens), la Brasserie des Confluences (musée des Confluences, Lyon), Le Môle Passedat (MuCem, Marseille) ou encore l’Insensé (musée Fabre, Montpellier).
Des concepts stores à part entière ?

Post Instagram du Café Andry, menu temporaire © Café Andry
Cette formule séduisante, alliée à des prix souvent attractifs, se calque sur les stratégies marketing des concepts stores misant sur le caractère unique et surprenant de l boutique qui attirera naturellement la clientèle, accélérera la croissance des ventes et ce, en limitant les dépenses de communication. Plus encore, certains de ces commerces ont une forme éphémère, généralement présents à la période estivale, et fonctionnent sur les principes d’un événement créant le sentiment d’enthousiasme et d’urgence chez les clients. Bousculons-nous donc Au Bonheur du jour, le pop-up café du musée Cognacq-Jay, pour y déguster de délicieux produits avant qu’il ne soit trop tard !
Des lieux dédiés aux publics

Café du musée de la Vie romantique, Paris © O’bon Paris
La convivialité et l’engagement au musée

Estaminet du musée de la Vie rurale, Steenwerck © Sasha Pascual
En outre, d’autres espaces de restauration sont gérés et saisis par les publics comme de véritables lieux conviviaux. L’estaminet du musée de la Vie rurale de Steenwerck, nommé À la Gaîté souligne bien ses ambitions. La scénographie de cet espace, à la mode de l’ancien temps, comporte du mobilier, affiches et objets typiques de la période 1850-1950 faisant écho au parcours permanent du musée qui porte sur la reconstitution d’un village rural à cette période et du mode de vie associé. En plus d’une carte faite de produits locaux telles que des bières artisanales, des gaufres ou encore les pommes de son parc, le musée met à disposition des publics des jeux flamands d’époque, toujours aussi divertissants. Le café remplit ainsi les fonctions attendues d’une salle pédagogique, avec une sobriété de moyens, et encourage la transmission orale de ceux sachant jouer qui s’invite entre visiteurs d’âges différents. Par ailleurs, cet espace, véritable centre culturel, accueille la riche programmation associée du musée faite de concerts, spectacles, scènes ouvertes, soirées contes, etc., appliquant ainsi le projet muséal : fédérer autour d’un patrimoine vivant.
Romane Ottaviano
Pour aller plus loin :
Dans les musées, la pause gastronomique devient un élément clé de la visite | Les Echos
GOB André, DROUGUET Noémie, « Chapitre 9. Le musée comme acteur culturel : la fonction d’animation », La muséologie - 5e éd. Histoire, développements, enjeux actuels, Armand Colin, 2021. p.293-315. Chapitre 9. Le musée comme acteur culturel : la fonction d’animation | Cairn.info
#RestaurantDeMusée #CaféDeMusée #ExpérienceVisiteur

Le droit d'inventaire des « Premières choses » - MARKK
Si les musées d'ethnographie ont longtemps eu le monopole de la représentation de l'altérité humaine, la crise traversée par l'anthropologie a conduit les musées de société à remettre en question le regard porté sur leur collection et le discours qui en découle. L'exposition « Erste Dinge » (Premières choses) se propose de revenir sur la constitution de la première collection du musée d'anthropologie de Hambourg.
« Musée de colonisateur », « musée du monde », entrer dans un musée d'anthropologie n'est plus un choix aussi anodin qu'auparavant. Comment pourrait-il en être autrement pour nombre de ces institutions créées au XIXe siècle à une époque où ethnographie rimait avec peuples exotiques ou primitifs ? Il faudra d'ailleurs attendre le début du XXe siècle pour que les anthropologues européens se rendent compte du rapport d'altérité dans leur propre continent, et de la disparition des cultures populaires sur l'autel du progrès. En 2006, Jean-Pierre Willesme, conservateur en chef du Musée Carnavalet, concédait que ce musée de la ville voulu par le baron Haussmann correspondait à « une mémoire de bonne conscience »1;pour une élite se satisfaisant des nouvelles larges avenues parisiennes ouvertes à l’air frais et aux canons, et pour une classe populaire pour qui le musée devait être un argument d'acceptabilité de la violence politique. Ce schéma est le même pour les musées ethnographiques, voire même à un degré supérieur : imaginez qu'une instance étrangère vous force à renier votre culture « archaïque » et vous impose une « modernisation », en échange de quoi quelques aventuriers viendront dans votre ville ou village acheter (dans le meilleur des cas) quelques objets qu'ils exposeront chez eux pour le plaisir de leurs semblables. Ces derniers pourront admirer de belles mises en scène de rituels traditionnels, ceux-là même qui ont perdu tout leur sens chez vous, car les Blancs y ont tué vos génies. Un changement radical du mode de pensée des musées ethnographiques est donc nécessaire, et c'est dans cet élan que s'inscrit le nouveau programme muséographique du musée de Rothenbaum, à Hambourg.
L'exposition « Erste Dinge. Rückblick für Ausblick » (Premières choses. Rétrospective pour une perspective) répond à deux impératifs actuels du musée : la prise en compte dans son discours des dynamiques humaines entre Hambourg et le monde, et un examen approfondi des collections selon les principes d'une anthropologie respectueuse des peuples. Créé comme un « musée de l'autre » qui cherche à « donner à voir le monde » des autres cultures que la sienne2, ce musée d’ethnographie a enclenché depuis une trentaine d’années plusieurs cycles de restructuration répondant à l’affirmation des anciens pays colonisés et à la nécessité de dialoguer avec lui autrement qu'à travers un rapport ascendant hérité du colonialisme. En juin 2018, sous l'impulsion de sa nouvelle directrice Barbara Plankensteiner, le musée est rebaptisé MARKK (Museum am Rothenbaum / Kulturen und Künste der Welt – Musée de Rothenbaum / Cultures et Arts du monde) et se définit comme « un forum de réflexion examinant de manière critique les traces de l'héritage colonial, les modes de pensée traditionnels et les enjeux de la société urbaine mondialisée postmigrante ». Signe d'un nouveau départ, l’exposition « Erste Dinge », première exposition semi-permanente proposée depuis, porte un regard réflexif sur les premières acquisitions du musée, alors simple bibliothèque devenue musée, comptabilisées dans l’inventaire de 1867.
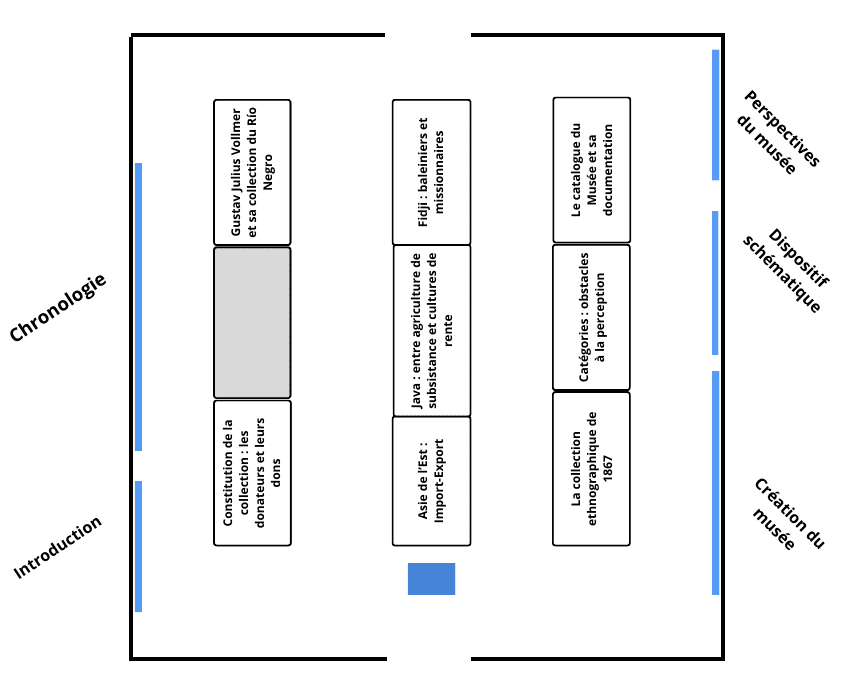
Figure 1 : Schéma de l'exposition ⓒ JT
Mondialisation et colonisation, mères de la collection de 1867
Le discours muséographique s'attache à montrer les liens étroits que tisse le musée avec la classe bourgeoise et moyenne commerçante de Hambourg. L'inventaire de 1867 recense tous les objets ethnographiques détenus par le Musée d'histoire naturelle de Hambourg, avant que ne soit mise en place une quelconque politique précise d'acquisition. Les donateurs des 650 objets recensés sont des acteurs importants de la ville, en lien avec les réseaux de marchands hambourgeois, à l'image de Gustav Julius Vollmer qui jouait un rôle de relais entre la société vénézuélienne et les expatriés allemands en Amérique du Sud. Des fonds ont ainsi été constitués à partir de réseaux relativement informels : selon le propos muséographique, il est par exemple probable qu'une partie des objets amenés des îles Pacifiques à Hambourg aient été rassemblés par des missionnaires méthodistes wesleyens dans le but de les vendre en Europe.
D'autres fonds d'objets, particulièrement ceux originaires de Chine et du Japon, sont au contraire le produit d'une industrie d'exportation orientée pour répondre au goût d'exotisme européen, tout en s'adaptant aux modes de vie occidentaux. Le visiteur assidu peut mettre en relation ces différentes origines d'objets avec la grande frise chronologique où se retrouvent pêle-mêle histoire mondiale de la mondialisation et de la colonisation, histoire nationale allemande, histoire commerciale des villes hanséatiques et le développement du commerce maritime à Hambourg. Cette représentation du commerce hambourgeois et du lien aux objets de l'inventaire est renforcée par une carte du commerce mondial où est indiqué le nombre d'objets inventoriés par région d'origine. On peut y lire, par exemple, que 221 objets proviennent d'Amérique latine (apparemment à la fois l'Amérique latine et l'Amérique du Sud) où les marchands vendaient des produits manufacturés en échange de matières premières tropicales telles que le sucre, le café, le tabac ou encore le cacao. Plusieurs encarts faisant référence à des routes commerciales de la carte permettent de découvrir l'intégration spécifique de Hambourg dans le commerce mondialisé ; la collection n'est plus seulement un ensemble d'objets sélectionnés scientifiquement, mais un rapport au monde historiquement situé et enchâssé dans des dynamiques qui peuvent être restituées : commerce des esclaves, commerce hambourgeois entre l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, l'importance des baleiniers, etc…
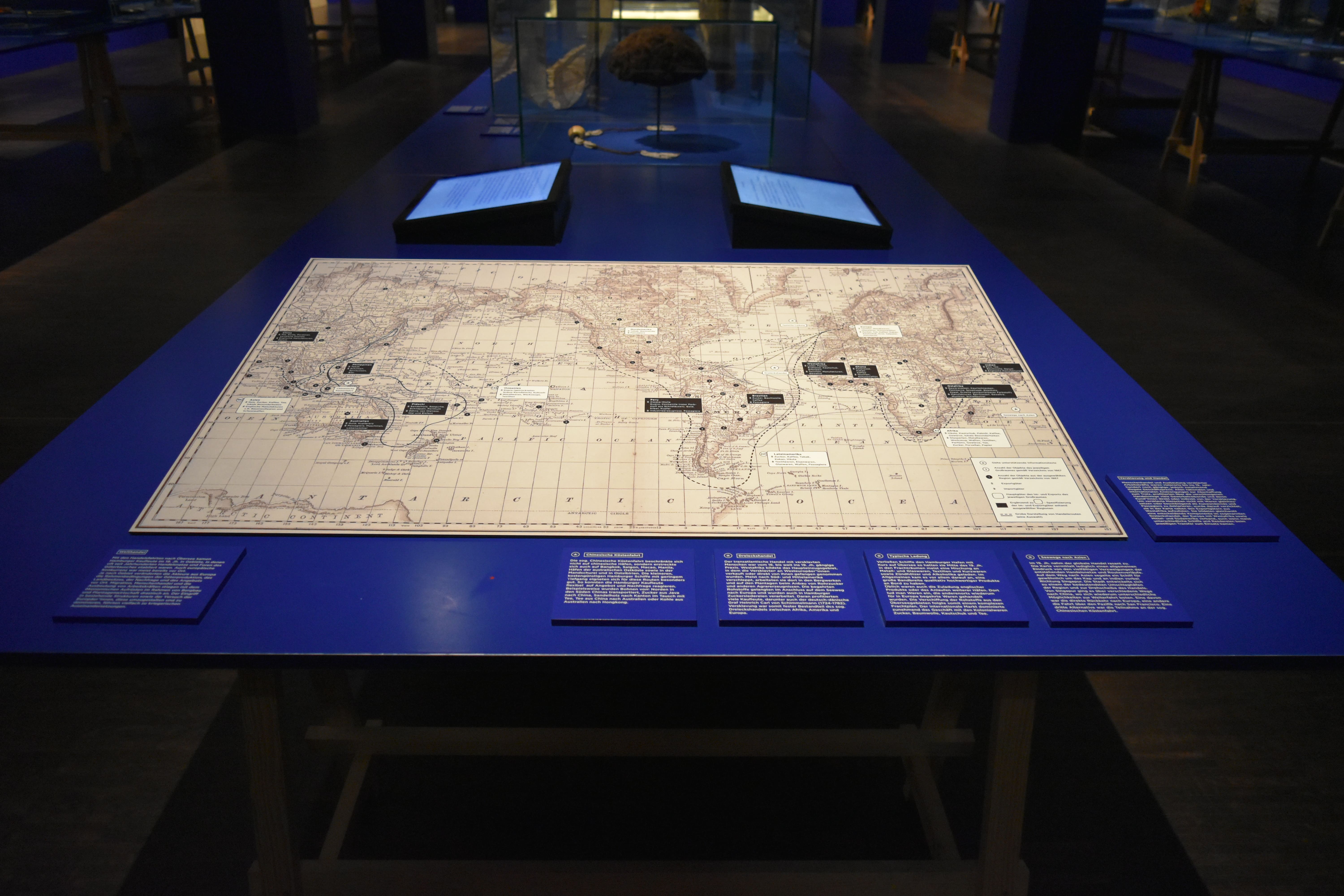
Figure 2 : Carte du commerce mondial, tablettes tactiles en arrière-plan ⓒ JT
Une anthropologie muséale hors-catégorie
Le second intérêt de l'exposition est l’interrogation portée sur les catégorisations des objets et la manière dont elles orientent la compréhension que nous avons de ces derniers, ainsi que de leurs sociétés d'appartenance. En 1867, la Commission du musée de la Société d'Histoire Naturelle prend la décision de classer les objets par région ou ethnie, faisant passer au second plan les logiques comparatives par type d'objet. Mais que faire alors des objets résultant de la rencontre de différents groupes ? C'est toute la problématique d'une ethnologie coloniale qui a longtemps voulu classifier le vivant (humains compris) sans voir les dynamiques d'échange culturel et de migration inhérentes à toute société en contact avec le monde extérieur. Le visiteur peut d'ailleurs se rendre compte par lui-même de la méthode de classement par ethnie en consultant les fiches historiques de l'inventaire sur une tablette numérique.

Figure 3 : Dispositif schématique ⓒ JT
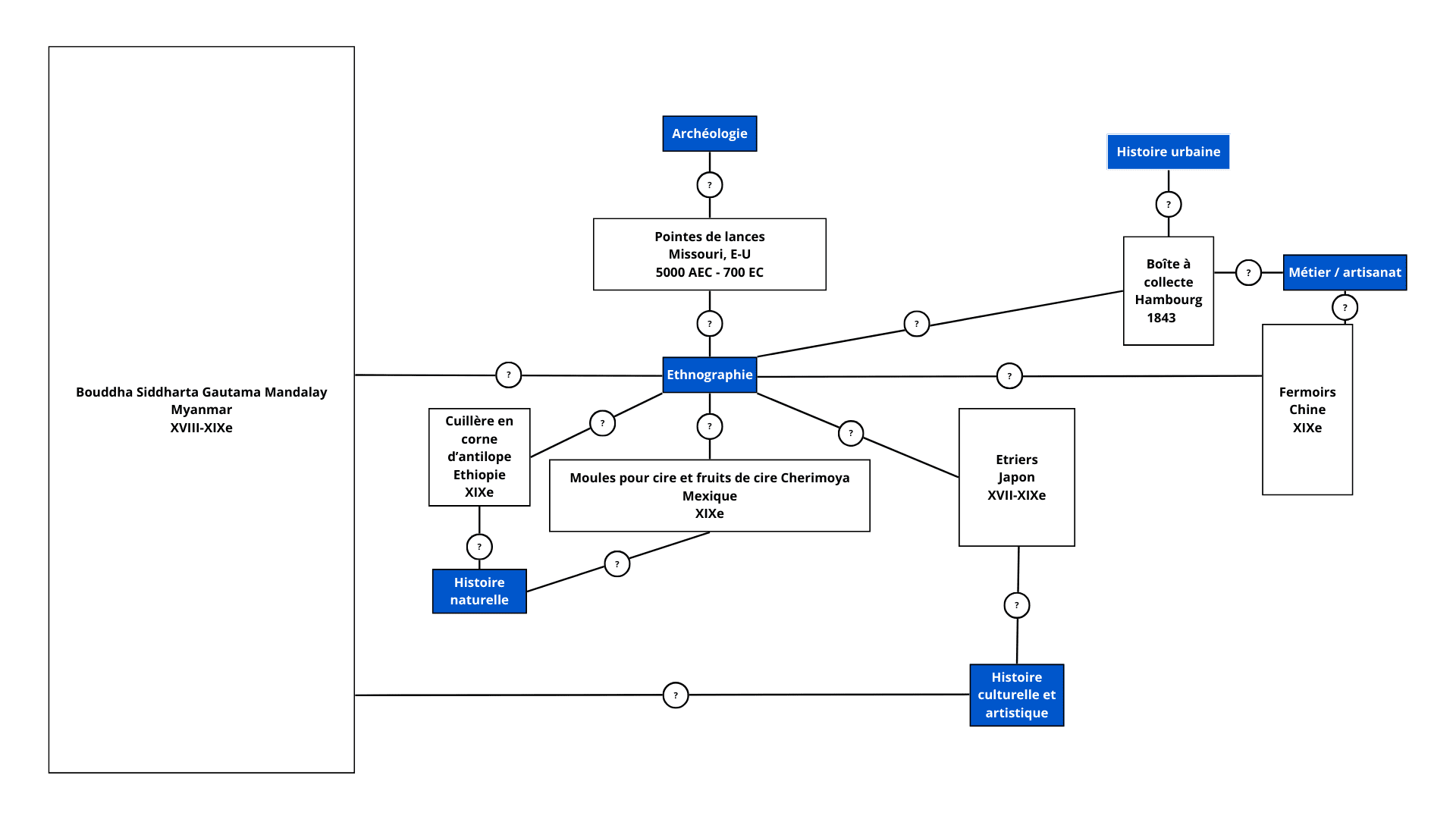
Figure 4 : Schéma du dispositif ⓒ JT
Enfin, l'un des dispositifs les plus originaux de l'exposition consiste en une disposition d'objets de façon à construire un schéma des types d'interprétations possibles selon le point de vue adopté, notamment disciplinaire. Si les objets sont rassemblés au musée pour leur intérêt ethnographique, tous peuvent être le support d'un autre savoir, comme les fruits de cire Cherimoya qui auraient autant leur place dans un Muséum d'histoire naturelle que dans un musée d'ethnographie (en termes de ressemblance à l'original, ils n'auraient pas à rougir des animaux empaillés). Cette proposition scénographique rappelle les réflexions de Thierry Bonnot dans L'attachement aux chosesoù il questionne les rapports sociaux aux objets : les classifications muséographiques sont à l'image de leurs contemporains, et c'est dans la relation que ces derniers tissent avec l'objet collecté qu’ils lui donnent du sens. Le dispositif reflète cette volonté de créer une nouvelle relation aux objets en les sortant de leur catégorie ethnique, en les mettant en relation à travers des disciplines qui ne sont plus aujourd'hui si étanches les unes par rapport aux autres.
Une métamorphose réussie ?
Seuls un an et demi séparent l'arrivée de la nouvelle directrice du musée et le vernissage de l'exposition Première chose, laissant penser que cette dernière a dû être montée rapidement pour répondre à l’agenda politique du musée et de la ville. La scénographie elle-même donne une impression de chantier à l'ensemble avec sa couleur bleue sans nuance et ses longues tables sur tréteaux, cet aspect work in progresscorrespond sans doute à la fois au propos de l’exposition et à son caractère transitoire. Malgré son air d’« exposition-manifeste », l'expographie n'a pas accouché de dispositifs interactifs ou participatifs qui traduirait une nouvelle approche dans les rapports de médiation. L’omniprésence du texte et la focalisation sur le seul sens de la vue sont des freins à la compréhension du message pour le plus grand nombre, tout comme l’absence de mesure d’accessibilité disponible au moment de ma visite.
Il n'en reste pas moins que le programme esquissé en discours s’est depuis traduit en acte : dès 2019, le musée a restitué au Musée national folklorique de Corée deux statues en pierre gardiennes de tombe achetées en 1987 à un collectionneur privé ayant outrepassé l'interdiction d'exportation des biens culturels en Corée. Ce nouveau départ a ainsi été l’occasion pour le musée de créer un partenariat de long-terme concrétisé par la mise en place de l'exposition semi-permanente « Uri Korea. Ruhe in Beschleunigung » (Uri Corée. Calme en accélération, depuis le 15 décembre 2017) sur le quotidien contemporain des Coréen.nes. Les expositions actuelles reflètent cette nouvelle politique de rupture de la représentation Soi/Autre, de rééquilibrage des rapports entre anciens pays colonisateurs et colonisés, et de participation concrète des acteurs culturels à la conception des expositions.
Julien TEA
Ouverture : 12 septembre 2018 - exposition semi-permanente, visitée en décembre 2022.
[1] Jean-Pierre Willesme, « Le musée Carnavalet : mémoire et patrimoine de la Ville de Paris » dans Andreas Sohn (ed.), Memoria : Kultur - Stadt - Museum. Mémoire : Culture- Ville - Musée, Bochum, D. Winkler, 2006, p. 284. ↩
[2] Benoît de L’Estoile, Le goût des autres: de l’Exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p. 17. Un « musée de l'autre » se compose d’une représentation finie d'un univers culturel (mise en ordre) tout en offrant une expérience d'altérité au visiteur (mise en scène) à travers la vue, sens le plus sollicité (mise en forme). ↩
Annexe :
Les expositions actuelles et leur lien au programme muséographique :
- « Benin. Geraubte Geschichte » (Bénin, Histoire volée, 17 décembre 2021 à mars 2025) présente dans son entièreté la collection de Bronzes du Bénin du musée avant que cette dernière ne soit restituée au Nigéria.
- « Jurte jetzt! Nomadisches Design neu gelebt » (Yourte maintenant ! Le design nomade réinventé, du 15 décembre 2023 au 3 novembre 2024) met en relation des yourtes de la collection et contemporaines pour présenter des problématiques liées à la mobilité, la durabilité et les compétences traditionnelles dans notre monde actuel.
- « Hey Hamburg, kennst Du Duala Manga Bell? » (Hey Hambourg, connais-tu Duala Manga Bell ?, du 14 avril 2021 au 7 avril 2024), conçue avec l'héritière de Duala Manga Bell, interroge l'héritage colonial et raciste de l'Allemagne et de Hambourg à travers cette figure de la lutte contre l'esclavage et pour l'égalité humaine.
- « Das Land spricht. Sámi Horizonte » (Le pays parle. Horizons sámi, du 8 septembre 2023 au 31 mars 2024) met en résonance les collections du musée avec des œuvres contemporaines d'artistes sámi, peuple victime d'ethnocide.
Pour aller plus loin :
- Sur le passage d'une anthropologie structurale vers une anthropologie de l'action : Bensa Alban, La fin de l’exotisme: essais d’anthropologie critique, Toulouse, France, Anacharsis, 2006, 366 p.
- Sur le rapport entre l'anthropologie et le contexte historique : Naepels Michel, « Anthropologie et histoire : de l’autre côté du miroir disciplinaire », Histoire, Sciences Sociales, 2010, 65e année, no 4, p. 873‑884.
- Sur le rapport entre l'individu et l'objet : Bonnot Thierry, L’attachement aux choses, Paris, France, CNRS éditions, 2014, 239 p.
#Allemagne ; #anthropologie ; #postcolonialisme
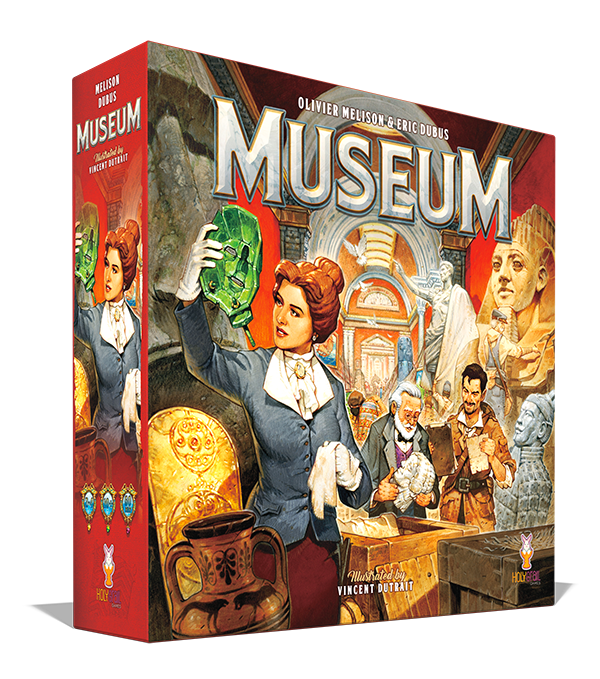
Le musée a enfin son jeu de société
Si vous rêvez de devenir conservateur d’un musée mais que vous n’arrivez pas à obtenir le concours, cet article peut résoudre votre problème… au moins virtuellement.
Il est vrai que les musées n’ont jamais été au centre d’une licence ludique ou vidéoludique. Alors que d’autres structures culturelles et/ou de loisirs ont été traités par des développeurs et ont connu le succès : notamment les parcs d’attractions avec les jeux de gestion de la licence vidéoludique Roller Coaster Tycoon ou encore les zoos avec le jeu vidéo Zoo Tycoon.
Aura-t-il fallu attendre 2018 pour que le musée connaisse son jeu culte ? Museum, créé par Olivier Melison et Eric Dubus et illustré par Vincent Dutrait, détient toutes les cartes en main pour le devenir ! Ce jeu nous invite à deux, trois ou quatre joueurs, à endosser le rôle d’un conservateur et à explorer les quatre continents pour trouver des artefacts et les exposer dans nos galeries. Mais notre quête sera parsemée d’obstacles grâce à différents mécanismes de jeu.
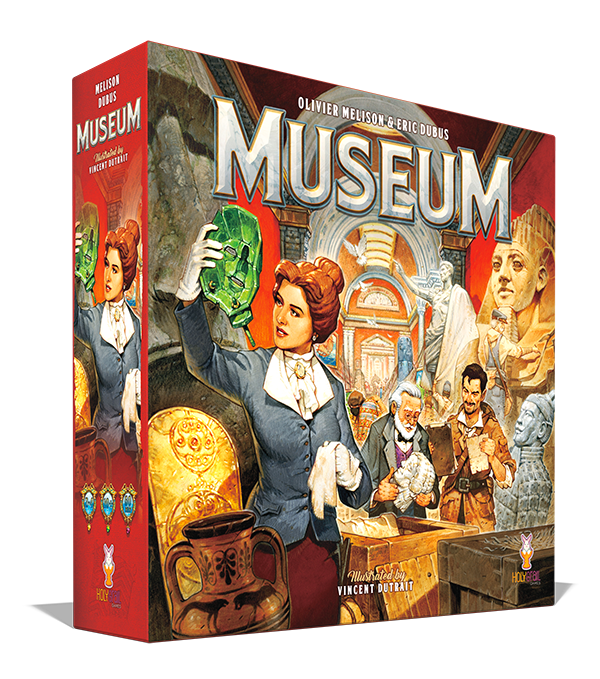
La boîte du jeu de base Museum
Revivre « l’âge d’or » des musées
Les créateurs ne sont pas d’anciens ou d’actuels professionnel des musées. L’un travaille dans la publication internationale et l’autre est professeur d’histoire. Ils ont apporté un contenu historique véridique. Les cartes « artefacts » regroupent des objets qui ont effectivement été trouvés lors d’expéditions européennes. Parmi elles, des jarres en céramiques japonaises, des artefacts de Stonehenge ou encore des sculptures préhistoriques des Cyclades. Quatre continents, douze civilisations et six domaines archéologiques sont représentés. De plus, les concepteurs font un peu de médiation en ajoutant au bas de chaque carte artefact un petit cartel explicatif. Les conservateurs virtuels peuvent de ce fait savoir précisément ce qu’ils exposent dans leur musée !

Exemple d’un carte artefact
Les concepteurs nous présentent Museum comme un jeu se déroulant durant « l’âge d’or » des musées. Cette périphrase indique la période s’étalant de la fin du XIXe siècle aux premières décennies du XXe. Cette période a vu gonfler le nombre d’objets au sein des collections des grands musées occidentaux comme le Louvre ou le British Museum pour ne citer que les plus emblématiques. Parmi les œuvres collectées à cette période figurent des artefacts de grande valeur culturelle qui sont ancrées dans nos représentations collectives et notre imaginaire. Le jeu montre à nouveau à quel point cette époque révolue a cristallisé une certaine relation au musée ainsi que des représentations. On remarque également que le musée est tout d’abord associé à ses collections.
Nous avons une relation ambigüe avec cette période car nous pouvons éprouver une certaine nostalgie envers elle. En effet, à cette époque, la planète et les anciennes civilisations étaient encore des sources de mystère. La stupéfaction et le vertige des années nous séparant de celles-ci se manifestaient à chaque grande découverte archéologique. On prête aussi aux archéologues de cette époque une fibre d’explorateurs et d’aventuriers hors pair. Indiana Jones est aussi venu participer à cette tendance. Ce frisson de la découverte de l’inconnu est bel et bien un des facteurs d’appétence pour ce jeu qui retransmet au joueur cette sensation. Cet appétit de la découverte mêlé à l’envie de mystère explique peut-être le choix des concepteurs de développer l’extension « Les Reliques de Cthulhu » qui intègrent l’univers fictif de H.P. Lovecraft ainsi que ses artefacts maudits au sein de vos collections qui faisaient jusqu’ici référence à des objets réels.
Cependant, cet âge d’or est aussi la période de toutes les expéditions des grandes puissances occidentales à l’origine des pillages des trésors des colonies et des pays pauvres où les expéditions avaient lieu. Ce sont ces pillages qui suscitent tous les débats autour des restitutions des collections dans le milieu muséal et culturel dans son ensemble. Nous sommes loin de tous ces questionnements dans Museum, même si les concepteurs n’ont pas été totalement naïfs. Le jeu propose en effet des cartes « Opinion Publique ». Elles signifient que la presse commence à remarquer que certains continents sont pillés, et que trop peu d'objets sont exposés par les musées. Ces cartes peuvent donner un malus conséquent aux joueurs conservateurs qui collectent des artefacts mais ne les exposent pas ! Autre indicateur de la conscience des concepteurs : l’extension « Marché Noir » du jeu. Cette extension encourage la fourberie et l’immoralité dans leur fonction temporaire de conservateur de musée. En effet, ces derniers peuvent tout simplement acquérir des artefacts sur le marché noir ! Ce genre de pratiques a pu être constatées lors de cet « âge d’or » des musées. Cependant, cette pratique peut s’avérer préjudiciable au joueur s’il ne joue pas habilement.
Pourquoi Museum s’ancre-t-il dans cet « âge d’or ». Et pourquoi cette période détient-elle une appellation aussi positive ? Nous pouvons peut-être interpréter cette représentation comme une idéalisation des créateurs et des joueurs pour cette période. Cette appellation traduit en réalité l’envie de découverte et le mystère qui entouraient les expéditions de cette époque plutôt que l’aspect purement historique. Ce regard a posteriori se ressent également dans la représentation archéologique conservateurs de musée.

Le plateau du jeu de base Museum
Dans la peau d’un conservateur ?
Tout au long de sa partie, le joueur est conduit à différentes actions différentes actions que le conservateur est censé mener. Parmi elles, placer les collections dans son musée. En d’autres termes qui ne sont pas explicites dans la règle du jeu ; faire de la muséographie. Attention, ici la réflexion et la conceptualisation ne va pas bien loin. Il s’agit avant tout de remplir toutes les salles du musée. Si aucun « trou » n’est laissé, un bonus conséquent est octroyé au joueur. Il s’agit également d’exposer les œuvres par civilisation ou par domaine dans les galeries de son musée pour gagner encore plus de points.
Dans Museum, on ne parle pas des réserves. Un lieu pourtant habituellement au centre des curiosités et des idéalisations du musée ! Cependant, le jeu parle vaguement d’un lieu où l’on peut entreposer ses artefacts non exposés : en termes purement ludiques, il s’agit de la défausse des cartes. On rappelle que le joueur se défausse d’artefacts valant un certain nombre de points pour en exposer d’autres. Mais ces cartes défaussées peuvent être récupérées par les autres joueurs.
Lors de son tour, le joueur peut également décider de faire un inventaire. C’est-à-dire qu’il vide sa défausse. Cette action permet au joueur de protéger des artefacts de « vols » des autres joueurs et de gagner des points supplémentaires à dépenser au tour suivant. On peut sourire en constatant la fragilité du statut des artefacts dans ces musées de papiers. L’inaliénabilité des collections est un concept bien absent de cet univers ludique. On ne leur en voudra pas de prendre des libertés afin de rendre le jeu un peu plus dynamique et amusant…
Enfin, les cartes « faveurs » font parfois référence à d’autres actions au sein d’un musée. Par exemple, il est possible d’organiser une conférence de presse au musée afin de gagner des « points de prestige » ou bien de recruter un expert pour valoriser ses collections. Ne sont donc représentées que des fonctions admirables dans ce musée virtuel…
Parmi les actions diverses et variées que le joueur dans la peau d’un conservateur peut mener, nous pouvons remarquer que le conservateur virtuel proposé par Museum rassemble dans sa seule entité plusieurs fonctions professionnelles au musée. Le joueur conservateur est à la fois muséographe, directeur de la communication et régisseur. Il n’est pas fait mention d’aucune autre fonction au musée à part les « experts » Ces derniers sont définis comme des spécialistes d’un domaine ou d’une civilisation qui « mettra en valeur les collections.» On se demande bien comment ils le font. Le plus important est qu’ils vous rapportent des points supplémentaires à la fin de la partie ! Pour en revenir au conservateur, on peut admettre également que l’image que l’on a souvent de lui, seul (ou presque) dans son musée, prend racine dans la réalité de l’époque. En effet, les conservateurs étaient souvent les seuls maîtres à bord au musée. Le jeu nous prouve une fois de plus que la représentation du conservateur du musée est, elle aussi, la source de beaucoup d’idées reçues.
Museum est sans grande surprise un jeu qui donne une image fantasmée et naïve du musée. Il met en scène un « âge d’or » qui met en valeur les conservateurs collectionneurs et les archéologues aventuriers. Un monde muséal virtuel où l’inaliénabilité des œuvres est un concept absent et où le marché noir est un lieu incertain mais excitant pour le joueur. Le système de jeu de Museum et de ses cinq extensions le rendent à la fois accessible à une clientèle familiale et attirant pour les joueurs chevronnés. Les concepteurs recommandent le jeu aux plus de 10 ans. Vous pouvez vous procurer le jeu de base pour 45 € et 18€ pour chaque extension (seule quatre sont vendues parmi les six existantes. En effet, les deux dernières sont des exclusivités Kickstarter réservées aux personnes ayant soutenu ce projet sur la plateforme de financement participatif) Pour vous le procurer, privilégiez le vendeur de jeux de société plutôt que les boutiques des musées où vous ne le trouverez pas, a priori. Cependant, malgré les libertés prises avec la réalité ainsi que le manque d’apports scientifiques étayés (malgré quelques efforts honorables mentionnés précédemment) peut-être que certaines boutiques le proposeront. Qui sait ? L’avenir nous dira aussi si Museum deviendra le jeu de société de référence se déroulant dans des musées. En tous cas, il possède tous les ingrédients pour le devenir !
Amaury Vanet
#jeu
#représentations
#réflexion
Pour plus d’informations sur le jeu rendez-vous sur : https://holygrail.games/museum-page-ks-francais/
Source des images : Holy Grail Games (https://holygrail.games/museum-page-ks-francais/)
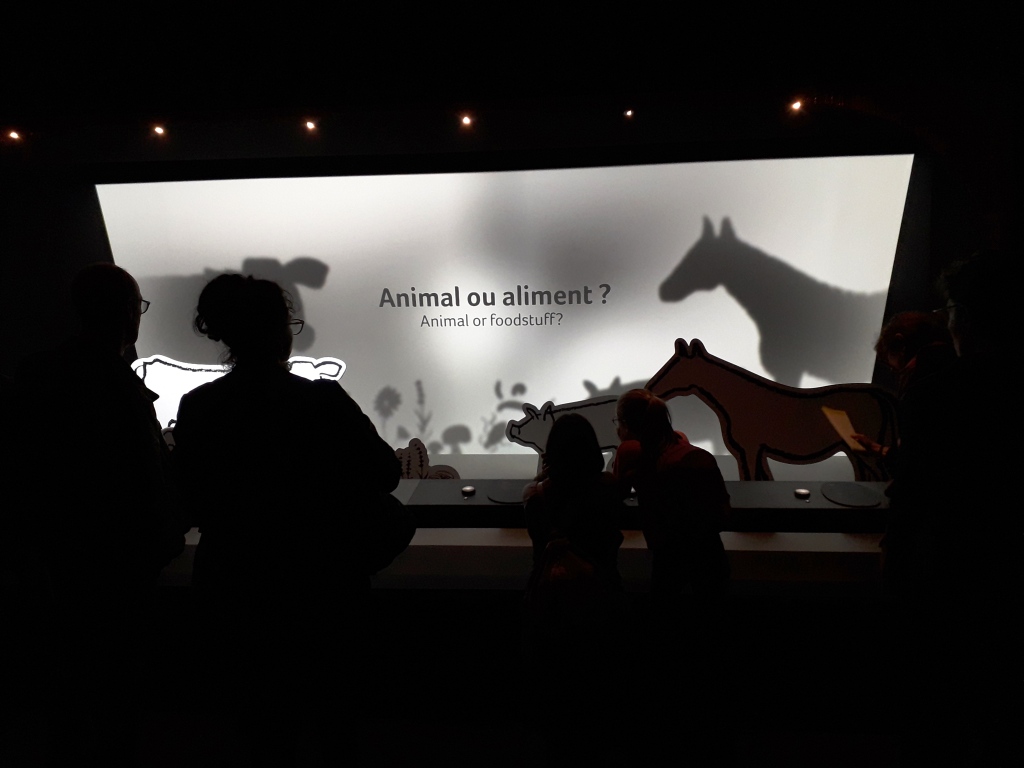
Le musée de l’Homme explore l’alimentation
L’odeur alléchante des viennoiseries et du café qui nous accueille à l’entrée de l’exposition, située à quelques pas de la cafétéria du musée, donne le ton. Une belle entrée en matière qui met en appétit. Visuellement attractive grâce à des graphismes enfantins, l’exposition Je mange donc je suis s’attaque à une question cruciale autour des pratiques alimentaires.
Un contenu aussi riche que notre alimentation
Des boîtes de céréales et des conserves de corned-beef côtoient des crânes de plusieurs milliers d’années. L’exposition nous révèle tout d’abord l’origine de nos aliments, à travers les âges, en nous plongeant dans un univers tantôt décalé et humoristique, tantôt poétique et engagé.

Les boîtes de céréales et de corned-beef présentées dans la première partie de l'exposition © Camille Fromager
D’autres sujets plus délicats sont également abordés incitant à s’interroger sur ses propres pratiques : comme la place de l’animal dans l’alimentation, le poids des injonctions sociales dans nos choix alimentaires ou les enjeux écologiques liés à la production de notre nourriture. La mise en parallèle du gavage des femmes au Niger et de la maigreur des mannequins illustre une partie du propos, posant la question de l’existence d’une nourriture genrée. La sensualité de certains aliments et leurs effets sur la sexualité sont également présentés sans tabou, huitres, chocolat ou gingembre en illustration.
Puis l’exposition explore, dans un second temps, nos habitudes alimentaires à travers le patrimoine culinaire et la culturalité de l’alimentation. Des vidéos montrent à cet effet les différentes coutumes relatives à la prise du repas dans le monde. Parallèlement, des objets ethnographiques contextualisés sont présentés, comme les baguettes et les bols utilisés en Asie ou le bureau et l’ordinateur aux Etats-Unis.

La reconstitution d'un bureau aux Etats-Unis, à l'heure du repas © ML
Le parcours est parsemé d’œuvres d’artistes modernes et contemporains qui se sont emparés du sujet de l’alimentation. Il est possible de contempler La Cène de Léonard de Vinci revisitée par différents créateurs, que l’original d’une nature morte de Pablo Picasso, Verre, citron et pichet. L’installation propose ainsi, sous l’angle de l’histoire de l’art, un autre éclairage : celui de la nourriture comme un art visuel.
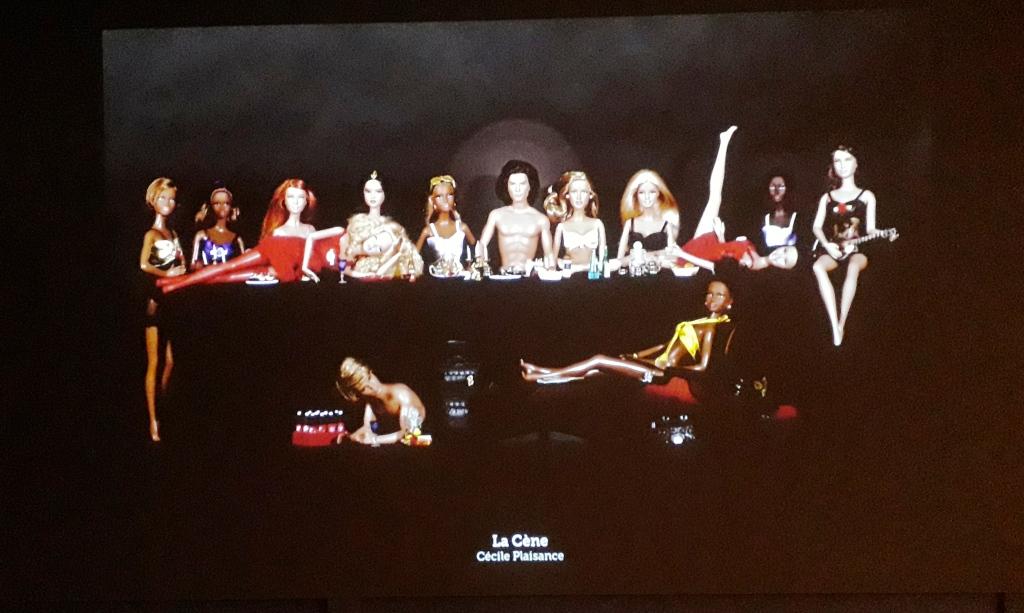 Une représentation de la Cène par Cécile Plaisance © ML
Une représentation de la Cène par Cécile Plaisance © ML
Des clins d’œil à la Pop Culture sont adressés au public tout au long de ce parcours qui inclut la diffusion d’extraits d’émissions populaires comme Master Chef ou Top Chef, du film L’aile ou la cuisse de Claude Zidi et de compositions musicales de Philippe Katerine, dont la chanson « Poulet n°728120 » qui évoque la problématique de l’élevage intensif.
Un extrait de L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, présenté sur écran © Camille Fromager
La visite se termine par un troisième espace de réflexion sur les enjeux écologiques liés à la production des ressources pour nourrir l’humanité aujourd’hui et demain. Y sont présentées les différentes techniques d’agriculture, qu’elles soient intensives, horticoles, ou arboricoles. L’artificialisation de la nature est dénoncée au travers du discours de l’exposition. De façon engagée, le musée prend part au débat global sur l’alimentation et ses modes de production.
Je mange donc je suis est donc une grande exposition, qui aborde un large éventail de sujets liés à l’alimentation et dont le discours est constamment renforcé par les objets et les représentations qui sont proposés dans les différentes salles.
Une scénographie à la sauce aigre-douce
Divisée en trois grands espaces, l’exposition repose sur des choix scénographiques qui interpellent, donnant l’impression que trois scénographes différents ont travaillé sur le projet, et créé un effet de rupture.
Le premier espace dédié aux origines de l’alimentation plonge le public dans une ambiance sombre, où les teintes rouges et noires prédominent, avec de longues chainettes rouges qui séparent les modules les uns des autres. Il semble que ce soit une entrée dans l’organisme vivant d’un être humain.
Entre le premier et le second espace, qui porte sur la dimension sacrée de l’aliment, une transition s’opère par l’intermédiaire d’une vitrine noire éclairant par intermittence des objets de culte appartenant à diverses cultures.
Ce deuxième ensemble se détache ensuite totalement du premier avec une ambiance plus éclairée, combinant objets ethnologiques, multimédia, objets d’art, art moderne et contemporain, dans des mises en scène de prise de repas à travers les différents continents et la présentation des arts de la table et leur diversité culturelle.

Reconstitution d'une prise de repas en Asie, accompagné d'une vidéo montrant la gestuelle © ML
Le dernier espace de l’exposition, consacré à l’impact environnemental de notre alimentation, se différencie encore des deux autres par des volumes plus stylisés et des couleurs beaucoup plus claires. Le graphisme y est impactant, particulièrement dans la dernière salle où de grandes toiles blanches s’élèvent en forme d’arbres dont la couronne s’étend au-dessus de chaque module et sur lesquels des dessins d’animaux tracés en noir s’enchevêtrent sans se mêler, rappelant le feuillage.

Dernière partie de l'exposition portant sur les risques liés à la production agro-alimentaire sur l'environnement et la santé © ML
Les choix scénographiques ont su mettre en valeur chaque espace en relation avec les thèmes qui y sont traités. Quant aux variations de mobilier, d’éclairage et de couleurs entre chacun des trois grands espaces qui conforment l’exposition, celles-ci semblent correspondre à une volonté de bouleverser la scénographie pour faire évoluer le visiteur dans le temps, de l’obscurité vers la lumière, pour aboutir à la fin du parcours à cette remise en question de ses pratiques et à s’interroger sur l’avenir. Trois ambiances différentes qui contribuent à créer des ruptures dans le discours pour modifier notre perception tout au long du parcours, puisque tout changement, tout apprentissage requiert en définitive une rupture.
Des médiations au goût du jour
Par ailleurs, l’exposition propose un large panel de médiation allant de l’espace d’écoute relaxant au multimédia ludique. Dès la première salle, un module propose d’écouter, confortablement assis dans des canapés rouges, l’épisode de la madeleine de Marcel Proust, narrée par une voix off, offrant un intermède poétique reposant avant d’aborder la suite.
Alcôve dans la première partie de l'exposition diffusant l'épisode de la "Madeleine" de Marcel Proust © ML
Un autre dispositif à retenir est sans doute l’écran interactif situé avant l’espace de transition qui conduit à la deuxième partie de l’exposition. Les questions complexes liées à notre alimentation, matières de controverse, y sont traitées. C’est le cas de la condition animale, les interdits alimentaires et la consommation d’insectes comme une nouvelle alternative, en s’appuyant sur des contenus vidéo, audio et photographique.
Dans le dernier espace, chaque module propose des contenus audio et vidéo supplémentaires, ainsi que des témoignages et des interviews.

Présentation de l'un des éléments scénographiques du décor de la dernière partie de l'exposition © Camille Fromager
D’une manière générale, l’exposition explore avec humour et inventivité l’humain à travers ses pratiques de consommation alimentaires actuelles et leur impact environnemental, pour mieux comprendre au bout du compte ce qui est en jeu : notre avenir. Les choix scénographiques surprenants, intrigants, parfois dérangeants, maintiennent l’illusion du changement en rendant tout à la fois l’immersion possible. Un seul regret pour les gourmands attirés par le thème de la nourriture, où est passé le côté sensoriel ? Le goût n’aura pas été mis à l’honneur cette fois-ci.
Margaux Louët
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970
#alimentation
#ethnographie
#exposition
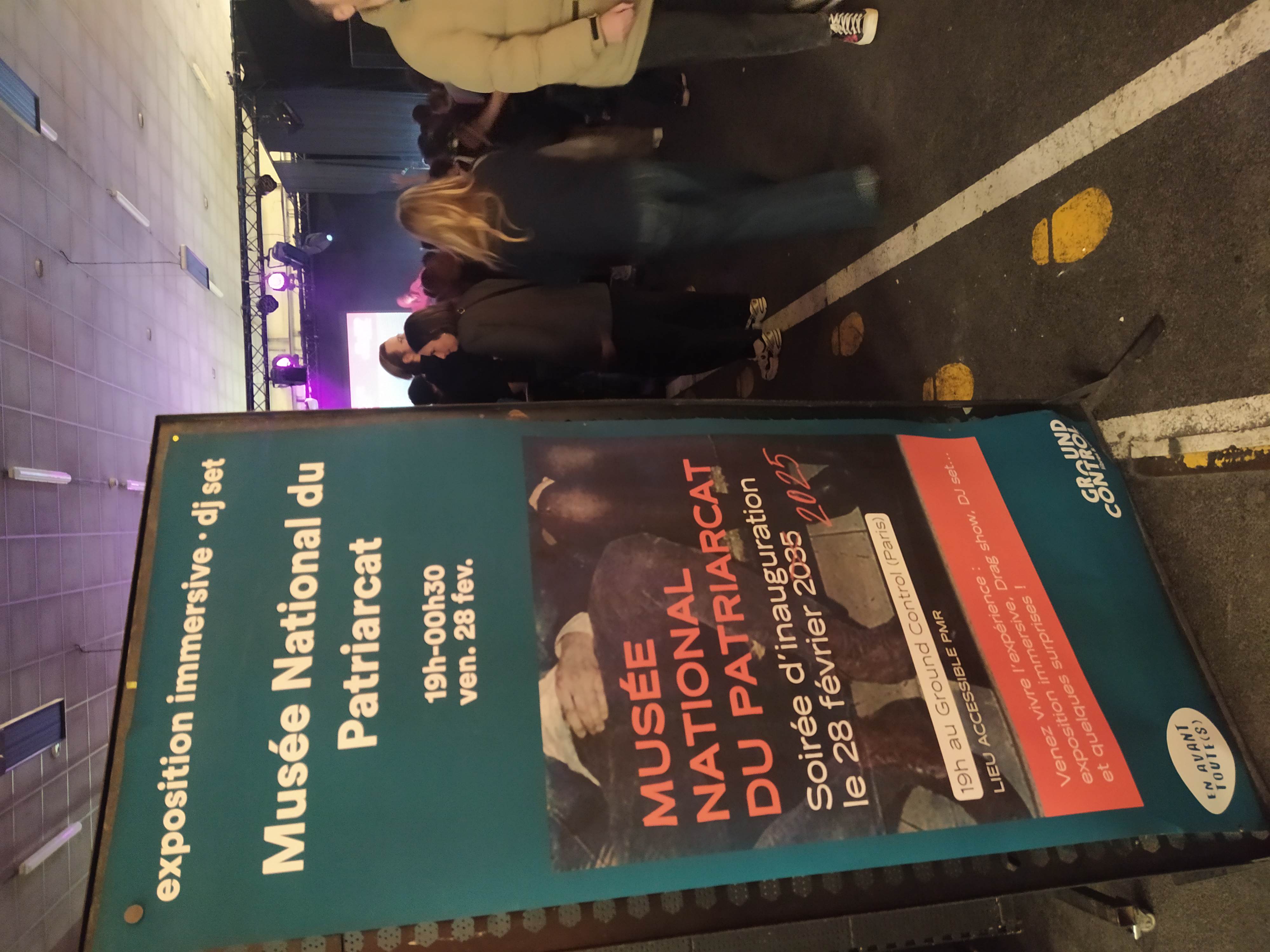
Le musée national du patriarcat
Et si le patriarcat appartenait à une époque si lointaine qu’il serait exposé dans un musée ?
© T. Schriver
“*Imaginez, nous sommes en 2035 et le patriarcat est mort. Fermez les yeux 5 minutes et imaginez un monde où les violences sexistes et sexuelles n’existent plus, où l’injustice et les inégalités liées au patriarcat sont enfin reléguées au passé*.” Ce monde si lointain devrait avoir un musée. C’est ainsi que le Musée National du Patriarcat a ouvert, le temps d’une soirée au Ground Control à Paris, le 28 février 2025.
L’association “En avant toute(s)” a consacré investi un espace de 176m2, pouvant accueillir 270 personnes debout. Sur les murs, les visiteurs et visiteuses découvrent de nombreuses affiches qui ont permis de faire la promotion de l’ouverture du musée “Venez découvrir un monde où la contraception était exclusivement féminine”, “Il y a un temps où la place des femmes dans la société se comptait en centimètre”.
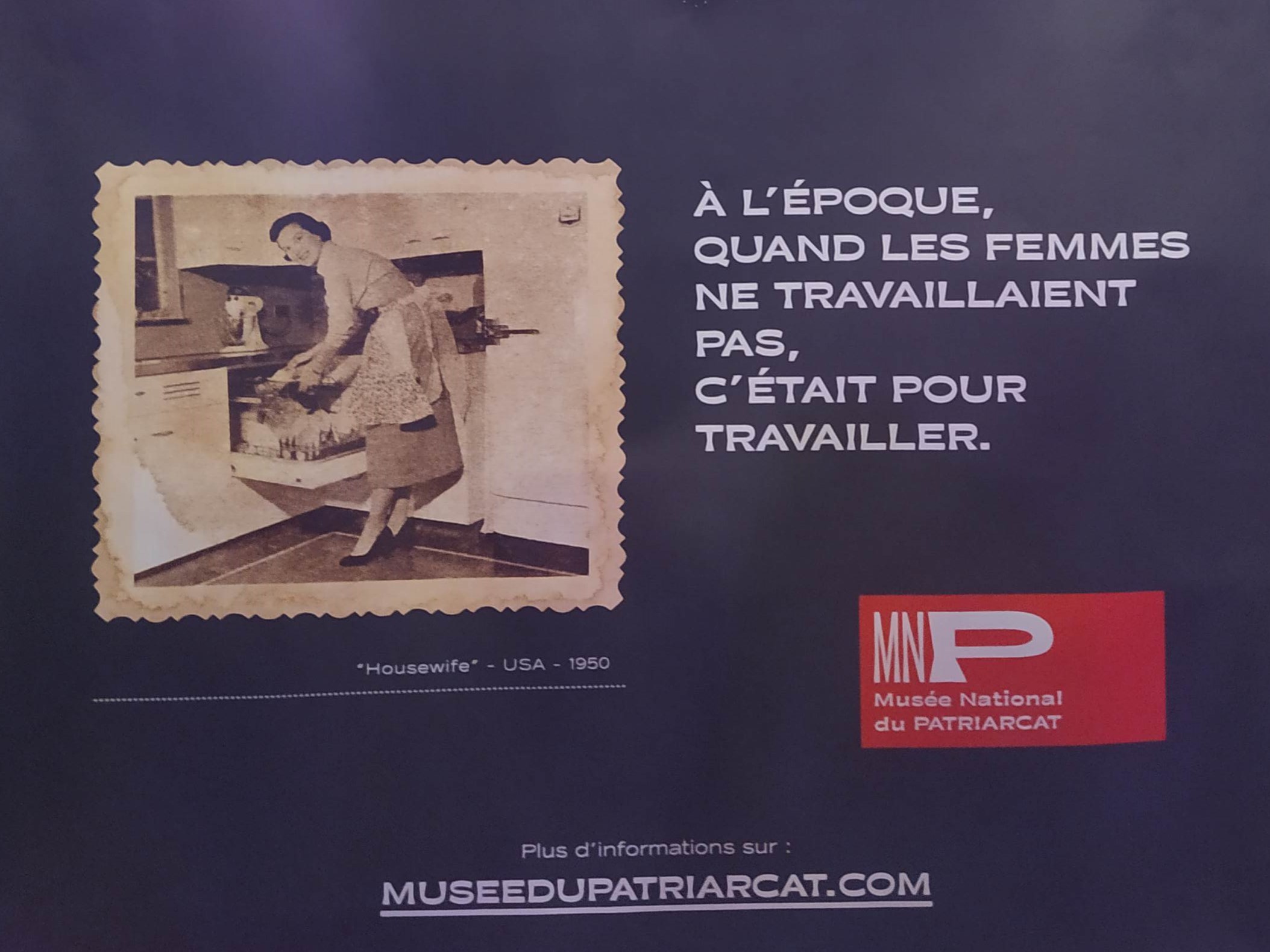
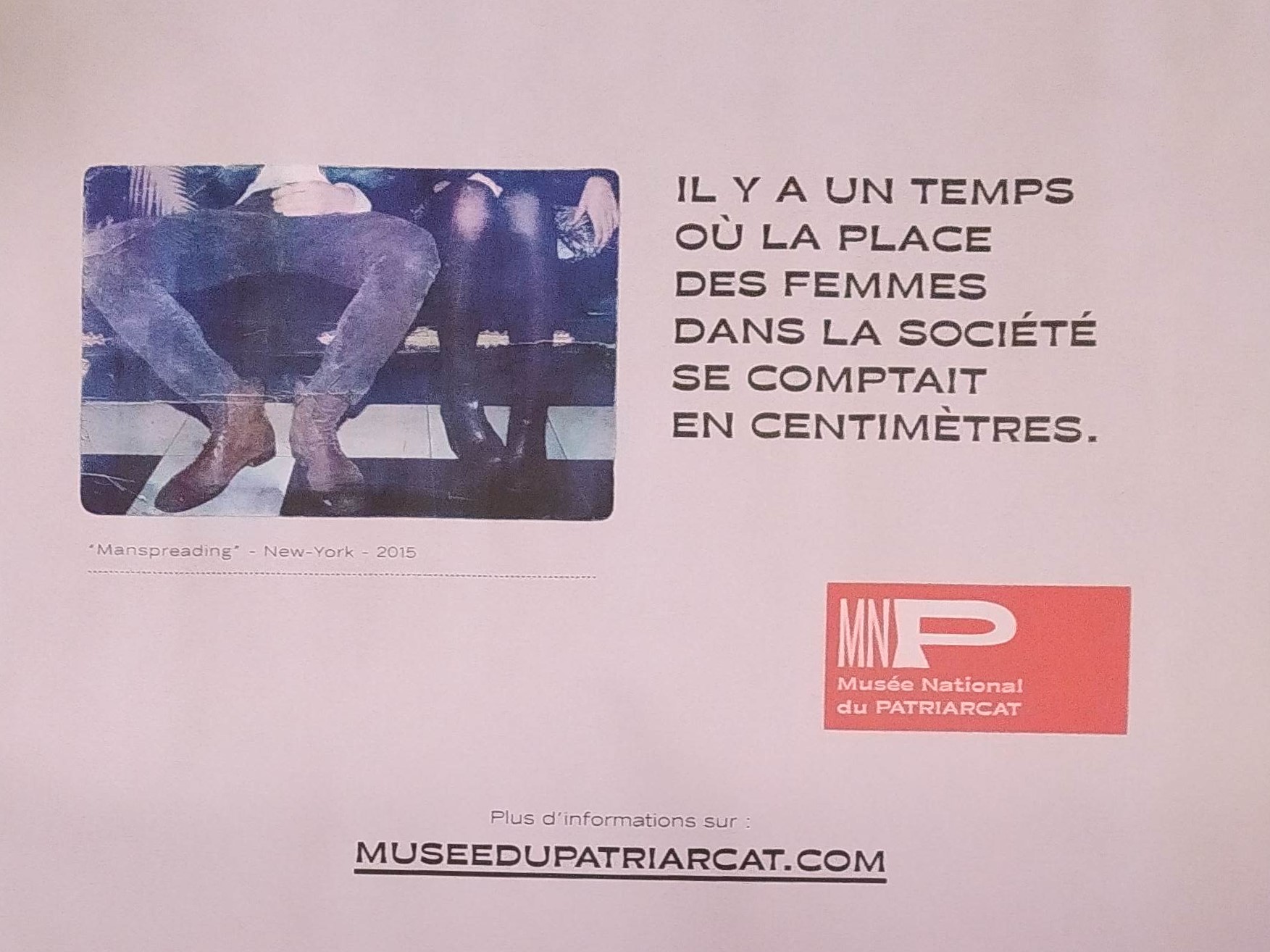
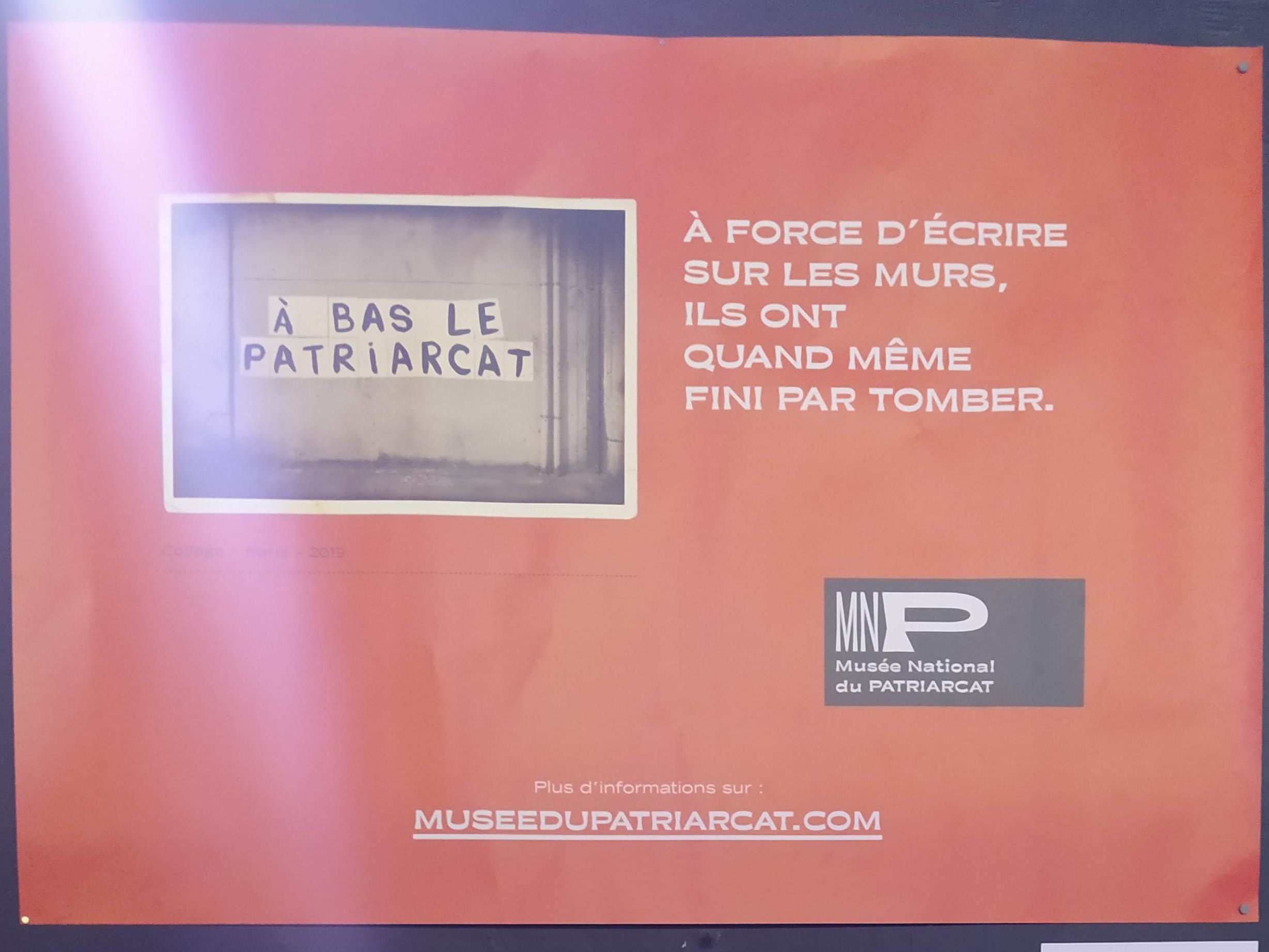
© T. Schriver
Parmi les “archives” exposées :
● des pancartes de manifestations,
● le violentomètre, outil de détection développé fin 2018 notamment par En avant toute(s) suite à une commande de l’état français,
● des jouets genrés (bébé rose, ordinateur bleu)
● des captures d’écrans où seul “Madame” ou “Monsieur” peuvent être cochés
● des rasoirs bleus et roses pour aborder la taxe rose etc.
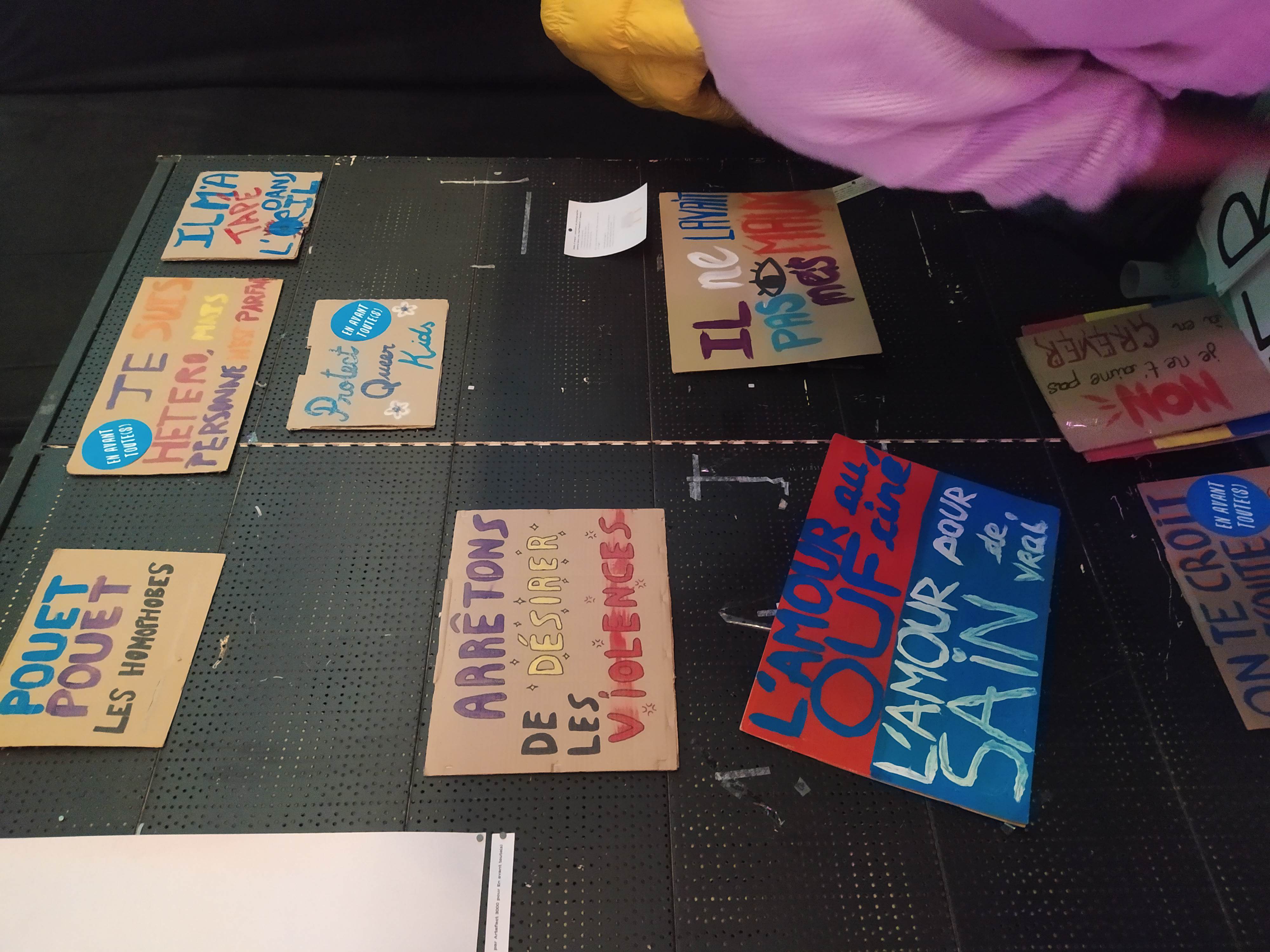
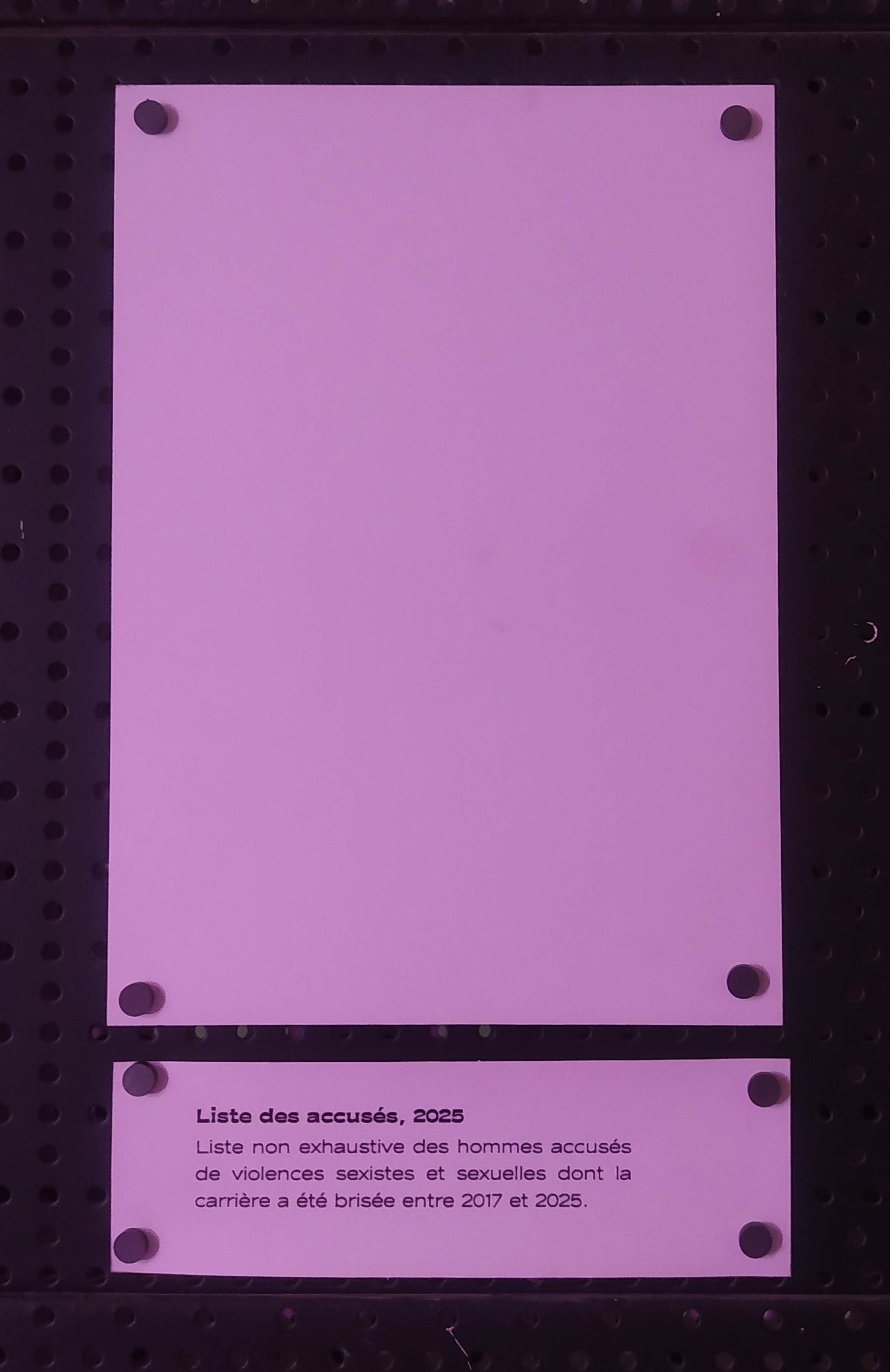
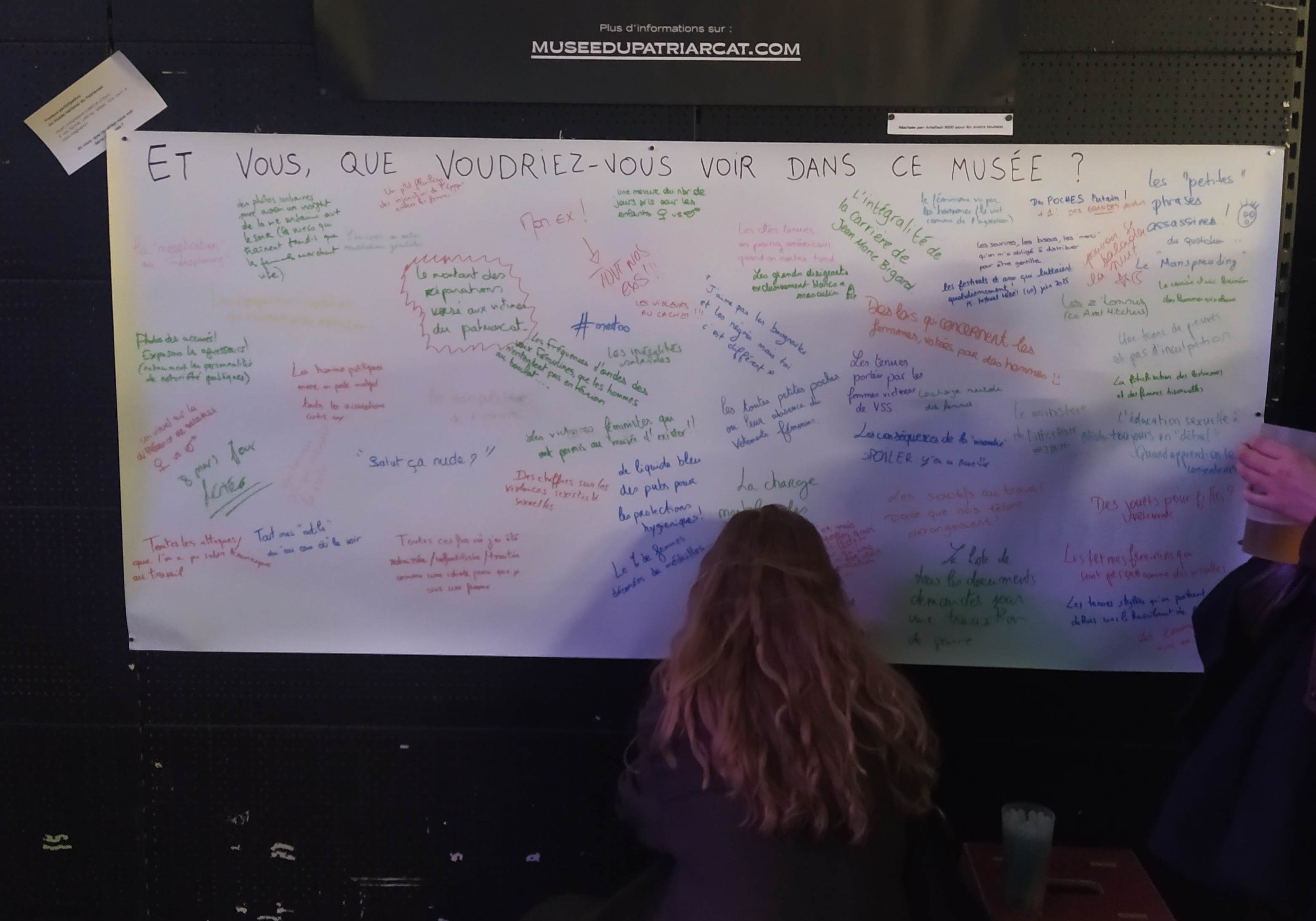
© T. Schriver
Ne manquant pas d’ironie pour pimenter le parcours, un vase rempli d’eau représente les “larmes ouin ouin des hommes” et une feuille blanche liste les “hommes accusés de violences sexistes et sexuelles dont la carrière a été brisée entre 2017 et 2025”.
L’association n’a pas travaillé avec des professionnels du monde muséal, néanmoins, elle a eu le réflexe de varier les moyens de médiations : une vidéo interactive sur le harcèlement de rue, et, à la fin du parcours, un mur sur lequel les participant.es répondent à “Et vous, que voulez-vous voir dans ce musée ?”.
Cette exposition éphémère, accessible après avoir fait un don à l’association, a aussi été le lieu de divers événements au cours de la soirée : discours des fondatrices de l’association, DJ sets, stand up et drag show.
Succès
L’événement relayé sur différentes plateformes (site web, instagram, journaux, magazines), a fait l’objet d’affichages publics avec MediaTransports. Et la collaboration entre l’association et l’agence de pub Artefact 3000 a été lauréate du Concours Futurs Désirables, organisée par le Club des Directeurs Artistiques.
De nombreux badauds, attirés par le mystère de cette salle feutrée de rideaux et de ses événements, ont bien tenté de se faufiler. C’était sans compter l’équipe de bénévoles qui leur demandait leurs bracelets ou bien expliquait le projet et le don de 10€ afin de rentrer. Une majeure partie était intriguée, intéressée par le projet et a fait ce don. Entre questions et réponses, la plupart d’entre eux terminaient par “Vous avez de l’espoir !”. Néanmoins, le succès fut tel que les rideaux qui marquaient la taille de la pièce, s’ouvraient de plus en plus, et que leurs ourlets ne touchaient plus le sol. Il était temps d’ouvrir l’exposition à toute.s.
Suite à ce succès temporaire, il est important de noter :
● que le sujet du patriarcat et de sa place dans un passé révolu intéresse l’opinion publique, les médias, les publicitaires
● que l’imaginaire du musée peut être saisi par tous et l’est saisi notamment par les associations à des fins de sensibilisation et d’opérations coup de poing (cf. les militants écologistes et leurs jets de soupe ou peinture)
● que le musée à l’image de lieu poussiéreux, bon à exposer des archives, lorsqu’il est repris par des sphères amatrices, est un lieu vivant, d’échanges, d’humour !
Tiphaine Schriver
#patriarcat #association #éphémère #féminisme
Pour en savoir plus sur “En avant toute(s)” :
“En avant toute(s) a été créée en 2013 par Ynaée Benaben et Thomas Humbert, très vite rejoint par Louise Delavier et Céleste Danos. Une vaste étude de terrain a permis de montrer que les structures destinées aux femmes victimes de violences étaient trop peu nombreuses ou surchargées et de constater la prévalence des violences chez les plus jeunes femmes.
Nous avons alors décidé d’œuvrer dans notre environnement proche en nous adressant aux personnes de notre âge en cherchant des modes de communication plus adaptés aux usages actuels et à l’imaginaire de notre génération.
Depuis 10 ans, nous développons notre expertise et menons toutes nos actions dans l’optique de : promouvoir l’égalité des genres, prévenir les violences de genre, s’adresser aux jeunes.”
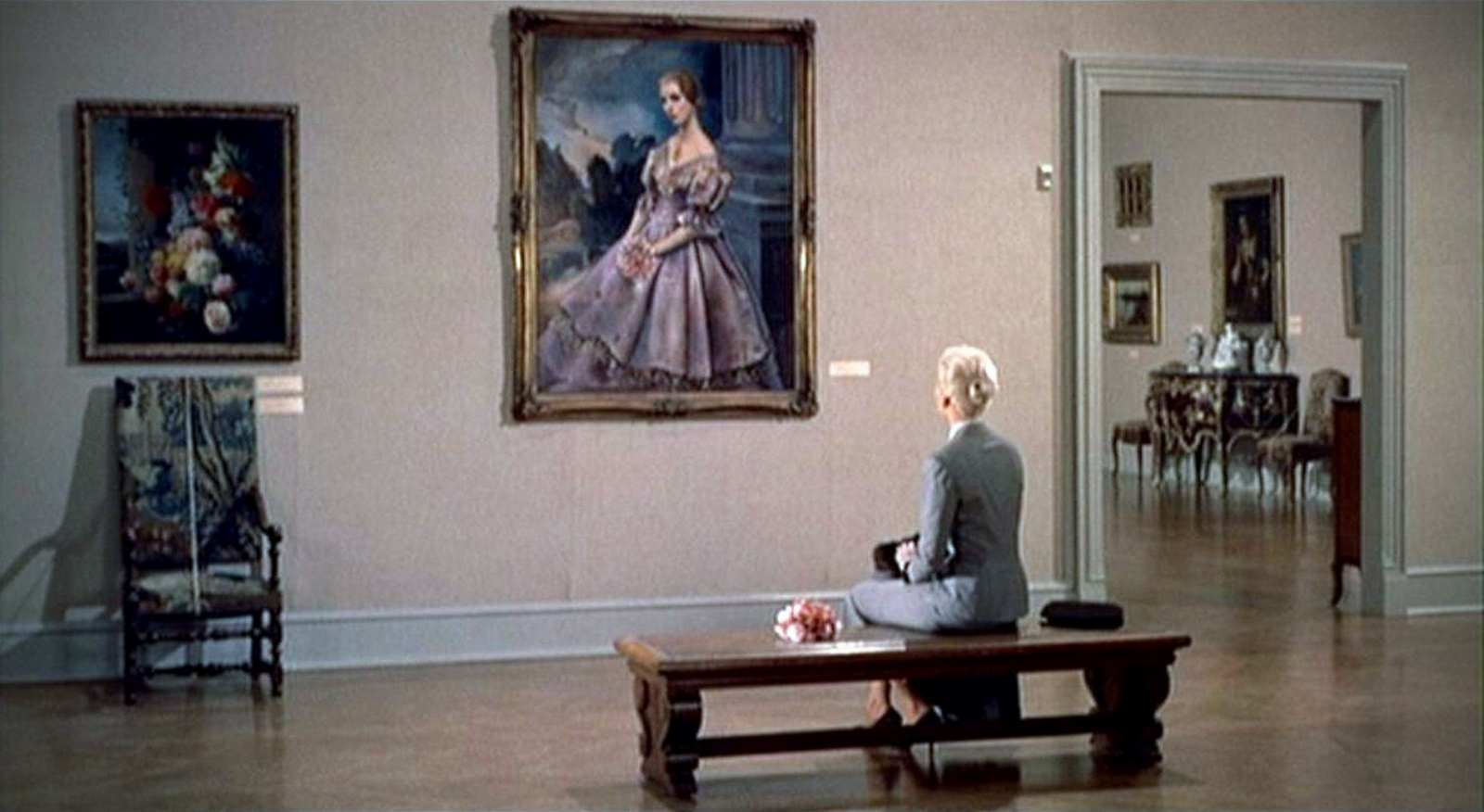
Le musée, muse du cinéma
Alors que le musée propose aujourd’hui de plus en plus de documents filmiques, intégrant le 7èmeart à ses chefs d’œuvre[1], [2], on peut à l’inverse s’interroger sur la place que prend celui-ci au grand écran. Les représentations que nous avons du musée peuvent en dire beaucoup sur l’imaginaire collectif, les préjugés ou plus positivement les projections dans ce lieu emprunt de poésie, de fantasmes, d’exotisme. Comment le musée est-il mis en œuvre par le cinéma ? Comment un espace de contemplation devient-il une scène "d'action" cinématographique ? Cette sélectionne ne se veut pas exhaustive, mais propose quelques grands angles de regard.
Photogramme du film "L'affaire Thomas Crown" 1999,©UnitedArtists
Le musée, espace de tous les possibles
La place du musée dans le cinéma réside avant tout dans son attachement aux « trésors », à l'objet précieux, érigé au domaine du sacré. Ce lieu si prestigieux, si stable, parfaitement surveillé, contrôlé, suscite un désir de transgression. L'idée de profanation d'un lieu sacré se retrouve aussi bien dans les scénarios de vols d’œuvres d'art que de meurtres au musée.
Pour cette raison le musée constitue l'objet de toutes les convoitises, et l'action s'attachera donc aux moyens mis en place afin de dérober l'œuvre d'art. On comprend donc la quantité impressionnante de long-métrages à suspensposant leur caméra au musée. Toute l’intrigue du film réside alors dans le très long processus de pénétration du musée, et dans l'organisation tout entière, du vol . Les plans qui sont fait du bâtiment mettent en exergue l'aspect prestigieux, colossal de l'architecture, et surtout son caractère institutionnel et inviolable. Cette idée résonne dans « L'affaire Thomas Crown »,film où l'art sort véritablement du tableau à travers des dizaines de figurants arborant le chapeau melon du tableau de Magritte, sauvant ainsi le protagoniste – auteur du vol- de ses assaillants.
(Metropolitan Museum of Art, New York)
Summum du vandalisme ? Agir au musée, et verser sans remords des litres de peinture rouge sur les tableaux les plus prisés du moment. Cet exercice de style, réalisé par Tim Burton, dans « Batman » (1989), montre le terrible Joker invitant cordialement ses acolytes à dégrader les œuvres du musée de Gotham City – et ne s'arrête que lorsqu'il s'agit de Francis Bacon (« J'aime assez celui-là »).
(Musée de Gotham City – fictif)
Dans un registre plus onirique, le musée inspire aussi les cinéastes y trouvant parmi ses collections des objets d’évasion. Le musée demeure ancré dans un imaginaire fantastique, nous permettant, par les objets qu’il contient, de rêver, de voyager, de se projeter dans un autre temps … Ce rapport au musée s'applique d'avantage aux musées d’ethnologie ou d’histoire naturelle : le très connu « La Nuit au Musée » (Shawn Levy, 2006), avec ses 2 millions d'entrées, en est la preuve ! Les statues, dinosaures, animaux naturalisés, etc. viennent alors prendre vie et troublent le bon fonctionnement du musée. Cette liberté d'appropriation du musée se retrouve avec « L'Arche Russe » (Alexandr Sokurov, 2003), dans lequel le spectateur se voit offrir un voyage dans le passé par le biais des 33 pièces du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Film tourné en une seule prise, l'action permet d'aborder au travers des collections 4000 ans d'une histoire russe haute en couleurs.
(Museum Américain d'Histoire Naturelle de New York) (Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg)
Le musée, espace de séduction
Woody Allen et Diane Keaton dans Manhattan, 1979, ©Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions
Par son architecture et le comportement qu'il suggère, le musée s'apparente également au miroir des passions humaines. Le visiteur, invité à déambuler parmi les nombreuses pièces et dédales du musée, peut voiret être vu au travers des colonnes, enfilades, statues... Cet espace clôt, hors du monde, semble propice aux errances amoureuses. Woody Allen exploite fréquemment cette dynamique : un grand nombre de ses longs-métrages pose sa caméra au musée . En portant un regard vif sur le milieu intellectuel new-yorkais, le réalisateur emmène les personnages entre flâneries amoureuses et réflexions existentielles. Au travers des réactions que suscite un tableau ou une œuvre, le personnage révèle aussi beaucoup de lui-même : indifférence, surprise, amusement... La rencontre au musée semble alors permettre à chacun de mieux comprendre l'autre, de mieux connaître ses aspirations, ses sensibilités. Pour le réalisateur, l’art est aussi un moyen de revendication et de libération des mœurs. Dans le plus récent « Whatever Works » (2009), une mère de famille très conservatrice se tourne subitement vers l’art contemporain et réalise des collages sexuellement explicites exposés dans une galerie new-yorkaise. Pour Woody Allen, c'est grâce à l'art que nous pouvons revendiquer notre identité politique et sexuelle.
(Musée d'Art Moderne, New York)
Cette représentation se retrouve en écho dans le cinéma plus brutal de Brian de Palma. L'exemple de « Pulsions » (1980) est assez parlant dans la mesure où le musée devient un véritable lieu de rencontres pour une femme malheureuse dans son couple. Voulant s'assurer qu'elle peut encore séduire, le réalisateur la montre alors arpentant pendant de longues minutes les dédales du musée, guettant l'attention et l’intérêt de la gente masculine. Un jeu de cache-cache se joue alors entre Kate Miller et un visiteur anonyme du musée, jeu dans lequel le musée n'est qu'un moyen métaphorique de représenter les rites de séduction.
(Musée des Beaux Arts de Philadelphie)
Le musée, espace d’introspection
Photogramme issu de Sueurs Froides (Vertigo),©ParamountPictures
Enfin, le musée semble incarner pour les cinéastes un lieu d'introspection, de refuge pour des personnages tourmentés, à la recherche de réponses à leurs questionnements. Pourquoi cette projection ?
Ce regard s'explique surtout par la place que le musée occupe dans son rôle de « gardien » de l'histoire et de la mémoire commune. Est-il donc étonnant, en perdant ses repères personnels et son identité, de se « re-trouver » au musée ?
Le meilleur exemple en est sans doute le film culte d'Alfred Hitchcock, « Sueurs froides », où l’héroïne de l'action, Madeleine, une jeune femme psychiquement instable, revient régulièrement au musée pour contempler durant de longues heures le portrait présumé de son arrière-grand-mère. Au delà de l'aspect narratif de ce plan, il apparaît que cette scène est la seule dans laquelle ce personnage semble apaisé, quittant temporairement un monde et une réalité qui la torturent.
(California Palace of the Legion of Honor, San Fransisco)
Desplechin illustre cette idée dans la scène qui clôt « Rois et Reine » (2003). Ismaël, le musicien, erre dans les salles des collections anthropologiques avec Elias, le fils de dix ans de son ancienne compagne. C'est dans cet environnement qu'Ismaël explique à l'enfant qu'il ne peut l'adopter, contrairement aux désirs de sa mère. Métaphoriquement, les collections pleines de passé représentent aussi la transmission de l'adulte à l'enfant, ce rapport à la filiation et les responsabilités qu'elles impliquent. Les plans très serrés sur les visages et les corps des deux personnages ne permettent pas au spectateur de saisir l'ambiance et les collections du musée, et occultent donc le lieu pour servir le propos. Ce cadre d'action participe aussi à l'atmosphère de calme et de sérénité dont la scène est baignée.
(Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, Paris)
Ce rapide tour d'horizon du cinéma met en avant la prépondérance des musées de beaux-arts, d'histoire naturelle ou d'ethnologie comme cadre narratif. Par ailleurs, le cinéma s'attache moins aux spécificités du musée dans lequel le film est tourné qu'à son aspect esthétique et symbolique : les émotions que provoque ce lieu intemporel deviennent alors universelles. En dehors de quelques grandes institutions mondialement connues (Le Louvre, Le British Museum, le musée Guggenheim,...), il est souvent impossible d'identifier le lieu du tournage, car le musée n'est qu'un décor mettant en avant le propos du film.
Le cinéma ne vise donc pas à retranscrire parfaitement le discours muséal, la particularité des collections, son aspect éducatif, mais véhicule avant tout une atmosphère, une « aura » . C'est un faire-valoir qui met en lumière le propos de l'œuvre cinématographique.
En continuité avec l'article, un film sorti en 2013 : « Museum Hours » de Jem Cohen. Celui-ci relate l’amitié se tissant progressivement entre un gardien de musée et une visiteuse. Le lieu devient alors prétexte à une réflexion sur la vie, sur le monde, et sur l'art, dans un espace si distant de l'agitation quotidienne.
Alléchés ? Voici une filmographie sélective, parmi laquelle certaines œuvres sont disponibles à la Bibliothèque Universitaire d'Artois ! La liste est longue, en dehors des films américains, russes et français. Amusez vous à chercher la scène de musée du prochain film que vous aurez la chance de voir !
Sueurs froides – Alfred Hitchcock, 1958 (USA)
Bande à part- Jean-LucGodard, 1964 (France)
Annie Hall – Woody Allen, 1977 (USA)
L'affaire Thomas Crown– Norman Jewison, 1968 (USA)
L'affaire Thomas Crown (remake)– John Mc Tiernan, 1999 (USA)
Pulsions – Brian dePalma, 1980 (USA)
Le syndrome de Stendhal– DarioArgento, 1996 (Italie)
L'arche russe - Alexander Sokourov, 2003(Russie)
Rois & Reine – Arnaud Desplechin, 2004(France)
Whatever Works– Woody Allen, 2009 (USA)
Pauline Wittmann
#cinéma
#image du musée
#représentation
[1] « L’image animée est si attractive qu’elle contamine le parcours muséal. » L’extension du domaine de l’art, Michel Guerrin, Le Monde, 29 novembre 2013
[2] Cinéma au Musée : expositions, installations, production Paris, Berlin, New York...Cahiers du Cinéma n°611, Avril 2006
Le sort des expositions temporaires
Qu’advient-il du mobilier d’une exposition temporaire quand elle se termine ? Ce n’est pas la question que l’on se pose lorsqu’on visite une exposition, sauf si, comme moi, vous voulez tout remporter chez vous). Par contre, c’est une question que se posent les concepteurs d’exposition, qu’ils soient exécutants ou commanditaires. Petit tour d’horizon des différents cas de figure.
Le musée de Bibracte, distingué au niveau européen pour ses actions en la matière
Direct à la poubelle...
Le cas le plus triste est l’aller simple à la case poubelle. Faute de moyens de stockage ou manutention, les lieux d’exposition doivent se résoudre à jeter les mobiliers utilisés. Mais comme l’éco-conception rentre de plus en plus dans les mœurs, les déchets occasionnés ne sont pas forcément importants. Si quelque chose doit vraiment être jeté, un suivi est mis en place pour que les déchets soient acheminés vers les centres de tri appropriés. Au musée portuaire de Dunkerque, l’exposition Tous pirates ? finira sa course à la poubelle, excepté pour certains éléments qui peuvent servir à la médiation. C’est aussi le sort qui a été réservé à l’exposition Zizi Sexuelréalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Mobilier de Zizi sexuelà la Cité des Sciences et de l’Industrie © Sortir à Paris
Vive le réemploi !
Consciente des enjeux, la Cité des Sciences a élaboré un guide d’éco-conception des expositions pour ne pas reproduire cette destruction. Ainsi l’exposition Ma terre première pour construire demain a été conçue de manière à ce que les supports soient réutilisables pour d’autres expositions : avec une nouvelle esthétique, les supports embrassent une nouvelle identité.
Les structures de Ma terre première pour construire demain © Musées et développement durable
La conception de mobilier durable et réutilisable dès le départ d’une exposition n’est pas encore de mise partout. C’est toutefois le cas à la BnF, sur le site de Richelieu, où des cimaises mobiles conçues en 2007 ont été réutilisées quatre fois par la suite.
Quand le mobilier ne peut resservir tel quel comme dans le cas précédemment abordé, il est stocké dans l’attente d’une possible réutilisation ou d’une itinérance. Au Musée National de l’Education à Rouen, le mobilier est stocké là où on peut, sans lieu dédié, jusqu’à sa réutilisation. Le Musée essaye de prévoir celle-ci en amont, en demandant aux scénographes lors de la conception des nouvelles expositions d’essayer de réutiliser l’existant. C’est le même principe à la BnF, qui inclut dans les cahiers des charges de nombreux critères de développement durable, dont l’obligation d’utiliser au maximum les vitrines existantes. Au Musée de l’île d’Oléron, ce sont des matériaux de récupération qui servent à faire les expositions et qui, une fois celles-ci terminées, sont “remis en jeu”. Pour l’exposition À la côte, des palettes furent utilisées pour créer des cloisons puis servirent à la manutention au sein du musée.

Les palettes de À la côte © photos du musée de l’île d’Oléron
De son côté, le musée de Bretagne dispose de peu d’espace de stockage dédié aux matériaux bruts, c’est pourquoi on n’y garde que des grandes surfaces de bois ou de plexiglas, qui peuvent être réutilisées pour d’autres usages. Des cloisons de la dernière exposition de l'Écomusée du pays de Rennes ont été utilisées pour l’exposition-écrin Louise de Quengo - Dame des Jacobins qui a eu lieu cet hiver.
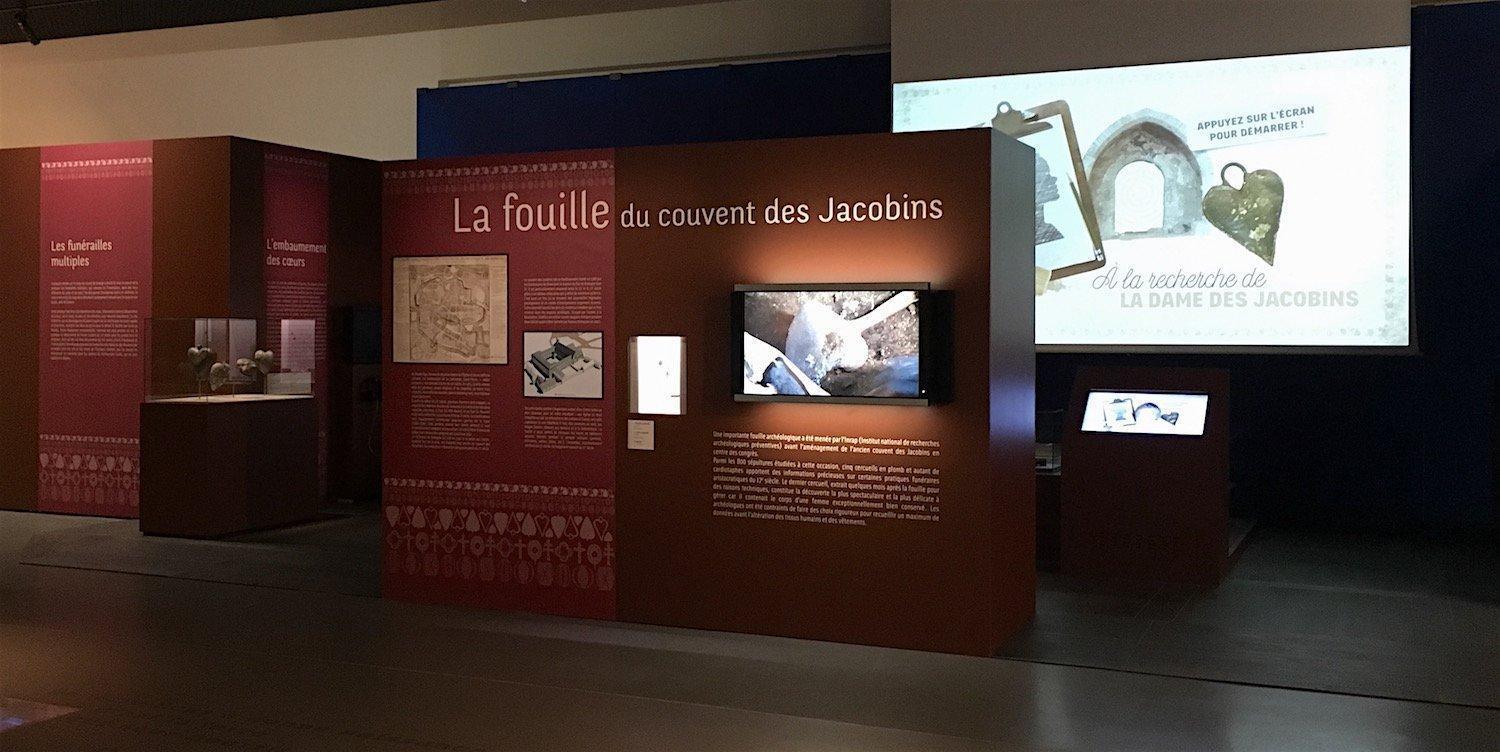
L’exposition Louise de Quengo - Dame des Jacobins© Musée de Bretagne
A l’inventaire !
A l’inverse, Rennes Métropole a mis à disposition du musée un espace où sont gardés tous les mobiliers moins ordinaires. Ceux-ci sont répertoriés dans une base de données indépendante, qui est communiquée aux scénographes pour privilégier la réutilisation en amont même de la conception.
D’autres lieux d’exposition possèdent des espaces de stockage conséquents pour leur mobilier d’exposition. C’est le cas du Centre Pompidou-Metz qui, dans une ancienne base aérienne, conserve les mobiliers intéressants. Un inventaire de ce mobilier est tenu à jour pour faciliter la réutilisation. La Cité des Sciences et de l’Industrie dispose elle aussi d’un tel lieu, où le mobilier est entreposé en attente d’itinérance ou de réutilisation.


L’entrepôt de la Cité des Sciences et de l’Industrie © M. C.
L’essor des ressourceries
Si la réutilisation des mobiliers n’est pas possible pour le lieu d’exposition lui-même, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas envisageable pour quelqu’un d’autre. Au musée de Bretagne, c’est La Belle Déchette, une ressourcerie qui donne une seconde chance à des objets et matériaux réutilisables, qui récupère une bonne partie du mobilier que le musée ne peut pas garder. Sinon, les chutes de matériaux font le bonheur des petites associations et des maisons de quartier de Rennes.
Upcycling, késako ?
La BnF, lorsqu’elle ne fait pas des expositions en carton, donne ses bâches d’exposition à la société bilum, qui les “upcycle” en articles de bagagerie. L’upcycling est l'action de récupérer des matériaux dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en produits de qualité ou d'utilité supérieure : c’est du recyclage « par le haut ». En plus de l’intérêt écologique, l’upcycling crée des objets uniques, comme cette gamme de bagagerie à partir des expositions Astérix à la BNF et Astérix s'affiche à Bercy Village. La RMN-Grand Palais et le Louvre font aussi confiance à bilum.

Modèles issus des expositions Astérix à la BnF, Monetet Hokusai© bilum
Plus tournés vers le grand public et sans partenaire régulier, les Ateliers Chutes Libresinvestissent des lieux d’exposition le temps d’un atelier, pour réutiliser les chutes de matériaux d’exposition et fabriquer des objets divers à destination du grand public.
Et les coopératives ?
La règle des 3R (réduire, réutiliser, recycler) est de plus en plus respectée par les musées et lieux d’exposition. Toutefois, les exemples abordés ici ne sauraient être représentatifs du paysage français, qui est bien plus varié. La vie du mobilier d’exposition temporaire devrait être une question centrale pour toutes les institutions : certaines ont du mobilier qui ne va plus servir mais qui pourrait servir à d’autres, des manipes et des maquettes, du matériel audiovisuel,... Il faudrait, comme Michaël Liborio le suggère dans l’ouvrage Musées et développement durable, créer une coopérative de mobilier d’exposition à l’échelle d’une région, d’un département ou tout simplement d’un réseau d’institutions. Une coopérative de ce type permettrait à bien des lieux de faire des expositions qu’ils ne pourraient faire autrement, et aux autres de s’engager plus fortement dans une démarche durable et solidaire.
Si l’on se penche sur l’éco-conception des expositions, il y a beaucoup à dire, à réfléchir et bien sûr à faire. De nombreuses structures se sont déjà engagées dans cette voie (la BnF, Universciences pour ne citer qu’elles), et il y a fort à parier que d’autres vont suivre d’ici quelques années.
Juliette Lagny
#recycler
#expositiontemporaire
#développementdurable
_________________________________________________________________________
Pour en savoir plus :
CHAUMIER Serge et PORCEDDA Aude (sous la direction de), Musées et développement durable, Paris, La Documentation Française, 2011
DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque nationale de France », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 140 | 2012, mis en ligne le 01 mars 2014, consulté le 06 janvier 2018
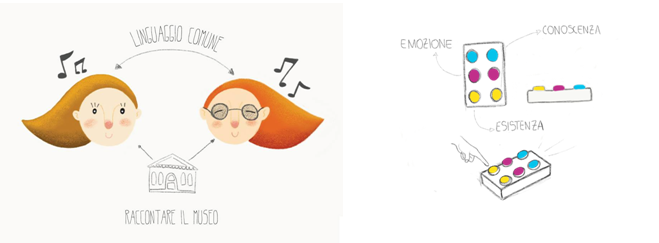
Les galline innamorate de Museomix Bologna
C’est au Museo Tolomeo de Bologne que s’est déroulée la première version de Museomix Italia du 11 au 13 novembre 2016. Situé au cœur de l’institut des aveugles Francesco Cavazza, le Museo Tolomeo a ouvert ses portes au public en janvier 2015.
Pendant trois jours, trente-cinq personnes venant de tous les horizons et aux compétences variées, se sont retrouvées au sein du museo. Leur mission : créer des dispositifs originaux pour que la visite du musée puisse se faire en autonomie. Le contexte : jusqu’à présent un médiateur accompagne toujours les visiteurs dans la salle unique du musée qui présente l’évolution des machines du XXème siècle pour lire et écrire le braille. C’est une salle sombre, étrange même, qui propose de développer un point de vue différent sur la ville de Bologne. Il faut admettre qu’il est particulièrement difficile de s’y retrouver sans les explications de Fabio Fornasari, conservateur.
Lancement de Museomix : une dynamique de groupe s’installe. Guidés par les managers d’entreprise, les groupes se forment. Je fais partie des galline innamorate, littéralement les poules amoureuses, autant vous dire tout de suite que je préfère ce nom aux muche sexy (vaches sexy). Puisque le Museo Tolomeo veut être un musée qui parle, qui interpelle, les poules amoureuses ont pour objectif de créer un dispositif autour du thème du son. Pour comprendre, pour apprendre, il est nécessaire d’écouter, d’entendre. C’est dans ce contexte que la TOLOCOMANDO est née. Inspirée de la forme du domino à six points, matrice du braille, la télécommande invite le visiteur à appuyer sur l’un de ses six boutons sensoriels. Chaque bouton émet un son en lien avec l’un des trois thèmes abordés par le musée. La connaissance est évoquée à travers deux boutons sur la lecture et l’écriture. La ville et la carte permettent d’aborder le thème de l’existence alors que des sons relatifs au conte et à la musique parlent de la sensibilité, de l’émotion. Chaque son oriente le parcours du visiteur dans la salle.
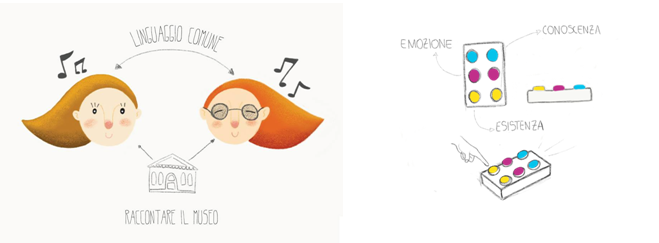
Illustrations explicatives du concept de la tolocomando réalisées par nos graphistes © Elena Della Rocca – Gummy Illustrations
La question centrale de ce museomix a été sans aucun doute celle de l’accessibilité. Il fallait imaginer des prototypes accessibles aux voyants comme aux non-voyants. Mais rendre ces dispositifs accessibles à tous n’était pas le but car travailler autour du son exclut forcément les personnes malentendantes. Quant à notre public cible, Hoëlle Corvest, chargée de projet accessibilité public handicapé visuel de la Cité des Sciences et de l’Industrie, nous a beaucoup aidés. En répondant à nos questions, en nous prodiguant de nombreux conseils et suggestions, Hoëlle nous a permis d’adapter la justesse de nos propositions de prototypes au public visé.
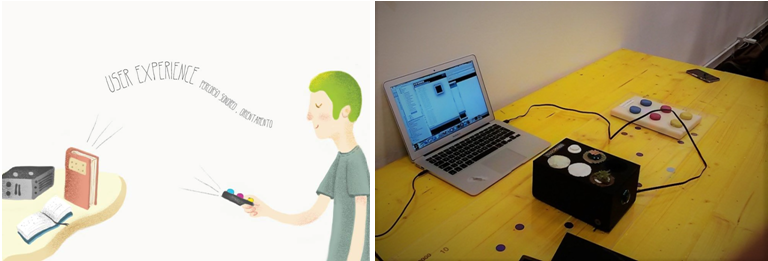
© Elena Della Rocca – Gummy Illustrations, Aperçu final de la tolocomando © M.D.
Ces trois jours se sont déroulés dans une dynamique de travail et de production inébranlable. Tout va très vite, peut-être trop vite. Les idées fusent et il me semble que nous ne prenions pas assez le temps de nous poser des questions fondamentales sur le sens des prototypes que nous voulons créer. Ce qui crée parfois une certaine frustration. Pourquoi créer une tolocomando ? Quel est le message ? Est-ce réellement une idée originale ? Certes, le but de museomix n’est pas de repenser le musée mais de le remixer et nous ne disposons que de trois jours pour créer nos prototypes. Nous n’avons pas le temps de nous interroger autant mais cela se ressent aussi sur la pertinence des propositions.
Enfin, Museomix Bologna c’est également une expérience humaine hors norme. C’est arriver dans une ville étrangère, sur un lieu inconnu avec un objectif précis. C’est pouvoir produire avec des personnes motivées et impliquées durant trois jours rythmés par les rencontres. Et pour finir, se dire que finalement, j’ai été capable de le faire, d’aller jusqu’au bout et de créer un prototype qui fonctionne.

Les « galline innamorate » © Michela Malvolti
M.D.
http://www.museomix.org/it/prototypes/tolocomando/
#museomix
#museomixbo
#tolocomando

Les musées dans nos oreilles : les podcasts au musée et sur les musées
Naissance et gloire du podcast
Le podcast-audioguide
Les podcasts de conversation : intimité et regards croisés

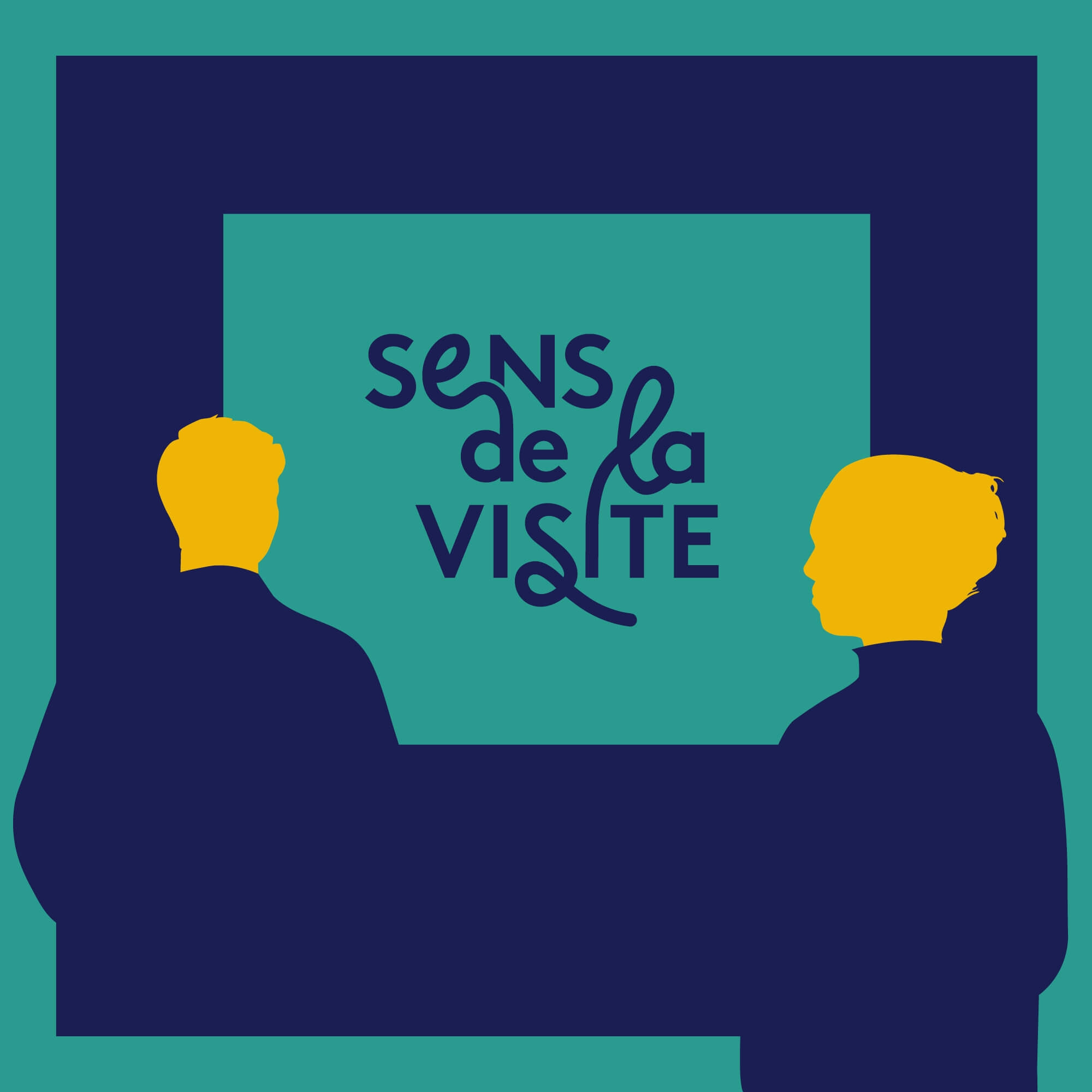


De gauche à droite : © Ausha ; © Podcastics ; © Stitcher ; © Anchor
Les podcasts documentaires : la science mêlée au récit
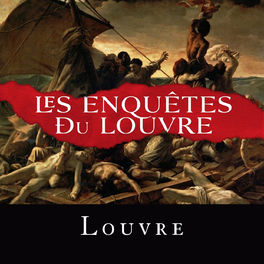


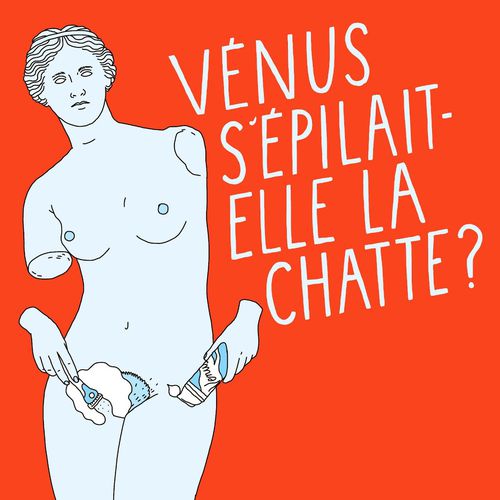
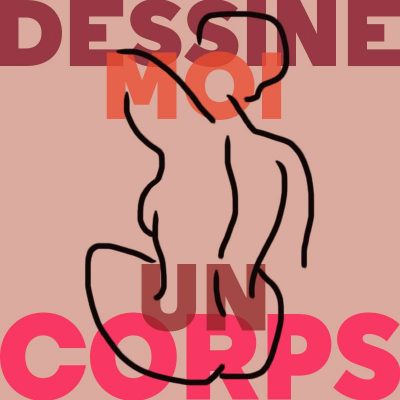
De gauche à droite : © Deezer ; © Centre Pompidou ; © Musée de l’Homme ; © Acast ; © Anchor
Les podcasts de fiction : cultiver l’imaginaire


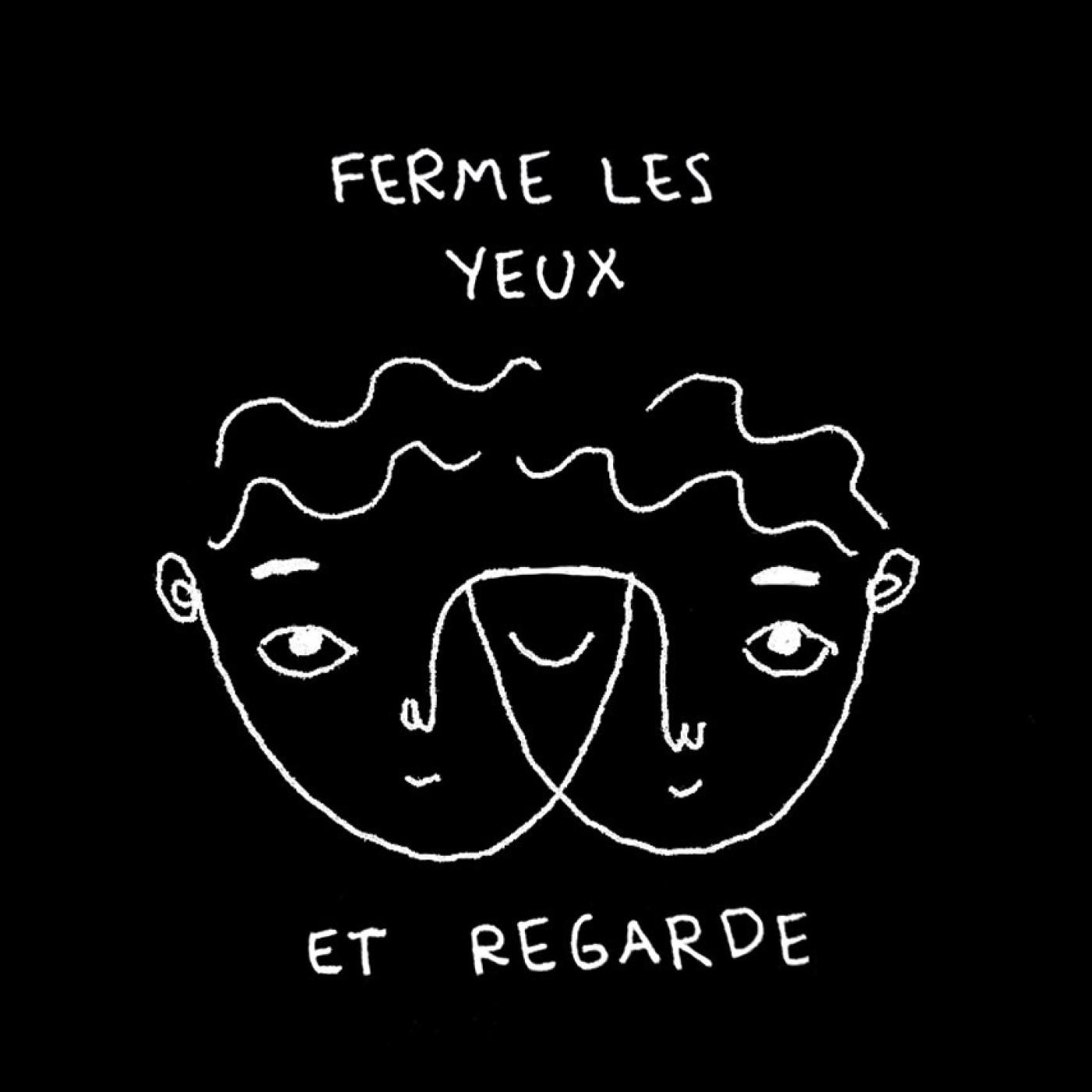
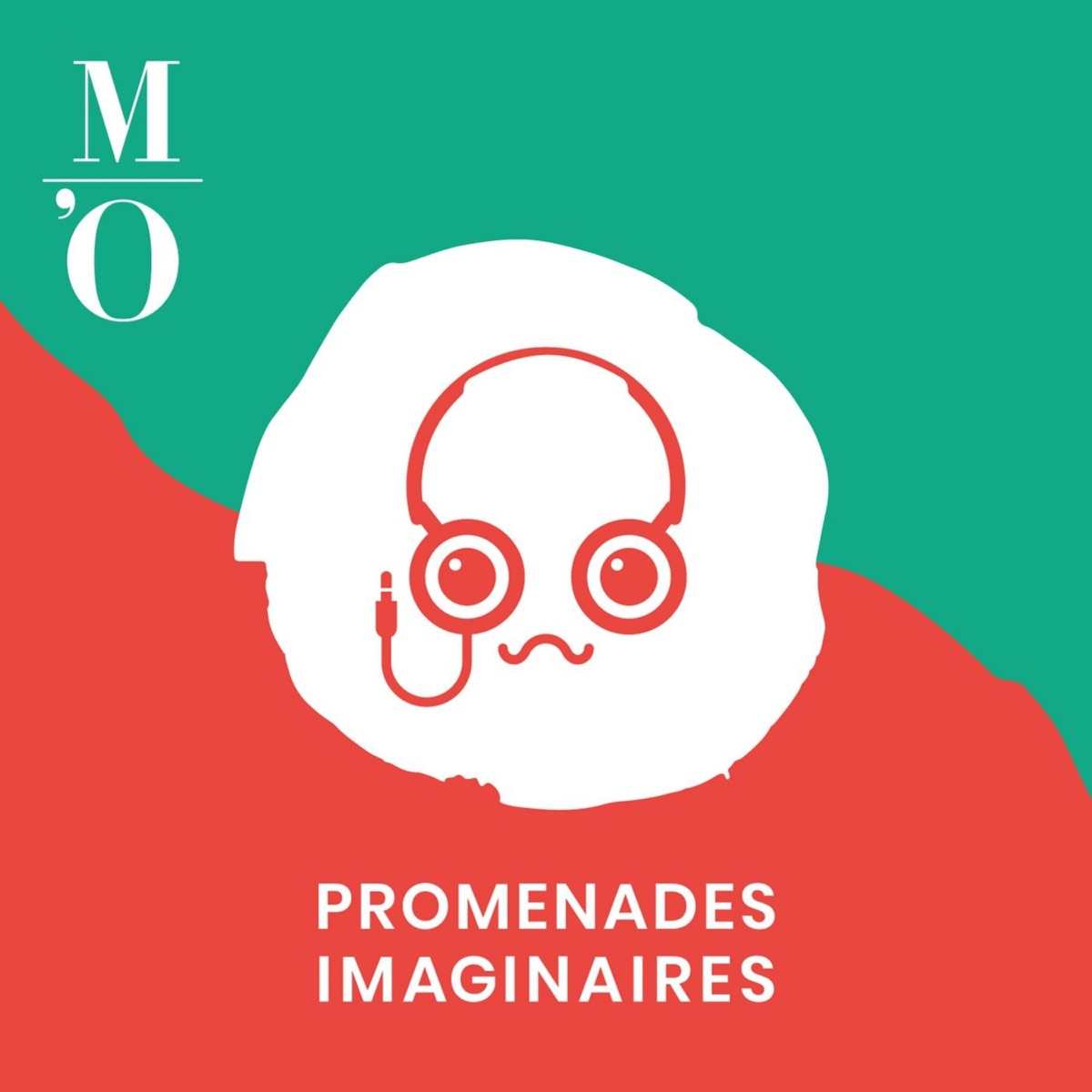
De gauche à droite : © Arte Radio ; © Centre Pompidou ; © Ausha ; © Les petits M’O
Quelques références

Les réserves visitables, ça n'existe pas
[L’article qui suit se base uniquement sur les réserves françaises et n’a pas vocation à être exhaustif.]
De vraies-fausses réserves
Comme beaucoup d’entre vous, j’aime connaître les coulisses, les « accès interdit[s] au public » des lieux culturels. Qui n’a jamais rêvé de passer derrière le rideau d’une scène de théâtre ? Alors quand je découvre qu’il est possible de visiter des réserves de musées, je n’ai plus qu’une envie : les découvrir ! Mon choix se porte en premier lieu sur les réserves du Louvre-Lens.
Une fois arrivée sur place, je descends les escaliers et fait face à une immense baie vitrée : devant moi, une salle peu remplie. Des films tactiles apposés sur la vitre me présentent les principes de conservation préventive mais face à cette grande salle presque vide, je me questionne… Le musée se targue de proposer à son futur public des réserves visibles depuis le hall et visitables par groupe. Vraiment ? La question se pose : en effet, l’objectif de départ de la réserve est de recevoir entre 300 et 350 œuvres à son ouverture, et de présenter le plus de typologies d’œuvre. Engager de telles sommes dans une toute nouvelle réserve pour seulement quelques centaines d’œuvres, cela paraît inutile et très peu efficace… A quoi cela sert-il d’avoir un tel espace pour si peu d’œuvres à conserver ?
J’ai bien conscience que la réserve du Louvre-Lens n’est pas une véritable réserve. La nature même d’une réserve est de conserver dans les meilleures conditions possibles les collections des musées. Or, le Louvre-Lens ne possède pas de fonds propre. Il ne fait qu’accueillir des œuvres du Louvre parisien. De plus, les œuvres conservées dans la réserve du Louvre-Lens ne sont là qu’à titre de présentation. Il ne s’agit pas d’œuvres qui intégreront un jour le parcours permanent, ou seulement pour une exposition temporaire et dans l’attente d’être peut-être restaurées.
La vue de la réserve depuis l’accès au visiteur. Les œuvres sont placées face à la baie vitrée, dans le sens du visiteur, sans véritablement faire au plus optimal en termes de rangement.
© J.D
Je décide de suivre une visite in situ. Le médiateur formé à la conservation présente aux visiteurs une réserve contenant la plus grande diversité d’expôts. Le musée, sans collection, construit donc son espace en fonction de ce que peut être une réserve, et non pas selon ses expôts. La sélection est pédagogique, les meubles font office d’échantillons (rac à palettes, grilles à tableau, armoires vitrée, meubles à plans/ à tiroir…). Mais tout cela ne ressemble pas à une réserve classique. On dirait une vision idéalisée d’une réserve type, celle que chaque régisseur rêverait d’avoir. Les expôts mis en scène sont tournés vers la baie vitrée. Quand une véritable réserve cherche l’efficacité, la réserve du Louvre-Lens recherche l’esthétisme.
La salle qui surplombe la réserve est quant à elle pensée dans un souci de médiation, et est articulée autour d’un programme précis. Un espace d’interprétation fait face à la baie vitrée, qui donne diverses informations que les œuvres, les mobiliers de la réserve, les métiers du musée… A l’origine, l’espace d’interprétation devait accueillir de manière permanente une médiation humaine gratuitement accessible pour le public mais cela n’a finalement pas été possible financièrement. En 5 ans, la réserve a accueilli 2759 visiteurs.
Autres réserves visitables, celle des Arts et Métiers qui proposent des visites régulières. Les réserves sont rationalisées, parfaitement équipées pour leur usage. Les allées sont larges et propres. La température est stable, la climatisation fonctionne. Les expôts sont rangés par typologie de matériaux, pour avoir les mêmes paramètres de conservation. Chaque expôt, en plus de son numéro d’inventaire, possède un code-barre pour le retrouver plus facilement. Les réserves sont accompagnées de bureaux pour la gestion des collections, de salles pour les chercheurs, de zones de décontamination, d’espaces de travail pour les restaurateurs, de zones de transition pour les œuvres en retour d’exposition…
Les visiteurs en ressortent ravis. Tout est « grand, beau, blanc et… frais ! ». Ce n’est pas étonnant : la réserve date de 1993-1994, elle est donc récente, propre et apte à être montrée. Les Arts et Métiers présentent bien de véritables réserves oui, mais sans faire pour autant figure de représentation des réserves françaises. Elles présentent la « belle » face cachée des musées, de ceux qui ont les moyens de construire de véritables réserves. Que dirait la multitude de musées de moindre envergure, qui ne peut pas conserver ses collections correctement, faute de moyens ? En explorant ce genre de réserves, les visiteurs – qui ne sont pas des professionnels – ne peuvent pas se rendre compte des difficultés éprouvées par une grande partie des musées en France en ce qui concerne les réserves.
Où trouver de véritables réserves visitables représentatives de la réalité du métier ? Peut-être au nouveau Centre de Conservation et de Recherche du MuCEM : dans ces 10 000m² et 17 réserves est présenté un « appartement témoin », qui regroupe une sélection d’œuvres présentées sous la forme de réserve. Faisant directement écho à la galerie d’étude de Georges Henri Rivière, l’appartement témoin de 800 m² a été pensée dès la conception du CCR. Les professionnels en charge du CCR le reconnaissent eux-mêmes : il s’agit là plus d’une réserve accessible que visitable, car la visite est sous condition, et accompagnée. L’espace peut accueillir jusqu’à 25 personnes, sur des créneaux spécifiques. La visite est dirigée non pas par des médiateurs, mais par des membres de l’équipe des collections. Ceux-ci parlent ainsi de leur métier, mais aussi des enjeux d’une réserve et des missions de conservation du MuCEM. De grandes allées permettent une déambulation et des stations de groupes plus commode. L’appartement témoin est accompagné de salles de consultation des collections, ouverte aux chercheurs, mais aussi aux curieux et autres amateurs. Enfin, une petite salle d’exposition vient compléter l’offre, où des commissaires extérieurs sont invités à exposer un plan des collections avec leur point de vue. Ici aussi, l’accent a été mis sur la valorisation du travail qui entoure la conservation. Chaque année, l’appartement témoin accueille en moyenne 4000 visiteurs.
En nommant leur espace visitable « appartement témoin », le MuCEM est honnête envers les visiteurs, en leur présentant clairement un espace qui ressemble à une réserve mais qui n’en est (toujours) pas une. Si, encore une fois, on ne fait pas visiter de véritables réserves, mais seulement un échantillon, l’objectif est ici de sensibiliser le public à la conservation. Ne serait-ce pas là le véritable point d’ancrage de ces vraies-fausses réserves ?

L’appartement témoin du CCR, visible en Street View depuis Google Maps. ©Google Maps
Une dénomination aux multiples facettes
La tour des instruments du Quai Branly est une autre manière d’appréhender la réserve visible. Le cylindre de 23 mètres de haut conserve plus de 10 000 instruments. La tour est entièrement visible et intégrée dans le parcours muséographique. Néanmoins, celle-ci est inaccessible au public, son but premier étant la conservation. « Il faut différencier réserves visitables et réserves visibles. La tour des instruments nous permet d’assurer nos missions tant dans la conservation que la diffusion des collections » indique Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine et des collections du musée. Une application donne des éléments d’informations et les parois diffusent les sons des instruments qui y sont conservés.
La tour des instruments du Quai Branly, au centre du musée, n’est que visible mais pas accessible. ©Musée du Quai Branly/ Nicolas Borel
Une vitrine des problématiques des réserves actuelles
Un point d’ancrage : la sensibilisation au monde muséal

Le #jourdefermeture du Château de Fontainebleau. ©Twitter/Serge Reby
Le succès grandissant de ces espaces ne se fait pas démentir : en 2023, le Victoria et Albert Museum de Londres ouvrira son nouveau Centre de Recherche et de Conservation. Un parcours public mettra en scène les réserves : l’esthétisme est au cœur du projet, des periods rooms ponctueront la visite. Des salles pédagogiques et des espaces de consultation seront accessibles au public, et le CRC accueillera même une résidence d’artiste. Mais attention : cette proposition spectaculaire ne viendrait-elle pas desservir le discours de sensibilisation à la conservation ?
Clémence de Carvalho
#réserves #conservation #visite
* D’autres articles du blog sur l’artothèque de Mons :
- « Arto » quoi ? - http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1204-arto-quoi?highlight=WyJyXHUwMGU5c2VydmVzIl0=
- Ouvrir les réserves muséales au public : zoom sur l’artothèque de Mons - http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1883-ouvrir-les-reserves-museales-au-public-zoom-sur-l-artotheque-de-mons
Pour en savoir plus :
- Roxanna Azimi, « Les réserves des musées s’exposent de plus en plus » [en ligne], Le Monde, 17/10/20. Disponible sur https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/17/les-reserves-des-musees-s-exposent-de-plus-en-plus_6056383_4500055.html?fbclid=IwAR22t_5GNs8B749iB2ZZ74RfSnvRf_rMHSwvzb5cGFbQ0o30qcvh-Y4aHfg
- Xavier Bourgine, « Les réserves, nouvelle extension des musées ? » [en ligne], Le Monde, 17/01/19. Disponible sur https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/01/17/les-reserves-nouvelle-extension-des-musees_5410612_3246.html
- Peccadille, « Une visite des réserves du Musée des Arts et Métiers » [en ligne], Blog peccadille, 11/03/13. Disponible sur : http://peccadille.net/2013/03/11/une-visite-des-reserves-du-musee-des-arts-et-metiers/
- Weo Nord-Pas de Calais Créateurs d’horizons, « Le Louvre-Lens : Les réserves s’ouvrent à vous », mise en ligne le 3/09/13. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=FQRRlOT9Zj0
- Coll, « Exposer les réserves ? Le pari du MuCEM » [en ligne], dans Accès réservé, 27/02/18. Disponible sur https://accesreserveedl.wordpress.com/2018/02/27/378/
- Coll, « Exposer en transparence : la « tour des instruments » du musée du quai Branly-Jacques Chirac » [en ligne], dans Accès réservé, 10/01/18. Disponible sur https://accesreserveedl.wordpress.com/2018/01/10/exposer-en-transparence/
- Soirée débat déontologie ICOM France – Les réserves sont-elles au cœur des musées ? Session 2. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=IEN3YmocfZA&list=PL1OZuubZXMSDm2PfIdMNeV3Ty5KAvqe41&index=4
- Visite virtuelle des réserves du CNAP : https://www.cnap.fr/360/

Les toiles prennent leur envol
Du rouge, du bleu, du noir, du orange, tels des cerf-volants, d'amples voilures émergent au loin sur la place de la République, derrière l'Hôtel de ville de Cambrai. Une sorte de cirque, entendrons nous dire par quelques curieux passants. Oui, mais pas tout à fait. Sur la place, s'élèvent trois longues tentes triangulaires et colorées desquelles vibre une certaine légèreté. Cette structure, simplement montée comme un chapiteau de cirque, appelle le marcheur comme à la fête foraine. Cette sensation d'intimité, cette invitation, tend à favoriser le désir de pénétrer au sein de ces curieuses toiles.
© D.R
©D.R
Ni structure lourde, ni tendeurs métalliques, ni parpaings disgracieux, mais huit sacs à voiles de marins emplis d'eau ancrent l'ensemble au sol. Pas d'édifice imposant, pas d'antique portique effrayant, un simple sas de toile permet à « tout un chacun » d'entrer sous ces chapiteaux accueillants.
L'entrée se fait librement et l'accès aux différents espaces est gratuit. Mais qu'est-ce donc ? Pas de clowns amusants, ni d'animaux exotiques. Il semblerait que l'appât des couleurs vives et des formes familières ait marché. Le visiteur égayé se laisse généralement emballer par la proposition de cet étrange lieu.
« Un musée mobile ! », lui dit-on. Un musée tout en kit conçu pour abriter une dizaine d’œuvres d'art tout droit sorties des collections du Centre Beaubourg. A l'intérieur, une ambiance ouatée et sobre enveloppe le visiteur. Les volumes, tous teintés de blanc, se mettent au service des œuvres exposées et accompagnent les flâneurs au gré de la couleur mise en exergue tout spécialement pour cette première exposition. En effet, le thème de cette initiative est la couleur. Une idée forte qui touche un tout public en étant également au coeur des préoccupations de l'art contemporain. Cet éloge de la couleur est en effet représenté par des joyaux de grands maîtres classiques et contemporains tels Pablo Picasso, Françis Picabia, Sonia Delaunay, Yves Klein, Fernand Leger, Alexander Calder mais également l'artiste contemporain Olafur Eliasson.
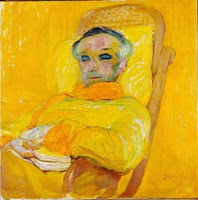 Frantisek Kupka La gamme jaune
Frantisek Kupka La gamme jaune
Pour accentuer cette impression d'intimité, de modestes cimaises protègent et sécurisent les œuvres tout en laissant paraître un sentiment d'étroite proximité. Ainsi, les tableaux sont fixés au sein des cimaise-caissons et se dévoilent au travers d'humbles vitres. Ce parcours, signé par la commissaire de l'exposition et conservatrice du Centre Pompidou Emma Lavigne, raconte alors une histoire de la couleur accessible et qui met en lumière une façon originale et ludique d'appréhender l'art en général. Cette histoire de la couleur est alors réinventée par une médiation nouvelle et très particulière. Non pas des clowns, ni des mimes ou des farceurs mais des comédiens issus de l'art du spectacle sont appelés à mettre en scène les œuvres. Cette approche, quelque peu surprenante, permet tout de même aux plus novices de stimuler une certaine construction d'un regard sensible sur l’œuvre. Pas de longs cartels à déchiffrer, point de mots savants incompréhensibles, La gamme jaune de Frantisek Kupka parle tout simplement d'elle-même.
Toutefois, un bémol vient s'inscrire dans cette si belle proposition : une médiation culturelle quelque peu restreinte et cloîtrée dans un scénario rigide et peu enclin à l'échange. Ainsi, les comédiens évoqués précédemment prétextent un mauvais rhume les empêchant de mener à bien leur rôle de « guide ». Ces derniers délèguent alors la majorité de leur prestation orale à une tablette tactile qu'ils utilisent comme une télécommande pour actionner tel ou tel fond sonore. L'idée est intéressante finalement car elle est abordable et appréciable par le plus grand nombre des publics. Cependant, il est impossible de suggérer un échange avec le médiateur, tant celui-ci est conformé dans son texte et ses différents outils. Il faut déplorer aussi le peu d'informations et de formation (!) dont ils ont disposé.
Cette idée de l'écrin, les voiles colorées, les œuvres protégées, est actionnée depuis l'année 2007 par le directeur du Centre Pompidou parisien, dans la continuité du Centre Pompidou-Metz. En effet, ces baldaquins, comme dirait l'architecte des lieux, Patrick Bouchain, sont à l'initiative du directeur de Beaubourg. La direction de ce musée d'art moderne et contemporain, dont les collections font parties des plus fournies dans le monde, a fait le pari de miser sur une itinérance de ses collections.
 François Lacour CHANEL Mobile Art
François Lacour CHANEL Mobile Art
Beaucoup diront que c'est une première dans le monde muséal. Mais il est à souligner que d'autres avant le Musée National d'Art Moderne avaient imaginé pareille entreprise. Le Corbusier par exemple, avait rêvé d'un musée itinérant dès les années 1930 ! Sans oublier André Malraux pour qui la décentralisation culturelle était une priorité dans la création de son ministère de la culture dans les années 1960. Pour les évoquer seulement, il existe aussi le CHANEL Mobile Art, pavillon d'exposition itinérant financé par la marque Chanel et offert à l'Institut du Monde Arabe de Paris ; le MuMo, pour musée mobile destiné aux enfants, qui fait également son entrée sur la route de la culture nomade ; ainsi que le Musée Précaire Albinet ayant pour objectif d'exposer des œuvres clefs de l'histoire de l'art du XXe siècle, en partenariat avec le Centre Pompidou et le Fonds National d'Art Contemporain, en impliquant les habitants du quartier dans toutes les phases du projet.
© D.R MuMo
Le Pompidou Mobile, projet de démocratisation culturelle, est calibré et modulable afin de lui permettre une implantation facile qu'il soit posé sur une friche industrielle, un site portuaire ou une place de marché. Ce centre veut privilégier avant tout les villes composées de 20 000 à 30 000 habitants parmi des zones rurales ou péri-urbaines culturellement défavorisées. Mais en s'installant sur des terres sous-équipées en lieux culturels, cette installation compensera-t-elle les inégalités territoriales ? Est-elle vraiment indispensable pour une ville comme Nantes lorsque l'on connait sa programmation artistique et culturelle ?
Soulignant la spontanéité de la rencontre avec les œuvres, ce projet donne tout de même à voir qu'une manifestation populaire peut aussi être un événement de qualité. Pour citer Bourdieu dans sa publication L'Amour de l'art : «... le plus important, c'est la médiation. Il faut donner au public les moyens de s'approprier les œuvres... ».
Jennifer Bouche

Lettre ouverte aux accueils des musées
Lorsque des visiteurs viennent au musée l’un des premiers espaces qu’ils côtoient est l’accueil. Lieux essentiels dans une institution culturelle, ils sont relégués au second plan sans grands aménagements particuliers. L’accueil se limite à une billetterie, une boutique qui sert à la fois de boutique-souvenir et de librairie pour mettre en valeur les dernières expositions ou une sélection d’ouvrages. Et parfois s’y trouve un café/salon de thé. Mais ces lieux restent de fait peu exploités au niveau muséographique par les institutions culturelles.
Pourtant, lors de mes dernières visites tant personnelles que lors de nos déplacements avec le master j’ai découvert des lieux qui ont donné une nouvelle dynamique à ces espaces quelques fois délaissés.
L’accueil : lieu d’ouverture sur l’extérieur
Si le musée est considéré comme une « zone de contact » – idée notamment développée par James Clifford – alors l’espace d’accueil devient l’intermédiaire entre l’extérieur et les espaces du musée. L’accueil est donc déterminant pour que les visiteurs s’immergent dès leur entrée dans la thématique ou les collections du musée.

Hall d’accueil du Centre Pompidou ©Keewego Paris
Outre le Centre Pompidou qui dans les années 70 offre une première proposition d’espace d’accueil par le biais de ce plateau forum. Une nouvelle aire d’accueil est pensée et plusieurs options sont présentées aux visiteurs dont de nombreux lieux de repos qui avaient été mis en place. Les visiteurs peuvent appréhender l’architecture moderne de Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini avant de continuer leurs libres circulations. Peu de musées ou institutions culturelles changent les codes architecturaux pour que l’expérience de visite commence réellement dès son entrée.
Et si un accueil vous faisiez venir au musée ?
C’est à travers la visite de quatre musées d’arts – le Palais des Beaux-Arts de Lille, le BAM de Mons, le FRAC de Dunkerque, et le CAPC de Bordeaux – que je m’intéresse à cette notion d’accueil du public en tant que structure et intégration dans le musée. Non exhaustive, mon approche n’évoque pas l’accueil comme centre de ressources, caractéristique qui se retrouve au Louvre-Lens par exemple.

Espaces d’accueil, Besoin d’air de Mathias Kiss, Palais des Beaux-Arts de Lille, Novembre 2019 ©AV et Espaces d’accueils, PBA, ©Sinapsesconseils
Direction le Palais des Beaux-Arts de Lille. De véritables espaces ont été pensés afin que le visiteur se sente plus à même de préparer sa visite. Au-delà de l’espace boutique et café, le musée a mis en place des « espaces relax » avec le wifi gratuit, une zone de travail, et différents canapés. Une zone numérique est également dédiée à la découverte des collections et des dispositifs de médiations où les visiteurs peuvent organiser leurs visites en fonction du parcours qu’ils choisissent ou les œuvres qu’ils préfèrent. Ces lieux deviennent de véritables espaces de vies.
Le PBA montre sa volonté d’intégrer les espaces d’accueils au sein du parcours muséographique, l’accueil s’inscrit comme la première étape de la visite où découvrir le musée devient une expérience ludique et agréable.

Espace d’accueil BAM, Mons, Décembre 2019, ©AV
Seconde visite : le BAM – Musée des Beaux-Arts de Mons. Si cette fois nous entrons sur un grand accueil-boutique aux lignes architecturales modernes et épurées, un espace se démarque dès l’extérieur du musée. « La bulle du BAM, meet, share, relax » accueille les publics. Cet espace à la fois recherché pour que les visiteurs s’y détendent est également un lieu où certaines personnes peuvent travailler sur le modèle d’un mini open space. Lors de notre visite plusieurs étudiants y préparaient des projets artistiques. Cet espace peut inviter de nouveaux publics à franchir les portes du musée.

Accueil du FRAC de Dunkerque, ©jepi-dunkerque
Ainsi découvrir ces espaces d’accueil devient une véritable expérience muséale dans laquelle les visiteurs peuvent se détendre et deviner les différentes collections du musée. De ce fait, mettre en valeur ces zones permet à la fois de donner des informations concernant les activités de l’institution ou encore de présenter une œuvre participative pour introduire la visite. Le FRAC de Dunkerque a également mis en valeur l’espace d’accueil par un seul et même bloc qui relie l’accueil du public en lui-même, la boutique et un espace dédié à l’échange autour d’un café. Cette nef centrale introduit et donne sur les espaces d’expositions.

Espaces d’accueils du CAPC, Bordeaux, Janvier 2020, © AV
Quant au CAPC de Bordeaux, son entrée se divise en trois espaces distincts. Le premier au centre, reste un espace libre de déambulation où un espace vidéo est consacré à l’histoire du lieu et de l’association Arc-en-Rêve (centre qui met en valeur l’architecture contemporaine). Le deuxième expose une œuvre participative dans laquelle le visiteur peut laisser s’il le souhaite des avis sur une thématique ou sur le CAPC. Et enfin l’espace de billetterie/librairie fait la liaison entre l’entrée et les espaces d’expositions.
La mise en valeur d’une réflexion et d’une organisation de ces espaces d’accueils offre un véritable intérêt muséographique pour les institutions culturelles. Leur aménagement témoigne de l’attention que donne le musée en question à l’accueil des publics. De plus, proposer des espaces tels que des salons de réflexions, lieux d’échanges ou d’appréhension des collections dès l’entrée introduit de manière significative l’expérience de visite.
Anaïs
#accueils
#musées
#publics

Lire sur les murs
Souvent, durant mes visites de musées, je ressens une certaine frustration devant un élément particulier des expositions. Je vous laisse deviner : je regarde les vitrines, et finis souvent par éprouver une gêne dans le cou que l’on peut sentir à force de trop tourner la tête… Vous ne voyez pas ?
Rappelez-vous, vous êtes devant ce magnifique objet en cuivre taillé (ou cette intrigante photographie argentique dans un cadre, chacun ses goûts) et vous aimeriez en connaître les détails, alors vous cherchez autour de vous des informations. Vous trouvez le cartel : avec un peu de chance, il se situe à moins d’un mètre de vous. Avec moins de chance, vous faites quelques pas pour aller le lire. Manque de chance, arrivé devant celui-ci, vous avez déjà oublié le numéro que portait votre Graal. Vous avez beau regarder les descriptions, espérant en trouver une qui corresponde à l’objet, vous ne savez pas faire la différence entre une fibule et une broche. Alors vous revenez vers votre objet. Ah oui, numéro 35. Vous retournez vers le cartel. C’est donc une fibule, en cuivre, du IIe siècle avant Jésus Christ. Vous retournez contempler l’objet. Attendez, c’était avant ou après Jésus Christ ?
On a tous connu un moment comme celui-ci. Voire plusieurs. Des moments où les cartels étaient à plusieurs mètres de l’objet (vous avez probablement vos propres exemples). Voire des moments où les objets en vitrine ne portaient pas de numéros, et où, après avoir parcouru la vingtaine de cartels délicatement apposés en bas de celle-ci, vous avez abandonné. Et encore, je ne vous parle pas du cartel placé trop haut, ou trop bas.
Celui-ci n'est pas assez informatif, celui-ci trop détaillé. Celui-ci trop haut, celui-ci trop bas. Celui-ci écrit trop petit, celui-ci est… où est-il enfin ? Sûrement plus loin, là où il ne gênera pas le regard du visiteur. Pourtant le visiteur attend souvent des ressources qu’il ne trouve pas toujours. Et à part directement à côté de l’expôt, peu d’emplacements ont grâce à mes yeux.
Récemment, j’ai visité un musée d’ethnographie, j’ai pu relever trois dispositifs pour se repérer parmi les expôts. Il ne s’agit pas ici de dispenser des conseils techniques, d’autant plus que les contraintes qui pèsent sur la disposition des cartels sont différentes selon les lieux et les types d’expôts. Il s’agit plutôt de pointer ce que j’ai trouvé de positif dans ma visite.
- Celui qui mentionne où regarder
Pas renversant, mais c’est plus simple quand on sait si l’on doit regarder en haut ou en bas, à gauche ou à droite.
- Celui qui trône fièrement au milieu de la vitrine
 Musée de Normandie @NP
Musée de Normandie @NP
Ou qui « veille » sur les expôts, à vous de voir.
- Celui qui est un peu plus que du texte
Il est aussi un schéma explicatif qui reconstitue ce que vous avez sous les yeux. Plusieurs expôts composent la vitrine, et ils sont difficilement séparables : j’ai retrouvé ce procédé plusieurs fois pour des collections archéologiques, il permet de saisir entièrement la vitrine ou l’assemblage d’expôts en regardant le cartel. Très pédagogique, c’est celui que je trouve le plus ingénieux, et le plus pensé pour le public.
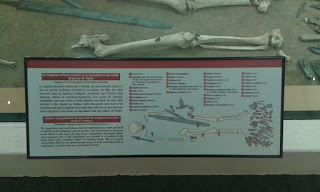 Musée de Normandie@NP
Musée de Normandie@NP
Mais il y a bien sûr plein d’autres solutions intéressantes et qui aident le confort de visite, quelles sont les vôtres ?
NP
#Cartel
#visite
#texte

Luminopolis, au cœur de la lumière
Bienvenue à toi voyageuse ! Te voici à Luminopolis !
Heureusement tu n'es pas seule, avec ton équipe, il te faudra répondre à un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir de la Cité des lumières, car une fois que tu as mis un pied dedans, soit la lumière du jour tu reverras, soit des nouveaux amis tu te feras... Réponds aux énigmes et trouve l'énigme cachée si tu veux faire partie des grands vainqueurs ! Attention tu as une heure.
Une heure pour valider les mots mystères, une heure pour montrer que les rats ne te font pas peur, et une heure pour ne te prendre aucun un coup de jus ? Et une autre heure ou 2 minutes selon tes dons d'observation pour l'énigme mystère.
Luminopolis est une exposition en mode escape game qui a lieu au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette exposition a été produite par Cap Sciences à Bordeaux.
Sauras-tu percer les mystères de la Cité des lumières ?
Entrée de l'exposition © C. Camarella
Le médiateur de la Cité des lumières t'invite à te réunir en équipe, puis choisir un parcours.
Avec tes amis, tu as le choix entre le parcours lumineux, le parcours éclatant ou le parcours flamboyant.
Selon le parcours choisi, il y a entre 10 et 18 énigmes à résoudre, et de 1 à 5 erreurs possibles. Soit vos erreurs sont pardonnées soit l'erreur est fatale ! Vous pourrez, une fois partie à la conquête de la lumière dans le parcours, choisir de répondre à des énigmes difficiles, (cela rapporte plus de points).
Selon ton score, ton équipe sera affichée sur le grand écran, là au choix tu pourras partir la tête basse ou alors t'exclamer haut et fort de ta réussite ! Tout en restant modeste bien sûr.
Après avoir choisi tes brillants coéquipiers, le médiateur, maître de Luminopolis et savant transmetteur de lumière te donne une plaquette qu'il faut disposer sur un scan à chaque dispositif pour lancer l'énigme. Il s'agit toujours de trouver un seul mot, pas de mot composé ni d'expression de plusieurs mots. Ces mots sont en rapport avec la lumière, nous sommes à Luminopolis quand même !
Vous l'avez bien compris, ceci est un escape game, pas d'échappatoire.
Dispositif avec oeillères © C. Camarella
Méfiez-vous des savants transmetteurs de lumière, ils pourront vous donner des indices...ou alors ajouter des réponses fausses si vous oubliez de désactiver la borne pour rentrer les mots trouvés aux énigmes. Et oui maintenant qu'ils ont rassemblé toutes les connaissances sur la lumière, ils ont certainement envie de distraction. Restez méfiants et toujours un œil sur le chrono, la lumière se propage vite.
Dispositif pour constater différentes déformations © C. Camarella
Les énigmes sont accessibles à tous. Sur un même dispositif, il peut y avoir 3 mots lumineux à trouver ou 1 mot flamboyant. Ensuite, il faudra rentrer ces réponses sur une borne noire avant que l'heure s'écoule. Ici, l'erreur peut être fatale. N'oublie surtout pas de déconnecter ta plaque sinon un des savants transmetteurs de lumière s'empressera d'y inscrire une fausse réponse pour te faire perdre ! Et d'autres voyageurs prêts à tout pourront y trouver leurs réponses manquantes.
Borne fatale où écrire les réponses aux énigmes © C. Camarella
Nous sommes une équipe de 3 pour tenter l'aventure, le contenu est accessible selon les niveaux. Les différents niveaux sont bien équilibrés et les dispositifs très variés. Au début, nous avons été désorientés par le parcours, les visiteurs peuvent suivre le chemin qu'ils souhaitent, et si tu fais comme nous et que tu veux commencer par la sortie par mégarde (nous les rats, ça nous fait pas peur !), un médiateur t'avertira à la hâte qu'il vaut mieux faire les énigmes pour avoir une chance de sortir ! Les médiateurs sont bienveillants, et jouent le jeu pour embarquer le visiteur dans l'aventure. Même si tu veux essayer une énigme difficile et que tu es bloqué, n'aies crainte tu ne resteras pas enfermé jusqu'à demain matin, quelqu'un viendra t'aider pour résoudre l'énigme et t'expliquera en te délivrant du contenu. C'est une manière ludique qui plaît, le Quai des savoirs accueille beaucoup de visiteurs grâce à ce concept d'escape game. Apprendre en s'amusant ce n'est pas que pour les petits. L'escape game permet à tout le monde y compris aux adultes, de se défier et de se prendre au jeu tout en acquérant mine de rien du contenu. Le jeu pour apprendre, c'est prouvé, ça marche. Cela nous a remis en mémoire plusieurs mots et explications que nous avions appris pendant nos études et oubliées depuis. Le timer et les points nous motivent, c'est un challenge d'équipe, voire personnel lorsque tu te retrouves à regarder tous les recoins du tunnel lumineux.
Manipes dans l'espace d'exposition © C. Camarella
Une des manipes, niveau flamboyant, consiste à replacer des aimants sur les heures d'une journée pour recréer le rythme circadien de ton corps. Sais-tu ce qu'est le rythme circadien ?
Tu pourras le comprendre grâce à des questions comme : Quelle est la température corporelle la plus basse ? A quel moment de la journée la pression artérielle est-elle la plus élevée ? A quel moment dors-tu en sommeil profond et à quelle heure de la journée atteints-tu ton éveil maximal ? Pour répondre à cette question, c'est à 10 heure, ne vous étonnez donc pas de ne pas être totalement réveillé avant cette horaire précise. C'est donc pour cela que les personnes qui vivent dans les pôles peuvent être en mauvaise forme, celles-ci peuvent maintenant faire de la luminothérapie pour pouvoir palier le manque de lumière qui régule le corps. Lorsque tu as trouvé la réponse à l'énigme et que tu enlèveras ta plaque, les aimants tomberont.
L'énigme mystère à trouver dans le tunnel lumineux © C. Camarella
Challenge d'équipe, ou challenge personnel avec cette énigme mystère ? Certaines voyageuses de mon équipe n'ont rien lâché. Au bout de 45 minutes, et quelques indices des maîtres de Luminopolis, nous avons trouvé la réponse à cette énigme et pu retrouver la lumière du jour en paix.
Pourquoi on a aimé ?
Pendant l'instant d'une heure, nous avons joué le jeu et nous nous sommes immergées dans la Cité de Luminopolis. Les médiateurs nous font des blagues, tentent de nous induire en erreur si l'énigme est trop facile, mais nous viennent en aide lorsque cela devient compliqué. Pendant une heure, nous discutons d'un seul sujet, la lumière. Pour se couper du monde extérieur et espérer ne pas réellement finir dans la cave avec les rats, c'est réussi. Le complément de contenu ajouté lorsqu'ils nous expliquent des énigmes que nous ne comprenons pas nous aide énormément à acquérir des nouvelles notions. Les manipes sont claires, accessibles et variées. Il y a des accessoires à utiliser pour trouver les mots, mais aussi de la VR pour s'immiscer complètement. La scénographie permet de nous plonger dans l'expérience, les jeux de lumières y participent également. Les manipes sont bien organisées dans l'espace avec des coins à dénicher à notre niveau mais aussi en dirigeant notre regard vers le haut. Nous aurions beaucoup aimé pouvoir faire un 2e round, car en une heure nous n'avons pas le temps de faire toutes les énigmes. Nous attendons avec impatience de savoir si l'exposition itinèrera dans un autre lieu !
Hé Jami un « Escape Game », c’est quoi et ça vient d’où ?
Avant de devenir IRL (in real life), l'escape game prend sa source des jeux vidéos où le but était de pouvoir s'échapper d'un endroit. Les premiers jeux vidéo d'évasion connus ont été conçu par Toshimitsu Takagi dès 2005.
C'est pourquoi, ce concept s'est d'abord développé en « Escape room » pour s'échapper d'une salle ou d'un bâtiment avant de se développer davantage. Les « Escape room » se trouve dans des lieux dédiés au jeu avant d'entrer dans les musées, les châteaux, les zoos...
Les escape games se sont d'abord développés en Asie avant de s'étendre à l'Europe.
L'idée est la même, cependant en Asie les escape games sont davantage dans un esprit de compétition tandis qu'en Europe c'est l'expérience immersive qui est mise en avant.
En français, nous dirions « jeu d'évasion réel » ou grandeur nature. Sous la forme de séance qui dure généralement une heure, des joueurs, souvent en équipe, sont immergés dans un environnement particulier comme une reconstitution d'un bateau, ou une contextualisation des années 80... A partir d'un scénario écrit, les joueurs doivent collaborer pour pouvoir sortir de l'endroit où ils sont enfermés. Des indices ou mini-jeux permettront de trouver généralement un code, un objet, la solution d'une enquête pour pouvoir sortir. Un maître du jeu surveille la partie pour donner éventuellement des indices si l'équipe a du mal.
Les escape games débarquent en France vers 2013.
Depuis peu, de plus en plus d'Escape Game apparaissent dans les lieux culturels ou institutions. D'ailleurs, les escape games auraient investi d'abord les lieux culturels avant d'être pensé le concept d'une exposition. Les game designers sont appelés à investir le Louvre, l'Opéra Garnier ou encore La Monnaie de Paris, dans le but de proposer aux visiteurs une expérience interactive. Ce n'est plus du simple divertissement, c'est l'occasion pour le musée de faire connaître ses lieux secrets, ses collections, les coulisses d'habitude impénétrables, et surtout un moyen de raviver la flamme avec ces visiteurs...
Le must : ce n'est pas que pour les enfants ou les gamers, et peu importe ton niveau !
Affiche de l'exposition Inside, Palais de Tokyo © site internet Club innovation culture
Un des précurseurs de ce concept en France au niveau artistique serait le Palais de Tokyo. En 2014, le Palais de Tokyo propose une exposition Inside, qui explore le thème de l'enfermement, où l'artiste Valia Fetisov propose une installation, Installation of Experience. Le visiteur se retrouve enfermé seul dans une pièce vide sans indication. La solution se trouve en lui même. Le game master (un médiateur) attendra une heure pour venir en aide au visiteur si celui-ci ne parvient pas à trouver la réponse.
Luminopolis, exposition au Quai des savoirs, Toulouse © C. Camarella
Tu veux participer ? L'aventure Luminopolis fermera ses portes au Quai des Savoirs à Toulouse le 1er septembre 2019.
N'hésites pas !
C. Camarella
#escapegame
#Luminopolis
#Quaidessavoirs
Pour en savoir plus :
- https://www.quaidessavoirs.fr/la-grande-expo#/?_k=p1xycw
- http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/

Mais que font donc les muséographes ?
Vous avez dit muséographie ? © CR
En fait, je pense que très peu de gens imaginent qu’un.e muséographe conçoit des contenus d’exposition et la manière de les médiatiser auprès du public. Et encore le terme de conception est-il trompeur car les muséographes ne fabriquent rien, du moins rien de physique. Mais alors que font-illes ? C’est simple : illes lisent, illes écrivent, illes coordonnent, illes improvisent. Pour rendre tout cela plus concret, partons d’un cas concret : l’exposition Rose Valland. En quête de l’art spolié qui se tient actuellement au Musée dauphinois. Son commissariat a été assuré par Olivier Cogne et sa muséographie par trois masterantes – Clara Pinhède, Suzy Louvet et moi-même - dans le cadre d’un stage long au Musée dauphinois.
Les muséographes lisent
Suzy Louvet à son bureau, équipée des indispensables du muséographe : des livres, un téléphone portable et un ordinateur © Denis Vinçon
Dans sa première phase, le travail des muséographes se rapproche de celui des chercheur/euses : pour s’approprier un sujet, les muséographes commencent par compiler de la documentation. Il s’agit souvent de littérature grise, produite par des spécialistes du sujet mais aussi de catalogues d’expositions traitant de thématiques proches, d’articles de presse mais aussi, d’ouvrages de fiction, etc. Dans le cas de Rose Valland et de l’art spolié, la littérature disponible était abondante. Elle se composait aussi bien d’ouvrages scientifiques que fiction. L’intérêt (re)naissant pour ce sujet depuis le mi-temps des années 1990 s’est également traduit par la production de documentaires et d’expositions sur le sujet.
Les muséographes s’intéressent aussi à des sources de première main – les archives – avec des objectifs un peu différents de ceux des chercheur/euses en sciences humaines. La consultation des archives peut bien entendu simplement compléter la veille documentaire. Mais le recours aux archives permet aussi de documenter un objet ou des objets à exposer, voir même de trouver des pièces à exposer. Pour préparer l’exposition Rose Valland. En Quête de l’art spolié, nous avons abondement consulté les fonds des Archives nationales et des Archives diplomatiques. Rose Valland a elle-même produit (et conservé) une documentation considérable. Sa consultation s’avérait indispensable pour comprendre en profondeur le travail de cette fonctionnaire déterminée mais discrète sur ces activités professionnelles. Nous avons été accompagné.es dans cette tâche par le comité scientifique de l’exposition regroupant des spécialistes de différentes institutions : Ophélie Jouan (Archives nationales), Sébastien Chauffour (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères), Alain Prévet (Direction des Musées de France), David Zivie et Thierry Bajou (Ministère de la culture), Didier Schulmann (Centre Pompidou), Olivier Renodeau (Musée de l’Armée). Jacqueline Barthay, présidente de l’Association La Mémoire de Rose Valland a également largement contribué à cette phase du projet en nous accompagnant dans le dépouillement du fond documentaire inédit rassemblé par l’association.
Quelle que soit la qualité des sources consultées, la lecture du muséographe n’est jamais désintéressée ; lire ce n’est pas seulement gagner des connaissances, c’est construire sa connaissance d’un sujet, l’apprivoiser, le circonscrire. La forme de synthèse opérée par muséographe est relativement spécifique. Il s’agit tout autant d’un tri de l’essentiel et de l’inessentiel, du simple et du complexe que de l’attrayant et de l’inattrayant, du curieux et du convenu. Son objectif est moins de résumer un champ de connaissance que d’y trouver une porte d’entrée originale par laquelle pourra se frayer le plus grand nombre. Ce ou ces biais de lectures sont souvent appelés des « partis pris muséographiques ».
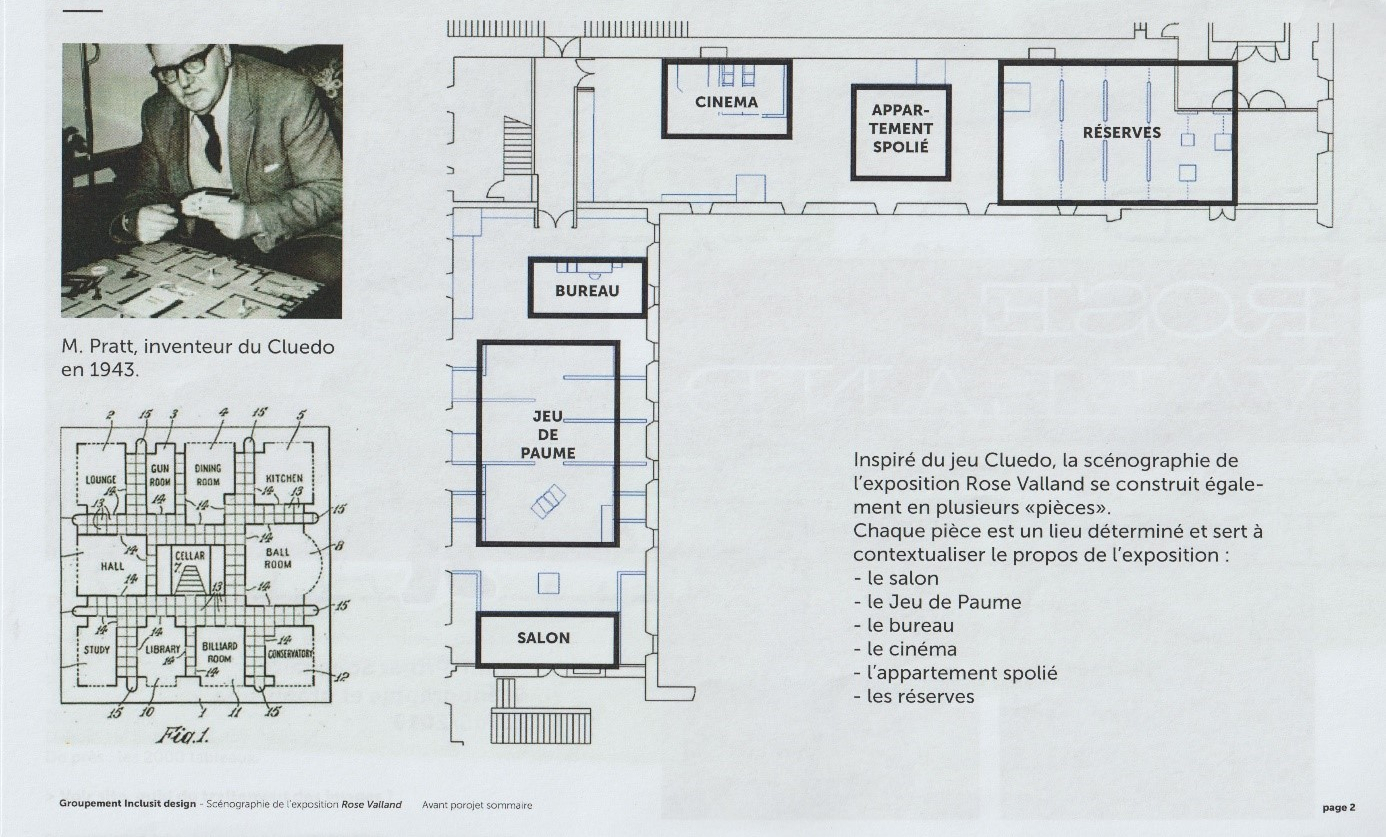
Les scénographes d’Inclusit Design se sont emparé du parti-pris de l’enquête en construisant l’espace comme un jeu de Cluedo © CR d’après une création originale d’Inclusit Design
Deux partis-pris muséographiques ont donné sa coloration à l’exposition du musée dauphinois. D’abord, l’insistance sur la période post 1945 de la vie de Rose Valland, soit sur son travail de recherche et de restitution de l’art spolié. Ce premier choix en a orienté un second, plus formel, celui de l’enquête.
Les muséographes écrivent
Assez logiquement une fois ce travail d’appropriation documentaire terminé – ou du moins bien entamé – les muséographes peuvent commencer à produire du contenu ou plutôt des contenus.
Classiquement, illes commencent par une note d’intention, document qui rappelle le contexte de production de l’exposition et précise ses premières intentions de contenu. Cette note d’intention devient au fil des mois un synopsis d’exposition, de plus en plus développé et précis. Le synopsis d’exposition détaille le parcours d’exposition. Il met en rapport un contenu organisé, hiérarchisé et les espaces d’exposition disponible. Chaque chapitre de l’exposition est ainsi déjà plus ou moins pensé dans et en fonction de l’espace.
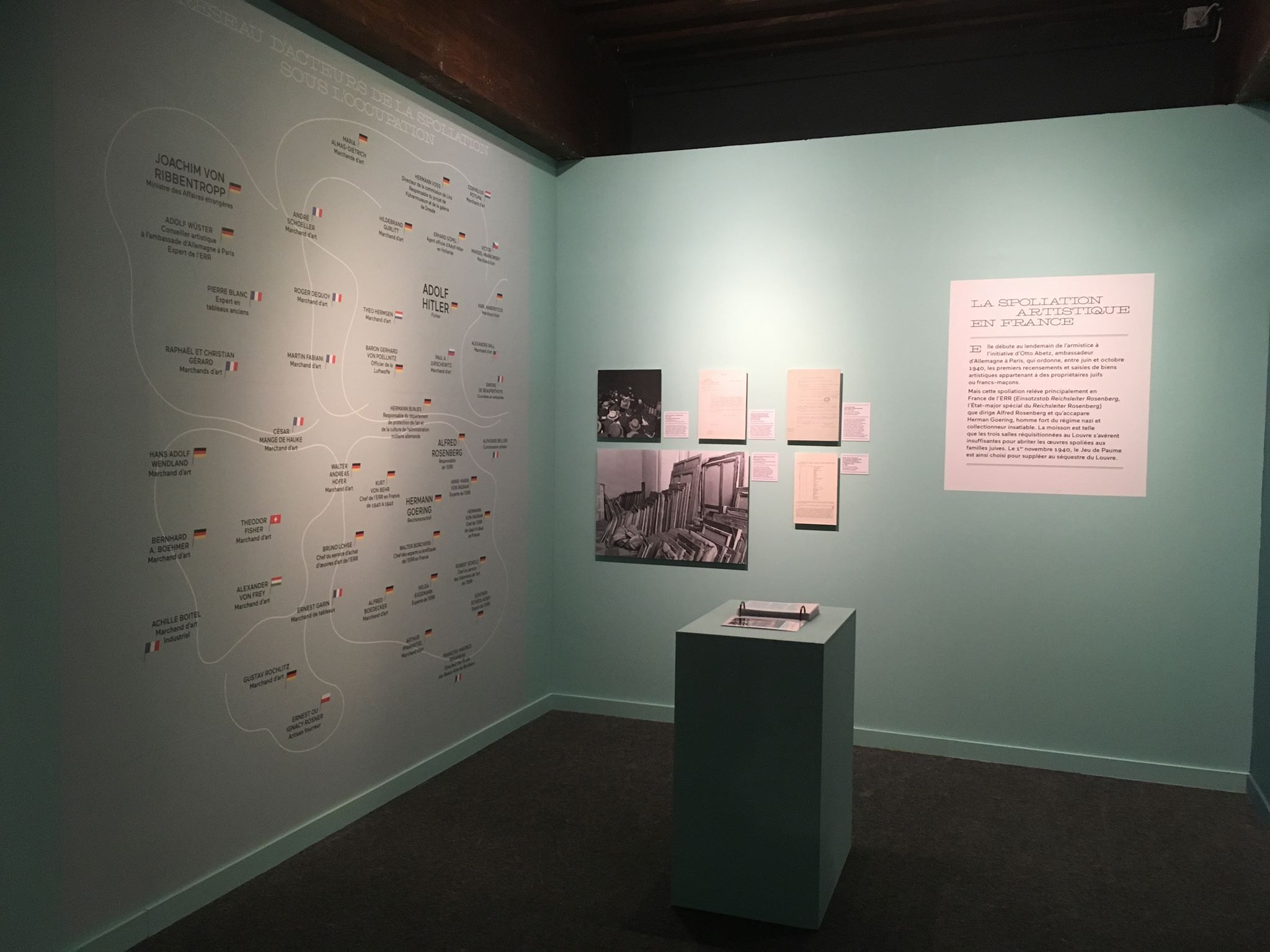
Des formes de productions écrites diverses dans l’espace évoquant la spoliation artistique et le marché de l’art parisien sous l’occupation : mur d’acteur/trices et fiches biographiques, texte de salle, cartels © C.R
Dans une des dernières phases du projet d’exposition, les muséographes peuvent être amené.es à rédiger des textes d’exposition. S’il n’est pas rare que les textes principaux de l’exposition soient rédigés par le commissaire de l’exposition, le muséographe échappe plus rarement à l’écriture des cartels.
Les textes de l’exposition Rose Valland, ont ainsi été produit.es à six mains : Olivier Cogne, le commissaire d’exposition se chargeant des textes de séquences, Suzy Louvet et moi-même nous répartissant l’écriture des cartels et de tous les autres éléments textuels de l’exposition (cartels, biographies d’acteur/trices, scénario et dialogue d’un jeu numérique, etc.). Le travail d’écriture muséographique est un travail d’équipe et donc un travail itératif. Selon les configurations, les textes sont relus au sein de l’équipe de projet et/ou par le comité scientifique de l’exposition. Ceux de l’exposition du Musée dauphinois ont fait l’objet d’une double relecture, en interne et en externe. Deux membres du comité scientifique se sont particulièrement investis dans cette vérification : dans un premier temps, la chercheuse Ophélie Jouan - par ailleurs autrice de Rose Valland. Une vie à l'œuvre la publication qui accompagne l’exposition – puis David Zivie, chargé du patrimoine au ministère de la culture.
Comme tous les travailleur/euses de bureau du 21e siècle, les muséographes écrivent aussi des mails, beaucoup de mails et d’autant plus de mails que leurs interlocuteur/trices sont nombreux/euses.
Les muséographes coordonnent
Qu’illes soient indépendant.es ou embauché.es par une structure muséale, les muséographes sont des interlocuteurs privilégié.es. Illes sont en contact permanent à la fois avec tout le personnel interne à la structure dans ou pour laquelle illes exercent mais aussi avec tous les prestataires qui interviennent sur le projet.
Les muséographes occupent un rôle pivot à l’intérieur comme à l’extérieur du musée. Pour ce projet, nous travaillions étroitement avec le service des collections, avec la chargées d’action culturelle et l’équipe technique mais aussi plus ponctuellement avec le photographe, la chargée de communication, la gestionnaire et plus globalement l’ensemble des personnels du musée.
En externe, nous assurions les relations avec les musées et particuliers prêteurs. Le nombre de prêteurs et leur dispersion géographique a rendu cette tâche particulièrement chronophage – mais aussi réellement passionnante puisqu’il s’agissait de collaborer avec des structures très diverses, tant régionales que nationales. Nous avons également sollicité des prêts d’œuvres restituées auprès de particuliers. Le repérage des prêteur/euses potentiel.les et la prise de contact avec elle/eux n’a pas été chose facile. Néanmoins, le dialogue instauré avec ces particuliers c’est avéré particulièrement riche et nous a permis de ne pas perdre de vue les conséquences de ce double mouvement de spoliation/restitution pour les familles impliquées.
Last but not least, nous étions le contact des prestataires extérieurs intervenant sur le projet : l’agence de scénographie Inclusit design, les graphiste Jeanne Bovier Lapierre et Jérôme Foubert, mais aussi l’agence de création numérique PixelsMill, le concepteur de jeu Escape Game Bastille, l’illustratrice Cécile Becq et le cartographe Thomas Lemot. Il s’agissait très concrètement de fournir à ces différents prestataires la matière dont ils avaient besoin pour leurs créations respectives. Nous avions aussi à charge d’établir un rétroplanning cohérent permettant de coordonner au mieux l’avancement et la remise des productions de chacun.e.

Comment présenter le verso des tableaux MNR exposés tout en sécurisant les œuvres, en permettant aux pompiers de les dégager facilement en cas d’incendie et en respectant les exigences de conservations imposées par les musées prêteurs ? Ce problème complexe a demandé plusieurs mois de réflexion collective. La solution mise en œuvre est un système sur mesure respectant les différents systèmes d’accrochages des tableaux © Denis Vinçon
A partir d’un certain stade, ce travail de coordination devient beaucoup plus concret. Lorsque la construction de l’exposition débute, le muséographe peut être amené à assurer le suivi de chantier. Dans cette configuration, notre rôle consistait essentiellement à faire l’interface entre l’équipe de chantier et la scénographe, basée à Saint-Etienne. Cela signifie, en pratique, recueillir les questions et demandes techniques de chacune des parties et y répondre au mieux pour faciliter le bon avancement du chantier. Cela suppose une connaissance solide du projet de scénographie et une grande disponibilité. Le muséographe n’est bien entendu pas un spécialiste de tous les métiers à qui il s’adresse : les solutions aux problèmes techniques soulevés sont donc le plus souvent trouvées collectivement. L’équipe de muséographie du projet "Rose Valland" était d’ailleurs chargée, en coordination avec le commissaire d’exposition, d’organiser et d’animer les réunions de chantier réunissant les équipes de conception et de réalisation.
Les muséographes improvisent
De par son double rôle de conception et de coordination, le muséographe est le roi des plans B (puis C puis D…). Dans toutes les phases de son travail, le muséographe doit tenir compte de contraintes plus ou moins nombreuses imposées à la fois par le commanditaire de l’exposition et par les musées prêteurs. Ces contraintes sont liées à la qualité des espaces d’exposition, aux exigences de conservation préventives, au budget alloué à l’exposition, etc.

Les vitrines récupérées pour m’exposition Rose Valland, rassemblée dans le chantier d’exposition en vue de leur aménagement par l’équipe technique du musée © Denis Vinçon
En sus des exigences évoquées ci-dessus, le musée dauphinois a à cœur de favoriser le réemploi du matériel d’exposition, dans une démarche de développement durable. Pour l’exposition Rose Valland, seules quelques vitrages aux dimensions très spécifiques ont dû être commandées. L’intégralité des vitrines tables présentes dans l’exposition a déjà servi dans une ou plusieurs expositions. Ce recyclage a d’abord nécessité plusieurs heures de repérage des éléments les plus adaptés dans les locaux de stockage du musée. L’utilisation de vitrines un peu plus grandes ou plus petites que celles prévues dans les plans de scénographie implique nécessairement des ajustements et donc un dialogue entre muséographes, scénographes et équipes techniques. Enfin, la plupart des vitrines utilisées n’étaient pas des vitrines climatiques, il a fallu prévoir les aménagements nécessaires pour pouvoir stabiliser leur climat et ainsi répondre aux exigences de conservations des centres d’archives prêteurs. La solution trouvée consiste à insérer des cassettes de gel de silice dans des doubles-fonds spécialement aménagé par les menuisiers du musée. Cette démarche de réemploi concerne tous les éléments de scénographie, y compris le matériel numérique : tous les écrans présent.es dans l’exposition sont des réemplois. Une fois encore, cela a supposé des ajustements de format, discutés en amont avec la vidéaste Bénédicte Delfaux qui a produit les six pastilles qui ponctuent le parcours d’exposition.
Les exemples de ce type pourraient être multipliés à l’infini. A tel point que si l’on devait ne retenir qu’une qualité requise du/de la muséographe, ce serait bien l’adaptabilité. Les muséographes sont aussi désireux/euses de partager le fruit de leurs aventures collectives ; je ne fais pas exception : rendez-vous au Musée dauphinois, jusqu’au 27 avril prochain.
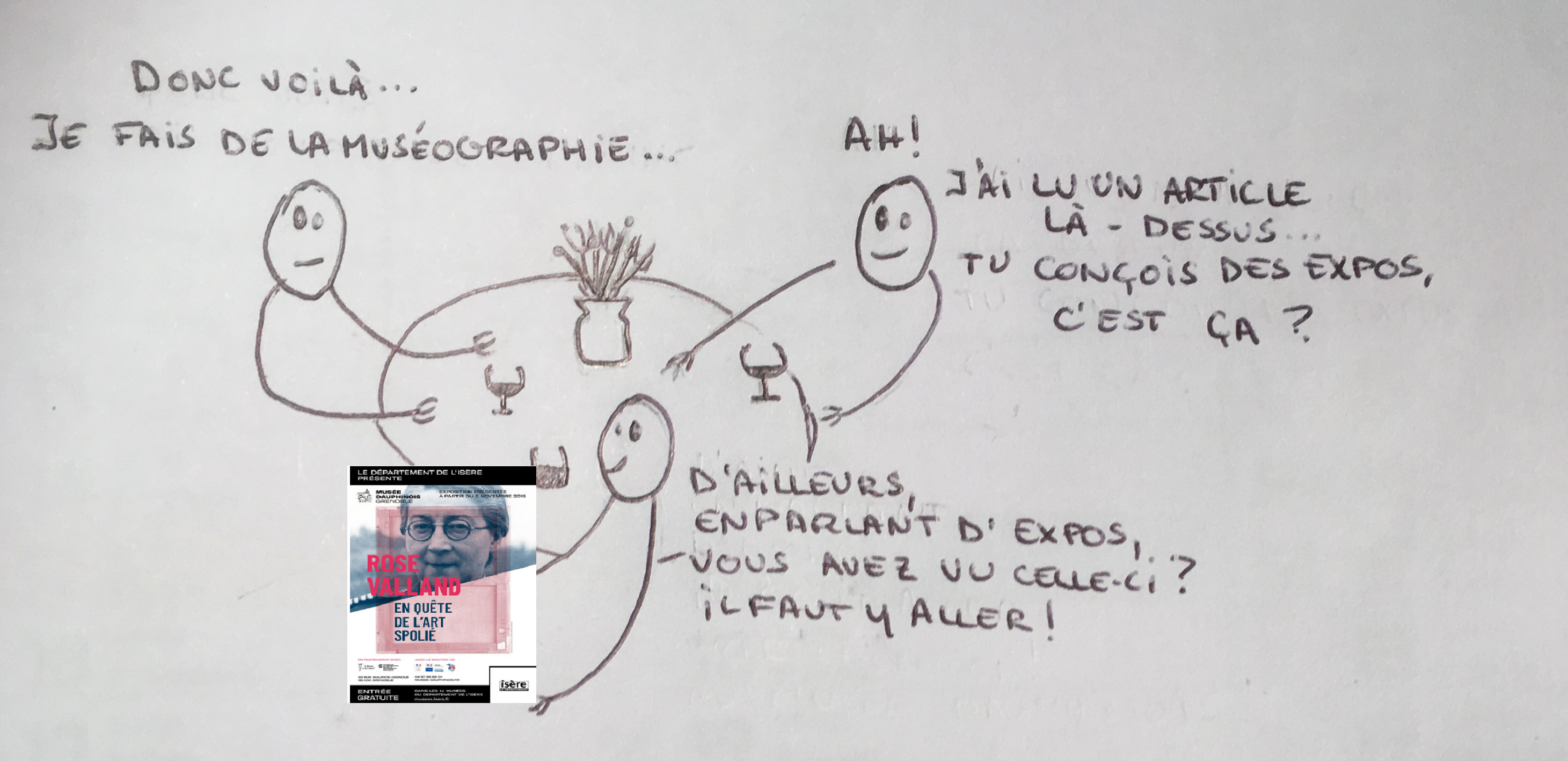
Vous avez re-dit muséographie ? © CR
C.R
#Muséographie
#RoseValland
#Muséedauphinois
Pour aller plus loin :
Le site du collectif professionnel Les Muséographes : http://les-museographes.org/museographie/les-missions-de-la-museographie/
L’exposition Rose Valland. En Quête de l’art spolié et la programmation associée : https://musees.isere.fr/expo/musee-dauphinois-rose-valland-en-quete-de-lart-spolie
…Et un excellent article que l’Art de Muser a consacré à Rose Valland, aux spoliations nazies et aux recherches de provenance.
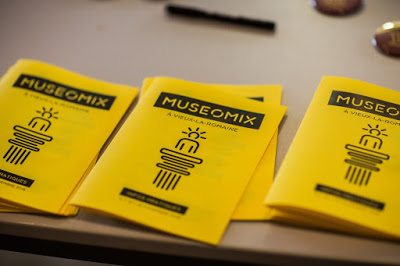
Mon premier Hackathon
La frénésie ‘Muséomix’ a commencé pour moi le vendredi 11 novembre à 9 heures tapantes autour de croissants, cafés, jus de fruits et goodies. J’étais encore loin d’imaginer à quoi aller ressembler mon week-end, notamment parce que je ne savais pas précisément dans quoi je m’étais engagée ! On m’avait parlé d’un événement pour réinventer le musée et je n’avais pas voulu fouiller les archives du site internet pour garder un effet de surprise.
Source : AG+ Studio
Me voilà donc au milieu d’une foule en liesse, où chacun trépigne en donnant l’impression de déjà savoir ce qu’il veut faire. Il n’y a pas de temps à perdre. Le café est à peine avalé qu’on organise déjà deux groupes pour visiter la structure ! Le premier part examiner le musée en compagnie du directeur. Il nous annonce la couleur dès le début : le musée archéologique de Vieux-la-Romaine manque de renouvellement et d’attractivité alors plus on est créatif, plus on propose des projets fous, plus nous serons soutenus ! S’amuser et profiter sont presque des devoirs !
L’ambiance est posée. Pourtant pendant la visite chacun suit poliment et prend note à la manière d’un cours magistral… Finalement il va falloir encore un peu de temps pour se libérer ! Mais qu’importe c’est déjà le moment de visiter « l’usine à inventer » ! Les ‘ingénieux’, qui sont là pour nous épauler dans tout ce qui touche aux technologies du Fab Lab, nous énumèrent tout un tas d’outils, dont la plupart semblent encore incongrus pour un musée. Il va vraiment falloir commencer à se lâcher ! Justement pour partir à la recherche de notre imagination, bien cachée ce matin-là, nous commençons un brainstorming géant, autour de cinq grandes thématiques. Armés de post-it multicolores et de stylos, nous voici la trentaine de participants, fourmillant d’un tableau thématique à l’autre, écrivant à tout va des mots-clés et répondant aux post-it précédents. Chacun y va de son commentaire ou sa blague. Toute idée, aussi farfelue qu’elle soit, se doit d’être exposée à tous !
Les groupes se forment en fonction des affinités thématiques et des compétences de chacun. Un petit pins permet de distinguer chaque savoir-faire : médiateur, bricoleur, designer, communicant, scientifique ou codeur. Une compétence par équipe est nécessaire à la réalisation de chaque projet. Enfin, le marathon créatif peut commencer... Les heures suivantes n’étaient que des discussions dynamiques autour de l’imagination d’un sujet, d’un dispositif et comment le mettre en place. Exposer ses idées et les confronter aux points de vue des autres n’est finalement pas si évident, surtout quand certains ne préfèrent pas entendre d’autres opinions que la leur.
En définitive, nous nous sommes accordés pour concevoir deux petits parcours se construisant autour des vitrines et textes de l’exposition permanente du musée. Le visiteur se munit soit d’une tesselle de céramique soit d’une coquille d’huître, et part à la recherche de son réemploi dans l’Antiquité, cherchant des indices dans l’espace d’exposition. Par des jeux d’interaction, de renvois lumineux et d’indices il peut reconstituer un pot en céramique, jouer à la marelle antique (jeu de plateau dont les pions sont constitués de tesselles) et participer à la construction d’une route romaine. Le principe est identique pour les coquilles d’huîtres : le visiteur doit trouver comment recycler ce déchet (très important en Normandie du fait d’une très grande consommation d’huîtres à l’époque) et finalement, il est invité à poser sa coquille sur un chantier de construction d’un sol. Les parcours sont libres mais interactifs et conviennent aux adultes comme aux enfants. Le musée est au cœur du dispositif pour inciter à s’approprier les espaces et y être attentif.

Table de travail du groupe Les Vieux Débris lors de la conception du parcours céramique
Source : C. Maury
Après les débats, c’est le début de la conception matérielle et les premiers problèmes techniques ressortent ! Sous le stress, l’excitation et l’effervescence chaque contrariété prend des proportions excessives ! C’est aussi ça l’expérience Muséomix : se maîtriser, s’adapter aux autres, organiser son temps et apprendre à mieux communiquer. Le bouillonnement créatif nous fait perdre toute notion de temps et même d’environnement. Le monde extérieur n’existe plus. On pense Muséomix, on mange Muséomix, on dort Muséomix ! Les journées sont intenses par leur longueur et productivité et finalement le soir en quittant l’équipe, il y a presque un vide.Les trois jours s’enchaînent avec la rapidité d’un éclair, et finalement dimanche arrive déjà. L’après-midi les visiteurs sont invités à tester les prototypes et donner leur avis. Eux aussi vivent une drôle d’expérience: partir visiter des sites archéologiques avec un parapluie transformé en GPS ou construire une voie romaine avec des coquilles d’huîtres, ce n’est pas ce à quoi on s’attend lorsque l’on choisit de visiter un musée archéologique ! Mais d’ailleurs la surprise est meilleure... J’entends certains visiteurs dire qu’ils ne trouvent plus l’archéologie ennuyeuse et trop éloignée de notre société… et ça c’est gagné !

Alliance de nouvelles technologies avec l'archéologie
Source : AG+ Studio
Après plus de trois heures de test avec un vrai public, le musée referme ses portes. C’est l’heure du bilan. On nous annonce que le dispositif pour lequel je me suis donné corps et âme sera certainement pérennisé. Quelques détails devront être repensés pour être parfait, mais le directeur semble confiant. Sur les cinq projets, seul le notre se voit récompensé de la sorte !
Nous fêtons cette réussite autour d’un dernier verre et les petits fours de la soirée de clôture. L’aventure s’achève déjà… Je ressens comme une sorte de nostalgie et en même temps un soulagement… Enfin la pression peut redescendre. C’est aussi à ce moment là que je réalise que je viens de vivre une expérience intense, humaine et riche où l’innovation est au cœur de toute pensée.Je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer autant de gens aux parcours si différents et pourtant unis dans un objectif commun, qu’était ici la rénovation de l’expérience muséale, je n’avais pas non plus eu l’occasion d’exercer ma créativité de telle manière et en si peu de temps, et surtout c’était la première fois que j’avais autant de moyens (tant matériels qu’humain) pour m’accompagner dans un projet d’invention. Finalement les délires peuvent parfois devenir cohérents et concrets !

Présentation du prototype des Vieux Débris en plénière
Source AG+ Studio
En partant, un de mes coéquipier me lance : « On se voit au prochain hackathon ! » Quoi ? C’est quoi ce charabia ?! Et lui de m’expliquer qu’un hackathon c’est l’événement qui vient de se terminer… C’est un processus de création soutenu pour concevoir par équipes de nouveaux dispositifs, ou réinventer une structure. Décidément je ne savais vraiment pas dans quoi je m’engageais en participant à Muséomix !
CM
#Museomix
#Vieux-la-Romaine
#LesVieuxDébris
#Hackaton

Musée à emporter : La boutique du musée d'art comme prolongement de l’expérience muséale ?
Qui n’a pas chez soi, une Mona Lisa aimantée à son frigo ou encore une affiche de Mucha épinglée au mur ? Ces ersatz arrivent dans nos intérieurs et sortent du musée grâce à la « Boutique », et plus spécifiquement celles des grandes institutions muséales d’art en France. Cet article est dédié à ce lieu considéré à la marge, devenu un passage obligé dans nos visites.
Photographie de la boutique du Musée de la civilisation ©Musée de la civilisation, Marie José Marcotte - icône
Un prolongement du parcours muséal
André Gob et Noémie Drouguet nous relatent dans La Muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels, 6 e édition parue en 2025, comment la boutique tend à s’étendre et à se multiplier dans toutes nos institutions muséales, du plus petit écomusée pour valoriser un savoir-faire local aux immenses boutiques promouvant l’image de marque de certaines institutions. Dans chaque rénovation, les espaces d’accueil comme la billetterie, la restauration ou encore la boutique prennent une place de plus en plus importante, dans une volonté d’offrir les meilleurs services et de placer les publics au centre de ces projets.
La variété des objets proposés s’étend toujours plus et ne cesse de se renouveler, au-delà des classiques cartes postales ou des catalogues d’exposition, viennent s’ajouter des objets de tout type, de design, des bijoux, et même des souvenirs locaux. On s’assure ainsi que tout le monde puisse “trouver son bonheur”, par exemple pour les plus grosses institutions comme le Louvre où il existe plus d’un millier de références vendues, mais les reproductions d'œuvres restent les best-sellers et continuellement, conquièrent le visiteur devenu consommateur. La photographie et l’impression démultiplient l’œuvre, collée, imprimée sur tous supports et formats possibles : le magnet, la carte postale, en passant par le tote bag ou encore le fac-similé et l’affiche.
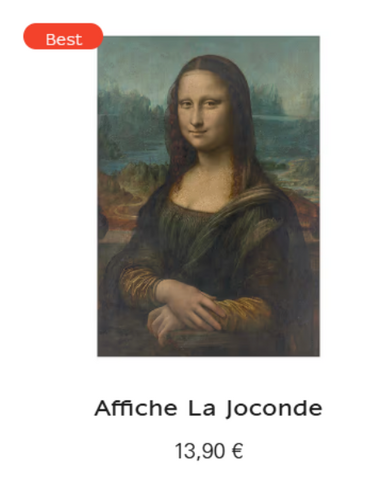
Capture d'écran de la boutique du musée du Louvre ©VDLG
Tous ces objets se nichent dans ce qu’on aime appeler un espace « liminaire », un espace de transition, de passage, entre le dedans et le dehors, entre l’intérieur et l’extérieur. Cela s’explique en premier lieu par des stratégies d’agencement mais, au-delà de ce fait, il s’agit d’un espace clé pour le visiteur qui y redevient un consommateur du quotidien. Le plus souvent placée en fin de parcours, la boutique est la dernière étape avant la sortie du musée, il y a alors une volonté de parachever l’expérience du public. Contraint par le parcours muséal de traverser cet espace, il est le dernier souvenir. Il s'agit alors d’un espace important, plus qu’une manne financière, il devient en quelque sorte la vitrine du musée, un outil de communication. La boutique du Louvre, pour reprendre l’exemple, s’étale sur plus de 2 000 m2 dans une esthétique minimaliste et élégante, conçue sur deux niveaux par le cabinet d’architecture RDAI. Elle vise à forger pour l’institution une réelle image de marque, symbole d’une élégance à la Française, avec de nombreux produits dérivés floqués du nom du musée ou des « chefs-d’œuvre » des collections. Le magasin et ses articles prennent une place essentielle dans les projets d’attractivité des établissements pour attirer tant des habitués que des nouveaux visiteurs. En 2025, par exemple, le musée de l’Orangerie a fermé sa boutique pour la réaménager entre le 1er juillet et le 30 septembre. On constate aussi une certaine autonomisation de ces lieux pour les faire rayonner davantage avec par exemple une entrée différente de celle de l’accueil du musée, comme pour le musée Picasso, ou encore des plages horaires plus larges que celles des salles d’exposition, avec le Louvre.

Photographie de la boutique du Musée du Louvre ©Musée du Louvre
La marchandisation de l’art comme expérience culturelle
Traverser une boutique peut être un passage rapide, à grandes enjambées, mais également une flânerie qui prolonge l’expérience muséale. De façon presque ironique, des peintures et des sculptures inestimables mutent, par leurs copies, en objets où leur valeur devient marchande. Ce qui est particulièrement flagrant avec les répliques et reproductions d'œuvres, toute la symbolique de l’original se désagrège pour des considérations esthétiques. Qui n’a pas acheté une affiche pour avoir chez soi un double ornemental d’une œuvre qu’on apprécie tout particulièrement ? Mais c’est aussi un moyen pour tout un chacun de s’approprier un art, de pouvoir ramener une petite partie du musée chez soi. Le terme boutique-souvenir présente bien cette volonté de revivre au travers d’un objet acheté, de façon certes très lacunaire, l’expérience de la visite. On y voit là cette volonté assez universelle de devenir propriétaire de ce qui nous plaît avec ces objets-souvenirs que l’on emporte dans notre intimité. Le visiteur devenu consommateur digère, d’une certaine manière, l’expérience muséale par l’achat d’un produit dérivé. Céline Schall parle en 2015 de ces seuils comme des “espaces de méditation”, propices à la métamorphose du passant en visiteur, la boutique propose dans ce cas un chemin inverse, le retour au monde réel.
Des objectifs flous où le profit éclipse parfois la cohérence muséale
Ce prolongement n’est plus seulement physique, mais également virtuel depuis quelques années, renforçant les dynamiques consuméristes vers lesquelles se tournent de plus en plus d’institutions. Il n’est plus question de lieu de transition mais d’un véritable commerce avec l’explosion des sites en ligne à la suite de la crise du Covid-19. Cela permet de toucher un public différent sans même qu'il ait à venir sur place et assure une stabilité dans les recettes du musée indépendamment des événements. Cependant, les recettes de la boutique restent souvent un moyen d’auto-financement non négligeable pour ces établissements publics qui connaissent des mises en tension toujours plus fortes de la part des politiques culturelles de l'État et autres coupes budgétaires. Que ce soit pour le musée ou ses visiteurs, chacun s’y retrouve, au Centre Pompidou, par exemple, les ventes de produits dérivés s'élèvent à un demi-million. Et avec une bonne stratégie marketing, les recettes peuvent atteindre des records : la Réunion des Musées Nationaux (RMN) enregistrait des recettes de plus de 55 millions d’euros pour ces 34 boutiques en 2019.
Bien que la boutique se veuille un rayonnement vers l’extérieur du musée, de nombreuses critiques sont soulevées par les professionnels, comme Monique Renault qui, dans son travail sur les seuils des musées, se désole de l’envahissement du musée par la culture marchande. Le Quotidien de l’art relate les propos de Marianne Lesimple à la RMN « Nous cherchons à avoir une visibilité en dehors de notre public captif. Mais peut-être avons-nous trop pêché en nous concentrant exclusivement sur le tourisme… La crise a montré que les musées sont devenus des pourvoyeurs de cadeaux : les objets de décoration et activités ludiques pour les enfants ont pris beaucoup d’ampleur ». Ces paroles soulèvent une autre potentielle critique pouvant être apposée à ce modèle, la redondance de certains articles que l’on retrouve dans la majorité des magasins des grandes institutions. On peut alors questionner la pertinence de leur présence. La boutique apparaît dans ce cas, comme une filiale commerciale proposant seulement ce qui se vend le mieux et en oubliant la cohérence avec le musée, son identité et ses collections. Bien que André Gob et Noémie Drouguet assurent que « La personne chargée de ce marketing usuel veille à ce que ces services annexes constituent réellement un apport financier pour le musée, tout en garantissant un choix de produits cohérents et compatibles avec l'image du musée ». Comme au musée Toulouse-Lautrec où on revendique que « Chaque pièce est l’occasion de mettre en avant une œuvre ou un personnage de Lautrec, toujours choisi avec soin par l’équipe pour plaire au plus grand nombre ». Mais il existe une autre réalité, notamment dans les établissements les plus touristiques où l’on vend ce qui plaît, n’ayant parfois plus vraisemblablement de lien avec la culture, comme les produits dérivés d'œuvres ne faisant même pas partie des collections. Cela peut s’expliquer entre autres par l’externalisation des tâches annexes du musée comme l’accueil, la restauration ou la boutique.
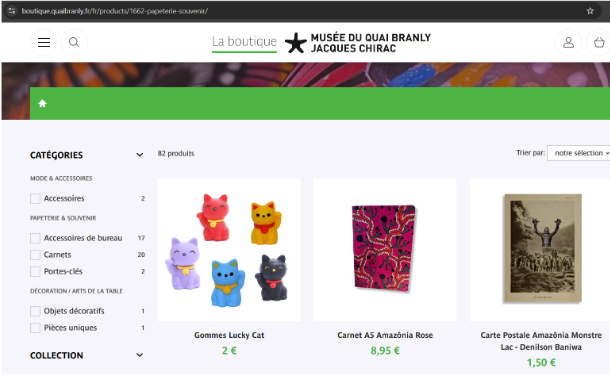
Capture d'écran de la boutique du musée du quai Branly - Jacques Chirac ©VDLG
Bien que les professionnels des musées se targuent de discours raisonnés, pleins de belles intentions, tout est marchandé dans une société où les enjeux environnementaux devraient nous pousser à sortir de cette logique de (sur)consommation, vers une “décroissance”. Peut-être que les œuvres doivent rester parfois au musée plutôt que d’être copiées en exemplaires infinis à emporter partout avec soi, geste qui renforce des hiérarchies en faveur de chefs-d’œuvre incontournables.
Violette Dupont-- Le Golvan
“Pour en savoir plus” :
- BIANCO Octavie, Les boutiques de musées, nouveaux marchands du temple ou auxiliaires de la culture ? Les boutiques de musées au prisme de l’expérience de visite, Sciences de l’information et de la communication, 2019.
- GOB André, DROUGUET Noémie, La muséologie - 5e éd. Histoire, développements, enjeux actuels, Armand Colin, 2021.
- RENAULT Monique, « Seuil du musée, deuil de la ville ? », La Lettre de l’Ocim, 2000.
- SCHALL Céline, « De l’espace public au musée. Le seuil comme espace de médiation », Culture & Musées, 25, 2015, pp. 185-206.
#ExpérienceVisiteur #Consommations #Souvenirs

Musée des Illusions : un musée qui porte bien son nom ?
Faux musée, attrape touriste, fastfood de la culture, arnaque… Bien des surnoms me viennent en tête après avoir visité le Musée des illusions, mais je ne le qualifierais surement pas de musée.
Photo du parcours de visite ©A.S.
Un nom plus que discutable
Selon la nouvelle définition de l’ICOM parue en août 2022, “Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. » L’autoproclamé « Musée » des illusions imite la structure muséale dans sa forme : une billetterie, un parcours de visite, des cartels, une boutique… mais en vérité, il est bien loin d’un musée tel qu’il est défini aujourd’hui.

Photo du parcours de visite ©A.S.
Faisons la liste :
- il n’y a pas de collection, il n’y a donc aucune mission de conservation ou valorisation.
- s’il donne à voir des illusions, les explications sont très limitées voire inexistantes donc le rôle éducatif est presque réduit à néant.
- ils (au pluriel) n’existent qu’à but lucratif !
De la définition du musée, ne reste que le divertissement. Nous pouvons alors nous demander : quelle différence avec une simple attraction touristique ? Aucune. Il existe uniquement pour des raisons lucratives. Et ce à travers le monde.
Un champ de franchises fleurissant
Il s’agit en effet d’une franchise qui pollue le paysage culturel de nombreux pays et de nombreuses villes. Il suffit d’observer la liste sur leur site.

Capture d’écran du site du musée montrant toutes les localisations
Il en existe un dans toutes ces villes :
Athènes, Belgrade, Bruxelles, Budapest, Busan, Le Caire (cairo), Dallas, Doha, Dubai, Hambourg, Istanboul Istiklal et Anatolia, Kansa City, Kuala Lumpur, Lyon, Maastricht, Madrid, Milan, New Delhi, New York, Orlando, Paris, Philadelphie, Riyadh, Seville, Shanghai, Stuttgart, Split, Taichung, Tbilisi, Tel Aviv, Thessaloniki, Toronto, Vienne, Zadar, Zagreb
S’ajoutent à la liste ces derniers qui sont en cours de création :
Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Denver, Dublin, Dubrovnik, Houston, Las Vegas, London, Mall of America, Manchester, Marseille, Melbourne, Montréal, Nashville, Rome, San Diego, Scottsdale, Seattle, Sydney, Valence, Washington
Comment ça marche ? Pour la maudite somme de 40 000€ vous pourriez ouvrir un musée des illusions, avec un business plan tout prêt établi. Par la suite il suffit de reverser mensuellement 15% des recettes au propriétaire du concept. Les tarifs d’entrée compris entre 12 euros pour les enfants et 18 euros pour les adultes en font un investissement particulièrement rentable.

Photo du parcours de visite ©A.S.
Il suffit de trouver le lieu, même s’il n’est pas propice apparemment. C’est du moins le cas de la version parisienne qui se déroule sur deux étages particulièrement étroits. Les tranches horaires de visites sont en théorie instaurées pour garantir un confort de visite en limitant le nombre d’entrées selon la capacité d’accueil. Mais malgré cela, la circulation est compliquée. Il est presque impossible de suivre le parcours de visite tel qu’il a été pensé sans avoir l’impression de faire constamment la queue. Serait-ce une simple stratégie marketing pour créer la demande ?
Un contenu creux

Photo de « cartels » ©A.S.
Le sujet de l’illusion semble pourtant aux yeux des muséographes être du pain béni puisqu’il est propice à l’implication physique du visiteur et de ses sens. Il permet d’aborder les lois de la physique, la logique d’espace ou encore les neurosciences et l’optique. Ici, toutes les « explications » ne font que décrire l’observable, restent à l’effleurement de la surface.


Photo d’expôt ©A.S.
Les effets d’illusions sont encadrés et accrochés comme des tableaux accompagnés de simples cartels écrits mais pauvres en contenu. À travers tout le parcours, seul un schéma permet d’aller un peu plus loin dans le contenu mais celui-ci est peu alléchant. Trop scientifique, trop complexe, trop long, les visiteurs passent sans le lire.

Photo des manipes ©A.S.
En guise de manip, trois petits casse-têtes sont laissés à disposition sur une table sans explication. L'utilité de ces derniers est-elle de faire comprendre un mécanisme, de transmettre une idée ou un contenu ? Non. Leur seule utilité est de donner envie de les acheter dans la boutique en sortant.

Photo des manipes ©A.S.
Ce qui captive le plus le public dans ce lieu sont les espaces photo qui ponctuent la visite. A chaque fois, il est possible de se mettre en scène de façon différente et de se prendre en photo. Certaines mises en scène présentent un intérêt scientifique qui n’est nullement exploité (encore une fois) et d’autres ont pour seul but de faire une photo rigolote.
Le musée des illusions, s’il donne l’illusion d’un musée, n’en est véritablement pas un. Il n’en a ni les missions, ni les intentions. La critique principale exprimée ici concerne le flou créé par l’appellation « musée ». Ce mot évoque un ensemble de choses au visiteur qui ne sont pas applicables dans ce lieu. Et ce lieu, à défaut d’être le lieu de culture, comme il tente de le suggérer, est simplement un lieu de divertissement et de consommation.
Aimé Sonveau
Pour en savoir plus :
- Si vous souhaitez prendre un billet : https://museedelillusion.fr/
- Si vous souhaitez ouvrir votre propre « Musée des illusions » : https://www.museumofillusions.com/
#illusions #photo #arnaque

Musée en miniature : la maquette dans l’institution muséale
Dans le cadre de deux expositions en 2021/2022 – respectivement Échelle et volume, la maquette d’aujourd’hui (Musée du Compagnonnage à Romanèche-Thorins (71), du 15 octobre 2021 au 31 mai 2022), et à l’occasion du festival de littérature jeunesse Des histoires pour l’histoire, une exposition sur « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » (du 1er au 27 octobre 2021 au Temps des Cerises à Issy-les-Moulineaux (92)) – la maquette est à l’honneur. Si l’une présente le métier de maquettiste, aujourd’hui considéré comme artisanat d’art, l’autre évoque les différentes casquettes de Léonard de Vinci, et notamment celles de l’ingénieur et du concepteur de machines. À la fois objet de médiation mais également thème d’exposition, la maquette a une place de choix dans les musées et autres institutions muséales.
L’origine de la maquette
À l’origine, ce n’était pourtant pas tout à fait son dessein premier. Née durant l’Antiquité, notamment au travers de jouets sumériens, une maquette comme l’indique la définition du CNRTL, est un « Modèle réduit à trois dimensions, respectant les détails et les proportions d’un décor de théâtre, d’une construction en projet (le décor, la construction devant être réalisée suivant ces données) ». Il s’agit donc le plus souvent d’une reproduction d’un bâtiment en devenir, ou déjà existant. La maquette a donc, au départ, un aspect scientifique et technique, puisqu’elle sert à vérifier si une construction est solide, ou bien à mettre en lumière un projet autour d’une future construction. Elle sert aussi à démontrer un propos, à obtenir un nouveau point de vue sur un bâtiment ou un objet qui n’est observable que grâce à la réduction.
Avec la réalisation de figurines et de dioramas – d’autres formes d’objet entrant également dans le champ du modélisme et de la maquette – il semble approprié de reconnaître un aspect pédagogique à cette dernière. Celle-ci peut effectivement servir à enseigner ou illustrer un fait, un événement - notamment historique – à montrer l’évolution topographique d’un lieu, la situation géographique d’une ville à une date donnée ou bien encore donner vie à des batailles célèbres. Le diorama de la Bataille de Waterloo créé par Charles Laurent et exposé au Musée de la Figurine historique à Compiègne en est un parfait exemple. Le Musée des Plans-reliefs situé à l’Hôtel des Invalides à Paris ou la collection du Palais des beaux-arts de Lille constitue également un socle solide de représentations de plans militaires et techniques sur des villes ou des zones données.
Ainsi, le rôle de la maquette est – de prime abord – militaire, technique, industriel, scientifique et pédagogique. Elle a toujours fasciné, en témoigne l’existence de France Miniature à Elancourt, Italia in miniatura à Rimini ou bien encore Bekonscot à Beaconsfield au Royaume-Uni, des parcs à thèmes autour des monuments historiques mondiaux miniaturisés. Mais comme son descriptif l’indique, il n’est question ici que de parcs à thème, centré uniquement sur le divertissement et le spectaculaire. Mais il aide à voir l’intérêt vif porté à cet objet, et l’attrait qu’il peut représenter s’il est utilisé au sein d’un musée.
Comme indiqué précédemment, c’est un support pédagogique idéal pour représenter, expliquer, étudier ou promouvoir. La maquette permet de faire revivre ce qui n’existe plus (un château détruit), de rendre visible ce qui n’existe pas encore (un projet urbain) ou encore de donner à découvrir des éléments minuscules. Il semble dès lors convenir d’utiliser cet aspect pédagogique dans des lieux culturels. Ce passage sur la miniature dans l’ouvrage La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique dirigé par Evelyne Thoizel et Isabelle Roussel-Gillet tend à corroborer cette idée: «Le modèle réduit permet ainsi d’accéder à une autre forme d'intelligibilité en modifiant l’échelle de la représentation. Dans bien des musées d’archéologie ou d’histoire de la ville, une maquette, modèle réduit d’un bâtiment, est le passage obligé de la visite guidée. Elle offre un potentiel de rassemblement pour les médiations, afin que les visiteurs puissent se grouper autour d’elle et la voir ensemble. Le guide l’utilise pour leur donner des repères, des connaissances historiques sur l’architecture et les évolutions d’un bâtiment. La maquette comme dispositif interactif est alors au service de la compréhension scientifique » (Introduction).
Maquettes de l’exposition Les drôles de machines de Léonard de Vinci. Crédits: PT
Fac-similé de boucle de ceinture par Michel Campana. Crédits: PT
L’imaginaire au service du discours scientifique
Si la maquette a une fonction plutôt technique au départ, elle trouve également sa place dans les musées et autres institutions muséales. L’article de Daniel Jacobi intitulé «La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques», qui est sous le prisme de l’exposition archéologique plus particulièrement, explique pourquoi un objet censé servir un but professionnel ou militaire est capable de servir une exposition, et pourquoi il y parvient aussi aisément. Si la maquette s’insère facilement dans un espace muséal, c’est qu’elle fait la part belle à l’imaginaire au sein d’un espace scientifique et historique. Support de médiation, elle permet d’expliciter un propos, de le démontrer tout en conservant un aspect ludique. La maquette ramène le visiteur à l’enfance, au jeu, à une part peut-être de spectaculaire, divertissant mais pour servir un propos scientifique. Cette recrudescence de l’usage de maquettes dans l’institution muséale provient, selon Daniel Jacobi, de l’arrivée de l’exposition temporaire lors de la refonte des musées durant les années 1980. Elle serait la première instigatrice de l’imaginaire au sein d’un discours muséographique. Dans son article, l’auteur explicite cette dimension scientifique de l’objet : « En tant qu’artefact muséographique, la maquette est sans aucun doute un dispositif pertinent pour donner à voir l’une des facettes majeures du discours scientifique archéologique : la reconstitution des édifices détruits et du mode de vie d’une civilisation disparue. Il permet, non seulement, de tester la validité d’une hypothèse scientifique […] mais aussi de la matérialiser concrètement ».
Il explique ensuite pourquoi il peut s’agir d’un dispositif muséographique attrayant et performant : « La maquette est une forme populaire. Plus encore, elle provoque une réaction presque jubilatoire en ce qu’elle évoque l’univers du jeu. Séduisante et attractive, elle suggère une posture de reconnaissance ludique et active. On l’observe, la commente, l’interprète comme une sorte d’énigme dans laquelle la solution est cachée. Et comme toute situation de jeu, la maquette incite à s’impliquer. Elle est en cela susceptible de devenir un support fantasmatique puisqu’elle est généralement associée, chez le visiteur adulte, aux souvenirs de l’enfance et à l’expérience d’une certaine liberté interprétative.». Dès lors, la faculté d’une maquette à communiquer et promouvoir, par exemple, un projet architectural en devenir se retrouve aussi dans une exposition muséale, où elle dévoile sous un nouveau jour ou tel qu’il a pu être un bâtiment ou une ville qui ne sont plus. Déchiffrable assez spontanément, elle est, pour reprendre les termes de Bourdieu, un art moyen. Il suffit de l’observer comme une saynète, d’en faire quasiment l’expérience empirique pour en comprendre, au moins une partie, l’interprétation scientifique dont on l’a imprégnée. Elle narre quelque chose visuellement. Elle donne également à voir l’objet original – sous sa forme réduite – comme un bâtiment sous un autre format, et on peut observer dès lors son organisation structurelle.
Elle se révèle ainsi comme un puissant dispositif cognitif : mettant en évidence ce qui est invisible, les détails qui semblent importants au maquettiste, les maquettes parviennent à illustrer de manière concrète le travail scientifique de l’exposition pour laquelle elle est utilisée. Par sa représentation de scènes, de monuments, de villes disparues ou appartenant au passé, la maquette matérialise et rend concret une hypothèse, un questionnement scientifique. L’exposition qui, pour Daniel Jacobi, est un nouveau média, permet aux chercheurs comme aux novices de s’approprier la maquette, s’approprier ce qu’elle retransmet. Ils se retrouvent conjointement autour du modèle réduit, qui est un plaisir partagé, un plaisir de l’enfance, plaisir qui se retrouve par ailleurs dans l’art de concevoir des modèles réduits – la confection de ces objets est devenu un loisir, un passe-temps pour nombre de personnes. Les maquettes ne sont après tout, selon l’auteur, « […] que de fragiles et éphémères constructions archéologiques imaginaires ».
La maquette, cœur d’expôt(sition), ou la maquette aujourd’hui
La maquette rentre donc aisément dans le champ muséal pour sa facilité à être comprise rapidement et à être un support de médiation. Tout d’abord, il convient de distinguer trois sortes de maquettes grâce aux éléments glanés précédemment. Il y a d’abord la maquette d’architecture, celle évoquée en première partie, qui est une œuvre d’art – et qui est exposée en tant que telle – et met à distance le visiteur, qui se contente de l’observer sans pouvoir la toucher. Ensuite, il existe la maquette conçue expressément pour la médiation comme la maquette de port fictif au musée portuaire de Dunkerque, qui permet aux visiteurs de découvrir comment fonctionne un port et son aménagement si particulier puis d’imaginer et construire à leur tour un port fictif et idéal. La Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais présente également une maquette du lieu qui montre la Cité telle qu’elle était auparavant et son évolution jusqu’à son apparence actuelle grâce à des éléments amovibles. Ce style de maquette s’explicite grâce à un médiateur qui en fait l’usage, la rend ludique tout en apprenant à son interlocuteur des données scientifiques, souvent à destination du jeune public. Enfin, il y a la maquette à actionner seule sans médiateur, et qui trouve sa place également dans le musée. Elle est alors considérée comme une manipe.
Dès lors, il apparaît évident que c’est un support modelable, malléable et qui rentre parfaitement dans le cadre muséal. Deux études de cas peuvent étayer ce propos : l’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci », qui fut exposée à la médiathèque Micro-Folie Le Temps des Cerises d’Issy-les-Moulineaux, et les maquettes du Musée portuaire de Dunkerque, où le nombre de modèles réduits conséquent, donnent à voir des méthodes de médiation variées.
L’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » comprend trois axes de contenu. Tout d’abord, une présentation des « Machines de Léonard », conçue par les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF-CVL), avec le concours de la Région Centre –Val de Loire grâce à des kakemonos. Puis, l’espace central d’exposition, situé sous une verrière, avec une série de maquettes et de fac-similés d’objets de travail et d’instruments qu’utilisait ou concevait l’artiste ingénieur toscan. Ces maquettes sont réalisées en bois par Claude Picoux, un ancien ingénieur devenu maquettiste à la retraite, ainsi que les instruments et mécanismes reconstitués de Michel Campana, réalisés en métal le plus souvent. Tous deux passionnés par Léonard de Vinci, leurs travaux respectifs sont mis au centre de l’exposition, où la muséographie présente et visualise réellement, et du mieux possible, les machines reproduites ou dessinées par l’artiste italien. Fondées sur les carnets de croquis de ce dernier, elles rendent vivantes les constructions de Léonard de Vinci. Lors des visites, les maquettes étaient utilisées (certaines sont amovibles et leurs mécanismes pouvaient réellement fonctionner) pour le plus grand plaisir des spectateurs de tous âges tout en expliquant comment elles ont été fabriquées et quelles machines elles représentaient. Ainsi, elles sont à la fois supports créés pour la médiation, objets pour illustrer une machine ayant ou n’ayant pas existé et expôt, puisqu’elles trônent au centre de la structure culturelle, et en deviennent dès lors des objets de collection.
L’autre étude de cas concerne le musée portuaire de Dunkerque, à la panoplie de maquettes de bateaux. Elles sont expôts, objets de collection au cœur de l’exposition mais aussi objets de médiation. Elles représentent des tranches de vie (il y a également des dioramas de moments de vie dans le port) avec des petits personnages dessus mais sont également des répliques de bateaux ayant navigué. Ces modèles réduits reproduisent fidèlement l’objet de départ – ou le faisant croire – et émerveillent le visiteur par son aspect ludique.
Toutefois, si ces maquettes rendent l’exposition ludique et bénéficient d’une médiation – en particulier celles de l’exposition sur les machines de Léonard de Vinci – elles restent tout de même des objets exposés sans réelle médiation pour les maquettes de Dunkerque. Par ailleurs, le trop plein de maquettes finit par desservir le propos ou surcharger le parcours visuel pour le visiteur.
Dès lors, s’il est vrai que la maquette peut offrir une médiation, son aspect ludique peut tout autant être moteur et frein à la compréhension. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’elle constitue la figure centrale d’une exposition. Le propos qu’elle sert ne peut être compris sous toutes ses coutures qu’à travers une explicitation de son fonctionnement. Mais étant souvent considéré comme un objet d’art, cet accès ne lui est, dans la majorité des cas, pas permis. Pour exploiter son potentiel à son maximum, la maquette doit peut-être se réinventer, et pousser ses capacités à être saisi à bras le corps par le visiteur en tant que manipe à son paroxysme. Elle ne serait plus seulement objet de médiation, ou objet de collection exposable mais partie intégrante de l’expérience de visite, sous toutes ses formes.

Maquette d’un navire au musée portuaire de Dunkerque. Crédits: PT
Pauline Tiadina
Pour aller plus loin :
- La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques, Daniel JACOBI, mai-juin 2009
- « Introduction : La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique » par Evelyne THOIZEL et Isabelle ROUSSEL-GILLET, 26 avril 2018
- La vraie-fausse nature des dioramas, Clémence de Carvalho, L’art de Muser, 20 octobre 2021
#maquette #DispositifMuséographique #imaginaire
Musée en tous sens !
J’ai visité l’exposition « corps rebelles » au musée des confluences de Lyon. Afin de favoriser l’immersion du visiteur dans l’univers de la danse,le son prenait une place importante : dès l’entrée où se font entendre des bruissements de vêtements, des battements de cœurs, des mouvements de corps. Tout du long, l’ouïe est sollicitée par la musique sur laquelle se déplacent les danseurs, les paroles qu’ils prononcent sur leur pratique, ou les bruits qui émanent de leurs danses. Cette immersion est d’autant plus importante que chaque visiteur porte un casque.
Visuel de l'Exposition Corps rebelles © Jessy Bernier
Jouer sur les différents sens, offrir une nouvelle expérience au visiteur, mobilisant différentes sensations et émotions cela est à mon sens primordial dans l’exposition. La vue est le sens le plus monopolisé au musée. Le public voit les œuvres, lis les cartels, regarde les détails d’un objet, etc. Quelques musées proposent des expériences où l’on coupe ce sens afin d’utiliser les autres, mais cela est très rare, et le musée est avant tout un lieu visuel où le public vient pour « voir » des choses. La scénographie prend alors une place importante afin de mettre en valeur les objets, en les surélevant, les encadrant, les contextualisant, etc. Dans les musées de beaux-arts notamment l’expérience du beau est essentielle, un soin particulier est donc accordé à la mise en spectacle de l’objet. Mais aujourd’hui, le visuel n’est plus le principal sens sollicité au musée, ainsi d’autres éléments apparaissent dans la scénographie tel que la sonographie.
Le musée dans l’imaginaire commun est encore perçu comme un lieu de silence, dans lequel il faut rester calme et ne pas faire de bruit. Faire entrer l’ouïe au musée n’est donc pas chose commune. C’est d’ailleurs ce que précise Cécile Corbel dans son introduction à un article sur le son au musée : « Avant toute chose, je voudrais dire que j’ai trouvé « amusant » — certains diront décourageant — lorsque je faisais part de mon sujet à mes connaissances — dont des amis musiciens — de constater leur étonnement, voire leur incompréhension, quant au rapprochement des sons et de l’univers du musée »[1].
Cette démarche non évidente existe pourtant. Ainsi le son fait son apparition de manière individuelle avec les audio-guides, qui sonorisent le discours du musée. On peut aussi le trouver comme objet des collections avec par exemple la diffusion d’extraits de musique dans l’exposition. Au musée Dauphinois de Grenoble pour l’exposition Nunavik, un chant de gorge inuit était diffusé pour illustrer la pratique de ce peuple, ce chant créait aussi une ambiance sonore puisqu’il s’entendait avant d’apprendre à quoi il correspondait. L’utilisation du son comme créateur d’ambiance est un autre usage. L’ouïe est beaucoup utilisée dans les musées, bien que sa sollicitation ne soit pas évidente, le brouillage entre pistes sonores étant à éviter. Les dispositifs travaillant ce sens sont trèsintéressant car ils posent plusieurs questions. Lorsque l’on déclenche un dispositif manuellement que d’autres visiteurs peuvent entendre, ne va--ton pas les gêner ? Le son peut être invasif. Il est certes possible d’utiliser des dispositifs individuels, à ce moment-là la coupure avec les autres est plus nette. Les dispositifs avec casques ferment aux autres, ils recentrent sur lemusée, permettent l’immersion dans l’exposition mais plus l’interaction avec les autres visiteurs, ce que je trouvais dommage dans l’exposition « corps rebelle ». Il y a alors la solution des douches sonores qui ne transmettent pas le bruit à tout le monde mais qui permettent d’avoir des dispositifs individuels sans se couper des autres.
Le toucher est sûrement le 3ème sens le plus utilisé, surtout aujourd’hui avec l’apparition des écrans tactiles qui permettent plus de médiation active. A une époque le visiteur pouvait toucher à sa guise les objets des cabinets de curiosité et musée, mais les dernières années on fait des objets muséographies des objets saints, alors « prière de ne pas toucher ». De nouvelles médiations proposent de faire d’objets de collection des objets de médiation. Et de plus en plus de reproductions sont tendues aux mains des publics dans les visites. Certains musées font même pied de nez à toutes les autres institutions comme au musée de Tinguely qui propose l’exposition PRIÈRE DE TOUCHER.
Visuel de l'exposition Prière de toucher © Musée de Tinguely
Par convention le visiteur est éduqué à ne pas toucher dans le musée, même si l’envie de transgression est forte, il faut souvent indiquer la possibilité de le faire pour que le visiteur se permette d’apposer sa main sur les objets exposés. On notera qu’en dehors des dispositifs de médiation pour des publics particuliers : handicap visuel, enfant, etc., le musée a tendance à être un lieu où il faut mieux garder ses mains dans ses poches.
Enfin l’odorat et le goût sont des sens peu mobilisées dans le musée. Pourtant il existe des médiations gustatives et olfactives, mais très rare. Ces sens peuvent être au cœur de l’exposition comme lors de l’exposition Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon,sans pour autant être mobilisés. Des dispositifs permanents faisant appel à ces sens sont trop contraignants, et ils sont surtout une histoire de médiation ponctuelle, par exemple au musée portuaire de Dunkerque pour l’exposition Banane, un atelier de confection de cake avec ce fruit était proposé en médiation pour les enfants.
Bananes suscitant le goût pour l’exposition Banane © Musée portuaire de Dunkerque
Ces médiations peuvent être nommée visite sensorielle, comme au musée de La Piscine à Roubaix[2].
Les 5 sens sont donc beaucoup sollicités en médiation, peu de collections font appel à l’odorat et le goût, bien certains objets liés à ces sens soient inscrits dans notre patrimoine, comme le patrimoine gastronomique français. Il est déjà difficile de mettre en place des dispositifs faisant appel aux autres sens. Les enceintes des dispositif audio finissent par grésiller, les objets donnés au toucher s’abiment, les odeurs s’évanouissent et les aliments sont périssables. Cela nécessite donc beaucoup de contraintes, et de maintenance, mais cela n’est-il pas plus intéressant de favoriser le multi sensoriel pour que le visiteur bénéficie d’une expérience de visite optimale ?
C’est un sujet large que les 5 sens au musée, pour satisfaire au mieux la soif de connaissance sur ce qui a pu être fait, les articles du magazine de L’art de muser ont de quoi vous nourrir :
Quenelles, grattons, bugnes et autres spécialités des bouchons à l'honneur : médiation gustative
La Maison-Musée Hector-Berlioz: à voir et à entendre : médiation auditive
L'alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentationL'alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentation : médiation gustative
Un audio-guide au cœur des oeuvres
Mmmmmmmh! : médiation gustative
Au musée de Flandre de Cassel, "cette oeuvre est à toucher"
Touchez la musique!" Lancez vous dans le parcours du musée de la musique.: médiation auditive
Au musée j'ai touché...!Au musée j'ai touché...! : médiation tactile
La Nuit met nos sens en éveil! : multisensoriel
Faire l'expérience de la conservation-restauration à l'Ashmolean Museum d'Oxford : médiation tactile
La Piscine, championne de médiation : médiation olfactive
Océane De Souza
Le Musée de Tinguely propose des expositions basées sur les 5 sens.
Les médiations gustatives ou l’art de la mise en bouche. Emmanuelle Lambert : complément sur la médiation gustative
#5sens
#Médiation
#Rétrospective
[1] Cécile Corbel, « L’intégration du sonore au musée », Cahiers d’ethnomusicologie [Enligne], 16 | 2003, mis en ligne le 16 janvier 2012, consulté le 03 janvier 2017. URL : http://ethnomusicologie.revues.org/571
[2] A ce propos : http://lartdemuser.blogspot.fr/2012/10/la-piscine-championne-de-mediation.html?q=la+piscine

Musée, un naufrage annoncé ?
Musée haut, musée bas est un film de Jean-Michel Ribes, sorti en 2007, qui bien que centré sur le musée n’est pas un documentaire. Le musée devient le lieu d’une lutte entre la nature et la culture. Ce musée regroupe les signes de la culture humaine sans pour autant placer les œuvres au premier plan. L’objet ici n’est pas de faire une critique du film mais plutôt d’analyser ce que cette comédie nous dit sur le musée, ses publics, ses agents et son avenir.

Affiche du film - 2007
Le scénario présente, à travers différents groupes stéréotypés, les visiteurs du musée d’art. Le musée présenté ici est ultra généraliste puisque composé des grandes structures nationales et parisiennes (Louvre, Cité de l’Architecture, Musée Guimet, Cité de la Musique…). Le Petit Palais a été choisi pour représenter l’extérieur de ce musée dont le plan est invraisemblable, alambiqué et truffé de codes couleurs divers.
Parmi ces groupes on trouve :
- Les visiteurs en groupe, pressés, bruyants, …
- Les visiteurs individuels un peu perdus soit dans les méandres du plan soit dans l’incompréhension de ce qu’ils voient, ce qui donne lieu à des scènes loufoques, surréalistes (ou baroques).
- Les artistes contemporains qui se questionnent sur leur art ou présentent des expositions pour le moins conceptuelles ou sexuelles
- Les élus, représentés par un ministre de la culture, qui à peine arrivé au vernissage de l’exposition est déjà ailleurs, débordé par les inaugurations et les vernissages sans trop savoir évaluer la qualité de ces événements.
Sans oublier le personnel du musée : les guides qui tentent de gérer les groupes et renseigner les visiteurs ; les gardiens de salle qui ne supportent plus leur vie tellement ils sont entourés de beau ; la régisseur qui réceptionne les objets d'art primitif pour la prochaine exposition ; les ouvriers, baptisés du nom de apôtres, qui effectuent les mouvements d’œuvres.
Photogramme du film - Les gardiens de salle© David Koskas
Ce film est ponctué de jolis moments qui peuvent faire échos à des expériences de visite, à des œuvres. Si tout est présenté avec ironie et un certain goût de l’absurde, un fond de vérité est bien présent dans les points de vue qu’on peut avoir sur les musées. Intéressant à garder en tête pour les prochaines expériences muséales.
Au delà de ces petites histoires, se tisse une histoire principale, celle de la lutte, de plus en plus présente, entre la nature et la culture. Le musée subit en effet l’invasion progressive de la nature de son abord immédiat : des cygnes, des crapauds, des cafards, des végétaux puis la mer. La nature veut reconquérir ses droits alors que le musée symbolise la culture. Les peintres sont, selon les propos du conservateur de ce musée imaginaire, les garants du non retour vers l’âge des cavernes : « L’art, c’est à dire l’artificiel, nous protège du retour au préhistorique ». Et quand bien même le musée fait naufrage, il y aura toujours les rescapés de la Méduse pour aller refaire un musée ailleurs, autrement, ou peut-être seulement pas tout à fait pareil…
Photogramme du film© David Koskas
Morceaux choisis :
« Ce n’est pas un très bon exemple pour les enfants, un peintre qui se fait renvoyer dans une semaine »
« On n’sait plus trop bien qui on est, où on va, qui sont ces gens dans la rue en imperméable, quand on a trop longtemps regardé Klimt ou Man Ray. »
« Non, ce qui compte c’est ce que tu ressens après. Par exemple, il y a trois ans en sortant de l’exposition Picabia, j’étais contente, mais tellement contente qu’en rentrant à la maison, j’ai quitté mon mari. »
« Il dit qu’il ne comprend pas pourquoi, les statues africaines obtiennent toujours des papiers pour entrer dans ce pays et jamais les Africains. »
« Si elle te l’a dit, y a aucun risque, les musées en matière de bon goût c’est la garantie absolue, avec ce qui est accroché au mur, ils peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur les tasses à café »
« Ça c’est sûr qu’ils en avaient du talent les Impressionnistes ! Je n’sais pas si vous êtes déjà allé à Argenteuil, mais c’est une horreur Argenteuil. Et encore, aujourd’hui ils ont refait la place et arrangé le pont. Alors on s’imagine ce que ça devait être de leur temps. Eh bien déjà rien qu’arriver à peindre cette ville pourrie d’Argenteuil et qu’elle se trouve maintenant dans un musée, chapeau bas les Impressionnistes ! »
« C’est l’opposé madame, c’est une création. Ce n’est pas quelqu’un qui disparaît, c’est quelqu’un qui apparaît, l’envers exactement, l’envers du crime. »
« Si on a un sens, Sulku, est-ce qu’on sera encore de l’art ? » (Sulku, œuvre d’art / performeur)
Coralie Galmiche
#cinéma
#image du musée
#publics

Musées dans le métro
Doukevienlafiche ? Mais que vois-je ? Dans les couloirs du métro, Orsay a ressorti ses affiches, créée par l’agence Madame Bovary en octobre 2015.
Elles n’annoncent pas une nouvelle exposition, un événement, non elles incitent les citadins à revenir user leurs savates dans l’ancienne gare. Plus, elles appellent les parents à venir éduquer leur progéniture. Le musée, lieu d’éducation et de délectation. C’est le meilleur moyen de fidéliser un public, montrer dès l’enfance que le musée n’est pas (plus ?) un lieu poussiéreux et ennuyeux (enfin, pas tous), un lieu non scolaire (quoique les visites de primaires tendent bien souvent à n’en faire qu’une extension de l’école, où l’on y suit les mêmes règles : s’asseoir et écouter, lever le doigt, ne pas parler, ne pas courir, ne pas rire…), un lieu où l’on s’amuse.
Mais assez sournoisement, ces slogans confortent les théories de Bourdieu :« Toute la tradition culturelle des pays de vieille tradition s’exprime en effet dans un rapport traditionnel à la culture qui ne peut se constituer dans sa modalité propre, avec la complicité des institutions chargées d’organiser le culte de la culture, que dans le cas où le principe de la dévotion culturelle a été inculquée, dès la prime enfance, par des incitations et les sanctions de la tradition familiale.[1] » La tradition familiale, déterminisme social de la fréquentation des lieux culturels.J’ignore si des études ont été menées pour évaluer la portée de cette campagne publicitaire, mais la fréquentation du musée a-t-elle vu déferler des vagues de familles primo-visiteurs ? N’était-ce qu’une piqûre de rappel pour les nouveaux parents (anciens enfants visiteurs, de fait), qui déjà fréquentent régulièrement les musées ?
Il y a quelques semaines, les trente années du musée d’Orsay ont été fêtées par la floraison de plusieurs nouvelles affiches aux slogans alléchants : mettez vous sur votre 31 et Aucune tenue n’est exigée (ou presque). Robe de soirée ou nu artistique, on n’est pas loin du Venez comme vous êtes d’une certaine chaîne de malbouffe institutionnalisée… mais le message sonne étrangement faux lorsque le musée est éclaboussé à la même période par plusieurs sorties manu militari de classes de banlieue et de familles défavorisées[2] qui viennent contredire le message d’ouverture baba cool si lyriquement annoncé. Sans même parler de l’artiste Déborah de Roberti, expulsée par deux fois du musée pour s’être allongée nue[3] devant L’Origine du monde et l’Olympia.
Les opérations de comm’ cherchent à attirer de nouveaux publics, moins enclins à passer leurs après-midi pluvieuses devant des Kandinsky ou des cathares grecs. La mise en place d’une carte pass étudiant au musée Fabre de Montpellier a été l’occasion de lancer à la rentrée de septembre une opération de séduction pour le public étudiant. Ces deux visuels diffusés uniquement en ligne jouent sur la même corde décalée que le musée d’Orsay, le musée étant aussi un lieu des premières sensations émoustillées (moi même...).
L’idée venant du musée a été soumise à une agence. Celle-ci a réalisé une petite étude du public et proposé plusieurs pistes, soumises à la Métropole dont dépend le musée avant validation. La diffusion sur les réseaux étudiants, universitaires, ou via les réseaux sociaux a ses limites, sans compter la pudibonderie aberrante de Facebook qui a censuré ces deux floutages au motif de caractère tendancieux. (Cette opération de censure d’œuvres au nom de la peau dévoilée, de ce sein que la bienséance ne saurait voir et qui vise au systématisme – on ne compte plus les photos de fontaines baroques, tableaux et sculptures centenaires interdites de séjour sur le sol pas palpable d’internet– n’est pas sans évoquer l’emballage des indécentes statues antiques du Musée du Capitole afin de protéger les chastes pupilles du président iranien en janvier 2016.) Fort heureusement, après quelques semaines de blocage, ces affiches ont tout de même pu être lancées à la conquête du réseau. Il demeure cependant que ces affiches restent très discrètes et peu diffusées hors du public ciblé directement (étudiants montpelliérains), ce qui est dommage pour une campagne publicitaire.
Orsay n’a cependant pas le monopole des affiches du métropolitain. On y croise les placards annonçant de sexpositions temporaires. À venir : le Grand Palais a lancé une campagne avec un seul mot, une seule promesse : « Bientôt ». Nulle date ni titre. Le sujet n’étant précisé que sous l’excuse d’un # en petites lettres en bas. Si on reconnaît vite le Penseur, le tableau de Klimt ne touche qu’un public averti, quant à la parure indienne…
Les couloirs nous allèchent avec des expositions en cours ou presque terminées, les affiches alors dotées d’un bandeau « derniers jours » ou « prolongation », collé de biais tel une écharpe d’élu, sous entendu : « dépêchez vous de venir, mais attention il y aura du monde ! ».
Les musées en quête de publicité
Le Château de Versailles n’est pas en reste et envahit lui aussi la lumière blafarde des couloirs métropolitains pour y ouvrir des fenêtres de couleur et de soleil. Jouant, comme Orsay sur une série d’affiches avec pour leitmotiv une expression anaphorique suivie de l’emploi de l’impératif, qui n’est pas anodin et est loin d’être une nouveauté dans le domaine de la publicité, avant les variations de fin.
Un certain modèle de publicité pour musée se démarque ces dernières années. Miser sur l’humour, sur la tentation ou le besoin de vacances, bref sur le côté décontracté des institutions muséales. Se désolidariser de la poussière des salles glauques d’un vieux Louvre. Briser les barrières psychologiques dressées devant la pompe de ces lieux, nouvelle aux yeux de ceux qui ne sont pas habitués à en arpenter les allées.
L’ouverture de l’antenne de Lens jouait déjà sur cette corde (cas intéressant de publicité périssable puisque l’œuvre de Delacroix est retourné après un an d’exposition dans les galeries de peinture française du Louvre-Paris).
En fouillant un peu les archives publicitaires, on peut trouver des publicités totalement à l’opposé de cette vision, insistant sur le contenu de façon plus sérieuse, froide, distante, et sans doute plus rebutant : en 2012, le Musée de la Grande Guerre, à Meaux et la Cité de l’Immigration, à Paris, ont fait une proposition particulièrement austère, alors même que l’ouverture d’un nouveau musée ou la réouverture après une période de travaux est l’occasion de donner une identité particulière au musée et le ton de son discours. La sentence péremptoire à haute vertu pédagogique, associée à une photo ancienne noir et blanc éloignant encore davantage l’institution de la vision d’un musée moderne, vivant et dynamique et surtout comme lieu d’éducation non scolaire. Comment attirer ainsi un public peu enclin à franchir les portes imposantes d’un musée ?
Affiche du Musée de la Grande Guerre, à Meaux (2012)
Si une deuxième affiche de la Cité de l’Immigration plaçait « Ton grand-père dans un musée. » (notons la formule sans verbe, presque une apostrophe, presque une insulte délicieusement absurde), elle ne fait qu’insister sur le musée nostalgique plein de vieux albums de famille et de vieilleries poussiéreuses mais sans doute est-ce une fibre qui attire un public familial urbain, nostalgique d’un c’était mieux avant et du pittoresque des anciens métiers.
Plus récemment, en 2016, année anniversaire de nombreux musées parisiens, en particulier des dix bougies du Quai Branly (pardon, du désormais baptisé Musée du Quai Branly – Jacques Chirac), occasion d’inviter le dessinateur Riad Sattouf à réaliser l’affiche dont les traits de Bande dessinées ne sont pas sans évoquer le fétiche à l’Oreille Cassée et la pop-culture voguant sur l’esthétique de l’archéologie et des cultures non occidentales. Le médium utilisé, le personnage qui vient compléter la série (après le grand-père, voilà le gamin sous vitrine), interpellent un public plus jeune, visent même directement les enfants, contrairement à la campagne d’Orsay qui s’adresse aux parents (encore que…).
Que de raisons de se rendre au musée ! S’instruire et s’amuser, voir « des sales gosses » ou des bijoux de famille, des antiquités ou son aïeul… Encore faut-il que les musées tiennent leurs promesses.
Jérôme Politi
#affichedemusée
#sinstruirensamusant
#métro
Merci à Marion Boutellier, Chargée des publics au Musée Fabre, pour avoir répondu à mes questions.
[1] Bourdieu Pierre et Darbel Alain, L’Amour de l’art, Les éditions de Minuit, 1969, p. 65-66
[2] http://www.sudouest.fr/2016/12/09/des-eleves-de-banlieue-chasses-du-musee-d-orsay-leur-prof-s-indigne-sur-facebook-3013559-4699.php
et
[3] http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/17/nue-musee-orsay-paris-exhibitionnisme_n_9003114.html

Musées en bulles : la BD comme porte d’entrée vers les collections
VIGNETTE : Station « La salle sans fond – Une Chapelle Sixtine à l’envers » - Photo E. Brousse
Durant l’été 2021, pour l’Open Museum du Palais des Beaux-arts de Lille, le dessinateur et bédéiste François Boucq investit l’espace muséal avec son personnage Jérôme Moucherot. A l’instar de certains récits sur version papier, au musée, le protagoniste évolue dans les méandres de la jungle urbaine. Sauvagement, le parcours pensé par le dessinateur fait irruption dans la collection permanente du Palais des Beaux-Arts. Quinze stations ont été pensées par Boucq à commencer par un tunnel hypnotique dans lequel les visiteurs s’immergent dans le trait du créateur, un motif léopard en noir et blanc duquel naissent divers animaux. A sa sortie quelques mètres plus loin, les tâches félines semblent imprégner le regard du visiteur et tournoient encore sur les statues de marbres. Que se passe-t-il ? Les collections sont-elles devenues indomptables ? Non… il s’agit d’une projection (mapping) de motifs animaliers en noir et blanc sur les blanches statues. Le safari muséal peut commencer.

IMAGE 1 Station « Une mise en route déroutante – Entrez dans le vortex de François Boucq » - Photo E. Brousse
Déconcerté par cette entrée en matière, le visiteur déambule à la recherche des farces du bédéiste. Dispatchées dans tout l’espace, soit les interventions bestiales sont des outils pour mieux comprendre les œuvres d’art ou leur composition, soit elles jouent un discours méta-muséographique en moquant l’attitude des visiteurs eux-mêmes.
Installations artistiques ou dispositifs muséaux ?
Dans une salle, le long du mur, un fil bleu est tendu devant les toiles, il se positionne au niveau de l’horizon sur chacune d’entre elles et met en valeur cette ligne cruciale qui marque systématiquement toutes représentations de paysages. Entre installation artistique et dispositif muséal, ce fil permet de saisir la composition de la catégorie picturale du paysage. Plus loin, une autre station permet d’appréhender via une installation l’illusion d’optique qu’est l’anamorphose.

IMAGE 2 Station « De l’anamorphose et au-delà – Une question de point de vue » - Photo E. Brousse
Ces interventions décalées de Boucq seraient presque des dispositifs de médiation destinés à la compréhension de techniques picturales. Par ailleurs, sur un mode plus ludique, François Boucq exploite la notion de « hors-cadre ». Au pied de deux natures mortes, il fait jaillir une abondance de fruits et légumes gigantesques qui s’amoncèlent sur le sol et ravissent le nez du public de leurs senteurs grâce à un dispositif olfactif. Autour de toiles abstraites, hors du cadre, Boucq brise également les frontières entre les œuvres : il prolonge sur le mur la composition de cinq tableaux différents. Il fait se rejoindre les motifs qui finissent par former une seule et même grande composition. Il est l’artiste qui lie les artistes à travers le temps et l’espace.
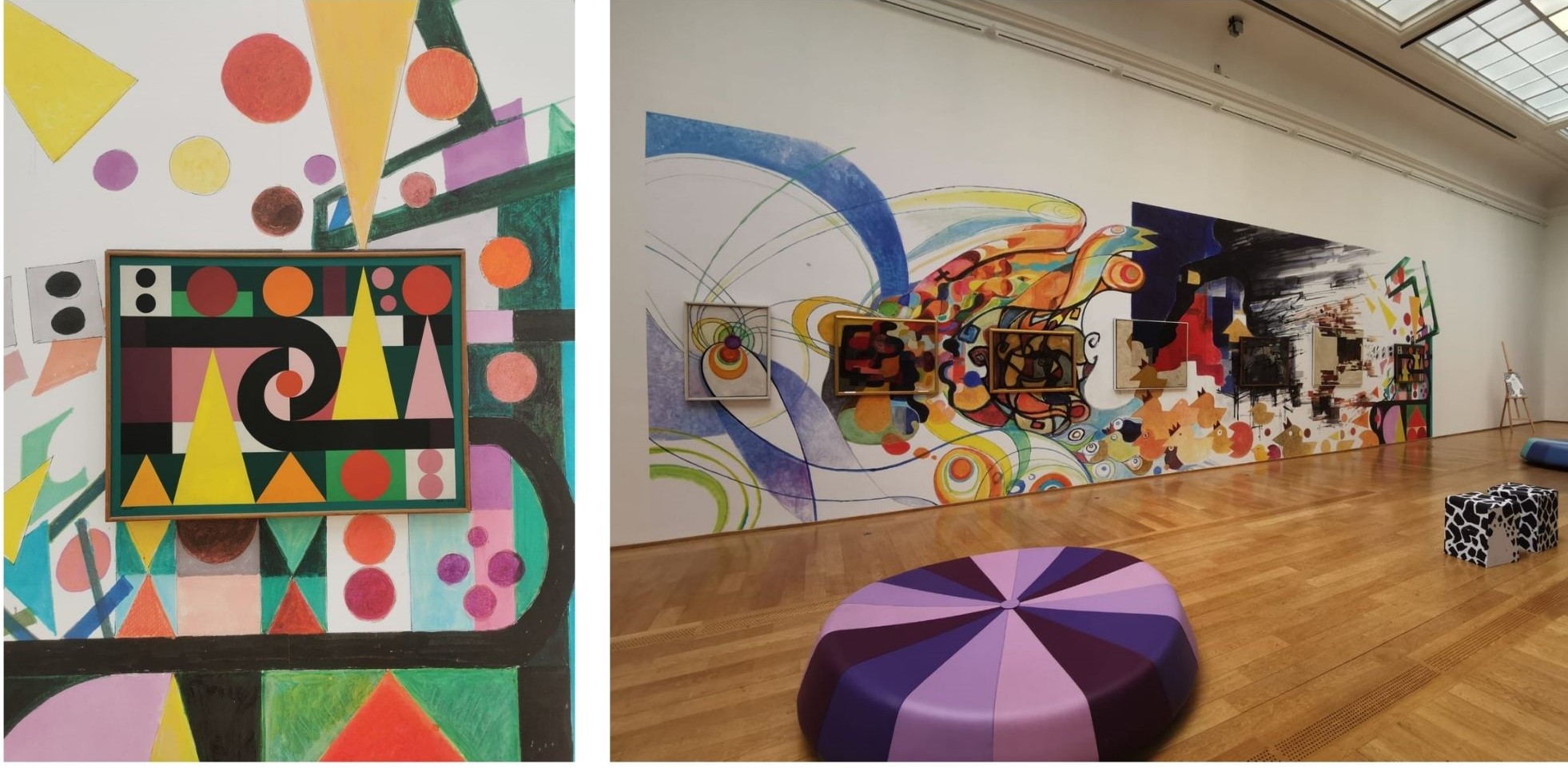
IMAGE 3 Station « Une bande dessinée de tableaux – Sortir du cadre » - Photos E. Brousse
Singer le visiteur
Ce jeu sur la composition des toiles se poursuit dans une salle réservée à la présentation de portraits. Ces derniers, selon l’illustrateur, paraissent souvent regarder le visiteur. L’effet est décuplé car les tableaux sont disposés à touche-touche (comme dans la salle des paysages), c’est donc une myriade d’yeux qui regardent le visiteur avec insistance. Au centre de l’espace, une installation tournant sur elle-même accentue davantage ce sentiment de voyeurisme puisqu’elle présente de grands cadres remplis de miroirs dans lesquels le visiteur se voit entouré des portraits. Il se photographie d’ailleurs systématiquement, dans les miroirs et joue avec ce décor. Par ce dispositif, le narcissisme du public et son attitude au musée sont gentiment moqués. Depuis deux enceintes placées aux angles de la pièce, des chuchotements (« on dirait qu’il me regarde ») se font entendre. Il s’agit de commentaires croustillants de visiteurs qui sont diffusés pour confronter le visiteur à son attitude face aux œuvres, le parodier.

IMAGE 4 Station « Se voir en peinture – Miroirs miroirs » - Photo E. Brousse
Au rez-de-chaussée, un violent bris de verre retentit dans le couloir des porcelaines. Le public cherche activement l’incivilisé qui a brisé une œuvre dans une sacro-sainte institution muséale avant de s’apercevoir naïvement que c’est encore un piège de François Boucq. Il a pris le musée pour terrain de jeu, le visiteur se retrouve confronté à son propre comportement. Il devient éléphant dans un magasin de porcelaine mais aussi singe dans d’autres espaces.
Collection de bulles
Avec cet Open-Museum, le Palais des Beaux-arts de Lille ouvre une seconde fois (la première avec ZEP lors de la troisième édition de l’Open Museum en 2016) les portes de son institution à la BD, encore trop peu présente dans les musées de beaux-arts. Le tour de passe-passe de François Boucq est une réussite ! Le bédéiste devient presque muséographe avec des dispositifs qui font réfléchir le visiteur et lui livrent des clés de compréhension sur les collections du musée. Ces dispositifs désacralisent aussi les œuvres. Pour en citer un dernier et non des moins marquants, une animation sous forme d’hologramme dans un cadre fait descendre Jésus de la Croix à partir de l’œuvre La Descente de Croix de Rubens. Un acteur vêtu comme le Christ sort virtuellement de l’œuvre pour venir s’assoir devant et interagir avec d’autres toiles. Ici, Boucq exploite encore une manière de « sortir du cadre ».
A l’occasion de cet évènement, François Boucq a fait une donation de près de 400 dessins au Palais des Beaux-Arts de Lille. Comme il le dit lui-même, c’est assez exceptionnel pour être noté car les exigences artistiques de la BD ne sont pas réellement reconnues.
Pour diverses expositions, la bande-dessinée a été la porte d’entrée vers les collections muséales. Par son graphisme et sa didactique, elle constitue un biais muséographique original. Pour citer un autre exemple hors-Beaux-Arts, l’exposition « Derrière les cases de la mission » (collaboration entre le Musée d’ethnographie de Neuchâtel et le Musée d’art et d’histoire de Lausanne) proposait une adaptation de la bande-dessinée Capitão de Stefano Boroni et Yann Karlen. Le public y poussait des reproductions de cases des planches agrandies et imprimées sur d’immenses rideaux pour accéder à une mise en scène. Derrière ces cases et par le biais d’objets ethnographiques, c’est l’entreprise missionnaire suisse au Mozambique qui était explicitée.
E. Brousse
#bd #openmuseum #lille
Pour aller plus loin
Le site du PBA de Lille: https://pba.lille.fr/Agenda/OPEN-MUSEUM-FRANCOIS-BOUCQ
Le site du Musée d’ethnographie de Neuchâtel : https://www.men.ch/fr/expositions/a-laffiche/derriere-les-cases-de-la-mission/#:~:text=d%C3%A9sinscrire%2C%20cliquez%20ici-,Derri%C3%A8re%20les%20cases%20de%20la%20mission,.2020%E2%80%9301.08.2021)&text=tels%20sont%20les%20ingr%C3%A9dients%20de,et%20d'histoire%20%C3%A0%20Lausanne.
Un précédent open museum du PBA relaté dans le blog : http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1213-open-museum-passard-une-mission-reussie

Museomix à la Manufacture des Flandres : vivre le musée différemment
Le dimanche 8 novembre 2015, la 3e édition de Museomix Nord prenait fin. Les museomixeurs laissaient leurs prototypes entre les mains de l’équipe de la Manufacture de Roubaix et retournaient à leur quotidien, loin de l’euphorie de l’événement.
Museomix, depuis 5 ans,c’est trois jours, 72 heures, un musée, 6 équipes et des esprits en ébullition. L’objectif ? Créer un prototype de médiation innovant qui parle à tous. Comment ? Les museomixeurs disposent d’un grand nombre d’outils : découpe laser, imprimantes 3D, hologrammes, tablettes, écrans, rétroprojecteurs, matériel informatique et bien sûr du bois, de la peinture et une menuiserie est mise à notre disposition. Toutes les conditions sont réunies pour qu’il n’y ait aucune limite à notre créativité.
Pour commencer, les museomixeurs visitent la Manufacture ou plutôt le Musée de la mémoire et de la création textile de Roubaix. Des métiers à tisser de toutes époques sont mis en mouvement sous nos yeux. De la pédale, à la machine à vapeur jusqu’à l’électricité, de la navette à la lance ou encore du jacquard au système informatisé, le musée nous propose de découvrir l’évolution de l’industrie du textile. Une fois les marques prises dans les lieux, les équipes se forment autour de 6 grandes thématiques dont Tissu / tissage ; Métier(s) ; Mémoire/patrimoine ; Le futur /demain/ innovation ; Maillage/ territoire ; Collecter /connecter / recycler et Usine/machine, celle vers laquelle je me suis tournée.
© C.B.
Du fil au motif
Un coach, un médiateur, un chargé des contenus, un codeur, un graphiste et enfin une bricoleuse (moi !) se regroupent autour des mots Usine et Machine pour se lancer dans une journée de discussions, de débats mais surtout d’échanges d’idées du Jacquard. Inventé en 1801 par Joseph Marie Jacquard, le Métier Jacquard permet la réalisation de motifs de façon automatique. Pour cela, les métiers sont équipés d'un mécanisme qui sélectionne les fils de chaîne grâce à un programme inscrit sur des cartes perforées. Basées sur un système binaire, les cartes jacquard vont permettre de créer des motifs allant du simple losange au plus complexe des ornements. Aussi fascinant que soit ce procédé, son fonctionnement est difficile à comprendre, d’avantage du fait que tout se passe au sommet des machines, c’est-à-dire à quelques mètres au-dessus de nos têtes.
La volonté d’expliquer le métier Jacquard au public fédère l’équipe. Dès le samedi matin, les débats reprennent sur la forme que prendra notre prototype et plusieurs pistes apparaissent. Pourquoi ne pas présenter le Jacquard à travers le son ? En effet, l’orgue de barbarie produit de la musique en utilisant un procédé mécanique qui fonctionne à l’aide de papier perforé comme le jacquard. Autre idée ? Le visiteur actionnerait un métier jacquard virtuel à l’aide d’un système permettant d’interagir par la reconnaissance de mouvements. Des problèmes de réalisation technique surviennent rapidement et rendent ces idées non réalisables.
Un visiteur aux commandes
Ce que nous souhaitons absolument retrouver dans notre futur outil de médiation est la manipulation du visiteur. Nous considérons que pour faire comprendre le procédé du jacquard au public, ce dernier doit réaliser son propre motif en actionnant lui-même le système jacquard. Nous pensons alors à ramener la partie supérieure du métier à tisser à hauteur du regard du visiteur afin que ce dernier puisse le manier.
Avec l’aide d’un ancien travailleur du textile, nous réfléchissons au mécanisme à mettre en place et le concept prend forme au fil des échanges et des croquis. En parallèle, le contenu explicatif s’élabore entre la graphiste la médiatrice et la chargée du contenu. Logo, vidéo de présentation et tweeter se mettent également en place pour présenter à tous La mini-jacquard. À la fin de la journée les plans définitifs sont réalisés, les mesures sont décidées et la liste des matériaux est rédigée avec l’aide du menuisier. Le principe du prototype sera donc de soulever les fils désirés grâce à des crochets qui seront introduits dans les trous supérieurs de la machine et de la carte jacquard. Une fois les fils disposés, il suffit de passer la navette entre ceux-ci et le motif apparaîtra peu à peu.
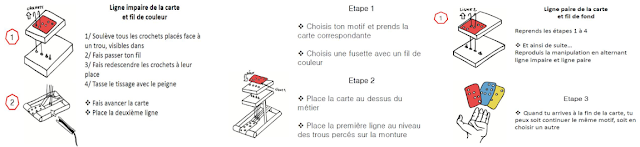 © C.B.
© C.B.
« Merci, j’ai enfin compris ! »
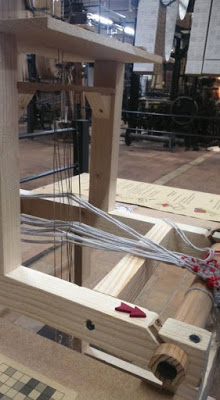 © C.B.
© C.B.
Le troisième et dernier jour est consacré à la construction de la « mini jacquard » et à la réalisation graphique des contenus. Scier, percer, coller, clouer, visser, petit à petit le jacquard prend forme et des tests sont régulièrement réalisés pour s’assurer de la faisabilité du prototype. Cette dernière journée est une course contre la montre, dès 14h, les prototypes doivent être disposés dans le musée et être prêts à passer au crashtest.Nous devons régler les derniers détails et préparer nos discours pour l’arrivée du public.
L’installation se fait rapidement, c’est à cet instant que certains problèmes techniques apparaissent : un fil pas assez tendu ou encore des aiguilles difficiles à manipuler. Mais nous n’avons plus le temps d’y remédier car dès 15h les visiteurs affluent. Toute l’équipe se transforme alors en médiatrice afin de présenter le fruit de ce marathon créatif, passionnant et exigeant. Le public est attentif, il nous écoute, pose des questions, manipule et quel plaisir d’entendre « Merci, j’ai enfin compris ! ».
C.B
Pour en savoir plus :
http://www.lamanufacture-roubaix.fr/
#Museomix
#Roubaix

Muséonérique, le réveil des collections au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
A l’occasion de son bicentenaire, le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille propose aux visiteurs de découvrir ses coulisses. En effet, les missions du musée, notamment celle liées à la conservation des collections sont mal connues du grand public, et pour cause, peu de communication est faite à ce sujet. L’exposition Muséonérique comble un vide et offre à mon sens un vrai moment de découverte aux visiteurs.
Elle a été conçue et réalisée en partenariat avec La Fabulerie, lieu marseillais regroupant des acteurs qui œuvrent au renouveau des structures culturelles et facilitent leur accès au numérique.
Dans les vitrines, on peut admirer la variété et la richesse des collections d’un muséum : animaux naturalisés, secs, conservés en bocal, mais aussi des herbiers, des minéraux...

© C. L
Gérer les collections d’un musée demande beaucoup de compétences différentes, autant de métiers souvent peu connus en dehors de ses murs... Pour en apprendre un peu plus sur le travail du taxidermiste, une vitrine montre ses différents outils : mannequins en forme d’animal à habiller, yeux en verre, instruments pour sculpter, cordelette pour modeler les veines de l’animal,… Il est même possible d’entendre le témoignage d’un taxidermiste à travers le combiné d’un téléphone. Son travail ne consiste pas simplement à fourrer de la paille dans une peau d’animal, il faut rendre le spécimen le plus réaliste possible, chaque détail est important. Cela signifie aussi que le taxidermiste doit avoir de bonnes connaissances en zoologie !

© C. L
Les réserves d’un musée, c’est aussi des “croûtes”, des objets pas très jolis, pas très bien conservés, des curiosités. En témoignent les spécimens exposés dans un espace aménagé à l’image d’un salon. Ici, de la paille dépasse d’un flamant rose bien fatigué et plus loin, un pauvre cerf est affublé d’un énorme clou sur le front. Vous pourrez même les entendre se plaindre grâce à un dispositif sonore dans lequel ils narrent leur histoire au musée.
Un casque de réalité virtuelle permet d’en découvrir l’intérieur des réserves, espace d’habitude dissimulé et jalousement gardé le personnel du musée… On peut ainsi apercevoir un grand nombre de spécimens sagement rangés sur des kilomètres d’étagères. À cela s’ajoute un commentaire audio qui indique les conditions nécessaires pour préserver les fragiles collections.
En plus de ce casque, de nombreux dispositifs interactifs rythment le parcours de l’exposition. Du côté des insectes, vous serez invités à vous asseoir derrière un bureau en bois ancien pour créer votre insecte : choisissez le corps, les pattes, les antennes,… Une manière ludique de découvrir toutes les formes que peuvent prendre les petites bêtes. Plus loin, sur une table où le couvert est dressé pour un dîner, composez votre propre assiette à partir des aliments présents dans les réserves du Muséum.

© C. L
Plusieurs dispositifs sonores jalonnent l’exposition, dont un qui donne la parole à des spécimens du musée. Mettez un casque et faites la connaissance de l’ours brun, de la marmotte ou du puma.
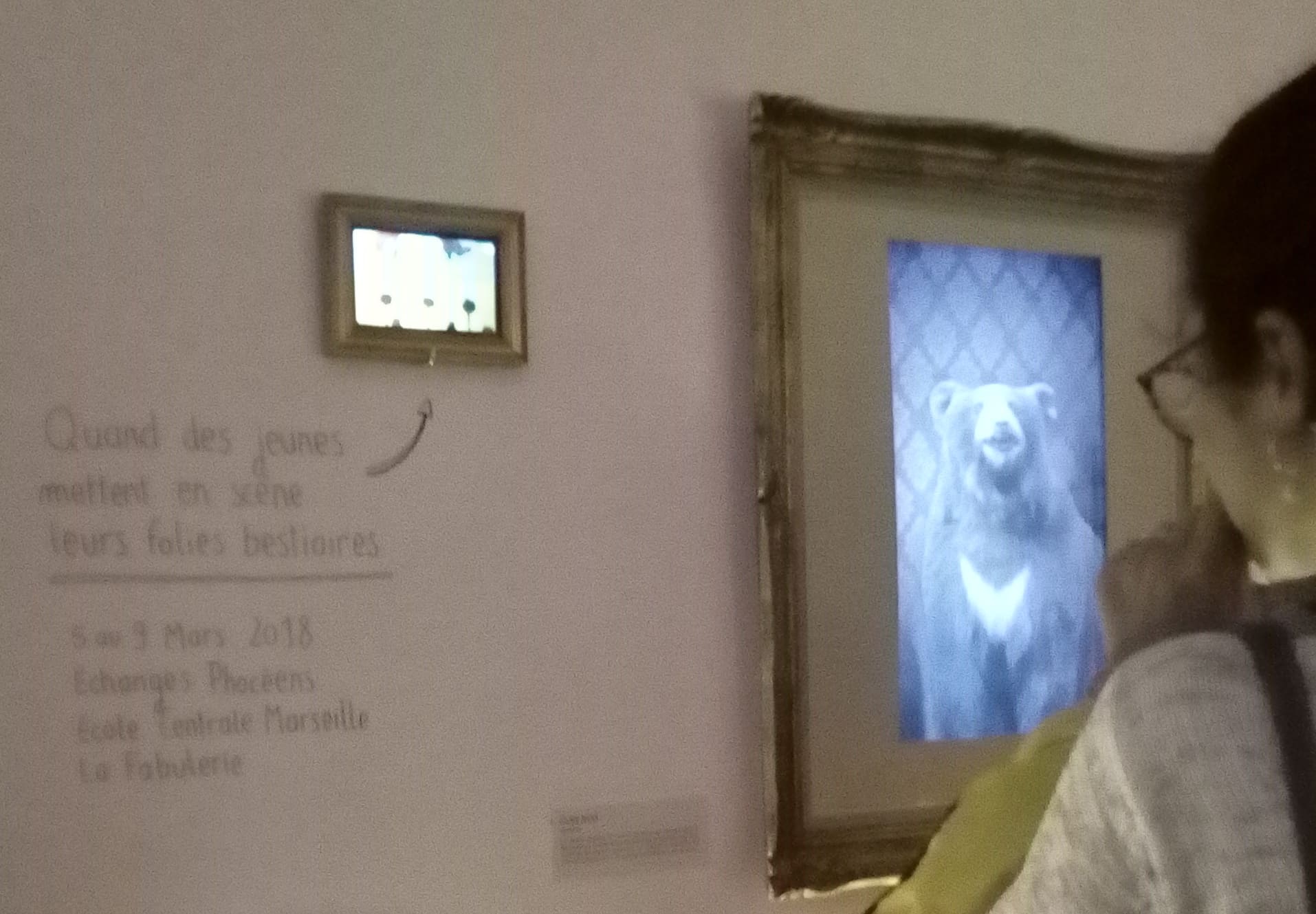
© C. L
Pour aller plus loin, les empreintes de pas des animaux sont accrochées au mur et vous pourrez même les toucher. Quel bonheur de pouvoir poser la main sur un objet exposé, on transgresse une des règles sacrées des musées !
Un dispositif particulièrement réussi consiste à écouter le cri d’un animal et deviner duquel il s’agit. Il suffit d’appuyer sur un petit bouton pour déclencher l’enregistrement et pour deviner la réponse, d’ouvrir une montre à gousset, qui révèle un animal.

© C. L
Plus loin, des tablettes numériques offrent plusieurs jeux : des quizz concernant les animaux exposés, des petits puzzles, etc. Mon préféré consiste à trouver les différences entre un spécimen dans une vitrine et sa photo sur la tablette numérique. Simple mais très efficace.

© C. L
Les dispositifs interactifs, très ludiques, sont tout particulièrement adaptés aux enfants. Cependant, les adultes ne boudent pas les petits jeux proposés. Cette exposition est susceptible de toucher tous les publics.
J’ai aussi beaucoup aimé le côté décalé de l’exposition, par exemple avec les animaux “mal” naturalisés ou des petits messages inscrits çà et là qui apportent un peu de légèreté.
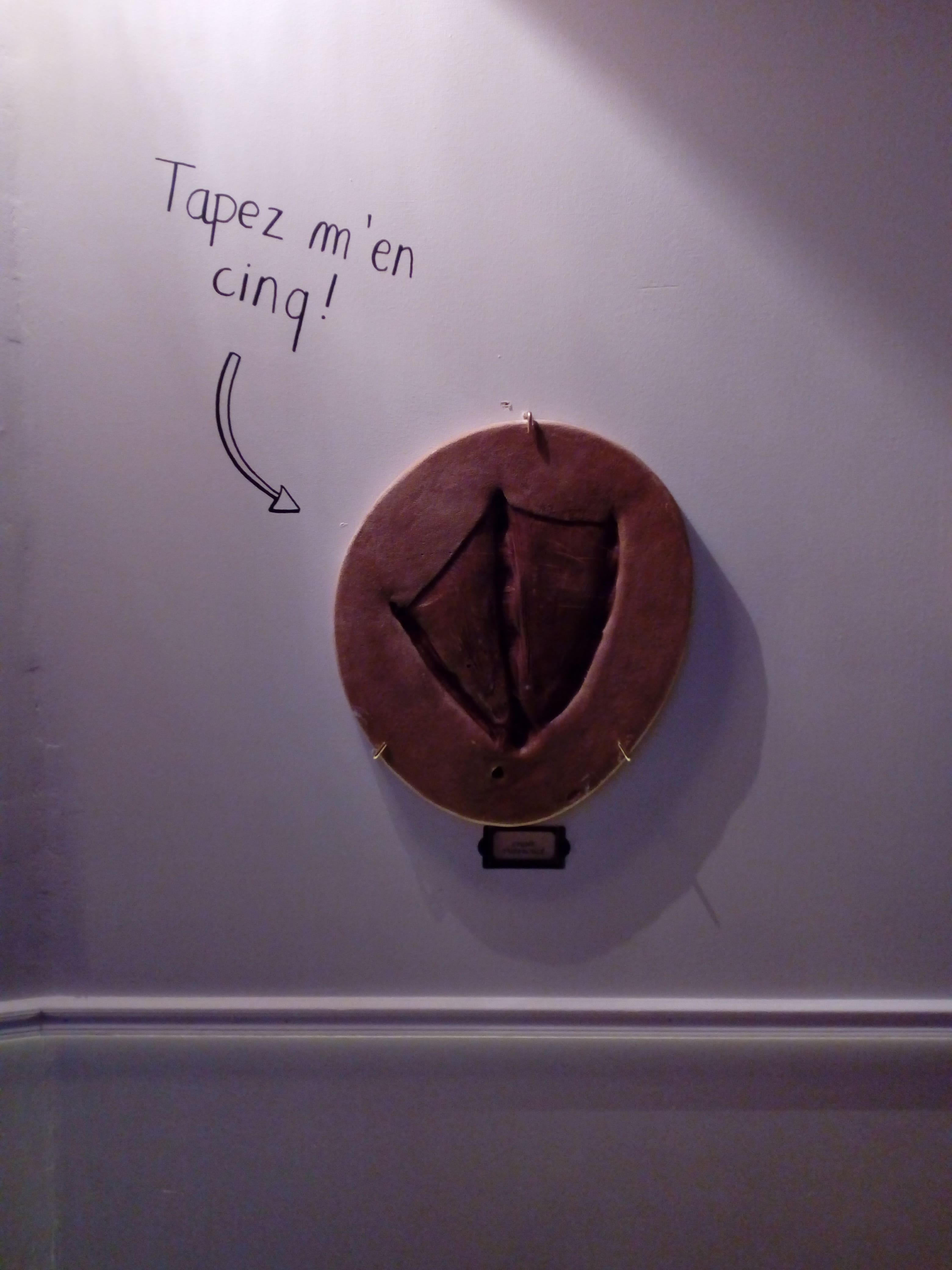
© C. L
Pour finir, la scénographie de l’exposition a su mettre en valeur l’espace d’exposition temporaire, notamment ses vitrines, très anciennes et très représentatives de l’architecture des Muséums classiques. Le musée a fait un choix ambitieux : allier l’existant avec les nouvelles technologies. La chouette naturalisée munie de lunettes 3D, qui sert de mascotte à l’exposition, symbolise bien cette association entre passé, présent et futur. Une sorte de retour vers le futur, en somme.
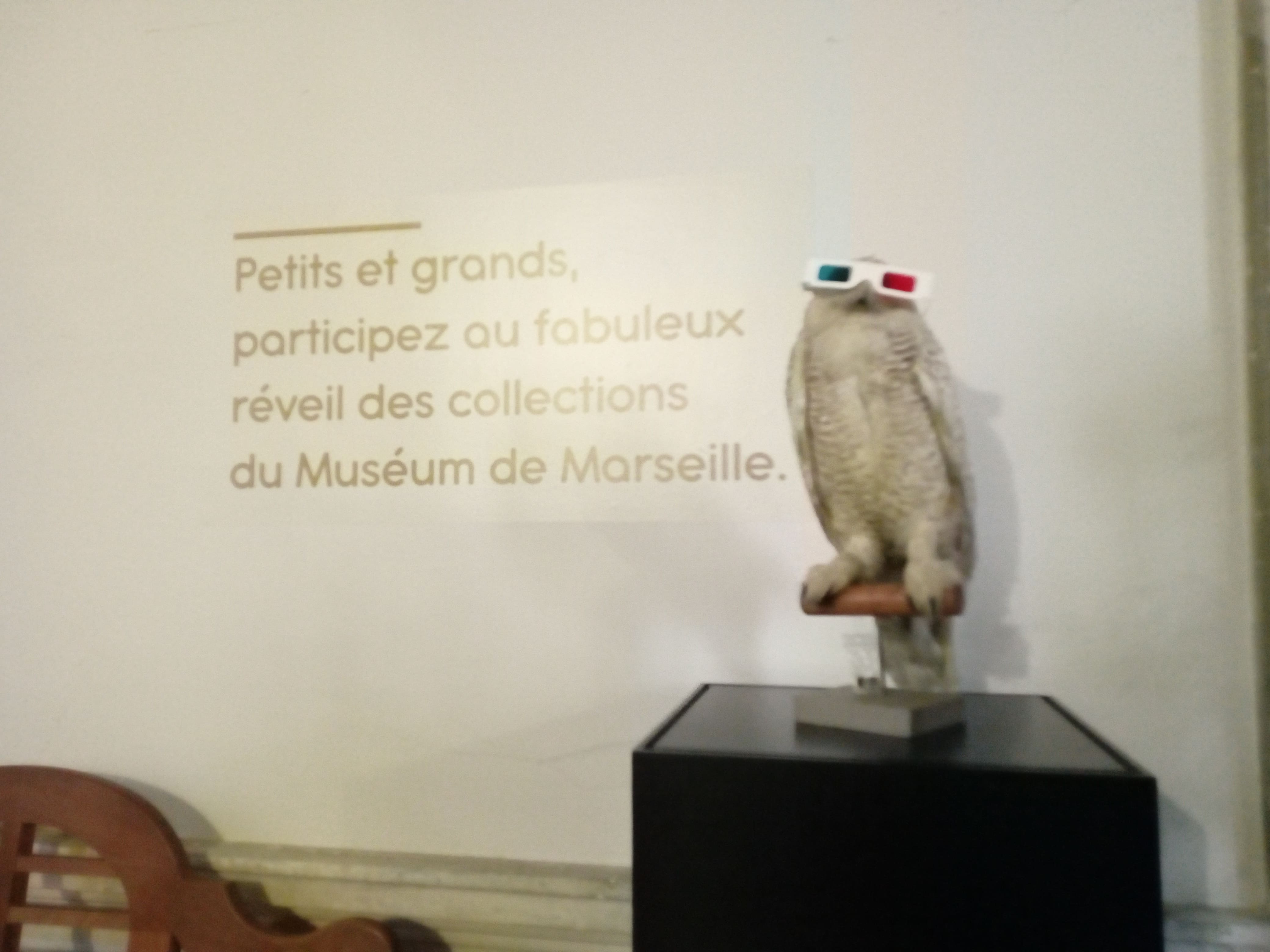
© C. L
Les nombreux messages positifs qu’on peut lire dans le livre d’or semblent indiquer que les visiteurs ont été, tout comme moi, séduits. Ils montrent que les publics ont été agréablement surpris par cette exposition qui sort du cadre muséal habituel, grâce à la dimension interactive et le ton léger du parcours : “Je me suis régalée. Et pourtant, les musées ça me saoul.” ou encore “D’habitude j’aime pas le musée mais là j’adore.”
Ces retours très positifs sur la forme de l’exposition conduisent à questionner le rôle des expositions et leurs supports de communication.
L’exposition Muséonérique s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, proposant une expérience sensorielle et ludique avec une vraie volonté de faire découvrir.
Pour voir l’exposition, direction le Muséum d’Histoire Naturelle au Palais Longchamp dans le 4e arrondissement de Marseille, avant le 24 février 2019
Clémence L.
#museum
#collections
#numerique
#expositiontemporaire
#marseille
Museu Nacional Vive
Le musée est mort, vive le musée.
Alors qu’il fête ses 200 ans d’existence, le Musée National de Rio de Janeiro s’embrase soudainement. Tandis que les nuages de fumée s’élèvent vers le ciel, les collections s’éteignent peu à peu sur le bûcher de la négligence. Nombreux sont les articles qui décrivent toute l’horreur de la catastrophe qui a frappé le Brésil la nuit du 2 au 3 septembre 2018. Il ne s’agit donc pas ici de faire une énième énumération des pertes aussi colossales qu’inestimables, mais plutôt de faire l’archéologie de cette inhumation et d’entrevoir le phœnix renaitre de ses cendres. Pour ce faire, j’ai interviewé Manuelina Duarte, professeure de muséologie à l’Université de Liège et professeure du programme en anthropologie sociale de l’Université fédérale de Goiás au Brésil (équivalent Master et Doctorat), mais aussi directrice du Département des processus muséaux de l’Institut Brésilien des musées (IBRAM) entre 2015 et 2016.

Manuelina Duarte © Markus Garscha
Emeline Larroudé : De quoi cet incident est-il symptomatique ?
Manuelina Duarte : Cet incident est symptomatique d’une situation de total abandon de la culture et des musées au Brésil, par les politiques publiques. Il y a, depuis le coup d’Etat qui a eu lieu en 2016, tout un ensemble d’actions du gouvernement de Temer, notre actuel président, et d’autres actions déjà annoncées par le prochain président Bolsonaro, qui vont vers la suppression de la culture et de l’éducation publique au Brésil. Dès les premiers jours de sa prise de fonction, Temer a commencé par supprimer le Ministère de la Culture. Après beaucoup de lutte, le Ministère a été rétabli, mais même si le problème n’est pas nouveau, il y a eu de moins en moins de ressources financières pour le Ministère tout au long de l’année. On a eu un accroissement de l’investissement au Ministère de la Culture pendant les gouvernances de Lula da Silva, puis pendant la première de Rousseff, qui était la continuation de celles du Parti des travailleurs. Mais durant son deuxième mandat, les questions de coupes budgétaires pour la culture étaient là, et les réunions et négociations entre le Ministère de la Culture et le Ministère de la Planification et des Finances étaient de plus en plus dures. La décision de Temer de supprimer le Ministère de la Culture le premier jour de sa prise de fonction en dit long sur la façon de voir la culture. La question se posait déjà avec la politique de Rousseff : on avait ces coupes mais toujours l’espoir que la situation financière du pays s’améliore et que l’investissement serait alors plus important. En 2017, le gouvernement de Temer a quant à lui adopté une loi limitant les investissements dans la santé, l’éducation, la culture et les infrastructures du pays : ils ne peuvent dépasser ceux de 2016, et ce pendant 20 ans. Les investissements de 2016 définissent donc les limites maximales des investissements pour les prochaines 20 années. Ce manque d’investissement est la cause de ce qui est arrivé au Musée National, malheureusement. Je peux déjà affirmer que cela va se reproduire dans d’autres musées mais aussi dans des hôpitaux, des écoles et des universités. Ce qui est bien, nouveau aujourd’hui, sera vieux, obsolète et désuet après 20 années sans investissements, et il est à prévoir de grandes tragédies pour les biens et les institutions qui sont déjà à risques.
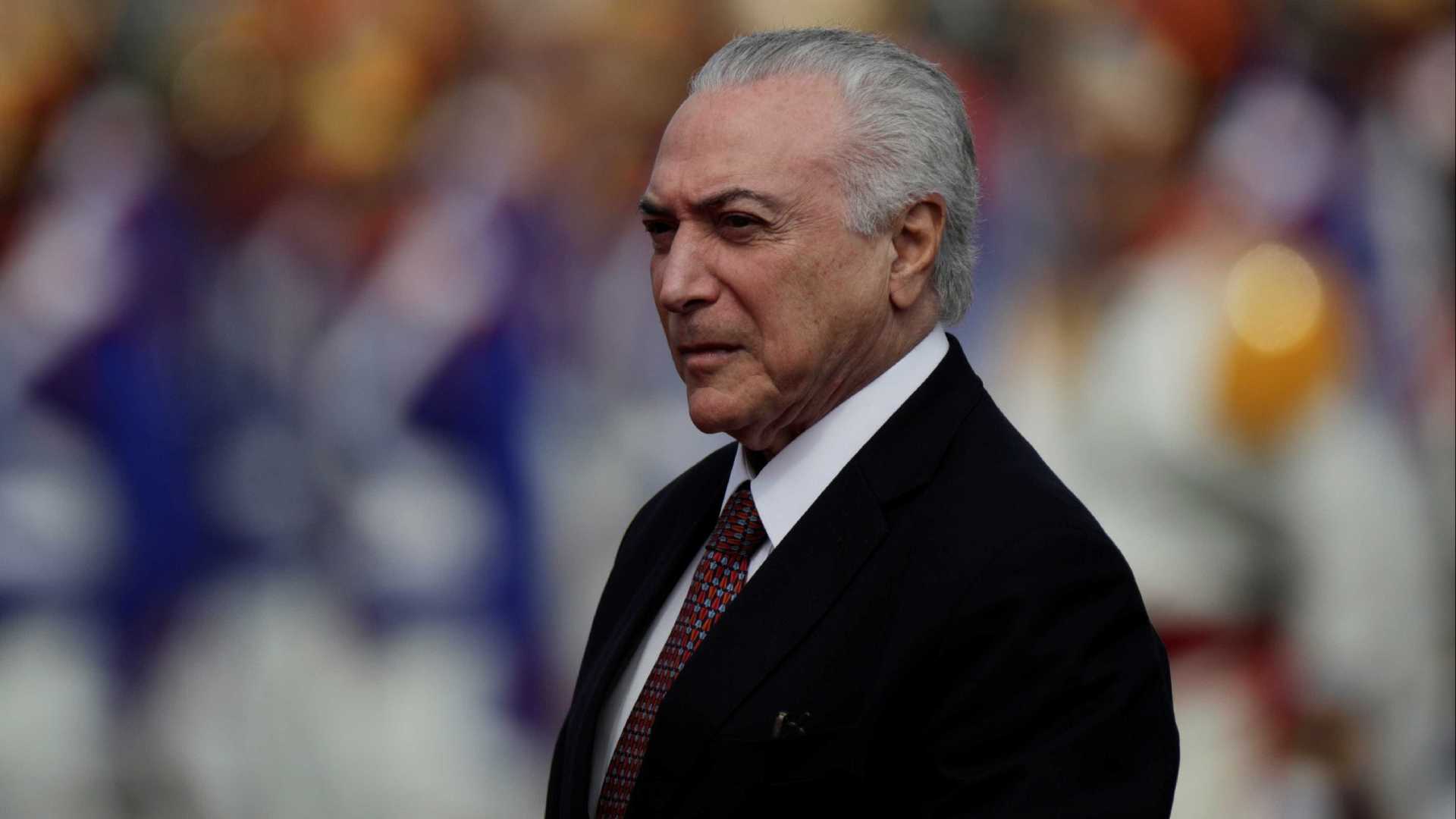
Michel Temer © REUTERS / Ueslei Marcelino
E. L. : Quelles mesures politiques sont prises ? Sont-elles significatives ?
M. D. : Les mesures qui ont été prises juste après l’incendie sont des mesures destinées à « sauver les apparences ». Le gouvernement et les politiciens ont très rapidement annoncé qu’ils allaient reconstruire le musée, et je pense que l’annonce immédiate de cette reconstruction trahit la volonté du gouvernement de contourner le problème et d’éviter toutes les discussions et débats qui devraient se tenir concernant les conditions, non seulement du musée incendié, mais plus globalement de l’ensemble des musées brésiliens. On pourrait apprendre de cette situation tragique pour décider d’investir davantage en amont pour d’autres musées et ainsi faire de la prévention. Que nenni, puisque le gouvernement préfère fuir la discussion. Mais ces mesures prises très vite n’ont pas maintenu cet élan face à la lenteur de notre bureaucratie. Même avec quelques aides internationales, le temps est nécessaire. Une chose importante est cependant en cours, bien qu’elle demande également du temps. Il s’agit d’une archéologie de sauvetage dans les ruines du musée pour essayer de trouver tous les vestiges des collections et les documents qui peuvent aider à reconstruire sa mémoire.
Une mesure politique désastreuse a été engagée par le ministre de la Culture les jours suivants l’incendie. Celui-ci a profité de cet épisode pour dire que le manque de ressources des musées brésiliens est dû à la complexité administrative, pour eux, de recevoir l’investissement privé. Il a donc annoncé la suppression de l’Institut Brésilien des musées qui est l’organe principal du Ministère de la Culture, présidant les 3700 musées brésiliens et responsable direct de 30 d’entre eux. Le musée National de Rio de Janeiro appartient à un autre ministère, non pas l’IBRAM mais le Ministère de l’Education, responsable des universités nationales dont fait partie l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Le Brésil comptant 68 universités fédérales, chacune ayant plusieurs campus et parfois 3 ou 4 musées, on peut estimer que le Ministère de l’Education possède environ 200-300 musées. D’autres musées dépendent de ministères différents, comme le Ministère des Transports ou le Ministère de la Justice. Cependant, sans le vouloir, le ministre de la Culture a laissé échapper que cet incendie était pour lui une « fenêtre d’opportunité ». C’est l’expression exacte qu’il a utilisée, une « fenêtre d’opportunité » pour effectuer les changements auxquels il songeait déjà auparavant : supprimer l’Institut et créer une agence brésilienne des musées. La différence entre l’agence et l’Institut est que l’agence ne va pas vraiment être un organe public gérant directement les musées avec l’argent du gouvernement, mais elle sera moins contrainte par les lois. C’est une institution à la gestion différente puisqu’elle peut recevoir des investissements privés avec plus de facilité. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant monnaie courante. En effet, même en étant un musée public, le musée National de Rio de Janeiro pouvait recevoir des investissements. Comme presque tous les grands musées du Brésil, il a une association des Amis du musée qui peut lancer des projets et établir des partenariats avec les sponsors privés. Il y avait à ce titre un projet de renouvellement de 10 millions de réal (monnaie brésilienne, ce qui équivaut à 225 680 euros). Ce projet existait depuis longtemps mais n’a pas réussi à susciter l’intérêt des investisseurs privés. Comme le ministre l’a laissé entendre, l’incendie a donc été utilisé comme une opportunité pour déresponsabiliser le Ministère de la gestion des musées en créant une agence pour remplacer l’Institut. Rien ne dit cependant qu’il y aura plus d’investissements qu’avant car ils étaient déjà très rares. Lorsqu’ils existaient, ils étaient uniquement destinés aux grands musées, donc les petits musées ou musées de tailles moyennes vont être encore plus délaissés qu’ils ne le sont aujourd’hui. C’est un problème vraiment préoccupant, car le ministre de la Culture a réussi à faire signer la suppression de l’IBRAM et la création de la nouvelle agence par le président Temer. C’est exactement pour cette raison que l’incendie a été considéré comme une opportunité, puisqu’il a permis de créer une loi sans concertation du parlement, dans l’urgence. La loi autorise en effet le président, en cas d’urgence, à signer une loi comme celle-ci, bien qu’elle ne soit vraiment valide que si, dans un délai de trois mois, le congrès l’approuve. Pour le moment, cette discussion a étonnement eu pour résultat le maintien de l’IBRAM et, en parallèle, à la création d’une fondation privée qu’il gèrerait afin de pouvoir recevoir plus facilement les dons privés pour la sauvegarde des musées. Mais cela reste une discussion difficile car notre parlement est très peu préoccupé par les questions culturelles. Aucun des politiciens ne veut revoir ou supprimer le coût des pouvoirs publics relatif aux salaires des parlementaires, des juges, des agents publics, mais ils s’accordent à vouloir supprimer ce qui pour eux relève du luxe, comme la culture.

Vue aérienne du musée après l’incendie © AFP / Mauro Pimentel
E. L. : À quels retentissements internationaux peut-on s’attendre ? Des démarches sont-elles déjà mises en place ?
M. D. : On a reçu beaucoup de soutien de tous les pays, du Conseil International des Musées (ICOM), des grands musées internationaux... Quelques-uns comme la France ou l’Allemagne ont annoncé leur appui et même proposé quelques aides financières (à hauteur d’1 million d’euros pour ce qui est des Allemands). En ce moment ont lieu les travaux d’archéologie de sauvetage dans les ruines, de fortifications des ruines pour ne pas avoir davantage de destruction concernant les murs qui sont encore debout aujourd’hui. Plus de 2000 objets ont déjà été retrouvés. La prochaine étape concerne les travaux pour les préparations de projet. Mais le soutien international le plus significatif concerne la question de l’information. Je pense que, plus que d’obtenir de l’argent, on a réussi à informer. Il y a beaucoup de partage des informations liées aux collections détruites du musée National de Rio de Janeiro qui sont dans les bases de données des musées internationaux. Ils nous aident à, d’une certaine façon, regrouper au moins digitalement une partie des données conservées sur les collections perdues. Donc, les musées qui ont sauvegardé des informations, données, qui ont photographié les collections brésiliennes, sont en train de contacter le musée National pour collaborer avec lui. Il y a également une offre internationale du point de vue de l’expertise, pour ce qui est de la restauration, de la reconstruction du bâtiment, etc.

Bannière de la campagne Museu Nacional Vive © UFRJ
E. L. : Comment appréhender cet incident à l’échelle du musée ? Qu’en faire ?
M. D. : Le musée a fait preuve d’une grande réactivité. Rapidement, les équipes se sont réunies pour essayer de sauver tout ce qui pouvait encore l’être, et ce dès l’annonce de l’incendie. Les gens se sont précipités, ce dimanche-là. Les scientifiques, les chercheurs, ont couru au musée pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être et qui était moins pris par les flammes. Pour ce faire, ils se sont mis en danger eux-mêmes. Dans les jours suivants, ils ont tous vivement soutenu l’idée que le musée vit encore. Oui, les pertes sont énormes et quasi totales, mais toute la connaissance est là. Les recherches étaient parfois copiées sur des ordinateurs personnels, tout est fait pour que les données puissent être réunies. Je pense qu’à ce moment-là, l’action du service éducatif du musée a été vraiment très forte, importante, symbolique. Il a lancé une campagne : « Museu Nacional Vive » (le musée National vit). Ils ont sensibilisé quelques artistes, beaucoup de Brésiliens ont fait des campagnes volontaires pour demander aux gens qui ont des photos du musée de les partager, ou de faire des dons financiers. Pendant l’incendie, les collections, en brûlant, se sont parfois envolées. Il était donc possible de trouver de petits morceaux de collections d’insectes ou de feuilles de papiers semi-brûlées dans les appartements, les rues, les maisons, les jardins jusqu’à 2km autour du musée, ce qui a également permis de sauver quelques informations. Le service éducatif du musée a donc fait une grande campagne pour retrouver ces morceaux ainsi que toutes les photos, informations et témoignages que les gens pouvaient conserver à propos du musée. Grâce à ce travail colossal, un google street view du musée a pu être réalisé. L’action éducative du musée est particulièrement impliquée, c’est une des parties les plus actives dans ce processus de recomposition du musée qui n’est pas seulement un processus de reconstruction de bâtiment mais bien de reconstruction des liens entre le personnel du musée et la population, autant qu’en interne. Tout le monde a beaucoup souffert émotionnellement, face à cette situation. Tous les événements et actions qui ont eu cours les jours suivants dans les jardins du musée ont été initiés pour prouver, à la population mais aussi à eux-mêmes, que le musée vit encore et qu’il n’est pas mort.
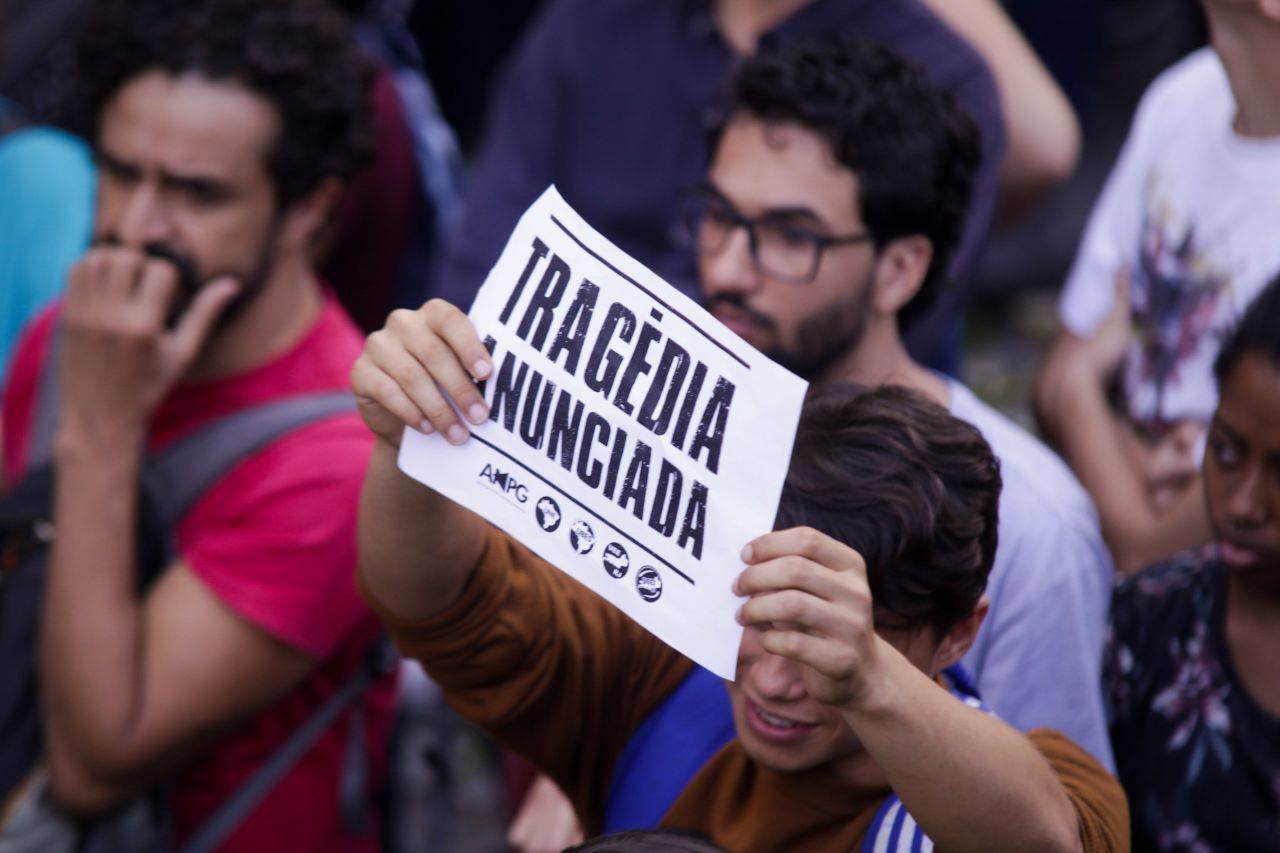
Population mobilisée devant le musée à la suite de l’incendie © Annelize Tozetto
E. L. : Cet événement a-t-il permis l’éveil d’un plus vif intérêt ou d’une sensibilisation plus grande par les brésiliens ? Quelle réaction du public, des visiteurs ?
M. D. : Cet événement a vraiment touché les Brésiliens. Malheureusement, je ne sais pas si l’effet va s’estomper ou au contraire perdurer. Sur le moment en tout cas, la population a été très touchée, très solidaire, particulièrement la population de Rio mais aussi celles des autres villes brésiliennes. Tout le monde a suivi l’événement sur la télévision, c’était un choc. Ils y ont tous été sensibles. La première réaction, notamment des habitants de Rio, a été de visiter non pas le lieu ni les ruines, qui sont protégés par la police pour les investigations, mais le jardin qui les entoure. Le personnel du musée y a organisé des événements les jours qui suivirent l’incident. La population s’y est rendue. Je pense qu’en général, on a constaté une vague d’articles, de réactions dans tous les médias : presse, télé... Tout le monde était préoccupé, par le musée National mais également par les autres musées. Je pense que le plus important est que cela a mis en lumière le fait que le musée National ne serait pas forcément un cas particulier, puisque beaucoup d’autres musées sont également en danger. En effet, le Brésil n’a ni les moyens suffisants ni une politique de prévention qui permettent de dire que les autres musées sont dans un meilleur état et sans risques.

Crâne de « Luzia », plus ancien fossile humain retrouvé au Brésil, dont une partie a été perdue dans l’incendie © Acervo Coordcom
E. L. : Quel musée de demain pour le Brésil ?
M. D. : Le Brésil est un grand pays, pauvre du point de vue économique mais très riche du point de vue de la culture, de la diversité, de la vivacité du peuple etc… Il a beaucoup à gagner avec des processus de muséalisation moins traditionnels, davantage liés à la culture populaire, à la culture vivante, aux savoir-faire, au patrimoine immatériel, tout ce qui se trouve dans le peuple en général et non derrière des vitrines. On a d’importantes collections, mais contrairement à l’Europe, je pense qu’on s’accorde beaucoup plus de libertés pour explorer ces autres modèles de muséalisation. Un événement comme celui-ci montre que concentrer les collections sous une seule institution, dans une seule structure parfois, c’est aussi créer une situation plus à risques qu’opter pour une sorte de décentralisation. Le plus important est la récolte des informations, la collecte, la réalisation des inventaires, des dossiers, des photographies … Mais parfois, ne vaut-il pas mieux ne pas réunir physiquement les collections ? On mène beaucoup d’expériences, au Brésil, d’inventaires participatifs. Ces expériences participatives ne décontextualisent pas les objets dans la mesure où ceux-ci restent chez les propriétaires originels, dans leurs maisons. Ils en sont responsables et vont les transmettre aux futures générations. C’est un véritable modèle, surtout si l’on tient compte du fait que le gouvernement ne semble pas vraiment intéressé à faire les investissements nécessaires pour les institutions. Ce partage de responsabilité mais aussi de propriété avec les communautés, pourrait aussi être particulièrement utile pour les Brésiliens qui n’habitent pas dans les capitales, car les grands musées comme celui-là sont toujours situés dans de grandes villes brésiliennes auxquels tous n’ont pas accès. 80% des quelques 5000 villes brésiliennes n’ont aucun musée. Les musées sont surtout concentrés dans le Sud et le Sud-Ouest du Brésil, régions les plus riches, dans les capitales et sur les littoraux. On a donc un grand désert muséal au Nord, au Nord-Ouest et au Centre du Brésil. Je pense qu’on ne peut occuper ces espaces vides qu’avec la multiplication des initiatives communautaires, des initiatives plus petites et diffusées de manière décentralisée. C’est préférable au fait de créer de grands musées avec des architectes connus dans les capitales du pays. La reproduction du modèle européen, basée sur une perspective courte, ne peut pas réussir à occuper tous ces grands espaces de 8 millions de km² dans un pays qui a toujours dit que la culture ne fait pas partie de ses priorités.
Emeline Larroudé
#museunacionalvive
#lutomuseunacional
#museunacional
Pour en savoir plus :
http://www.museunacional.ufrj.br/
Museum Fighter
Amoureux de street-fighter et de scénographie ? Cet article est fait pour vous.
Le white cube et la scénographie théâtrale s'affrontent ici dans un match au sommet !
En tant qu'arbitre je vous propose deux combattants : Camille Claudel, miroir de l'Art Déco (La Piscine, Roubaix) & Arras vous fait la Cour (Musée des Beaux-Arts, Arras).
Le match se fera en deux rounds gagnants.
Vous pouvez choisir la durée du match : 30, 60 ou 90 secondes selon vos capacités de lecture. Je vous déconseille cependant la version en temps illimité.
Mais avant de commencer lancez cette vidéo, je suis certaine que la bande-son vous mettra en condition.
Round 1 : Multitude d'objets vs choix de cent œuvres
Arras a fait le choix d'exposer « uniquement » cent chefs-d’œuvre de Versailles. Des spécialistes vous diront sûrement que le château n'a pas prêté ses plus belles pièces ! Cette remarque ne vaut pas bien entendu pour des pièces comme le magnifique groupe Apollon servi par les nymphes –qui ne sera d'ailleurs pas exposé sur la totalité du temps de l'expo (18 mois) – maison remarquera juste que les pièces ne sont pas toutes des chefs-d’œuvre. Cependant le simple amateur – c'est-à-dire une personne qui n'a pas fait une thèse de 799 pages sur la marqueterie versaillaise entre 1526 et 1532 – reste ébloui par ces objets de luxe ! Dans les salles, point trop d'objets, ce qui permet de les découvrir réellement. Ici je m'attarde sur un tableau, là sur une chaise ou ici encore sur un fusil de chasse. Je ne me sens pas oppressée, le lieu me laisse le temps de vagabonder sereinement.
Du côté de Roubaix, on a plutôt sorti l'artillerie lourde ! Des dizaines et des dizaines d’œuvres de l'artiste sont exposées : sculptures, dessins, photographies, esquisses, moulages, etc. Sans compter les œuvres de son maître, de ceux qui l'ont inspirée, etc. Sur le papier, ça m'emballe de suite ! Camille Claudel, j'adore ! Elle a tout pour plaire, la beauté, le talent, la passion et la folie ! Cependant, comme souvent dans ce type d'exposition je déchante. J'ai du mal à me fixer, il y a trop d’œuvres à découvrir, trop de traitements différents d'une même sculpture. Résultat je suis un peu perdue au milieu.
Résultat du round :un point pour Arras pour avoir su choisir un nombre d’œuvres limité ! On est désolée pour Camille Claudel, nous aussi on l'aime, mais la on parle de muséo et de scéno.
Round 2 : Sobriété vs Démesure
Honneur au perdant on commence avec La Piscine. Le choix du musée a été celui du White Cube. Pour rappel ce type de scénographie consiste à créer un espace blanc pour que le public se focalise uniquement sur les œuvres d'art. Ce concept a été schématisé de la façon suivante par l'essayiste Brian O'Doherty :
Pour le meilleur et pour le pire, le “cube blanc” est la seule convention majeure à laquelle l’art ait dû se soumettre. Sa pérennité est garantie parce qu’il n’y a pas d’alternative.
Est-ce vrai ? Les murs blancs sont-ils le seul moyen de mettre en avant une œuvre d'art ? J'en doute. Voilà des siècles que les objets sont exposés dans des habitations, des églises ou même dans la rue. C'est-à-dire dans un contexte où l'objet n'est pas forcément le centre de toutes les attentions. Mais bon quitte à sacraliser ce dernier on peut en effet l'exposer dans un environnement blanc. Cependant, est-ce vraiment le meilleur moyen de valoriser un marbre de Camille Claudel ? De but en blanc je pense justement que le blanc, c'est idiot mais ça salit rapidement, alors ce n'est vraiment pas l'idéal, surtout pour les assises. Concernant les vitrines, sur ce point encore j'ai été déçue elles s'alignent le plus souvent contre les murs, et ne permettent pas de faire le tour des rondes-bosse. Ce qui est dommage quand on connaît le talent de Claudel. Quant à la compréhension des salles, elle s'avère ardue. Les textes sont déclinés en couleurs pâles … sur les murs blancs. Bref dans la foule, je n'ai découvert leur existence qu'après avoir parcouru la moitié de l'exposition. En ma défaveur j'avoue aussi qu'un guide de visite était fourni à l'entrée du musée, mais qu'au milieu des dizaines de prospectus distribués, je ne l'ai lu qu'une fois rentrée chez moi. Dommage quand on connaît le talent de Claudel.
Du côté d'Arras, les mots d'ordre seraient plutôt « démesure et extravagance ! ». La scénographie tient une place à part entière dans l'exposition, on la voit. Par moments trop. Cependant elle permet d'être transporté directement dans l'ambiance du lieu. Bien sûr, on est loin du château de Versailles, on appréciera d'ailleurs que les commissaires d'exposition n'aient pas tenté d'en faire une pâle imitation. Chaque salle possède une ambiance, ce qui facilite la lecture de celle-ci. Sans avoir besoin de consulter un plan vous savez que vous vous trouvez dans les bosquetsou dans la salle consacrée aux Fêtes. La scénographie est donc élégante et à mon sens léchée. Elle procure aux visiteurs une véritable expérience de visite. Cependant il y a un hic, enfin deux. Le premier : la scénographie prend parfois, voire souvent le pas sur les expôts. Dans les premières salles, elle est certes présente mais valorise les objets. Mais une fois dans la salle des Eaux et Fontaines, on oublie complètement l'objet. Cette scénographie grandiloquente a d'ailleurs été très critiquée par la presse spécialisée. Personnellement j'ai apprécié l'installation numérique, même si ce fut au détriment de la sculpture Latone et ses enfants, par ailleurs très abîmée. Si vous avez aimé le Marie-Antoinette de Sofia Coppola vous apprécierez peut-être la présence d'une boule à facettes contemporaine dans la salle dédiée aux fêtes (oui ça existait à l'époque mais pas cette version là). Deuxième hic : on parle quasiment uniquement de la scénographie dans la presse. C'est ce que je fais aussi d'ailleurs.
Résultat du round : serré, très serré ! Malgré tout Arras l'emporte pour m'avoir transportée dans un autre univers, pour avoir essayé de contextualiser les œuvres, alors que pour l'exposition Camille Claudel, la scénographie était selon moi absente.
And the winner is :
Versailles gagne donc le match d'une courte tête !
Si vous désirez refaire le match, protestez contre les jugements totalement subjectifs de l'arbitre ou juste me donner raison n'hésitez pas laisser un commentaire.
Marion Boistel
Pour avoir une idée un peu plus sérieuse de ce qu'est le White – Cube je vous invite à lire :
Brian O'Doherty, White cube : l'espace de la galerie et son idéologie, Zurich, JRP, 2008.
Si vous cherchez une vision plus synthétique :
Laure Bodonaba, « Note de lecture », Cahiers philosophiques 1/2011 (n°124), p.123-126, disponible ici.
Pour lire un avis beaucoup plus tranché que le mien sur l'exposition d'Arras,
je vous conseille l'article très virulent de Didier Rykner, intitulé sobrement :
De Versailles à Arras, cent chefs-d'oeuvre déplacés pour rien
#scénographie
#muséographie
#battle

MUSOGYNIE : un musée de la misogynie
Les institutions patrimoniales comptent parmi leurs collections des objets dits « sensibles » au regard de systèmes de valeurs philosophiques, politiques ou culturels. Leur mise en exposition pose alors de nombreuses interrogations, particulièrement dans un contexte récent de remise en cause des récits institutionnels et d’une exigence croissante de représentativité de la part des publics.
Les revendications et réactions parfois violentes émanant d’individus ou de groupes face à ces objets traduisent la violence symbolique qu’ils peuvent véhiculer. Elles rappellent aussi combien il est nécessaire, pour les professionnel·les des institutions culturelles, de repenser les modalités de leur présentation. Faut-il les présenter au public au risque de heurter certaines sensibilités ? Quel cadre scientifique et quelle forme de médiation conviennent-ils de mettre en place autour de ces objets ? Comment concevoir un discours scientifique et une muséographie capables de prendre en compte ces enjeux ?
On distingue plusieurs catégories d’objets dits « sensibles », parmi lesquels figurent ceux liés à l’histoire coloniale, aux conflits armés, à des épisodes de violence, ou encore à certaines œuvres d’art contemporain.
Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov
MUSOGYNIE
L’artiste Mélina Ghorafi (née en 1995, vit et travaille à Bruxelles) collectionne des objets occidentaux marqués par la misogynie. Elle les compile dans son projet MUSOGYNIE, un musée de la misogynie qui a pour objectif de visibiliser les violences faites aux femmes, notamment en rassemblant des images archétypales de la Femme et l’esthétisation de la misogynie.
Avec les outils d’une artiste, elle prend à bras-le-corps la violence des images et s’en sert comme réservoir de création, pour réinventer des contre-esthétiques, produire des résistances.
Elle a accepté de discuter avec moi de l’image du musée exprimée au travers de MUSOGYNIE, de la médiation de ces objets misogynes et de son rapport personnel à eux.
R.O : Peux-tu raconter quand et comment est né le projet MUSOGYNIE ?
M.G : J’ai commencé MUSOGYNIE en 2018 pendant mes études d'art à la Villa Arson. Depuis des années, j'utilisais dans mon travail pas mal d’objets qui venaient d'une tradition misogyne, qui mettaient en scène des violences envers les femmes et notamment via la tradition orale francophone. Je travaillais énormément avec les chansons traditionnelles, les contes, etc., dans le but de me réapproprier, avoir un propos autour des femmes et cela m'a amené à m'interroger sur l'avenir de toutes ces esthétiques et tous ces objets qui sont - alors on imagine dans un futur certainement lointain - de plus en plus obsolètes. J’ai imaginé un musée de ce phénomène qu’est la misogynie qui serait en train de dépérir et de disparaître. C’est une sorte de vestige d’un passé dans lequel la misogynie était rampante. C’est un peu un musée du futur. À la base de MUSOGYNIE c’est vraiment une réflexion autour de mon propre travail et de la question « que fait-on de ces objets-là ? » qui ont été produits par le passé, qui continuent d’être produits, et qui vont très certainement encore perdurer, on ne va pas se mentir. C’est vraiment un projet visionnaire, au sens de se projeter dans le futur. Et c'est aussi une réflexion sur ce qu'est un musée, un musée qui met sous vitrine des vestiges d'un phénomène qui est en train de dépérir, qui est en train de disparaître. C’est une sorte d'archive d'un phénomène qui a existé. Et donc, je voulais renseigner les esthétiques d'une violence systémique, celle du sexisme, par ses objets, par ses formes, par ses archétypes, par l'imaginaire autour de la fiction de la femme, ce qu'est la Femme avec un grand F plutôt que les réalités des femmes.
Des collections ou des musées t'ont-ils inspirée ou nourrie dans la création de MUSOGYNIE ?
M.G : Cette démarche m’a été inspirée par un musée qui s'appelle le « Jim Crow Museum of Racist Memorabilia ». C'est une collection d'objets racistes de la période de ségrégation raciale aux États-Unis imposée par les lois Jim Crow promulguée après l'abolition de l'esclavage en 1865. Ces lois étaient en vigueur de 1877 à 1964, donc cela a duré près d'un siècle. Pendant cette période, c'était aussi l'industrialisation progressive de la société, beaucoup d'objets ont été produits et perpétuaient des stéréotypes racistes extrêmement violents. Ce musée accumule tous ces objets-là. David Pilgrim Graham, un chercheur en sociologie de la Ferris State University, l’université où est établi le musée, a collectionné ces objets de manière privée dans les années 1970. Il utilisait ces objets pendant ses cours pour enseigner le racisme à ses élèves et il s'est rendu compte que c'était un support très efficace. C'est ainsi qu’est né ce musée public dans cette université du Michigan. Cette collection m'a inspiré le fait de documenter une violence systémique par ses esthétiques, par ses objets. Sachant que le Jim Crow Museum se concentre essentiellement sur les États-Unis pendant la période de ségrégation raciale. Alors que MUSOGYNIE est un peu plus vaste : on se situe majoritairement dans les cultures occidentales, à quelques exceptions près, mais on n’est pas sur une zone historique ou géographique déterminée. Il y a des objets très anciens, notamment des livres qui datent de l'Antiquité, par exemple, et puis des choses que j'achète, neuves, qui sont produites aujourd'hui.
Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2021, exposition Hallali, B.R.A.V.E., 2021
De quelle nature sont les objets qui composent MUSOGYNIE ? Peux-tu nous donner des exemples concrets ? Est-ce une collection d’objets populaires et usuels, ou au contraire vas-tu puiser dans l’imaginaire des beaux-arts qui ne tarit pas de misogynie ?
M.G : Une chose que je crains beaucoup c'est que les gens voient MUSOGYNIE et pensent que la misogynie ou le sexisme est le fait d'une culture populaire, alors que c’est faux. Pour moi, la misogynie est dans toutes les différentes cultures, savantes comme populaires. Elle imprègne toutes les strates culturelles de la société. Je peux sentir parfois dans des visites guidées et lorsqu’on parle de misogynie que les gens se figurent directement les chansons paillardes, les cérémonies de mariage avec parfois des rituels sexistes, ce genre de choses. Alors qu'effectivement, il y a aussi des livres d'artistes, des livres de littérature dans la collection. Ils ne représentent pas la majorité, et la raison s’explique en partie par un intérêt personnel : j'ai tendance à être plus intéressée par la culture populaire que par la culture des beaux-arts. En réalité, j’ai aussi acquis un livre sur Picasso, un livre de peinture sur Félicien Rops, j’ai des livres de Sade, des ouvrages vraiment littéraires.
La raison pour laquelle il y a beaucoup d'objets usuels, c'est également parce qu'ils sont faciles à trouver. Je trouve ces objets quand je vais dans des brocantes. Parfois, je vais spécifiquement dans certains magasins pour en chercher certains. Parfois, c'est par hasard que je tombe dessus. Les gens eux-mêmes peuvent me faire des donations de vieux objets qu'ils ont depuis longtemps, qu’ils avaient dans leur famille. La proportion d’objets populaires est donc plutôt une question de circonstance qu'un choix. Ce n’est pas un non-choix, cela reflète mon intérêt personnel : je pense que je me retrouve plus dans ces objets-là, comme des miroirs, que dans ceux des beaux-arts. C’est d’ailleurs le but de MUSOGYNIE de renseigner un héritage collectif et d’explorer la familiarité de ces objets, la familiarité de la misogynie.
Pour donner des exemples spécifiques, la collection compte plusieurs objets autour de l’expression « embrasser Fanny » qui est une expression de pétanque pour dire perdre 13-0. Elle vient de Lyon où il y avait un terrain de pétanque célèbre du nom de « Clos Jouve » dans le quartier de la Croix-Rousse et selon une légende urbaine, plus ou moins réelle, une jeune fille du nom de Fanny s’y attardait et montrait ses fesses aux perdants pour les consoler. C’est une histoire qui date à peu près de la fin du 19ème siècle. C’est comme cela que serait née la légende d'embrasser Fanny. Des bas-reliefs, des cartes postales, des assiettes représentent une femme qui monte ses fesses, accompagnée de l’inscription « 13-0 ». On trouve facilement des boules de pétanque à cette effigie dans le sud de la France, à Marseille ou à Nice. Dans la collection, j'ai deux cartes postales, un bas-relief et un médaillon de la série « embrasser Fanny ». C’est un exemple d’un imaginaire dit populaire.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE X BRAVE, © Guillaume Seyller
MUSOGYNIE x BRAVE
Pourquoi avoir choisi la forme du musée pour aborder ce sujet ? Qu'est-ce que cette structure permet selon toi ?
M.G : Selon moi, le musée est la création d’une collection d'un phénomène qui serait en train de disparaître, c'est une sorte de musée magique. Il y a aussi évidemment une référence au musée colonial et ses effets, un musée colonial est un cimetière. L’idée était d’exploiter le potentiel mortifère du musée qui extrait d'un contexte un objet et qui le présente comme étant digne d’intérêt. La structure MUSOGYNIE permet de recontextualiser certains objets et de donner un aperçu ou une constellation de ce qu'est la misogynie, sous plein de formes différentes. Certains objets prennent d’ailleurs sens lorsqu’ils sont mis en perspective avec le reste de la collection : je pense à des poupées en porcelaine, par exemple, qui en tant que telles, ne sont pas misogynes. - Et puis moi, j'adore les poupées, je les collectionne aussi, en dehors de MUSOGYNIE ! -Le but est plutôt de renseigner des archétypes ou des standards de représentation.
Le projet emprunte-t-il d’autres éléments au monde muséal, au-delà de la simple forme ?
M.G : Je mène moi-même des visites guidées de la collection quasiment tous les mois, soit dans le local de l'association Poissons sans bicyclette à Bruxelles, soit dans des bibliothèques où l’on m'invite, ou encore dans des centres d'art. J’ai pu exposer la collection dans un white cube lors d’une exposition collective[1] et j'ai fait une visite guidée dans ce cadre-là. La visite guidée, qui me semble appartenir typiquement au monde des musées, est différente lorsque je la mène car j'encourage les gens à toucher les objets, à interagir avec. Les objets sont installés sur des tables, à portée de main, pas sous des vitrines qui les rendent inaccessibles. Lors de ces visites, je présente à la fois le musée mais aussi certains objets dont je partage les histoires ou les anecdotes liées. À chaque fois, cela engendre des discussions parce que ces objets évoquent systématiquement des souvenirs chez les gens. Et c’est ce qui m’intéresse. C’est un bagage collectif qui ressurgit, qui amène des discussions passionnantes. Ce sont des visites guidées assez interactives. Je ne suis pas du tout dans le « ne pas toucher ». De la même manière, je ne suis pas dans une démarche de conservation d’objets, comme s’ils devaient être préservés dans un bon état, et sur le long terme. Je crois que ça ne me gêne pas si les objets se détériorent parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils sont manipulés. Cela participe à garder cette collection vivante.
Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov
© photo Émile Ouroumov
Au sujet de l’exposition de MUSOGYNIE dans ce white cube, est-ce toi qui as disposé les objets ? Quelle nouvelle dimension la scénographie peut-elle apporter au projet ?
M.G : J’ai réellement été aux rennes de cette installation. Le commissaire d'exposition m’a donné quelques conseils sur l'installation, mais il m'a laissé faire et il était content du résultat. J'ai travaillé en collaboration avec lui, l'équipe de production et d'installation pour placer les différentes étagères, les créer aux dimensions que je voulais, ou encore acheter de nouveaux objets grâce à un budget. J’ai tout de même pris les décisions pour l’installation. Par conséquent, cette installation était adaptée à ce contexte-là, et j’en suis fière. Mais c’est vrai que j'aimerais tester des formats plus immersifs que l'installation sur un mur dans le cadre d'une exposition collective.
Tu peux préciser ce que tu entends par immersif ?
M.G : La forme idéale de MUSOGYNIE serait une maison. Ce serait ma maison, vraiment chez moi. Les espaces seraient remplis d’objets hyper misogynes, avec par exemple une table et on pourrait réellement y manger. Ce serait sa forme ultime. Un musée privé ou d'espèce de « cabinet de curiosités » - alors je n’aime pas trop le mot qui renvoie à un imaginaire que je trouve un peu bof mais il y a de cela quand même. C’est vraiment quelque chose de très personnel. Ce serait moins un musée public mais plutôt quelque chose qui se rapporte à la sphère privée. Le problème c’est qu’il faudrait beaucoup de place, une maison, ça demande plein de choses.
Oui je vois, la forme du musée-foyer où tu vis avec ces « horreurs ».
M.G : Mais j'ai des objets qui sont chez moi, en fait. Il y a des objets de la collection qui sont dans mon quotidien et lorsque je fais les visites guidées de MUSOGYNIE, je les sors et les ramène pour l’occasion. Puis après, je les reprends, je les ramène. J’aime certains objets de cette collection. Pour moi, un des angles importants de MUSOGYNIE est de dire que ces objets nous forment, qu’on le veuille ou non. Ce sont des esthétiques ou des imaginaires qui sont ancrés dans notre culture, dans nos rapports à la vie et aux choses. Le fait d’en avoir certains avec moi, c'est presque une forme de désenvoûtement. Je ne sais pas comment expliquer. Ça désamorce presque leur violence. Et évidemment, j'ai conscience de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils véhiculent, mais c'est une sorte de réappropriation. Plein de ces objets sont chez moi et sont utilisés.
Ça me fait penser à une réflexion que je me suis déjà faite. Souvent, dans des brocantes ou vides greniers, j’ai eu ce mouvement d'aller vers un objet misogyne, d’en prendre possession en l’achetant et j’ai été soulagée. Comme si j'avais mis en sécurité une chose violente qui m'aurait tuée de savoir entre d’autres mains. Donc une assiette immonde trône chez moi mais il y a une satisfaction à la voir quotidiennement. J’ai l’impression que par l’humour et le second degré, je lui enlève toute charge violente. Qu’en penses-tu ?
M.G : Je me pose toujours la question « est-ce vraiment du second degré ? ». Lorsque j’ai ces objets avec moi, j’ai l'impression d'être à 1,5 degré. J’essaye autant que possible de maintenir une position critique tout en évitant la distance absolue. Je trouve important de ne pas me positionner comme étant au-dessus de ces objets ou de quelqu’un qui les trouve anodins. Je ne veux pas être dans la moralisation. Il y a une problématique persistante depuis le début de MUSOGYNIE qui est celle du rapport à l'objet : trouver la bonne place entre la distance complète et sans distance aucune. C’est assez fluctuant. Le fait d'avoir ces objets chez moi me confronte constamment à cette position : je ressens, comme tu disais, un peu de soulagement d'avoir raflé l'objet, qu’il est chez moi en sécurité et à la fois, j’aime réellement certains. Il y a sincèrement de l’appréciation, de l’amour pour eux, pour leurs esthétiques, parce que j’y suis habitée, j’en suis familière et elles me rappellent des souvenirs.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov
N’est-ce pas paradoxal de collecter et exposer, c’est-à-dire donner de l’attention, du temps et un certain statut à des objets qui devraient nous faire horreur et surtout te font du tort en tant que femme ?
M.G : Je pense qu'il n’y a personne de mieux placé qu'une personne concernée par une violence pour parler de ses objets ou se les approprier. On devrait bien plus faire des collections d'objets de violence parce qu’elles aident à nommer les choses à l’œuvre. Ces objets différents mais de même nature s’éclairent entre eux. Il y a de plus en plus d’initiatives d’archives concernant des groupes systématiquement effacés parce que ça permet de faire traces. Ça c’est un rôle. Je pense que les collections de violence remplissent un autre rôle complémentaire. Je comprends l'argument de dire que collectionner c’est visibiliser mais la misogynie est déjà omniprésente : ces façons de penser sont omniprésentes, c'est juste que le phénomène est éparpillé. Le fait de mettre ces objets ensemble leur redonne une force qui permet de plus facilement avoir un rapport critique vis-à-vis d’eux.
Les professionnel·les des musées vont souvent chercher à médiatiser les objets, surtout ceux relatifs à des questions socialement vives, en les replaçant dans leur contexte de création afin de les rendre rationnels ; ta démarche au contraire semble prendre le contre-pied dans le sens où tu exposes de manière brute et a priori sans explication contextuelle des objets qui sont misogynes. Pourquoi as-tu fait ce choix de t'en tenir aux formes ?
M.G : Je n’ai pas une approche très historique ou très contextuelle de la société, même si parfois c'est important pour comprendre certains éléments. Généralement, pendant les visites guidées, je donne des explications qui sont – je n'aime pas trop ce mot mais - aussi « neutres » que possible. Souvent, je ne donne pas mon avis sur l'objet : je reste très factuelle dans mon explication parce que j'aime laisser les personnes réagir aux objets ou à l'histoire. Justement, certaines sont offusquées, d'autres qui rient…Il y a des réactions très différentes. Parfois, des personnes qui disent « Ah, mais j'avais jamais réalisé à quel point c'était violent ». L’autre raison d’approcher factuellement les objets, c’est que je ne connais pas systématiquement l’histoire ou le contexte associé de chacun, certains restent assez mystérieux. Ou au contraire, j’accompagne de commentaires personnels certains objets récents, ceux des années 2000, période que j’ai vécu et que les personnes suivant les visites guidées ont vécu aussi. Cela nous permet de se remémorer cette époque où par exemple le fat shaming et une misogynie très décomplexée régnaient avec une culture des people ; une sorte de post-féminisme genre « on n'a plus besoin du féminisme ». Les objets de cette époque, que j’ai vécue, permettent de se remémorer des choses qu'on a personnellement vues et qui étaient contemporaines.
Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Recettes de filles dans la collection qui a été publié par Marabout chef, qui date de 2006 et qui est l'adaptation en français d'un livre australien du nom de Kids Cooking. C'est un livre à la quatrième de couverture horrible comportant un jeu de mots « passer à la casserole », les recettes « sont passées trois fois la casserole » avant de vous être proposées. Donc, une expression culture du viol. Quand j'ai trouvé ce livre, ça a fait ressurgir tout cet humour-là, très présent dans les années 2000, dans les livres et jouets pour jeunes filles, que j’ai vécus personnellement quand j’étais jeune et qui déjà à l’époque me gênait. Souvent, les personnes venant aux visites de MUSOGYNIE sont suffisamment âgées pour l’avoir vécu aussi. À la dernière visite que j'ai faite, une femme d’environ 50 ans avait connu l’époque de Matzneff en France, tous ces gars du cinéma français qui sortaient avec des jeunettes. Elle nous en parlait et disait comment c’était normalisé, comment elle-même adhérait à cette culture et trouvait ça « trop cool » de sortir avec des vieux. Les témoignages se recoupent beaucoup entre les participants et participantes de la visite. J’apprécie de laisser à chaque personne la possibilité d'apporter sa propre vision sur les objets : c'est pour cela que j'essaie de ne pas avoir une approche trop justificative de cette misogynie. Je ne suis pas une historienne, ni une conservatrice de musée, j'essaye de ne pas non plus prétendre une expertise que je n'ai pas.
Tu as parlé d’appropriation / réappropriation, un terme qui est beaucoup utilisé pour désigner lorsque des groupes oppressés se saisissent de ce qui a été créé sans eux, et souvent à leurs dépens, et s’en servent pour donner plus de force à leur propre voix. Penses-tu que c'est le cas avec MUSOGYNIE ? Ta réappropriation prend-elle une forme créative ?
M.G : Je puise beaucoup dans MUSOGYNIE pour mon travail personnel, notamment mon travail d'écriture et de musique. C'est ce que je fais principalement en dehors de ce projet. MUSOGYNIE est un socle sur lequel je construis tout mon travail. Il y a deux ans, j'avais organisé avec un collectif qui s'appelle B.R.A.V.E. à Schaerbeek, à Bruxelles, des résidences d'artistes[2]. Pendant un mois, quatre artistes avaient travaillé avec la collection MUSOGYNIE et créaient des œuvres avec. Ce format a existé à un moment, d'inviter d'autres personnes à se réapproprier le contenu de cette collection. Pour moi, MUSOGYNIE est un projet créatif et artistique en tant que tel. C'est vraiment un musée d'artistes et c’est ce que je veux assumer.
Tu aurais des exemples précis d’œuvres faites sur le socle de MUSOGYNIE ?
M.G : Pour une exposition il y a trois ans - que j'ai ensuite repris plusieurs fois dans d'autres expos - j’ai fait une réécriture de chansons paillardes, version lesbienne. C'était pour une exposition autour de l'identité lesbienne où j’avais été invitée à faire une pièce. C'était une installation sonore avec des chansons paillardes, un peu grivoises du répertoire traditionnel français que j'avais réécrites version lesbienne[3]. Certaines chansons paillardes sont vraiment trash : très misogynes ou juste très scato. J'avais fait une version live en chantant devant un public pendant des festivals queer. Ce projet par exemple m’a été directement inspiré de ma collection. Ou encore, j’ai créé une performance qui s'appelait Femme sans tête, tout en est bon[4], qui est un proverbe misogyne du 16e ou 17e siècle. À cette époque, il y avait une tendance de gravures qui représentaient un personnage forgeron du nom de Lustucru. Les maris, insatisfaits de leurs compagnes, les apportaient à Lustucru pour qu’elles se fassent taper la tête afin de les rendre dociles et aimables. Il y a donc des gravures représentant une forge avec un forgeron frappant des têtes de femmes sur son enclume, avec plein de têtes alignées dans le fond. Ces gravures circulaient de manière anonyme dans des brochures. Cette performance, autour de ce motif de tête de femme à retaper ou de femme à refaire, consistait en la lecture d’un texte qui était un montage de citations misogynes prises dans différents ouvrages. À cela s’ajoutait la projection de cette gravure, et à chaque fois que j'utilisais une citation, sa référence apparaissait à l'écran. Cela a créé une cartographie de toutes ces citations misogynes. C’était une performance vraiment prise dans le fond MUSOGYNIE.
Un grand merci pour cette discussion qui offre un éclairage nouveau sur les pratiques muséales et, plus largement, nourrit la réflexion sur la manière dont chacun·e s’empare des héritages violents.
Romane Ottaviano
[1]Exposition « Les Sillons #1 », curatée par Thomas Conchou, Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, 19/03 – 16/07//2023. White cube : type d’espace d’exposition dépouillé, aux murs blancs et sans fenêtre. ↩
[2]https://brave1030.org/MUSOGYNIE-x-B-R-A-V-E ↩
[3]Les Mirlitons, 2022-2024, installation sonore, exposition Lesbien•x•nes à B.R.A.V.E. (Schaerbeek, Belgique). ↩
[4]Femme sans tête, tout en est bon, 2021, performance, festival À boire et à manger, Centre Tour à Plomb, Bruxelles. ↩
En savoir plus
Prochaines visites de MUSOGYNIE au Poisson sans bicyclette, Bruxelles (Le poisson sans bicyclette – Le poisson sans bicyclette) :
- 5 décembre 2025
- 20 décembre 2025
- Mélina Ghorafi
- MÉLINA (@melinaghorafi) • Photos et vidéos Instagram
- https://www.wishlistr.com/musogynie/
A lire aussi :
-Article de l'Art de Muser sur le Musée National du Patriarcat
#Muséemisogynie #objetsensible #violence #MUSOGYNIE
Open Museum Passard, une mission réussie ?
Le Palais des Beaux-Arts de Lille a choisi un chef étoilé pour donner un nouveau regard sur ses collections, sa mission est-elle remplie ?
Je commence un stage en médiation dans cette incroyable structure. Le musée est en pleine effervescence : conception de son nouveau projet scientifique et culturel dédié aux publics, projet de réaménagement de l’Atrium, réalisation de l’Open Museum ZEP…
Tout en m’imprégnant des objectifs de cet Open Museum, revisiter l’histoire de l’art et attirer de nouveaux visages, ma principale mission était d’aider à la mise en place du vernissage enfants en réalisant les fiches des œuvres que ZEP a choisi de mettre en lumière. Faire le lien entre ces deux univers pour que les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants soient les meilleurs guides d’un jour.
Affiche d’Open Museum #4 © PBA
Décembre 2015 – Palais des Beaux-Arts, Lille.
Je me sentais presque privilégiée de voir les dessins et animations exclusives que l’auteur de BD avait réalisés en s’appuyant sur les chefs d’œuvre du musée. Le pari était gagné. J’en étais certaine, cet Open Museum ferait un carton. Le père de Titeuf avait réussi à décomplexer notre rapport à l’histoire de l’art et à capter l’attention de ses amateurs mais aussi de ses initiés. On irait au musée par plaisir, on rirait devant des œuvres, on comprendrait leur histoire et sortirait avec l’envie de revenir l’année prochaine en se demandant ce que le PBA pourrait bien nous réserver.
Février 2016 – même lieu.
Ce questionnement, je l’ai moi-même eu. Discrètement, j’ai donc demandé à ma tutrice de stage si le musée avait une idée du nouvel invité de la quatrième édition de l’Open Museum. J’appris alors que le directeur, Brunon Girveau, était en discussion avec Alain Passard, le chef étoilé du restaurant l’Arpège, mais que rien n’était encore fixé. Décidément, le PBA me surprendrait toujours.
J’avais laissé libre cours à mon imagination : comment un chef pouvait apporter un regard nouveau sur les collections du Palais des Beaux-Arts ? Quel nouveau public pouvait-il attirer ? Quelle forme prendrait cet Open Museum ? Et puis, j’avais attendu patiemment son ouverture, sans savoir si Passard serait définitivement l’heureux élu.
Septembre 2016 – chez moi, Lille.
Ça y est, c’est officiel. Cela sera bien Alain Passard le centre de l’attention pour l’Open Museum #4. Le PBA lui offre sa fameuse carte blanche devenue un rendez-vous annuel. Que cela va-t-il bien donner ?
Je lis quelques articles de presse qui annoncent l’événement, me documente et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce chef Passard avait lui-même une pratique artistique autre que la cuisine. Ce féru d’art contemporain fait d’ailleurs ressentir dans sa cuisine ses autres passions : la sculpture, le collage à travers des associations de matières ou de formes…
Mars 2017 – le Sweet Flamingo, Lille.
Je déjeune avec mon ancienne tutrice de stage. Elle m’avait envoyé les documents de communication pour que je cerne cet Open Museum dont j’avais entendu quelques remarques par une amie agent d’accueil…
Surprise, Alain Passard est le commissaire de l’exposition et présentera quelques-unes de ses œuvres, mais, il donnera aussi la primauté à d’autres artistes contemporains. Il partagera l’événement avec Valentine Meyer, une curatrice indépendante et bien sûr Bruno Girveau et Régis Cotentin, le chargé de la programmation contemporaine.
À partir de ce moment, je doute. Je ne suis pas une initiée de l’art contemporain, et pourtant, je travaille dans le milieu culturel, qui plus est dans celui des musées. Alors, je me mets à la place de ceux qui ne sont pas des habitués, ceux qui sont éloignés de ces problématiques. Comment un Open Museum peut-il attirer de nouveaux venus en proposant un événement intégrant de l’art contemporain, qui peut selon moi, autant réunir qu’exclure. En choisissant cette orientation, le PBA s’est lancé dans un pari risqué mais conscient. Comment allait-il réussir son coup ?
30 avril 2017 – Palais des Beaux-Arts, Lille.
J’entre dans le PBA curieuse et décidée à m’ouvrir aux méandres de l’art contemporain. Je trouve toujours génialel’idée d’inviter un chef dans un musée mais je m’interroge quant à la façon de procéder. Ticket et livret d’aide à la visite en main, nous voilà lancées, Joanna et moi. Nous n’avons pas bien vu la première installation, les grandes pinces de homard installées dans l’entrée, dommage. Peut-être mériteraient-elles plus de lumières ou un autre lieu d’exposition… Mais nous nous sommes arrêtées un moment dans l’atrium. Les Marmites enragées de Pilar Albarracín qui reprennent l’Internationale nous font sourire et nous partons confiantes. L’art de la cuisine ou la cuisine de l’art est un monde à découvrir.

Les Marmites enragées de Pilar Albarracin © L.T.
Nous tentons de suivre le parcours, nous devons certainement rater quelques œuvres, nous passons plus ou moins de temps devant d’autres, nous nous promenons à tous les étagesdu musée. Certaines nous posent question : pourquoi ce choix ? quel lien ? quelle utilité ? Nous sommes parfois dubitatives. Malheureusement, ce n’est pas avec l’Open Museum Passard que je vais m’ouvrir plus largement à l’art contemporain, ; ce n’est pas l’art en lui-même qui me dérange, ici c’est la façon dont il intervient sur le parcours et le lien entre le musée et la cuisine. Le propos peut être évident lorsque l’on croise sur son chemin une tenue de cuisinier. Le montage vidéo avec Le Gobelet d’Argent de Chardin est intéressant : voir le chef à l’ouvrage dans le reflet des instruments de cuisine… Je reste sur ma faim. J’aurais souhaité que les liens avec les œuvres du musée soient plus intuitifs. Le dialogue entre la sculpture du vendeur ambulant indien faite de montres (Mumbai Dabbawala de Valey Shende, 2015) et d’un tableau qui évoque l’Orient avec L’adoration des mages n’est pas évident pour tout le monde… Pour avoir travaillé sur une édition précédente, je sais que les œuvres de l’Open Museum ne sont pas placées là par hasard, alors pourquoi en ai-je la sensation pour cette quatrième saison ?
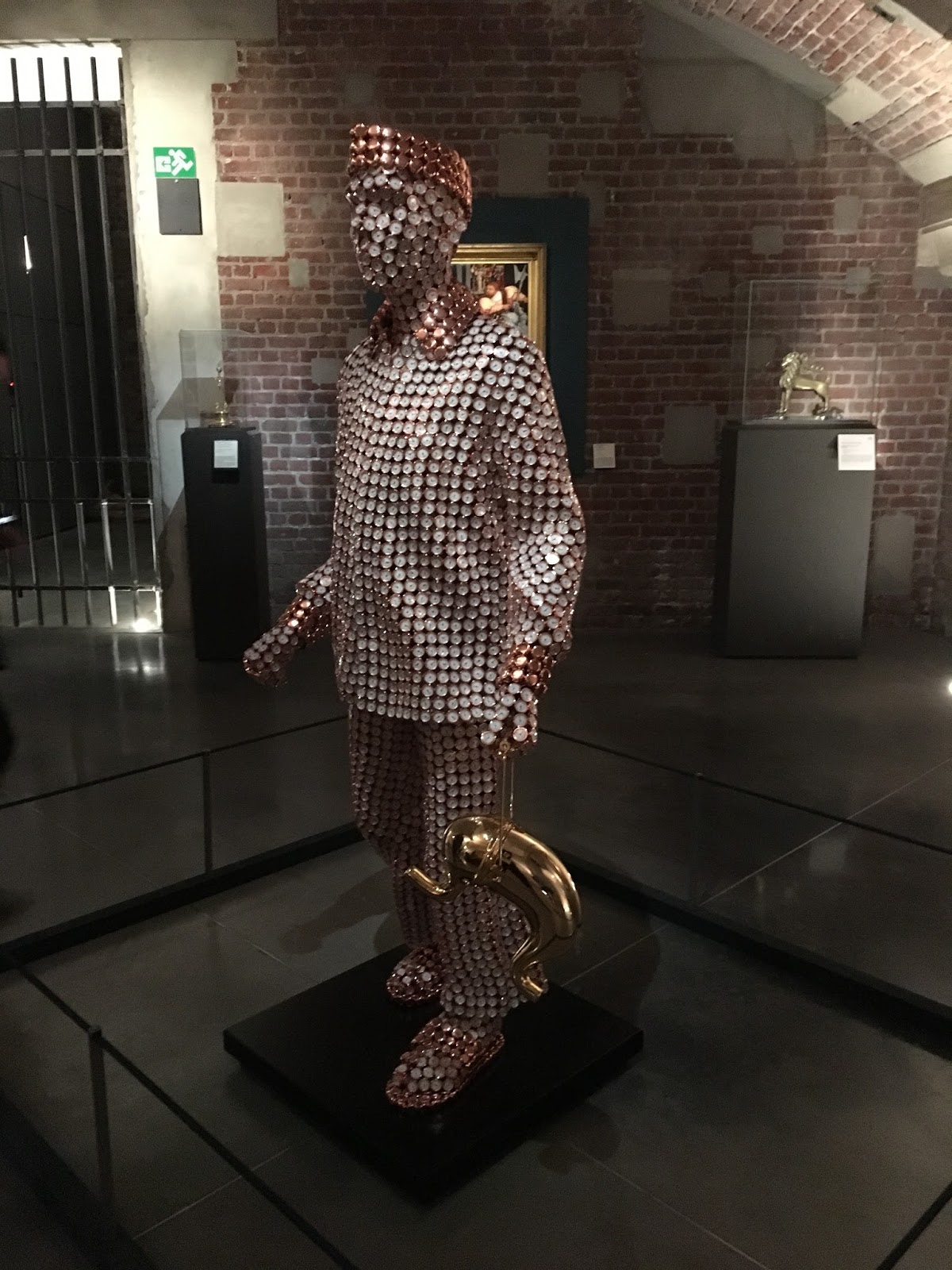
Mumbai Dabbawala de Valey Shende, 2015 ©L.T.
Mai 2017 – chez moi, Lille.
En écrivant cet article, je me rends compte que je ne sais toujours pas ce que je pense de cette quatrième édition, Open Museum Passard. J’avais envie d’aimer. Je n’avais pas envie de ne pas aimer. Mais je dois me l’avouer, j’espérais que cela soit différent : plus de choses à toucher, sentir, plus de sons, d’effervescence. Bref, vivre et ressentir l’atmosphère même d’une cuisine, découvrir qu’en tant que lieu de travail, que contenant d’autres objets et personnages à l’ouvrage, en tant qu’ambiance, la Cuisine était une œuvre d’art, un art en elle-même. Passer après ZEP et son humour décalé était une difficulté en soi et créait chez le visiteur une véritable attente : inviter un chef lors de cette édition laissait à penser que cela serait surtout son métier d’artiste culinaire qui serait mis à jour et que des liens seraient tissés par ce biais. Cela est parfois chose faite grâce à l’exposition des menus qui selon qu’ils soient lus dans un restaurant ou dans un musée n’ont pas le même effet… De fait, le PBA nous a bien étonnées et continuera de tisser des liens entre les différents pans de la culture, des arts. Il fallait oser.
Lucie Taverne
#openmuseum
#pba

Openmuseum Séries TV : seulement une thématique attractive ?
Chaque année, le Palais des Beaux-arts de Lille organise son « Openmuseum » et donne carte blanche à un invité inattendu qui investit le musée et propose un dialogue inédit avec les collections.

Ouvrir les réserves muséales au public : zoom sur l’Artothèque de Mons
Conserver et préserver des objets dans les meilleures conditions possibles fait partie des missions principales des musées. Pourtant, ne faisant pas l’objet d’une couverture médiatique car invisibles aux yeux du public, elles souffrent trop souvent du désintérêt des pouvoirs politiques, perçues comme de simples lieux de stockage. Heureusement, depuis une quinzaine d’années, de plus en plus d’institutions profitent du déménagement ou du réaménagement de leur réserve pour développer une stratégie de communication de ces lieux envers le public. Si certaines, à l’image de la réserve commune des musées de Nancy, font le choix de la discrétion, d’autres les dotent de nouvelles fonctions comme l’a anticipé dès sa conception l’Artothèque de Mons.
Un laboratoire à idées
Inaugurée à l’occasion de « Mons 2015, Capitale européenne de la culture », l’Artothèque est le fruit de dix années de réflexion. Elle regroupe aujourd’hui les collections éclectiques de onze sites muséaux et lieux d’exposition montois réparties sur 1000 m² de réserves dans l’ancienne Chapelle du couvent des Ursulines. À la fois centre de réserve, de restauration, d’étude et de recherche, elle allie les missions de conservation et de transmission du patrimoine muséal montois au public via différentes démarches, reflet d’un engouement général qui a pour ambition d’animer et effacer l’image poussiéreuse des réserves.
Les réserves visitables : au cœur des coulisses des musées
Bien souvent, les visiteurs des musées n’ont pas conscience que ne sont exposée qu’une infime partie des collections muséales. Ce sont parfois 90% de ces collections qui « dorment » dans les réserves. Pour faire découvrir ce riche patrimoine insoupçonné, le premier pas de la part d'un musée est généralement d’ouvrir ses réserves au public à travers des visites guidées sur demande. À l’Artothèque, ce service est confié à l’office du tourisme. Les participants, bien qu’enthousiasmés par cette offre, regrettent que ces visites ne soient pas assurées par des membres du personnel interne. Ce type de visite est en effet l’occasion de découvrir les différents métiers méconnus liés à la gestion des collections. Lors des visites des réserves du Musée des Arts et Métiers de Paris, de nombreux participants rapportent l’expérience très positive de leur rencontre avec les restaurateurs au sein même de leur atelier. Ce sentiment d’exclusivité donné aux visiteurs est également un moyen intermédiaire pour leur faire prendre conscience des enjeux de toute cette face cachée des musées.
Certains pointeront du doigt les risques en matière de sécurité encourus pour les œuvres et les personnes lors de la visite de ces lieux au départ non prévus à l’accueil du public. À l’Artothèque, les groupes ne dépassent pas dix participants et la circulation des œuvres et du public a bien entendu été étudiée au préalable.
Des échantillons de réserve derrière des vitrines
Lorsque que le visiteur entre dans le hall d’accueil de l’Artothèque, il découvre d’emblée une réserve d’œuvres de grands formats dont il est séparé par des parois vitrées. Des images multimédias tactiles projetées sur celles-ci présentent l’ensemble des réserves et apportent des informations sur la conservation préventive. Cette présentation assez curieuse mélange un sentiment d’immersion mais aussi de mise à distance. Elle évoque à la fois les « visibles storages » américaines, mais aussi la Tour des instruments dans le hall du musée du quai Branly qui ne se visite pas mais peut être interprétée via une application mobile, ainsi que les baies vitrées internes du musée du Louvre-Lens qui ouvrent le regard sur une partie des réserves et de l’atelier de restauration.
Le hall de l’Artothèque et sa réserve-vitrine © http://www.artotheque.mons.be/presentation/fuillet-artotheque
Si le hall est parfois qualifié d’aménagement scénographié, lorsque le public franchit les portes de cet ancien couvent, il a conscience qu’il entre dans des réserves muséales. Dans d’autres cas, l’ambiguïté entre espace de réserve et espace d’exposition peut porter à confusion. Quand des visiteurs se rendent au Musée Aan de Stroom à Anvers (MAS), ils ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un des dix étages du musée soit consacré à la présentation d’un dépôt composé de 180 000 objets répartis sur des grilles derrière des fenêtres, dans des tiroirs à ouvrir protégés de vitres et sur des rayonnages de plusieurs mètres de haut. À l’Historisches Museum de Lucerne, l’expérience va encore plus loin. L’exposition permanente utilise les codes visuels des réserves comme principe scénographique (fléchage au sol, accumulation des objets sur les étagères, cartels sous forme de code-barres à scanner…). Certains saluent l’originalité amusante de cette mise en scène, d’autres regrettent le manque de mise en valeur des objets.

Exposition permanente à l’Historisches Museum de Lucerne © http://grosseltern-magazin.ch/historisches-museum-luzern/
Quoi qu’il en soit, ces espaces hybrides ne reflètent pas toujours la réalité des réserves. On ne montre que ce que l'on choisit de montrer, contrairement aux visites guidées in situ peut-être plus authentiques. Néanmoins, ces échantillons de réserves « modèles » ont le mérite de présenter aux néophytes un aperçu d’une facette des musées habituellement restée dans l’ombre.
S’approprier le patrimoine à travers un écran
Dès lors, la médiation est indispensable pour transmettre au public de multiples informations à propos de ce qui se présente à lui. Le numérique est alors un outil formidable que l’Artothèque exploite pleinement. S’il intervient déjà dans le hall d’accueil pour présenter les lieux et expliquer le parcours d’une œuvre dans la réserve, le numérique invite le visiteur à adopter une posture active dans la deuxième partie du parcours, plus spécifiquement consacrée à l’étude des collections. C’est dans l’ancienne nef latérale que l’on découvre des dispositifs multimédias au sein même de divers tableaux, costumes, soupières, monnaies et autres curiosités. Le premier propose une immersion dans les collections via un écran panoramique incurvé sur lequel l’intervenant peut interagir avec les œuvres et documents projetés via un détecteur de mouvement. L’exploration des collections se poursuit sur les douze écrans tactiles répartis en trois meubles pour naviguer des ressources numériques aux objets présentés dans les tiroirs à ouvrir, les armoires et les murs de la pièce selon différents scénarios possibles, du plus ludique au plus classique, construits par le visiteur lui-même. Le foisonnement des innombrables œuvres que renferme la réserve s’offre alors au regard des plus curieux et, indirectement, les encouragent à développer leur intérêt pour le patrimoine et éventuellement se rendre dans les musées dont sont issues ces œuvres.
Dans tous les cas, le numérique permet la découverte en autonomie des réserves, de ses collections, de leur fonctionnement et leurs enjeux. Devant les baies vitrées qui séparent les réserves du public au musée du Louvre-Lens, on retrouve également ce même type de tablettes tactiles pour accompagner le visiteur dans la compréhension du lieu. D’autres musées comme le Mucem ne s’arrêtent pas à la numérisation des œuvres, et donnent accès à une visite virtuelle des réserves grâce à la technologie street view de Google.
Mobiliers multimédias dans les collections de l’Artothèque © Laurence Louis
Centres de ressources et au-delà
Une autre proposition pour dynamiser une réserve muséale est de l’accompagner d’un centre de documentation et de ressources. Au Mucem toujours, le Centre de Conservation et de Ressources (CCR) se décline en quatre espaces ouverts au public : une salle de consultation des objets, une salle de lecture, une salle d'exposition et des réserves. À l’Artothèque, le Centre de documentation, attaché au Pôle muséal et au Réseau de Lecture publique de la Ville de Mons, est devenu un lieu de référence pour les recherches concernant l’histoire de Mons et ses collections muséales à travers de nombreux ouvrages, périodiques, catalogues d’exposition, coupures de presse, dossier de presse… et bien sûr pour la consultation de l’inventaire des collections.
Mais tel un musée à part entière, elle pousse encore plus loin son offre en proposant une réelle programmation culturelle entre ateliers créatifs, stages, nuits contées, projections cinématographiques, workshops pour les professionnels, mini expositions… Dans cette optique, le pôle de conservation et d’étude de Strasbourg actuellement en construction se positionne de façon encore plus ambitieuse se situant sur un site qui proposera à terme logements, bureaux, restaurants, salles de concerts et ateliers d’artistes et artisans. Cet éparpillement risque cependant de créer de l’incompréhension de la part du public face à ces diversifications à outrance de l’offre de ce qui avait pour fonction originelle des réserves muséales.
Un modèle d’inspiration
Dans sa conception même, l’Artothèque de Mons se présente comme un lieu insolite du paysage muséal. Avec son comptoir d’accueil, ses propres tarifs et horaires d’ouverture, ses espaces scénographiés, ses outils numériques, ses publications et son offre culturelle et pédagogique, ce centre de conservation, de restauration, d’étude et de transmission du patrimoine montois remplit finalement les missions d’un musée en tant que tel. Bien que son concept soit singulier, l’Artothèque est en réalité représentative de l’engouement général d’un souhait de dynamisation des réserves, d’ouverture au public de cette richesse patrimoniale sous-estimée et d’une meilleure compréhension de l’institution muséale.
Évidemment, ce projet a pu bénéficier de l’opportunité d’un soutien politique et financier à travers l’évènement « Mons 2015 ». Chaque structure peut cependant s’inspirer de ces différentes pistes d’action pour attiser la curiosité croissante du public à l’égard de cette face cachée des musées.
Laurence Louis
#Artotheque
#Reserves
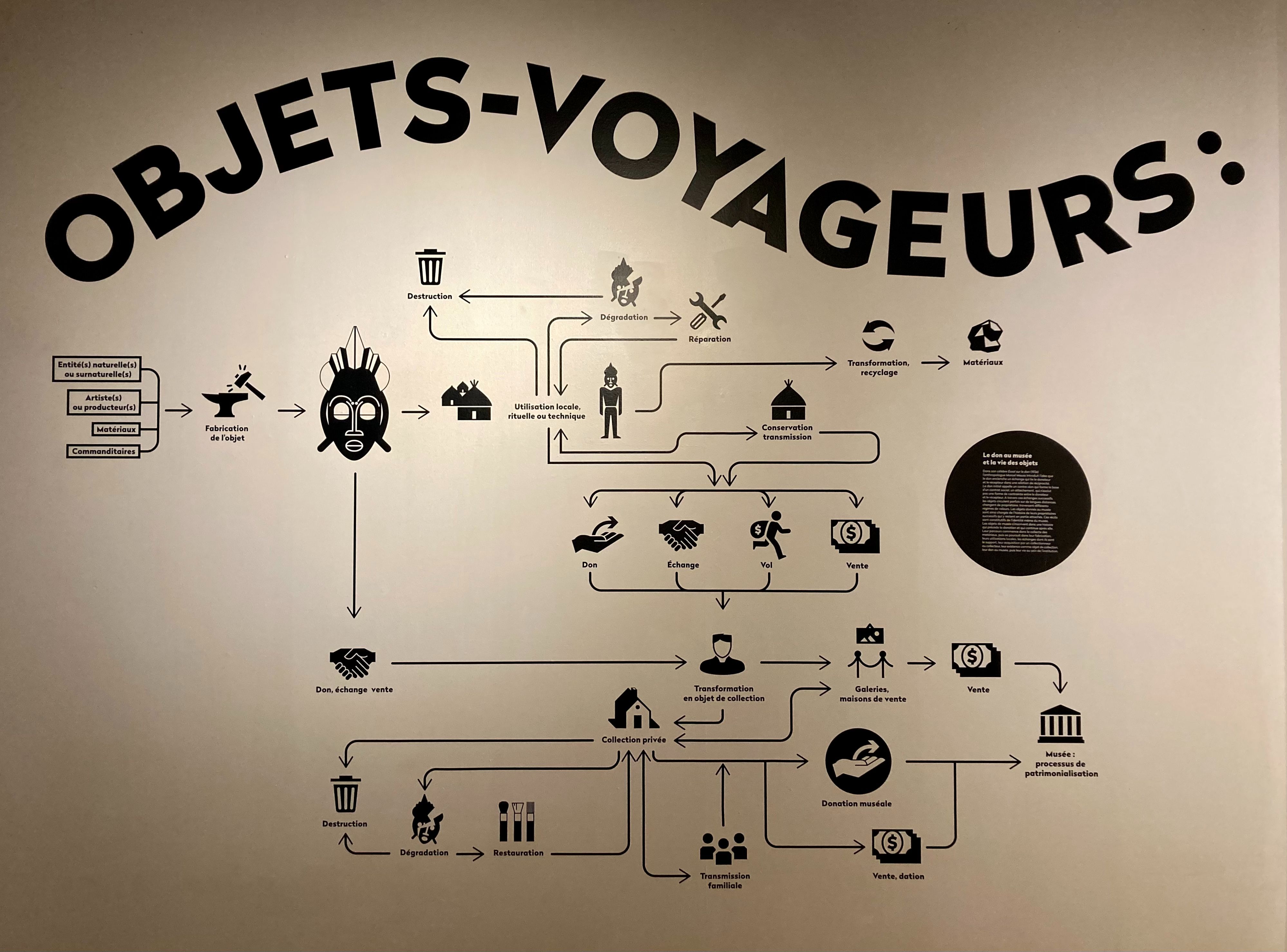
Oyez oyez, le musée dévoile ses secrets !
Sais-tu quelles étaient les vies passées des objets de collection présents dans les musées ou encore comment les conserver ? Aujourd’hui, nous décryptons ensemble cette nouvelle mouvance : les expositions temporaires qui cherchent à te sensibiliser au fonctionnement d’un musée.
Chère visiteuse, cher visiteur,
Te demandes-tu comment les objets de collections que tu admires, qui te dérangent, qui t’interrogent, ou qui te laissent indifférents lorsque tu visites une exposition sont arrivés dans le musée ? Quelles étaient leurs vies passées ? Pour quelles raisons et de quelle manière ont-ils été acquis ? Comment ont-ils traversé les siècles pour être toujours intacts ? Et quels sont les métiers des professionnels qui gravitent dans un musée ?
Si tu es de nature curieuse, que tu te découvres une véritable passion pour ce qui est d’ordinaire inaccessible, alors tu t’es peut-être déjà laissé séduire par une visite des réserves de musées. Ces lieux qui semblent mystérieux et où dorment les objets lorsqu’ils ne sont pas exposés.
Certaines institutions cherchent à sensibiliser leurs publics à ces pratiques muséales. Elles développent leur programmation culturelle et l’enrichissent de médiations insolites : le Louvre Lens te propose une visite des coulisses du musée accessible dès 8 ans, tandis que le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, en Suisse, t’invite à contribuer au déménagement des collections. Il t’apprend à dépoussiérer, t’initie aux constats d’états et tu peux même participer à l’emballage de certains objets du musée aux côtés d’une restauratrice.

Atelier de conditionnement au sein de l’exposition temporaire « Emballe-moi », Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel ©CL.
Aujourd’hui, nous décryptons ensemble cette nouvelle mouvance : les expositions qui cherchent à te sensibiliser au fonctionnement d’un musée, et qui sait, te donneront envie de changer de métier ?
Comment les objets se retrouvent-ils au musée ?
Les musées ont plusieurs typologies de collections et conservent en leurs murs aussi bien le patrimoine culturel matériel qu’immatériel. Ils regorgent d’objets aux valeurs symboliques, esthétiques, marchandes, pédagogiques, historiques… qui sont polysémiques. Cela signifie qu’on leur attribue un sens différent en fonction du contexte de l’exposition, de son sujet, de ce que les muséographes, commissaires ou concepteurs d’expositions cherchent à illustrer, montrer, du message qu’ils veulent transmettre.
Mais les objets qui sont entrés dans les collections d’un musée n’ont pas tous été acquis de la même manière : donnés par des collectionneurs, légués par des héritiers, achetés par l’Etat, ils sont également dans les musées d’ethnographie principalement, pillés et volés lors des grandes campagnes de collecte à l’époque coloniale (qui s’étend du 16e au 20e siècle). Les conservateurs de musées, en tant que garants et passeurs de cet héritage, ont le devoir d’informer leurs publics sur cette histoire. La nouvelle définition du musée, définie par l’ICOM (Le conseil international des musées) et votée en août 2022, réaffirme le devoir d’éthique incombé aux musées :
« Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. »
Afin de connaitre le mode d’acquisition des objets, des chercheurs étudient leur origine : c’est ce que l’on nomme la recherche de provenance. Elle permet d’établir des liens avec les contextes de spoliation des biens culturels : fouilles clandestines, pillage par les colons ou encore par le régime nazi.
L’anthropologue Arnaud Morvan a entrepris en 2017 une recherche de provenance socio-anthropologique pour le Musée des Civilisations – Daniel Pouget à Saint-Just Saint Rambert. De cette recherche est née l’exposition « Objets-voyageurs : l’énigme du don », présentée au public de juin 2021 à septembre 2022. L’occasion pour l’institution de montrer en toute transparence, l’histoire des collections ethnographiques qu’elle conserve. L’exposition questionne l’acte du don et du contre-don, interroge la constitution des collections et les modes d’acquisition et propose une nouvelle lecture qui met en dialogue l’histoire singulière des donateurs et donatrices avec les parcours des objets en retraçant la biographie de chacun.
D’un point de vue muséographique, les cartels sont souvent l’occasion d’expliciter le mode d’acquisition de l’œuvre. Dans l’exposition « Objets-voyageurs : l’énigme du don », une frise pictographique permet de connaitre les principales étapes de la vie de l’objet, un cartel simple dévoile les informations descriptives et un cartel développé éclaire le contexte de fabrication de l’objet, son utilisation au sein de la société, sa symbolique, les conditions de son acquisition ainsi que sa vie au sein du musée [1].

Différents niveaux de lecture des cartels de deux œuvres au sein de l’exposition temporaire « Objets-voyageurs : l’énigme du don » au Musée des Civilisations – Daniel Pouget à Saint-Just Saint Rambert ©CL.
Le cartel met en évidence les conditions de la saisie des objets et interroge les différents statuts et valeurs qui leur sont attribuées. La patrimonialisation, révélée par la taille du numéro d’inventaire comme l’information la plus importante visuellement, apparait comme un évènement radical dans le parcours de l’objet et questionne ainsi le rôle de l’institution dans la reconceptualisation des objets ethnographiques. Le cartel du reliquaire fait prendre conscience que la collecte est parfois motivée par la dimension esthétique. Tandis qu’en exposant une tablette de bois provenant de l’île de Pâques, le discours tenu par l’institution se veut plus engagé, questionne sur le non-sens que représente la pratique de collecte : arracher des biens ayant une valeur sacrée à des communautés pour les exposer dans des musées occidentaux.
Au MEG, Musée d’ethnographie de Genève, c’est également par le biais du cartel que le mode d’acquisition des objets de collections exposés est présenté dans le parcours permanent. Si ce dernier est plus neutre dans sa formulation (les précisions sont purement factuelles), le musée est précurseur dans sa pratique de la recherche de provenance, qu’il réfléchit dans une perspective décoloniale [2].
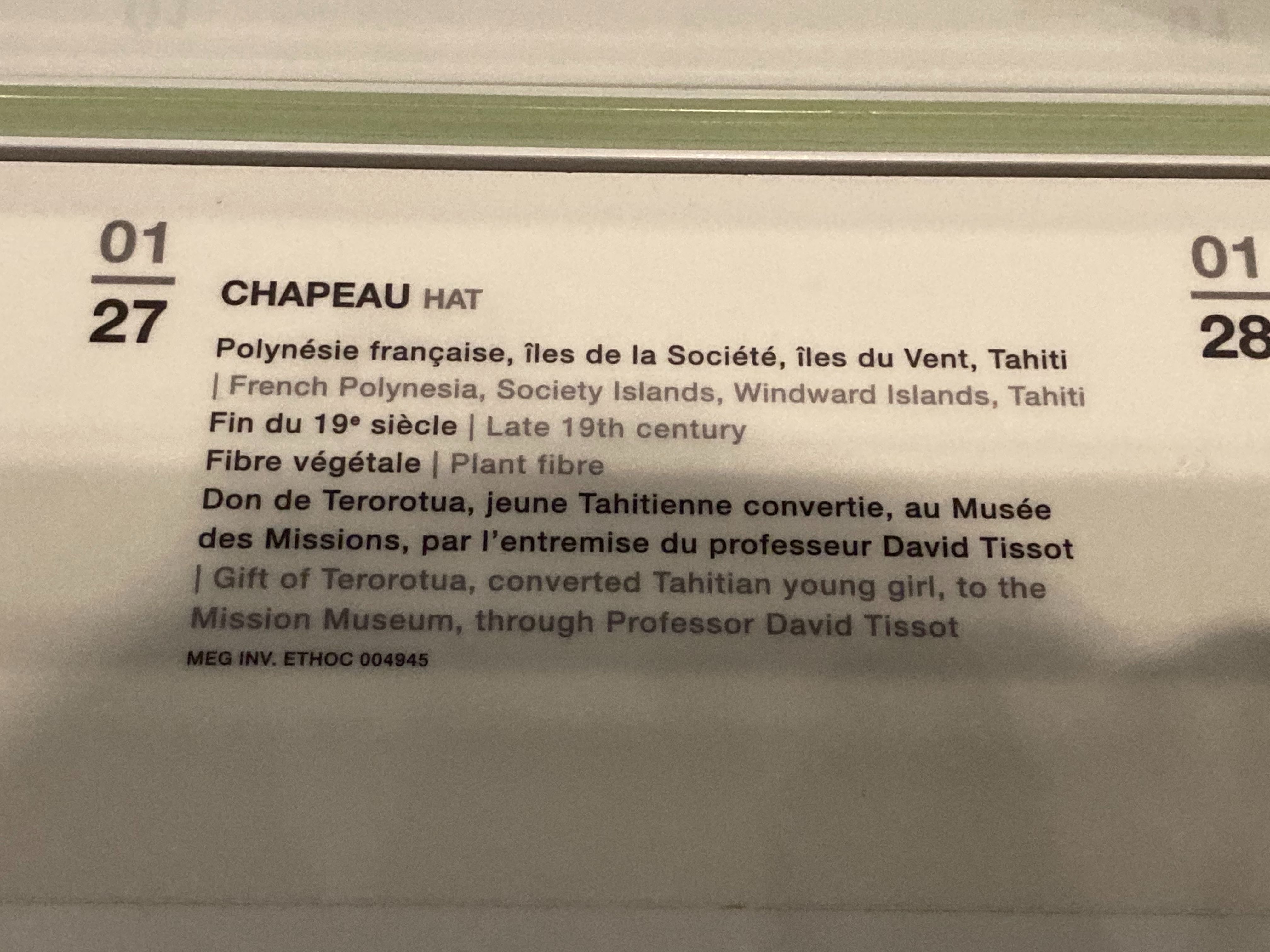
Cartel de l’exposition permanente « Les archives de la diversité humaine » au MEG (Musée d’Ethnographie de Genève), sur lequel est indiqué le mode d’acquisition de ce chapeau polynésien ©CL.
Tu l’auras compris, les collections des musées d’ethnographie et de civilisations européens sont principalement issues des spoliations coloniales. Le cas du Tropenmuseum à Ammsterdam, créé en 1864 sous le nom de Musée Colonial, est en ce sens intéressant. Il t’offre la possibilité de débuter le parcours de visite par un espace de remise en contexte, où les questions qui semblent taboues sont posées. Par exemple : « Tout ce que vous voyez ici a-t-il été volé ? », permet d’éclairer l’histoire coloniale du musée, de susciter la réflexion et de modifier le regard des visiteurs sur le patrimoine culturel exposé dans le parcours permanent, qu’il découvre au fil de sa visite.
Réponse : « Les objets du musée ont été acquis de diverses manières ; ils ont été achetés, donnés et parfois volés. Cela s'est produit dans le contexte de l'oppression coloniale, du commerce, des actions militaires, des projets scientifiques et du travail missionnaire. Une grande partie de la collection date de la période coloniale. Le Tropenmuseum considère que les objets qui n'ont pas été abandonnés volontairement ou qui ont plus de valeur culturelle dans le pays d'origine peuvent être restitués. »
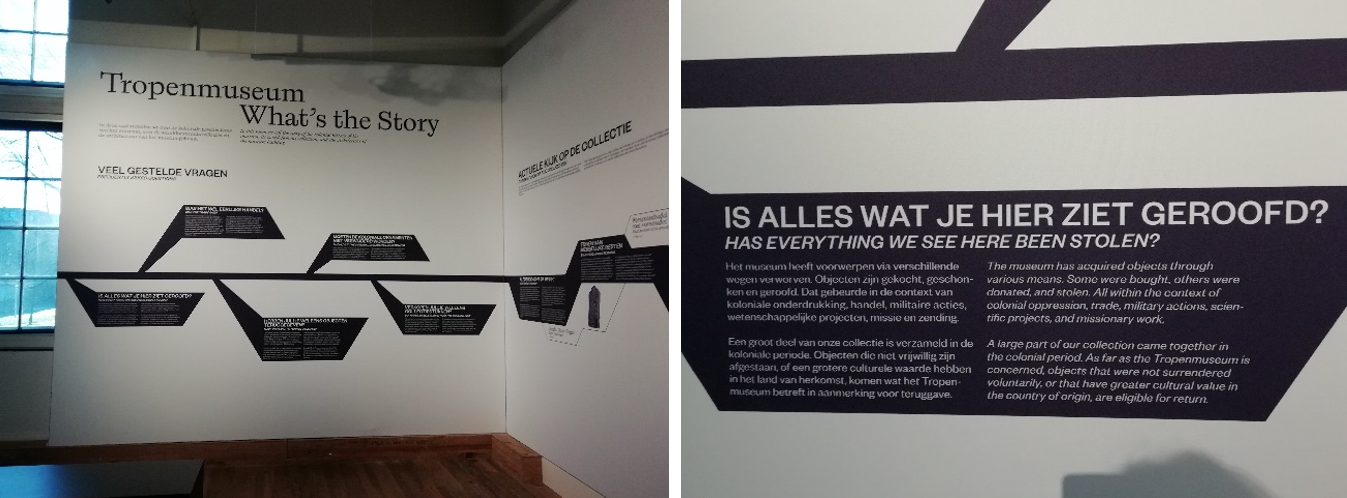
Cimaise de questions-réponses au sein de l’exposition permanente « C’est quoi l’histoire ? » du Tropenmuseum à Amsterdam ©Sibylle Neveu.
Si certaines institutions portent ce regard dans le parcours permanent, d’autres conçoivent des expositions temporaires leur permettant d’expliquer aux visiteurs la constitution des collections. C’est notamment le cas du Musée des Confluences à Lyon, qui du 18 juin au 8 mai 2022, présentait « Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires ». Depuis 40 ans, les Œuvres Pontificales Missionnaires de Lyon ont mis en dépôt plus de 2300 objets collectés et envoyés à Lyon par de jeunes missionnaires partis évangéliser les habitants de tous les continents. L’exposition dévoile leurs récits, la vie des objets et ce qui a conduit à les collecter.
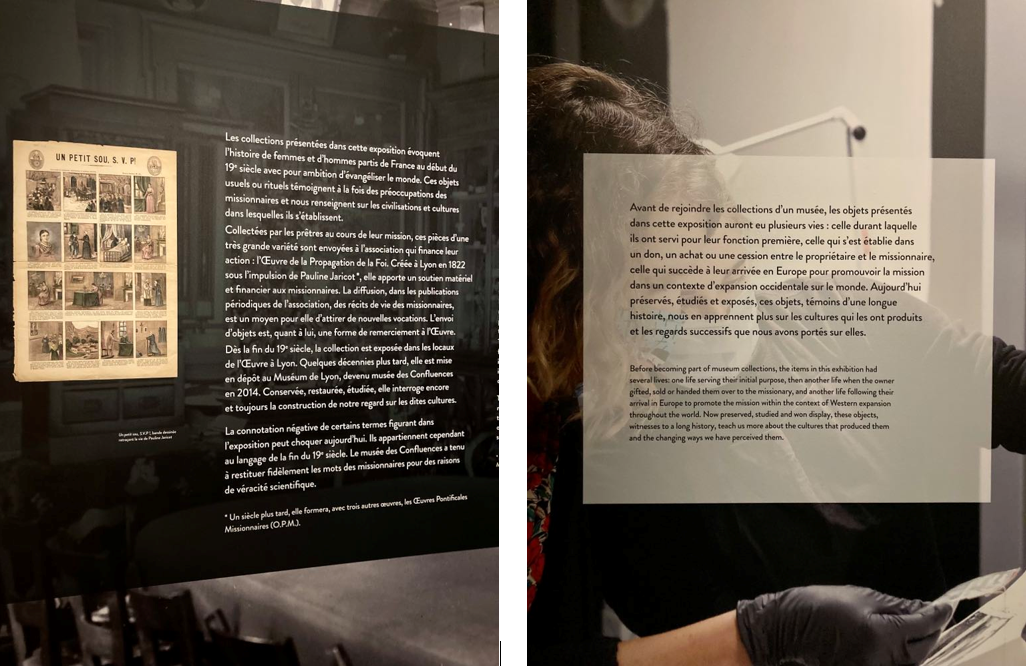
Panneaux d’introduction de l’exposition temporaire « Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires », au Musée des Confluences à Lyon ©CL.
Le Musée d’histoire naturelle de Lille, dans son exposition « Bien conservés ! », ouverte au public depuis le 21 octobre dernier, te plonge dans les coulisses du musée. Au programme, deux parcours sont proposés, dont l’un permet de découvrir les différentes typologies de collections et les fonds conservés ainsi que leur constitution. Le second parcours est plus pratico pratique, et te permet de découvrir comment sont bichonnées les collections.

Les deux parcours de visite de l’exposition temporaire « Bien conservés ! » au Musée d’histoire naturelle de Lille ©CL.
Comment les objets sont-ils conservés dans un musée ?
L’une des plus grandes difficultés rencontrées quand on parle de musée, c’est de faire comprendre que les objets, que tu vois le temps d’une exposition, ne représentent qu’une infime partie des éléments conservés dans les réserves. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel à trouver la solution dans son exposition temporaire « Emballe-moi ».

Figure 1 : Salle présentant la collection d’insectes et d’arachnides au sein de l’exposition temporaire « Emballe-moi » au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel ©CL. La scénographie en tiroirs reprend les meubles de conditionnement de ses collections.
Figure 2 : Vitrine dans la salle des mammifères et exemple d’un cartel « Secrets de conservation » au sein de l’exposition temporaire « Emballe-moi » au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel ©CL.
Dans la première salle, seule 0,008% de la collection de géologie est exposée, contre 0,05% de la collection d’insectes et arachnides dans la suivante et ainsi de suite. En quantifiant les collections au regard de ce que le visiteur voit, tu peux alors imaginer le travail titanesque des chargés de collection et autres professionnels que tu découvriras plus tard au fil de ta visite.
PS : n’oublie pas de monter sur la petite marche dans la salle où sont exposés les champignons et de passer ta tête dans la petite trappe, une surprise t’attend et te permets de découvrir un autre métier, celui de scénographe. A la fin du parcours de visite, des vidéos ludiques et garanties rire assuré, t’emmènent dans un face à face à la rencontre de membres de l’équipe. Tu peux découvrir les personnalités de différents intervenants tels que le taxidermiste du musée.
En plus de connaitre la quantité des spécimens conservés au Muséum, tu découvres aussi la manière dont ils le sont (regardes les cartels « Secret de conservation ») comme les différentes techniques de préparation des insectes ou encore le montage taxidermique, la lyophilisation et bien d’autres. Envie d’en savoir plus ? Lyophiliser, c’est retirer l’eau d’un spécimen tout en gardant sa forme, cette technique est utilisée pour empêcher les moisissures. Attention à la déformation professionnelle, après ces explications, tu n’observeras plus les collections de la même façon.
Au Musée d’histoire naturelle de Lille, toujours pour l’exposition « Bien conservés ! », ce sont les différentes étapes de gestion des collections qui sont explicitées. Tu apprends le vocabulaire professionnel propre au monde des musées. Comme ce qu’est une fiche d’inventaire : la carte d’identité de l’objet qui indique son numéro, son mode d’acquisition et son année d’entrée dans les collections, une description et les matériaux et techniques de fabrication utilisés… En passant par la nécessité de réguler les conditions climatiques et environnementales dans les réserves. S’il y a un élément nécessaire à retenir, c’est la stabilité de la température ou de l’hygrométrie ; les objets supportent très mal les changements trop bruts d’environnement. En ce qui concerne les conditions précises, celles-ci dépendent des matériaux composant les œuvres, objets et spécimens. Les moyens de transport utilisés pour déplacer les collections ainsi que les différentes machines dont se servent les professionnels. Lorsque les objets sont prêtés à différentes institutions muséales dans le cadre d’une exposition temporaire, il faut rester vigilent car les chocs et les vibrations lors du transport peuvent avoir de graves répercussions sur les objets si ces derniers ne sont pas bien emballés. Il existe diverses manières d’emballer les objets, et chacune d’entre elle est réfléchie en fonction de la taille, des matériaux, des altérations possibles et de l’état de conservation de l’objet. Et ce, en totale immersion dans des réserves fictif de musée, de quoi en enchanter plus d’un.
Toutes ces expositions, qu’elles présentent les méthodes de conditionnement des collections, la constitution de ses dernières ou qu’elles explicitent les différents corps de métiers qui gravitent au sein d’un musée, ont un objectif commun – qui la plupart du temps semble atteint –, celui de te donner des clefs de compréhensions pour changer ton regard sur les œuvres et objets de collection exposés !
Alors, convaincu ?
Camille Leblanc
[1] Fabrice Grognet développe le concept de biographie d’objet dans son article : « Objets de musée, n’avez-vous donc qu’une vie ? », Gradhiva, n°2, 2005. URL : http://gradhiva.revues.org/473. La vie de l’objet se poursuit au sein du musée : « Qu’ils soient placés dans la pénombre d’un rayonnage de réserve ou sous les éclairages d’une vitrine, les objets ethnographiques de musée ont bien des choses à nous dire, un réel vécu à raconter. » (Grognet, 2005, p. 49). ↩
[2]MEG, Conférence internationale « Décoloniser la recherche de provenance, Expériences de co-constuction des connaissances et de négociation du futur des collections coloniales », 24-25 novembre 2021. URL : https://www.meg.ch/fr/recherche-collections/decoloniser-recherche-provenance ↩
#Expositions #Acquisitions #Coulisses
Pour en savoir plus :
- CRENN Gaëlle, « La réforme muséale à l’heure postcoloniale. Stratégies muséographiques et reformulation du discours au Musée royal d’Afrique centrale (2005-2012) », Culture & Musées, n°28, 2016, p. 177-201. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/866
- C2RMF, Vade-Mecum de la conservation préventive, 48 p. URL : https://c2rmf.fr/sites/c2rmf/files/vademecum_cc.pdf
- DE CARVALHO Clémence, « Les réserves visitables, ça n'existe pas », Le blog de l’art de muser. URL :https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2118-les-reserves-visitables-ca-n-existe-pas-2
- Des tutos YouTube pour conditionner des œuvres : Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, « Comment enchâsser un grand animal ? », L’instant tuto – Collections bestiales,. URL : https://www.youtube.com/watch?v=nFae2VRQYWQ&ab_channel=Mus%C3%A9umd%27histoirenaturelle-Neuch%C3%A2tel
- HOFFMANN Marie, « Le musée à travers le prisme postcolonial », Histo art, p. 291-304.
- GROGNET Fabrice, « Objets de musée, n’avez-vous donc qu’une vie ? », Gradhiva, n°2, 2005. URL : http://gradhiva.revues.org/473.
- MEG, Conférence internationale « Décoloniser la recherche de provenance, Expériences de co-constuction des connaissances et de négociation du futur des collections coloniales », 24-25 novembre 2021. URL : https://www.meg.ch/fr/recherche-collections/decoloniser-recherche-provenance
- Article sur l’exposition Emballe-moi à retrouver sur le blog : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2434-emballe-moi-ou-l-histoire-d-un-demenagement

Portraits au féminin
A l’heure où la Suède est considérée comme un modèle d’égalité hommes-femmes, l'une des dernières expositions du Nationalmuseum de Stockholm avant sa fermeture en mars 2013 pour 5 ans de rénovation nous a démontré à travers Pride and Prejudice qu'il fut un temps où les femmes n'avaient pas accès au savoir, à l'éducation au même titre que les hommes.

Crédits : Anaïs Kraemer
A cette époque, l'Académie des Beaux-Arts était constituée uniquement d'hommes. L'exposition explorait la condition des femmes artistes en France et en Suède entre 1750 et 1860. Le portrait de plusieurs d'entre elles, dont certaines ont été les premières à pénétrer ce monde très masculin, démontrait que oui, même sans autorisation, les femmes aussi savaient manier un pinceau et qu'aujourd'hui, certaines d'entre elle ont même leur place au musée.
Crédits : Anaïs Kraemer
Au premier étage, les femmes prennaient le pouvoir, chaque artiste disposait de sa cimaise et de son chevalet, dressant son parcours à l'origine avec des œuvres associées. En plus d'une courte biographie classique, le panneau était complété par de petites anecdotes personnelles qui permettaient d'installer une plus grande proximité avec le public. Le visiteur parcourait les différents espaces sans aucun sens de visite défini, le discours étant réduit à ces différents portraits. L'absence à première vue d'autres éléments de médiation rendait le propos quelque peu confus au visiteur qui n'était pas attentif. En effet, bien qu'un accès principal avec un texte introductif ait été mis en place, la présentation de plusieurs expositions en simultané, permettait un accès par les salles mitoyennes. De plus, l'absence d'une scénographie en nette rupture avec les autres salles du musée ne permettait pas une réelle délimitation de l'exposition dans l'espace. Il n'y avait guère que les gardiens pour nous signaler la transition de l'espace temporaire à l'espace permanent.
Le choix des couleurs de fond ne présentait pas de continuité entre les salles. La cohésion était apportée par les espaces de repos. Vous l'aurez compris, c'est dans la scénographie que se situait le point faible de l'exposition ; bien que très convenable, il fallait être un visiteur aguerri pour comprendre les contours et la finalité. La proposition était restée très simpliste et ne servait pas suffisamment le propos. Un bon point néanmoins concernait les assises. Dans le prolongement des cimaises autoportantes se dressaient des colonnes autour desquels étaient disposés des coussins, identiques dans chaque salle, lesquels jouaient le rôle de liant entre les espaces. La présence en nombre de ces coussins donnait un aspect cosy au lieu et facilitait la contemplation de l'ensemble des expôts de par leur emplacement stratégique, qui permettait un angle de vue très complet sur les différents espaces d'exposition.
Au sortir de l'exposition, les sentiments étaient mitigés. Tout d'abord le choix du sujet semblait pertinent en regard du rapport particulier de la Suède avec le féminisme. De même pour les portraits qui permettaient de connaître l'artiste mais également la femme. Ensuite, les choix scénographiques permettaient au visiteur de prendre ses aises dans la déambulation et la contemplation des œuvres picturales. Cependant, ces mêmes choix de mises en exposition ne permettaient pas de voir se dessiner un réel parcours de visite. Le discours promis à l'entrée n'était pas entièrement tenu. Certes on nous présentait des artistes souvent peu présentes dans les institutions, mais l'aspect franco-suédois n'était pas exploité, et de plus, aucun lien n'était tissé entre les différents portraits et œuvres présentées. Une dernière rencontre avec des femmes remarquables du XVIIIe et XIXe siècle avant la fermeture du musée pour rénovation complète.
Anais Kraemer

Quand je suis devenu peintre
Une après-midi de libre, les beaux jours qui font leur retour timide, une envie de balade muséale agrémentée d’un thé et d’un macaron servis au café … Voilà un contexte bien approprié pour décider d’aller errer dans l’écrin XIXe du Petit Palais.
Malette de peintre et dispositifs de médiation divers © Emeline Larroudé
Sous la hauteur des plafonds peints dans un style fin de siècle, c’est moins l’écrasement d’une architecture monumentale que l’apaisement devant des figures lascives aux colorations douces qui s’opère. Moi, primo visiteur ? Que nenni. Devant cette magnificence, difficile de rester impassible, si bien que s’y rendre devient presque régulier. Et pourtant ! Voilà que cet établissement si souvent arpenté arrive encore à me surprendre. Dans une partie des galeries longeant les jardins fleuris se déploient des expositions temporaires. J’ai eu le loisir d’apprendre, une fois traversé le pont depuis les Invalides, que du 6 février au 13 mai 2018 se tient Les Hollandais à Paris, 1789-1914. Ma foi, un témoignage des échanges artistiques fréquents et souvent emblématiques des artistes peut être enrichissant. D’autant plus que l’affiche mentionne Van Gogh et Mondrian. Si l’un me laisse perplexe, l’autre m’éblouit par sa touche, et la mention de ces personnalités aux styles hétérogènes trahit déjà la richesse du contenu développé. De fait, j’ai rarement été déçu par une des expositions proposées par ce musée municipal Beaux-Arts. C’est alors le pas léger et l’estomac presque vide que je m’avance un peu nonchalant vers les espaces dédiés après avoir pris mon billet. Je salue l’agent de surveillance, je m’imprègne du sujet en parcourant l’introduction, je papillonne sous la verrière de chefs-d’œuvre et continue mon chemin de salle en salle, m’arrêtant ci et là lorsque mon regard se trouve inexplicablement attiré par une composition élancée ou des couleurs vives.
Copie en cours d’un chef-d’œuvre des collections du musée © E. L.
Là, après avoir traversé plusieurs salles présentant les travaux d’artistes qui, avouons-le, ne m’étaient pas familiers, je me plonge dans un Van Gogh qui se cherche, assez peu exploité. Je croise, amusé, des regards perplexes. C’est alors que, tandis que mes yeux longent les murs, j’aperçois une inscription blanche fléchée bien discrète sur ce fond bleu marin, « espace pédagogique ». Espace pédagogique ? Que peuvent-ils bien entendre par-là ? Ne puis-je y entrer sans petits-enfants pour prétexte ? Qu’ont-ils à leur proposer ? De la pratique ? Cela fait-il partie de l’exposition ou est-ce une annexe ? Je m’attarde à proximité, me retourne intrigué pour voir si je suis le seul à avoir remarqué cette signalétique, et constate qu’il y a du passage. La curiosité trop piquée, je ne peux m’empêcher de franchir précautionneusement le seuil d’entrée de cette salle qui, dans l’angle de la porte, semble déjà éblouir de sa lumière comme la source éclairée d’un tableau clair-obscur. Je m’arrête, saisi par la clarté qu’offrent ces grandes fenêtres donnant sur l’extérieur dans cette pièce qui retrouve une hauteur de plafond non-négligeable. Déjà, c’est l’agréable surprise, je me retrouve émerveillé dans un environnement auquel je ne m’attendais pas. Je guette et découvre, après avoir tenté de poser mon regard sur tout ce qui y est installé, que je me trouve en réalité dans L’Atelier du peintre. D’évidence, le public n’est pas plus bambin qu’ailleurs, et bien que quelque peu déstabilisé par la proposition, je me redonne toute légitimité à la parcourir.
Dispositif Dessiner par la fenêtre © E. L.
Réalisation en cours de la plasticienne © E. L.
En effet, se dressent cinq ou six chevalets et leurs tabourets associés au centre de la pièce. Que font-ils ? Faut-il réserver pour participer ? Guidés par une plasticienne, certains visiteurs s’attèlent à tenter de reproduire des chefs-d’œuvre mentionnés par le catalogue de l’exposition. Celle-ci en profite pour m’informer de la gratuité de la participation, des horaires des ateliers, et du reste des informations pratiques qui se trouvent sur le panneau de présentation à l’entrée. Pardonnez ma méprise, mais ce texte tout en longueur est bien la chose la moins attrayante ici. Quand bien même, nous sommes un vendredi après-midi, et le vendredi après-midi, c’est donc atelier Dessiner pour voir. Ma petite fringale tente de me rappeler à l’ordre, mais je suis bien trop obnubilé par les créations en train de prendre forme. Quel exercice laborieux se doit être, mais quel plaisir de contempler ces travaux s’exécuter dans une concentration pleine de sérénité. Regarder, c’est déjà se libérer, profiter d’un apaisement sans commune mesure. La tentation de prendre part est là, mais d’aucun pourrait se raviser devant la peur de mal faire, de n’avoir jamais fait ou de ne pas être à la hauteur (quelle hauteur ?). Si je n’ai jusqu’alors jamais dépassé le stade de novice, j’entends bien cependant que le dessin peut être considéré comme une activité très personnelle et intime, que l’on ne souhaite pas partager avec d’illustres inconnus nous observant avec insistance.
Dessin effectué par un visiteur durant l’atelier Dessiner pour voir © E. L.
Mais le dessin, pour moi, c’est avant tout les croquis esquissés dans le jardin de ma grand-mère, à retranscrire les paysages. C’est l’herbier crayonné en récoltant diverses feuilles. C’est aussi mon oncle qui, peintre amateur, s’est tenté à une carrière d’artiste. C’est un passe-temps trop longtemps délaissé, fruit dont j’ai encore le souvenir du goût, mais que j’ai cessé de croquer. Peut-être que le moment est venu pour moi d’y revenir, dans une émulation mutuelle, ici, dans les espaces aménagés du Petit Palais. Oui, je sens les craies et fusains qui m’attirent. Le café et les macarons vont attendre, la résignation aussi.
Emeline Larroudé
Liens internet :
http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/content/scholar-kits/latelier_du_peintre.pdf
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/les-hollandais-paris-1789-1914
https://www.facebook.com/Petit-Palais-mus%C3%A9e-des-Beaux-arts-de-la-Ville-de-Paris-273861966942/
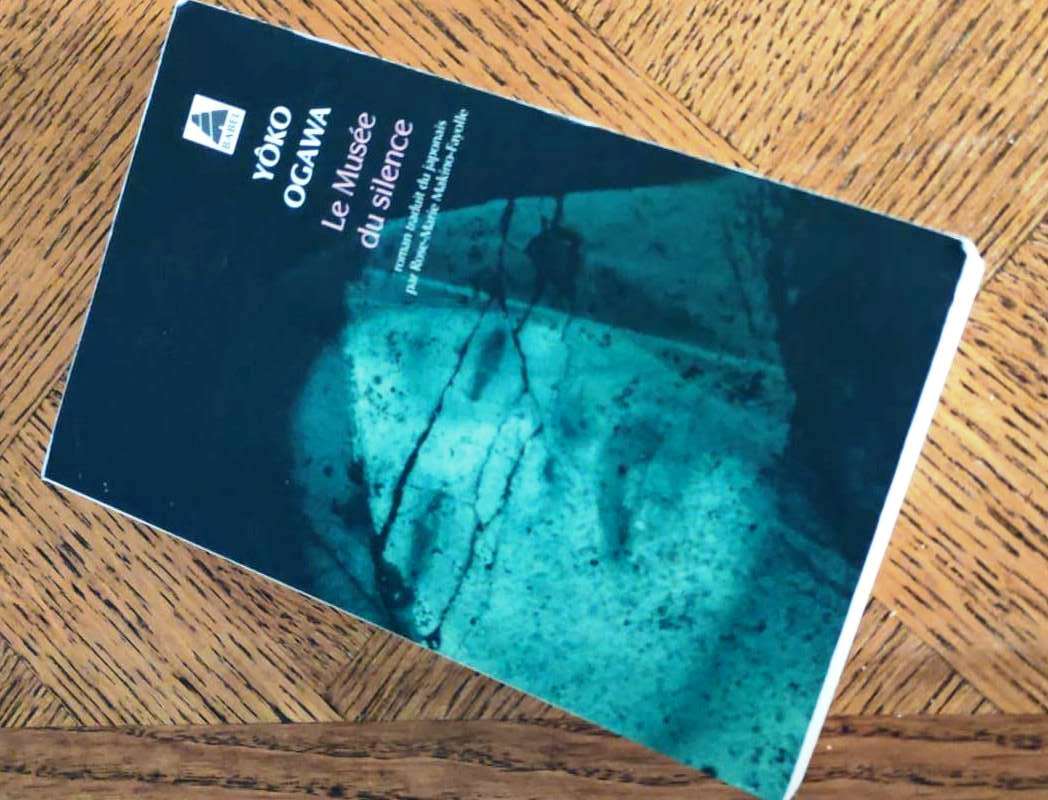
Quand la mort s'invite au musée
Durant le mois de juillet 2020, j’appris que j’étais retenue pour intégrer le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois. Aussi, dans la torpeur de l’été parisien, je cherchais à préparer mon esprit déconfiné à cette rentrée pleine de promesses. Si mes lectures étaient avant tout théoriques, je tombais un jour, en parcourant d’un œil distrait la bibliothèque d’un ami japonophile, sur un ouvrage dont le titre mystérieux retint mon attention : Le Musée du Silence. J’empruntais ce livre et découvrais alors Yōko Ogawa, auteure japonaise à succès... Et je me laissais entrainer dans une étrange aventure.
Des collections, un musée et… Quatre phases de la lune.
L’histoire prend place dans un manoir. Le lecteur suit le narrateur, un jeune muséographe, qui arrive par le train dans un petit village éloigné du reste du monde. Sa vie va alors graviter autour de l’étrange habitation, où il est chargé de réaliser un musée pour le compte d’une vieille dame acariâtre et… outrageusement ridée. Il s’agit pour lui d’exposer une collection particulière, encore en cours de constitution. En effet, chacun des objets a été volé par la vieille dame à un habitant du village juste après sa mort. C’est désormais au muséographe de poursuive la mission engagée par la propriétaire du manoir : celle de garder une trace de chaque habitants de la bourgade. Pour ce faire, il est aidé d'une jeune fille mystérieuse et du jardinier du domaine, et croise sur sa route tout un panel de personnalités énigmatiques. Les personnages développés par Ogawa semblent complexes mais restent toujours insaisissables.
C’est d’ailleurs le propre de ce roman : tout reste en surface. Où l’histoire se déroule-t-elle exactement ? On ne sait. Yōko Ogawa nous plonge au cœur d’un univers clos, intemporel, qui attise la curiosité du lecteur autant qu’il le déroute. Sommes-nous au Japon ? En Europe ? Rien ne nous permet de le dire, car aucun lieu n’a de nom, ni ne porte le sceau d’une quelconque culture pour nous orienter. On se contente de suivre paisiblement le fil des saisons et des cycles lunaires, qui rythment l’avancée de la mise en place du musée. L’auteure enferme ainsi son lecteur autant que son personnage principal au sein d’un microcosme sans âge, d’où l’on comprend vite qu’il ne sortira jamais. En effet, toute entreprise de contact avec le monde extérieur semble vaine : si le muséographe essaie à plusieurs reprises de communiquer par voie épistolaire avec son frère, ses tentatives ne trouvent aucun écho et restent sans réponse (ce qui semble d’ailleurs frustrer plus lourdement le lecteur que le jeune homme lui-même). Nous restons ainsi dans les grandes pièces froides de ce manoir, petit monde à part entière, avec son immense jardin et ses écuries. Ce lieu, calme et paisible en apparence, véritable havre de paix, semble exister dans un seul et unique but : accueillir le musée. Et lorsque les personnages en sortent, c’est pour grimper au monastère, où ils tombent sur d’étranges moines vêtus d'une peau de bête qui, ayant fait vœu de silence, recueillent les secrets, ou bien pour accéder au village et à ses drôles de boutiques de souvenir. Mais l’ensemble de cet environnement décrit par Ogawa nous apparaît lisse, aseptisé, même quand l’on y rencontre une violence inouïe (meurtres en série, attentat à la bombe…). En effet, la succession d’évènements exogènes angoissants venant ponctuer les scènes de huis-clos doucereuses du manoir ne parvient pas à perturber le climat de quiétude qui alimente la sensation dérangeante ressentie par le lecteur. Cette dernière est renforcée par le fait que le livre se termine comme il a commencé : dans la « normalité » et l’ordre le plus total.
L’histoire que nous raconte Le Musée du Silence n’est pas inattendue. Au contraire, on sent dès le début que quelque chose cloche et l’on comprend vite ce qu’il se passe. La fin est donc sans surprise, mais ce qui fait pour moi le charme de ce roman et toute sa poésie, c’est cette étrange atmosphère cotonneuse, ce monde aux contours flous. Où s’arrête la réalité pour laisser place au fantastique, au surnaturel ? Où commence le rêve ? La perte de repères spatio-temporels de l’œuvre de l’auteure japonaise m’a inlassablement renvoyée à l’univers lynchien et à ses zones d’ombres qui se découvrent au sein d’un univers en apparence sain et rationnel. Comme chez Lynch, le silence est omniprésent chez Ogawa et les horreurs de l’humanité sont vécues avec une passivité déconcertante.

Betty Elms (Naomi Watts) entrant dans le Silencio Club dans Mullholland Drive © David Lynch.
Le macchabé et le musée.
Un aspect important du Musée du Silence est bien évidemment la mise en place du musée en lui-même et le travail du personnage principal autour de la collection. En effet, les étapes de conservation sont décrites et suivies méticuleusement : après avoir découvert un amoncellement d’objets en tout genre laissés à l’abandon, le muséographe s’emploie au dépoussiérage et à l’archivage des artefacts. L’étape de fumigation est également abordée par l’auteure, dont le personnage construit un dispositif « maison » permettant d’assainir chaque œuvre. Le jeune homme suit également la construction du musée dans les anciennes écuries du manoir et livre ses réflexions concernant le sens de déambulation, l’éclairage, la présentation des objets au sein des vitrines… Bien que le lecteur imagine mal qui pourrait bien venir visiter ce musée, on comprend que la prise en compte des publics et de leur ressenti vis-à-vis de cette collection particulière importe au personnage développé par Yōko Ogawa. Car là se trouve bien le propos principal de l’auteure. En travaillant à la conservation des objets des défunts, le muséographe permet la transmission et la sauvegarde de leur mémoire. Il respecte ainsi en partie la définition que donne l’ICOM du musée dans son rôle de « sauvegarde des mémoires diverses pour les générations futures ».
La mort est omniprésente dans les musées. Comme le dit l’historien de l’art Jean-Marc Terrasse, elle est « l’événement par excellence » qui constitue les collections. Serge Chaumier et Isabelle Roussel-Gillet soulèvent d’ailleurs à juste titre, dans le chapitre consacré au Musée du Silence au sein de leur ouvrage Le Goût des Musées, que « le musée a toujours peu ou prou à voir avec le cimetière ». Face à la collection décrite par Ogawa, on ne peut pourtant pas s’empêcher de ressentir un malaise, une sorte de rejet mêlé d’une fascination qui nous semble malsaine. Cela tient peut-être à l’idée de se retrouver face à un objet dans lequel semble s’être incarnée l’âme de quelqu’un, et à l’aspect invasif que représente le fait de poser son regard sur un objet aussi intime. Mais si le musée du silence et ses collections n’existent, à ma connaissance, pas encore, il est des musées qui, par la volonté première de leurs créateurs, s’en rapprochent. Éloge de l’accumulation et du foisonnement, les musées personnels attisent notre curiosité par ce caractère intime.

Poupée réalisée par l’artiste Danielle Jacqui © Lucile Garcia Lopez.
Ce qui rend la maison de Celle qui Peint de Roquevaire si attirante, ce qui nous donne, presque malgré nous, l’envie irrésistible de pénétrer en son sein ne tient pas (qu’) à son aspect esthétique déroutant. Ce qui nous attire, c’est de voir, de vivre cet amoncellement d’objets parmi lesquels se meut au quotidien Danielle Jacqui. Le visiteur, devenu voyeur, constate alors l’effacement des frontières entre l’utile et le cosmétique, entre la réalité et le rêve. Et dans l’illisible, il a la sensation d’avoir pu toucher du doigt, d’avoir pu ne serait-ce qu’effleurer l’être profond de l’Artiste, cette personne souvent sacralisée, dont on oublie qu’elle est (ou qu’elle fut) aussi humaine que nous.
Une quête sans fin.
On l’aura compris, Yōko Ogawa se penche sur le rôle des musées plus que sur celui des muséographes. Elle y trouve le prétexte parfait pour aborder le thème de la mémoire. L’objet extorqué à la mort du défunt devient le résumé d’une vie : les tubes de peinture d’une artiste ratée, le scalpel d’un médecin spécialisé dans l’ablation des oreilles… L’entreposer, c’est permettre à l’être qu’il personnifie d’échapper à l’anéantissement total que représente l’oubli… Et ainsi de lui permettre de continuer à vivre. Que serait le monde si l’on avait gardé un objet représentant chaque personne étant physiquement passé sur cette terre ? Le muséographe d’Ogawa se pose la question : quand cette quête s’arrêtera-t-elle ? Le musée sera-t-il assez grand, assez vaste, assez solide pour accueillir et protéger indéfiniment ces souvenirs ? De tout temps, en tout lieu, dans toutes les sociétés et civilisations, l’Homme a collectionné. Cette action d’accumulation semble découler de cette inclinaison humaine à vouloir marquer symboliquement les objets qu’il croise sur son chemin. Déjà Néandertal, au Moustérien, amassait de petits objets divers dans un but qui nous est, aujourd’hui encore, inconnu. Leroi-Gourhan, en 1965, nous disait d’un dépôt retrouvé à Arcy-sur-Cure qu’il était « le premier témoin attesté de la reconnaissance de formes [...] le premier signe [...] de la quête du fantastique naturel [...] forme d'adolescence des sciences naturelles car dans toutes les civilisations l'aurore scientifique débute dans le bric-à-brac des ''curios"».
Aujourd’hui, une collection de musée se constitue à la suite de choix et de refus, réalisés selon des règles strictes. Dans le cas du Musée du Silence, il s’agit d’une sélection arbitraire, basée sur le choix d’un tiers et sur l’idée qu’il se fait d’une personne. Les objets sont la traduction physique de relations entretenues au cours d’une vie. Ils sont le lieu de fixation du souvenir, mais aussi des fantasmes d’une collectionneuse qui reconstitue une communauté macabre centrée autour du village. Malgré cela, le livre de Yōko Ogawa nous invite à nous questionner : Quel statut ontologique pour l’objet de musée ? Quelle présence du corps ? Plus largement, on ne peut s’empêcher de se demander : Quel objet pour me représenter ? Que choisir pour se substituer à mon corps lorsque ce dernier sera redevenu poussière ? Pour le muséographe de notre histoire, cette quête de l’objet devient passion. Elle permet garder la mémoire et de ne pas être « avalé par les ténèbres ». Le roman se fait ainsi la cristallisation de ce besoin tu, gardé secret, mais qui pourtant traverse les âges : se souvenir pour ne pas disparaître.
Lucile Garcia Lopez
#Musée
#Collections
#Mort
Bibliographie :
Chaumier Serge, Roussel-Gillet Isabelle, Le Goût des Musées, Paris, Mercure de France, 2020, 128 p.
Coquet Michèle, « Des objets et leurs musées : en guise d'introduction », dans : Journal des africanistes, tome 69, 1999, pp. 7-28.
Lascault Gilbert, « Les Musées Personnels », dans : Encyclopedia Universalis [en ligne] https://www.universalis.fr/encyclopedie/musees-personnels/
Ogawa Yōko, Le Musée du Silence, Arles, Actes Sud, 2005, 315 p.
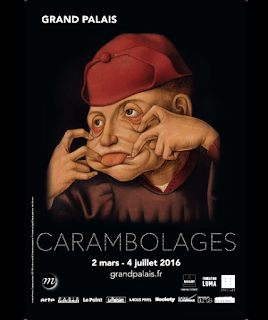
Quel Carambolage ? Élitisation ou démocratisation du musée ?
Quel premier article vais-je écrire pour le blog ? Un petit tour sur l’Art de muser pour me donner des idées, voir les sujets abordés, si divers, et y rencontrer des expositions, des radiateurs et des films, reconnaître des noms dans les titres et dans les signatures. Un regard autour de moi, l’affiche de Carambolages me retient, déjà aperçue en coup de vent dans les couloirs labyrinthiques de l’Université de Liège pendant la semaine expographique. Certes, l’exposition est terminée depuis trois mois. Certes, d’autres musées m’appellent, avec leurs nouveaux accrochages. Mais je ne veux pas ici faire une critique journalistique, bien plutôt, j’aimerais évoquer mes sentiments envers une démarche originale.
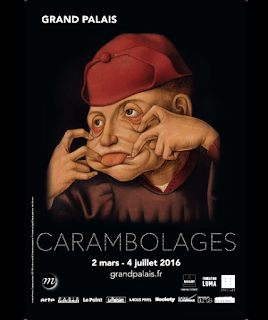
L'affiche de Carambolages. Clin d'œil étonnant, ce tableau provient des collections de l'Université de Liège.
Ma première visite remonte au mois de mars, (période de chômage à l’avantage rarement évoqué de permettre de rentrer à prix réduit sinon gratuitement dans la plupart des expositions parisiennes en semaine, évitant la foule du samedi matin), ma seconde visite, précisément un samedi pour accompagner un ami qui ne pouvait faire autrement. On ne peut pas tout avoir. Deux visites, donc. Deux expériences opposées.
Rappelons le principe de l’exposition orchestrée par Jean-Hubert Martin : faire du musée un jeu de domino, confronter des œuvres et des objets venant de tout le globe et de toutes les époques par un lien sémantique, une ressemblance esthétique, un thème, et rebondir ainsi dans une danse narrative continue, inspiré de L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg.
Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, planche 79.
Une exposition mêlant tout, s’affranchissant des catégories traditionnelles de musées (art ancien ou contemporain, ethnographie, archéologie, histoire naturelle…), sans discours universitaire, sans autre discours même que celui que le visiteur veut se raconter. D’où la mise à distance : ni savant ni élève, juste des joueurs.
Quelques partis-pris : un plan de salle boustrophédon déroulant le fil de la comptine marabout, bout de ficelle, selle de cheval... Aucune explication sur les expôts, les cartels numériques – minimalistes – relégués au fond des allées et tournant en boucle. Sempiternelle ritournelle. Des objets décontextualisés : on en connaît certains, d’autres sont totalement obscurs.
Un jeu, je vous dis ! On se détend, on avance et on regarde. « Un travelling ludique pour tous les publics » clame le dossier de presse, « un divertissement qui entend stimuler le savoir » explique le (seul et unique) texte (introductif) de l’exposition. L’affiche elle-même n’annonçait-elle pas qu’il ne s’agit là que d’une blague ?
L’idée est bonne, originale, innovante… L’expo se veut donc accessible pour tous, les experts de tous poils qui s’amuseront à tisser des liens entre les œuvres, les visiteurs cultivés, habitués au musée traditionnel qui verront ici une nouvelle expérience à explorer, les visiteurs occasionnels, qui n’ont pas besoin de bagages culturels foisonnants puisque l’exposition se refuse à toute démonstration et n’ont qu’à se bercer au rythme des découvertes. Car « point n’est besoin d’aller chercher si loin dans le passé, pour trouver des exemples de présentation échappant à l’axiome historico-géographique. » dixit J-H M.
Un écran-cartel aux informations obscures pour qui n’a pas une licence d’ethnographie océanienne.
Seulement voilà, nous ne sommes pas tous Jean-Hubert Martin.
Première visite : il y avait très peu de monde, je ressors émerveillé. Quel concept étonnant ! J’ai vu tant de choses diverses, réveillant les souvenirs de tant de lieux, de tant d’expositions, de tant de cours d’histoire de l’art, d’archéologie, d’anthropologie…Ce jeu intellectuel a en effet « stimulé » mes connaissances et mon imagination. Je suis heureux, amusé d’avoir cherché les liens cachés, deviné les rebondissements en restant longtemps devant chaque vitrine, et conforté dans mon ego d’universitaire historien d’art – archéologue – muséologue.
Comment ? Et les autres ? Quels autres ? Les salles étaient presque vides, c’était d’ailleurs très agréable !
Seconde visite, un mois plus tard, un samedi. Damned ! Le monde ! Impossible de circuler dans ces allées étroites que l’on doit suivre à la queue leu-leu (une danse vous dis-je et vous assène-je !), on avance donc un peu pour revenir ensuite lorsque le groupe de la visite guidée sera passé. Mais comment établir les liens ludiques entre les œuvres dans ces conditions ? Le fil est rompu, on le raccommode bien une fois ou deux mais après quelques temps ce n’est plus qu’une pelote emmêlée. Encore une exposition qui ne prévoit pas la présence massive de visiteurs.
Qu’avez-vous dit ? Une visite guidée ? S’il y a bien une exposition au monde qui ne doit pas avoir de visite guidée c’est bien celle là ! Je vais la suivre un peu… On vous vend un divertissement frivole et vous avez un cours d’ethnographie sur un crâne surmodelé de Vanuatu, un cours d’histoire de l’art sur une gravure de Dürer, un cours d’archéologie devant une momie de chat… À la sortie je tends l’oreille. Moi qui me suis tant amusé à ma première visite, je tombe des nues : que de critiques négatives, que de déception. Quel mépris envers les visiteurs ! Ne rien expliquer, mais on ne comprend rien ! C’est très joli, mais à quoi bon si on ne sait pas ce que l’on voit et qui est beau ? Les conservateurs, on les connaît, ils ne font que des expositions pour eux, ils s’amusent, mais nous qui n’y connaissons rien, qui n’avons pas les clés de compréhension, sommes enfoncés dans notre ignorance. Humiliés. Le jeu a cessé d’être drôle.
Le Huffington Post titrait "Carambolages" au Grand Palais, l'expo qu'un enfant de 4 ans comprendra mieux que les experts en art. Certes. Un enfant de quatre ans ne se pose pas les mêmes questions qu’un adulte. Sans doute il regarde et s’interroge. Il comprendra le jeu et « carambolera » aussi longtemps qu’il chantera sa comptine.
« Si quelques trouvailles devraient ravir les initiés, l’exposition ambitionne de s’adresser au public le plus large, en particulier à ceux qui n’ont aucune connaissance en histoire de l’art, en suscitant choc, rire et émotion » (toujours dans le communiqué de presse).
Cette exposition est un passe-temps ludique, un jeu, une blague à ne pas trop prendre au sérieux ! Une blague,oui, mais une blague d’intello ! Ou pour les gamins ! Entre les deux, le visiteur imaginé et visé n’existe pas.
Jean Huber, Voltaire à son lever à Ferney, Musée Carnavalet. Tableau introduisant l’espace de l’étage. Echo/ego ?
Ainsi, cette tentative de décloisonner le musée de son carcan thématique, de décontextualiser les œuvres pour la plus pure délectation esthétique, débarrassée des connaissances scientifiques, est un échec, ou bien n’est pas allée assez loin.
Echec, car humiliant, combien de visiteurs dégoûtés à jamais ne poseront plus un orteil sur le perron d’un musée ? Relisons ensemble Bourdieu ! Pas assez loin, car si la règle du jeu est clair, le musée jalonne la visite d’entorses et de tricheries : on veut décontextualiser les œuvres ? Supprimons complètement les cartels au lieu de n’y rien mettre, ainsi qu’à Insel Hombroich, en Allemagne ou au Pitt Rivers Museum d’Oxford où la collection démentielle est classée par ordre alphabétique de thème.
Annulons les visites guidées explicatives : va-t-on commenter chaque case du Monopoly ? Carambolage devait-elle apprendre en amusant ? Raté, car ceux qui s’amusent connaissent déjà. Et dans un tel dispositif, où le visiteur est « joueur », la médiation n’a pas sa place, du moins pas la médiation traditionnelle. Sans doute le Grand Palais n’a-t-il pas osé laisser le visiteur totalement démuni, mais c’était pourtant pire que mieux. L’innovation n’était pas complète, inachevée. Et, selon les mots mêmes du commissaire, le catalogue est là pour donner les informations détaillées des œuvres… a posteriori donc, et au modeste prix de 49€ (en plus des 13€ du ticket d’entrée).
À trop vouloir démocratiser le musée par la conceptualisation, on peut craindre d’élever encore plus haut le piédestal sur lequel il repose, et de le rendre encore plus hermétique à ceux qui n’ont pas la clé pour y pénétrer. Pour un jeu populaire, les règles étaient simples, mais le sous-entendu inconsciemment méprisant. Carambolage des œuvres, carambolage du public.
Jérôme Politi
23 octobre 2016
#Grandpalais
#public

Quelle place pour le métavers dans les musées de demain ?
Et si le musée de demain n’avait plus de murs ? Avec le métavers, la visite devient immersive et accessible à tous, de partout. Dernière ces belles belles promesses, quels défis techniques, éthiques et financiers limitent encore le déploiement de ces « nouvelles façons d'exposer ».
Depuis quelques années déjà, les musées explorent la réalité virtuelle pour enrichir leurs offres. Reconstituer le passé, étendre l’accès au patrimoine, briser les murs géographiques… En bref, des innovations aux multiples avantages. Mais entre défis techniques, éthiques et financiers, la démocratisation du musée virtuel reste un projet encore loin d’être universel.

Image générée par une IA - Pixabay
Ajustez le casque de réalité virtuelle sur votre nez et laissez-vous embarquer dans un monde virtuel immersif où les frontières du réel se floutent. Le musée du Quai Branly, le Museum national d’Histoire naturelle, le MusiX... certains musées investissent déjà dans la création d’expériences en réalité mixte ou virtuelle. Toutefois, cette pratique reste relativement rare. Si ces innovations offrent des perspectives inédites pour les musées et le public, pourquoi leur usage n’est-il pas déjà démocratisé ? Quels défis éthiques, techniques et muséographiques constituent-ils ?
Un patrimoine culturel à portée de clic
Le patrimoine culturel européen est particulièrement riche et diversifié, mais reste souvent inaccessible à une large partie de la population. Numériser ces œuvres et les intégrer dans des espaces virtuels permet d’étendre l’accès à ce patrimoine au-delà des murs des musées. D’une part, cela permet de s’affranchir des dimensions du bâtiment, ouvrant la possibilité d’explorer des collections et des mises en scènes – presque – sans fin. En plus de dépasser les contraintes spatiales qui limitent leurs expositions, le virtuel permet de reconstituer des lieux historiques disparus ou altérés et de resituer le visiteur dans un contexte particulier. Dans son sous-sol, le musée de Libération de Paris a recréé le parcours d’un journaliste qui rencontre le Colonel Rol-Tanguy et son équipe, caché dans ce poste de commandement souterrain en 1944. Le visiteur déambule et interagit avec des personnages virtuels créés à partir de scènes des archives. Cette reconstitution fidèle et immersive permet de rendre les événements appartenant au passé plus tangibles et mémorables.
Pour aller plus loin : avec ces avancées technologiques, les visiteurs peuvent « voyager » dans le temps et l’espace. Par exemple, des reconstitutions en réalité virtuelle permettent de se balader dans des sites historiques dans leur état d’origine. Sous le parvis de Notre-Dame de Paris, « Éternelle Notre-Dame » entraîne le visiteur dans les différentes étapes du chantier : de sa construction aux réparations actuelles. Équipé d’un sac à dos/ordinateur et d’un casque occultant, le visiteur se déplace, voit et entend les rues de Paris il y a 850 ans. Ainsi, replacer les œuvres dans leur environnement original ou dans des scénarios historiques favorise une compréhension plus riche et transversale.
Visiteurs en immersion face aux plans de la Cathédrale. Éternelle Notre-Dame - © Orange/Émissive - 2021
En démocratisant l’accès au patrimoine à travers les mondes virtuels, la visite devient possible aux personnes qui, pour des raisons géographiques, économiques ou physiques, ne pourraient pas se rendre dans les musées. Cela recèle un potentiel important, notamment en termes d'élargissement de l’audience et de promotion d’une véritable égalité d’accès à la culture. De plus, la création de musées virtuels pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération culturelle entre les pays. Si ces perspectives sont, en théories, enrichissantes et réjouissantes ; qu’en est-il de l’usage ? Pourquoi ces technologies si prometteuses n’ont-elles pas passé la porte de tous les musées ?
Des défis à relever et des écueils à éviter
Bien que les possibilités offertes par les musées virtuels soient nombreuses, les challenges restent nombreux. L’un des enjeux majeurs concerne la souveraineté culturelle et numérique. En effet, les musées souhaitant numériser leurs œuvres dépendent souvent de plateformes technologiques étrangères pour héberger leurs contenus. Cette appartenance pose certaines questions. Qui est propriétaire des métadonnées associées aux œuvres numérisées ? Qui garantit leur conservation à long terme ?
L’éthique de la représentation culturelle est également un enjeu de taille. Numériser des œuvres d’art ne se limite pas à une simple reproduction technique, cela implique aussi des choix de représentation. En effet, une fois modélisées il est possible de jouer sur de multiples paramètres pour moduler l’aspect de l’œuvre. Or, certains objets de culte ou œuvres anciennes possèdent une signification particulière pour les communautés concernées. Leur numérisation, et encore plus leur modification dans un environnement virtuel, pourraient être perçues comme une forme d’appropriation ou de dénaturation.
La question de l’usager dans le métavers muséal
Il est essentiel de réfléchir à la question de l’usage. Il faut nécessairement penser à inclure différents groupes sociaux et culturels, surtout dans un monde où la fracture numérique persiste. Ces musées virtuels ne doivent pas devenir des espaces réservés à une élite technologique, mais doivent être adaptés à tous les publics. Enfin, un autre enjeu réside dans le coût et l’accès aux technologies nécessaires. Aujourd’hui, les équipements de réalité virtuelle sont encore onéreux et peu ergonomiques. Les casques actuels sont souvent lourds et inconfortables, ce qui peut entraver la durée et l’expérience visiteur. Si les progrès technologiques continueront de perfectionner ces outils, il est probable que le coûts renforce la scission entre les musées disposant des moyens de développer ces technologies, et ceux qui n’en auront pas les capacités.
Les musées virtuels sont encore loin d’être universels, et chaque projet doit être adapté aux spécificités des œuvres, des publics et aux besoins des institutions. Mais lorsqu’ils sont bien réalisés, ces dispositifs peuvent offrir des expériences spectaculaires et marquantes, qui redéfinissent la manière dont nous percevons et interagissons avec le patrimoine. L’œuvre numérisée ne fait pas, à elle seule, une expérience muséale. Penser le parcours visiteurs, la mise en scène et la muséographie reste primordiales. L’équilibre entre l’innovation technologique et le respect des valeurs culturelles reste encore à réfléchir.
Loraine ODOT
#métavers ; #immersion ; #expériencevisiteurs
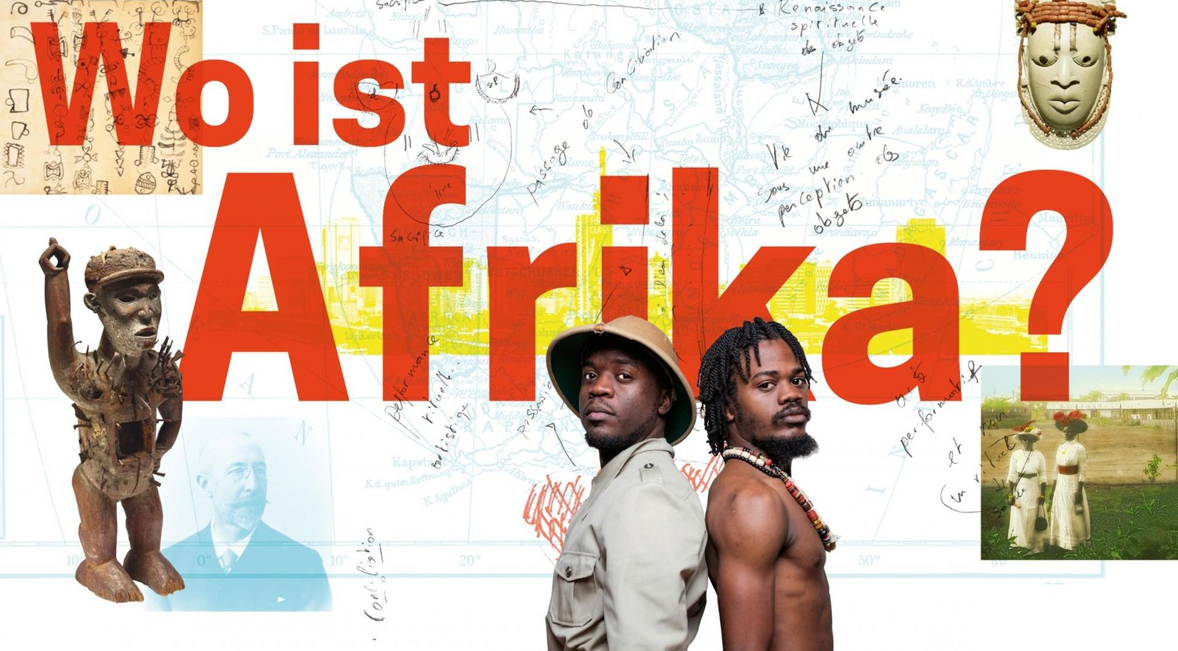
Restitutions de biens culturels au Linden Museum
Les restitutions de biens culturels ont fait l’objet de plusieurs débats ces dernières années, de nombreuses collections publiques européennes ayant été constituées durant la colonisation et le pillage des territoires africains. C’est en 2017, lors du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, que la France a réellement entamé une démarche collaborative avec des pays africains, notamment avec le Bénin.[1] D’autres pays européens, dont l’Allemagne, s’étaient déjà engagés dans un dialogue constructif avec les autorités africaines.
En Allemagne, comment cela se passe-t-il ?
Depuis une dizaine d’années déjà, notre voisin s’est engagé avec les structures muséales africaines à restituer des œuvres et objets leur appartenant. En 2022, des œuvres ont été transférées au Nigeria, en Namibie, au Cameroun et en Tanzanie. Le professeur Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, a d’ailleurs déclaré, toujours en 2022, qu’il était important que « les musées allemands aient une attitude très ouverte » sur ces questions, et que l’échange et la coopération étaient les clefs de restitutions réussies.[2] Si cette démarche est bénéfique aux musées africains, qu’advient-il des musées allemands ?
Le cas du Linden Museum
Musée d’ethnographie de Stuttgart, le Linden Museum a été fondé en grande partie durant la période coloniale. Aujourd’hui, l’équipe du musée affiche sa volonté de « prendre des responsabilités face à son passé » et suit les instructions du Deutschen Museumbundes(institution nationale des musées allemands) pour ce qui concerne les restitutions. Ces informations sont consultables sur leur site internet[3], mais dans le musée en lui-même, qu’a-t-il été fait ?
Au début de l’année 2016, le musée s’est réellement penché sur la recherche de la provenance et du contexte de l’acquisition des objets africains. Le musée est organisé de telle sorte que chaque continent a son parcours, dans des salles spécifiques. L’équipe interne a alors choisi de refaçonner les espaces concernant le continent africain afin de relater ses recherches et questionnements. Nommé Wo ist Afrika ? (en français « Où est l’Afrique ? ») ce parcours a été inauguré en 2019.
Wo ist Afrika ?, conçue par qui ?
Ce parcours a évidemment été pensé sur plusieurs années, le sujet étant délicat. Trois ans en amont, l’équipe interne du musée s’est entourée d’habitants de Stuttgart d’origines africaines afin d’ouvrir le dialogue avec ces communautés et ne pas créer de nouvelles erreurs d’appropriation et d’interprétation des collections. La directrice du musée, la Prof. Dr. Inés de Castro, est d’ailleurs particulièrement engagée et alertée sur toutes les questions touchant aux restitutions, c’est elle qui est à l’initiative de ce parcours.
Wo ist Afrika ?, conçue pour quoi ?
Le but de cette exposition n’est donc pas uniquement de présenter les objets mais de redécouvrir les contextes et les récits de ces collections africaines, de les questionner, de découvrir leurs relations avec le musée et avec les peuples africains. L’exposition n’est pas chronologique mais thématique.
La première salle Von Sammlerstücken oder einer ohrenbetaübenden Stille (en français « choses à collecter, ou un silence de plomb »), illustre le décalage entre la frénésie des collectionneurs à l’époque coloniale, et le silence sur la provenance et l’histoire des objets. Nous sommes accueillis par un diorama renommé « Vous êtes là ». Conçue dans les années 1960 à Stuttgart, cette pièce avait pour but de présenter au public un village africain. Le cartel remet en cause son exactitude et alerte sur la différence entre les faits relatés dans l’exposition et la réalité sur place. « Vous êtes là, donc, s’il vous plaît, rappelez-vous : ce n’est pas ‘’l’Afrique’’.»
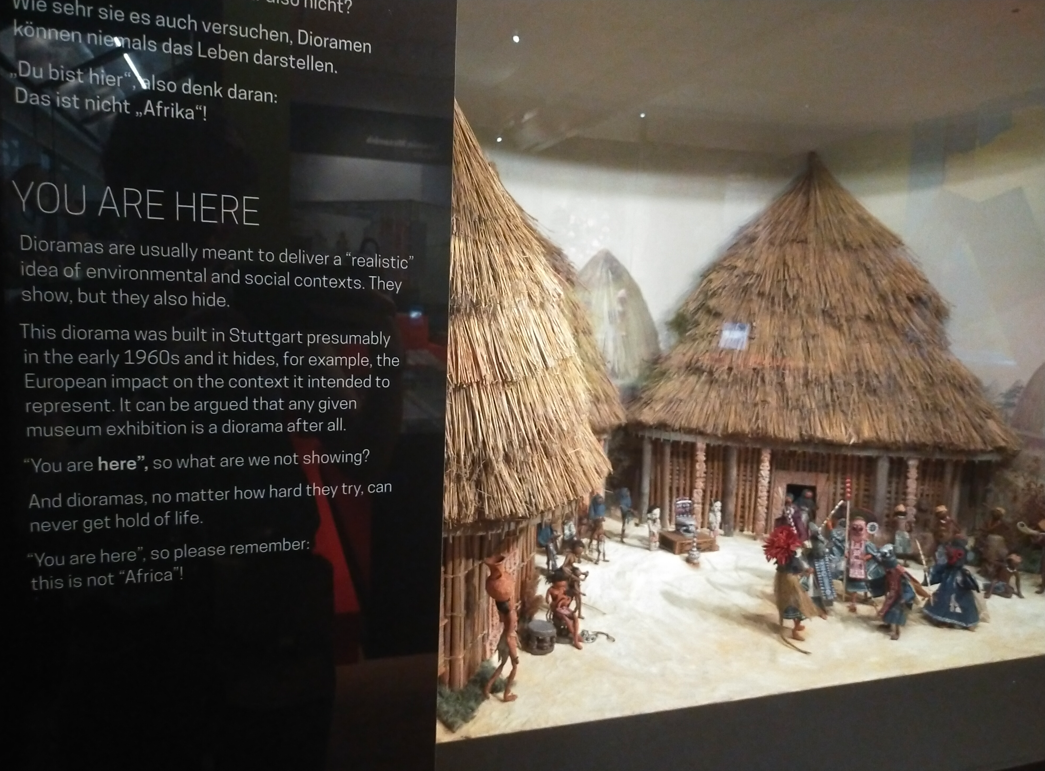
Diorama qui accueille le public, © JD
Dans la deuxième séquence Von S[o]bjekten in Aktion oder kultureller Kreativität(« S[ob]jets performants, ou créativité culturelle »), c’est l’art et l’artisanat de différentes époques qui sont représentés, passant d’une reconstitution d’un atelier de sculpteur de masques à une moto décorée du XXIème siècle.

Deuxième salle de l’exposition © JD
Wo ist Afrika ?, un espace qui évolue ?
Comme les recherches s’effectuent sur le long terme, le musée avait pour volonté de tenir ses visiteurs informés. Une base de données sur un écran, mise à jour régulièrement, permet aux plus curieux de s’informer des dernières découvertes. Certains espaces et dispositifs sont aussi ajoutés au fil du temps.
« Si les objets pouvaient parler » est une installation visible depuis juillet 2023. Un objet des Kikuyu est dans les réserves du musée depuis 1903 mais la base de données interne n’avait aucune information à son sujet. De quoi s’agit-il ? A quoi servait-il ? Y a-t-il encore des gens capables de l’identifier ? Deux cinéastes, Elena Schiling et Saitabao Kaiyare, sont allés au Kenya dans l’espoir de répondre à ces questions. Accompagnés de leur caméra et de l’objet représenté grâce à la réalité augmentée, ils ont interrogé plusieurs personnes. Malgré les différences de générations, les témoignages et réponses sont unanimes : aucun ne comprend pourquoi cet objet, appartenant à leur peuple, leurs ancêtres, se trouve en Allemagne. Cette expédition, présentée par un film, permet au public de faire un pas de côté et de changer de point de vue. Les restitutions ne vident pas les musées, elles enrichissent l’histoire des peuples à qui appartenaient des objets.
Bande annonce "If objects could speak"
Wo ist Afrika ?, et après ?
Dans la troisième et dernière salle Von Bindegliedern oder gemeinsamer Geschichte(« Objets à connecter, ou histoires communes »), les liens entre les Européens et les Africains est au cœur du propos. Par exemple, un espace compare les styles de marché alimentaire, et un autre permet de découvrir un jeu africain très pratiqué. La volonté est de susciter l’interactivité entre les visiteurs.

1ère image : reproduction d’un stand de marché africain comparé à une photo grandeur nature d’un marché européen © JD
2ème image : dispositif pour apprendre à jouer au Mancala © JD
L’exposition se termine sur une vitrine originale : « Qu’est-ce nous allons collecter dans le futur ? ». Un cartel jaune trône au milieu avec un titre : restitué. Une photo d’un objet, son histoire, et c’est tout. Ce masque de chef de tribu, récemment restitué, a tout de même une place importante dans les collections puisqu’il illustre les différents statuts sociaux au sein des tribus. Alors, le musée a décidé d’en garder une trace dans son parcours.

Dernière vitrine du parcours, © JD
Les questionnements autour de la restitution ne se résoudront pas tous en rendant les objets et en exposant uniquement des photos dans les musées européens. Cependant, avec un parcours comme celui du Linden Museum, le visiteur comprend que la restitution n’est pas forcément une perte de valeur pour les musées européens. Ce parcours permet de découvrir une partie du continent africain tout en explicitant les liens du passé, mais aussi le travail qui, aujourd’hui, est conduit autour de ces questions.
Les restitutions n’ont donc pas appauvri les collections, elles ont enrichi le propos, les connexions interculturelles et l’histoire du musée. N’est-ce pas là le rôle d’un musée d’ethnographie ?
Julie Dumontel
Pour en savoir plus :
-
https://www.jeuneafrique.com/1315340/culture/patrimoine-africain-lallemagne-sur-le-chemin-des-restitutions/
-
https://www.deutschlandfunk.de/ausstellung-ueber-kolonialkunst-in-stuttgart-es-geht-um-100.html
#Allemagne #Ethnographie #Restitutions
[1] Article de Carole Assignon, juin 2022 : https://www.dw.com/fr/allemagne-restitution-des-oeuvres-culturelles/a-62293712
[2] Article publié sur le blog concernant la restitution du Trésor d’Abomey au Bénin par la France, par Éva Augustine en 2021 : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2299-restitution-du-tresor-d-abomey-un-acte-symbolique
Sésame, ouvre-toi !
Ou un groupe se prenant pour Ali Baba devant la porte des réserves du MuCEM
Bon, il ne faut pas rêver, dans la réalité, tout le monde n’a pas la même chance qu’Ali Baba. Vous avez beau essayer de prononcer la formule magique devant les portes d’un musée, il est peu probable qu’elles s’ouvrent. Et pourtant ce sont bien des trésors qu’il renferme. Alors, changement de méthode, prenez votre téléphone et inscrivez-vous à une visite des réserves. C’est moins exotique, mais au moins, ça marche.
Le Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM © www.mucem.org
Se promener dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, ce n’est pas comme se promener en Perse. Quoique. Même si le Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM est imposant il reste néanmoins bien camouflé. Je n’ai pas compté le nombre de personnes qui passent à côté sans le voir. Et oui, un trésor ça se cache, il faut se donner du mal pour le trouver. J’exagère puisque le nom « MuCEM » est tout de même inscrit sur la façade, mais bon, comme aucune indication n’invite à franchir la grille ça fait un peu coffre-fort. Heureusement, vous qui êtes téméraire, vous allez franchir le pas. Devant la porte, c’est simple : sonnez et il y a des chances pour que la porte s’ouvre. Cen’est pas pour autant que vous aurez accès aux réserves. Il faut réserver sa place (une action qui semble en fait évidente pour accéder aux réserves…), et, en plus, la visite a lieu le premier lundi de chaque mois. Ou alors il faut faire des études et avoir un enseignant super qui vous emmène dans la semaine. Ce n’est pas gagné. Mais bon, si vous avez vraiment beaucoup de chance, le fameux lundi arrive dans trois jours et, ça tombe bien, vous serez encore à Marseille. Et oui, je vous l’ai dit, entrer dans les réserves, ça se mérite.
Le jour J enfinarrivé, un petit groupe se rassemble devant une porte qui semble assez banale (soyez patients la prochaine porte est plus impressionnante). Mais avant d’entrer, il faut déposer ses affaires, y compris et surtout sa bouteille d’eau. Certains craignent la déshydratation et sont réticents à laisser leur précieuse bouteille. Est-ce qu’ils n’en font pas un peu trop ? Je vous le répète, cequi se cache derrière cette porte, ce n’est pas une grotte perdue en plein désert, tout le monde en ressortira. En attendant que chacun retrouve la raison, les plus impatients commencent à toucher à ce qu’ils peuvent. Remarquez mieux vaut se défouler dans le hall qu’une fois dans les réserves, sauf qu’à force de vouloir faire les malins, de vouloir ouvrir des portes, c’est l’alarme qui se déclenche. Au moins, ça calme. C’est vraiment dur d’entrer dans les réserves, pourvu que ça vaille le coup.
Les réserves du MuCEM © www.mucem.org
Pas de grandes formules, juste un badge, un bip, et c’est bon nous voilà entrés. Enfin, pas encore, il y a une autre porte à franchir, pour le coup une grande porte du type porte blindée. Un autre bip et c’est parti pour la visite ! Leplafond est immense, l’horizon paraît lointain et le groupe reste sagement dans l’entrée, émerveillé. Je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à un tas de pièces d’or et de bijoux, mais plutôt à des instruments de musique, de la vaisselle, des meubles, des skates et autres objets de toute sorte rangés sur 800 m2. Au fond, ça change des trésors habituels et c’est peut-être pour cela que c’est si impressionnant. La visite commence alors et plus le groupe avance entre les étagères, les armoires, les racks et les compactus (oui tout ce vocabulaire s’apprend pendant la visite), plus il semble fasciné. Bien sûr interdiction de toucher les objets, mais si vous êtes sages vous pourrez manœuvrer les compactus et, croyez-moi, ça donne un sentiment de découverte plus important encore. Mais je n’en dis pas plus, si vous voulez satisfaire votre curiosité vous savez ce qu’il vous reste à faire (regarder les informations pratiques à la fin de l’article par exemple ?).
Alors verdict ? Si Ali Baba nous avait vus, il serait certainement vert de jalousie. Les réactions sont unanimes : « Je m’attendais pas du tout à ça ! », « C’est incroyable ! » et même « Mon Dieu que c’est beau ! ». Conclusion, ça valait le coup de se donner du mal car c’est une expérience et quelque chose me dit que les membres du groupe ne verront plus les musées de la même façon. Franchir la porte (un peu magique quand même) des réserves, c’est découvrir un autre visage du musée d’autant que la médiatrice alimente la visite d’informations sur la constitution de la collection, les métiers du musée et bien d’autres sujets encore. Imaginez en plus que la visite ne montre qu’une partie des réserves du MuCEM qui sont réparties sur une surface totale de près de 8000 m2 ! D’autres portes renferment d’autres trésors, mais pour voir le reste, il faut travailler dans le monde des musées. Comme quoi ça a des avantages, comment ne pas se sentir privilégier après ça ? Rassurez-vous tout de même, de plus en plus de musées souhaitent ouvrir leurs réserves au public. Inutile donc d’essayer d’entrer en contact avec Ali Baba, il n’est plus le seul à détenir le secret pour voir un trésor.
C.D.
Pour aller plus loin :
Visite gratuite de « L’appartement témoin » (les réserves) tous les premiers lundi du mois, de 14h à 17h, surréservation. (
Si vous avez aimé votre visite, sachez que tout lemonde peut consulter les archives, les ouvrages, les documents et même les objets des réserves sur demande ! (http://www.mucem.org/fr/node/2823)
#MuCEM
#réserves #coulisses
Sortir des clous (1/2) : Barcelona Flashback, de l’autre côté du miroir
« Sortir des clous » est un diptyque de deux expositions invitant les visiteurs et visiteuses à reprendre le contrôle de la réalité qui s’offre à eux, et à entrer en action. Premier épisode, le Musée d’histoire de Barcelone (MUHBA) et son exposition « Barcelona Flashback », ou comment transmettre les connaissances nécessaires à l’exercice du droit de la ville ?
Salle « Battements urbains » © JT
Le MUHBA, un musée de la longue traîne ?
Le « kit minimum de connaissances » sur Barcelone
Radiographie urbaine, ou la discipline géographique
Salle des « paysages » © JT
Objets-témoins
A travers la géographie, le visiteur a désormais une image assez claire de ce que représente Barcelone aujourd’hui, il est alors temps de se demander commentnous en sommes arrivés là. La salle des témoignages ne regroupe pas des interviews, mais plutôt des objets de toute sortes. Et ils nous parlent :
Certains pensent que je serais mieux dans un autre musée, je ne le vois pas de cette oreille ! Regardez la carte des appels !
Téléphone public à pièces. Composants plastiques et électroniques. Fin du XXe siècle.
Des archéologues m’ont trouvé dans le district de Raval. Où étais-je quand certains se faisaient tuer dans la rue au temps des pistoleros ?
Revolver, XIXe siècle.
Un premier point de vue est tissé, où l’objet est témoin, où sa parole et ce qu’il symbolise prime sur sa fonction. A ce moment du parcours de visite, l’objectif est que les visiteurs et visiteuses aient une idée suffisamment précise de l’histoire vécue de Barcelone et de sa géographie pour commencer à aborder son histoire. Une fois que l’avocat a établi les premiers faits et écouté les témoins, il va commencer à écrire l’histoire, faire un récit.
Salle des « témoignages » © JT
L’histoire par le geste
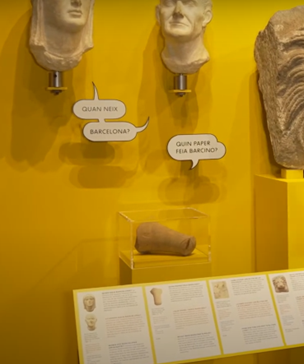
Vue du pivot d’amphore de la première salle historique © JT
Plus loin dans le temps, une affiche sur les Olympiades populaires de 1936 et une autre question toute d’actualité : « quel est le lien entre Hitler, l’Olympiade et la guerre civile de 1936 ? ». Juste à côté, une petite figurine nous demande : « Quelle mission avait ‘el més petit de tots’ (le plus petit d’entre eux) ? ».

Vue de la seconde salle historique © JT
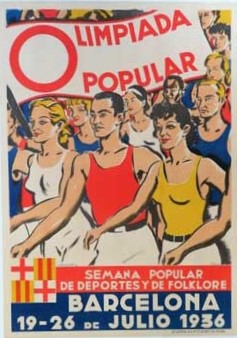

Affiche des Olympiades populaires de 1936 et vue de la figurine El més petit de tots © JT
Connaitre Barcelone pour connaître sa ville
La dernière salle de l’exposition invite le visiteur à connecter l’histoire urbaine de Barcelone à celles des autres capitales européennes. Le dispositif numérique Europa Inter Urbes est un projet mené par le MUHBA en coopération avec les autres musées de ville de son réseau européen pour comparer les villes contemporaines depuis 1850. Cet outil interactif donne la possibilité de comparer dates, données statistiques et photographies pour compléter la « radiographie » de Barcelone.
Dispositif Europa Inter Urbes © JT
Le « kit de connaissance minimal » que nous apporte Barcelona flashback est un appareil critique initiant les visiteurs et visiteuses aux études urbaines et à leur interdisciplinarité. La force de la muséographie du MUHBA est de nous accompagner dans la découverte de la recherche scientifique, ce qui est à la fois une force et une faiblesse, l’exposition n’étant pas calibrée pour le jeune public. De manière générale, on pourrait reprocher à la muséographie de trop se prendre au sérieux et de ne pas ménager aux visiteurs et visiteuses des espaces ludiques permettant d’approcher la connaissance d’une autre manière. Il n’en reste pas moins que Barcelona flashback est une source d’inspiration pour tous les musées de ville.
Julien Tea
Pour en savoir plus :
- ROCA I ALBERT Joan et MARSHALL Tim (eds.), European City Museums, Barcelone, Ajuntament de Barcelona : Museu d’Història de Barcelona, 2023.
#Espagne #MUHBA #Museedeville
[1] Calcul réalisé additionnant les chiffres de fréquentation de 2022 du musée ainsi que de ses espaces patrimoniaux.
[2] Trois moments épistémologiques ont conduit le musée à devenir un laboratoire du musée de ville de demain. Le premier moment date de début 1993, quand a lieu le tout premier colloque international dédié aux musées de ville, à un moment où l’UNESCO cherche à inscrire l’urbain dans son périmètre patrimonial. Le second moment est la formation de l’International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities (CAMOC-ICOM) qui crée à partir de 2008 un réseau global des musées de ville. Un réseau plus régional et informel est créé à l’initiative du MUHBA en 2010, donnant lieux à une déclaration commune en 2013 qui préfigure la philosophie du MUHBA.
[3] Cette théorie, imaginée par Chris Anderson en 2004 dans le magazine Wired, est une adaptation de la théorie mathématique de la longue traîne.
[4] Voir le dossier de presse du 29 mars 2023.
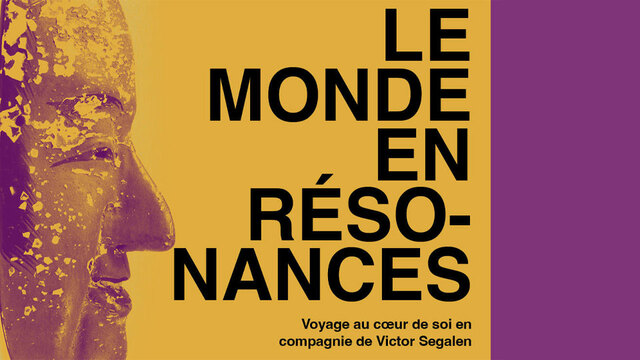
Sortir des clous (2/2) – se dérouter, pour mieux se retrouver, le monde en résonances
Ce deuxième volet de « Sortir des clous » est consacrée à l’exposition Le monde en résonances : voyage au cœur de soi en compagnie de Victor Segalen au Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, à voir jusqu’au 30 mai 2025. Pensée comme un dispositif expérimental de psychologie de l’orientation, elle invite les visiteurs et visiteuses à « répondre mieux et de façon ‘créative’ à des changements ou des transitions plus ou moins subies » dans leur vie personnelle.
Espace d’introduction de l’exposition © JT
Respirer, inspirer, expirer

Résonance 5 : Les traces. © JT
Ces moules, la cinquième résonance de l’exposition, sont un pont entre la démarche clinique de Jacques Pouyaud, l’œuvre littéraire de Victor Segalen et la philosophie libératrice d’Hartmut Rosa. Écoutons ce dernier :
« Nous sommes non aliénés là où et lorsque nous entrons en résonance avec le monde. Là où les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent ou nous émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence »[1].
 |
 |
Espace intérieur et espace extérieur © JT
La dérive en ville
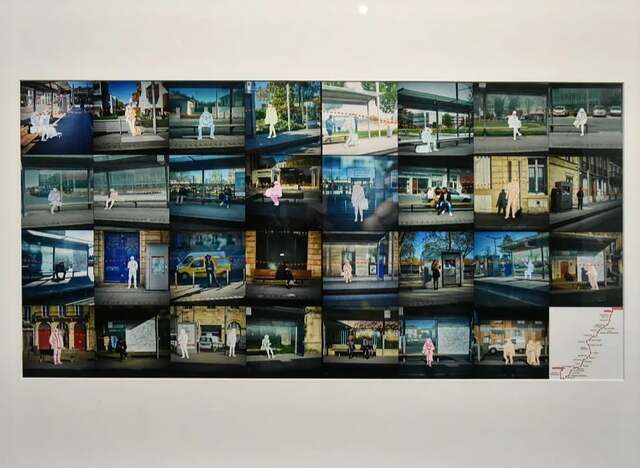 |
 |
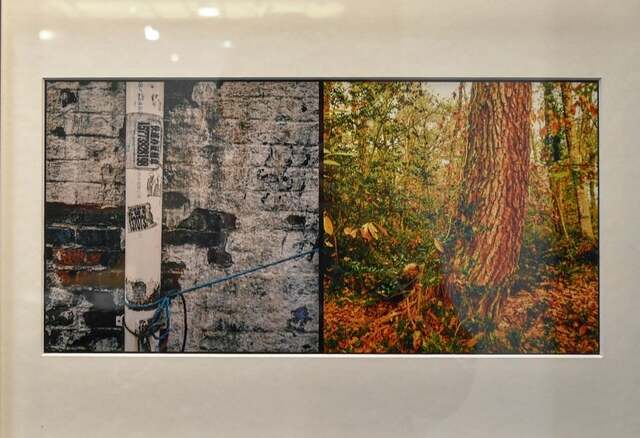 |
Trois des 5 projets photographiques (Les événements de vie et le parcours, L’identité, Le milieu de vie) © JT
 |
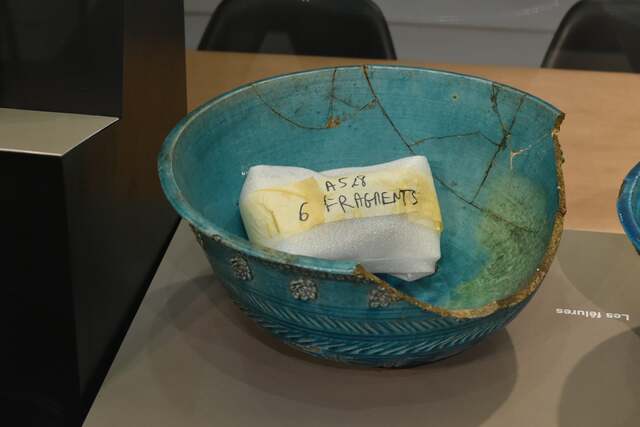 |
Deux objets sans cartel scientifique, le premier appelé « sacrifice », le deuxième « les félures » © JT
« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent […] aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et de rencontres qui y correspondent »[3].
« Nous devons mélanger intimement des zones d’ambiance évoquant la ville et des zones d’ambiance évoquant l’intérieur d’une maison. […] Je considère ce mélange intérieur-extérieur comme le point le plus avancé de notre construction expérimentale »[4].
La stèle, l’objet et la résonance
- Face au midi - la Loi (律), les règles et normes qui s’imposent à nous : quelle est votre expression ou devise préférée ?
- Face à l’Ouest – l’adversité (挑), construire du sens pour surmonter les épreuves : vous faites peut-être face actuellement à des choix, des transitions ? Quelles questions vous posez-vous sur vous-même et votre parcours de vie ?
- Face au Nord – l’amitié (朋), quête d’un milieu de vie par l’intermédiaire d’autrui : quels journaux, séries, émissions, radio, site internet, etc… aimez-vous consulter ou suivre régulièrement ? Décrivez ce que l’on y trouve et les personnes qui y participent.
- Face à l’Est – l’amour (愛), hybridation de deux récits individuels en une forme partagée : quand vous aviez entre 6 et 10 ans, qui étaient vos héros ? En dehors de vos parents, quelles personnes étaient pour vous des modèles que vous admiriez, qu’ils soient réels ou fictifs ?
- Au centre - le soi (中), perdre le midi quotidien : quel est votre plus ancien souvenir d’enfance ?
- Au bord du chemin – (道), chemin fait de hasard et de rencontres : quel serait votre livre, roman, film de chever à emporter sur une île déserte ? Quelle histoire raconte-t-il ?
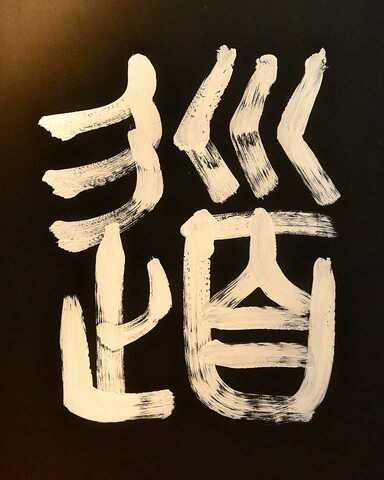 |
 |
Idéogramme calligraphie et espace d’« Au bord du chemin » © JT
Un espace de participation ?

La vitrine centrale est participative, une visiteuse y a déposé une paire de chaussures de danse © JT
Conclusion
Pour aller plus loin :
- Cohen-Scali Valérie, Psychologie de l’orientation tout au long de la vie: défis contemporains et nouvelles perspectives, Malakoff, Dunod, 2021.
- Poyaud Jacques, L’entretien sculptural d’orientation, Habilitation à diriger es recherches, Université de Bordeaux, Bordeaux, 2022.
- Rosa Hartmut, Zilberfarb Sacha et Raquillet Sarah, Résonance: une sociologie de la relation au monde, Paris, la Découverte, 2018.
- Segalen Victor, Stèles, Pei-King, Pei-T’ang, 1912.
Notes

Spoliations nazies : exposer, entre tabous et nécessité
Le 17 avril 2019, ont été rendus publics les statuts de la Mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945, créée par le ministère de la Culture dans le but d’étudier les biens au passé trouble dans les musées français, étrangers ou présents sur le marché de l’art. Depuis quelques années et à chaque restitution, le sujet des spoliations d’œuvres d’art pendant la Seconde Guerre mondiale passionne le grand public et les expositions sur ce sujet se succèdent depuis l’après-guerre, mais ne se ressemblent pas.
De 1939 au années 1950 : des spoliations aux premières expositions
L’art a occupé une part importante dans la politique et la suprématie voulue par l’Allemagne nazie : rejet de l’art moderne considéré comme dégénéré, création du musée du Führer à Linz et accaparement des biens des Juifs d’Europe. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et dès fin aout, l’ambassadeur d’Allemagne Otto Abetz commence à saisir les biens de collectionneurs et marchands d’art juifs. Les pillages seront ensuite dirigés par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), aidé des politiques du régime de Vichy comme l’aryanisation des biens. Les objets confisqués transitent d’abord au Louvre puis dès octobre 1940 au Jeu de paume où Rose Valland, attachée de conservation française, note clandestinement les mouvements d’œuvres durant la guerre. Au total, près de 100 000 objets sont envoyés en Allemagne et 60 000 reviennent à la Libération grâce aux Alliés et aux fameux Monuments Men connus du grand public depuis le film homonyme de Georges Clooney en 2014. De ces 60 000 œuvres revenues, 45 000 sont restituées aux familles dans l’immédiate après-guerre grâce au travail de la Commission de la Récupération Artistique (CRA).

« Salle des martyrs » du Jeu de Paume où étaient stockées les œuvres d’art considérées comme dégénérées dans le but de les détruire ou les échanger contre des œuvres plus classiques appréciées des nazis. © 1940. Archives du Ministère des Affaires étrangères.
Entre juin et août 1946, une exposition est organisée à l’Orangerie des Tuileries intitulée Les chefs-d’œuvre des collections privées françaises retrouvées en Allemagne par la Commission de récupération artistique et les services alliés. Cette exposition ne s’intéresse pas vraiment à la provenance des œuvres ni aux « collections privées françaises » mais mentionne plutôt dans le catalogue, le destin des œuvres pendant la guerre comme celles destinées au musée d’Hitler ou celles choisies par Goering pour sa collection particulière. Le but de cette première exposition, quelques mois après la signature de l’armistice, est de montrer idéologiquement, ce que représente le pillage de ces collections privées. L’Etat semble se les approprier dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Albert S. Henraux, président de la CRA :
« Voilà nos chefs-d’œuvre revenus sur la Place de la Concorde, théâtre de la dernière bataille de la capitale et de sa délivrance. Guérie de ses blessures, elle aussi, l’Orangerie les recueille après leur long exil et les replace, à l’ombre des drapeaux alliés, dans leur atmosphère, celle de Paris et de la France. »
En 1949, une exposition est consacrée aux bibliothèques spoliées à la Bibliothèque de l’Arsenal, les « Manuscrits et livres précieux retrouvés en Allemagne » et la CRA est dissoute cette même année. 15 000 œuvres restent sans propriétaires. Il est décidé d’en vendre 13 000, à travers plusieurs ventes organisées par les Domaines et de sélectionner 2000 œuvres afin de les laisser à la garde des Musées Nationaux dans le but de les restituer, les fameux MNR (Musées Nationaux Récupération). Le décret du 30 septembre 1949, qui décide de la création d’un inventaire provisoire spécial pour ces œuvres indique aussi la nécessité de les exposer en vue de leur identification par leur propriétaire et c’est ce qui se passe entre 1950 et 1954 au musée national du château de Compiègne. Les œuvres MNR non restituées furent ensuite mises en dépôts au Louvre, au musée d’Orsay, au musée national d’art moderne et dans plusieurs musées de régions, en attente de leur éventuelle restitution, où la plupart se trouvent encore aujourd’hui.
Les années 1990 : le temps des éclaircissements
Entre les années 50 et les années 90, on oublie. Beaucoup de personnes ayant vécu l’Holocauste veulent s’affranchir de ce passé difficile, le sujet est tabou dans les familles et certaines, décimées, laissent derrière elles peu, voire aucuns souvenirs de leur possession à leur ayants-droits. Les Français redécouvrent cette question en 1995 avec le discours de Jacques Chirac qui reconnait la part de la France dans la déportation des Juifs puis avec le livre du journaliste portoricain Hector Feliciano, Le musée disparu qui pointe du doigt le peu de préoccupation des musées français sur ces œuvres particulières qu’ils conservent. C’est pourquoi dès 1996 est mise en ligne la base Rose Valland, le site de référence recense les MNR et indique leur historique connu. Un article du Monde datant du 27 janvier 1997 et titrant « Les musées détiennent 1955 œuvres d’art volées aux juifs pendant l’Occupation », remet le feu aux poudres, et cette même année plusieurs expositions présentent les MNR dans cinq grandes institutions françaises : le Louvre, le musée d’Orsay, la Manufacture de Sèvres, le château de Versailles et le musée d’art moderne Georges Pompidou. Ces expositions avaient pour volonté de présenter ces collections et de taire les rumeurs naissantes sur la passivité des musées entre les années 50 et les années 90, où seulement 6 restitutions ont eu lieu. Cette volonté de remettre les pendules à l’heure se retrouve dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Jean-Jacques Aillagon alors directeur du musée national d’art moderne :
« J'ai la conviction que cette transparence est le seul moyen de couper court à la suspicion, à la rumeur, à la tentation du sensationnel, de mettre un terme à l'oubli et à toute possible complaisance à l'égard de l'iniquité. J'estime qu'il est du devoir de l'établissement public qu'est le Centre Georges Pompidou de permettre à tout un chacun de porter un regard lucide sur ces œuvres auxquelles l'Histoire a conféré un statut particulier, un destin tragique. »
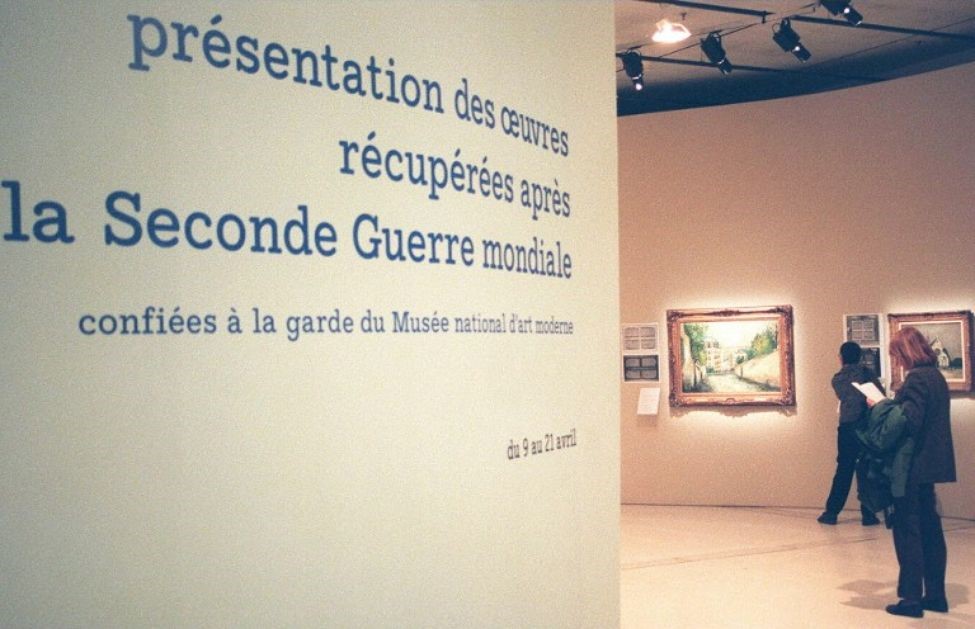
Entrée de l’exposition de 1997 au musée national d’art moderne. Au fond, deux toiles, leurs cartels et des photographies du revers des toiles avec étiquettes, inscriptions qui témoignent parfois du cheminement des œuvres © AFP
Dans un article de Libération, publié lors de l’ouverture de l’exposition au musée d’Orsay, encore disponible en ligne vingt ans après, la raison de ces expositions est la même mais la finalité, étonnamment, n’est pas vraiment celle de la restitution pour le ministre de la Culture de l’époque :
« Ce qui pouvait être restitué l'a été depuis cinquante ans, affirme Philippe Douste-Blazy. Il n'y a rien à cacher. J'espère que des gens, parce que nous les montrons par tous les moyens possibles, pourront récupérer leurs tableaux. Mais on pense qu'il y en aura très peu. Très probablement. Le geste est symbolique. Un demi-siècle après la guerre, il s'agit plutôt de faire de l'histoire que de rendre des objets d'art qui ne sont pas réclamés. »
Et pourtant, toujours en 1997 Alain Juppé, premier ministre, demande un rapport ministériel, publié en 2000, la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France ou Mission Matéoli qui fera date et particulièrement son volet sur les spoliations « Le pillage de l’art en France pendant l’Occupation et la situation des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux » rédigé par Didier Schulmann et Isabelle Le Masne de Chermont. Le sujet redevient central également sur la scène internationale avec en 1998, la Conférence de Washington où 44 pays décident d’ouvrir leur archives et de remettre la recherche de provenance au cœur des préoccupations. Et cela fonctionne, on dénombre 32 restitutions entre 1997 et 2008.
Depuis 2008 : une dynamique de recherche et d’exposition proactive
En 2008, organisé conjointement au musée d’Israël de Jérusalem puis au musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ? est la dernière grande exposition sur le sujet des spoliations en France. 53 tableaux MNR y sont présentés à travers plusieurs sections parlant précisément de l’histoire de ces œuvres : les saisies des services nazis, les opérations d’échange de l’ERR, les restitutions d’après-guerre, les acquisitions sur marché parisien, les œuvres de provenance inconnue et les restitutions faites à la France en 1994. Dans cette exposition, ce n’est donc plus juste une présentation mais une véritablement exposition présentant l’histoire et l’itinéraire de ces œuvres, également retracé dans le catalogue de l’exposition :
« Le cartel prend une place démesurée et ce ne sont plus les œuvres qui sautent aux yeux, mais leur destin de marchandise et les méandres tragiques de leur circulation. » Alain Dreyfus, Artnet.fr, 09/09/2008
Depuis, les musées de régions s’inspirent de cette démarche et s’ouvrent à ces problématiques en valorisent les MNR déposés dans leurs collections. Les présentations thématiques se multiplient. La plus connue, suite à la publication du livre 21 rue de la Boétie d’Anne Sinclair sur la vie et le destin de son grand-père le galeriste Paul Rosenberg a eu lieu une exposition homonyme au musée Maillol en 2012. Nous pouvons aussi citer L’Art victime de la guerre en 2012 à Bordeaux et dans les musées d’Aquitaine, Face à l’histoire en 2017-2018 au LAAC de Dunkerque mettant en parallèle 6 MNR et des œuvres contemporaines d’artistes ayant connus la guerre, MNR, les tableaux de la guerre au musée des Beaux-Arts de Rennes en 2016-2017 et plus récemment, la mise en place controversée de deux salles dédiées aux MNR en 2017 au Louvre, le texte de ces dernières n’employant pas une fois, dans un premier temps, le mot « juif ». Dernièrement, un espace de médiation dévoilé en février 2019 au musée des beaux-Arts de Poitiers, rend visible l’histoire et le parcours de ces œuvres spéciales au plus grand nombre dans le parcours permanent.

Raphaëlle Martin-Pigalle, responsable des collections devant l’espace de médiation conçu autour des MNR du musée de Poitiers
© Dominique Bordier pour La Nouvelle République, 06/02/19
On observe aussi de plus en plus la mise en ligne de pages internet dédiés sur le site des musées mettant en valeur cette histoire particulière et les conditions de réclamation ainsi que de cartels développés retraçant la provenance connue de ces œuvres comme à l’exposition Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle en 2018 ou au musée des Beaux-Arts d’Angers, attirant l’attention des visiteurs sur la situation particulière de ces œuvres.
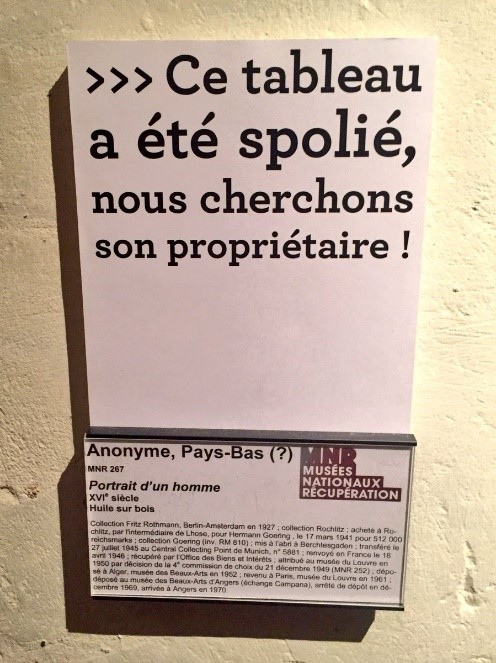
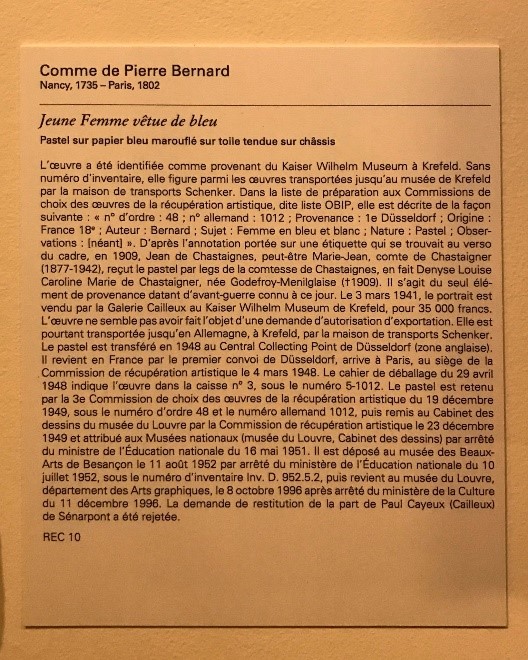
Cartel MNR du musée des Beaux-Arts d’Angers © Pierre Noual, Twitter / Cartel MNR lors de l’exposition
Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle © Alexandre Curnier-Pregigodsky, Twitter
Il semble absolument nécessaire de mentionner la provenance connue de ces œuvres, mais celle-ci peut toutefois étouffer le visiteur sous une masse d’informations. Aussi, il serait peut-être pertinent de représenter le parcours complexe des œuvres sous la forme de schéma, comme ce fut le cas à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne avec un compromis intéressant entre nécessité d’informer et pédagogie !
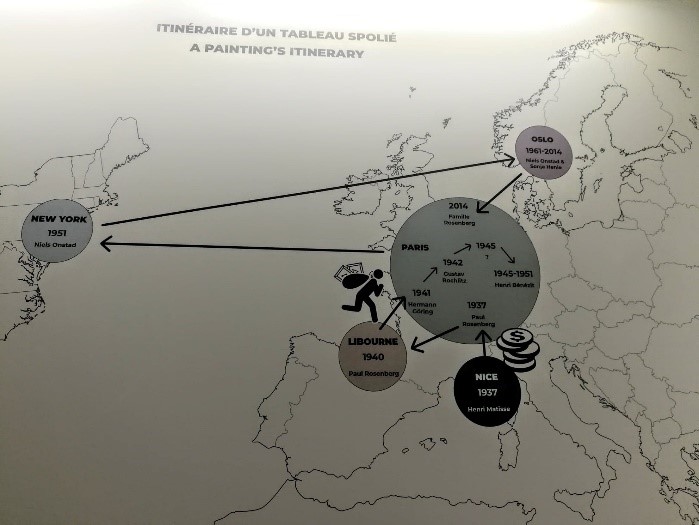
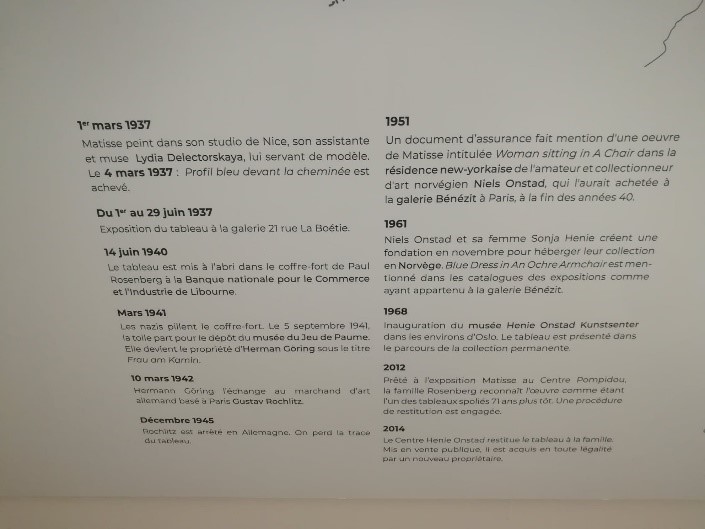
Itinéraire d’un tableau spolié : schéma et dates clés pour comprendre le parcours complexe d’une œuvre de Matisse à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne © Cloé Alriquet
Enfin, des initiatives innovantes sont également développées ces dernières années comme la bande dessinée numérique disponible en ligne intitulée Le portrait d’Esther où le lecteur se glisse dans la peau d’une famille découvrant son passé et le destin d’une œuvre spoliée, créé par le musée des Beaux-Arts d’Angers en 2016 et débouchant sur une exposition des planches originales en résonnance avec les MNR du musée. Du côté du numérique, une exposition virtuelle Spoils of war du musée numérique UMA, a été inauguré suite à un financement participatif en septembre 2018, où l’on se balade dans une exposition numérique autour des spoliations et plus étonnant, un hackaton, un marathon de développement informatique a même eu lieu en octobre 2018 au musée de Niort dans le but de mettre en valeur les MNR du musée !
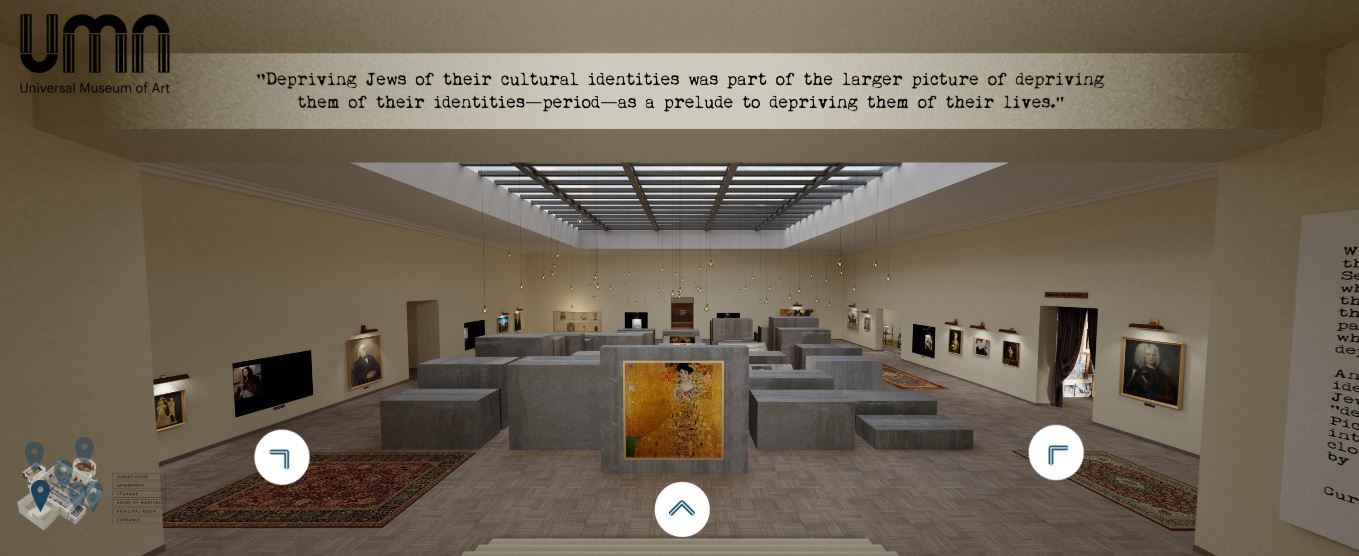
Capture d’écran de l’exposition numérique « Spoil of Wars » de l’UMA avec au premier plan le célèbre tableau de Klimt « Portrait d’Adèle Bloch Bauer », spolié et restitué aux ayants droit en 2006.
Depuis 2014 : L’après Gurlitt et le rôle affirmé du chercheur de provenance
En 2014, était révélé dans la presse allemande la découverte de milliers œuvres dans un appartement munichois, chez Cornelius Gurlitt, fils du marchand d’art allemand controversé Hildebrandt Gurlitt. La donation de ces œuvres au musée des Beaux-Arts de Berne à la mort de Cornelius entrainera un programme de recherche sur la provenance de ces œuvres, et en 2017 à deux expositions conjointes, une première sur l’art dégénéré au musée des Beaux-Arts de Berne et une seconde sur les spoliations nazies au Bundestkunsthalle de Bonn qui relancera l’intérêt mondial sur les recherches de provenance. Fin 2018, l’exposition Gurlitt est présentée au Gropius Bau de Berlin et en parallèle ont lieu les 20 ans de la Conférence de Washington, renouvelant au niveau international l’importance et l’actualité de ces problématiques avec une importance donnée à la formation et au métier du chercheur de provenance. La mise en valeur de ce travail, qui était plutôt invisible avant, se ressent aussi dans l’exposition Gurlitt où le public est accueilli dans la salle finale par un médiateur-chercheur pour répondre à leurs questions et les guider dans la recherche sur ordinateur.

Vue de l’espace final de l’exposition Gurlitt à Berlin, Gropius Bau, novembre 2018 © Cloé Alriquet
La dernière restitution à ce jour de cette collection, date du 8 janvier 2019 où le Portrait de femme de Thomas Couture a été rendu aux ayants droit de l’ancien premier ministre français Georges Mandel. Ce dernier est exposé depuis fin mars au côté d’une œuvre restituée d’Odilon Redon découverte sur une vente aux enchères et Georges Romney ancienne œuvre MNR, et d’une photographie du dos d’un tableau de John Constable restitué en 2017 au Mémorial de la Shoah dans l’exposition Le marché de l’art sous l’Occupation sous le commissariat de l’historienne de l’art Emmanuelle Polack. Ces trois tableaux sont accrochés dans la salle de « L’atelier du chercheur de provenance » où de nombreuses ressources sont présentes et une permanence est organisée le dimanche pour répondre aux interrogations des visiteurs ou de familles spoliées. Plusieurs expositions vont ouvrir en 2019 sur ces problématiques : une salle sur les œuvres spoliées de Paul Rosenberg au Centre Pompidou le 22 mai 2019, une exposition sur Rose Valland au musée Dauphinois de Grenoble à l’automne…
Cet article s’ouvrait sur la création d’une Mission de recherche et de restitution des biens spoliées entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture ce printemps. Celle-ci fait suite à un rapport demandé en 2017 par la ministre Audrey Azoulay et remis à Françoise Nyssen par David Zivie sur l’état des lieux de la recherche de provenance en France. Ce rapport redéfinit les priorités autour de la recherche de provenance dont le but principal est évidemment d’étudier, d’une part les MNR et d’autre part les œuvres des musées nationaux acquises sous l’Occupation en vue de leur restitution éventuelle, mais également de valoriser ces questions auprès du grand public comme le montre un paragraphe des statuts officiels : « elle veille à la sensibilisation des publics et des professionnels aux enjeux soulevés par les spoliations de biens culturels intervenues entre 1933 et 1945 et par la présence de biens spoliés dans les institutions publiques».
On ne peut désormais qu’espérer que cette nouvelle dynamique donnera lieu à une future grande exposition française ! A suivre…
Cloé Alriquet
#exposition
#spoliations
#restitution
Pour aller plus loin :
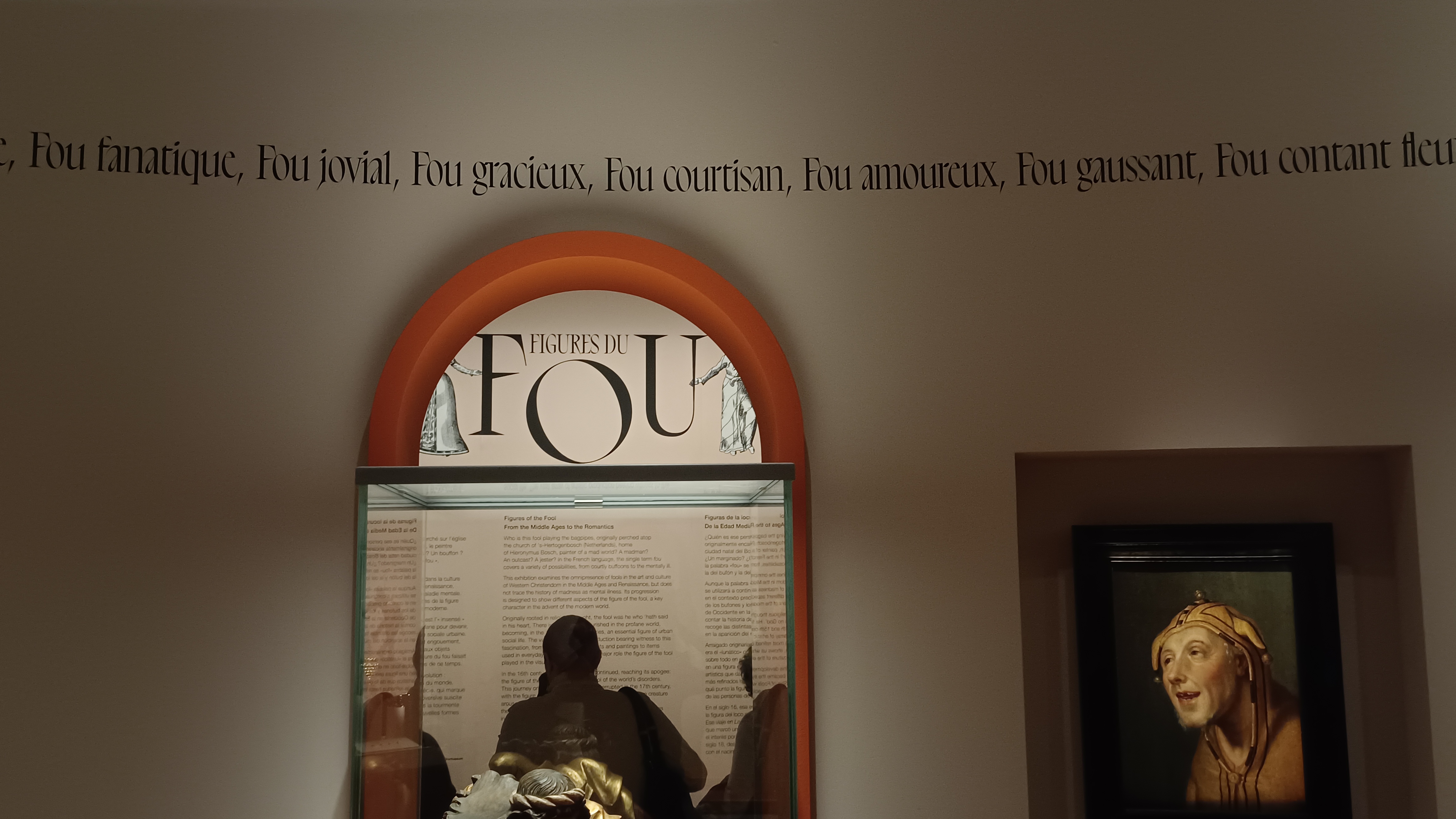
TOUS FOU !
Les fous, invités de marque du Musée du Louvre. Quelles histoires et représentation de la folie ?
scénographie de l’exposition. crédit T.Lops
Le 16 octobre 2024, le musée du Louvre a inauguré l’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques qui durera jusqu’au 3 février 2025. Cette exposition a pour but de retracer l’évolution de la figure du fou dans l’histoire de l’art. La notion de fou et de folie a inspiré la création artistique depuis de nombreux siècles, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans celui des arts visuels. L’exposition rassemble plus de 300 œuvres parmi lesquelles des dessins, gravures, sculptures, objets d'art et peintures sur panneau. Avant d’aborder l’analyse de cette exposition, il convient d’abord d’en définir les termes. Qu’est-ce qu’un fou ? Qui peut fièrement prétendre à ce titre ? Selon la définition du Robert, “un fou est une personne atteinte de troubles, de désordres mentaux”, ou encore “une personne qui se comporte d'une manière déraisonnable, extravagante.” Vous vous reconnaissez ? Non ? C’est bien triste…
Mais l’objectif de cet article n’est pas de se plaindre de l’uniformité des individus, qui n’ont jamais été plus individualistes et pourtant plus indiscernables qu’aujourd’hui, mais simplement d’analyser la muséographie de l’exposition, qui nous montre le regard des artistes (plus ou moins ordinaires) sur leurs concitoyens extra-ordinaires.
La volonté muséographique de cette exposition est donc de montrer l’évolution du regard porté sur les individus définis comme “fous” de la fin du 15e siècle jusqu’au 19e siècle en Europe. Mais aussi comment la notion même de fou et de folie a évolué au cours de cette période. L’histoire nous est racontée de manière chronologique, avec des œuvres empreintes d’humour. Car les fous, qu’ils soient observateurs ou observés, peintres ou peints, c’est drôle, jusqu'à ce que ça ne fasse peur… et là c’est moins drôle, ce que nous verrons plus tard. D’abord l’exposition : elle se développe de manière très cohérente et intelligible, avec un parcours chronologique se divisant en quatre thématiques principales. La première, Folie et religion, examine la dualité entre les « fous de Dieu », tels que saint François d'Assise, et les saints visionnaires, illustrant comment la folie était perçue dans un contexte spirituel. La seconde, la Folie amoureuse, expose des manuscrits ou illustrations de récits chevaleresques où les héros, « fous d’amour », sont mis en avant, montrant comment la passion pouvait être assimilée à une forme de folie. La troisième partie introduit la notion de “fous de cour”. Cette thématique se concentre sur les bouffons qui, par leurs critiques et leur humour, occupaient une place particulière dans les cours royales, permettant une remise en question des normes sociales. La quatrième partie de l’exposition, “folie et société”, explore comment, lors de carnavals et de fêtes populaires, la folie prenait le pouvoir, inversant les rôles sociaux, permettant au fou de devenir roi et offrant une critique subversive des structures de pouvoir en place. Cette conclusion illustre la manière dont la folie servait de miroir aux normes sociales et aux comportements humains.
Les visiteurs, tous silencieux et respectueux, sont invités à se déplacer dans dans un parcours à la disposition spatiale pas spécialement folle, c’est à dire, pour reprendre notre définition, ni atteinte de troubles ou de désordres mentaux (imaginez un espace atteint de désordre mental, cela serait fou) ni déraisonnable ou extravagante. Une scénographie à l'esthétique sobre et épurée afin de ne pas distraire l’attention du public et de valoriser les œuvres tout en le transportant dans l’histoire.
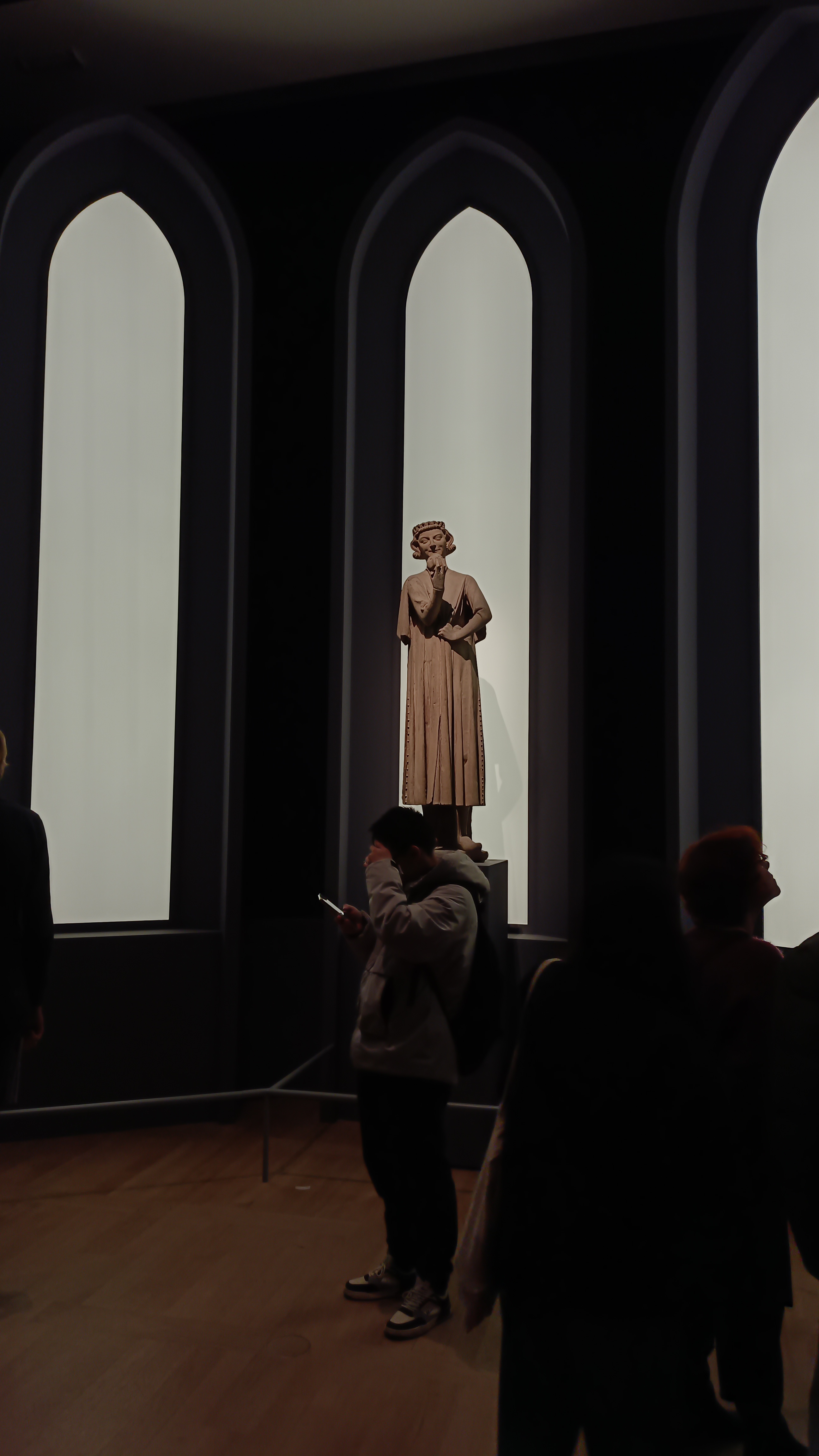
Sculpture d’un fou. crédit T.Lops
La salle la plus dépourvue de couleurs ou de textes muraux avec une typographie un peu singulière est celle abritant les gravures et peintures des maîtres flamands Jérôme Bosch et Pieter Bruegel, l’ancien et le jeune. Véritable apothéose de l’exposition, cette salle met en relation des gravures, dessins et peintures attribués à l'un et l'autre des peintres flamands pour qui ce thème est particulièrement important. Dans cette salle un détail amuse: un dessin attribué à Bosch sur le cartel, signé de la main de Bruegel. Erreur de muséographie ou de référencement ? Dessin réalisé par l’un et offert “in mano propria” à l’autre ? De quoi rendre fou un visiteur curieux…
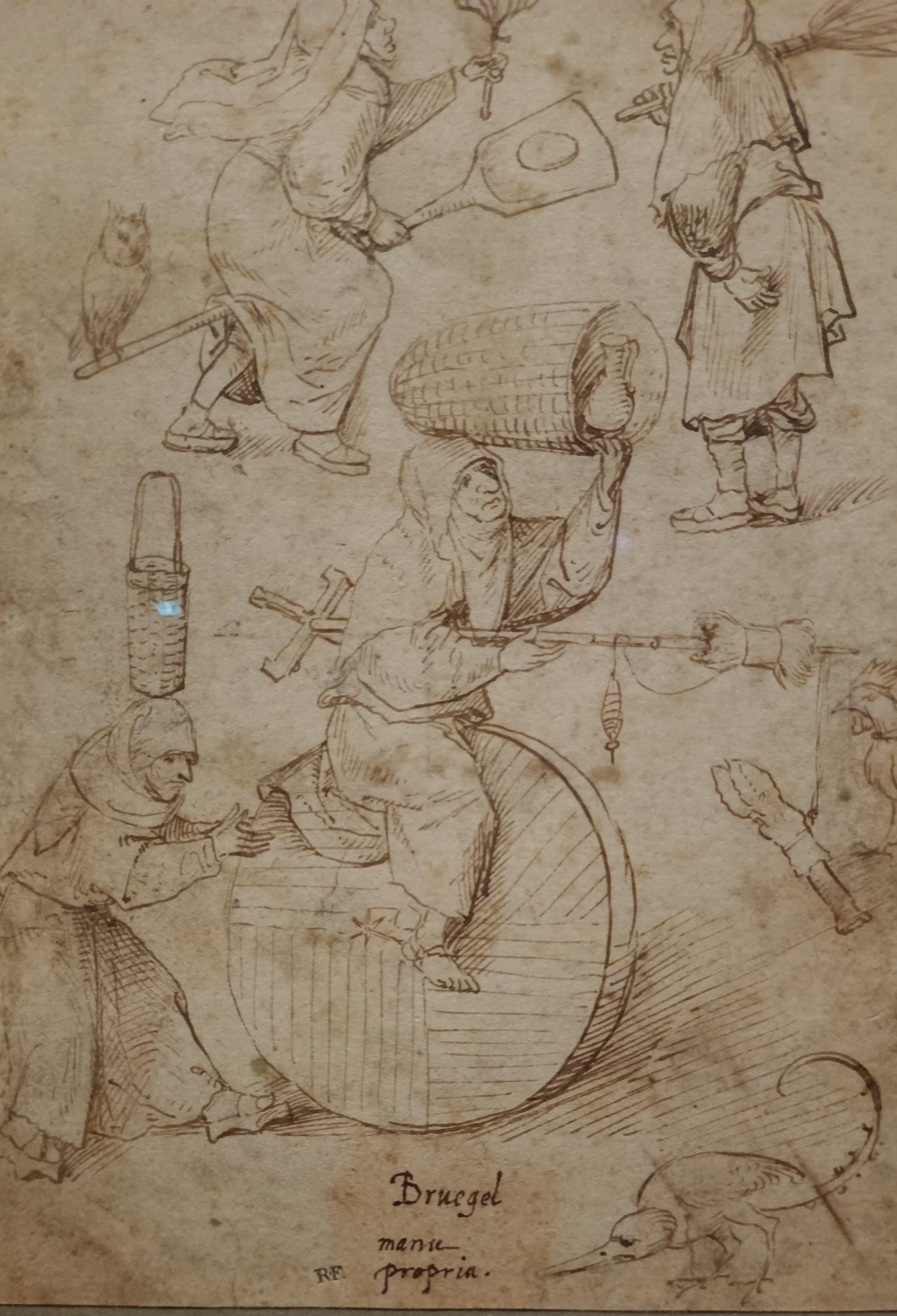
Dessin attribué à Bosch crédit T.Lops
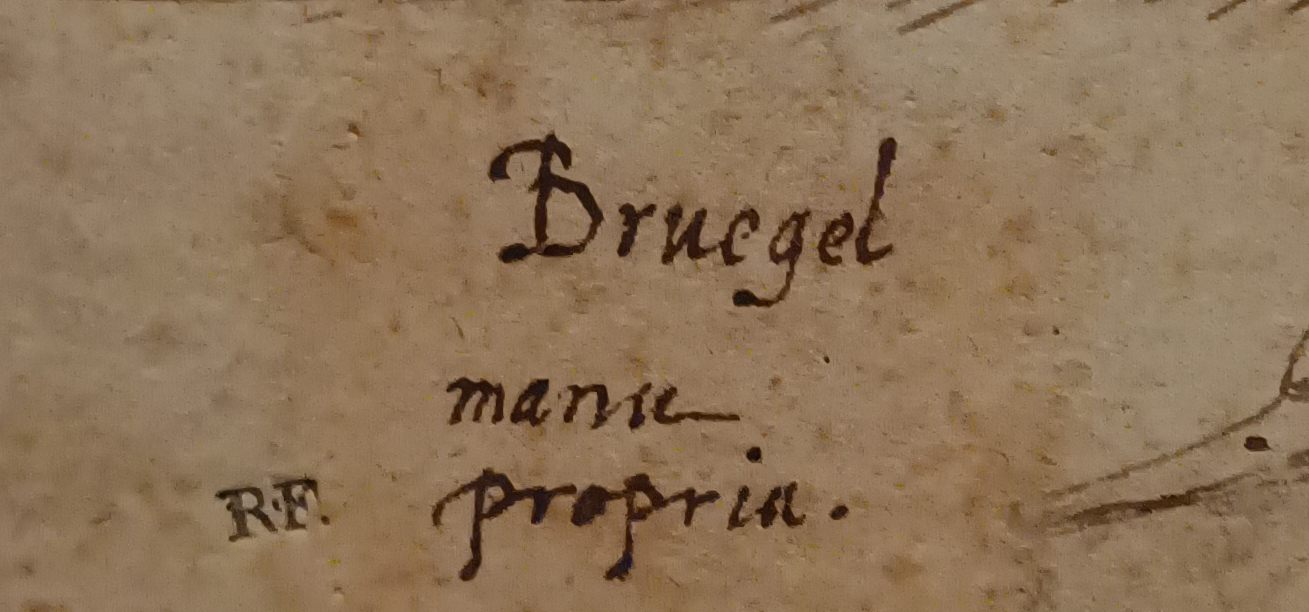
Inscription sur le dessin. crédit T.Lops
Cartel d’exposition crédit T.Lops
Cette mise en scène est parfaitement adaptée au sujet, et dans la salle précédant celle des maîtres, une série de sculptures représentant des bouffons exécutant des pas de danse, en alternance avec des portraits de fou de rois sont disposées sur une cimaise en demi-cercle, comme dans une valse folle, invitant le visiteurs à rentrer dans le cercle et a executer un tour afin de passer devant chacune des sculptures, prenant ainsi part a la danse. L’invitation est subtile mais elle prouve une intelligente volonté de faire dialoguer le visiteur avec le sujet.

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops
La muséographie propose aussi une prise en compte des enfants lors de leur visite. Au début de l'exposition, une cocotte est proposée pour le jeune public. Tout au long du parcours, des cartels simplifiés expliquent certaines œuvres sur un ton léger et proposent ensuite au jeune visiteur d’activer la cocotte. Sur celle-ci sont écrites un certain nombre d’actions permettant à l'enfant de verbaliser sa visite et les émotions ressenties face aux œuvres, mais aussi de s’amuser en imitant les œuvres ou de communiquer avec son accompagnateur en décrivant ou échangeant avec lui sur ce qu’il est en train d’observer. Cette initiative peu coûteuse est extrêmement intéressante car elle permet à l’enfant de créer son propre parcours de visite, mais aussi de créer du lien avec son accompagnateur et transforme l’exposition en espace ludique et pédagogique, sur un thème en premier lieu non adapté pour le jeune public.
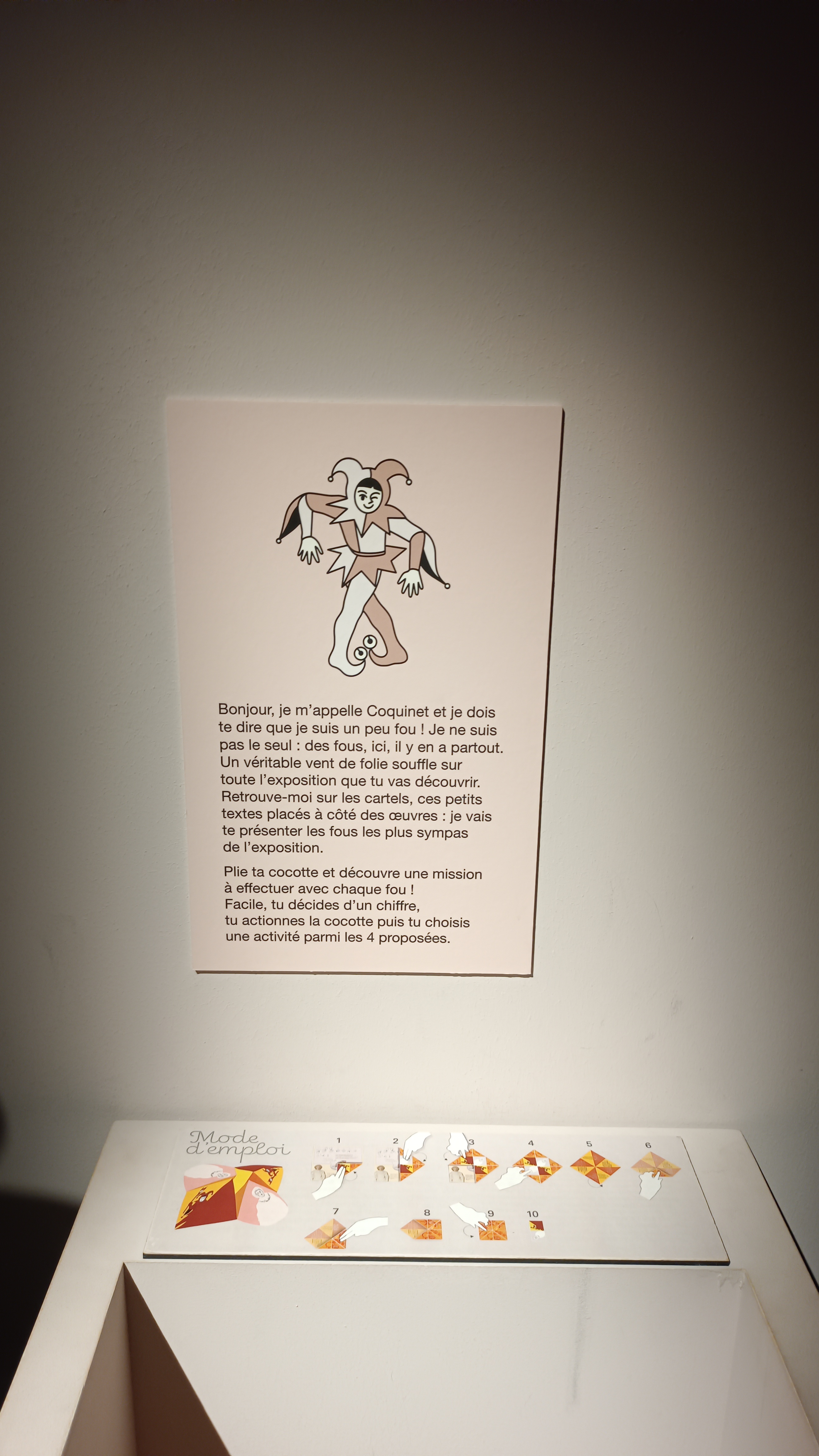
Cocotte pour le parcours enfant. crédit T.Lops
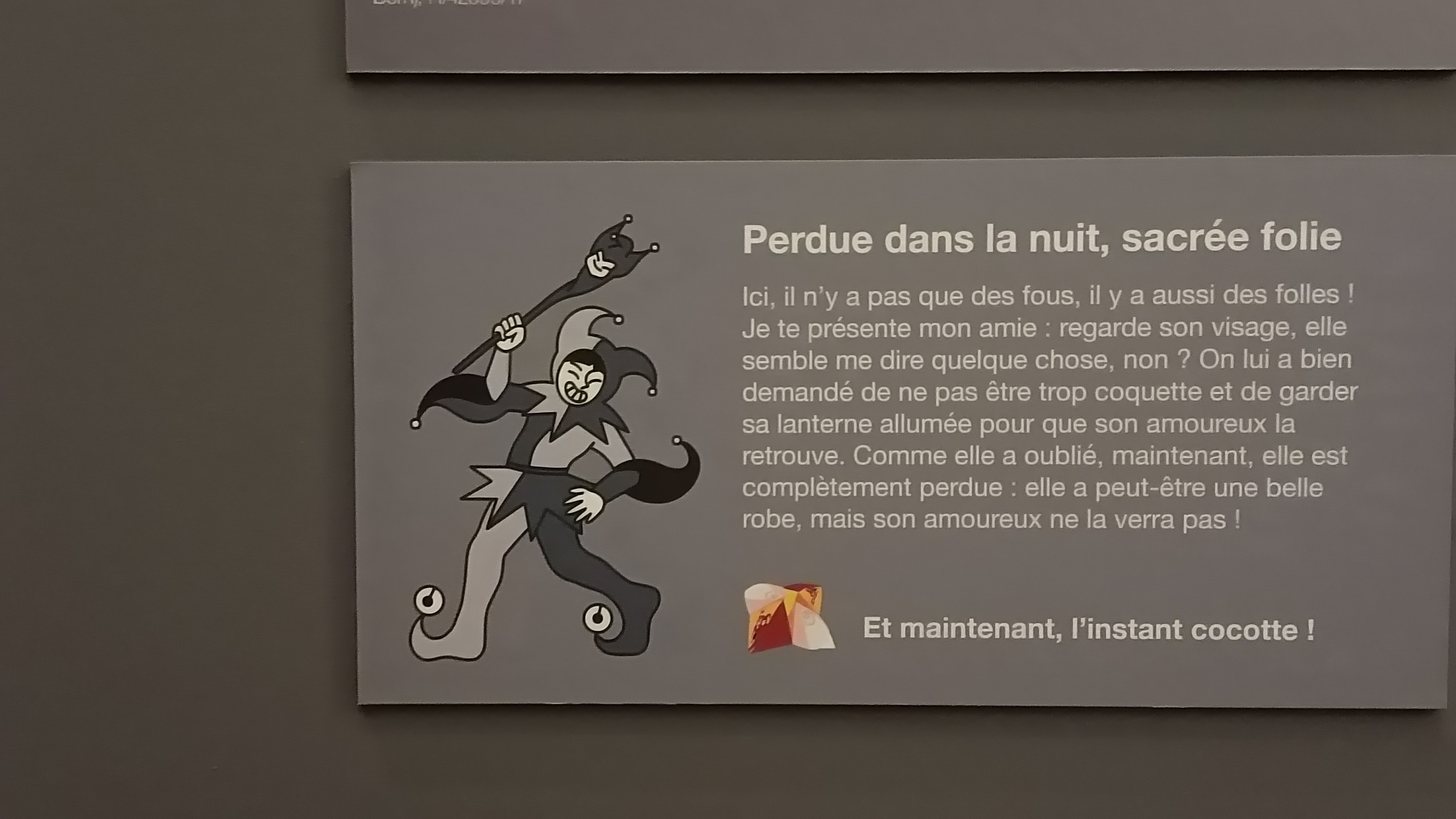
Cartel du parcours enfant. crédit T.Lops
Le thème de la folie a été maintes fois utilisé dans des espaces d’exposition, comme notamment dans le musée du Dr Guislain à Gand. L’édifice du musée, dont la construction a été finalisé en 1857 et qui est un des premiers centres psychiatriques européens, propose des expositions tournées sur l’histoire de la psychiatrie et sur l'art en lien avec la folie, ainsi que sur le regard porté sur la folie dans une période plus contemporaine. Ses expositions permanentes et temporaires, tel que l’exposition Déséquilibre (du 12.10.2019 au 30.12.2025) explorent la frontière entre le normal et l'anormal, offrant une réflexion sur la manière dont la société perçoit et traite la maladie mentale. Situé dans les bâtiments du premier institut belge de psychiatrie, le musée présente des thématiques liées à la santé mentale. La scénographie vise à provoquer une réflexion sur les concepts de normalité et d'anormalité. Le musée cherche à déconstruire les préjugés entourant la maladie mentale, en offrant une perspective historique sur la psychiatrie et en exposant des œuvres d'artistes ayant une expérience directe de la folie. Il s'agit de sensibiliser le public aux réalités de la santé mentale et de promouvoir une compréhension plus nuancée de la diversité psychique. Outre la différence d’approche de la thématique, la programmation du musée du Dr Guislain diffère de l'exposition du Louvre par son public cible. En effet, le musée gantois attire des visiteurs intéressés par l'histoire de la psychiatrie, l'art brut et les questions de santé mentale. Alors que le Louvre s'adresse à un large public international, des amateurs d'art aux spécialistes, en proposant une exploration esthétique et historique de la folie dans l'art. L’exposition offre également des ressources éducatives et des conférences pour approfondir le sujet ainsi qu’un cycle de concerts et spectacles vivants dans l’auditorium du Louvre en lien avec l’exposition.
En conclusion, il est plutôt rassurant de voir que le musée du Louvre a su apporter une touche d’intelligence et d’humour à une thématique aussi complexe que celle de la folie. L’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques se distingue par son approche muséographique originale, qui réussit à raconter une histoire riche et cohérente tout en offrant une analyse fine de l’évolution de la perception de la folie à travers les siècles. Les œuvres sont intelligemment sélectionnées et agencées dans un parcours intelligible et esthétiquement sobre, peut-être pas assez “fou” ? mais servant parfaitement le propos. Elles invitent les visiteurs, jeunes et moins jeunes, à une certaine réflexion sur notre perception actuelle du sujet tout en leur permettant d’admirer et de s’amuser. Cette exposition parvient plutôt bien à faire dialoguer passé et présent, art et société, sérieux et légèreté, offrant ainsi une belle folie artistique à contempler. Dans un monde carnavalesque post élection américaine, ou les fous sont devenus rois, un peu de réflexion et d’émerveillement ne font jamais de mal.
Tano Lops
POUR ALLER PLUS LOIN:
https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou
https://www.familinparis.fr/exposition-figures-du-fou-au-musee-du-louvre/?utm_source=chatgpt.com
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/10/22/au-musee-du-louvre-l-art-de-representer-la-demence_6358309_3246.html?utm_source=chatgpt.com
#expositions #Louvre #folie
Un Louvre, habillé de blanc
Imaginez, le Louvre, sans aucune file d’attente, sans passage de sécurité ; mais aussi le Louvre, pour votre cérémonie de mariage…Science fiction, rêve, souhait, non, tout simplement Zola !
Page de couverture du roman
© psychiatrie.histoire
Dans L’Assommoir[1], Emile Zola, nous invite à parcourir l’un des plus grands musées du monde, en quelques minutes. Sous les mots se dessine une incroyable et inattendue visite…
« Gervaise Macquart se marie avec Coupeau, c’est un petit mariage, fait à la hâte, avecles amis proches et la famille. A la suite de cela, la noce décide de partir faire une balade …
Mais voilà, un orage qui arrive et le cortège transforme sa promenade bucolique en visite culturelle. A quelques mètres se trouve le Louvre, alors pourquoi ne pas s’y rendre …
A la tête du cortège, Monsieur Madinier, qui est déjà venu plusieurs fois. Il les mène à travers les salles, où la noce laisse son imagination s’échapper.
[…] « En bas, quand la noce se fut engagée dans le musée syrien, elle eut un frisson.Fichtre ! Il faisait chaud ; la salle aurait fait une fameuse cave » […]
Les œuvres se suivent et défilent devant leurs yeux. Le cortège continue sa visite en se rendant au 1er étage, où Monsieur Madinier les emmène devant le Radeau de la Méduse, qu’il affecte plus particulièrement.
[…] « Boche résuma le sentiment général : c’était tapé. » […]
La noce continue alors dans les autres salles, avec des yeux émerveillés mais aussi sous des regards amusés et interrogateurs des autres visiteurs,voyant un tableau, bien, inaccoutumé se déplacer devant eux.
[…] « Peu à peu, pourtant, le bruit avait dû se répandre qu’une noce visitait le Louvre : des peintres accouraient, la bouche fendus de rire ; des curieux s’asseyaient à l’avance sur des banquettes, pour assister commodément au défilé ; » […]
Représentation du Louvre en 1878
© La Muse au musée
Emile Zola, nous fait découvrir ici, le Louvre à une autre époque où les copistes venaient, encore, armés de leur chevalet, croquer et recopier les grands de ce nom.
[…] « Mais ce qui les intéressaient le plus, c’était encore les copistes, avec leur chevalet installés parmi le monde, peignant sans gêne ; » […]
La Joconde était exposée le plus simplement du monde, adieu gardiens, sécurités et touristes ; elle était visible et accessible.
[…] « Coupeau s’arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes.» […]
L’Assommoirnous permet de pouvoir imaginer le musée d’un autre temps, comme cela pouvait être plaisant de ne pas programmer une visite et venir quand bon nous semble ou à cause d’une simple averse. Ainsi que le ravissement de déambuler juste déambuler et musarder à travers les œuvres.
Illustration du roman :
Les noces dans le Louvre
© L’Assommoir illustré
[…] « Ils suivirent l’enfilade des petits salons, regardant passer les images, trop nombreuses pour être bien vues. Il aurait fallu une heure devant chacune, si l’on avait voulu comprendre. Que de tableaux, sacredié ! » […]
On y retrouve même le questionnement sur la présentation des tableaux qui, de nos jours, continue de faire quelques controverses et nous rappelle que la pratique du cartel est somme toute bien récente.
[…] « Gervaise demanda le sujet des Noces de Cana ; c’était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. » […]
Découvrir un musée à travers ces mots, est ici, tout aussi évocateur qu’une visite. Notre imagination dessine les œuvres et les espaces au fur et à mesure et l’on y redécouvre le Louvre et ses collections. Il nous faut juste quelques instants de lecture pour nous transporter dans cet ancien palais…
Margaux G.L
[1] L’Assommoir : Roman consacré au monde ouvrier d’Emile Zola de 1876. Il décrit la langue, les mœurs et les ravages (misère et alcoolisme) de ce milieu social.
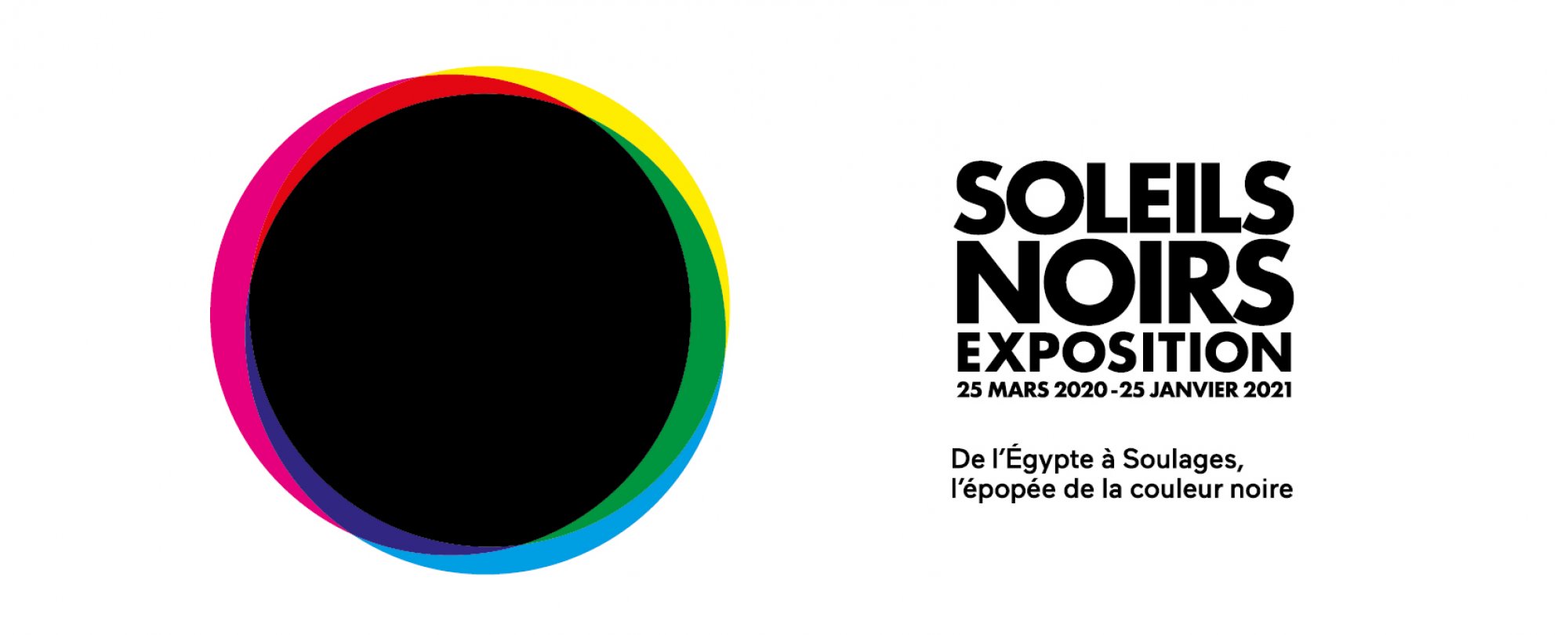
Un noir en demi-teinte : Soleils Noirs au Louvre-Lens
En apprenant que le Louvre Lens tenait une exposition temporaire intitulée Soleils Noirs, j’ai tout de suite été enthousiaste. J’espérais visiter un parcours qui explorerait toutes les symboliques sociales associées au noir, les aventures artistiques menées autour de cette couleur, les problématiques chimiques de l’obtention des pigments nécessaires pour en faire de la peinture, les définitions physiques de la lumière et de l’obscurité... Bref, je m’attendais à une croisée dynamique des savoirs de tous ordres autour de cette teinte fascinante. C’est ce que j’espérais, tout simplement car c’est sûrement ce que je ferais si j’étais en charge d’une exposition sur la thématique du noir.
Pour me renseigner, je consulte alors le site internet du musée, et vois l’exposition décrite comme « poétique et sensorielle », « croisant les époques et les disciplines, entre peinture, mode, arts décoratifs, projections et installations », « de l’antiquité à nos jours ». Exit la physique, la chimie, l’anthropologie, je comprends donc qu’il s’agit avant tout des arts plastiques, avec une incursion – timide – dans le monde social par le biais du vêtement et par l’histoire locale de la mine. C’est un parti-pris intéressant, car plutôt que de partir dans toutes les directions, l’exposition est cadrée sur une thématique présente de manière transversale dans l’art de toutes les époques. Un parcours dans l’histoire de l’art par le biais d’une couleur peut être l’occasion de faire de belles découvertes.
Mais lors de la visite, j’ai trouvé que la multiplicité des périodes était limitée à quelques époques spécifiques (d’un côté, de la 2nde moitié du 18e siècle aux années 1900 en Europe, de l’autre l’art contemporain international). L’art contemporain est présent autant par des œuvres déjà bien inscrites dans le panorama artistique (de Soulages ou Hans Hartung par exemple) que par le recours à des commandes à des artistes en vie, ce qui enrichit considérablement le parcours. Le Moyen Âge, en revanche, est à peine présent via le transi de Guillaume Lefranchois, des collections du musée des Beaux-Arts d’Arras et La chute des anges rebelles du Louvre. Les périodes couvertes sont donc moins nombreuses que ne le laissent penser communiqués de presse et communication internet, et sont aussi les plus mises en avant dans les musées de beaux-arts français en général.

La chute des anges rebelles © Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard
Il me semble qu’au fond, plutôt qu’une question de discipline ou d’époques, ce qui fait la cohérence de l’exposition, c’est l’orientation vers l’esthétique, la beauté forcément sublime d’une couleur abondamment présentée comme ambivalente.

La solitude, Alexander HARRISON, © RMN-Grand Palais, musée d'Orsay, Hervé Lewandowski

Lee BAE, Issu du feu, conservé au FIMAC (Fonds d’investissement et de mécénat en art contemporain) de Lille © MH
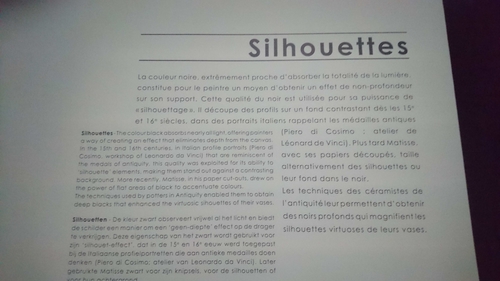
un texte de séquence de Soleils Noirs sur la technique de la silhouette © MH
Simon Hantaï, étude I, suite pour Pierre Reverdy conservée au MAC/VAL (détail) © MH
Pour finir, je regrette que Soleils Noirs présente si peu d’œuvres de femmes. En excluant les œuvres d’artistes anonymes, toutes les œuvres présentées antérieures au 20e siècle sont faites par des hommes, et seul l’art contemporain permet d’insérer des œuvres de femmes dans le parcours. J’ai pris des photographies de chaque œuvre de femme artiste pour le compte twitter @accrochee_s, qui recense les œuvres de femmes présentées dans des expositions temporaires ou permanentes en musées : au total, et sauf erreur de ma part, seules 5 œuvres présentées sur 140 en font partie, plus une œuvre réalisée par un couple de photographes mariés qui travaillaient et signaient leurs œuvres ensemble. Ce relevé indicatif ne dit rien de la qualité de l’exposition, mais signale tout de même un problème de diversité saisissant.
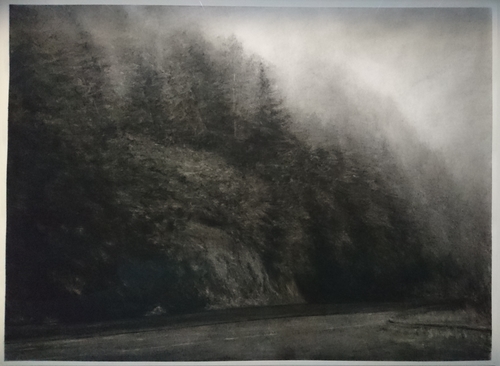
Misty Road de Renie Spoelstra (Frac Picardie Hauts-de-France) © MH l’une des rares œuvres de femmes dans le parcours et l’une de mes œuvres favorites de l’exposition
En somme, cette exposition ne m’a pas entièrement convaincue, même si elle m’a donné l’occasion de voir des œuvres variées et parfois très belles, car j’ai eu l’impression de ne pas accéder à des contenus sur le noir mais seulement à des œuvres d’art dont la couleur noire était une composante. Malgré tout, j’ai particulièrement apprécié l’effort mené pour sortir du cadre monographique ou chronologique qui domine souvent dans les expositions de beaux-arts en France.
Marie Huber
#soleilsnoirs
#artcontemporain
#LouvreLens
Lien pour aller plus loin :
Un nouvel écrin pour la mode : l'ouverture du musée Yves Saint Laurent à Paris
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter le nouveau Musée Yves Saint Laurent ? Une étudiante du master MEM s’est infiltrée pour vous ! Installé dans l’ancien hôtel particulier qui a accueilli la maison de couture d’Yves Saint Laurent, le musée éponyme a tout pour intriguer. Au loin, on ne peut que s’interroger sur la longue file d’attente. Que viennent donc faire tous ces gens ? En s’approchant, une photographie d’Yves Saint Laurent accompagnée d’une citation interpelle le piéton qui marche sur les trottoirs de l’avenue Marceau.
© N.V.
Le musée a été inauguré le 3 octobre 2017, une dizaine de jours avant son homologue à Marrakech1 et près d’un mois après la mort de Pierre Bergé2. Auparavant, de nombreuses expositions ont déjà pu attirer l’attention des férus de mode : depuis 2004, la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent propose des expositions temporaires. Avec Yves Saint Laurent, Dialogue avec l’Artou Deux collectionneurs de génie, Jacques Doucet et Yves Saint Laurent, ce n’est donc pas la première fois que le créateur de mode est mis à l’honneur. Cependant, l’ouverture du musée par la Fondation propose un lieu d’exposition permanente et une reconnaissance muséale (et donc patrimoniale) encore plus forte d’Yves Saint Laurent. Peu de créateurs ont la chance d’avoir leur propre musée ! Il existe par exemple le musée Pierre Cardin (25€ l’entrée en plein tarif, contre 10€ au Musée Yves Saint Laurent !) ou le musée Christian Dior à Granville (à 8€ l’entrée). Autrement, de nombreuses expositions temporaires sont organisées au musée des Arts décoratifs, au Grand Palais, ou encore à la Pinacothèque, mettant à l’honneur Hermès, Dior, Louis Vuitton ou Karl Lagerfeld.
Ici, il s’agit véritablement d’un hommage au génie d’une personnalité, voulu originellement par son partenaire en amour et en affaires, Pierre Bergé. Yves Saint Laurent a profondément marqué l’histoire de la mode, avec des répercussions sociales. En effet, ses vêtements font véritablement partie de l’histoire du XXe siècle : ils accompagnent l’émancipation des femmes, tant dans le privé que dans le public. « Les modes passent, le style est éternel. La mode est futile, le style pas » : le caractère éternel de la création d’Yves-Saint-Laurent s’affirme, dans ce musée labellisé Musée de France garantissant l'inaliénabilité des collections.
Les musées Yves Saint Laurent, aboutissement des missions de la Fondation
La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent prend le relais de 40 ans de création (1961-2002). Reconnue d’utilité publique l’année même de sa création, elle a pour objectif de conserver des collections variées (vêtements de haute couture, accessoires de mode, croquis…), de mettre en valeur ce patrimoine et d’organiser des expositions sur la mode, les arts décoratifs, les photographies, etc., et de soutenir des actions culturelles et éducatives. D’emblée, cela rappelle indéniablement les missions d’un musée (conservation, mise en valeur patrimoniale et actions tournées vers les publics) !
Depuis 2010, la Fondation est également propriétaire du Jardin Majorelle à Marrakech, ville que le créateur de mode a découverte en 1966.
© N.V.
C’est ainsi qu’à proximité du jardin Majorelle, un musée de près de 4 000m² est désormais consacré à Yves Saint Laurent3. Cette antenne marocaine - installée dans un assemblage de cubes qui semblent habillés de dentelle4 - est complémentaire au musée parisien. Le génie créatif d’Yves Saint Laurent ne peut se comprendre sans le véritable choc esthétique qu’a symbolisé pour lui l’expérience marocaine. C'est à Marrakech qu'il disait avoir « découvert la couleur ». En attendant d’avoir la chance de faire un petit voyage dans « la ville rouge », concentrons-nous sur le cas parisien.
Si le choix du majestueux ancien hôtel particulier de la maison de haute couture est pertinent du point de vue du propos, il n’est pas adapté pour accueillir un musée.
Le parcours inaugural : l’immersion au prix d’une bonne circulation ?
Le musée propose une exposition inaugurale, prévue pour durer 1 an5. L’alliance du décorateur Jacques Grange et de l’agence de scénographie et d’architecture d’intérieur Nathalie Crinière donne beaucoup d’élégance, de luxe et de sophistication à ce lieu. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé étaient des clients de longue date de Jacques Grange : c’est donc tout naturellement qu’il a apporté sa touche « classique-contemporaine » à l’ancien hôtel particulier.
L’agence Nathalie Crinière, quant à elle, n’en est pas à sa première exposition pour la Fondation, ni dans le domaine de la mode6. Elle est donc familière avec le fait de magnifier les pièces de créateur, les collections de luxe. Le mot d’ordre de la scénographie semble être celui de l’élégance : épurée et accompagnée d’un éclairage particulièrement soigné, elle propose un véritable environnement d’écrin aux objets. Comme le dit Yves Saint Laurent, « La ligne doit avant tout son élégance au dépouillement et à la pureté de sa construction. […] Jamais de surcharge, il ne faut pas trop de fantaisie. ». Le visiteur a l’impression d’assister à un doux bal d’étoffes, tant les matières sont mises en valeur dans leur diversité de formes, de couleurs, de textures. La mise en scène s’accompagne de jeux de drapés, d’effets d’ombre et de lumière… Et les photos ne peuvent donner qu’une infime idée de l’effet rendu !
© N.V.
Du point de vue des contenus, l’exposition propose un bon équilibre entre les différents expôts et éléments scénographiques : les pièces de haute couture côtoient les croquis, les documents d’archives, les textes (cartels, textes explicatifs assez courts), les ressources audiovisuelles (interviews, films) et l’ambiance sonore7. Les choix muséographiques offrent donc un bon équilibre entre contemplation et consultation d’informations.
En revanche, la complexité du parcours de visite rend l’organisation du propos assez floue. Le visiteur entre dans le bâtiment, commence son cheminement par une salle à gauche (film sur la biographie d’Yves Saint Laurent) avant de revenir sur ses pas, de repasser par la salle de l’accueil. Il doit ensuite monter au 1er étage, puis au 2e étage, avant de repasser par le 1er étage, puis de descendre au niveau -1, pour enfin terminer sa visite au rez-de-chaussée. Si la signalétique fait office de fil d’Ariane, difficile tout de même de comprendre la logique d’un tel cheminement ! Ajoutez à cela les problèmes en termes de circulation (sas d’attente avant la découverte d’un film… dans un escalier !) en raison du nombre de visiteurs (dans des salles souvent assez exiguës), l’expérience de visite s’en trouve gênée. C’est ici que l’exploitation architecturale d’un ancien hôtel particulier, dont le rôle originel n’était en aucun cas d’accueillir un ERP, montre ses limites. Un ascenseur permet toutefois de rendre la visite accessible aux PMR.
© N.V.
N. V.
#muséeprivé
#mode
#museeyslparis
#myslmarrakech
_________________________________________________________________________
1 Le Musée Yves-Saint-Laurent de Marrakech a ouvert le 19 octobre 2017, après 3 ans de travaux.
2 Pierre Bergé est décédé le 8 septembre 2017. C’est lui qui est à l’initiative du musée.
3 Comprenant un espace d’exposition permanente de 400 m², une salle d’exposition temporaire, une bibliothèque de recherche, un auditorium de 140 places, une librairie et un café.
4 Ce bâtiment a été conçu spécialement pour accueillir le musée. L’architecture a été confiée au studio KO (Olivier Marty et Karl Fournier).
5 Du 03.10.2017 au 09.09.2018.
6 Elle s’est notamment chargée de la scénographie de Hermès à tire-d’aile au Grand Palais, et de Dior, couturier du rêve au Musée des arts décoratifs.7 Dans la salle « Hommage à la mode » : chanson de Maria Callas ; dans la salle « Les fantômes esthétiques » : musique du film L’amour fou de Pierre Thoretton, composée par Côme Aguiar.
___________________________________________________________________________________
Pour en savoir plus :

Un styliste pour commissaire au musée de Valence
C’est les vacances ! Mais en tant qu’étudiante en muséographie, même en vacances, difficile de résister à l’envie d’entrer dans un musée !
De passage à Valence (la ville en France, et non celle en Espagne) avec des amis, nous profitons d’un jour orageux pour aller visiter l’exposition « De l’autre côté du miroir, reflet de collection » au musée de Valence (ou Musée d’Art et d’Archéologie de Valence) dont nous avions vu les affiches un peu partout dans la ville.
Armée de mon réflex sans flash j’ai pu à loisir prendre pleins de photographies de cette exposition. Plutôt que de vous faire un simple résumé d’une exposition que vous ne verrez peut-être jamais si vous n’êtes pas de la région ou de passage, je vous propose de vous la faire revivre à travers ce photo reportage. Je ne m’empêcherai pas pour autant d’ajouter mes petits commentaires subjectifs afin de vous faire partager mes ressentis.
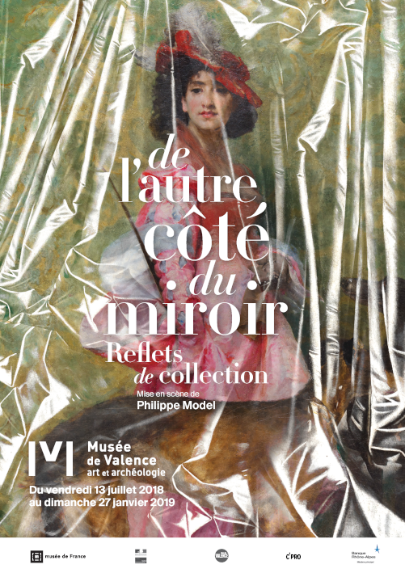
Affiche de l'exposition © Musée de Valence
Hall d'entrée:
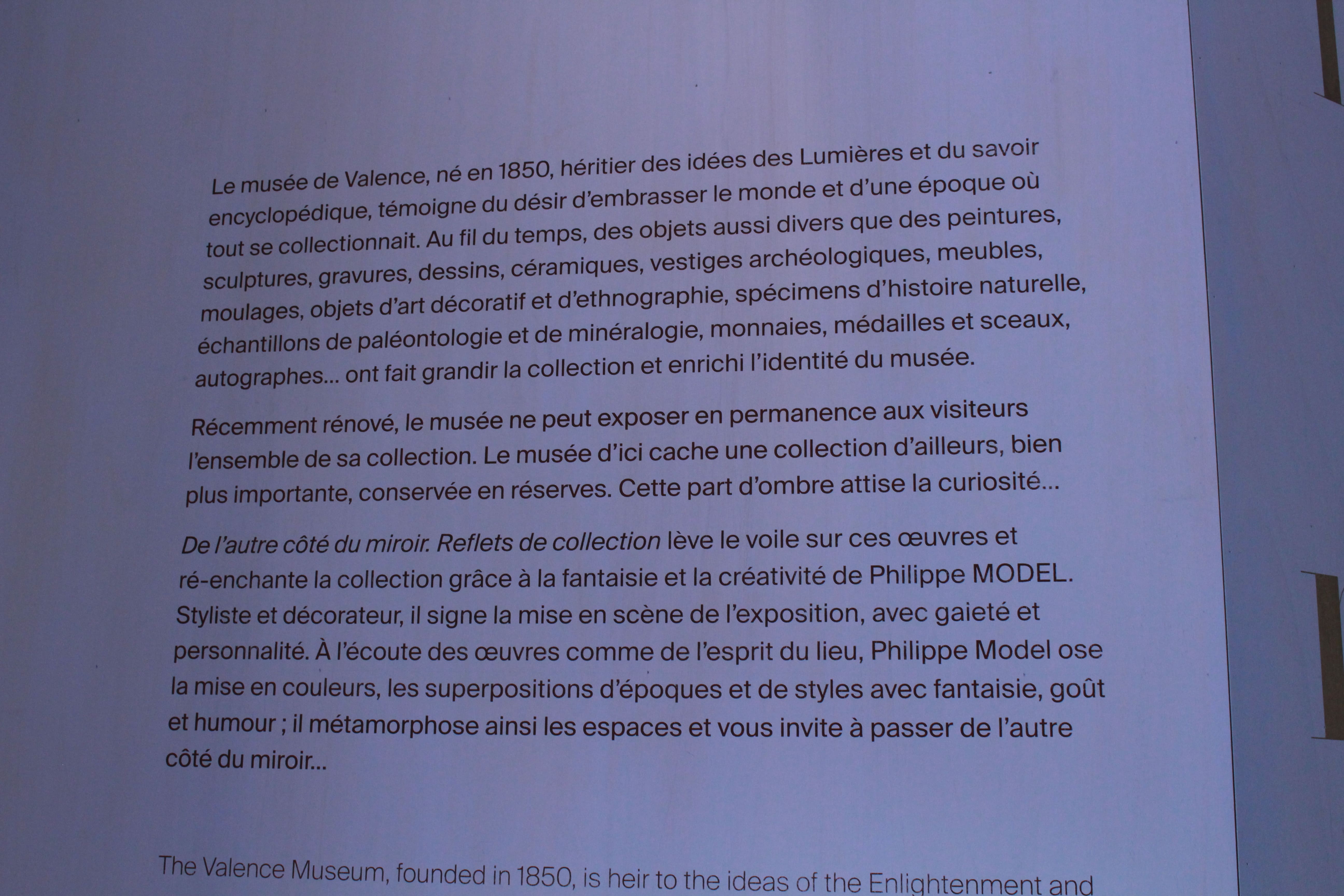
Dans l’entrée de l’exposition vous vous retrouvez dans un petit sas aux murs gris, sur votre gauche le texte d’introduction ci-dessus. A droite du texte l’entrée vers la première salle de l’exposition. L’objectif de l’exposition est la mise en valeur d’objets de la collection du musée par Philippe Model, styliste et décorateur.
Derrière vous, un mobilier sur lequel se trouve le livret de visite, un très beau livret qui sert de cartels pour l’exposition où chaque œuvre est indiquée par un numéro.
Première salle:
« Retour d’Egypte » s’apparente (comme le dit la fin du texte de salle) à un style décoratif qui dura une dizaine d’années après l’expédition en Egypte de Napoléon Bonaparte en 1798. Le texte de salle explique cette campagne d’Egypte. Des objets, dessins, meubles sont disposés sur ces pans de mur, recréant ainsi une sorte de petit cabinet d’étude sur l’Egypte.
Deuxième salle:
Vous voici dans une salle aux murs noirs, une salle dans la pénombre, sur le thème de l’ombre. Je vous avoue que là j’ai du mal à comprendre le thème en voyant les tableaux et objets autour de moi, je pense plutôt à « Sombre » qu’à « Ombre » comme titre de salle.
C’est une salle allongée, un peu comme un couloir, sur la droite des vitrines niches dans lesquelles se trouvent diverses statues. Problème majeur : le manque de lumière rend très inconfortable le fait de voir le numéro de l’objet et de lire son cartel sur le petit livret.
L’œuvre ci-dessous, à l’entrée de la pièce, bénéficie au contraire d’un éclairage qui facilite la lecture et la met en valeur
Dans un coin de la salle, vers le fond, un peu caché, un tableau se reflète dans un mur de carreaux de miroir. On ne comprend pas très bien ce que ce tableau fait là, caché dans ce petit coin, mais au moins on n’oublie pas le thème de l’exposition.
Derrière ce mur de miroir, une toute petite salle, toute noire, comme une petite grotte, montre des négatifs de photographies, d’un certain Paul Peyrouze, photographe valentinois, qui semblent flotter dans cette alcôve exigüe.
Enfin, un mur (toujours noir !) sur lequel sont accrochés des tableaux noirs qui, lorsque l’on s’approchent révèlent des silhouettes de personnages.
La qualité de la photo ne vous permet peut être pas de lire le texte aisément mais il est dit là que dès les années 1980, des artistes sont invités au musée, s’inspirant des collections pour de nouvelles créations et que l’acquisition de certaines œuvres des expositions à contribué à étoffer la collection du musée. Je vous avoue que le lien avec la salle que je viens de voir n’est pas clair, le cloisonnement des espaces et l’enchainement des thématiques ne me paraissent pas évident.
Troisième salle:
Après L’ombre, la lumière, enfin « Lumiere », sans accent, étrange… Là encore le lien entre le thème et les œuvres présentées n’est pas évident. Le regard est attiré par la collection de sanguines exposées sur les murs.
Au fond de la salle, un miroir déformant donne à la pièce une autre perspective. C’est l’arrière du tableau qui s’expose au fond à gauche et se « reflète » de manière fictive sur le sol, comme s’il était l’ombre de la fenêtre. (C’est en fait un sticker collé sur le sol.)
L'escalier:
Un amas d’œuvres colorées sur un mur tacheté de peinture vous invite joyeusement à gagner le premier étage.
On apprécie l’espace dans son ensemble mais il est regrettable qu’on ne puisse pas s’approcher de plus près de certaines œuvres pour les apprécier dans leur singularité.
L'étage, première salle:
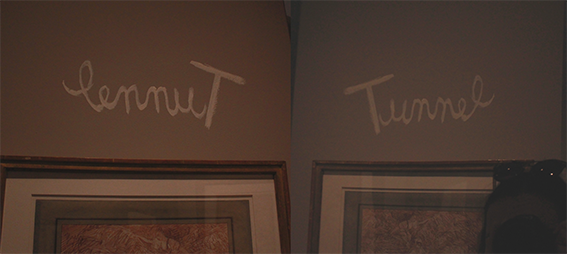
En haut des escaliers, sur votre gauche, en franchissant ce rideau, cette entrée théâtralisée, vous vous retrouvez dans un espace couloir, un « Lennut » ou « Tunnel » comme on peut le lire à travers les miroirs qui construisent cet espace.
Les œuvres s’observent et se reflètent de chaque côté, créant un espace de passage perturbant entre réalité et fiction. Où est l’œuvre vraie, où est son reflet ? Où suis je moi visiteur qui me reflète parmi ces œuvres ? C’est un espace de questionnement déstabilisant mais malheureusement très sombre et exiguë qui n’est qu’un lieu de passage dès lors qu’il y a un peu de monde.
A la sortie de ce tunnel, on arrive dans un tout petit espace encore sombre, intitulé « Point de vue », qui permet d’observer une tête de cheval sous différents angles de vue, grâce à des petits miroirs, et donne aussi un point de vue sur l’escalier.
Ensuite s’ouvre finalement un grand espace lumineux, découpé en plusieurs petites atmosphères.
Première atmosphère : en partant de cette œuvre de Raoul Dufy présente dans les collections du musée, Philippe Model créé un espace reprenant couleurs et atmosphère du tableau, dans des des créations du styliste (le mobilier notamment).
Idem pour l’atmosphère suivante : qui s’inspire cette fois d’une œuvre d’Emile Boilvin, toujours avec des créations de X : chapeaux et chaises.
Ce dernier espace, « Télécaramboscopage », rassemble des chaussures de Model avec des objets des collections, à la façon d’une boutique de chaussures de luxe aux vitrines particulièrement soignées.
Puis nous reprenons l’escalier pour sortir de l’exposition. Avant de partir, un dernier espace met en scène les coulisses de l’expo à travers des photos imprimées sur les murs. Une très bonne idée que de donner à voir les coulisses, les boites de conservation des objets, les espaces avant l’exposition, les équipes et les réflexions nécessaires à l’obtention du résultat. Peut-être qu’une vidéo montrant les coulisses du projet aurait permis de pousser plus loin dans cette idée.
En sortant de l’exposition, une petite urne nous propose d’y déposer notre livret de visite si nous ne souhaitons pas le conserver. Une bonne idée pour limiter le nombre de tirages, réduire un peu les déchets pour des livrets de visite qui, on le sait bien, finissent très souvent à la poubelle.
C’est ici que s’achève notre visite de l’exposition « De l’autre côté du miroir, reflet de collection » au musée de Valence. Sans vous familiariser avec toutes les œuvres de cette collection, j’espère vous avoir sensibilisés à l’atmosphère. J’ai vu les objets de cette collection certes mais je n’ai pas bien compris leur rapprochement, ce qui me laisse sur une sensation de brouillon. C’’est original mais c’est un peu « random » comme on dit en anglais. Les objets sont-ils mis en valeur ? La collection n’est-elle pas plutôt noyée dans cette scénographie singulière qui crée des espaces de déambulations originaux mais nous fait finalement passer à côté des objets eux-mêmes. Le travail du styliste est intéressant, du fait de sa sensibilité aux couleurs, aux matières, aux textures mais non à l’espace d’exposition comme espace de circulation thématique. N’aurait-il pas mis de côté le visiteur au profit d’une immersion à travers des univers, qui ne font pas toujours sens. Nous sommes bel et bien passés de l’autre côté de quelque chose mais je ne sais pas très bien de quoi.
Julie Schafir
Site du musée :
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=mus%C3%A9e+de+valence&ie=UTF-8&oe=UTF-8
#Valence
#Collection
#Stylisme
#Singulier
Photographies de Julie Schafir

Und....Aktion !
Le musée du cinéma de Berlin, ou Museum für Film und Fernsehen, se confond dans l'architecture du Sony Center sur une des places emblématiques de Berlin, la Potsdamer platz. Dès 1963, une collection constituée d'archives vidéo, de costumes, d'affiches et de photographies existait dans les archives de la Deutsche Kinemathek mais ce n'est qu'en 2000 qu'elle est rendue accessible au public avec l'ouverture de ce musée. Le musée est situé dans un ensemble appelé le Filmhaus où se trouve également la cinémathèque allemande, une importante bibliothèque sur le cinéma et un institut pour le film et l'art vidéo. La visite de ce musée - pourtant peu connu des flux de touristes qui visitent Berlin - est particulièrement marquante car la muséographie et la scénographie en font davantage qu'un musée sur le cinéma allemand, pour diverses raisons.
Spiegelsaal © Deutsche Kinemathek
Le Filmmuseum ne présente pas une histoire exhaustive du cinéma allemand : seulement certaines périodes sont abordées et illustrées d’objets, de photographies et d’extraits de films emblématiques. Le parcours de la visite est chronologique et traverse une période de 1895 jusqu’à aujourd’hui. Certains espaces marquent le parcours par une scénographie et une muséographie intrinsèquement liées.
A l'entrée, le visiteur accède à la Salledes miroirs (Spiegelsaal), un espace saisissant pour le visiteur. Prologue dumusée, le circuit de visite est entouré de toutes parts par des miroirs et quelquesécrans diffusant des extraits de films emblématiques qui se reflètent àl’infini. Le visiteur retrouve ces films à travers l’exposition permanente etl’effet de multiplication d’écrans est aussi récurrent. Les images diffuséesmontrent surtout des couples, des personnages isolés et des gros plans sur desvisages. Par exemple, des extraits de Métropolis de FritzLang, du Cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene ou de LolaRennt de Tom Tykwer animent les murs. La musique d’ambiance évoque labande originale d’un film à suspense.

Salle Caligari © T. Rin
Les sections du musée se suivent comme autant de plongées historiques dans des périodes du cinéma allemand. Celle consacrée au film muet de Robert Wiene, le Cabinet du docteur Caligari, par exemple, immerge dans l'univers du film. Ce dernier a fortement marqué l’Histoire du cinéma allemand à ses débuts. Les thèmes abordés, comme l’hypnose, les forces occultes ou les excès de cocaïne, en font un film à l’atmosphère particulière. Cette dernière est très bien rendue dans la salle du musée. Elle est plutôt sombre et un son inquiétant provenant du film est diffusé, comme le râle d’un des personnages. De longs extraits sont projetés dans un renfoncement noir, qui évoque une salle de cinéma. Concernant les objets exposés, il y a des affiches et des croquis, une reconstruction en maquette du studio et des décors... La pièce devient presque un décor de ce film, une immense photographie de scène de rue et un faux mur de briques où est écrit « Du musst Caligari werden » plaçant le visiteur dans la position de l’acteur.

Salle sur le cinéma nazi © T. Rin
La section « Transatlantique » montre quant à elle comment Berlin a été un centre européen du cinéma avec des vitrines consacrées à Murnau, Lubitsch et Stronheim mais aussi les artistes qui sont partis aux Etats-Unis où leur renommée fut très importante. C’est le cas par exemple d’Emil Jannings qui reçoit le premier Oscar à Hollywood pour le prix du meilleur acteur en 1927. Pour représenter cette émigration, l’espace du musée a également été réfléchi. Au fond, le visiteur peut distinguer une barrière avec une photo de paysage en arrière-plan. Sur les côtés, des hublots font office de fausses fenêtres. La volonté de l’architecte a donc été d’évoquer un bateau ; ce bateau qui emmenait les artistes de l’autre côté de l’Atlantique.
Cette salle contraste énormément avec celle consacrée à la période nazie. Cette dernière est très froide et les murs sont quasiment nus, couverts de plaques de métal. Dans ces murs, quarante tiroirs, qui contiennent aussi bien des documents papiers que des vidéos, peuvent être ouverts. Ce sont des extraits ou des documents en lien avec le cinéma de propagande qui envahissent la culture de l’Allemagne. Le fait que ces tiroirs soient fermés et l’atmosphère si froide renvoient à cette période sombre de l’Histoire allemande. A travers ces quelques exemples, il est facile de comprendre la réflexion poussée des muséographes et scénographes pour nous faire comprendre l'histoire du cinéma allemand.

Tunnel du temps © Deutsche Kinemathek
Cette réflexion se poursuit d'ailleurs dans la partie consacrée à la télévision. Le but de l’exposition permanente est de donner un aperçu de l’évolution de la télévision, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Elle comprend tout d’abord la galerie des programmes où le visiteur a accès aux archives de la cinémathèque et peut regarder des émissions et des films en entier. Ensuite, l’accès à la deuxième partie de l’exposition se fait par un escalier blanc entouré de miroirs et d’écrans blancs très lumineux. On arrive alors dans la pièce appelée le « tunnel du temps » qui rappelle les étapes de l’Histoire de la télévision. Des dates et des écrans entrent en écho et le couloir matérialise l’évolution de la télévision jusqu’à son omniprésence dans notre société actuelle. Son aspect minimal et très lumineux paraît futuriste. Cela renvoie certainement à la modernité de la télévision, qui a bouleversé notre quotidien en seulement quelques décennies.
La fin du parcours nous conduit dans une autre salle de miroirs, qui fait écho à l'entrée. Un documentaire projeté sur des dizaines d'écrans et se reflétant sur 141 miroirs retrace l’histoire de la télévision. La vidéo est réalisée en mosaïques : des dizaines et des dizaines d’extraits d’émissions se confrontent. Des thèmes émergent : le divertissement, la musique, les informations, les scandales, la cigarette à la télévision. C’est un véritable kaléidoscope de la télévision de 1950 jusqu’aux années 2000.

Spiegelsaal 2 © Deutsche Kinemathek
Ainsi, ce n'est pas un musée sur les techniques du cinéma même s’il y a beaucoup de matériels cinématographiques dans leurs archives, comme des caméras. Ce musée est en réalité un musée sur l'Histoire allemande sous le prisme du cinéma comme le montre les divisions chronologiques du musée, toutes en écho avec une période historique. Le musée montre à quel point le cinéma est souvent un reflet de sa société et de son époque. Pourtant le parcours évoque aussi la force critique du cinéma face à l'Histoire et sa force d'anticipation. La section sur l'œuvre de Fritz Lang, Métropolis de 1927 nous rappelle son audace pour l'époque, en nous immergeant dans un décor de ville tentaculaire et aliénante comme peuvent l'être les mégalopoles d'aujourd'hui.
Ce parcours évocateur est le résultat des travaux de l'architecte Hans Dieter Schaal. Il explique ainsi sa conception de la scénographie du musée : «I imagined the pathway through film history like a musical score : still, quietzones give way to loud, shrill areas, there are slow increases in intensity,eddies, melody-clusters and harmony fields. Then again disharmony breaksthrough the wall of images like a stabbing knife ». Au risque de paraphraser, il montre ici que l’espace du musée n’est pas linéaire, chaque pièce procure une sensation particulière au visiteur. Il y a des pièces classiques où des éléments de l’histoire du cinéma allemand sont présents dans des vitrines mais il y a aussi des pièces où la scénographie est plus importante que le contenu.
La musique, la lumière et tous les autres éléments scénographiques ont une place majeure dans le musée. Ils ponctuent la visite et renvoient aux sens éveillés par le cinéma : l’ouïe et la vue. En quelque sorte, l’espace muséal possède la même dramaturgie qu’un film : il y a des espaces inquiétants, d’autres plus calmes, d’autres bruyants, etc. Les sections du musée ont quelque chose de métaphorique : elles représentent une période historique et cinématographique grâce à leur décor, leur lumière et la collection présentée. Hans Dieter Schaal explique d’ailleurs qu’il a choisi les matériaux de chaque pièce en fonction de l’atmosphère de la période exposée.
Hans Dieter Schaal parle également d’un aspect intéressant qui peut nous faire comprendre l’importance de la muséographie et de la mise en scène dans un musée sur le cinéma. Il est difficile de parler du cinéma en tant que tel car il est lié a beaucoup d’éléments. Le film dans un musée n’est pas présenté comme au cinéma mais sous un autre angle : on voit l’envers du décor si on peut dire. En effet, le Filmmuseum présente des maquettes des décors, des photographies, les biographies des acteurs ou actrices, des costumes ou des objets utilisés pendant les tournages. La présentation de ces éléments est donc fondamentale.
La singularité du musée vient du contexte historique particulier dans lequel le cinéma allemand a évolué. Sa visite est aussi bien une expérience visuelle qu'un aperçu de l'Histoire de l'Allemagne. Ce musée est à l'image de la ville de Berlin sur de nombreux points : innovant, singulier, en perpétuelle reconstruction, tout en gardant, toujours visibles, les traces du passé.
#cinéma
#histoire
#scénographie
Pour en savoir plus :

Une heure au musée : les escape games muséaux
N’avez-vous jamais rêvé de découvrir les musées à la manière du film blockbuster « Une nuit au musée » ? De chercher des indices dans les collections des musées ? Ou encore de résoudre des énigmes pour éviter la destruction du site par un pharaon en colère ? C’est ce qui vous est proposé – l’évasion des collections en moins – dans plusieurs musées européens à travers les escape games au musée. Véritables outils de médiation ou gadgets détournant le public de la découverte des collections, c’est ce que nous allons découvrir ensemble.
C’est quoi un escape game ?
L’escape game est un nouveau concept de jeu qui fleurit partout en France et à l’étranger depuis environ 4 ans. Ces jeux d’évasion, issus des jeux vidéos « escape the room », se jouent en équipes réduites (entre 2 et 6 personnes en moyenne) et se déroulent sur une période d’une heure. Ils sont constitués d’une multitude d’énigmes à résoudre afin que les visiteurs puissent s’échapper de la pièce dans laquelle ils sont enfermés.
Quel lien entre les escape games et les musées ?
Face à l’ennui croissant de certains visiteurs au musée, les médiateurs culturels ont enclenché une ludification de leur programmation culturelle afin d’intéresser de nouveau les jeunes générations aux musées.
La ludification qu’est-ce que c’est ?
La ludification est une manière d’aborder la médiation culturelle en utilisant les éléments caractéristiques qui rendent le jeu attrayant, comme le challenge, la compétition, ou encore le dépassement de niveaux, le tout, dans un contexte autre que celui du jeu, dans la découverte d’un musée par exemple. La ludification permet (entre autres) de rendre le visiteur acteur de sa découverte.
Les médiateurs ne créent pas ces jeux parce qu’ils ont conservé leur âme d’enfant et que cela les amuse mais bien pour motiver les visiteurs et les impliquer. La ludification se distingue du jeu car elle utilise le jeu pour atteindre des objectifs pédagogiques autres que le fait de simplement jouer à un jeu, en théorie. Dans les faits cela est beaucoup plus complexe.
On s’amuse, mais qu’apprend-t-on vraiment ?
De nombreux musées et sites culturels mettent en place des escape games pour répondre à une mode des escape games, sans pour autant poursuivre des objectifs pédagogiques dans le jeu. C’est notamment le cas d’un site miner du sud de la France où l’escape game se déroule dans une galerie de mine. L’ambiance créée par les créateurs de l’escape game s’appuie sur des faits historiques réels de la mine. Mais à aucun moment le visiteur n’est invité à mobiliser des connaissances historiques afin de résoudre les énigmes. Bien sûr, toutes les structures culturelles organisant des escape games ne souhaitent pas en faire une introduction à la découverte de leurs collections. Certaines souhaitent simplement proposer un moment ludique à leurs visiteurs, il ne faut pas oublier ce cas de figure.
En dehors de ces cas particuliers, le souci principal de nombre d’escape games culturels est qu’ils ont tendance à agglomérer des jeux se voulant ludiques, sans véritable apport historique. Cela a pour effet de dissoudre l’ambition pédagogique de ces jeux, les transformant en simples jeux sans intérêt pédagogique particulier.
S’il est « bien » réalisé, alors les collections ou bien des éléments de leur histoire peuvent être directement incorporées à l’escape game. Elles deviennent alors des éléments clés à la résolution des énigmes. L’escape game « De faux airs de faussaire » du musée de Flandres à Cassel en est un bon exemple. Afin de résoudre les énigmes, les joueurs doivent consulter des dossiers d’œuvres du musée. Cette démarche permet de faire découvrir l’histoire du site et de ses collections aux jeunes générations et aide à dépoussiérer le musée qui est parfois vu comme un lieu ennuyeux pour le transformer en un lieu de jeu.

Escape game «De faux airs de faussaire » du Musée de Flandres (Cassel) © Par A. R.-M pour L’indicateur des Flandres
Parfois les escape games sont moins bien réalisés, le jeu accapare alors l’attention du visiteur et détourne son regard des œuvres. C’est le problème de beaucoup d’escape games muséaux où les visiteurs sont focalisés sur les énigmes et leurs réussites et non pas sur la découverte des œuvres. Les médiateurs qui créent des outils de médiation ludique doivent donc équilibrer cette ludification.
Ces escape games ne vont-ils pas transformer le musée en parc d’attraction ?
Plusieurs risques se font jour avec le développement de ces jeux. Le risque principal étant le fait de n’attirer finalement que des visiteurs uniques/des primo-visiteurs. Cela serait contraire au but premier de la création de ces outils, à savoir, élargir la typologie de public se rendant au musée. C’est pour cette raison que les musées ne doivent pas créer des escape games dans le but d’attirer un public pour une seule fois. La création de ce jeu ne doit pas être une fin en soi, mais une manière de véhiculer des informations sur l’histoire, afin d’éveiller un intérêt chez le visiteur. Nous ne sommes pas sûrs que les jeunes qui découvrent le musée pour la première fois à travers ce jeu y reviennent un jour.
Mais après tout, les visiteurs sont-ils obligés d’aller au musée pour apprendre quelque chose ? Ne peuvent-ils pas simplement se rendre au musée pour regarder des œuvres qu’ils trouvent belles sans vouloir nécessairement en apprendre plus ? Il existe beaucoup de raisons plus ou moins avouables de se rendre au musée, s’amuser en est une. Je ne l’évoque que peu, mais évidemment, nous pouvons simplement comprendre que les joueurs qui participent à ces escape games souhaitent juste s’amuser, et au fond, il n’y a aucun mal à cela.
L’escape game du Sisterna Museo de Fermo, un projet rondement mené
Certains musées en Europe parviennent à mettre au point des escape games qui mobilisent les visiteurs, sans les détourner de la découverte du lieu en question, tel le Sisterna Museo de Fermo en Italie (Musée des Citernes). Il tire profit de l’ambiance authentique dont il dispose déjà pour créer un escape game basé sur l’histoire et la culture. Pour ce faire, les solutions des énigmes mobilisaient des faits historiques ainsi que des légendes romaines, permettant ainsi aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’époque romaine. L’objectif était atteint puisqu’il s’agissait du but principal de la création de cet escape game, c'est-à-dire amener les joueurs à mobiliser des connaissances historiques multiples pour résoudre les énigmes.

Escape game de Sisterna Museo (Fermo, Italie) © Musée Sisterna de Fermo
Les motivations qui ont conduit l’équipe du musée à créer cet escape game sont également bien définies, ce qui a probablement contribué à son succès. Ils souhaitaient accueillir des touristes sur leur site, et développer la fréquentation par un public plus jeune. Comme le dit Eliana Ameli (créatrice de l’escape game), « plus que jamais, les musées sont perçus par les jeunes générations comme étant ennuyeux », à travers cet escape game, l’équipe souhaitait démentir cette perception du musée.
Cet escape game est un modèle pédagogique autant que ludique, car il parvient à allier parfaitement le plaisir du jeu et l’apprentissage. D’autant que la plupart des personnes n’ayant jamais visité les citernes romaines leur ont fait un retour positif sur cet escape game, cette idée a également encouragé de nombreux visiteurs à venir découvrir le site.
Les escape games muséaux peuvent être une manière originale d’engager le public dans la découverte du site et de mettre un terme à une expérience de visite qui consiste à consommer passivement des expositions et des informations. Mais rien n’exclut la possibilité pour les visiteurs de simplement s’amuser en résolvant des énigmes dans un cadre exceptionnel. C’est pourquoi les escape games et « les jeux ne doivent pas être considérés comme des ennemis, mais comme des alliés pour transmettre de la culture ». Et voilà qu’est rafraîchie la façon que nous avons de découvrir les collections des musées, au croisement de l’apprentissage et de l’amusement.
Claire HAMMOUM—FAUCHEUX
#escapegame
#ludification
#mediationculturelle

Une lettre ouverte au Victoria and Albert Museum
Londres, le 11 novembre 2014
Chère Victoria and Albert Museum, Merci beaucoup pour votre accueil quand je suis venue visiter votre musée cette semaine. Vos instructions sur votre site web étaient très claires et précises : j'ai facilement trouvé le musée. Les prix des expositions temporaires sont abordables, surtout en sachant que les expositions permanentes sont gratuites.
Affiche de l'exposition Crédits photo : JC
En tant que visiteur, j'ai pu découvrir votre exposition, Wedding Dresses 1775-2014, sur les robes de mariage. En tant que femme qui approche de la trentaine, avec toutes ses copines qui se marient en ce moment, j'ai trouvé l'exposition particulièrement pertinente sans trop nous asticoter (pour dire que les membres féminins de la famille qui demandent aux jeunes femmes de nos jours "quand est-ce que tu vas te marier ?" reproduisent une pression collective et un modèle. Certes, l'exposition ne choisit pas la glorification de la construction de la famille comme thème central, mais on vit une exposition au prisme de son expérience aussi.). Je trouve que la façon chronologique de raconter l'évolution des robes de mariage était un bon fil à suivre pour le parcours muséographique, et de restituer le mariage de la Reine Victoria d'Angleterre avec le Prince Albert où la robe de mariage blanche est devenue à la mode.
J'aurais vivement recommandé votre exposition pour ceux -- ou plutôt celles -- dans ma tranche d'âge (c'est-à-dire, les femmes entre 20-35 ans nées dans un pays occidental et qui ont grandi sans handicap sans aucune autre envie que de vivre une histoire féerique en recherchant le Prince Charmant) ; mais heureusement, ou malheureusement selon votre regard, nous ne sommes pas tous et toutes les mêmes sortes de visiteur. J'ai trouvé particulièrement absente l'interaction entre le musée et le visiteur : pour un sujet si individuel comme le mariage, il n'yavait aucune personnalisation dans le discours. Pour cela, j'ai préparé une liste des petites améliorations pour un plus grand public, sans dépenser trop d'argent (même avec votre mécène Waterford, la marque de la cristallerie mondialement célèbre, c'est la crise). Sans délai :1. L'accessibilité des publics. Les mariées et les mariés ont toutes les tailles et formes, mais l’exposition ne montre que très peu d'effort pour atteindre ces publics. J'ai vu à l'entrée un livre avec tous les textes des cartels en grande police pour les malvoyants. Bravo ! Mais sans contexte, comment pourrais-je savoir quelle robe va avec quel texte ? Les ascenseurs se trouvent en dehors de l'exposition, ce qui veut dire que je dois sortir de l'exposition si je suis en fauteuil roulant ou si je ne peux pas monter desmarches pour l'étage. Et alors, le discours est totalement interrompu.
Crédits : JC
2. La diversification du discours. Le mariage existe bien sûr dans différentes cultures. Malgré la diversité ethnique du Royaume Uni, les robes exposées reflètent presque uniquement l'idée de la robe blanche occidentale. Il est vrai que vous avez présenté des robes des femmes non-anglaises (notamment une mariée chinoise et une mariée nigérienne qui sesont mariées avec des Anglais avec les robes avec quelques influences de ses pays d'origine; également une femme qui voulait un style indien pour sa robe), mais aucune de ces robes ne parlait de l'histoire du mariage dans ces autres cultures, et donc l'influence sur le marché de nos jours. Je vous félicite pour l'inclusion des costumes pour les hommes dans le contexte du mariage pour tous.
Crédits : JC
3. Je veux toucher les robes ! Je connais les problèmes soulevés par la conservation des textiles, et les robes de mariées ne font pas exception. Mais vous parlez sans cesse de l'importance de la qualité du tissu, en otage en pleine vue derrière les vitres. Qu'est ce qui se passe quand un enfant, qui n'est jamais allé dans un magasin de tissu ou qui n’a jamais touché les tissus riches, comprend si on dit que cette robe-ci est faite de soie, tandis que celle-là est faite de mousseline ? A quoi servent les cerceaux trouvés sous les jupons ou les corsets ? Un public savant saura que ces éléments étaient à la mode de l'époque, mais peut-être il n’en saura pas les raisons. Peut-être faut-il ajouter un petit atelier sur la fabrication de la dentelle, ou l'application des billes en verre pour montrer la main d'œuvre nécessaire pour réaliser chaque robe. Comme votre collection est visible sur Pinterest, quel est l'intérêt à venir au musée si lavisite n'ajoute pas une autre dimension ?
4. Laissez jouer l'imagination ! Je sais à quel point c’est nunuche, mais j'ai rêvé de ma robe de mariée depuis que je suis toute petite. Après avoir vu toutes ces robes bien travaillées, j'avais tellement envie de partager mon avis sur les robes et faire "retravailler" la mienne dans l'imaginaire. Ceserait "la cerise sur la pièce montée" de trouver un moyen de partager mes idées en s'inspirant de toutes ces robes présentées. Imaginez si vos visiteurs pouvaient trouver à la fin de l'exposition un logiciel interactif pour créer sa propre robe de mariage, et de l'envoyer à sa boîte mail ? Encore plus loin, sur votre site web peut-être vous pouvez proposer de "pinner" les créations du public sur Pinterest ?
5. Laissez-moi témoigner! Une grande lacune est le manque de conversation entre le musée et le visiteur. Plus concrètement, le musée alimente le visiteur, mais le visiteur ne peut pas alimenter le musée. En 2011 pour le mariage du Prince William et Kate Middleton, le monde a été témoin de la cérémonie la plus diffusée dans le monde. Ceci est particulièrement touchant pour la population régulière du musée car le lieu royal du mariage, Westminster Abbey, se situe seulement à quatre arrêts de métro du musée, on y est en quinze minutes. Les vidéos des mariages royaux britanniques depuis le 20ème siècle sont diffusées dans la salle, mais il n'est pas possible d'ajouter ses sentiments--et vu les chiffres des spectateurs pour le mariage de Will et Kate ,la population anglaise, et le monde entier d'ailleurs, ont quelque chose à partager. Je propose de créer un tableau interactif pour ajouter les souvenirs du public de ces jours. Selon les âges des visiteurs, le musée peut cueillir des souvenirs de la cérémonie de la Reine Elizabeth et le Prince Philip en 1947, le mariage du Prince Charles et Lady Diana en 1981, et bien sûr le mariage de Will et Kate. Laissez-nous la parole, et vous augmentere zénormément notre expérience en tant que visiteur.
Crédits : JC
J'espère que vous ne prenez pas mal ces recommandations, j'avoue que celles-ci visent à vous aider pour ne pas capter uniquement les 40 autres femmes (moi y compris) qui visitaient alors l'exposition. Comme j'ai beaucoup entendu parler de vos efforts d'accessibilité et d'interactivité dans les expositions du passé, honnêtement je m'attendais à plus d'interactions. Merci pour votre attention. Je vous invite à me contacter pour toutes questions (ou offres d'emploi auprès de votre service des publics). Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée,
Mademoiselle CARLSON
#Londres
#robedemariage
#textiles
#recommandations
#VandAmuseum
UNE SOIRÉE ZUMBA
Jeudi 1er octobre 2015 – 20 h 00. Je suis assise dans un des magnifiques fauteuils en velours rouge de l’Opéra de Lille, en train d’écouter Madame la Directrice Caroline SONRIER exposer la programmation artistique de la saison 2015/2016. Les statues représentants les personnifications de la Danse, la Musique, la Tragédieet la Comédie me dominent depuis le plafond doré.
Attendez un moment avant de bâiller.
Le parterre et le premier balcon de l’opéra sont pleins, mais aucun des spectateurs n’a plus de 28 ans. Autour de moi, les langues des étudiants Erasmus se mélangent : anglais, espagnol, italien... Dans une demi-heure, nous aurons tous abandonné nos manteaux pour nous lancer dans une session de danse, avant de nous restaurer avec une petite bière assis sur le tapis rouge du grand escalier.
C’est ce qui se passe à la Soirée Découverte de l’Opéra de Lille : une invitation aux jeunes pour passer une soirée « dans la maison », avec l’espoir, bien entendu, qu’ils auront envie de revenir.
L’accueil chaleureux de Caroline SONRIER met l’accent sur le mot clé d’ouverture (à double sens : vers les artistes et vers le public), un aspect porté par l’architecture même du théâtre, qui dispose d’un foyer s’étendant sur l’intégralité de sa façade principale, vers l’extérieur. C’est la volonté qui guide le théâtre depuis sa rénovation, quand l’impulsion de Lille 2004 lui a rendu sa grandeur.

Photographie : L.Zambonelli
Ma présence à cette soirée démontre que cette politique de médiation culturelle est efficace. Je suis rentrée à l’opéra un peu par hasard lors des Journées du Patrimoine. Comme moi, beaucoup d’autres jeunes et d’étudiants sont entrés par curiosité, pressés de voir et découvrir un lieu un peu sacré comme celui-ci. L’équipe présente nous a alors parlé de la Soirée Découverte et nous a invités à y participer : la simple évocation d’un drink a fait le reste.
Au programme de cette soirée apparait un paragraphe sibyllin qui annonce que la chorégraphe et son équipe nous feront « partager » un moment de danse. Mais surprise ! Si la plupart de nous s’attendait simplement à profiter d'un morceau de ballet, une fois tous rassemblés dans le Foyer, nous n’assistons pas à une démonstration, mais nous participons. Alors qu’on est en train d’essayer d’apprendre quelques pas tirés de Xerse, (premier Opéra qui ouvre la saison 2015), je ne peux pas m’empêcher de faire une similitude très irrespectueuse et de nous imaginer élèves de Zumba dans une gym d’exception.
Mais enfin, n’était-ce pas l’objectif de la soirée : nous mettre à l’aise dans les espaces monumentaux de l’Opéra ?
Photographie : L.Zambonelli
Les initiatives d’appropriation des établissements culturels de la part d’un public (notamment jeune) se multiplient donc non seulement dans le monde muséal, où le flash mob et la nuit des musées font désormais partie des outils classiques de médiation, mais aussi ailleurs. Peut-être alors pourrait-on saisir cette dernière forme d’inclusion des visiteurs proposée par l’Opéra et imaginer une session de Danse dans le merveilleux hall du Palais des Beaux-arts de Lille, en lien bien sûr avec une programmation ? Joie de Vivre, Joie de danser !
Une petite anecdote en guise de conclusion : il y a trois ans, pendant la première version de la Soirée Découverte, une jeune fille de 23 ans, séduite par la politique novatrice de cet établissement culturel, s’entretient longuement avec les artistes et l’équipe de l’Opéra. Elle s’appelle Marion GAUTIER. Elle est aujourd’hui Présidente de l’Opéra de Lille, ou de « la fabrique à émotions » comme elle l’aime à l’appeler.
Si ce n’est pas le conte de Cendrillon de la médiation culturelle !
Lara ZAMBONELLI.
#MEDIATION
#OPERA
#LILLE
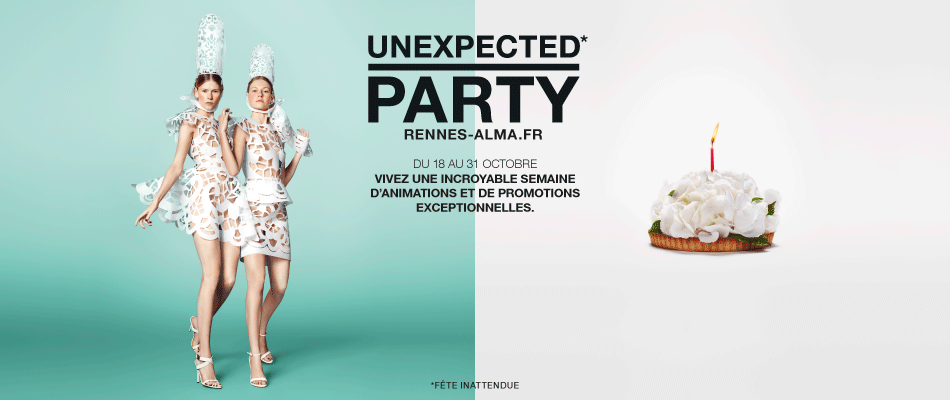
Une visite muséographique décoiffante
Cet été, j’ai eu l’occasion de mêler médiation des collections et présentation du travail de muséographe lors d’une visite guidée. Comment aider les publics à porter un œil critique sur les objets de musée et les manières dont l’institution les présente ?
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc a mis en place pour l’été 2020 un programme de visites consistant à présenter un objet des collections du musée exposé dans les galeries permanentes et à faire suivre cette présentation d’une discussion pour ouvrir le débat avec les visiteur.se.s présent.e.s. L’angle d’approche est libre et se fait selon la sensibilité de l’intervenant.e qui anime la visite. Cet.te intervenant.e peut faire partie du personnel du musée, ou non, et a le champ libre pour aborder les collections à sa manière : une restauratrice du patrimoine a proposé une analyse matérielle d’un coffre de mariés tandis qu’un archéologue a organisé une visite gustative autour d’une bouteille en verre de la section archéologie sous-marine.
Intervenante d’un jour, j’ai choisi de présenter un objet exposé dans un parcours intitulé « clichés bretons ? » qui revient sur la création et l’évolution de l’image de la Bretagne et des Côtes d’Armor au fil du temps. Cet objet n’est pas au sens propre un objet de musée : il n’est pas inventorié dans les collections, n’a pas fait l’objet d’une commission d’acquisition, n’est pas protégé au titre des collections des musées de France. Il s’agit d’une affiche publicitaire. Elle a été collectée spécifiquement pour ce parcours de visite et pourra être conservée ou non par le musée au moment où ce parcours de visite sera remanié ou retiré.
La galerie « clichés bretons ? »
Un musée d’art et d’histoire n’est pas un musée des beaux-arts ; le musée de Saint-Brieuc peut ouvrir des questionnements d’autre nature que l’esthétique ou l’histoire de l’art car il se positionne comme musée de société. La galerie « clichés bretons ? » a vocation à soulever la question de l’iconographie actuelle qui entoure la Bretagne, en la replaçant dans un contexte historique et en permettant d’en identifier les acteurs et leurs intentions. À ce titre, l’affiche publicitaire que j’ai sélectionnée pour la visite a une valeur ethnographique. Elle nous parle de la société d’aujourd’hui, pour peu qu’on soit prêt.e à la percevoir comme un témoignage, une trace produite par des acteurs donnés à un moment donné, avec des intentions précises. Et c’est aux muséographes, concepteurs de l’exposition, que revient la tâche de rendre cette trace lisible et compréhensible comme telle par des visiteurs. Après tout, pourquoi approcherait-on cette publicité comme une preuve que la coiffe bigoudène a pris toute la place dans l’imaginaire de la Bretagne, plutôt que comme une œuvre photographique esthétique mettant en scène des jeunes femmes séduisantes ? Le visiteur, si tant est qu’il suive les intentions des concepteurs qui ont pensé le parcours et que le parcours produise sur lui l’effet escompté, est amené à voir l’image dans ces deux dimensions en même temps, à avoir lui-même une approche sémiologique. Mais est-ce toujours le cas ?
Une image au croisement des normes de beauté et du folklore breton
Lors de ma visite, j’ai présenté l’objet en déclinant la date et les conditions de sa création (le premier anniversaire du centre commercial Alma à Rennes), pour commencer par une mise en contexte factuelle. J’ai ensuite évoqué tout de suite le fait que cette image relève du marketing, puisqu’elle a pour rôle d’être attractive pour faire venir des consommateur.ice.s au centre commercial : il s’agissait de situer les intentions qui ont présidé sa production. Puis j’ai proposé une description de la publicité : les personnages photographiés sont deux jeunes femmes à l’image retouchée typiques des iconographies publicitaires, à ceci près qu’elles portent une coiffe bigoudène et une robe taillée dans la même dentelle que les coiffes. Peuvent ensuite naître des interrogations : pourquoi cette coiffe-ci ? Pourquoi les robes et les coiffes sont-elles faites de la même matière et sont-elles ainsi assimilées ? La dentelle des robes (même s’il s’agit en fait de robe en papier) renvoie-t-elle à l’imaginaire de la lingerie, ou des coiffes traditionnelles ? Pourquoi trouvons-nous cette image séduisante ? Mon interprétation : les normes de beauté féminine de notre époque croisent ici une mise en scène d’un folklore régional qui symbolise à lui seul toute la Bretagne, le centre commercial exploitant le folklore à seule fin de se singulariser dans le paysage marketing.
Toutes ces questions relèvent de l’analyse des images, de la sémiologie. Il s’agit de percevoir la composition, les couleurs, les figures de style en somme, d’une image, et d’en tirer des informations sur ce qu’un centre commercial du XXIe siècle fait au folklore breton et à l’image des femmes en produisant cette publicité.
Le travail muséographique : orienter l’analyse des visiteurs
Mais pour aborder cet objet sous un angle muséographique, il ne suffit pas de produire un discours critique sur l’image. Il faut mettre en lumière de quelle manière cette publicité est positionnée dans un musée pour véhiculer du sens. Cette image n’est pas isolée, elle est incluse dans une vitrine, elle-même incluse dans une galerie qui regroupe des vitrines thématiques.

La vitrine « Iconographie contemporaine »
dans laquelle est incluse la publicité du centre Alma (invisible sur cette photo car affichée plus haut sur le mur), photographie : Dominique Morin
Le rôle des concepteurs d’exposition est de faire en sorte que l’organisation des espaces muséographiques les uns par rapport aux autres, leur contenu, leur disposition, leur taille, leur organisation interne, tout cela fasse sens de manière à ce que les visiteurs puissent percevoir les objets de la manière dont on a voulu les mettre en place. Peut-on aujourd’hui, au musée de Saint-Brieuc, voir l’affiche publicitaire du centre Alma comme une production qui joue sur une iconographie stéréotypée et limitée de la Bretagne ?
Passé le temps de l’analyse de l’image, j’ai donc mis l’accent sur la manière de la présenter dans un contexte spécifique : une vitrine intitulée « iconographie contemporaine » qui fait face à celle qui regroupe des coiffes traditionnelles briochines et s’intitule « coiffes d’hier, musées d’aujourd’hui ? ». Cette vitrine-ci montre des coiffes locales, a contrario de la coiffe bigoudène (dans le Finistère) présente systématiquement dans l’imagerie bretonne : la muséographie est pensée pour que les visiteur.se.s s’interrogent alors sur l’usage récurrent de la coiffe bigoudène pour symboliser la Bretagne toute entière, au détriment de la diversité réelle des costumes.

La vitrine « coiffes d’hier, musées d’aujourd’hui ? », photographie : Dominique Morin
Il faut noter aussi que ces deux vitrines se situent à la fin du parcours « clichés bretons ? » et que le visiteur a présent à l’esprit aussi les sections précédentes : la Bretagne rurale, la Bretagne touristique, la Bretagne habitée. Toutes ces sections montrent des ensembles iconographiques contextualisés : la ruralité bretonne fantasmée par les peintres d’ailleurs depuis le 18e siècle, les revues, affiches et cartes postales qui encouragent le tourisme, ou encore la production des portraitistes locaux qui ont photographié la société de Saint-Brieuc dans la première moitié du 20e siècle. C’est en ayant déjà vu tout cela que les visiteur.se.s abordent les dernières vitrines, comme j’ai pu leur rappeler.
En reprenant les thématiques abordées dans le parcours de visite, j’ai souhaité attirer l’attention sur la manière dont le propos est construit et véhiculé par les objets, peintures, photographies et textes qui composent l’exposition. De cette manière, il ne s’agit pas d’éveiller un regard critique sur l’iconographie seulement, mais aussi sur la muséographie elle-même : le discours tenu par un musée n’est qu’un discours parmi d’autres, lui-même situé dans le temps et produit par des acteurs, et qui s’appuie sur des dispositifs que l’on peut apprendre à décrypter.
Marie Hubert
#muséographie
#coiffesbretonnes
#SaintBrieuc
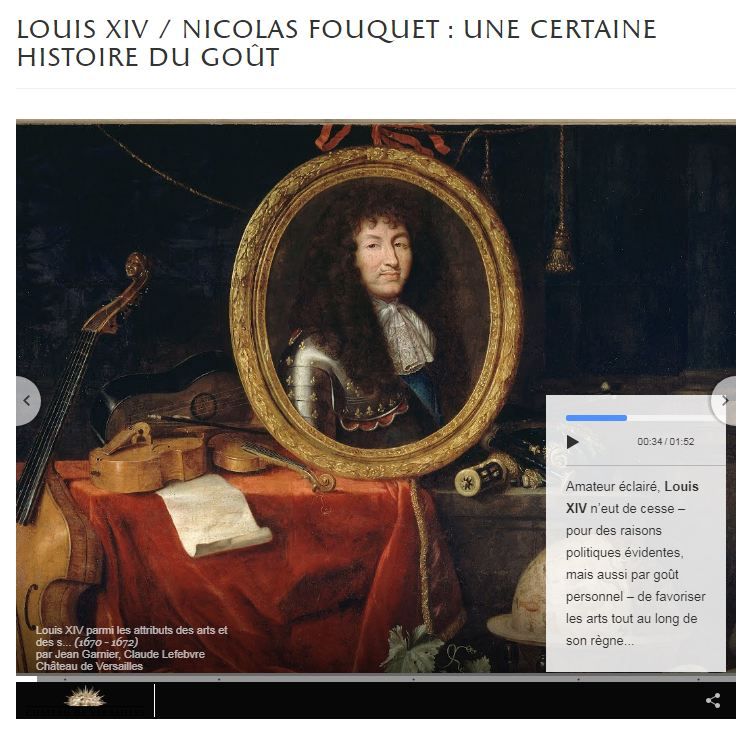
Zoom sur les expositions virtuelles
Ces dernières années ont été marquées par la ludification du musée. Entre les escape games,les chatbots et l’usage de la réalité augmentée, les nouvelles technologies n’ont pas fini de jouer avec le patrimoine.
Depuis le confinement causé par la pandémie du COVID-19, un autre dispositif ludique est plébiscité : l’exposition virtuelle. Par définition, il s’agit d’une exposition diffusée sur internet, mais selon les moyens employés, il existe une grande hétérogénéité des formes. Allant du simple « slide » aux reconstitutions immersives, voici quelques exemples :
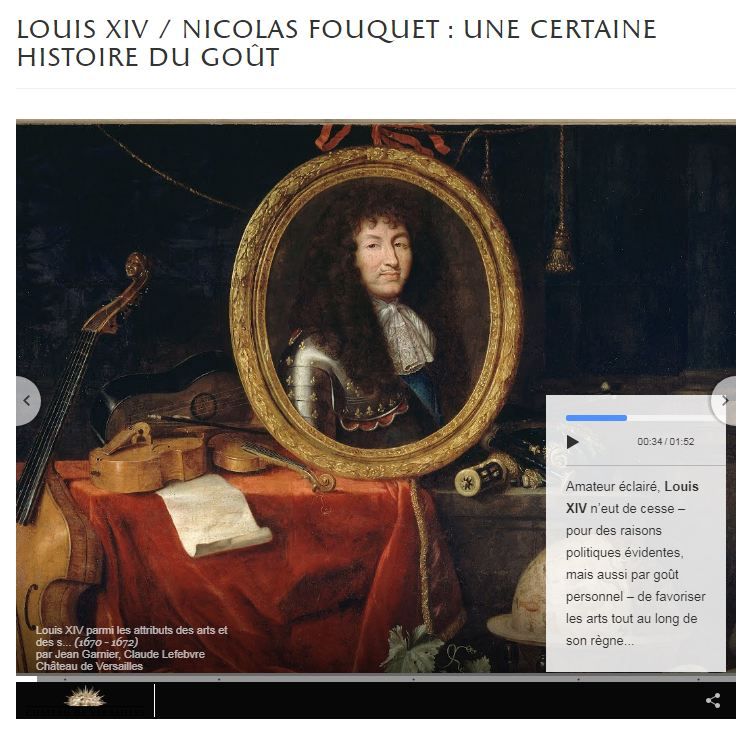
Exposition « Louis XIV et Nicolas Fouquet, une histoire de goût », du Château de Versailles, créé spécialement pour le web, sous forme de slide multimédia (images, textes, audio…)
©Château de Versailles http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-fouquet-:-une-certaine-histoire-du-gout

Exposition « L’Estuaire de la Seine, l’invention d’un paysage » par le Musée d’art moderne André Malraux. Un moyen de “faire perdurer” cette exposition en publiant sur le site du musée un corpus de textes et d’œuvres.
©MuMa Le Havre http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/lestuaire-de-la-seine-linvention-dun-paysage

Une mise en page dynamique pour l’exposition « Les Nadar, une légende photographique », de la BnF. Le contenu se « déploie » à mesure que l’on parcourt la page.
©BnFhttp://expositions.bnf.fr/les-nadar/
Il existe même des expositions dans lesquelles des environnements entiers sont simulés. C’est précisément le travail de l’UMA, l’Universal Museum of Arts, fondé par l’historien de l’art Jean Vergès : un musée fictif qui collabore avec les “ vrais musées ” pour réaliser des expositions gratuites sur internet.
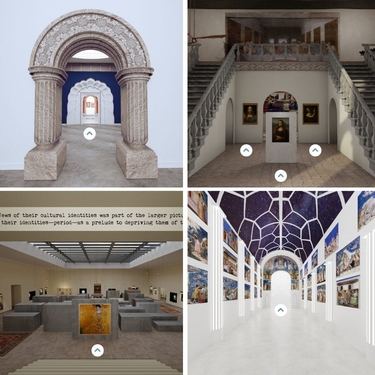
Captures d’écran de diverses entrées d’expositions © UMAhttps://the-uma.org/fr
La page d’accueil liste les expositions en cours et celles à venir. En cliquant sur l’exposition de notre choix, nous voici dans un environnement pensé par un architecte contemporain. Selon le propos de l’exposition, la scénographie va de la plus classique (type ancien palais réhabilité) à la plus ambitieuse (architecture totalement fantasmée). Pour naviguer dans l’espace, il faut maintenir le bouton clic enfoncé et bouger la souris, ou utiliser les flèches directionnelles qui apparaissent sur l’écran. Si l’on n’utilise pas souvent d’ordinateur où que l’on ne joue pas aux jeux en ligne, cette manipulation peut demander un petit temps d’adaptation.

Navigation dans un espace d’exposition © UMA
Lorsque nous cliquons sur une œuvre qui nous intéresse, une fenêtre d’information apparaît. Elle contient le cartel de l’œuvre, un commentaire descriptif ainsi qu’un propos lié à l’exposition.
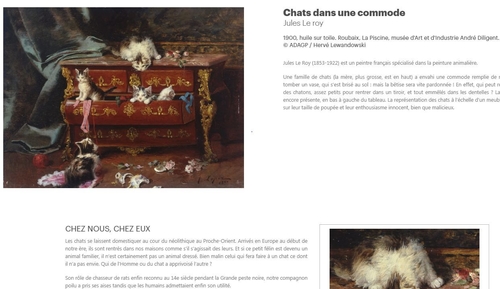
Fenêtre d’informations © UMA
L’implication d’un musée dans ce genre de projet varie. Ainsi, l’exposition « Chats dans l’histoire de l’art »lancée le 7 juillet 2018 a été imaginée par la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, alors qu’une des prochaines expositions intitulée « De la Renaissance au XXème siècle »nécessite pour les musées concernés, un simple envoi de photos à l’UMA. Dans tous les cas, les expositions de l’UMA ne sont pas un simple rassemblement d’œuvres en haute qualité car elles s’accompagnent bel un bien d’un propos scientifique. L’UMA fait appel à des spécialistes qui ont champ libre sur la sélection des œuvres.
Quel est l’intérêt d’exporter les expositions en ligne ? Le premier argument qui nous vient est celui de la démocratisation : avoir accès à une exposition gratuite, à tout moment. D’autant que la tendance actuelle défend de plus en plus le partage des biens communs, dont les œuvres d’art (les créations de Microfolies, les versements sur wikimédia…). Avec les expositions virtuelles, le musée se montre également garant de la qualité d’image, de la « bonne version » de l’œuvre, car les prises de vues retouchées sont nombreuses sur le net.
Sur un support numérique, il y a la possibilité de zoomer sur des détails tels que la touche d’un peintre. Vous ne verrez jamais la Joconde aussi près que depuis un écran, c’est un fait. « Le contact avec l’œuvre physique est unique et irremplaçable. Mais nous sommes convaincus que la reproduction d’une œuvre peut émouvoir, intriguer et enthousiasmer... Au même titre que l’écoute d’un artiste sur Spotify nous pousse à aller voir son concert ! »explique l’UMA.
Autre argument fort en faveur de l’exposition virtuelle, le pouvoir de créer une exposition sans les contraintes qu’imposent la matérialité : pas de problèmes d’espace, pas de convoiements, pas d’assurances, pas de risques de conservation préventive… On réunit ce qu’on veut ! Une utopie réalisée qui fera sourire les amateurs d’arts. « Cela n’a donc rien d’un musée ! » dirons les réfractaires. Encore une fois, l’UMA n’entend pas remplacer le musée mais « diffuser son image et renforcer l’affirmation de sa pertinence actuelle ».
Faire des expositions en ligne, est-ce vraiment une manière de démocratiser l’art ? Pas vraiment, puisque l’UMA précise jouer un rôle complémentaire. Ce qui veut dire que dans la réalité, ce concept tombe dans les mains d’un public averti. Autre exemple, le géant Google Arts & Culture, qui est une mine d’or de ressources, n’a jamais transcendé les foules, jusqu’à ce qu’ils lancent une fonction permettant aux gens de trouver leur sosie en peinture grâce à leur selfies. C’est plutôt ce genre d’actions culturelles qui « démocratisent »l’art et donnent aux gens l’envie de s’intéresser aux musées.
Un conseil aux établissements qui souhaitent développer des expositions virtuelles : exposez l'inexposable ! L’exposition « Chats dans l’histoire de l’art », aussi adorable soit-elle, peut être réalisée dans n’importe quel musée. Il serait plus pertinent d’exposer des sujets sensibles, complètement décalés, que les musées ne sont peut-être pas encore prêts à accueillir…
B.O
#expositionvirtuelle
#democratisation