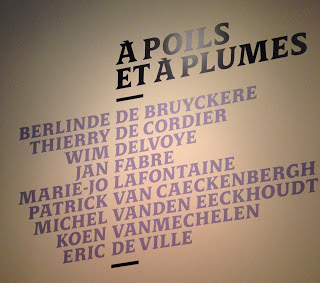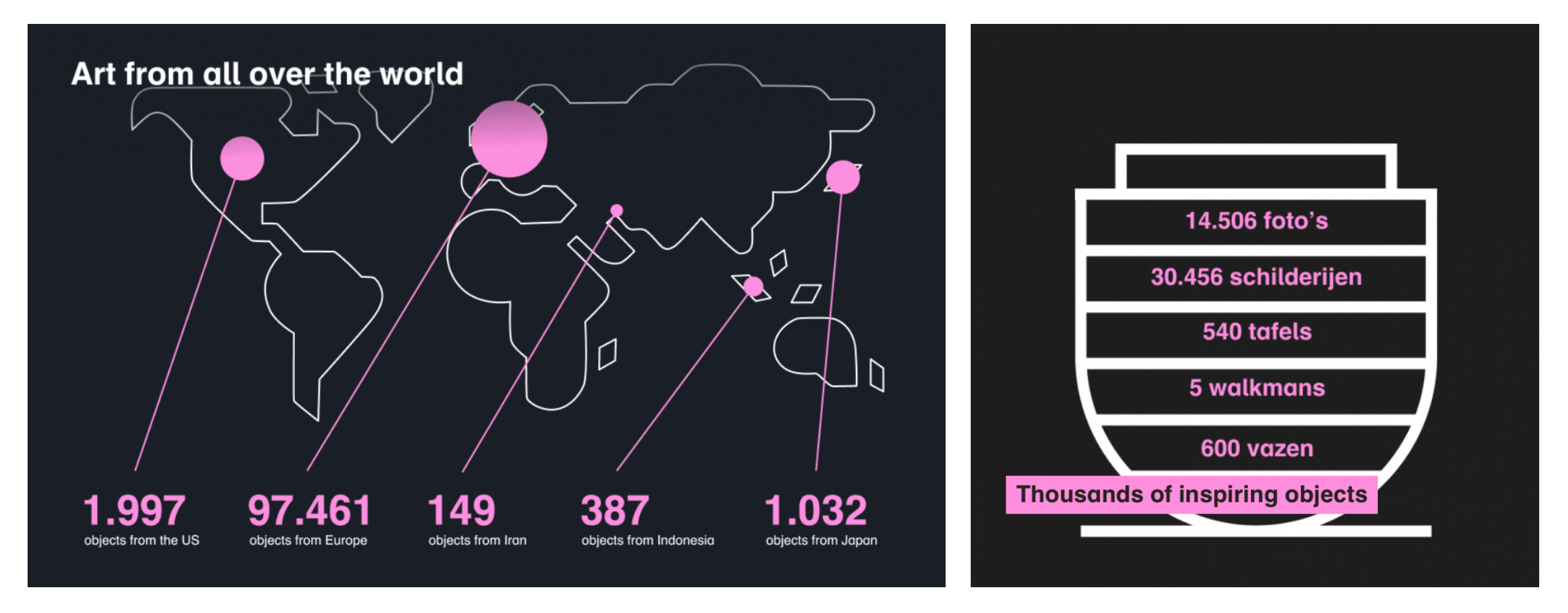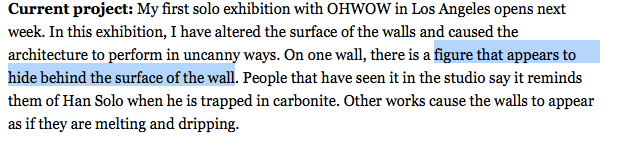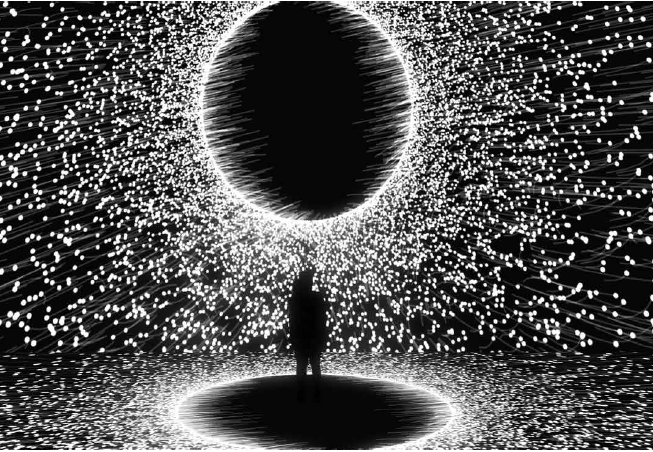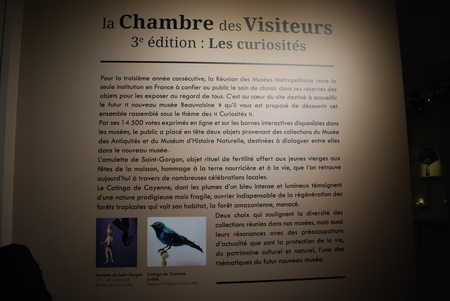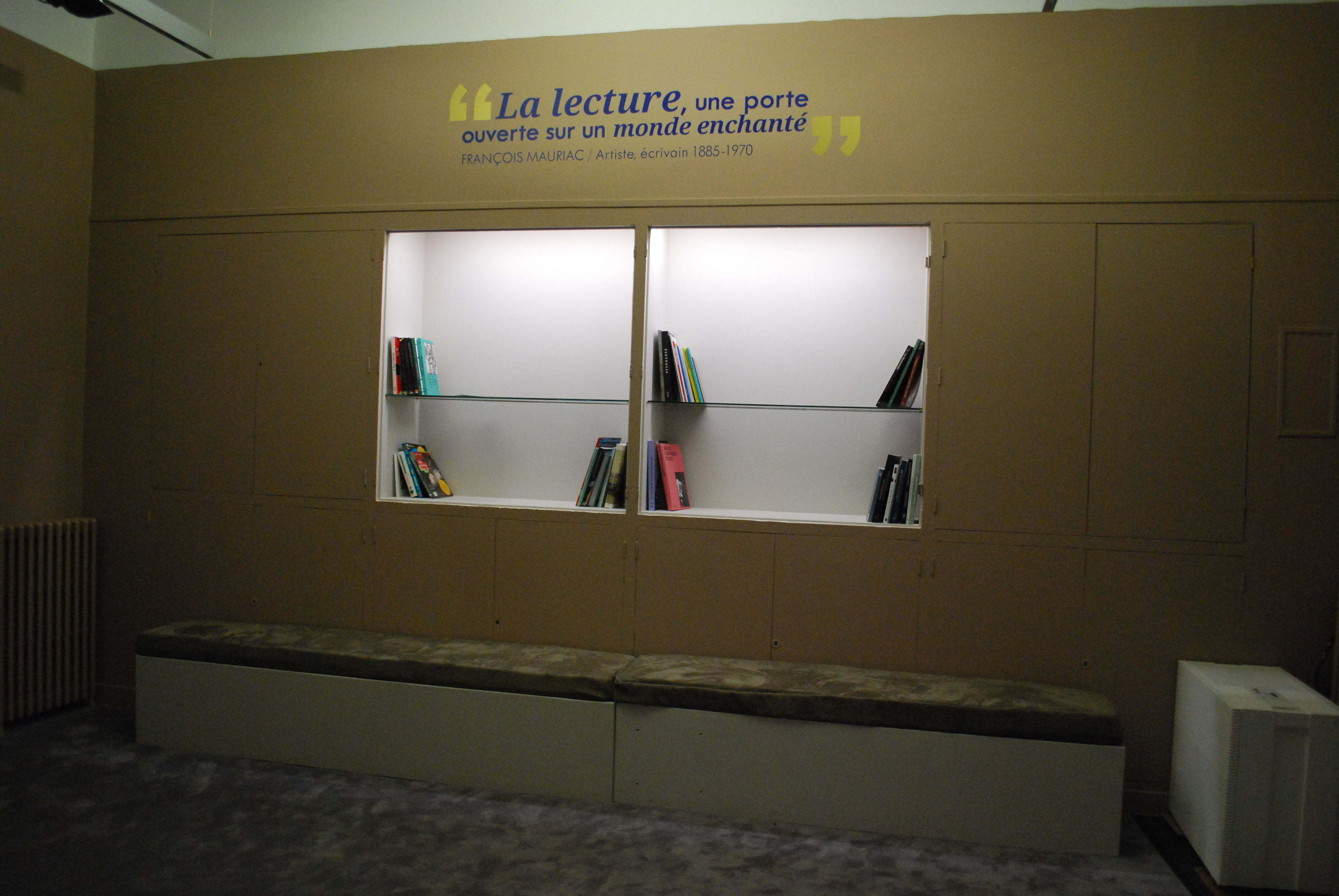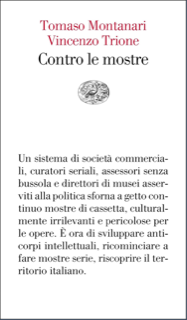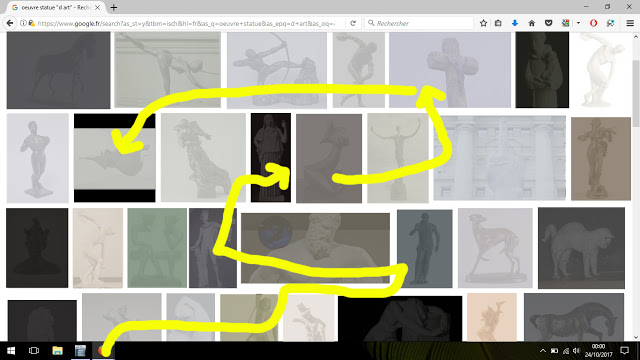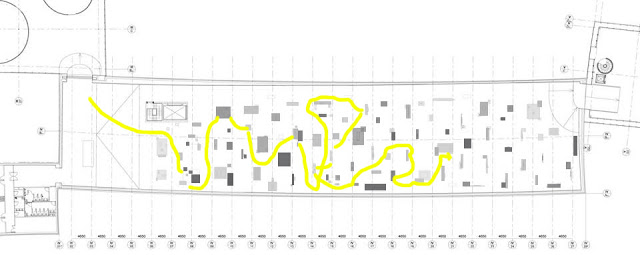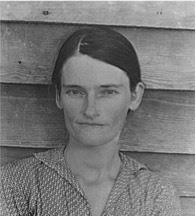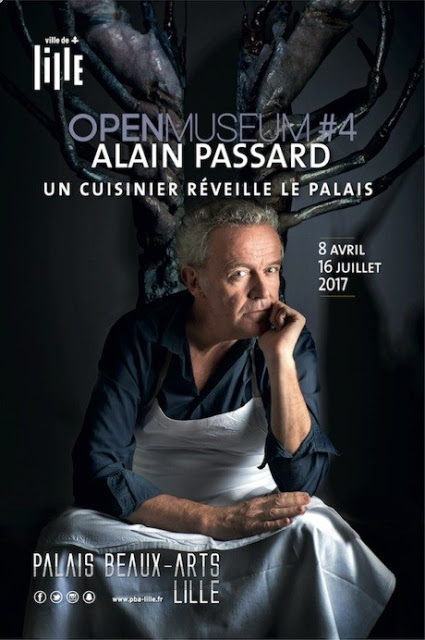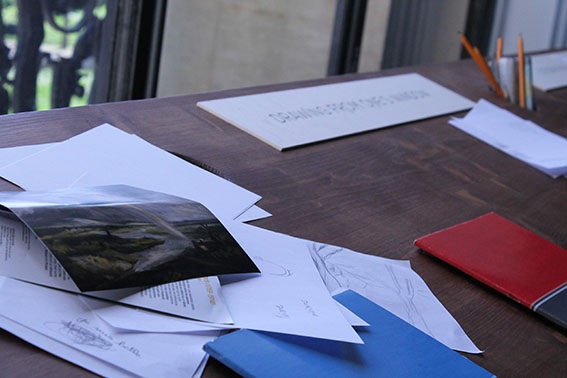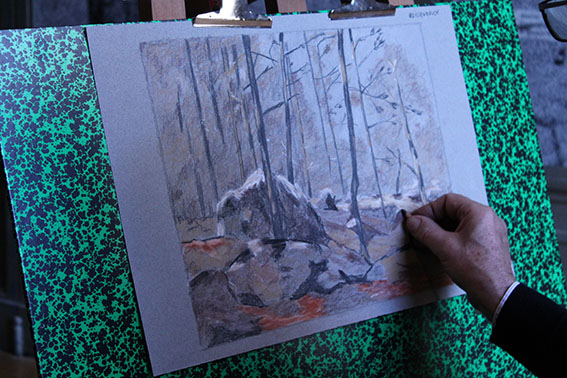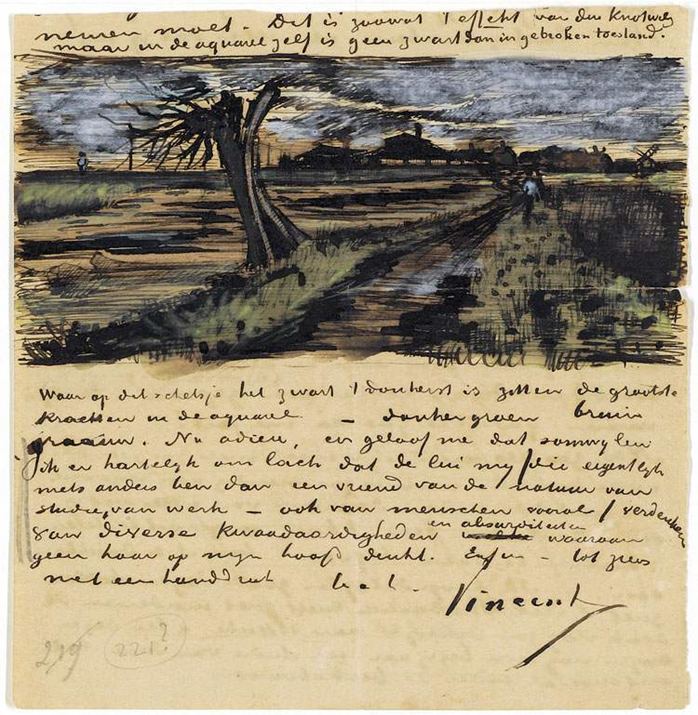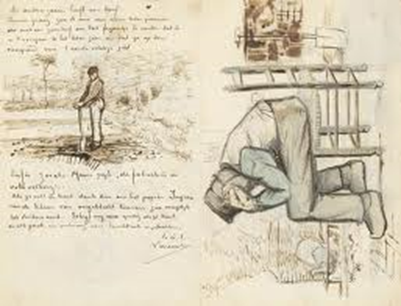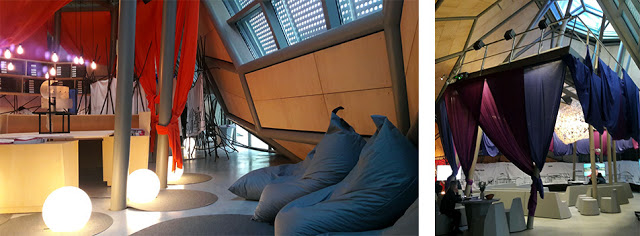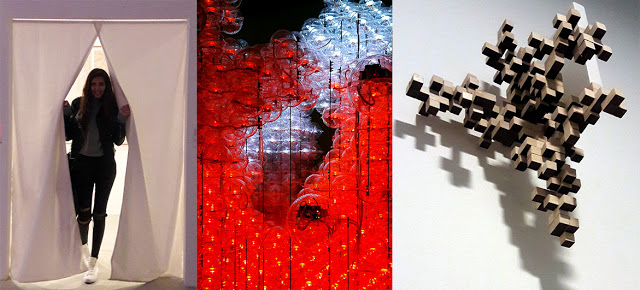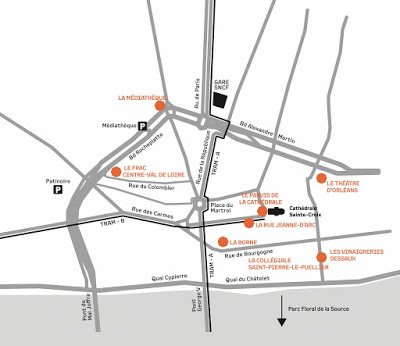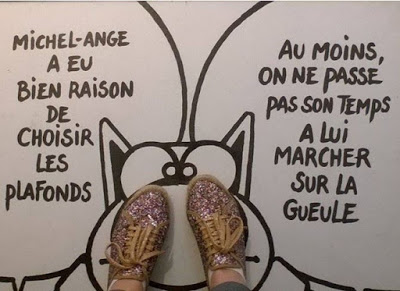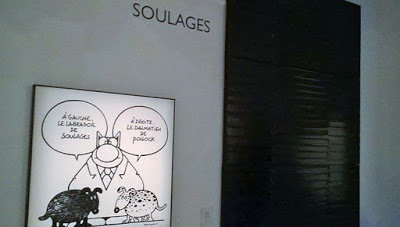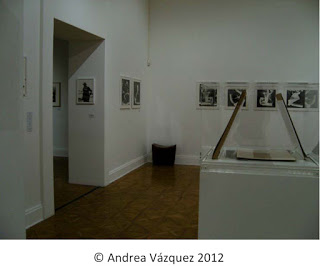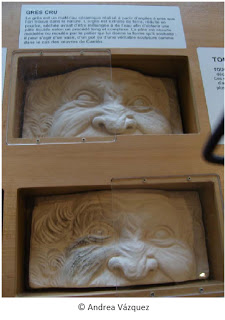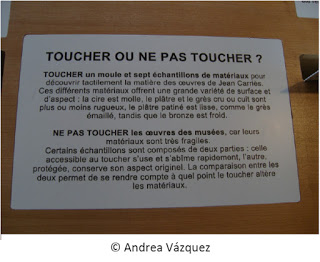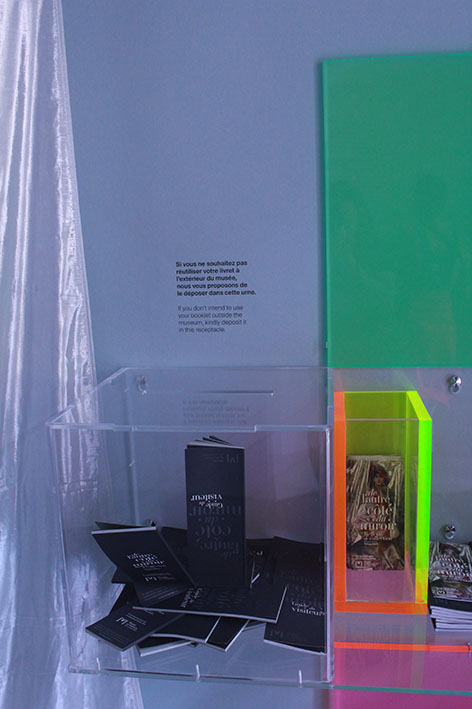Architecture - Beaux Arts

Impressionnistes aujourd'hui ?
Pour le Festival Normandie Impressionniste le Musée des Beaux-Arts de Rouen présente l’exposition Manet, Renoir, Monet, Morisot... Scènes de la vie impressionniste. Comme l’introduit le musée : « À travers onze thèmes articulés chronologiquement, une centaine de peintures de première importance, mais aussi des photographies, des dessins, des sculptures et des correspondances, l’exposition offre une plongée au cœur d’univers personnels souvent occultés par une œuvre immense. » Le parcours est effectivement composé de onze séquences : Premiers portraits : Monet et la caricature ; Identité artistiques ; Muses et modèles ; L'enfance ; Correspondances ; Jeunes et Julie; En société ; Intimités ; Salle des photos : poser pour l'éternité ; Le temps retrouvé.
Cet événement pose un certain nombre de questions : que peut apporter aux publics une exposition sur les impressionnistes aujourd’hui ? Comment renouveler le traitement dece mouvement ? D’autant plus sur un territoire où l’héritage de ces peintres est « sur-exploité » ; comment justement ne pas tomber dans la facilité ?
Première chose notableet mise en avant dans la communication de cette exposition il y a de trèsnombreuses œuvres … peut-être trop. C’est une chance d’en voir autant réuniesmais peut-être au détriment d’un approfondissement. Comme nous en discutionsavec mon acolyte pendant notre visite pourquoi ne pas montrer moins d’œuvres sur lesquels le discours de l’exposition s’appuierait davantage ? Les œuvres et le discours se renforcent mutuellement et cela permettrait à l’exposition d’avoir une posture plus ouverte, peut-être plus transversale et interdisciplinaire. En effet je n’ai pas eu l’impression que l’exposition dépassait le fait de montrer des œuvres exceptionnelles de peintres marquants, certes sous l’angle de l’intime.
De la même manière il y a de nombreuses informations présentées. Les textes comme l’articulation de l’exposition restent classiques avec des références et jeux de mots dans les titres : « Jeune et Julie », « le temps retrouvé »… Cependant on peut facilement avoir l’impression de rester en surface malgré la richesse des contenus. Les textes de salle et les fréquents cartels élargis autour des œuvres sont soit très généraux soit très précis. Il est trop rare que soit évoqué une réalité plus large autour des peintres ou des œuvres comme le contexte social sinon la place de l’enfant dans la société est abordée. Certes un mur généalogique et chronologique explore les liens de trois familles impressionnistes, les Monet Hoschédé, les Renoir et les Manet Morisot en parallèle avec les évènements historiques et sociétaux.
La scénographie correspond bien à l’exposition. Elle reste dans l’esprit de ce qui s’est fait ces dernières années, notamment au Musée d’Orsay : des cimaises de couleurs pastels, et parfois des motifs. Les titres des œuvres et les textes de salles sont écrits en caractères assez importants pour qu’un maximum de personnes puisse les lire. Il est toutefois troublant que dans chaque salle, en dessous du texte principal, on puisse lire la mention du mécénat pour la peinture des cimaises : le nom de l’entreprise, la référence de la teinte utilisée ainsi qu’occasionnellement l’indication d’un papier peint original ayant servi d’inspiration ou ayant été reproduit des collections du Musée des Arts Décoratifs. S’il fait partie du jeu de citer ses soutiens à la fin de l’exposition, ici ce sont des inscriptions très présentes …
Je suis ressortie mitigée de mes deux visites mais j’ai pu constater que le Musée n’oubliait pas les publics. Trois dispositifs ressortent dans l’exposition, deux dans un premier espace appelé « salle de médiation » qui se trouve pas directement dans le parcours mais à partir d’une des salles principales, pratique pour accueillir des groupes mais peut-être un peu isolé. Le premier est le mur généalogique dont nous parlions plus haut.
 Le second est une tablette accompagnée d’une assise pour se prendre en photo puis y appliquer un filtre à la manière de Monet, Renoir ou Cassat. Si on accepte, notre portrait peut être projeté sur le mur d’entrée dans l’exposition, il peut également être partagé. Ce dispositif pourrait être creusé pour avoir une dimension encore plus interactive en renforçant les réseaux sociaux. Mais il faut laisser plus de liberté aux visiteurs : il est actuellement interdit de prendre toute photo dans l’exposition, même des dispositifs de médiations. Pouvoir uniquement se portraiturer avec une tablette est bien limité pour partager l’exposition par ce biais.
Le second est une tablette accompagnée d’une assise pour se prendre en photo puis y appliquer un filtre à la manière de Monet, Renoir ou Cassat. Si on accepte, notre portrait peut être projeté sur le mur d’entrée dans l’exposition, il peut également être partagé. Ce dispositif pourrait être creusé pour avoir une dimension encore plus interactive en renforçant les réseaux sociaux. Mais il faut laisser plus de liberté aux visiteurs : il est actuellement interdit de prendre toute photo dans l’exposition, même des dispositifs de médiations. Pouvoir uniquement se portraiturer avec une tablette est bien limité pour partager l’exposition par ce biais.
© S. Goudal
© S. Goudal
 Le troisième ? Juste avant la sortie de l’exposition dans un espace lumineux, un grand tableau représentant un Salon des Artistes Français où de nombreux personnages figurent est sonorisé et théâtralisé. On peut assister à six discussions, entre divers personnages qui sont présentés dans un grand panneau entre le visiteur et le tableau. C’est une idée qui aurait plus de potentiel si les voix et le jeu des acteurs étaient plus naturels et la lecture des pistes plus interactive. Actuellement il est impossible de choisir une scène ou un personnage et il faut se reporter à la droite du tableau, sur un cartel, pour identifier les scènes. Pour une meilleure expérience il aurait été intéressant de choisir la discussion que l’on souhaite entendre et de signaler les personnages activés à l’aide d’un signal lumineux sur le panneau.
Le troisième ? Juste avant la sortie de l’exposition dans un espace lumineux, un grand tableau représentant un Salon des Artistes Français où de nombreux personnages figurent est sonorisé et théâtralisé. On peut assister à six discussions, entre divers personnages qui sont présentés dans un grand panneau entre le visiteur et le tableau. C’est une idée qui aurait plus de potentiel si les voix et le jeu des acteurs étaient plus naturels et la lecture des pistes plus interactive. Actuellement il est impossible de choisir une scène ou un personnage et il faut se reporter à la droite du tableau, sur un cartel, pour identifier les scènes. Pour une meilleure expérience il aurait été intéressant de choisir la discussion que l’on souhaite entendre et de signaler les personnages activés à l’aide d’un signal lumineux sur le panneau.
Cette exposition est scientifiquement juste et les œuvres sont riches, c’est indéniable, mais elle manque d’originalité et d’innovation. Certes je suis une visiteuse relativement « avertie » et j’ai eu la chance d’étudier le mouvement impressionniste aussi je suis ressortie du musée sans avoir l’impression que cela m’ait apporté quoi que ce soit de nouveau, je n’ai pas été surprise ou étonnée. Peut-être m’a-t-il manqué un lien avec nos réalités, nos vies, notre actualité ou société, un élément qui nous touche et nous fasse rentrer dans l’exposition : l’exposition est trop en vase clos. Cela nous pose la question : qu’attendons-nous d’une exposition ? Et à qui s’adresse-t-elle ?
Alors non, en effet, il ne me semble pas évident d’organiser aujourd’hui une exposition sur les impressionnistes. C’est un mouvement pictural porteur, rassembleur généralement synonyme de succès d’audience. Comment conjuguer ce capital avec un parti-pris, un discours innovant, original ?
Salambô Goudal
#NormandieImpressionniste
#Beaux-Arts
#Rouen
http://scenesdelavieimpressionniste.fr/fr

Mark Rothko, du songe au vaporeux
Vaporeuses et colorées, les œuvres de l’artiste américain Mark Rothko éblouissent les espaces de la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu’en avril 2024. Que savons-nous de cet artiste américain, si peu représenté dans des collections muséales (privées et publiques) en Europe ?
Vue d'installation de l'exposition Mark Rothko, galerie 2, niveau -1, salle Multiformes et début des œuvres dites « classiques », exposition présentée du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024 à la Fondation Louis Vuitton, Paris. © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023
Mark Rothko, son œuvre, méconnu.

Mark Rothko, No. 21, 1949, Huile et techniques mixtes sur toile, 238,8 x 135,6 cm, The Menil Collection, Houston, Acquired in honor of Alice and George Brown with support from Nancy Wellin and Louisa Sarofim © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023
En 1946, Rothko est désemparé par la fin de la seconde guerre mondiale, et, à défaut de rêver avec ses personnages surréalistes, il se concentre sur ce qu’on appellera plus tard, le « Color Field », un mouvement artistique centré sur l’explosion et l’implosion des couleurs par le biais de couleurs vives et franches sur un support pictural, souvent de grande taille.
Mark Rothko et les commandes, privées et publiques, quels besoins et quelles limites ?
Les aventures parisiennes de Mark Rothko
En examinant le rôle des commandes, nous avons constaté que ces interventions artistiques soulèvent des questions complexes sur les besoins et les limitations, le tout dans un contexte de création unique et francophone.
Dans son cas, Rothko fut contacté fin mars 1969 par Franz Meyer, rapporteur du Comité artistique de l’Unesco. Il transmet alors une invitation à l’artiste pour la réalisation d’une commande destinée à un nouveau bâtiment, alors en construction à Paris, discutée comme ceci : « une grande peinture murale d’environ 30 mètres carrés pour le mur Est de la cafétéria. L’œuvre doit être visible de trois niveaux, y compris du grand hall d’entrée. […] Le Comité a estimé qu’un tel travail doit être confié à l’un des artistes américains habitués à traiter de grandes surfaces et a recommandé, par ordre de préférence : [Mark] Rothko, [Kenneth] Noland, [Robert] Indiana, [Ellsworth] Kelly »[2].
Lors de la discussion avec le comité et avec son ami Robert Motherwell, Mark Rothko apprend que l’UNESCO souhaitait acquérir une sculpture de Giacometti pour l’une des salles. En joie, l’artiste discuta avec son ami de sa nouvelle approche picturale dans une nouvelle série de toiles, inspirée par les sculptures de l’artiste Suisse. Or, en absence de plans architecturaux de l’espace dessiné par Bernard Zehrfuss, et suite à la prise de position des architectes sur le positionnement des œuvres dans l’espace, Rothko décide le 3 juillet 1969 de ne pas exécuter la commande due à son état de santé. En réponse à son refus, la création de la commande fut donnée à Ellsworth Kelly.
Gasgar Lucas
#Art Moderne et contemporain ; #Architecture et beaux-arts ; #Action culturelle et médiations
[1] « Comparaisons internationales », disponible à l’adresse URL suivante : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Particuliers/Comparaisons-internationales ↩
[2] Mark Rothko, catalogue d’exposition, Fondation Louis Vuitton, Paris, 2023, p282 ↩
Un géant à affronter...
Vienne, on a tous rêvés de Sissi l'impératrice, des balades en calèche dans la neige, du chocolat viennois, de Wolfgang Amadeus Mozart, mais Vienne est beaucoup plus, c'est aussi de nombreux trésors à dévoiler ! Ville d'histoire et de culture, classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle regorge d'une multitude de musées des plus divers, du Palais de Schönbrunn aux musées d'art moderne. Ces lieux incontournables sont aussi nombreux que différents.
En arrivant sur cette place, encerclée de musées, notre regard est systématiquement attiré par cet édifice blanc immaculé, mais surtout par cette reproduction d'un homme nu, gigantesque ! (référence à l'une des expositions temporaires « Nackle Männer »).
Le Léopold Museum établit les règles. Avec plus de 5 000 travaux exposés, deux étages entiers attribués aux expositions temporaires, il s'impose comme le chef de file des musées viennois et le proclame haut et fort.
Premiers pas timides dans ce « monstre » de l'art, l'accueil est agréable (en français !), malgré le prix élevé (8€ étudiant 12€ tarif normal ), comme la majorité des centres culturels de la capitale. Un immense hall nous submerge de lumière. C'est alors que deux choix s'imposent à nous : à gauche la partie consacrée au maître de l'expressionnisme autrichien - Egon Schiele - et à droite les 4étages restant. Le choix est vite fait ! C'est parti pour la plus vaste collection d'œuvres d'Egon Schiele au monde! Cette partie du bâtiment nous offre un aperçu unique sur la création de cet artiste hors du commun : 44 peintures à l'huile et près de 180 dessins. L'exposition est partagée en trois salles, et l'immersion est totale ! On passe d'une œuvre à l'autre avec toujours cette même impression d'hypnose fasse à un Egon Schiele, il nous transporte dans son Œuvre tourmentée et mystique. Chaque salle est accompagnée d'un commentaire d'Elisabeth Leopold. Ceux-ci nous éclairent, très brièvement, sur la vie de Schiele et de ces différents rapports au corps humain, notamment celui des femmes.
Deuxième étape : le sous-sol, consacré aux expositions temporaires. On admire alors l'exposition « Japan–Fragilität des daseins » ou « Japon- Les sentiments du trait » (que l'on pouvait admirer jusqu'en février dernier), consacrée aux estampes japonaises. Cette partie nous fait voyage dans un monde de sensibilité et de légèreté. Les calligraphies représentent, avec une grande virtuosité, la finesse des sentiments.
©A.G
 Troisième étape : second étage, on se dirige vers le deuxième espace d'exposition temporaire (qui a malheureusement fermé ses portes en janvier dernier), « Nackle Männer » ou « Les hommes nus ». L'exposition est d'une originalité et d'un humour peu commun. Elle s'interroge sur les différentes représentations corporelles du «mâle ». De Pierre et Gilles à Paul Cézanne, cette exposition nous montre l'un des point fort du Léopold : son l'habilité à mélanger contemporain et Beaux-arts.
Troisième étape : second étage, on se dirige vers le deuxième espace d'exposition temporaire (qui a malheureusement fermé ses portes en janvier dernier), « Nackle Männer » ou « Les hommes nus ». L'exposition est d'une originalité et d'un humour peu commun. Elle s'interroge sur les différentes représentations corporelles du «mâle ». De Pierre et Gilles à Paul Cézanne, cette exposition nous montre l'un des point fort du Léopold : son l'habilité à mélanger contemporain et Beaux-arts.
La visite continue, déjà 2h30 de passées, et nous ne sommes qu'à la 4éme partie ! Nous entrons dans la zone de la collection privée à proprement parler de la famille Leopold. Elle est consacrée aux différentes personnalités artistiques les plus éminentes de la sécession viennoise. Entre peintures, estampes et objets du 19éme et 20éme, nous retrouvons aussi le mobilier de cette école singulière et complète. On se promène entre Wiener Werkstätt, Gustave Klimt, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, Richard Gerstl, Koloman Moser... le tout en parallèle avec les travaux d'Egon Schiele, qui est le fil conducteur de cette section permanente. Nous nous imprégnons de cette ambiance, le musée Léopold veut assurément nous faire entrer dans un univers mystique, à travers cette collection permanente.
Le dernier étage se termine sur une touche plus sombre, et peu visité. Néanmoins il s'agit de la deuxième partie de la collection permanente. On découvre alors des œuvres de l'entre deux guerres, fascinantes et perturbantes à la fois, montrant les horreurs de la première guerre, les incertitudes et la montée du fascisme en Autriche. Malheureusement le visiteur épuisé par les 5 parties immenses du musée ne s'attarde pas sur cette dernière exposition. Quel dommage !
Après plus de 3h00 de visite, de prise de notes, de rêves, d'immersions, d'interrogations, de surprises et de coups de cœur, la visite se termine. Nous voilà donc de retour au 2éme étage dans le bar-restaurant d'où nous avons une vue imprenable sur cette place Museum Quartier. Le Leopold Museum est assurément un musée à ne pas manquer lors d'un séjour à Vienne, néanmoins la superficie et la richesse en œuvre de l'édifice peut être pour certain novice, une épreuve. Pour moi, le géant a été vaincu !
Agathe Gadenne
Musée Leopold,
Museumsplatz1 im MQ, 1070 Vienne, Autriche
Tél.: +43 1 525.70-0
Email:
"National Gallery" : Le musée à travers la caméra de Frederick Wiseman.
Comme les articles récents du blog le prouvent, le musée et le cinéma entretiennent une longue histoire commune, des films d'Alfred Hitchcock à ceux plus récemment de Wes Anderson, le musée a souvent investi le grand écran.
Affiche du film, 2014.
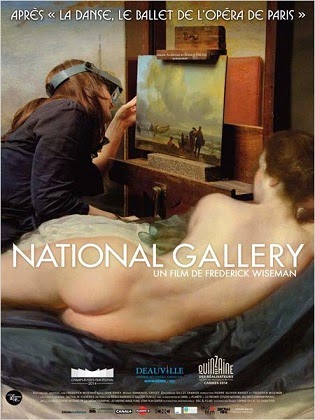 Cette année, c'est le réalisateur Frederick Wiseman qui s'est attaché àce lieu dans son dernier documentaire. Ce dernier a consacré sa carrière de cinéaste à filmer de grandes institutions publiques comme l'Université de Berkeley aux Etats-Unis, un service de soin intensif, et des institutions culturelles telles que l'Opéra de Paris. S'immergeant dans les lieux pendant des semaines jusqu'à faire oublier sa présence, il veut dresser un portrait fidèle de l'institution et son fonctionnement... Filmer le musée était doncla continuation logique de son entreprise, et c'est la National Gallery de Londres qui a été sélectionnée pour ce documentaire. Wiseman a accumulé 170 heures de rushes pour réaliser son documentaire de 3h.
Cette année, c'est le réalisateur Frederick Wiseman qui s'est attaché àce lieu dans son dernier documentaire. Ce dernier a consacré sa carrière de cinéaste à filmer de grandes institutions publiques comme l'Université de Berkeley aux Etats-Unis, un service de soin intensif, et des institutions culturelles telles que l'Opéra de Paris. S'immergeant dans les lieux pendant des semaines jusqu'à faire oublier sa présence, il veut dresser un portrait fidèle de l'institution et son fonctionnement... Filmer le musée était doncla continuation logique de son entreprise, et c'est la National Gallery de Londres qui a été sélectionnée pour ce documentaire. Wiseman a accumulé 170 heures de rushes pour réaliser son documentaire de 3h.
NationalGallerycommence sur un plan fixe d'une des salles d'exposition du musée. Un technicien de surface passe devant la caméra. Comme tous les documentaires du cinéaste, celui-ci nous montre le fourmillement d'activités que le musée contient : restauration (de cadres, de peintures, nettoyage de toiles), analyses de tableaux, mais aussi démontage et montage d'exposition (réaménagements des salles comprenant la peinture, le changement des revêtements..), atelier de modèle vivant, médiation diverse sur divers aspects de diverses œuvres (technique, historique, artistique...), prise en photo des œuvres, scénographie (il montre par exemple une discussion sur la lumière naturelle et ses impacts sur la vision des œuvres), entretien (arrangement de bouquets de fleurs et plantes dans les espace), mais aussi les question de gestion (les questionnements de révision de dépenses dues aux restrictions budgétaires) et ainsi de suite.
Mais dans ce documentaire, une place particulière est accordée aux œuvres d'art, plus qu'à l'aspect social des institutions que Wiseman privilégie habituellement. Les tableaux sont présentés de face, morcelés parfois, pour en relever les détails, et ce parfois longuement. Il montre beaucoup ces œuvres, mais aussi le face à face entre celles-ci et les visiteurs. Il filme le regard des visiteurs vers l’œuvre. Il s'attarde ainsi sur ce jeu de regards dont l’œuvre est la cible.
Outre la rencontre directe des œuvres, Wiseman consacre une grande partie de son documentaire à présenter une autre forme de rencontre entre le public et les œuvres, à travers les médiations diverses, qui s'avèrent très intéressantes : une médiatrice fait revivre, par l'imagination, la façon dont les contemporains d'un triptyque issu d'une Église le regardaient. Une autre médiatrice révèle que l'acquisition des collections a été faite avec l'argent de la Lloyd's, et a donc été financée par la traite négrière, tout comme l'acquisition des collections de la Tate et du British Museum. Ces aspects de l'histoire des musées sont généralement tus et il est intéressant de voir des médiateurs rappeler ce qui n'est généralement pas dit.
National Gallery montre aussi les questions et les enjeux actuels qui pèsent sur l'institution muséale : surtout ceux de représentation et d'identité du musée. Comment prendre en compte le public ? Une des premières scènes nous donne à voir une discussion entre deux membres du musée. La première, chargée de la communication, rappelle que le musée est aussi une attraction touristique et que le public devrait être pris en compte dans le discours, quand l'autre interlocuteur, conservateur, dit ne pas vouloir faire une exposition à succès qui soit « moyenne », prenant le « plus petit dénominateur commun » et y préférant un échec « intéressant ».
Cela montre aussi les positions de professionnels du musée, une vision« marketing », mais plus ouverte sur le public qui rencontre une vision encore très verticale de la culture, qui oppose l'expert et le profane, et qui assimile « grand public » à « simplification ».
Aun autre moment, lors d'une réunion, la question de la participation à un événement populaire de charité (le marathon du « Sport Relief »), est posée. Celui-ci se termine devant le musée, et la population londonienne y est fortement attachée : quelle image le musée renvoie en ne s'associant pas à un projet que tout le monde apprécie ? Mais comment sera t'il perçu en s'associant à un événement populaire et non culturel ? Wiseman nous donne ainsi à voir les stratégies de communication mises en place par le musée.
Habilement, le film se termine sur une scène de danse dans les galeries, dont l'organisation a été discutée précédemment, les danseurs se retirent, la présentation est finie.
Le seul regret est que la question des démarches du musée envers les publics ne soit pas plus développée dans le documentaire, lequel est plus centré sur la rencontre avec les œuvres. L'exploration des coulisses, à part pour certains exemples évoqués ici, mettent les œuvres au centre de l'attention. Ainsi, le musée de Wiseman semble être plus tourné vers les œuvres que vers son public, comme certains le sont encore aujourd'hui. Le film reste une immersion passionnante à l'intérieur d'une institution telle que la National Gallery.
N.PPour en savoir plus : - Cliquez ici !#cinéma#NationalGallery#coulisses

"Norman Foster", Une vision technologique du futur
10.05.23 au 07.08.23
Centre Pompidou Paris
Commissaire Frédéric Migayrou
130 projets d’architecture
2 200m²
Du 10 mai au 7 août 2023, le Centre Pompidou de Paris nous a offert une rétrospective des œuvres et travaux de l’architecte britannique Norman Foster. Sur près de 2 200m², ce sont 130 projets d’architecture réalisés ou non qui nous sont présentés accompagnés de dessins, de photographies et d’œuvres d’art. Ce qui fait de cet évènement la plus grande exposition consacrée à un architecte de son vivant. Revenons sur cette exposition phare de l’année rendant hommage à l’un des plus grands architectes de son temps.
Particulièrement attendue, toute la spécificité de l’exposition repose sur la participation de Norman Foster lui-même, de son cabinet d’architectes Foster + Partners, ainsi que de la Norman Foster Foundation. Ces multiples contributions induisent, vous l’aurez compris, une forte implication de l’artiste et de ses collaborateurs dans cette exposition faite à leur image tant d’un point de vue plastique que par le discours.
Sobriété d’une scénographie qui impressionne
La scénographie de l’espace, réalisée par l’architecte et son agence Foster + Partners s’accorde à la sobriété habituelle du Centre Pompidou, pourtant, l’exposition nous impressionne dès la première salle. Malgré l’immense majorité de murs monochrome gris, l’abondance de maquettes et de plans dynamise l’espace pour permettre au public de plonger dans l’univers de Norman Foster. L’espace laisse transparaître le goût de l’architecte pour la technologie, le progrès et l’art en intégrant subtilement des œuvres et engins motorisés (img.1) au milieu des projets architecturaux. Le public est plongé dans une ambiance moderne et futuriste.
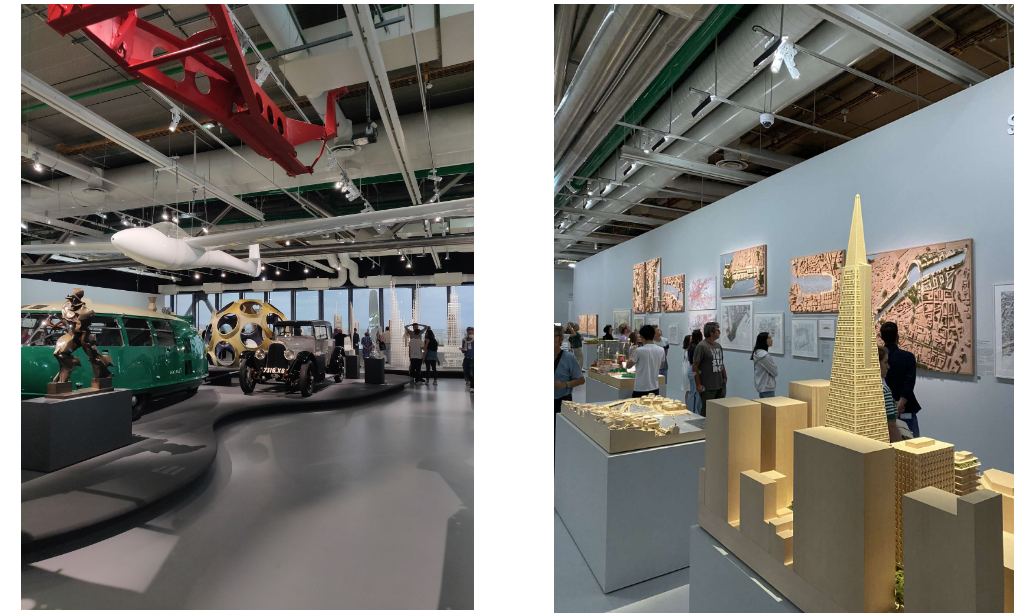
Img. 1. scénographie de l'espace "Nature et urbanité" et "Villes verticales" © CP
Img. 2. scénographie de l'espace "Nature et urbanité" © CP
Comme il est possible de le voir sur les images 1 et 2, les visiteurs sont invités à lever la tête et à être attentifs tout au long de la visite. À la fois sur les murs, au sol et au plafond, les expôts investissent entièrement l’espace. C’est véritablement leur profusion qui produit cet effet immersif. Même si l’exposition subjugue son public, happé par de nombreuses choses simultanément, le risque de le perdre est élevé avec ce type de scénographie. Et pour cause, cette exposition a tendance à le déconnecter complètement du propos en le concentrant seulement sur l’aspect visuel de l’exposition. La discrétion des titres et des textes renforce d’autant cette impression dans ce parcours libre et ouvert. Le repérage dans le parcours et son discours est en réalité difficile à cerner. Comme s’il y avait un propos unique valable tout le long de la visite et que peu importe le sens dans lequel nous découvrons les projets architecturaux, le discours et les valeurs mises en avant s’appliquent à toutes les maquettes exposées.
Un propos en décalage : l’architecture vue par le prisme du progrès technique
Les projets de Norman Foster sont grandioses et impressionnent toujours au premier abord. L’exposition nous présente l’architecture de Foster principalement du point de vue de l’industrie positive qui allie une production matérielle architecturale aux services des besoins de la société par le biais du progrès technologique. Le discours tente de nous montrer des projets qui renouent avec le territoire dans lequel ils sont implantés. Mais il aborde aussi les questions autour de l’autosuffisance des villes tout en conciliant le développement durable au progrès technique.
Ces édifices sont ambitieux certes, et en cohérence avec les nouveaux enjeux contemporains de l’architecture. Mais finalement les projets de l’architecte semblent parfois être en décalage avec la réalité de l’urgence environnementale de l’époque alors même que le lien entre la nature et l’architecture est abordé dans la troisième partie « Nature et urbanité ». Cette volonté de renouer les édifices avec leur territoire est difficile à percevoir tant l’exposition aborde l’architecture seulement par le prisme de la technique et du progrès. Cette approche insensible des projets ne permet pas de se projeter dans cet avenir architectural. Comme s’il y avait une distance entre l’architecture et notre réalité. Ces enjeux présentés comme fondamentaux dans l’exposition et qui nous concernent tous pour demain, ont du mal à nous toucher.
Cette apologie de la technologie laisse finalement peu de place à la réalité et à la profondeur du discours sur l’environnement et les nouvelles façons de vivre en société. Le propos est à la fois en décalage avec les valeurs environnementales que Norman Foster défend fermement dans ses projets, mais aussi avec un public qui pourrait ne pas saisir la réalité de ces changements imminents dans les années à venir. L’exposition se place davantage dans le prisme d’une société industrielle qui tente de s'accommoder aux défis environnementaux.
L'empreinte de l’architecte est-elle visible dans l’exposition ?
Il est évident que toute participation directe d’un artiste dans une exposition qui lui est dédiée impacte considérablement le résultat final. Cette exposition n’y échappe pas. La plasticité de l’espace rendu par la scénographie ne peut que refléter Foster puisqu’il est lui-même auteur de sa propre mise en scène. Cette scénographie peut être interprétée comme le résultat de la vision qu’il a de lui-même, ou être le reflet d’une image idéale qu’il souhaiterait renvoyer au public. Cet aspect donne matière à réfléchir : est-il seulement auteur de sa mise en scène spatiale ou a-t-il un rôle dans le propos muséographique de l’exposition ?
En plus d’avoir écrit tous les textes de l’exposition, on sent qu’à travers celle-ci, Norman Foster a voulu remercier les personnes qui l’ont accompagné dans ses projets sur près d’une soixantaine d’années. Passée la première salle, nous sommes face à un mur sur lequel sont inscrits plusieurs centaines de noms. Ce sont ceux de ses associés, collègues et partenaires avec qui il a collaboré tout au long de sa vie. Un point dans l’exposition retrace aussi toute l’histoire de son agence d’architecture et énumère les prix que Norman ou son entreprise ont gagnés (img. 3).
De plus, les expositions rétrospectives présentant le travail d’un artiste mentionnent quelques aspects de sa vie privée afin de faire connaître au public sa vie sous d’autres angles. Or, l’exposition Norman Foster ne mentionne aucune information concernant sa vie privée qui aurait pu avoir un impact sur certains projets. Le propos est purement professionnel et met en avant seulement sa personne en tant qu’architecte après qu’il ait ouvert son agence. Raison pour laquelle on devine aisément qu’il a fortement contribué au discours de l’exposition au côté du commissaire Frédéric Migayrou. Mais cela pose la question des échecs et des projets critiqués de l’architecte. On remarque qu’il n’y a aucune mise en perspective des travaux de Norman Foster avec d’autres projets architecturaux similaires à la même période.
Néanmoins, la participation de Norman Foster dans l’exposition présente certains avantages, notamment concernant le prêt d’œuvres. Aspect qui se voit particulièrement dans la première salle qui présente une galerie de dessins, croquis et photographies réalisés par l’architecte (img. 4). Elle permet de se rendre compte de l’immensité de son travail sur près de soixante ans. Sans la contribution de Foster, cette salle n’aurait probablement pas été aussi abondante.
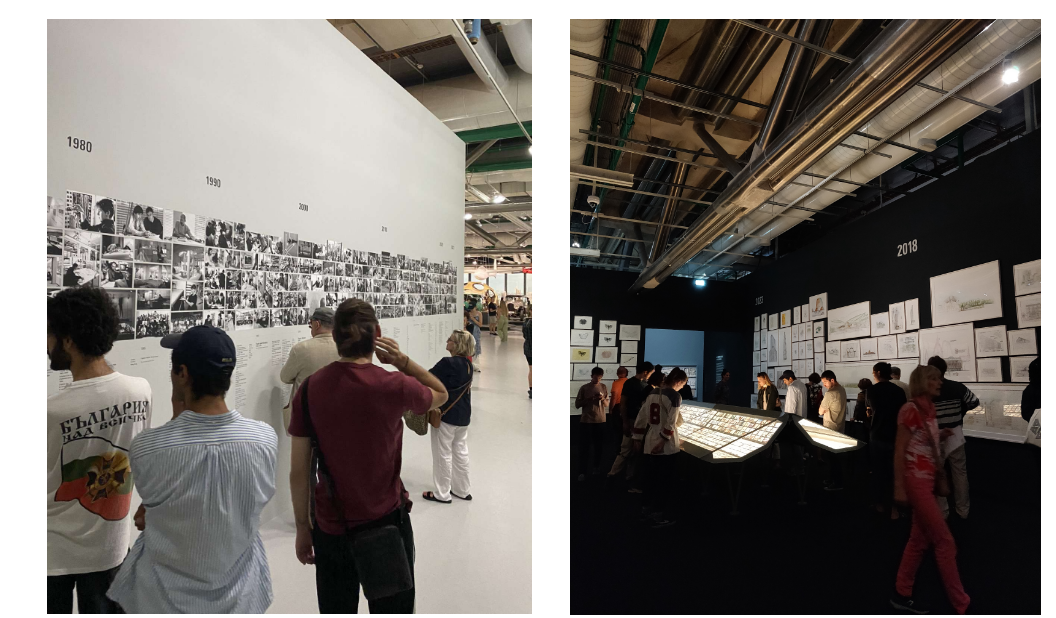
Img. 3 Frise chronologique retraçant l’histoire de l’agence Foster © Thomas Schweitzer
Img. 4 Galerie de dessins et photographies © Thomas Schweitzer
Une exposition tape-à-l’œil qui impressionne sans émouvoir
Cette rétrospective dédiée à l’un des architectes les plus influents de notre époque est sans aucun doute impressionnante. L’abondance d’expôts et la diversité des maquettes nous plongent véritablement dans un autre univers le temps d’une demi-journée. En revanche, elle semble plus compréhensible pour un public qui aurait déjà un pas en architecture. Puisqu’au regard des cartels et textes de salles, le discours n’est pas accessible à tous[1].
La mise en exposition des travaux est réalisée de manière froide et professionnelle. Ce qui rend effectivement l’exposition époustouflante, mais nous restons sur notre faim quand il s’agit de comprendre les nouveaux enjeux de l’architecture contemporaine. Cette apologie de la technique et la mise en avant du côté rationnel de l’architecture est susceptible d’instaurer une distance entre un public non averti en architecture et la discipline. Cette grande place accordée aux prouesses techniques vide l’architecture de sa nature humaine puisque l’exposition ne questionne pas ce qu'un projet pourrait apporter à tel territoire ou à telle société ; et en quoi ces nouvelles technologies en architecture sont-elles réellement envisageables sur un territoire donné. En tant que non spécialiste, il m’était difficile de m’imprégner et de développer un affect ou une sensibilité pour l’architecture qui nous était présentée.
C’est finalement le risque lorsqu’on fait appel aux artistes dans l’élaboration de l’exposition. En résumé, cette exposition évènement manque de profondeur humaine et sociale en ne faisant que l’éloge des réussites de Norman Foster.
Camille Paris
#architecture #maquette #technologie
[1] les textes de salles sont disponibles sur le dossier de presse de l’exposition p. 6-9 : Centre Pompidou, Dossier de presse de l’exposition Norman Foster, Paris, Centre Pompidou, 2023 [en ligne, consulté le 06/11/23]

« Art Cares Covid – Inside out », une exposition qui bouscule le modèle classique des musées
Bannière « actualités » du site des MRBA, novembre 2020, affiche de l’exposition « Art Cares Covid – Inside out », © MRBA, 2020.
Des projets culturels au temps de la Covid-19
L’exposition « Art cares Covid, Inside-out » s’est développée dans un cadre particulier, celui d’une crise sanitaire. En Belgique et partout ailleurs, la création artistique contemporaine a été fortement touchée : fermeture des galeries, annulation ou suspension des expositions, visites d’ateliers annulées, etc. Le monde muséal a également été particulièrement touché, notamment par la fermeture des institutions culturelles et ce pendant de longs mois. C’est à partir de cette observation que l’exposition temporaire « Art cares Covid » a été conçue.
D’abord prévue du 2 octobre 2020 au 24 janvier 2021, puis prolongée jusqu’au 14 février 2021, elle a été présentée au sein des Musées Royaux des Beaux-arts de Bruxelles (MRBA). Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration de cette exposition : Maëlle Delaplanche, commissaire de l’exposition et co-créatrice d’« Art cares Covid », Sandrine Morgante, artiste et co-créatrice d’« Art cares Covid » ainsi que Gaëlle Dieu, exhibition coordinator des MRBA.
Présentons d’abord le projet « Art cares Covid », une plateforme numérique élaborée par M. Delaplanche et S. Morgante. Celle-ci consiste à offrir une galerie numérique à différents artistes sélectionnés par les deux créatrices : des artistes belges ou résidants belges actuellement peu connus dans le domaine de la création artistique (Samuel Coine, Laure Forêt, Selçuk Multu ou encore Catherine Warmoes). La plateforme permet de leur donner de la visibilité et de vendre leurs œuvres en ligne. Elle a été pensée en association avec l’ASBL « A travers les Arts ! » qui se donne pour objectif d’aller contre l’isolement des séniors en leur donnant accès à la culture. « Art cares Covid » soutient donc cette association par un système de don lors de chaque achat d’une œuvre sur la plateforme (60% revient à l’artiste et 40% à l’association). Ces dons sont ensuite utilisés par l’ASBL pour des projets comme l’organisation d’animations artistiques près des maisons de repos. Le projet global souhaite fédérer des artistes émergeants à travers les arts, de vendre leurs œuvres tout en aidant les séniors isolés.
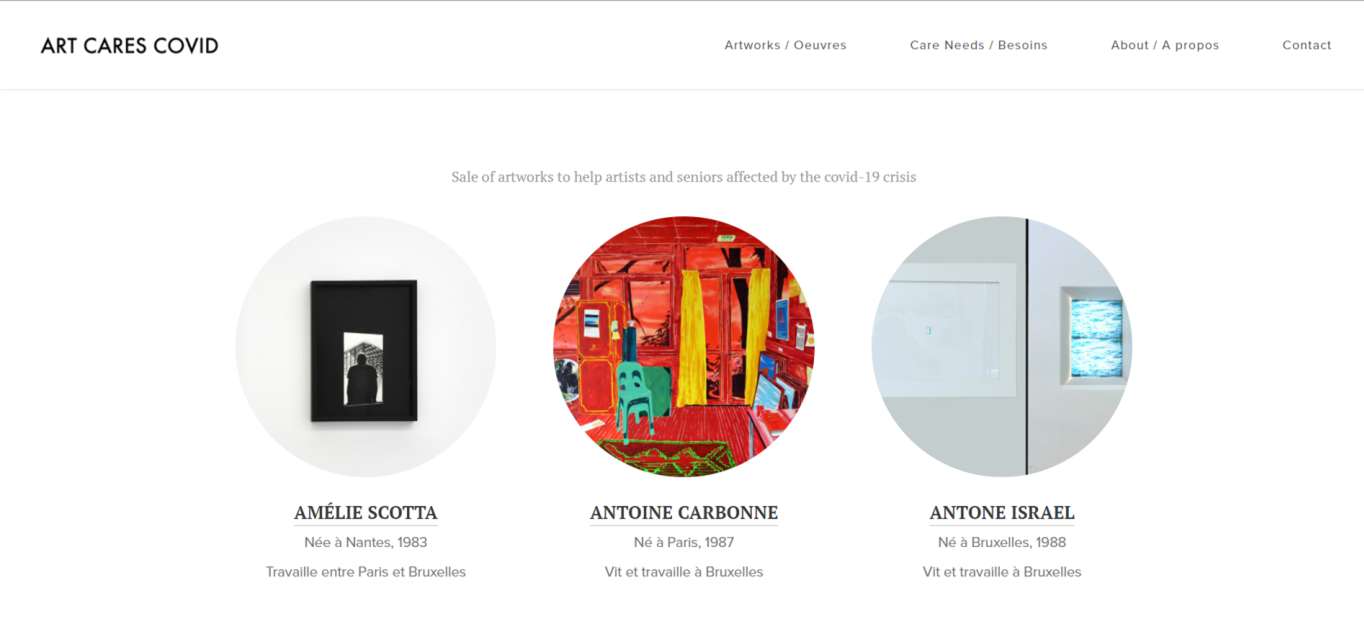
Site internet « Art cares Covid », exposition numérique présentant les artistes, novembre 2020 © M. DELAPLANCHE, 2020.
Art Cares Covid est alors, dans un premier temps, une galerie-« exposition » virtuelle d’artistes. A partir d’une œuvre phare de l’artiste, vous pouviez naviguer pour voir l’ensemble de ces œuvres, avoir accès à son site, comprendre sa démarche, etc. Le conservateur des œuvres contemporaines des MRBA, P-Y. Desaive, a été touché par ce projet et par la galerie virtuelle que proposait M. Delaplanche. Il lui a proposé de créer une exposition réelle à partir de cette galerie numérique. Une occasion pour le musée de s’ouvrir au contemporain, qui, depuis quelques années cherche à exposer ce type de collections, alors très peu présentes depuis la création du musée en 1801. Cette exposition permet également d’offrir une visibilité à une initiative sociale et artistique. Le conservateur a ainsi donné carte blanche à la commissaire M. Delaplanche pour l'exposition, en matière de scénographie et de muséographie pour l’exposition « Art cares Covid, Inside-out ».
Une exposition temporaire, du numérique au réel
« Art cares Covid, Inside-out » est une exposition dite « focus » mettant en avant 41 artistes belges à travers 72 œuvres. Le but premier est de « concrétiser » physiquement une exposition numérique. C’est un processus très intéressant puisque nous avons vu durant cette crise sanitaire comment les expositions et les musées se sont numérisés (visite d’exposition en vidéos, podcasts sur les œuvres, ateliers de médiation à faire à la maison, etc.) pour donner accès à la culture « à domicile » alors que cette exposition fait le chemin inverse : un projet numérique prend forme physiquement dans une institution muséale. L’exposition prend place dans le patio 0 des MRBAB, une pièce carrée avec en son centre une salle circulaire. Quatre îlots d’exposition ont été mis en place et présentent des œuvres choisies autour du thème que souhaitait aborder M. Delaplanche : la création artistique contemporaine au temps du Covid-19. Elle a demandé à chaque artiste participant de composer une œuvre de grandes dimensions et une œuvre de petites dimensions en accord avec la thématique : microcosme et macrocosme. Ainsi, dans un même espace les œuvres dialoguent ensemble par un jeu d’échelle : Stéphanie Roland propose une sculpture imposante en plexiglas nommée Méta-église (2016) alors que Joao Freitas élabore une petite sculpture de papier, Untitled réalisée pendant une résidence italienne. Les publics peuvent se déplacer d’expôt en expôt au sein de chaque îlot thématique, l’espace est très aéré et reprend les codes habituels du « white-cube ».
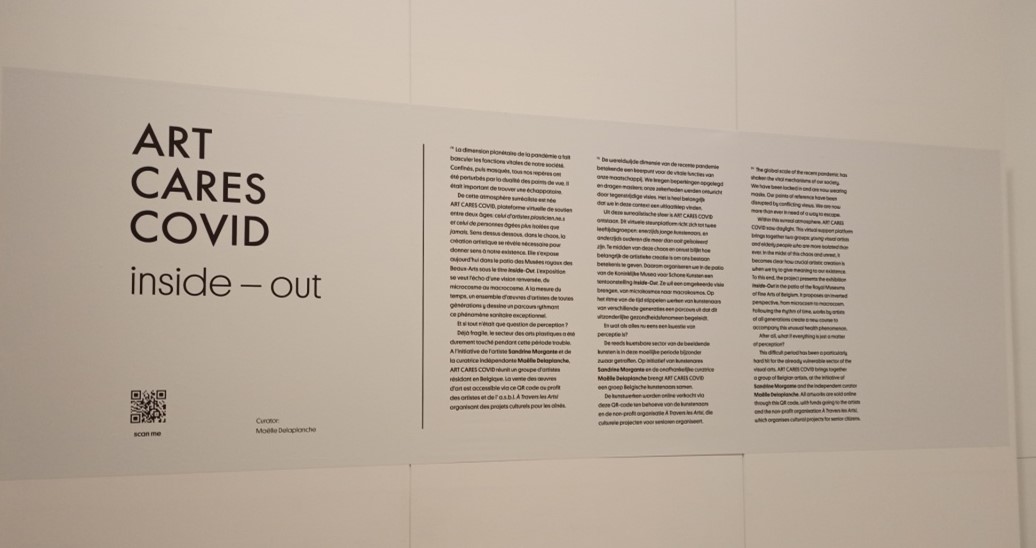
Texte mural, introduction de l’exposition, en trois langues, titre et nom de la commissaire © M. MAINE, 2020.
L’exposition présente une variété d’œuvres en rapport avec l’actualité sanitaire et aborde plus précisément les différentes phases ressenties par chacun durant le confinement, conséquence directe de cette pandémie. Le sujet choisi permet de parler des sentiments d’enfermement puis de délivrance, les tâches répétitives accomplies, le repli sur soi, etc. Dans un second temps, le but est de montrer comment la création artistique actuelle, dans sa diversité (supports, matériaux, aspects), peut donner une image de nos sentiments dans une situation complexe internationale de confinement. Sont donc mis en scène la création artistique d’artistes méconnus belges, le confinement et ses conséquences sur nos perceptions (temps, espace) et sur le monde artistique, les repères habituels de la vie quotidienne perturbée, l’art contemporain face à un sujet de société, le rapport microcosme/macrocosme, etc. Les objets exposés sont quant à eux, tous des œuvres dédiées à la vente, ils appartiennent aux artistes qui en détiennent les droits jusqu’à leur vente. Les MRBA ont fait le choix d’exposer des œuvres d’art ayant un but lucratif dans une institution où l’inaliénabilité des œuvres est de mise. Ce parti pris audacieux répond à la volonté du musée de s’ouvrir au contemporain mais pose de réelles questions sur le statut de ces œuvres. Assurance, régie, muséographie et accrochage, toutes ces actions en sont nécessairement touchées : l’artiste étant propriétaire de son œuvre, il a fallu de la pédagogie et de nombreux échanges pour que cette exposition ouvre aux publics.


Premier îlot de l’exposition © M. MAINE, 2020.
Salle circulaire, pièce dédiée aux projections, © M. MAINE, 2020.
De la galerie au musée, accrochage et muséographie
Cette exposition se démarque par son originalité : exposer des œuvres d’artistes originellement dédiées au marché de l’art dans une institution muséale publique peu axée sur le contemporain. Ce fait a d’ailleurs beaucoup d’influence sur la scénographie, sur les outils de médiation et notamment sur l’absence de cartels explicatifs ou de textes de murs thématiques. Par son type d’accrochage, l’exposition dans sa forme s’approche d’une galerie. Cela a une conséquence directe sur les publics visés : l’exposition s’adresse principalement à un public de galerie ou habitué à l’art contemporain. Le manque d’explications (textes, cartels) et l’absence d’outils de médiation rendent assez complexe la compréhension du propos de l’exposition durant la visite. Les différents sentiments ressentis durant le confinement n’étant pas indiqués, les publics non habitués ou les publics jeunes auront du mal à les déceler.
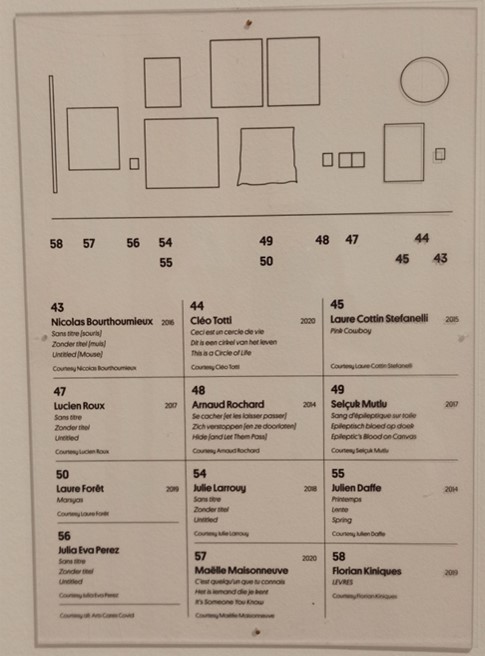
Cartel de l’exposition, quatrième îlot, © M. MAINE, 2020.
Pour autant, l’accrochage qui se fait à la fois sur une association chromatique et sur une diversité des supports offre aux publics un large aperçu de l’étendue de la création artistique contemporaine. Ce parcours de visite permet ainsi d’appréhender différents matériaux, médias, dimensions et sujets ; on comprend donc le caractère personnel de chaque œuvre. En sachant que le propos de l’exposition s’organise autour du vécu du confinement, on comprend mieux la relation entre l’individu et l’objet : émotions, contemplation, sensation, ressenti.

Quatrième îlot de l’exposition, © MRBAB, Bruxelles, Odile Keromnes, 2020.
Cette exposition donne de réelles pistes de recherche muséologiques comme la place de l’art contemporain dédié au marché de l’art dans un musée public, les compromis entre la volonté des artistes et les normes muséales ou encore l’implication d’une exposition dans des sujets d’actualité. Dans un contexte complexe pour les institutions culturelles comme pour les créateurs, de tels projets peuvent réellement faire la différence notamment en donnant une visibilité aux artistes et en proposant une nouvelle façon d’exposer les œuvres pour les publics. Cette exposition permet également aux MRBA de s’impliquer dans l’art contemporain, le tout dans un but associatif pour aider les séniors isolés. « Art cares Covid, Inside-out » bouscule quelque peu le modèle classique des musées en lui donnant de nouvelles fonctions et de nouvelles missions.
MAINE Marion.
Merci à Gaëlle Dieu et Maëlle Delaplanche d’avoir accompagné la rédaction de cet article.
Pour aller plus loin :
- ART BASEL, « The Impact of Covid-19 on the art market », vidéo YouTube, publiée le 21.05.2020.
- R. AZIMI, « Art contemporain : face au Covid-19, le virage numérique des galeries africaines », Le Monde, 19 janvier 2021.
- M. DELAPLANCHE, Site internet « Art cares Covid », lancé en 2020
.
#artcontemporain #bruxelles #galerie

« La Chambre des visiteurs », un commissariat participatif au musée des Beaux-Arts.
Pour la 3e fois, Le Musée des Beaux-Arts de Rouen propose le commissariat participatif, une expérience trop rare en France. Cette année encore, l’évènement offre la possibilité aux visiteurs de sélectionner des œuvres parmi celles des huit musées de la métropole rouennaise.
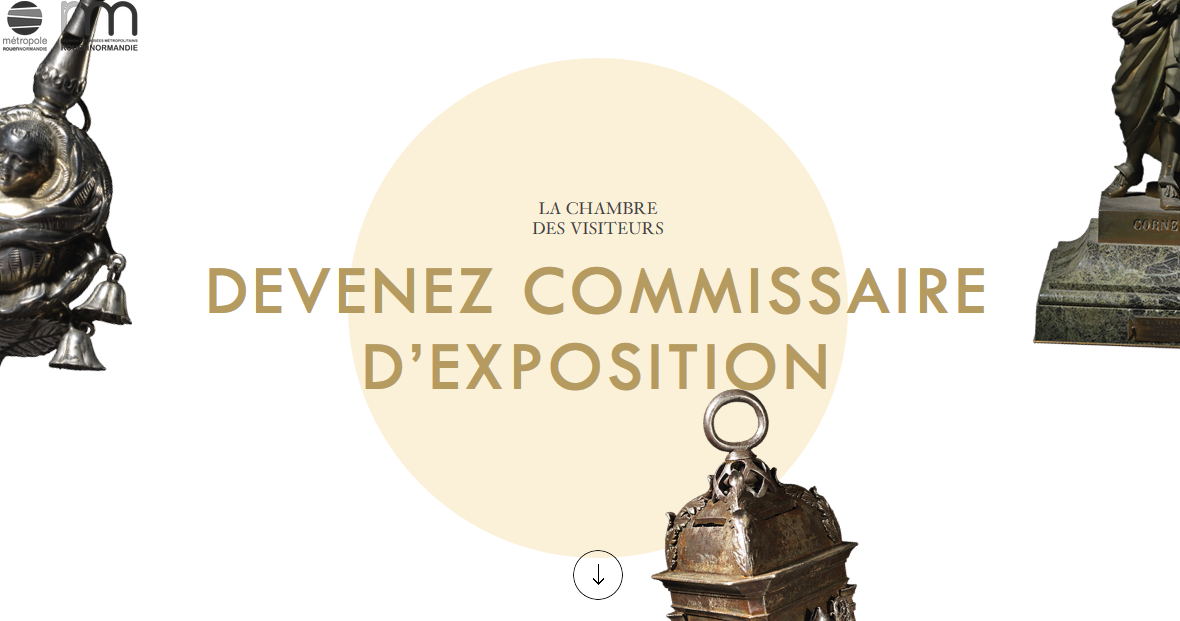
Visuel du site http://www.lachambredesvisiteurs.com/ © MBA Rouen
Revenons sur la genèse de cette initiative : en 2012, Sylvain Amic, historien de l’art et conservateur en chef du patrimoine prend la direction de trois musées rouennais : les Beaux-arts, le Secq des Tournelles et le musée de la Céramique. Peu de temps après son arrivée, il lance « Le Temps des collections », l’objectif est de répondre à la dichotomie de valorisation entre expositions temporaires et collection permanente, de créer un pont entre les réserves et les salles. Chaque musée répond à sa manière à ces problématiques, aujourd’hui récurrentes et dues, en partie, à la baisse drastique des budgets de la culture et des subventions.
Ainsi, si le Palais des Beaux-Arts de Lille décide de créer son #OpenMuseum, le Musée des Beaux-Arts de Rouen explore une autre option en invitant des personnalités telles que Olivia Pulman, Agnès Jaoui ou Christian Delacroix à réaliser des expositions temporaires, avec la volonté de décadenasser le discours et d’attirer un autre public. Mais très vite une question de légitimité se pose : pourquoi ouvrir et offrir la possibilité d’explorer les réserves à une poignée de célébrités ?
Pour Sylvain Amic, l’accès aux collections est un service public minimum, après tout c’est le public qui finance le musée, l’enrichissement et la conservation des collections. Alors pourquoi toujours déléguer à des experts ce qu’ils ont ou non le droit de voir ?
C’est ainsi que naît, en 2016, la première édition de « La Chambre des visiteurs ». L’idée est de faire choisir au public les œuvres qui sortiront des réserves, initiative que le directeur Sylvain Amic voit comme le « prolongement naturel de la mission de service public » que doit remplir le musée. Un site internet est alors spécialement créée pour l’évènement, servant d’interface aux visiteurs qui souhaitent participer à la sélection. Une borne est aussi disponible dans le hall du musée des Beaux-Arts de Rouen. La première édition récoltera 17 000 votes et permettra la sélection d’une vingtaine d’œuvres parmi 70 tableaux pré-sélectionnés par l’équipe.
La pré-sélection est bien évidemment un passage obligé effectué par les équipes du musée, le moment pour eux de proposer leurs trouvailles et objets préférés. Les œuvres doivent être montrables en l’état, car bien sûr aucune restauration n’est envisageable l’enjeu étant de réduire les coûts. En outre, les œuvres doivent être rarement sorties des réserves, posséder des clichés haute définition produits par le musée et être, entre elles, de nature variée. D’autant que depuis l’année dernière, « le concept a été élargi à 8 musées de la Réunion des musées métropolitains qui ont chacun proposé une dizaine d’œuvres » parmi lesquels le Muséum d’histoire naturelle, le Musée Industriel de la Corderie de Vallois ou encore la Maison des champs Pierre Corneille.
Un éclectisme que l’on retrouve dans les propositions du site http://www.lachambredesvisiteurs.com/, classées par catégories : Drôles de bêtes, Tête à tête, Bizarre ou Secrets. Les liens entre les différentes sections sont quelques peu difficile à imaginer. À côté d’un Contiga de Cayenne, conservé au Muséum d’Histoire Naturelle, on trouve Les joueuses d’osselet de Paul Hyppolyte Flandrin au Musée des Beaux-Arts, ou encore l’Amulette : Saint-Gorgon en verre émaillé du Musée des Antiquités. Chaque œuvre est accompagnée d’un court cartel explicitant son emploi ou son histoire.



Oeuvres du musée © Musée des Beaux-Arts de Rouen
Comment, alors que ces œuvres sont si différentes, va-t-on réussir à créer un discours ? La piste de l’exposition Carambolages de Jean-Hubert Martin au Grand Palais - exposition dans laquelle chaque œuvre induisait la suivante par une association d’idées ou de formes – serait intéressante à creuser. Sinon on peut espérer une muséographie originale posant pourquoi pas, les problématiques de conservation dans les réserves. D’autant que la médiation qui en découlerait pourrait être extrêmement ludique. Cette initiative de Sylvain Amic est donc pleine de promesses et suscite beaucoup d’attentes de la part du public. Car n’oublions pas que si le public choisit les objets et participe à la mise en œuvre, il viendra voir le résultat !

Visuel du site © http://www.lachambredesvisiteurs.com/
Récompensée par le Prix Patrimoine et Innovation en 2016, cette initiative est une nouveauté dans le monde des musées en France. Le public, au cœur du musée, est malheureusement trop souvent oublié. L’évènement organisé par le MBA de Rouen le ramène donc à sa juste place, premier pas vers un musée participatif, collaboratif et ouvert. Espérons que très vite, d’autres musées emboîtent le pas, inventant d’autres modes, ouvrant d’autres voies.
En attendant de voir le résultat de cette édition, qui prendra place du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019 au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen, on peut découvrir les œuvres choisies sur le site de « La Chambre des visiteurs », prendre part à l’accrochage ou participer à l’écriture des cartels ! Alors à vos plumes !
C.M
#mbarouen
#commissariatparticipatif
#exposition
Pour en savoir plus:
Sur « La Chambre des visiteurs » édition 2016, présentation du « Temps des collections » par Sylvain Amic : https://www.youtube.com/watch?v=k_C3SHske10
Sur les saisons précédentes de « La Chambre des visiteurs » : http://www.lachambredesvisiteurs.com/saisons/#presentation

« Le monde nouveau de Charlotte Perriand », rencontre avec une femme moderne et engagée
Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020, à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Charlotte Perriand la Fondation Louis Vuitton met en lumière une architecte femme oubliée de l’histoire de l’architecture.
« Le monde nouveau de Charlotte Perriand » est-il réellement nouveau ?
C’est avec une grande curiosité que nous allions à cette exposition enfin consacrée à une architecte et une artiste femme du 20e siècle. Pourtant c’est avec surprise que nous découvrons les premières salles. Car croyez-le ou non, vous ne découvrirez pas essentiellement du Charlotte Perriand lors de cette exposition, bien au contraire. C’est l’univers artistique masculin au sens large qu’il faut s’attendre à explorer.

Bannière de l’exposition, Octobre 2019 © Anaïs Verdoux
En effet, dès la bannière à l’entrée de l’exposition plusieurs noms d’architectes et d’artistes attirent notre attention : Léger, Miró, Picasso, Calder, Braque, Le Corbusier, Delaunay, etc… Le mot d’ordre est lancé, aujourd’hui nous ne verrons pas seulement du Charlotte Perriand.
Plusieurs sens peuvent être donnés au terme « monde nouveau ». Les cinq commissaires d’expositions - Jacques Barsac, Sébastien Cherruet, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp, et Pernette Perriand - révèlent l’importance de cette architecte dans un domaine où peu de femmes trouvent leurs places au 20e siècle. Ce qui rend inédite cette exposition. Cependant le « monde nouveau » auquel fait allusion les commissaires est celui de l’implication de Charlotte Perriand dans l’univers des artistes et des architectes. Comment expliquer que cette femme ait autant collaboré avec Fernand Léger, Picasso ou Le Corbusier et que son nom soit si peu connu ?
L’interrogation se confirme pendant que nous franchissons les premières salles. Face à cette première partie « Construire la modernité » où le mobilier de l’artiste se confronte aux œuvres monumentales de Fernand Léger et de Pablo Picasso « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » révèle l’univers artistique dans lequel elle baigne tout au long de ses créations. Voilà posé le choix du commissariat d’exposition.
« Mon rôle à l’atelier n’est pas celui de l’architecture mais « l’équipement de l’habitation ». Le Corbusier attendait de moi avec impatience, que je donne vie au mobilier. »
Nous découvrons de manière chronologique sa carrière. Tout d’abord, Charlotte Perriand entre dans le cabinet d’architecture de Le Corbusier, puis le Japon l’inspire lors de son voyage ou encore quand elle collabore avec Fernand Léger. Proposer d’autres œuvres au sein des salles met en lumière ses différentes inspirations pour concevoir le nouvel intérieur moderne des années 30. Tâche où elle excelle. Le visiteur découvre la création de son bar pour le Salon d’Automne de 1929, puis le Fauteuil Grand Confort trop souvent attribué à Le Corbusier. Charlotte Perriand est véritablement actrice de la modernité au sein des arts et de l’architecture au début du 20e siècle.
Exposer de l’architecture et du mobilier : un exercice complexe
Comprendre le design, l’architecture, lors d’une visite n’est pas toujours évident. Ici, par l’agencement des espaces, le visiteur découvre progressivement plusieurs installations qui permettent d’expérimenter la réflexion architecturale de Charlotte Perriand. Dans l’un des premiers espaces, une reconstitution de l’atelier de Saint-Sulpice nous immerge dans ses créations. Le mobilier nous apparaît pleinement lorsque nous arrivons dans la reconstitution de l’appartement moderne du Salon d’Automne (1929) réalisé par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand. Le visiteur est invité à contempler cette réplique et à s’asseoir sur les différentes répliques de sièges, laissant le loisir d’appréhender le mobilier.

Appartement moderne conçu par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, 1929 © Anne Chepeau / Radio France.
Suite à l’accumulation de petits espaces d’architectures, le visiteur plonge dans des espaces plus ouverts et aérés propres aux expositions de la Fondation Louis Vuitton. Une nouvelle fois les œuvres de Charlotte Perriand sont confrontées aux œuvres plastiques de Fernand Léger, Pablo Picasso, ou Le Corbusier, dans un réel dialogue entre le mobilier et les peintures.
Ce dialogue s’estompe progressivement dans les espaces suivants révélant de plus en plus le design et l’architecture de Charlotte Perriand.
De ce fait, l’espace « Dialogue des cultures » renoue avec des espaces architecturés dont l’ampleur est bien plus imposante que les espaces précédents. En continuant la visite, l’amatrice de tapisserie que je suis ne pouvait être que ravie. Il n’est plus question de peintures mais d’un médium dont les origines sont liées à l’architecture. Les œuvres de Charlotte Perriand dialoguent avec différentes tapisseries de Fernand Léger, de Pablo Picasso ou de Miró. Ces espaces nous bercent entre architecture, lumière et matière.
Cependant que regardons nous, l’expérimentation du mobilier de l’artiste ou davantage les différents Picasso, Léger exposés ? Différentes répliques de sièges et de bancs sont répandues tout au long du parcours, les visiteurs s’assoient, admirent les peintures et oublient le mobilier de Charlotte Perriand. L’espace « un nouvel art de vivre » dédié à la Galerie Steph Simon (1956-1972) en fin d’exposition illustre cette perte d’attention donnée à l’artiste. Jusqu’à quel point la découverte par l’expérience du monde de Charlotte Perriand s’arrête-t-elle ?
Nous terminons sur les différentes propositions et créations architecturales qui ont fait connaître l’architecte tel que les Arcs en Savoie ou la reconstitution de la Maison de thé de l’UNESCO. Reconstitution qui est impatiemment attendue tout au long de l’exposition.
Retour sur une artiste engagée

Vue de l’exposition, espace galerie 1 « Une femme engagée » © Idboox
Nous l’apprenons très tôt, Charlotte Perriand était une femme engagée pour différentes causes à la fois politiques, féministes et environnementales. Cet espace la montre en militante pour l’Espagne Républicaine et pour une société plus juste et libre. Son engagement pendant la guerre d’Espagne est présenté à travers la réinterprétation de Guernica sur une table basse destinée au salon de l’homme politique Jean-Richard Bloch (1884-1947). Son œuvre est écrasée par l’imposant carton de tapisserie de l’œuvre Guernica.
« Si je délaisse le "métier d’architecte" pour me diriger sur les questions plus directement dans la vie, c’est afin de voir plus clair avec mes problèmes, c’est aussi et surtout parce qu’il y avait un plafond, un mur dans notre travail […] Le mur s’est fissuré, et au-delà il y a tout un monde nouveau qui nous intéresse au plus haut point, car enfin le « métier d’architecte » c’est travailler pour l’homme » Lettre de Charlotte Perriand à Fernand Léger, 1936.
Pendant l’exposition, montrer la vision engagée de Charlotte Perriand passe également par sa perception de la nature, de son « art brut » : ces photographies de vies, de natures qui lui permettent de concevoir d’une nouvelle manière l’habitat. Ce terme d’ « art brut » est utilisé par l’artiste elle-même pour caractériser ses œuvres et photographies en lien avec la nature. Pour l’artiste la photographie est le médium de toutes les libertés. Outre la nature, sa relation avec la culture japonaise modifie profondément sa perception de l’architecture.
Ainsi la carrière de l’artiste n’est plus seulement associée à Le Corbusier. Elle continue d’évoluer à l’international notamment pendant ses années au Japon. Charlotte Perriand crée un mobilier et une architecture qui s’adapte aux modes de vies modernes qui émergent afin de promouvoir l’art pour tous.
Une exposition à FLV : Forcément un succès ?
Une exposition à la Fondation Louis Vuitton est souvent un succès : par les œuvres connues qui font la popularité de l’exposition, ou la diversité des espaces dévoilés au visiteur. Mais avoir visité « Le nouveau monde de Charlotte Perriand » me laisse en demi-teinte. Si l’exposition fait effectivement voyager dans l’univers artistique de l’architecte, la présence incessante des œuvres d’artistes tels que Picasso ou Léger effacent l’existence des œuvres de Charlotte Perriand. Cette impression se renforce nettement par l’aspect IKEA de la présentation des modules d’architectures dans les espaces « Dialogue des cultures » et « Synthèses des arts ».

Reconstitution de la Maison de Thé de l’UNESCO © Marc Domage
Cependant cela demeure une joie de découvrir Le monde nouveau de Charlotte Perriand qui retrace les enjeux « contemporains autour de la femme et de la place de la nature dans notre société ». Écouter le podcast réalisé par l’émission Le réveil du culturel sur France Culture, "Charlotte Perriand, architecte d’un nouvel art de vivre et d’habiter le 20e siècle" éclaire profondément sur sa personnalité et cette exposition.
Anaïs
#CharlottePerriand
#design
#architectefemme
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/charlotte-perriand-architecte-dun-nouvel-art-de-vivre-et-dhabiter
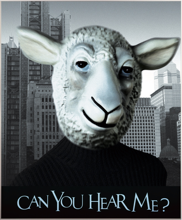
A Cassel, le cri sourd des animaux
À poils et à plumes. L’exposition présentée jusqu’au 9 juillet au Musée de Flandre de Cassel propose de se pencher sur la question de l’utilisation de l’animal dans l’art ancien et contemporain.
Marie-Jo Lafontaine, I love The World / Can you hear me ? 2006, Duratrans - Studio Marie-Jo Lafontaine
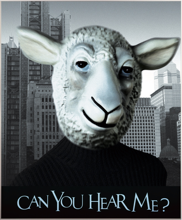 Pour ce faire, neuf artistes belges ont été invités à dialoguer avec les maîtres flamands présents dans la collection du musée. Une initiative aux multiples possibilités, car en passant de la représentation à l’utilisation de l’animal, l’art contemporain a opéré une rupture majeure.
Pour ce faire, neuf artistes belges ont été invités à dialoguer avec les maîtres flamands présents dans la collection du musée. Une initiative aux multiples possibilités, car en passant de la représentation à l’utilisation de l’animal, l’art contemporain a opéré une rupture majeure.
Le texte d’introduction de l’exposition annonce clairement ce dont il retourne : le point commun de tous ces artistes, c’est la matière animale. Pourquoi les artistes choisissent-ils ce matériau si particulier ? Quels en sont les enjeux ? Quel sens y mettent-ils ? Autant de questions délicates mais intéressantes que l’exposition promettait d’aborder via des œuvres tantôt poétiques, engagées, en tous les cas troublantes. L’animal comme matière artistique : un sujet qui donne matière à penser !
Texte d'introduction de l'exposition © A.L
Le casting est en tout cas au rendez-vous : les pièces sont fortes, troublantes, glaçantes, belles et poétiques. De ce point de vue-là, on a ce que l’on est venu chercher et c’est un bel exploit d’avoir réuni toutes ces œuvres. Mais tout l’enjeu pour nous résidait dans la mise en place d’un discours, d’un liant entre ces œuvres qui vienne les questionner, les triturer, les rassembler, les opposer, bref, les faire parler.
Au cas par cas, le dialogue entre les différentes époques fonctionne. Le plus souvent, le lien entre les œuvres repose sur des analogies formelles ou thématiques. Par exemple, les sept hiboux Messagers de la Mort décapités font écho à des scènes de chaos et de jugement dernier. Pas de traces d’un quelconque animal dans ces gravures car c’est la thématique qui importe ici.
Vue de l'exposition, premier plan : Leda, engel van de dood, arrière-plan : Peeter Boel, Nature morte de chasse avec un cygne© J.L
Mais ce type de rapprochement est en fait assez rare dans l’exposition, et pour cause : il est plus difficilement perceptible. On lui a préféré les rapprochements formels. Ainsi, la Leda, engel van de dood(ange de la mort) de Jan Fabre figure auxcôtés d’une Nature morte de chasse avec un cygne de Peter Boel. Ces parallèles iconographiques dans la présence du cygne sont immédiatement perçus par le spectateur, et ce quelle que soit son habitude de l’art ou des musées. Ils trouvent toute leur pertinence dans le cas de lieux comme celui-ci qui n’accueillent normalement pas d’œuvres contemporaines. Ils permettent au visiteur non habitué de se raccrocher à ce qu’il connait, de rapprocher les différentes pièces et ainsi de commencer à se les approprier. Mais si ces rapprochements permettent d’apprécier les liens entre art ancien et contemporain et de voir la constante réactualisation des mêmes sujets, qu’en-est-il du thème de l’exposition ? Que cherche-t-on à nous dire ?
Il est très difficile de répondre à cette dernière question, en partie parce que les murs de l’exposition sont totalement dépourvus d’écrit. Hormis le texte introductif et les cartels, le visiteur ne trouvera ni titre de sections, ni explications. Aussi, même si certaines salles semblent faire ressortir des thèmes généraux (la mort, l’alimentation), il est très difficile de percevoir où le parcours nous conduit. Aucun axe de réflexion n’est mis en avant, on déambule de salle en salle, se confrontant à telle ou telle œuvre, en comprenant le plus souvent les liens qui l’unissent aux autres.
Vue de l'exposition, au premier plan Patrick Van Coaeckenbergh, Le Cheval ; arrière-plan :Jan Fyt, Le Marché aux poissons© A.L.
Est-ce que le livret d’exposition disponible à l’accueil propose une alternative ? Oui et non. S’il comprend bien des notices pour chaque œuvre, elles ne semblent pas spécifiquement adaptées au thème de l’exposition et passent parfois complètement à côté. Pour exemple, une salle du musée présente des œuvres de la collection liées au thème du repas, de la nourriture. En plein milieu de cette salle trône Le Cheval de Patric Van Caeckenbergh, une sculpture entièrement réalisée de boîtes de conserves. Un animal fait d’un amoncellement de bocaux alimentaires, le tout dans une salle liée à l’alimentation, on est en droit de se dire que l’artiste tient là un propos militant attaché aux thèmes de la nourriture et de la consommation. Pourtant la notice n’y fait pas du tout mention. Elle ne s’attarde pas sur le choix symbolique du cheval, ni sur la démarche de l’artiste dans le cadre de cette œuvre précise. Comment, pourquoi et quid de la question de l’animal ? Les notices survolent le thème de l’exposition sans le creuser.
Vue de l'exposition, au premier plan : Berlinde de Bruyckere, InFlanders Fields, 2000 © A.L.
À dire vrai, quand nous sommes sorties de cette exposition, nous étions ravies ; ravies d’avoir pu découvrir ce beau musée, d’avoir pu voir ces pièces d’artistes renommés. Nous nous sommes laissées emportées par le mysticisme des œuvres de Jan Fabre, la violence glaçante de l’installation de Berline de Bruyckere, la poésie de l’œuvre de Thierry Cordier ou la vision engagée de Michel Vanden Eeckhoudt.
Et puis nous avons essayé de mettre des mots sur notre expérience de visite. Or la seule chose qui nous restait, c’était un catalogue d’œuvres. Mais au fond qu’en est-il de cette question de la matière animale ? Que peut-on dire de plus à ce sujet après avoir vu l’exposition ? Quels en étaient les partis-pris ? C’est une situation récurrente dans bien des musées d’art et qui pose la question de l’enjeu d’une exposition et de ce que l’on attend d’elle. Ici, nous avons pris du plaisir - à coup sûr - , mais nous aurions aussi aimé réfléchir.
Car il y avait tant de choses à dire et à faire. À l’heure où les consciences s’éveillent de plus en plus à la condition animale, les usages contemporains posent nécessairement question. Peindre un animal ou utiliser sa peau, sa graisse…, les enjeux ne sont définitivement pas les mêmes. Nombreux sont les artistes actuels à s’emparer de ce matériau, ce qui ne manque jamais de soulever de vives réactions. Parce que ces démarches charrient avec elles des questions éthiques, esthétiques et sociétales à commencer par celle-ci : qu’est-ce que l’on est en droit de faire au nom de l’art ?
Sans doute que les pièces choisies par le musée ne permettaient pas d’aller si loin dans le discours, mais il est dommage qu’elles n’affleurent pas davantage. Ce sont des questions délicates, probablement difficiles à aborder dans un musée, plus encore à assumer et ce n’était visiblement pas le parti-pris choisi de questionner la condition animale. Mais peut-on vraiment parler de l’animal comme médium artistique en évacuant complètement ces interrogations ?
Reste que l’exposition réussit à marier les styles et les époques, rappelant que l’art ancien se trouve constamment réactualisé dans les créations actuelles.Ceux qui cherchent matière à réfléchir sur cette condition animale seront sûrement déçus quand d’autres, souhaitant surtout se laisser happer par les œuvres, y trouveront leur bonheur.
Et pour ceux d'entre-vous qui se demandent où se trouve Cassel et ce que l'on peut bien y faire, je vous invite à aller parcourir l'article de Joanna qui vous raconte notre périple à travers la flore casseloise : http://lartdemuser.blogspot.fr/2017/06/museo-transpi.html .
Annaëlle Lecry
#artcontemporain
#conditionnimale

Accro(c) au futur musée des collectionneurs d'Angers?
Vue panoramique du projet sur le Front de Maine, le quartier du musée des collectionneurs. compagnie Phalsbourg. source: ImagineAngers
« Rappelez-vous le Centre Pompidou »
Cette remarque faite à des visiteurs de la foire d’exposition sur le stand des lauréats du projet imagine Angers eut le don de me faire sortir les crocs. Et non, ce n’est pas seulement un mauvais jeu de mots sur l’apparence architecturale imaginée par Steven Holl et Franklin Azzi du musée des collectionneurs, que certains appellent déjà les dents. Car en mauvaise journaliste que je suis c’est bien évidemment un véritable dialogue de sourds avec les « médiatrices du projet » post scriptumque j’ai mené, tout en perdant mon calme. Il faut dire que citer Jean-Jacques Aillagon ancien ministre de la culture et de la communication sous le gouvernement Raffarin, aujourd’hui conseiller de la Compagnie Phalsbourg, était le faux pas que j’attendais. Pourquoi tant d’effusions?
Tout d’abord parce qu’entonner le couplet de la « réussite architecturale » d’un centre culturel pluridisciplinaire aujourd’hui éminent dans le paysage français (et parisien) ne permet en aucun cas de justifier les nouveaux projets architecturaux d’équipements culturels qui interpellent le public. En effet le cas de l’édifice qui comprend le musée national d’art moderne et contemporain est unique.
Bien qu’évidemment si l’on se fait l’avocat du diable des points communs peuvent être établis :
- Un concours architectural novateur.
- Un bâtiment pluriel
- Et surtout une volonté similaire à celle du président Pompidou qui avait l’ambition de « doter Paris d’un ensemble architectural et urbain qui marque notre époque ».
ci il s’agit davantage de marquer un territoire. Stephan Holl l’explique de cette manière dans une vidéo réalisée avant que le jury ne statue sur les différents projets :« Nous sommes convaincus que le site front de Maine pourra accueillir un équipement grandiose et iconique participant au rayonnement d’Angers tant en Europe qu’à l’international »[5].
Enfin bien sûr l’apparence du Centre George Pompidou fut qualifiée dès la présentation des architectes Renzo Piano Gianfranco Franchini et Richard Rogers (dont le projet a été retenu en 1971) par « tous les sobriquets. « Pompidoleum», «Hangar de l'art» ou «Raffinerie culturelle» sont quelques-uns des noms d'oiseaux dont le bâtiment est affublé. »[6]
Mais, tout d’abord, nous sommes loin de cette ampleur en termes de rejet[7] et de créativité pour qualifier le projet de la compagnie Phalsbourg. Ensuite, bien évidemment, la logique et la facilité nous poussent à rejeter l’aspect visuel du bâtiment. La nouveauté effraie certains autant qu’elle peut en fasciner d’autres. Toutefois, est-ce pour autant la peine d’évoquer le modèle du Centre George Pompidou pour stopper toute réaction un tantinet négative sur l’apparence prévue pour le front de Maine ?
N’oublions pas non plus le rôle de l'architecte des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard qui veille à la bonne insertion des constructions neuves aux abords des monuments protégés. Dans le cas présent « il se montre plus réservé. Il ne voulait pas de concurrence avec le château. Selon lui, les dessins de Steven Holl ne sont pas encore définitifs et restent « à préciser », les teintes et les formes notamment. »[8]
Pour ma part je n’ai rien contre ces incisives géantes !
Et pourtant pour me convaincre de l’intérêt du musée des collectionneurs, il me faudra bien au moins un texte de Jean d’Ormesson ! Je fais allusion à son éditorial du 31 janvier 1977 dans Le Figaro où il transcrit ce fameux état d’esprit collectif au sujet du Centre Pompidou : « C’est atroce. On dirait une usine, un paquebot, une raffinerie. Une espèce d'écorché monstrueux et multicolore, avec ses tripes à l’air » avant d’en faire son plaidoyer[9].
Si l’on se propose de faire l’inverse, nous débuterions par un « c’est étonnant ! On dirait une belle roche immaculée, un jeu d’osselet monumental, une famille d’icebergs. Une espèce de monolithe lisse et blanc, avec ses reflets miroitants. ». Puis nous saluerions le cheminement de pensée des créateurs basée sur le château d’Angers, et la tapisserie de l’Apocalypse qui se trouve en face, c’est donc une structure à la fois complètement différente de son environnement tout en étant complémentaire.
A la clef, 5 grands concepts que voici en image :
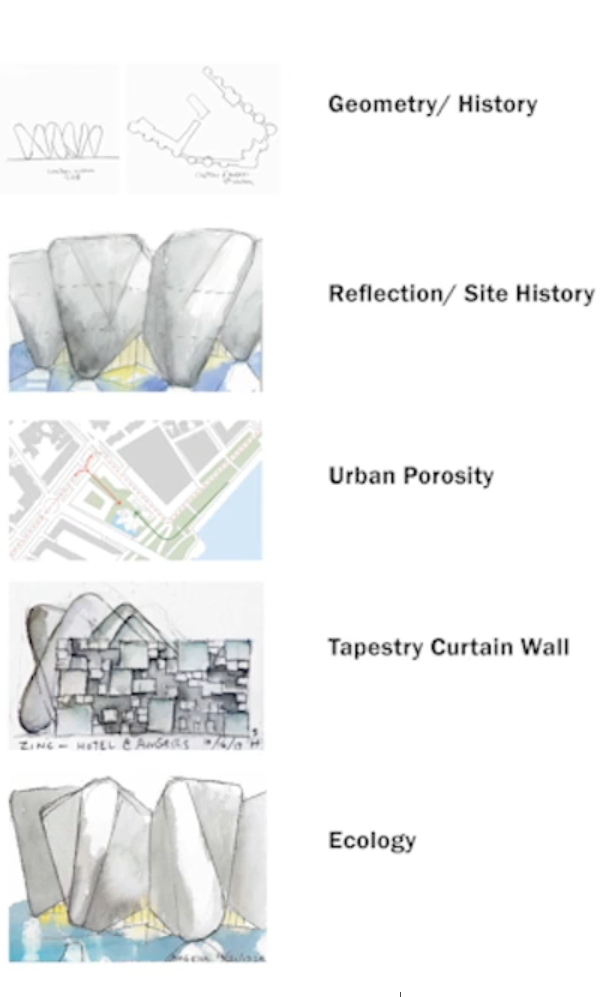
A mon sens on peut admirer le travail d’un architecte de la même manière qu’une œuvre d’art, sans parler de son utilité. Néanmoins, utilité il y a, à qui s’adresse cette offre du futur front de Maine ?
Des nouveaux logements et services pour la Doutre, ce quartier d’Angers qui était très populaire jusque dans les années 80, est aujourd’hui très prisé notamment pour le cachet des vieilles maisons et le calme qui y règne. Ces 145 logements participeront à la gentrification de cette zone urbaine en offrant des logements modernes avec un tout autre cachet.

Vue d'intérieur d'un logement, source site Imagine Angers
L’hôtel 4* étoiles à vocation touristique ajoute une couche supplémentaire de luxe au projet. Certes le complexe architectural propose ses espaces de co-working ce qui apporte l’aspect chaleureux et inclusif à ce projet urbain. En dépit d’un travail conduit pour dédier cet espace au domaine artistique via une recherche des besoins sur le site internet myprofileart qui regroupe 900 artistes angevins, les futurs habitants sont supposés être de jeunes actifs, start-uppers….
S’il faut développer une offre sur le territoire angevin pour cette catégorie de population, on peut néanmoins regretter que le projet n’intègre pas plus de mixité sociale. Certaines interventions de la conférence publiques font écho : une dame souleva, une phrase émise par Phillipe Journo[10] directeur et seul actionnaire de la Compagnie de Phalsbourg, sur le sentiment de réussite qu’auront les futurs habitants de cette résidence du quartier des collectionneurs. Qu’il réponde qu’il ne pensait pas à polémiquer avec cette formulation mais juste à présenter leur philosophie ne satisfait pas. S’il expliqua penser aux gens, sans être hors sol mais bien ancré dans la vraie vie, son interlocutrice répliqua que la vraie vie ce n’est pas que la consommation et habiter dans des appartements luxueux. A cela, il acquiesça, le modérateur en profita pour introduire : « d’où le musée ».
Cette inconnue de la conférence se dit sceptique : « Qu’est-ce qu’un musée des collectionneurs ? ». Effectivement, ce concept est à interroger. En voici sa description officielle[11] :« ce musée unique au monde sera dédié aux collectionneurs qui pourront exposer au grand public leurs œuvres inestimables accumulées pendant leur vie. ».
Tout est dit. Cet équipement servira davantage les collectionneurs et sans doute par la même occasion leurs égos. De cette manière, ils auront peut-être le sentiment d’avoir réussi ou d’être philanthropes en exposant aux publics démunis de « l’art » leurs patrimoines. Et puis quel grand public espère-t-on ? L’accessibilité n’est ici qu’un mirage. Il semble évident que les publics que l’on retrouvera dans cet espace « White cube » ne sera guère différents de ceux avides de l’offre culturelle, voir ceux qui collectionnent des œuvres d’arts. De plus si l’on se fie à la définition du musée de l’ICOM et à celle de la loi musée 2002[12], l’utilisation du terme musée est ici un abus de langage. Ce modèle se rapproche en effet plus du Centre d’art, puisqu’il n’y aura aucune collection propre à l’établissement. Le fonctionnement de ce système d’exposition reste d’ailleurs très obscur. Un comité scientifique semble avoir pris forme autour de la personne de Jean-Jacques Aillagon. D’après la presse, il aurait même l’idée d’appeler la 1ere exposition : « Apocalypse Now » en hommage à la tapisserie conservée au Chateau et au film de F. F. Coppola.
Ce projet, P. Journo souhaite qu’il comble le problème que très peu d’individus sont en mesure de se créer un musée pour montrer leur passion. Selon une élue angevine[13] un doute existe quant à la possibilité d’exposer en étant un collectionneur local. La stature de l’ancien ministre, féru d’art contemporain[14] n’engage pas dans cette direction.
Le projet de société Phalsbourg pour le musée des collectionneurs à Angers
Finalement ce système d’exposition qui promet des œuvres venant du monde « dentier »[15]servira plus à installer Angers comme destination d’un certain type de tourisme basé sur le star-system grâce à la renommée des architectes et des possibles œuvres que l’on y trouvera. Par ailleurs, l’idée que Angers soit la 1ère ville d’un possible « réseau mondial de musées des Collectionneurs. » n’a pu que séduire les personnes en charge de sélectionner les lauréats de Imagine Angers.
Sur ce point, M. Béchu maire de la ville, explique « on n’a pas signé un permis de construire, on a adhéré à une vision ». A cette même conférence, peu de temps avant, P. Journo expliquait que le rayonnement d’une ville relevait d’un collectif, qui commence par les élus qui doivent donner la vision, et continue par les opérateurs privés qui doivent la réaliser.
Or, ce projet d’innovation urbaine en ce qui concerne la partie musée n’est pas issue d’une réflexion municipale sur sa politique culturelle ou touristique mais bien un effet d’opportunité, profitant de l’expertise d’un promoteur immobilier. Je ne critique pas la société Phalsbourg qui se voit développer un projet singulier dans un environnement qui lui semble cher. Je réagis à cette privatisation de l’offre muséal, où aucun projet scientifique et culturel n’est établi, où l’on ne sait pas quelle politique des publics sera menée, ni même les orientations scientifiques du futur musée.
Tout cela alors qu’une offre existe et que des effets de concurrence peuvent être en jeu. Ainsi le musée des beaux-arts a clôturé en mars 2018 l’exposition « Collectionner, un désir inachevé » qui présentait au public 5 collections particulières[16]. Le musée d’histoire naturelle a lui, besoin d’une rénovation des espaces. A l’inverse le musée Pincé a été complétement restauré, le chantier des collections est toujours en cours et l’on ne sait guère ce qui va advenir ensuite. Ajoutons qu’un Centre d’art contemporain pensé pour reconvertir la maison d’arrêt après sa fermeture était une des propositions électorales de C. Béchu. Sachant que le déménagement de la maison d’arrêt est retardé, est-ce que le musée des collectionneurs va prendre le pas sur cette ancienne ambition ?
En tant qu’étudiante je me prépare à m’insérer dans le monde professionnel de la culture. J’aimerais évidemment participer dans un futur aussi proche que possible à la construction d’un musée. Pourtant ce projet de musée des collectionneurs dans ma ville natale que certains voient comme une chance est très loin de mon idéal.
Il correspond à ce « retour du collectionneur » évoqué par A.Gob et N.Drouguet[17] , évolution à rebours (une limite nette existe entre musée et collection privé depuis la fin du XVIIIème siècle) pratiqué par de nombreux musées européens dont le Museo Carmen Thyssen Malaga. Le projet muséologique de ce musée a été élaboré par la directrice scientifique après l’ouverture du musée. Espérons que le musée des collectionneurs lui ne se cassera pas les dents lorsqu’il s’agira de mettre en place un projet muséologique cohérent. Même si cela semble mal parti, qui-sait, rendez-vous dans 10 ans comme le dit Phillipe Journo. Il s’agira peut-être des dents du bonheur de la Ville...
Julie Davasse
Post scriptum
Nous pouvons nuancer notre propos, la municipalité a en effet la capacité de faire force de proposition en matière d’équipement culturel. suite à la publication le 15 mai 2018, d’un article Le Courrier de l’Ouest:
« L'ancien restaurant universitaire de l'école des Beaux-arts, installé dans le jardin du musée, va devenir un espace municipal culturel. [...] Les lieux, désertés depuis juin 2015, ont été rachetés par la Ville qui compte faire une opération blanche en y relogeant plusieurs services (archives municipales, service d'art et d'histoire...) et en revendant certains bâtiments ainsi libérés. En plus des services de la ville, ce bâtiment des années cinquante accueillera des expositions permanentes et temporaires sur le patrimoine, une salle pour l'art contemporain et un espace de résidence d'artistes. ».
http://m.courrierdelouest.fr/actualite/angers-lancien-resto-universitaire-transforme-en-espace-culturel-15-05-2018-359545?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire [1]https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/31-janvier-1977-Centre-Pompidou-tant-decrie-inaugure-2017-01-29-1200820789
[2] http://imagine.angers.fr/
[3] Oups vous ne connaissiez pas tous les méandres du bâtiment ! Pour me faire pardonner je vous incite à regarder un dessin animé sur le sujet ici!
[4] Idem à 2 http://imagine.angers.fr/[5] Extrait du doublage français de l’architecte qui s’exprime en anglais
[6] Centre Pompidou : les trois points qui fâchaient lors de la création, Par Camille Lestienne Mis à jour le 23/01/2017 à 12:20 Publié le 20/01/2017 à 18:14 sur le figaro.fr Histoire. Consulté le 31/04/18. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/20/26010-20170120ARTFIG00271-centre-pompidou-les-3-points-qui-fachaient.php[7] Pour aller plus loin dans la controverse sur le Centre George Pompidou http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/01/23/tv-l-histoire-controversee-du-centre-beaubourg_5067792_1655027.html[8] « A Angers, l’architecte Steven Holl défie Blanche de Castille » LE MONDE | 29.03.2018 à 08h49 • Mis à jour le 29.03.2018 à 09h18 | Par Yves Tréca-Durand (Angers, correspondant)
[9] Cet éditorial a été republié par le Figaro Histoire, à l’occasion de l’ouverture du Centre Pompidou à Malaga (Espagne). Par Sophie Guerrier Mis à jour le 02/04/2015 à 17:19 Publié le 27/03/2015 à 18:29. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/03/27/26010-20150327ARTFIG00315-inauguration-du-centre-pompidou-paris-1977-malaga-2015.php[10] Également 62ème fortune française selon le classement challenges de 2017. Ce n’est pas nouveau pour la Compagnie et lui-même de se lancer dans des projets artistiques et culturels. Il est effectivement propriétaire du théâtre Bobino, l’un des mécènes de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris (financement de la rénovation des façades de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, quai Malaquais à Paris et de leur mise en lumière), du Centre Pompidou Metz (soutien à diverses expositions) et de l’Opéra de Paris (co-financement de « 10 mois d’École et d’Opéra » et restauration de la Ceinture de Lumière). Source :http://www.club-innovation-culture.fr/angers-premier-musee-des-collectionneurs-monde/
[11] Issue du site Imagine Angers et présente dans les communications de l’entrepreneur et des architectes.
[12] Article 1er : « Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public. »
[13] Rachel Capron élue de l’opposition interrogée par mes soins au téléphone sur le sujet.
[14] Il fut également à la tête du musée et domaine de Versailles, l’exposition Jeff Koons est par exemple de son initiative il collabore également avec d’autres musées et conseille F.Pinault pour la mise en place de sa fondation.
[15] Encore un jeu de mots pardonnez-moi
[16] Collections présentées : association PACA (Présence de l’art contemporain-Angers), collection Philippe Méaille, collection Fondation La Roche Jacquelin, collection Alain Le Provost, collection particulière.
[17] La Muséologie, histoire, développements, enjeux actuels. André Gob, Noémie Drouguet 4ème éditions Armand Colin, 2014
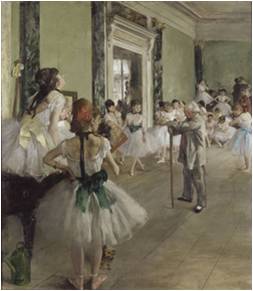
Alors, on danse ?
De l'exposition classique au musée d'Orsay
S’il y a bien un peintre qui aime la danse, c’est Degas. Retournons au XIXème siècle, époque où la bourgeoisie parisienne se veut érudite. Une société accordant de l’importance aux loisirs fréquente aussi bien les théâtres que les opéras. C’est dans ce contexte fertile que Degas grandit et alimente sa fascination pour les arts et surtout l’Opéra. Pour l’anecdote, le père de Degas organisait tous les samedis un récital dans le salon. Pour le 350ème anniversaire du Musée d’Orsay, les toiles du « peintre des danseuses » sont exposées sous un angle inédit. Ici, l’Opéra est abordé dans sa globalité, une première pour le musée. Au regard des œuvres telles que La Loge ou bien La Petite Danseuse de quatorze ans, œuvre qui a scandalisé le public lors de son exposition en 1881, l’artiste nous parle de sa fascination pour le corps humain et le mouvement. Difficile d’évoquer le mouvement avec des collections alors, que par définition, les œuvres sont figées dans le temps. L’exposition présentée au musée d’Orsay nous invite à comprendre le mouvement par la représentation des danseuses dans leurs univers. Pour lui, le mouvement né de l’effort. Effort, qui transparait autant dans ses dessins au pastel que dans ses peintures. D’ailleurs, contrairement à Claude Monet, Degas détestait peindre en dehors de son atelier. Les danseuses posaient donc devant le maitre qui réussissait à peindre les jeunes femmes dans leur intimité de danseuse. Des backstages aux planchers, des musiciens aux habitués des lieux, Degas représente également tous les acteurs de l’Opéra. Avec ses œuvres cadrées à la façon d’un photographe, il témoigne des mœurs de la société bourgeoise.
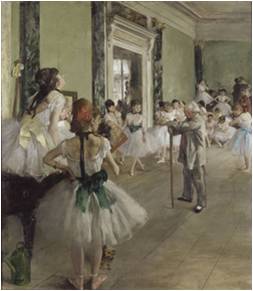
Edgar Degas La classe de danse© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski
Cette exposition nous invite à découvrir ou à redécouvrir un artiste, qui pendant plus de 50 ans de carrière n’a cessé de peindre des femmes en tutus, n’hésitant pas à expérimenter des palettes de couleurs audacieuses. Deux ans auparavant, en 2017, le Louvre avait présenté son exposition au public, intitulé Corps en mouvement. La danse au musée se veut pédagogique puisque l’exposition donne au public les clés pour comprendre l’art et décortiquer gestes, postures et émotions dégagées par les corps peint. Chose innovante, quoi de mieux qu’un chorégraphe pour parler danse. C’est sur ce parti-pris que le Louvre a décidé de travailler de concert pour cette exposition en conviant le chorégraphe danseur Benjamin Millepied, en tant que co-commissaire de l’exposition.
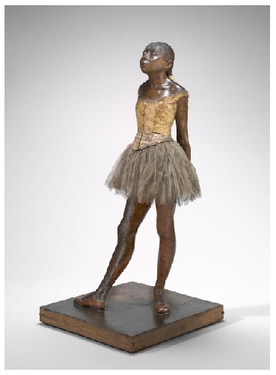
Edgar Degas, La petite danseuse de 14 ans © National Gallery of Art, Washington DC
A l’exposition Corps Rebelles au musée des Confluences

Vue de l'exposition Corps Rebelles © Bertrand Stofleth, Hétéroclite
Danse et musée ne font pas bon ménage ?
Que retenir de ces deux expositions ? Qu’il est difficile de faire cohabiter des artistes danseurs dans les collections des musées. La première raison est sécuritaire. Les musées n’ont pas été conçus comme des lieux de spectacle vivant, hormis les nouvelles structures qui se dotent d’auditorium ou d’espaces dédiés. Boris Charmatz releva le défi en 2016 avec Danse de nuit dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il réalisa ainsi sa chorégraphie dans la cour Carrée du musée du Louvre. L’espace n’étant pas aménagé pour recevoir le public venu en masse, l’accessibilité au spectacle fut complexe. Mettant ainsi le public proche de la performance et à la fois éloigné, puisqu’il était difficile pour un grand nombre d’apercevoir l’artiste au cœur de sa pratique. La deuxième raison est financière. Les musées ne produisant pas les spectacles d’art vivant, les enjeux ne sont pas les mêmes. La rémunération des danseurs peut peser, surtout quand le projet est conséquent. C’est le cas de l’exposition Carte blanche à Tino Sehgal où les 13 000m² d’exposition du Palais de Tokyo furent entièrement dédiée à la performance dansée du chorégraphe et de plusieurs de ses compères. La dernière raison s’accorde sur la gestion de l’humain. Il est complexe de faire intervenir des danseurs durant tout le temps que l’exposition est présentée au public.
« Danse de nuit », une chorégraphie de Boris Charmatz. © BORIS BRUSSEY
L'importance de la programmation : ateliers et résidence
Et comme le dit si bien Jean de La Fontaine, « Et bien, dansez maintenant ! »
L’exposition Degas à l’Opéra
Du 24 septembre 2019 du 19 janvier 2020
Musée d’Orsay
#danse
#exposition
#performance
Edith Grillas
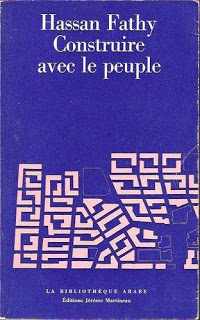
Attention patrimoine en construction ! Analyse croisée d'un livre et d'une chronique radiophonique.
Le patrimoine et moi, c’est un peu « qui aime bien châtie bien ».Plus je l’aime plus je le maltraite, le renie, le chamboule, et ose tous les blasphèmes : détruire une partie de la conciergerie à grand coup de dynamite pour écrire une nouvelle histoire, je suis pour ! Je vous l’accorde, cet amour vache tourne parfois à la caricature !
Mais face à des budgets de la culture qui s’amaigrissent d’année en année, vous ne m’enlèverez pas l’idée que les vieilles pierres sont de vieilles bourgeoises aigries face aux associations culturelles de banlieue, fraiches et révoltées, mais, fauchées.
Pour cet article j’ai convoqué deux voix, paroles écrites ou radiophoniques, pour tenter de vous convaincre ; celles d’Hassan Fathy dans son ouvrage Construire avec le Peuple et d’une jeune chroniqueuse de France inter, Nicole Ferroni. Avant de vous parler du livre et de la chronique, laissez-moi-vous présenter les auteurs. Hassan Fathy représente souvent le mythe de l’architecte aux pieds nus, le Pierre Rabhi du béton armé, bref le métèque du prix Pritzker[1] ! Il a d’ailleurs reçu le premier prix Nobel alternatif en 1980. Nicole Ferroni, elle est une ancienne professeure de Sciences et Vie de la Terre, devenue humoriste et chroniqueuse à France Inter.
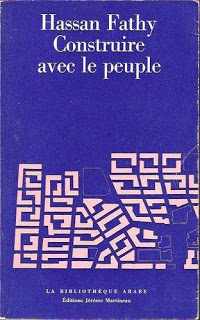
Couverture du livre "construire avec le peuple" d'Hassan Fathy
En 1945, l’architecte égyptien Hasan Fathy est chargé de reconstruire le village de Gourna, près de Louxor, en Egypte. Son livre, Construire avec le peuple, est le récit de cette grande réalisation mais c’est aussi pour l’auteur l’occasion d’exprimer ses convictions architecturales et sociales. Les pieds (nus) dans la terre argileuse et la tête tournée vers l’avenir, l’auteur développe sa réflexion au fur à mesure de l’avancement du projet : analyse des lieux, des traditions locales, des systèmes économiques du village et en parallèle réflexion sur l’ensemble du pays et la population égyptienne…
Dès le début du récit, Hassan Fathy montre son attachement à la campagne égyptienne et souhaite reconstruire ce village selon les traditions constructives et sociales locales. Cette volonté se traduit par le choix d’un matériau aussi traditionnel que malléable et éphémère : la brique de boue.
Loin d’être anecdotique ou purement technique, l’importance du matériau de construction montre que la tradition pourrait être un matériau primordial pour l’architecture. La vision d’Hasan Fathy est riche et pourtant extrêmement simple : la tradition est modelable et surtout constructive.
La tradition prend alors un sens particulier dans son discours : en effet, la notion de tradition (et notamment tradition constructive) s’apparente à celle de patrimoine bâti et pourrait même la remplacer. La tradition devient une matière à travailler sans nécessité d’existence physique. On peut alors se demander ce qu’il en est de l’histoire, souvent prisonnière de ce patrimoine bâti. En effet, beaucoup diront qu’au-delà d’une technique ou beauté constructive, chaque bâtiment véhicule aussi une histoire, un contexte, et témoigne d’une époque.
Il ne renie pas, bien au contraire le lien entre matérialité et histoire. Il le met en évidence pour pouvoir en débattre. Et c’est là tout l’intérêt de ce livre face aux enjeux actuels. Il affirme ainsi que sans aucune référence à la culture ancestrale du pays les architectures contemporaines perdent tout caractère humain et se détachent de la société qu’elles habitent. Il parle ainsi, d’ « enlaidissement progressif de la ville et de la campagne », marquant volontairement le décalage entre l’énergie et le budget alloués à la conservation d’un certain patrimoine bâti et l’indifférence face à l’aménagement de nos périphéries urbaines.
Cette réflexion menée sur la relation entre construction contemporaine et patrimoine bâti peut s’appliquer à d’autres vecteurs culturels, artistiques et sociaux. Et c’est pourquoi je voudrais croiser l’analyse d’Hasan Fathy à la chronique radiophonique de Nicole Ferroni diffusée sur France Inter le 3 Septembre 2004, et intitulée « A Marseille, je suis partie à la pêche aux subventions ».
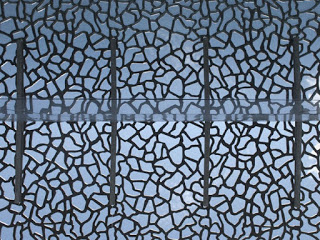 Dans cette chronique, NicoleFerroni cherche à définir les objectifs traduits par la répartition des subventions du ministère de la culture. Sur un air faussement naïf, elle interroge avec lucidité le rôle du tout nouveau Muceum dans la vie culturelle marseillaise. Elle dénonce avec subtilité un lien, non négligeable, entre culture et communication et rappelle que l’action culturelle est motivée par une recherche de visibilité. Appliquant la réflexiond’Hasan Fathy au spectacle vivant, cette envie de « Construire avec le peuple » et notamment avec la jeunesse marseillaise peut prendre forme au travers d’actions culturelles de proximité. Nicole Ferroni mentionne d’ailleurs le cas d’un théâtre de la banlieue Nord de Marseille, dont le budget nécessaire à son fonctionnement semble englouti dans les remarquables façades du Muceum !
Dans cette chronique, NicoleFerroni cherche à définir les objectifs traduits par la répartition des subventions du ministère de la culture. Sur un air faussement naïf, elle interroge avec lucidité le rôle du tout nouveau Muceum dans la vie culturelle marseillaise. Elle dénonce avec subtilité un lien, non négligeable, entre culture et communication et rappelle que l’action culturelle est motivée par une recherche de visibilité. Appliquant la réflexiond’Hasan Fathy au spectacle vivant, cette envie de « Construire avec le peuple » et notamment avec la jeunesse marseillaise peut prendre forme au travers d’actions culturelles de proximité. Nicole Ferroni mentionne d’ailleurs le cas d’un théâtre de la banlieue Nord de Marseille, dont le budget nécessaire à son fonctionnement semble englouti dans les remarquables façades du Muceum !
Détail d'une façade du MUCEM - Joran Briand
Ce parallèle pousse à croire qu’à travers de tels projets (celui du Muceum, du Louvre-Lens) nous projetons un nouveau patrimoine bâti, que nous conserverons à grands coups de subventions plus tard. Ces bâtiments, qui écrasent parfois des lieux culturels existants, ne font-ils pas figure de patrimoine pré-classés avant même qu’ils prennent et prouvent leur sens dans l’espace et la vie publics ? La notion de patrimoine et les raisons de sa conservation doivent demeurer une question toujours ouverte. A l’heure où les politiques actuelles semblent vouloir figer leurs actions dans du béton, de peur que nos traditions culturelles, fruits d’une transmission humaine, soient déjà en voie de disparition… ré-ouvrons le débat !
Margot Delobelle
En savoir plus :
Hassan Fathy, Construire avec le peuple,Paris, éditions Jérôme Martineau, 1970
Chronique de Nicole Ferroni, à réecouter sur le site de France inter : http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-nicole-ferroni-a-marseille-je-suis-partie-a-la-peche-aux-subventions
# patrimoine bâti# Hassan Fathy
[1] Le prix Pritzker d'architecture est un prixd'architecture annuel décerné par un jury indépendant depuis 1979
Au Musée de Flandre de Cassel, « cette oeuvre est à toucher ».
Situé sur la Grand Place de Cassel dans le département du Nord et à environ cinquante kilomètres au nord est de Lille et dix kilomètres au nord de Hazebrouck, ce musée que l’on pourrait qualifier de « Beaux-arts », propose des médiations tactiles originales et plutôt novatrices. Il prend place au sein de l’Hôtel de la Noble-Cour (XVIème siècle) classé monument historique depuis1910 et entièrement rénové. Ce même monument fût le théâtre en 1964 de l’inauguration d’un musée d’art, d’histoire et du Folklore. En le rachetant en1997, le département en aura la tutelle et le chantier du musée de Flandre ne s’ouvre qu’en 2008 après dix ans de fermeture. Projet muséographique moderne et unique en Europe, la thématique s’inscrit dans le territoire et sa priorité constitue la mise à jour de l’identité culturelle et artistique de la Flandre en valorisant sa richesse à travers les âges. Les collections présentées initient un dialogue entre les oeuvres dites « classiques », ethnographiques et contemporaines.
On note immanquablement un objectif d’accessibilité à un large public. Fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite, ce musée présente des médiations et animations diverses pour optimiser l’accès à la compréhension des œuvres : outils multimédias, panneaux explicatifs, visites guidées adaptées aux publics (visites en LSF, pour les enfants…), ateliers divers, attention particulière donnée aux groupes et bien d’autres. Le musée de Flandre accorde en outre un soin particulier en faveur des personnes déficientes visuelles ; c’est notamment la raison pour laquelle ont été crées ces maquettes tactiles qui permettent de surcroît de donner vie à ses collections. Ces publics spécifiques sont bien pris en compte et impliqués. Le parcours muséographique est partagé en quatre thématiques ambivalentes «Soumission et Colère », « Entre Terre et Ciel », « Mesure et Démesure » et «Ostentation et Dérision » et est enrichi d’une maquette tactile par thème permettant une approche sensorielle du contenu de l’exposition permanente.
"Carnaval de Cassel" d'Alexis Bafcop – 1876
© Artesens, association dont le « but est d’offrir un éveil à l’Art par le biais des sens », a réalisé les maquettes tactiles de l’exposition permanente
Ces maquettes représentent une adaptation en 3D et reliefs d’œuvres phares au sein des thématiques dans lesquelles elles sont disposées ainsi que des cartels qui les accompagnent. Ces derniers sont constitués d’une apposition en transparence d’un texte en braille sur le texte classique, ce qui est pertinent pour des publics souvent non pris en compte. Leur sens du toucher est sollicité par le relief et la description ; l’imagination opérant, d’autres images peuvent naître.
Pour les deux premières maquettes du parcours, on peut parler d’une traduction sensorielle de l’image picturale et de support de délectation esthétique de quelque visiteur. Présenté différemment, l’art est perçu autrement et de façon inhabituelle. De fait, des publics plus « secondaires » peuvent également utiliser ces maquettes. Par exemple, toucher un expôt présent dans un musée s’assimile à l’élan naturel de l’enfant. Je vis d’ailleurs un enfant, sourire aux lèvres, prononcer un « je peux toucher ? » adressé à sa mère les yeux pétillants : les doigts s’affairaient déjà à toucher cette maquette simultanément au son produit. Ainsi il est possible que le jeune public soit d’entrée capté par une maquette tactile car elle peut donner l’occasion de s’approprier ce qu’il peut considérer comme un jeu, alors même qui lui est transmis un certain savoir. Et même si son interprétation est approximative, l’enfant est accompagné dans sa dynamique et sa soif de découverte du monde qui passe principalement par l’usage des yeux et des mains. Un musée communément boudé par l’enfant est devenu vivant et attractif, alors que sans médiation particulière la visite revêtirait un aspect contraignant par l’attention et la concentration nécessaire à l’observation des œuvres (si différent de son environnement habituel).
La troisième maquette présente un aspect plus didactique au regard de l’histoire de la pièce où elle se situe : cette ancienne cuisine est baptisée « Gourmandise » dans le parcours de visite. Celle-ci est plutôt un « meuble tactile » avec plusieurs tiroirs à ouvrir de haut en bas et séparé en deux : la gauche éclairant sur la gastronomie « chez les riches », la droite celle « chez les pauvres ». Le tiroir le plus bas présente deux maquettes en relief illustrant deux scènes de repas. La lecture du cartel incite à découvrir successivement les tiroirs afin de toucher et décrypter les différents objets : porcelaine, fruits de mer, légumes… Le toucher est confronté à l’aspect des matières : lisse, rugueux, chaud, froid etc., ce qui participe à l’apprentissage des différentes perceptions. Cette maquette tactile ramène à la réalité en réajustant la thématique abordée à la réalité du quotidien. Enfin, la dernière apporte et révèle une plus-value du discours véhiculé par le musée. C’est ainsi que celle représentée par la photographie ci-dessus invite plutôt les visiteurs à s’imprégner des us et coutumes flamands : la tradition spécifique, le carnaval et de surcroît celui de Cassel. Cette création comportant des pièces mobiles évoque l’ambiance et l’énergie de la fête avec la foule, les danseurs et l’identification d’un géant (Reuze Papa), élément reconnu du patrimoine cassellois. L’esprit du carnaval transparaît d’une manière innovante. Le nouvel élan du musée, incarné par la diffusion de ce type de médiation, met à jour un renouveau dans l’interaction avec l’art et les oeuvres, ouvrant alors d’autres perspectives d’expériences émotionnelles et/ou sensorielles.
A quand la généralisation de ces médiations dans les musées « traditionnels » pour démocratiser et favoriser l’accessibilité à l’art et principalement aux Beaux Arts, au plus grand nombre ?
Lucie Vallade

Ave BDvores !
Amateurs de Bandes dessinées, passionnés de l'Antiquité ou simples curieux : l'exposition Bulles d'Antiquité, le monde romain dans la B.D, est faite pour vous ! Le Forum antique de Bavay, musée archéologique du département du Nord nous offre une belle immersion du 2 février au 28 août 2012. Hommage à Jacques Martin et Gilles Chaillet, deux figures incontournables de la B.D, l'exposition est également l'occasion de comprendre la façon dont les professionnels de ce genre, scénaristes et dessinateurs, ont envisagé les différents aspects de la complexe société romaine.
© Droits réservés
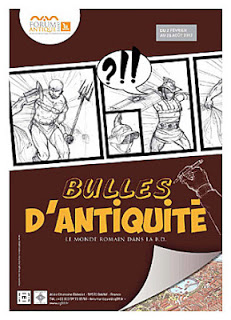 L'exposition s'organise en cinq espaces distincts délimités par de grands panneaux constituant des blocs, ainsi que par trois couleurs qui différencient les thèmes abordés ; le tout formant un carré de quatre parties reliées par une zone centrale. Les grands panneaux se dotent de vitrines incrustées, exposant des collections, qui permettent avant tout de créer des effets de profondeurs entre les diverses parties qui se coordonnent. Notre déambulation dans cet univers se réalise donc dans un espace ouvert où l'on ne se sent pas enfermés. Avec amusement, on peut remarquer que les panneaux s'assimilent à des planches de B.D : écriture noire sur fond blanc, encadrée de couleur rappelant les fameuses vignettes, et ils sont agrémentés d'anecdotes placées dans les incontournables bulles, marques de fabrication de ce genre littéraire à part entière.
L'exposition s'organise en cinq espaces distincts délimités par de grands panneaux constituant des blocs, ainsi que par trois couleurs qui différencient les thèmes abordés ; le tout formant un carré de quatre parties reliées par une zone centrale. Les grands panneaux se dotent de vitrines incrustées, exposant des collections, qui permettent avant tout de créer des effets de profondeurs entre les diverses parties qui se coordonnent. Notre déambulation dans cet univers se réalise donc dans un espace ouvert où l'on ne se sent pas enfermés. Avec amusement, on peut remarquer que les panneaux s'assimilent à des planches de B.D : écriture noire sur fond blanc, encadrée de couleur rappelant les fameuses vignettes, et ils sont agrémentés d'anecdotes placées dans les incontournables bulles, marques de fabrication de ce genre littéraire à part entière.
La première partie bleue constitue une introduction, présentant deux bandes dessinées phares sur l'Antiquité : Alix, première B.D à succès, et Astérix. Elle est aussi l'occasion d'exposer des livres anciens tels que les gravures d'Auguste Racinet ou encore des manuels scolaires et des couvertures de cahiers datant des années 50. La partie suivante en vert s'attarde sur les Gaulois. Utilisant Astérix comme point de départ, elle aborde des sujets divers comme leur nourriture, leur mode de vie et met à bas les préjugés concernant la moustache, la hutte, les druides et la magie, en nous dévoilant des Hommes tout à fait civilisés. Denier, ancienne monnaie grossie à la loupe, rhyton, corne à boire, ou encore maquette de maisons gauloises s'offrent à notre regard curieux. La couleur rouge illustrant les Romains ornent les deux parties suivantes. L'une dévoile à travers la B.D les thèmes de l'armée, des jeux du cirque et de l'amphithéâtre ou encore la religion, exposant ainsi diplômes militaires en bronze, trousseaux de toilette et d'impressionnants casques et poignards de Gladiateurs en provenance de Pompéi. La seconde se concentre sur l'Urbs, la ville ; la domus, la maison ; et la nécropole. Un immense plan de la ville de Rome composé de quatorze dessins originaux de Gilles Chaillet frappe par la complexité des nombreux détails. À la découverte de ce monde lointain couronné d'un univers de dessins et de bulles, on a presque envie de s'exclamer : « Ils sont fous ces Romains ! ». Pour finir, la partie centrale peut amuser petits et grands grâce à des bancs et poufs qui poussent à s'installer confortablement afin de se plonger dans les bandes dessinées mises à disposition. C'est également l'opportunité d'expliquer la fabrication d'une B.D, notamment grâce à une table à dessin exposant des planches en cours, originales et inédites d’Arelate. Par ailleurs, un reportage du dessinateur Gilles Chaillet défile. Bien évidemment, tout au long des différents espaces, planches et bandes dessinées d'époque sont exposées.
Par ailleurs, plusieurs activités et journées ont été organisées autour de l'exposition ; ainsi, conférences, journées gratuites telles qu'Archéo'culte avec entre autres dédicaces de B.D et montgolfière à l'effigie d'Obélix, ou encore Ciné-Forum où l'on peut assister à une séance plein air parmi les vestiges antiques, de même que des stages pour le jeune public s'inspirent de la B.D pour notre plus grand plaisir.
Néanmoins, l'exposition comporte quelques défauts non négligeables. Trop de texte tue le texte, aurait-on envie de dire... Même si les thèmes abordés sont particulièrement intéressants, lire l'ensemble est impossible et l'on finit par survoler, ce qui est dommage. De même, certains termes employés sont parfois très compliqués et supposent un temps de « décodage ». En outre, le reportage dure quinze minutes, ce qui est beaucoup trop long. Arrivant au milieu, il est difficile de s'y intéresser, et qui aurait la patience d'attendre ou de jeter un coup d’œil régulièrement pour le reprendre au début ? De tels constats en induisent un autre : ce n'est pas destiné aux enfants ! Il aurait été judicieux de leur consacrer une partie, quand on sait à quel point le jeune public apprécie ce genre littéraire.
Toutefois, cette exposition n'en reste pas moins agréable et instructive. En effet, on apprend beaucoup de celle-ci, avant tout pédagogique, aussi bien sur l'univers de la bande dessinée que sur les modes de vie gauloise et romaine ; en contraste avec le côté « douillet » des poufs qui offrent un temps de pause appréciable. En outre, elle présente une très belle collection d'objets particulièrement remarquables et fascinants. Qui plus est, les tarifs relativement faibles de 5€, 3€ pour les tarifs réduits et gratuit pour les moins de 18 ans, billet comprenant l'accès à l'ensemble des activités proposées, - expositions permanente et temporaire, site archéologique, film 3D et visites guidées individuelles -, ne constitue pas un obstacle à la découverte de cette petite exposition fort sympathique. Les plus férus se régaleront et comme le dit si bien un professionnel du milieu : « Quand l'appétit va, tout va ! ».
Lucile TALLON
Brève de stage : Dans la ville. Architecture et "cartels ambulants"
En première année du Master Expo-Muséographie j’ai effectué mon stage à la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes à Lyon. J’y occupais le poste de chargée d’exposition mais participais également aux autres projets de la structure. Par exemple, j’ai eu en charge de rédiger quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole, version 2014. Avant de détailler plus en avant cette mission, voici quelques éléments de contexte…

Crédits : Archipel CDCU
En perpétuelle transformation, les villes se sont construites au fil des siècles et recèlent de vrais trésors d’architecture. Les édifices composent notre cadre de vie et définissent nos modes d’habiter, de se déplacer, voire nos rapports sociaux. Chaque ville possède son caractère et tire une partie de son identité dans son architecture. Ou plutôt ses architectures, puisque de la période antique à nos jours en passant par la Renaissance, des milliers d’édifices se juxtaposent et interagissent entre eux. Ils forment une collection impressionnante racontant l’histoire des villes comme celle des hommes. De véritables musées à ciel ouvert… Si les musées possèdent leurs propres outils de médiation, qu’en est-il pour les villes ?
Il existe des lieux comme les Maisons de l’Architecture qui ont pour vocation de sensibiliser les publics à la culture architecturale. Chaque région à sa Maison de l’Architecture, chacune organise des expositions, des conférences, des ateliers afin de diffuser le plus largement possible et sous différents modes, les savoirs et les enjeux actuels de l’architecture.
La Maison de l’Architecture Rhône-Alpes, aussi appelée Archipel Centre de Culture Urbaine, offre aux publics plusieurs formes de médiation, susceptibles de parler au plus grand nombre. Elle est située place des Terreaux, en plein centre de Lyon, on peut notamment y admirer la maquette au 1/1000° de la ville de Lyon. Actuellement, Archipel met à l’honneur les meilleurs Projets de Fin d'Etudes 2013 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon à travers l'exposition Futur Architecte. Si maquette et photographie sont des outils de médiation incontournables lorsqu’on parle d’architecture, il en existe un autre : le texte.
Logements, quartier Confluence E. Colboc, architecte. ©www.emanuelle-colboc.com
Lors de mon stage, j’ai donc eu en charge la rédaction de quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole. Cette application, présente les constructions du XXèmeet XXIème siècle du Grand Lyon. Véritables « cartels ambulants » les notices jouent donc le même rôle que les cartels de musée : donner des informations sur « l’objet » que l’on a en face de soi. Ainsi le promeneur-visiteur peut déambuler au gré de ses envies à travers la ville contemporaine et se constituer un parcours inédit dans cette riche collection. La plupart de sédifices dont j’ai rédigé les notices se situent dans le nouveau quartier Confluence, comme le groupe scolaire Germaine Tillion.
Voici un exemple de notice :
Groupe Scolaire Germaine Tillion
Rue Casimir Périer, rue Denuzière 69002 Lyon
Livraison : 2013
Architectes : Bernard Garbit & Jean-Pierre Blondeau
Maître d’ouvrage : Ville de Lyon
Groupe scolaire Germaine Tillion - Garbit et Blondeau architectes ©www.pss-archi.eu
L’écriture de ces cartels n’est pas chose aisée…Délivrer un message clair avec un maximum d’informations et ce, avec peu de mots (600 signes), relève du défi ! Mais tout l’intérêt est bien là. Il s’agit de transmettre un message court comportant les informations essentielles concernant l’édifice. La consigne est d’être le plus neutre possible, le lecteur n’a que faire de mon propre ressenti… Attirer son attention sur un détail d’architecture, sur la position urbaine du bâtiment, sur les matériaux de construction sont autant de manières de parler de l’édifice, et par là même, d’architecture au sens large. C’est donc important de bien choisir ses mots, et de bien construire son discours.
Ainsi, cette première expérience d’écriture est-elle très formatrice et également très agréable. En effet, se promener dans les rues de Lyon, à la découverte de ces nouvelles présences architecturales dans la collection architecturale de la ville Rhodanienne, est un réel délice.
CI
Pour en savoir plus :- Lien vers le site d'Archipel CDCU- L'application Archiguide-Lyon
#archipelcdcu
#architecturecontemporaine
#cartel
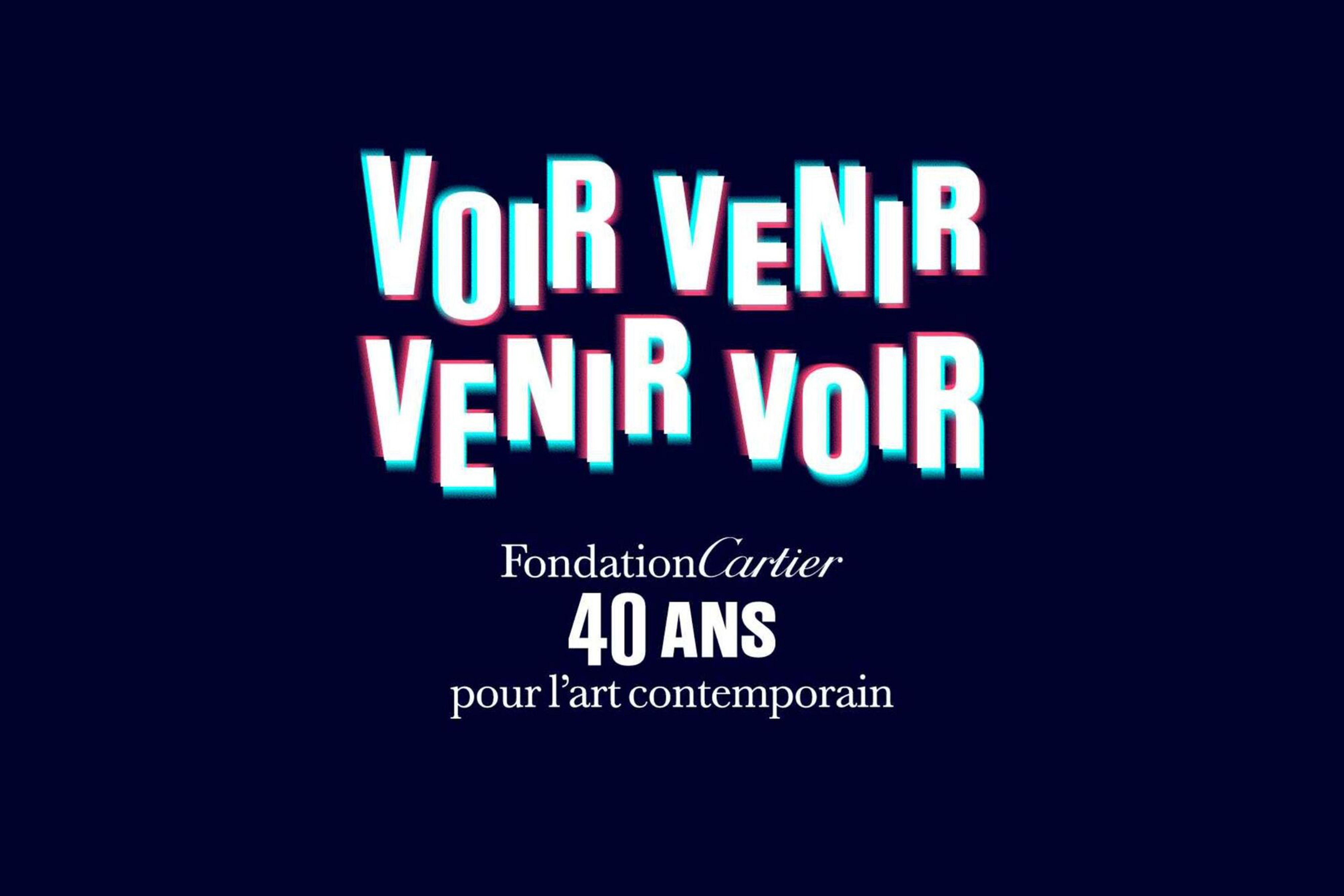
ÇA DÉMÉNAGE ! La Fondation Cartier fête ses 40 ans.
La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain dévoile son futur lieu d’exposition à l’occasion de ses quarante ans et accompagne cet anniversaire d’un podcast qui retrace son histoire : “Voir Venir, Venir Voir”.
La Fondation fête ses 40 ans
A ses débuts en 1984, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, créée par la Maison Cartier et dirigée par l’un de ses fondateurs Alain Dominique Perrin, s’installe au sein du domaine du Montcel, en région parisienne. Elle occupe ce site pendant dix ans avant de déménager dans le sud de Paris, entre le jardin du Luxembourg et Denfert-Rochereau, dans le 14ème arrondissement. A l’image de son premier lieu d’accueil, les locaux actuels se trouvent au sein d’un parc urbain, où l’architecture et les espaces d’expositions dialoguent avec le paysage. En retrait depuis la rue, à la manière d’un squelette de verre et de métal, le bâtiment du boulevard Raspail est rapidement devenu emblématique de l’image de la Fondation : un bâtiment contemporain qui se détache de l’architecture haussmannienne du boulevard, à l’image des œuvres qu’il accueille.
 Le bâtiment de Jean Nouvel pour la Fondation Cartier, boulevard Raspail, Paris.
Le bâtiment de Jean Nouvel pour la Fondation Cartier, boulevard Raspail, Paris.
A gauche : Vue extérieure, Photo ©CT. A droite : Vue intérieure, Photo ©CT.
A l’occasion des 40 ans de sa création, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain a décidé de marquer le coup, en changeant de décor. Actuellement situé au 261 Boulevard Raspail, le bâtiment de la rive gauche parisienne n’accueillera bientôt plus d’expositions, en raison de sa superficie devenue trop restreinte pour les ambitions futures de la Fondation. Elles vont désormais prendre place dans le cœur de la capitale, à proximité du Louvre, du Musée des Arts Décoratifs, de la Bourse du Commerce Pinault et de la Bibliothèque Nationale de France. Entre la rue de Rivoli et le Palais Royal, un ancien immeuble Haussmannien reconverti par l’architecte Jean Nouvel deviendra le nouveau terrain de jeu de la Fondation, le tout sur plus de 6500m² de surface d’exposition contre 1200 m² auparavant. L’actuel bâtiment du Boulevard Raspail, ayant accueilli l’American Center avant que la Fondation s’y installe, sera consacrée à des espaces de bureaux - dont une partie sera toujours réservée à l’entreprise Cartier.
40 ans d’expositions venues du monde entier, caractères singuliers et universels
Depuis sa création au milieu des années 1980, la Fondation Cartier a posé un regard à la fois singulier et universel sur l’art contemporain et les pratiques artistiques au sens large. Des dix premières années au domaine du Montcel de Jouy-en-Josas aux trente suivantes Boulevard Raspail, la Fondation Cartier offre aux artistes venant de tout horizon de la scène contemporaine la possibilité de rassembler leurs œuvres à travers des expositions sensibles et inédites, tout en leur permettant de se produire in-situ. Peinture, sculpture, tissage, collage, photographie, vidéo, design, paysage, ou même recherches mathématiques, scientifique ou domaine automobile, nombre des secteurs de la culture contemporaine sont représentés à travers les expositions de la Fondation Cartier. Un des objectifs est d’élargir les points de vues sur l’art contemporain et sa définition, sa caractérisation.
Au-delà de varier les médias et les médiums, une autre volonté de la Fondation est d’ouvrir les frontières aux pratiques artistiques internationales. Il est alors question de varier les styles, les types, les genres mais également les origines. Le panorama d’artistes de cette programmation est international, permettant de faire rayonner cette diversité à l’échelle nationale. Le tout premier artiste à avoir collaboré avec la Fondation est le sculpteur César, déjà reconnu à l’époque, aux côtés de deux artistes montant, Julian Opie et Lisa Milroy. Après eux se sont succédé de multiples artistes aux langages variés, parmi lesquels : Jean Tinguely, Agnes Varda, Ron Mueck, Patti Smith, Chuck Close, Junya Ishigami, Enzo Ferrari, Jean-Paul Gaultier, Bill Viola, Andy Warhol, Ron Arad, Issey Miyake, Claudia Andujar, David Lynch, Sarah Sze ou encore Bijoy Jain à travers le travail de Studio Mumbai, et tant d’autres…Elle clotûre ce chapitre avec une rétrospective sur l’artiste colombienne Olga de Amaral.
Cette diversité de fond et de forme fait la richesse de la Fondation depuis sa création. Chaque exposition est l’occasion de plonger le public dans un univers artistique unique. Après quarante années de création d’expositions et de programmation culturelle, les mêmes notions animent la Fondation et questionnent le visiteur : comment se réinventer perpétuellement en élargissant sans cesse le spectre de l’art contemporain, comment établir autrement les relations, aussi bien avec ce qui nous est familier qu’avec ce qui ne l’est pas et comment rester profondément inventif, ouvert d’esprit, curieux et libre ?
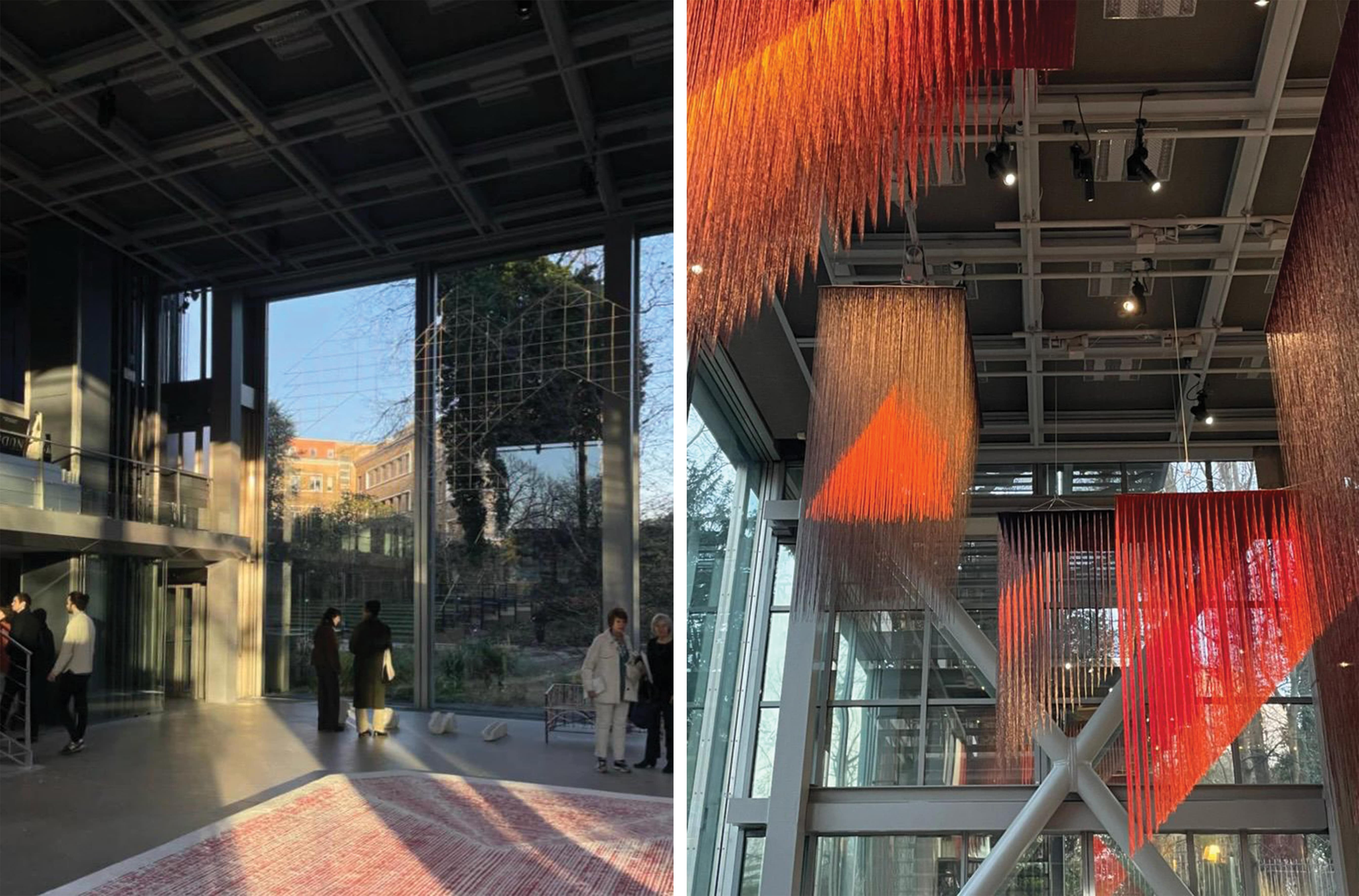 Deux des dernières expositions de la Fondation Cartier : Studio Mumbai et Olga de Amaral.
Deux des dernières expositions de la Fondation Cartier : Studio Mumbai et Olga de Amaral.
Photographies © CT
Une programmation culturelle pour rétrospective
Pour amorcer progressivement son changement de lieu, la Fondation propose une programmation culturelle qui permet au public de se replonger dans les moments phares de son histoire et ce, depuis sa création. Parmi ces propositions, un ouvrage retrace en images ces quarante ans de programmation et d’expositions, une installation photographique sur les futures façades de la rue de Rivoli met en avant les artistes ayant collaboré avec la Fondation, mais aussi un podcast de six épisodes raconte sa genèse, ses événements marquants, ses expositions majeures, le tout à travers des anecdotes inédites narrées par les fondateurs, les équipes, les artistes, archivistes, amis, mécènes, qui ont contribué à construire cette histoire. Une manière insolite et accessible d’offrir aux auditeurs un large panorama de sa production culturelle, de son fonctionnement et de ses engagements durant ces quarante dernières années.
#1 “Créer des expositions comme on crée une œuvre d’art”
Le premier épisode présente la genèse de la Fondation et ses objectifs dès ses débuts. A travers les paroles des personnes qui ont contribué à sa création, ses ambitions premières nous sont dévoilées : élaborer une programmation culturelle sans contrainte, aller au-delà de l’exposition elle-même, prolonger l’impact de l’art par-delà les murs de la Fondation, concevoir un lieu de création vivante, valoriser et promouvoir le travail d’artistes contemporains de tous horizons, connus et moins connus, tisser une relation pérenne entre artistes, commanditaires, critique et public, engager tous les acteurs qui gravitent autour de cette discipline.
#2 “Rendre à César ce qui lui appartient”
Au cours du deuxième épisode, les narrateurs lèvent le voile sur le contexte politique dans lequel la Fondation Cartier a vu le jour dans les années 1980 et le regard qui était posé sur l'art contemporain à cette époque. Les fondateurs expliquent la manière dont s’est construite la Fondation d’un point de vue entrepreneurial et comment cette méthode a pu permettre une plus grande souplesse dans la mise en place des expositions, le choix des artistes, les partis-pris muséographiques. A ce stade, il restait encore beaucoup à faire : trouver le lieu, choisir l’architecte, imaginer les premières expositions, prévoir la programmation, rencontrer les artistes, débloquer des financements…
#3 “C’est pas mal d’être un mécène”
Dans cet épisode, il est question de mettre en évidence le rôle du mécénat et son importance dans la production artistique contemporaine, et principalement dans le cas des fondations privées. L’objectif premier est de valoriser les artistes et faire reconnaître leurs œuvres - comme c’est déjà le cas pour les sportifs à l’époque, tout en dédiabolisant le regard posé sur l’argent et les financements. Cette prise de conscience s’amorce en comparant le fonctionnement à l’étranger et la pratique en France. Grâce à la régularisation et au développement du mécénat, la Fondation peut financer la production des artistes, acquérir leurs œuvres et débuter une collection propre, aménager le lieu pour les accueillir en résidence, organiser des événements pour promouvoir leur travail…
#4 ”Ma non sono morte, pourquoi voulez-vous faire une rétrospective ?
Le quatrième épisode de ce podcast aborde la création et l'expérimentation à travers les expositions. Comment traiter ce qui n’a jamais été traité, comment faire voyager le public vers un ailleurs, comment transcender les frontières en explorant toutes les zones de créations même à l’extérieur du domaine dit “artistique” ? Au fil des années, la Fondation tente de montrer et d’assumer pleinement que les limites de l’art vont au-delà de celles imposées et que les expositions ne sont pas faites pour plaire mais pour oser et marquer les esprits. Cela passe notamment par le fait d’être reconnu comme une institution muséale qui se transforme et se renouvelle sans cesse. La Fondation Cartier possède une collection qui réunit près de 4000 œuvres, réalisées par plus de 500 artistes du monde entier.
#5 “Aller voir ailleurs, et faire le mur toujours”
Cet avant-dernier épisode replonge les auditeurs dans les débuts de la Fondation et aborde le rapport étroit qu'entretient le contenu avec son contenant, c’est-à-dire les œuvres avec l’architecture qui les accueille. A travers les témoignages de l’architecte en charge du projet - aussi bien au domaine du Montcel que sur le boulevard Raspail, les grands enjeux sont explicités : valoriser le rapport au paysage, laisser la nature dominer le lieu, créer un jeu de transparence entre l’intérieur et l'extérieur, offrir un espace de liberté aux artistes, telle une toile vierge pour chaque installation, permettre de réinventer et reconfigurer indéfiniment l’espace, donner une dimension neutre, universelle et intemporelle au lieu…
#6 “Une Fondation, pas une institution”
Dans cet ultime épisode, l’ensemble des sujets traités tout au long de la narration sont de nouveau abordés, de manière à clôturer l’aventure. Après quarante années de fonctionnement, la Fondation souhaite continuer de mettre en avant un panorama éclectique et international de l’art, dans sa définition la plus large, de travailler à l’image d’un écosystème à échelle rapprochée, entretenant toujours un lien étroit avec les artistes et le public, en tentant d’inspirer et d'interroger sur les pratiques et les enjeux contemporains de nos sociétés.
Vers une altérité : des origines et un avenir controversés ?
La Fondation, pour célébrer cet anniversaire, établit un bilan que l’on pourrait considérer comme doré, de ce que furent ces quarante premières années d’activités Cela ne peut empêcher de poser la question de la subjectivité et parfois même, susciter la controverse. Ce vaste empire du monde de l’art dans le secteur privé est un des premiers en son genre en France. A l’époque où ses fondateurs mettent en place cette nouvelle activité, les fondations françaises que l’on connaît aujourd’hui telles que la Fondation Louis Vuitton, créée en 2014 ou la Fondation Carmignac, créée en 2000, n’ont pas encore vu le jour. En revanche, aux Etats-Unis, des Fondations privées telles que la Fondation Solomon R. Guggenheim ou encore la J. Paul Getty Trust existent depuis plusieurs décennies, puisqu’elles sont respectivement fondées en 1937 et 1953.
Malgré tout, se pose encore aujourd'hui de nombreuses questions en termes de consommation de l’art contemporain, la manière dont on le présente, dont on communique ou dont on capitalise sur sa diffusion. Quel rôle doivent jouer les fondations privées dans cet accompagnement et comment une médiation culturelle adaptée trouve-t-elle sa place entre profit et valorisation ? S’agit-il d’une affaire de business ou d’une volonté de mettre à la portée de tous l’infini spectre de la création contemporaine ? Quelles sont les dérives du secteur privé et les leviers qui peuvent être mis en place à l’avenir pour sortir d’un modèle basé sur des principes avant tout économiques ?
En tant que pionnière dans le domaine, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain doit relever ces nouveaux défis avec attention. Dès sa création, elle a permis de donner les voix aux artistes de leur époque, d’une manière qui n’avait jamais existé auparavant, tout en ouvrant la voie à une nouvelle approche du monde de l’art. Elle écrit aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire, et doit veiller à trouver un équilibre entre tous ces différents enjeux.
 Future façade de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Place du Palais Royal.
Future façade de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Place du Palais Royal.
Photographie ©CT
Clotilde TROLET
#fondation #architecture #art #contemporain #programmation #podcast
Pour en savoir plus :
- L’Histoire continue Place du Palais Royal : https://www.fondationcartier.com/histoire-mission/fondation-40-ans
- Le podcast “Venir voir, Voir venir” : https://open.spotify.com/show/2ZJ6hggaOteJhpkhhuFjrK?si=893b1a8e10e54fe4
- L’ouvrage “Venir voir, Voir venir” : https://www.fondationcartier.com/editions/voir-venir-venir-voir
- Les archives des expositions de la Fondation Cartier : https://www.fondationcartier.com/expositions/archive
Pour aller plus loin :
- Podcast “Le Bruit de l’Art” : https://open.spotify.com/show/2xWZTl71Pxfu6kArEpilmm?si=eda45e192a8e4c9e
- Podcast “Visites d’expos” : https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/podcasts-visites-dexpos
- Podcast “L’Amour de l’Art” : https://open.spotify.com/show/5ynCdvIjnQQyZr0Kmi08K2?si=22541a3f492b4695
- Podcast “ça a commencé comme ça” : https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/ca-commence-comme-ca
- Les podcasts du MAM : https://www.mam.paris.fr/fr/les-podcasts-du-mam

Charles Baudelaire et Constantin Guy, Le peintre de la vie moderne Le nouvel accrochage du musée d’Orsay, entre chronique du XIXème siècle et modernité de l’art
Si vous entrez dans le Musée d’Orsay, que vous choisissez de partir vers la gauche après le contrôle des billets et d’emprunter un escalier menant aux étages, alors vous aurez peut-être la chance de passer dans la petite salle 41. Dissimulée dans le dédale des autres espaces du musée, elle présente un accrochage passionnant : Charles Baudelaire et Constantin Guys. Le peintre de la vie moderne.
Image de couverture : Photographie de la salle d’accrochage, ©JR
Le parti-pris est de mettre en parallèle les dessins du peintre Constantin Guys (1802 – 1892) , et l’essai de Charles Baudelaire Le Peintre de la vie moderne, inspiré des œuvres de Constantin Guys que l’écrivain tenait en haute estime. L’essai questionne les notions d’Art, de Beau et de Modernité. La modernité est un concept défini par Baudelaire en son temps, qui lui donne ses lettres de noblesse, et qui est le premier à évoquer l’idée d’un art contemporain. « La modernité, c'est le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable » écrit-il dans Le Peintre de la vie moderne. Il s’agit alors aussi d’extraire de la mode ce qui est éternel, ce qui mérite de rester à la postérité. Dans son podcast intitulé « Un été avec Baudelaire », publié sur France Inter en août 2014, Antoine Compagnon, spécialiste du poète, explique : « Toute beauté, dit-il, est double, et la modernité est à présent assimilée à son élément transitoire, fugitif ou contingent, par opposition à son élément éternel et immuable. D’une phrase à l’autre, la modernité désignerait donc à la fois ce qu’il y a d’impérissable et ce qu’il y a de périssable dans le présent.» La modernité, une notion bien difficile à saisir, parcourt toute l’œuvre baudelairienne, et trouve sa définition dans Le Peintre de la vie moderne, comme cela est montré à travers l’accrochage du musée d’Orsay.
Peintre méconnu, dont la notoriété, acquise grâce à Baudelaire, s’est éteinte aussi rapidement qu’elle est arrivée, Constantin Guys est un dessinateur de talent, et un remarquable observateur de son époque. L’accrochage dont il fait l’objet met en regard sa vision de ses contemporains avec l’écriture, et quelques dessins, de Charles Baudelaire.
Avant de laisser la place à l’échange avec Géraldine Masson, commissaire de l’accrochage quelques lignes pour contextualiser les autres illustres de cette exposition :
Jeanne Duval (1820 – 1862) fut la muse et amante de Baudelaire. Elle lui inspire La Chevelure, poème des Fleurs du mal.
« Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure !
Ô boucles ! Ô parfum chargé de nonchaloir !
Extase ! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure
Des souvenirs dormant dans cette chevelure,
Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir ! … »
Femme métisse et libre dans le Paris du XIXème siècle, elle vécut une vie sulfureuse aux côtés des plus grands artistes de son temps.

Charles Baudelaire, Portrait de femme à mi-corps, de face, largement décolletée ou Portrait de Jeanne Duval à mi-corps, vers 1855, ©JR
Etienne Moreau-Nélaton (1859 – 1927) était un artiste, collectionneur et historien de l’artart français, grand donateur du Musée d’Orsay.
Echange avec Géraldine Masson, commissaire de l’accrochage « Charles Baudelaire et Constantin Guys. Le peintre de la vie moderne ».
JR : Pourriez-vous vous présenter ?
GM : je suis historienne de formation. Au musée, je suis collaboratrice scientifique au département des arts graphiques. Cela équivaut à un poste d’attaché de conservation. Mon travail consiste à suivre les campagnes de restauration, à faire des recherches sur les dessins de nos collections ainsi qu’à organiser des accrochages en partenariat avec les restaurateurs et la régie.
La présentation des dessins est dépendante de la fragilité des œuvres graphiques et de leur sensiblité à la lumière. Ils ne peuvent être exposées plus de trois mois tous les trois ans. Par exemple, deux portraits différents de Jeanne Duval ont été exposés pour cet accrochage. Le changement a été opéré le 5 décembre dernier, en raison des contraintes de l’exposition des dessins.
Nous exposons donc nos collections permanentes par rotation. Pour cela, nous restaurons à chaque fois un fonds qui est ensuite valorisé par un accrochage.
JR : Pourriez-vous évoquer la genèse de l’exposition ?
GM : Orsay célèbre le bicentenaire de la naissance de Baudelaire avec différentes manifestations. Le musée est aussi en partenariat avec l’exposition de la Bibliothèque nationale de France « Baudelaire, la modernité mélancolique »à laquelle il a prêté nos 3 autoportraits du poète. On lui connait 40 dessins.
Guys lui, était exclusivement dessinateur, pas peintre. Sa notoriété, il l’a acquise grâce à Baudelaire, mais elle est très vite retombée. 66 de ses œuvres se trouvent dans nos collections.
Dans la première section, j’ai voulu montrer les prestigieuses provenances de ces dessins. Les collections dont il est issu sont pour certaines d’entre elles, illustres ! Constantin Guys a accédé à la notoriété grâce à Baudelaire, nous avons un dessin qui a appartenu à Théophile Gaultier, ami du poète et critique d’art. C’est Nadar qui a mis les deux artistes en relation, il y a donc un dessin qui lui appartenait.
Le fonds est aussi issu d’une deuxième génération de collectionneurs qui sont des historiens de l’art, Claude Roger Mars, Etienne Moreau-Nélaton, Ce dernier avait une collection de dessins, qui lui servait à étayer son propos d’historien de l’art.

Constantin Guys, Napoléon III à cheval passant une revue, vers 1855-1860, œuvre faisant partie du don Claude-Roger Marx ainsi qu’on peut le voir en bas du cadre, ©JR
JR : Qu’est-ce qui vous a intéressée dans ce sujet ?
GM : Baudelaire s’est directement inspiré des dessins de Guys pour construire ses catégories du Peintre de la vie moderne. Il est donc intéressant de voir la modernité dans cet accrochage, de saisir ce que l’on retient du XIXème siècle et du Second Empire.
Ce sujet permet aussi de questionner son rapport à l’art, à l’utilité de l’art, au Beau. Pour Baudelaire, le beau était forcément éloigné de l’état de nature, le produit d’un artifice. Par exemple, le maquillage était pour les femmes un artifice pour accéder à la beauté.
Un autre axe mis en valeur est le rapport à la littérature. Baudelaire écrit Le Peintre de la vie moderne entre 1859 et 1861, deux ans seulement après le procès des Fleurs du Mal. Il a été très blessé par ce procès, même s’il savait que son recueil allait être « comme une explosion de gaz chez un vitrier »1 selon ses propres mots. Mais il souhaitait vraiment qu’on reconnaisse son talent de poète. Il ne croyait jamais être censuré alors que Flaubert avait été acquitté pour Madame Bovary deux mois avant. Il faut savoir qu’à l’époque, on a arraché des pages du recueil, censurées lors du procès !
Le Peintre de la vie moderne, c’est l’expression de toute la pensée de critique d’art de Baudelaire, nourrie depuis ses critiques du Salon de 1845 et 1846. Mais c’est aussi un artiste qui décrit la même société en dessins que ce que lui dénonçait en vers un artiste qui place les prostituées et les bourgeois comme représentatifs des mœurs de l’époque du second Empire
JR : Ce sujet s’est-il imposé à vous dans le contexte de votre poste aux arts graphiques, lorsqu’il s’est agi de faire une exposition liée à Baudelaire ?
GM : Oui, car je voulais faire une exposition sur Baudelaire critique d’art. C’est lors de la présentation de nos dessins de Guys pour l’exposition « Splendeurs et misères des courtisanes, images de la prostitution, 1850-1910 » que j’ai découvert qu’il était le peintre de la vie moderne.
JR : A quels types de publics souhaitez-vous vous adresser avec cet accrochage ?
GM : Il est vraiment destiné à tous publics. L’accrochage est un peu caché et c’est dommage. Il se situe dans les espaces dévolus aux présentations des œuvres graphiques : photographies, dessins d’architecture et d’art décoratifs. C’est un projet qui a commencé avec Laurence Des Cars et qui se poursuit aujourd’hui sous la direction de Christophe Leribault : on voudrait présenter plus de dessins dans plusieurs salles du musée. Christophe Leribault est un conservateur arts graphiques, il a été directeur adjoint du Cabinet d’arts graphiques du musée du Louvre.
Pour cet accrochage, nous n’avons pas de publication.
JR : Selon vous, faut-il être connaisseur de Baudelaire pour apprécier l’accrochage ?
GM : Oui et non. uniquement la découverte de l’œuvre de Constantin C’est un reporter ; le terme était déjà utilisé à l’époque ; qui produisait dans un journal, The Illustrated London News. Il avait une très grande maitrise du lavis d’encre, qui est une technique extrêmement délicate pour laquelle aucune retouche est possible. Il avait aussi un regard très intéressant sur J’aimerais beaucoup poursuivre sur sa vision peu partagée à l’époque de l’Orient et de la guerre de Crimée.
Connaitre la poésie de Baudelaire donne cependant une autre lecture des dessins. Il y a beaucoup des Fleurs du mal et des correspondances entre les cinq sens dans l’œuvre de Guys : On a par exemple presque l’impression d’entendre le galop des chevaux, quand on regarde les dessins…
JR : Vous avez aussi fait le choix de mettre un cartel par œuvre ?

Un cartel pour chaque œuvre, ©JR
GM : Oui c’était le moyen de compenser le fait de ne pas avoir de publication. Cela me permet aussi d’expliquer beaucoup de choses et d’éviter une simple juxtaposition de dessins. C’est aussi une trace qui restera de l’exposition : nous faisons dans le service de la documentation des dossiers d’expositions et dans chaque dossier de chaque œuvre, nous mettrons le cartel.
JR : Y’a-t-il une œuvre qui vous a particulièrement marquée ?
GM : C’est difficile de n’en donner qu’une… La Passante, à côté du panneau de salle, représente bien le lien entre Baudelaire et Guys, mais aussi la femme du XIXème siècle, qui marche seule dans la rue et qui a donné vie à toute une littérature du fantasme de la fugitive.
Il y aussi La Veuve, qui m’a donné envie de faire une exposition sur les veuves. Pas quelque chose de sombre, mais quelque chose qui donnerait à voir cette autre figure littéraire du XIXe siècle, la femme libre de l’autorité du père et du mari. Nous avons de nombreux portraits dessinés de veuves dans notre collection.
Il y a aussi une prostituée, très belle, de dos, en peignoir. Elle a beaucoup de présence. C’est son peignoir qui prend tout l’espace. Elle est magnétique. »

Constantin Guys, Femme à la fenêtre, de dos, debout, en peignoir, ©JR
Si vous avez été séduit par le propos de cet accrochage, courrez à la salle 41 avant le 25 janvier !
1 Lettre à Auguste Poulet-Malassis du 29 avril 1859 : « Nouvelles Fleurs du mal faites. A tout casser, comme une explosion de gaz chez un vitrier. »
#accrochage #littérature #Muséed’Orsay

Charogne et trash animals, quand le dégoûtant devient sublime
La recette du succès version Bordalo II n’est pourtant pas très ragoutante : l’artiste utilise des déchets – plastiques notamment - pour fabriquer d’immenses animaux qu’il installe au cœur des villes. Il nous alerte ainsi sur les dangers que notre mode de consommation fait courir à la faune sauvage. La démarche – recycler nos déchets en œuvres d’art - a déjà fait ses preuves dans l’art contemporain : pensons, par exemple, aux immenses portraits réalisés par l’artiste Vik Muniz et les ramasseurs de déchets de la décharge Jardim Gramacho, près de Rio. Mais après tout, ces représentations de nos immondices - ou plus largement de l’immonde - existent depuis le début de l’histoire de l’art. Elles ont aussi marqué l’histoire littéraire, en particulier le 19e siècle. La plus célèbre sublimation littéraire de la laideur, du repoussant, reste sans doute le poème "Une Charogne" publié en 1857 par l’écrivain Charles Baudelaire.
Faut-il alors voir une parenté entre Baudelaire et Bordalo II ? Comment et sur quelles bases confronter le poète et le street artiste ?
Du chat qui grogne à la charogne
Imaginons. Vous êtes prof.e de lettres, à Calais. Vous êtes le genre de prof.e qui prend son métier un peu à cœur. Le genre qui se souvient qu’éduquer c’est d’abord émanciper. Le genre de prof.e qui compare les roman-feuilleton du 19e siècle aux threads de Twitter. Mais là, c’est la panne sèche. Vous avez été rattrapé par le Léviathan de l’éducation nationale, ce monstre avaleur d’imagination : le programme. Et le programme vous dit, en substance :
« Merci de sensibiliser de vos élèves aux Parnasse et à la poésie symboliste. Il est grand temps que vos jeunes disciples se plongent dans les Fleurs du Mal. »
Dans le fond, vous n’avez rien contre Baudelaire. Mais il faut bien avouer que le musc, les correspondances et le spleen, cela ne parle généralement pas trop aux ados. Vous avez bien essayé de faire venir un nez pour recréer l’ambiance olfactive de "La Chevelure" et évoquer l’engouement orientaliste de cette fin de 19e siècle mais le proviseur a mis un frein à vos ardeurs. A force, vos élèves vont être les privilégiés du bahut.
Dépité.e, vous décidez de vous changer les idées en allant faire une petite visite au Musée des beaux - arts. Ça tombe bien, l’exposition de street art Conquête urbaine vient d’ouvrir. A peine entrée, vous êtes saisi.e par une œuvre monumentale. C’est un chat qui grogne, en plastique et en tôles multicolores.

Le « Chat qui grogne » de Bordalo II au Musée des Beaux-arts de Calais, avant l'ouverture de l'exposition © Laurie Crozet
« Un chat qui grogne ? Tient c’est drôle, vous pensez, « chat qui grogne » ça sonne presque comme comme « charogne »…». Inspirée, vous sortez un petit carnet et vous y cherchez vos notes sur le poème "Une Charogne". En se penchant un peu sur votre épaule on peut lire :
« Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant […] »
- Dans le poème de Baudelaire, la charogne est sublimée car elle incarne une continuité de la vie à la mort et de la mort à la vie. La putréfaction est à la fois la fin d’une forme de vie et le commencement d’une autre. En transformant le cadavre en substance nourricière, Baudelaire établit un rapport de continuité entre l’animal et la nature.
« - Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !
Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés ! »
- La chute du poème, qui annonce la putréfaction future de son amante, qui fait d’elle une future charogne, replace l’homme dans un cycle naturel, rétablit une continuité entre l’homme et la nature.
Geste esthétique, geste politique
Vous restez longtemps, carnet à la main, devant l’œuvre de Bordalo II. Vous pensez. De retour chez vous, vous sortez un crayon, reprenez votre petit carnet et d’une seule traite, remplissez la page de droite.
Bordalo II crée une émotion esthétique en assemblant ce que notre société moderne produit de plus immonde, des tonnes de déchets plastiques. Par là il s’inscrit dans la même esthétique de la laideur que Baudelaire lorsqu’il dépeint une « charogne infâme ». Mais si la charogne du poète permettait d’entrevoir une continuité entre l’homme et la nature, une juste inscription de l’homme dans son écosystème, le chat du street artiste montre exactement l’inverse. Cet assemblage de plastique et de peinture témoigne d’un dérèglement de notre rapport à notre écosystème. Les sculptures géantes de Bordalo II dénoncent l’impact écologique de nos modes de consommation, en particulier sur la faune. Le plastique en décomposition, contrairement aux corps animaux et humains, ne se transforme pas en substance nourricière mais en poison pour les animaux qui l’ingèrent.
Le recyclage opéré par Bordalo est en définitive plus un geste politique qu’un geste esthétique ; nos déchets plastiques ne sauraient être sublimés car ils n’incarnent aucune continuité entre la vie et la mort ou entre l’animal, l’homme et la nature. Au contraire, ces œuvres montrent la suprématie que l’homme s’est arrogé sur son environnement et les conséquences funestes de ce dérèglement.
Sourire aux lèvres malgré cette conclusion tragique, vous levez votre crayon : on dirait que vous avez trouvé où et comment commencer votre séquence sur les Fleurs du Mal. Reste à convaincre votre proviseur qu’il n’y a pas que « les parfums, les couleurs et les sons »1 qui se répondent mais aussi les artistes, par-delà les médiums, les frontières et les siècles.
C.R.
1 - Charles Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal, 1857
A voir :
Conquête urbaine, street art au musée, Musée des beaux-arts de Calais, 06.04.19 – 03.11.19
A écouter :
#BordaloII
#Streetart
#Calais
Collections italiennes dans les musées français : Étude de cas, le Musée Jacquemart André
Fermé pendant plus d’un an pour des travaux de rénovation et de restauration, le Musée Jacquemart André rouvrait ses portes en septembre dernier avec une exposition temporaire bien particulière, Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse jusqu’au 6 février 2025.
Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse,
Musée Jacquemart André, Paris
© Culturespaces, Nicolas Héron
Les prémisses du musée Jacquemart-André
Histoire des collections du Musée Jacquemart André : Nélie Jacquemart, une collectionneuse affamée

Vierge à l’enfant
Sandro Botticelli (1444 - 1510)
1470, tempera sur bois, 62 x 48 cm
Salle florentine, Musée Jacquemart André, Paris
© LS
Un “musée italien” au cœur de Paris

Salle Vénitienne,
Musée italien,
© Musée Jacquemart André, Paris.
Une histoire de l’Italie narrée par les expositions temporaires

Léda,
Léonard de Vinci (d’après), vers 1510-1520,
tempera sur panneau, 115 x 86 cm,
Galleria Borghese, Rome.
© Galleria Borghese / ph. Mauro Coen
Pour en savoir plus :
CONTRE TEMPS / Le Bureau du dessin
Le Bureau du dessin est un événement réunissant les écoles d'art du Grand Est : l'ESAL (Metz-Epinal), l'ENSAD (Nancy), la HEAR (Strasbourg-Mulhouse) et l'ESAD (Reims).
5 étudiants sont sélectionnés en novembre dans chaque école et se rencontrent pendant une semaine de workshop intensif où ils produisent des projets qui questionnent les formes multiples du dessin et ses modalités d'exposition.

Affiche de l'exposition
Une exposition est ensuite montée par les étudiants dans un lieu proche de l'école organisatrice ou dans l'école en question ( par exemple «et inversement... » s’est tenu dans la Galerie Namima del'ENSAD, Campus Artem, Nancy)
Pour cette édition 2017, c'est à Reims que cela se passe, au cœur du musée historique Saint-Remi.
Pour saisir le point de vue d'un jeune artiste, allons à la rencontre de Simon Deburck, étudiant à l'ENSAD, et Cécile Pétry, étudiante àl'ENSAD également, pour l'exposition Contre Temps qui s'est déroulé du 18 novembre 2017 au 8 décembre 2017.
Début de l'interview
Charlène : Quel est la problématique de cette édition 2017 de l'exposition Contre Temps ?
Simon : Cette édition a lieu dans le musée Saint-Remi de Reims et la problématique Contre Temps y est fortement liée. Le musée recense beaucoup d’œuvres et de pièces de différentes époques relatant l'histoire de Reims. Cela va du Mérovingien aux années 1900. Je pense que les mots "Contre Temps" montrent parfaitement cette étendue d'histoire concentrée en un seul lieu, le musée Saint-Remi.
 © ESAD Reims, vue de l'exposition
© ESAD Reims, vue de l'exposition
Comment as-tu abordé cette thématique ? Peux-tu nous expliquer ton projet ?
Étant donné l'écart chronologique dans le musée et la disparité des œuvres, j'ai voulu créer un personnage de bande dessinée immortel qui aurait eu une histoire, un lien avec tous ces objets.
 © Simon Deburck, « Les aventures de John l'Immortel »
© Simon Deburck, « Les aventures de John l'Immortel »
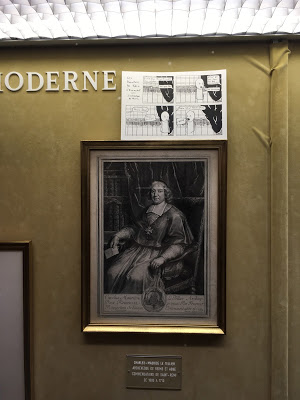 © Bureau du dessin, Vue rapprochée d'une vitrine
© Bureau du dessin, Vue rapprochée d'une vitrine
Comment s’est déroulé la préparation à l'exposition ?
Le lundi 13 novembre, nous sommes allés au musée vers 15h. Puis nous étions lâchés pour le visiter. Nous avions jusqu'à 16h pour trouver une idée de projet. De 16h à 18h, grande réunion pour présenter nos projets. Le lendemain matin, de 9h à 12h, nous devions trouver les dispositifs d'accrochage. Pour ce musée classé, nous devions trouver des alternatives différentes en fonction des lieux d'accrochages et des projets. Ensuite, lemardi de 14h à 18h, Le mercredi et jeudi toute la journée, j'ai créé mon projet. Et le vendredi, du matin jusqu'à 15h, nous avons accroché.
Quelles étaient ces alternatives d'accrochage ?
Par exemple, ne pas mettre de clous sur tous les murs et sur certains, on ne pouvait rien mettre. On a mis du double face. Pour accrocher le projet de Cécile Pétry (artiste de l'exposition), les professeurs ont mis des allumettes cassées dans des fissures du mur puis avec des épingles, ils ont planté le dessin dans les morceaux d'allumettes.
Quelest ton projet et quelles ont été les contraintes liées àl'accrochage ?
Cécile : Pour l'accrochage, mon dessin est dans la salle des arcs boutants. Onne pouvait rien utiliser (ni scotch, ni clous, ni patafix), il était seulement possible de se servir de ce qui était déjà en place. Avec Etienne Pressager (professeur à Nancy) nous avons vu des petites fissures dans le mur là où je voulais placer mon dessin, Etienne a proposé un système d'accrochage qui exploiterait ces fissures sans endommager le mur. On a finalement glissé des allumettes dans les fissures (après avoir mesuré et coupé la profondeur adéquate), puis dans ces allumettes nous avons fixé de petits clous qui tenaient le dessin ? C'est assez compliqué comme système, mais finalement l'accrochage est presque imperceptible et ça me plaît beaucoup.
Comment as-tu géré le fait que ce soit un bâtiment classé ?
Le fait que ce soit un bâtiment classé m'a influencé dans mon travail. C'était très stimulant, où qu'on aille il y avait deschoses extraordinaires et intéressantes qui en quelque sorte nous poussaient à faire de notre mieux. En même temps, la diversité des formes exposées, le lieu transformé (une abbaye en musée) nous autorisaient une certaine liberté d'interprétation.
 © Cécile Pétry, oeuvre enroulée
© Cécile Pétry, oeuvre enroulée
Charlène : Commentse passe le montage de l'exposition ?
Simon : Pour ma part, j'avais choisi les lieux où je placerai mes bandes dessinées. C'est pourquoi le mardi toute la matinée j'ai conversé avec la personne chargée de l'accrochage de l'exposition pour trouver des solutions. J'ai dû demander l'ouverture d'une vitrine pour pouvoir y placer une de mes planches. Et seule une personne du musée est autorisée à les ouvrir. Il y avait beaucoup de contrainte de ce type pour l'accrochage, ce qui nous forçait à y réfléchir en amont. Les enseignants sont présents pour nous aider lors des accrochages. Enfin, quand un étudiant avait fini d'accrocher son travail, il aidait les autres car nous avions peu de temps avant le vernissage.
 ©ESAD Reims, vue du montage de l'exposition
©ESAD Reims, vue du montage de l'exposition
Quelle médiation est prévue ?
Si je ne me trompe pas, ce sont des étudiants de Strasbourg qui ont créé la signalétique à l'aide d’autocollants colorés. Nous étions quelques étudiants à avoir un travail dispersé dans le musée, il fallait alors un moyen simple et efficace pour signaler les liens entres les productions. Le catalogue d'exposition se base également sur cette signalétique. Pour ce qui est de la médiation orale, nous avons expliqué à la personne chargée de la communication notre travail et elle s'est chargée de l'expliquer aux médiateurs du musée.
Est-ce que c'est ta première exposition ? Quelles sont tes opportunités d'exposer en tant que jeune artiste ?
C'est ma 4ème exposition. Étant en option Communication, je dois t'avouer que ce n'est pas un sujet auquel j'ai réfléchi. Ma première exposition, avec la classe entière, a eu lieu à Cholet grâce à la Prépa des beaux arts de Cholet dont j'ai fait partie. La seconde exposition a eu lieu durant ma première année avec le projet Cora qui est proposé chaque année à Nancy. La troisième est dû à Lina Hentgen (professeur à l'ENSAD) l'année dernière à la GhotHouse de Delme. Lina étant invitée pour exposer, elle a entraîné une quinzaine d'étudiants pour travailler avec elle. Avec du recul, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées que j'ai pu exposer. Je pense donc que se faire un réseau est un moyen d'avoir des opportunités d'expositions.
Dans quel musée aimerais-tu exposer ? Et quelles sont tes attentes en tant qu'artiste des lieux d'exposition ?
Je ne sais pas dans quel lieu d'exposition j'aimerais le plus exposer. Je ne suis pas contre les contraintes dans les lieux d'expositions. Le musée Saint-Remi en est la preuve, cela donne à réfléchir et nos productions peuvent évoluer ou prendre une tournure différentes grâce aux contrainte. J'ai souvenir d'un lieu d'exposition à Nantes du nom de Tripode où les murs sont noirs et inclinés, ce qui donne à réflexion pour un accrochage.
Fin de l'interview
Les rendez-vous du Bureau du dessin sont une occasion pour les étudiants, jeunes artistes, de monter une exposition où tout le déroulement est un processus inédit. Le workshop intensif permet de monter un projet en entier par rapport à la thématique en rapport avec le lieu, classé monument historique. Cela remet en cause les logiques d'accrochage et confronte les artistes à de nouvelles contraintes qui ne sont pas vues lors d'accrochage dans l'école. C'est uneoccasion d'apprendre avec les professeurs, habitués à exposer dansdivers lieux et à imaginer des astuces. Pendant l'accrochage, les étudiants apprennent aussi à manipuler des œuvres : utiliser des gants, les protéger et les stocker, les premiers rudiments de la régie d'exposition.
Si vous avez loupé cette édition, ne vous inquiétez pas Le Bureau du dessin remet le crayon l'année prochaine !
Charlène Camarella
http://www.tripode.fr/index.php?/2014/francois-lancien-guilberteau-vues-expositions/

COULEUR(S) : Immersion contemporaine
Thématique si récurrente de l’histoire des arts et donc des expositions d’art, la couleur est cette année omniprésente dans les programmations culturelles. Comment proposer une nouvelle perception pour une thématique si rebattue ?
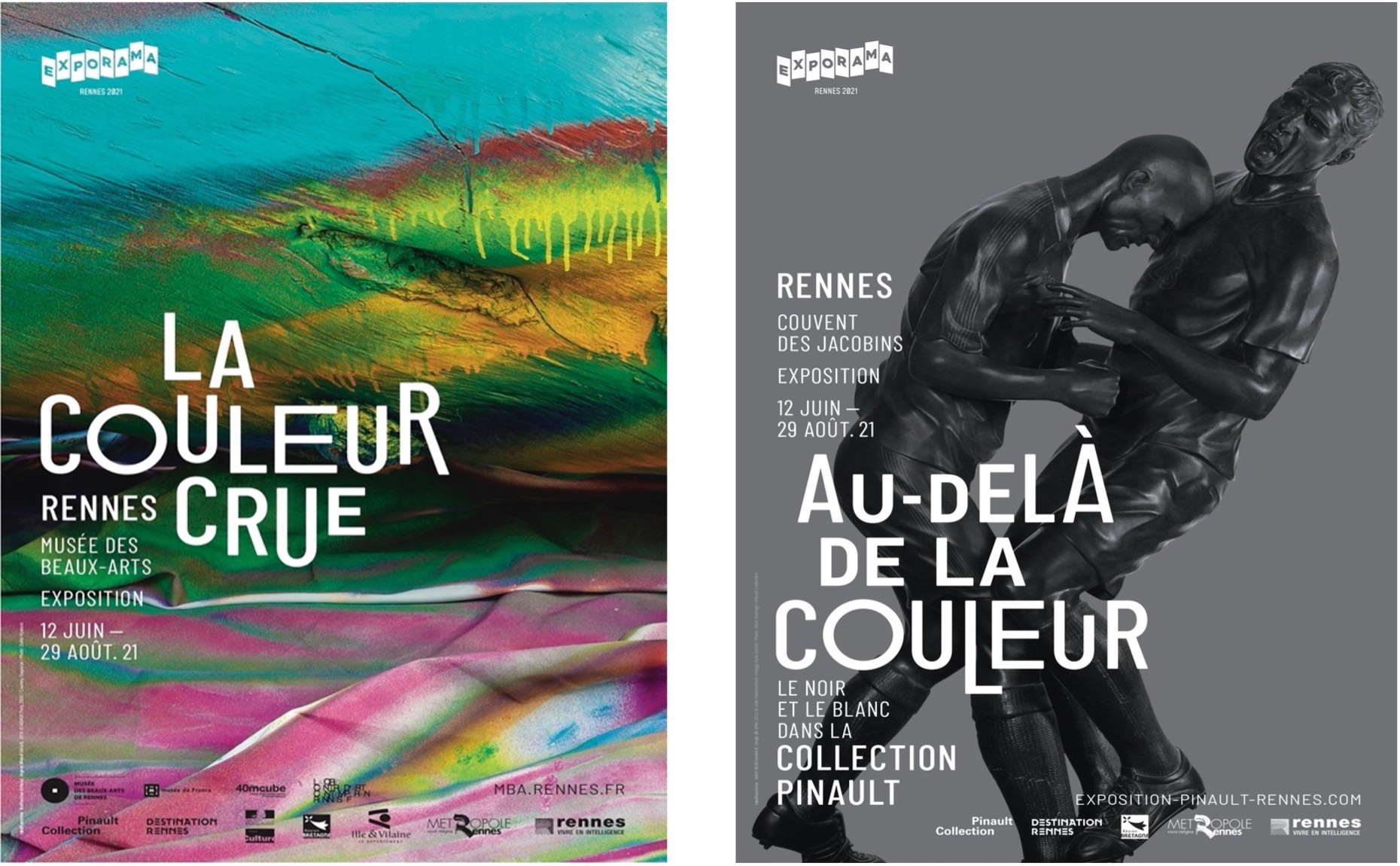
Affiches La Couleur Crue et Au-delà de la Couleur : Le Noir et le Blanc dans la collection Pinault ©MBA Rennes et Métropole Rennes
Quand je suis de passage à Rennes, une affiche d’exposition placardée sur tous les murs de la ville m’intrigue. C’est un aperçu de la collection Pinault au couvent des Jacobins. Le mot couleurs apparaît successivement sur les affiches. En parallèle de cette exposition, le musée des Beaux-Arts de Rennes propose une immersion dans la couleur crue.
Des expositions qui se répondent
Deux directions ont été prises dans ces expositions. La fondation Pinault propose un très grand parcours avec une découverte progressive du noir et du blanc, puis une rencontre de ces deux couleurs. La déambulation reste intime et personnelle avec les œuvres d’art. Le Musée des Beaux-Arts de Rennes propose quant à lui une expérience de la couleur, une immersion directe dans les pigments et à renfort d’œuvres interactives avec les visiteurs.
Créer des liens entre lieux culturels est essentiel et proposer deux expositions sur le même thème dans une même ville est très intéressant du point de vue expographique.
Chacune des expositions abordent la couleur à travers l’art d’une manière qui lui est propre. C’est tout l’intérêt d’une telle proposition. Les discours ne sont pas répétés mais se complètent. De plus, le livret de visite est pensé d’une manière commune, d’un côté l’exposition « Au-delà de la couleur. Le noir et le Blanc dans la collection Pinault », de l’autre « La couleur crue », ce qui peut inciter le visiteur à continuer sa visite dans l’autre lieu.
Si ces deux visites sont bien différentes par leur propos, un élément leur est commun : celui de l’expérience esthétique. Les œuvres sont convoquées pour faire vibrer nos émotions. Dans ces deux exemples, il ne s’agit pas de revenir sur l’histoire de la couleur ou de sa signification.
Ce sujet peut être perçu comme inépuisable, car il existe une multitude de perceptions, de pensées autour de la couleur.
Plusieurs éléments permettent de la revisiter : l’expérimentation, l’histoire, l’approche sensorielle et surtout le propos qui accompagne l’exposition. C’est à la fois laisser au visiteur le choix d’apprécier une couleur et d’approfondir sa perception par un propos.
Au delà de la couleur. Le noir et le blanc dans la collection Pinault
Dès l’entrée, la pluie d’or des fenêtres du couvent nous accueille. C’est l’affirmation d’une architecture moderne et épurée incrustée dans un lieu riche en histoire. Un véritable tour de force est proposé par la fondation Pinault, être visible dans deux villes françaises de manière simultanée à la fois à l’ouverture de la Bourse de commerce à Paris et à Rennes au couvent des jacobins.
« Le blanc et résulte du « mélange de toutes les couleurs » et le noir de leur absence. Pourtant, le blanc et le noir sont culturellement des couleurs, au même titre que le rouge, le bleu ou le jaune. Elles ont une histoire, elles véhiculent une mémoire. »
Texte du livret de l’exposition
L’exposition « Au-delà de la couleur. Le noir et le Blanc dans la collection Pinault » propose un éventail des œuvres collectionnées par François Pinault. Toutefois, les œuvres ne sont pas simplement posées pour qu’elles soient admirées, un réel questionnement autour du noir et du blanc accompagne le parcours.

Vues de l’exposition Au-delà de la couleur, Couvent des Jacobins ©Anaïs Vdx.
Le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, le titre l’affirme avec le « Au-delà de la couleur ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Noir et blanc questionnent notre rapport à la mort, au deuil, et aux images.
Le choix des œuvres d’art est également remarquable. Les couleurs se répondent tout au long de la mise en espace jusqu’au moindre détail des sols et des murs. Les deux couleurs sont en dialogue.
« Couleur Crue » au Musée des Beaux-Arts de Rennes
Autre exposition, autre proposition. C’est une Immersion instantanée dans la couleur. Le bleu, le rose, le jaune, le vert, que composent les deux œuvres de Flora Moscovici et Katharina Grosse. Ces artistes réveillent nos émotions. Leurs œuvres sont le premier contact avec l’exposition, elles propulsent les visiteurs dans une danse colorée.
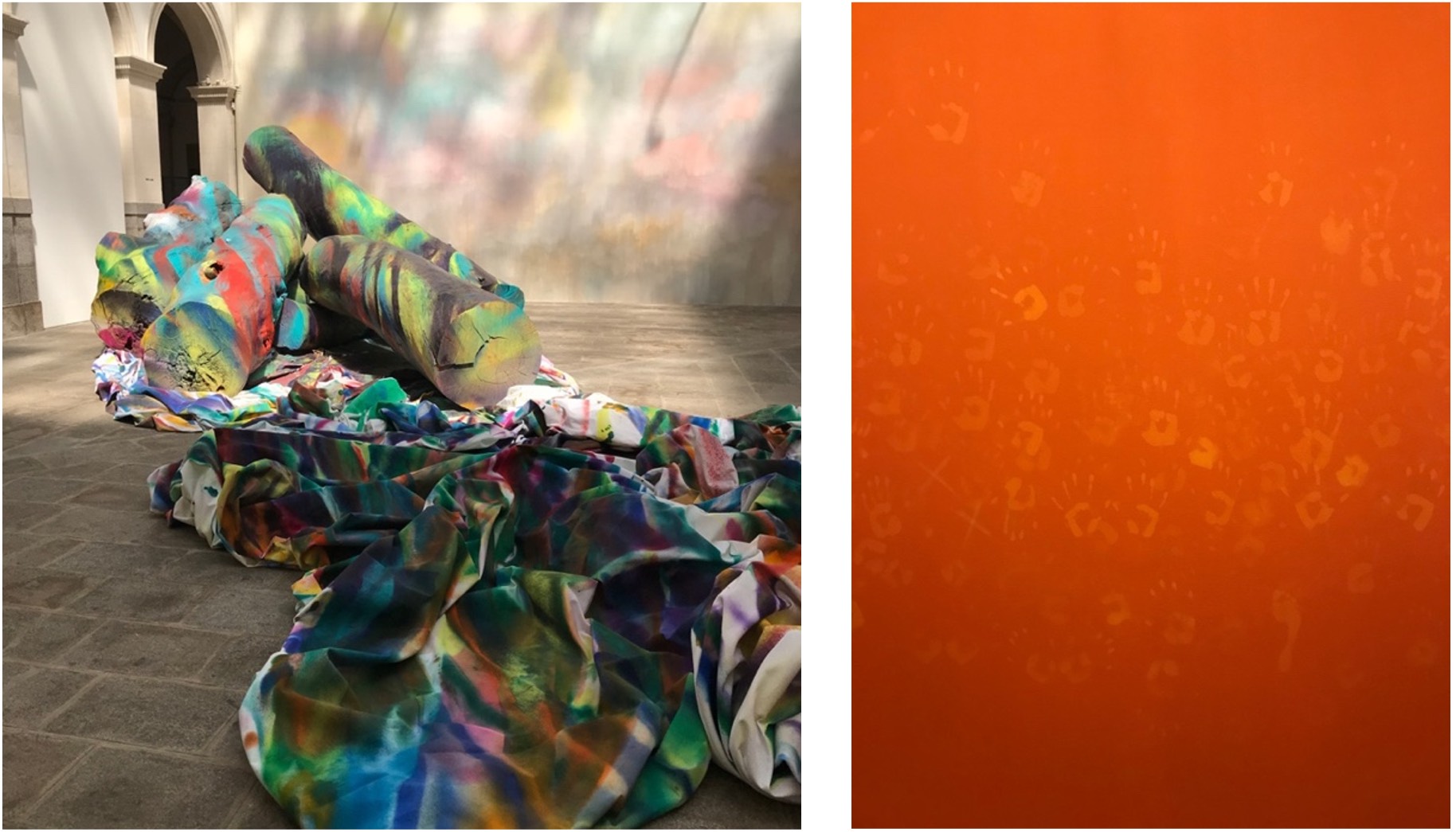
Installations de Flora Moscovici et de Katharina Grosse (gauche) et Orange de Véronique Joumard (droite), Musée des Beaux-Arts de Rennes,
©Anaïs Vdx.
La visite se continue avec une entrée orangée, œuvre de Véronique Joumard elle impulse une interactivité entre les visiteurs qui sont invités à laisser leurs traces sur ce mur orange. La peinture thermosensible réagit à la chaleur humaine. C’est expérimenter la couleur, lui donner une matérialité. Une fois la matière éprouvée, nous sommes plongées dans le traditionnel white cube. Le parcours de l’exposition se termine sur la décomposition de la couleur, des morceaux de peinture se décollent. C’est le mur de pellicules de Michel Blazy. Que se passe-t-il quand la couleur est présente mais que nous ne pouvons pas la toucher ? La capturer ? L’installation Rose de l’artiste Ann Veronica nous plonge dans un espace qui trouble nos sens. Nous traversons un brouillard de couleur rose.
#couleurs #musées #expositions

Croiser les regards : exposer autrement
L’exposition peut être vécue comme une promenade balisée : le parcours, qu’il soit linéaire ou relativement libre, conduit les visiteurs à observer des œuvres réunies par thématique, artiste ou encore période. Cette présentation est rassurante, déroulant une histoire parfois connue d’avance. Et si l’on renversait l’ordre établi ? C’est ce que
proposent certaines institutions en exposant côte à côte des œuvres de courants opposés, mais reliées par un geste, une couleur, une vibration de la matière. C’est moins l’histoire qui guide l’œil que la sensation immédiate. Mais n’est-ce pas frustrant pour d’autres visiteurs ? Apprécier ces associations ne présuppose-t-il pas d’avoir des connaissances préalables sur les œuvres ?
Dialogues inattendus : comprendre ce type d’accrochage
Ce choix curatorial semble agir comme un antidote contre les classifications académiques. Il refuse que l'œuvre soit réduite à son étiquette historique ; il invite à voir ce qui relie au lieu de ce qui sépare. En forçant l’œil à chercher des points communs inattendus, l’espace d’exposition devient un terrain d'expérience, où formes et couleurs tissent des liens, parfois plus éloquents pour certains publics.

Vue de l’exposition Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters, KMSKA, 2024, © KMSKA
Entre émerveillement et désorientation : les limitesAu KMSKA d’Anvers, récemment rénové, le parcours muséal décloisonne les époques en mettant en dialogue les maîtres anciens flamands, comme Rubens ou Van Dyck, avec des œuvres modernes et contemporaines. Non pour illustrer une progression historique, mais pour mettre en évidence des gestes formels partagés : la flamboyance du
rouge, la construction des volumes, l’intensité dramatique. Loin d’exercer le regard à une époque ou une technique particulière, l'institution cherche à provoquer une lecture
transversale. Cette approche a fait l’objet d’une exposition particulière et temporaire Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters (2024), questionnant le rôle des musées ainsi que des collectionneurs privés. La muséographie crée ainsi un nouveau dialogue, avec la croyance que les œuvres d'art contemporaines peuvent renouveler les représentations figées des portraits traditionnels ou des figures maternelles, en y insufflant un regard critique et ancré dans l'actualité.
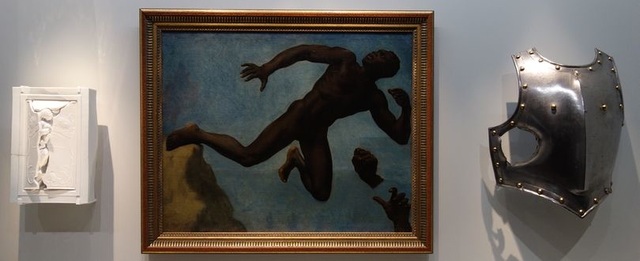
Vue de l’exposition Carambolages, Grand Palais, 2016 © spectacles sélection
Cette approche trouve également un écho dans l’exposition Carambolages (Grand Palais, 2016), conçue par Jean-Hubert Martin. L’éloignement des cartels numériques, invitaient le visiteur à cheminer de manière intuitive, réagissant aux affinités plastiques et symboliques. Jean-Hubert Martin semble ici faire renaître une logique propre à celle du cabinet de curiosité, plus que celle du directeur de musée.

Vue de l’exposition « La couleur parle toutes les langues », Hôtel de la Marine, 2024 ©The AI Thani Collection, photographie par Marc Domage
D'autres exemples confirment cette tendance : l’exposition La couleur parle toutes les langues à l’Hôtel de la Marine (jusqu’au 5 octobre 2025) dont Hélène de Givry, curator
à la Collection Al Thani est la commissaire fait dialoguer 80 œuvres de différentes civilisations issues des cinq continents et couvrant une période chronologique allant du
Néolithique à nos jours. Le parcours est organisé de manière chromatique correspondant aux couleurs fondamentales dans les arts : noir, blanc, rouge, jaune, bleu et vert. Ce mode de classement invite les visiteurs à explorer les matériaux utilisés en lien avec les techniques de production, à percevoir les effets visuels créés par les variations de teintes, d’éclats et de contrastes, et à réfléchir à leur dimension symbolique à travers différentes cultures.
Cette approche rejoint des réflexions théoriques contemporaines sur l’exposition comme « langage », tel que formulé par Jérôme Glicenstein dans « L’exposition comme langage et dispositif », chapitre de son ouvrage L’art : une histoire d’expositions (2009). L’agencement des œuvres devient lui-même un énoncé, engageant le visiteur dans une lecture libre, intuitive et polysémique.
Entre émerveillement et désorientation : les limites
Cependant, cette esthétique de la correspondance comporte ses risques. Si elle invite certains visiteurs à aiguiser leur regard, elle peut également dérouter ceux qui s’attendent à une structure narrative plus claire. Les salles d’exposition permanentes du KMSKA en sont un exemple : selon un article du The Art Newspaper, des préoccupations ont été soulevées concernant les choix esthétiques et curatoriaux du musée, notamment l'absence de fil conducteur historique dans la présentation des œuvres.
De plus, ce type d’accrochage présuppose souvent une certaine culture visuelle. Pour saisir pleinement les échos entre un retable du 15e siècle et une abstraction géométrique du 20e, il faut pouvoir identifier ce qui distingue, et ce qui rapproche. Or, tout le public n’est pas équipé pour une telle lecture. Comme l’analyse Odile Le Guern dans son article Rhétorique d'une mise en espace (2005), une mise en scène audacieuse peut renforcer l’élitisme muséal si elle ne ménage pas des points d’entrée accessibles pour tous. Le risque serait de diluer le sens historique des œuvres en occultant les contextes de création nécessaires à leur compréhension.
Une tension féconde, vers une exposition à double lecture
La juxtaposition libre d'œuvres de styles et d’époques différents constitue une tentative salutaire de revitaliser l'expérience muséale. Elle lutte contre la muséographie figée,
favorisant une lecture intuitive et sensible des formes. Dans ce sens, elle permet de renouveler l'attention du spectateur, de l'arracher à la passivité critique.
Cependant, pour que ce type d'accrochage soit pleinement efficace, il doit s'accompagner d’outils de médiation adaptés : cartels explicatifs, parcours thématiques optionnels,
dispositifs interactifs. Il ne s'agit pas de renoncer à l'histoire au profit d'une pure expérience esthétique, mais de trouver un juste équilibre entre l'émotion immédiate et la contextualisation raisonnée.
Ainsi conçu, l’accrochage par correspondances ne remplace pas la chronologie ; il la questionne, l’enrichit, et ouvre d’autres chemins pour apprendre à voir autrement. Car
exposer autrement, c’est avant tout multiplier les expériences du regard.
- Nina Colpaert
Pour en savoir plus ::
- La couleur parle toutes les langues, 2024, Hôtel de la Marine, du 3 octobre 2024 au 5 octobre 2025 : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/la-couleur-parle-toutes-les-langues.-aeuvres-choisies-de-la-collection-al-thani
- Collected with vision, 2024, KMSKA : https://kmska.be/en/collected-with-vision-private-collections-in-dialogue-with-the-old-masters
- Carambolages, 2016, Grand Palais : https://www.grandpalais.fr/fr/programme/carambolages
- Zeugma 01, 2025, Abbaye royale et musée d’art moderne de Fontevraud : https://www.fontevraud.fr/evenement/zeugma-romain-bernini/
#ExposerAutrement#DialogueDesOeuvres#MuséographieContemporaine
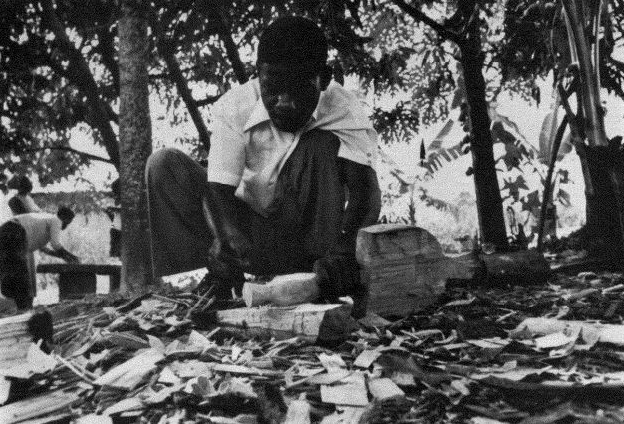
D'un masque à l'autre
L’« authenticité » dans les sculptures africaines : Le cas de la statuaire africaine subsaharienne
« Il n’y a peut-être pas d’autre art que l’Européen aborde avec autant de méfiance que l’art africain… »[1]
La question qui guida la rédaction de cet article fut toute simple : étant moi-même amateur de sculptures africaines, particulièrement de sculpture sur bois (masques et statuettes), je me suis interrogé sur l’« authenticité » des sculptures africaines aujourd’hui présentées au sein de collections muséales ? En effet, une statue ou bien une toile d’un artiste occidental est « authentique » ou non, et en ce cas, elle est une « copie » ou bien un « faux ». Mais est-ce aussi évident en ce qui concerne les sculptures africaines, pour lesquelles, souvent, la datation, la nature et la provenance d’acquisition restent floues sur les cartels de certains musées ?
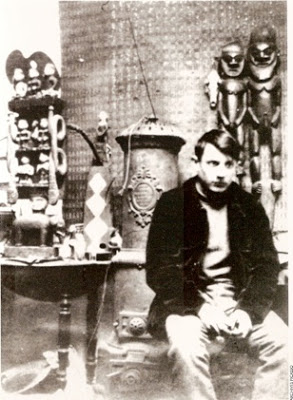 Petit retour historique ! Au début du XXe siècle, l’on sait que c’est principalement grâce aux artistes expressionnistes, primitivistes, fauvistes ou bien encore cubistes (Picasso, Braque, Brancusi, Matisse, Léger, etc.) que les sculptures africaines, tantôt classées dans des collections d’archéologie, tantôt classées dans des collections d’histoire naturelle et d’ethnographie, ont été, finalement assez récemment, promues au rang d’œuvres d’art à part entière.
Petit retour historique ! Au début du XXe siècle, l’on sait que c’est principalement grâce aux artistes expressionnistes, primitivistes, fauvistes ou bien encore cubistes (Picasso, Braque, Brancusi, Matisse, Léger, etc.) que les sculptures africaines, tantôt classées dans des collections d’archéologie, tantôt classées dans des collections d’histoire naturelle et d’ethnographie, ont été, finalement assez récemment, promues au rang d’œuvres d’art à part entière.
Pablo Picasso (1881-1973),dans son atelier du Bateau-Lavoir à Paris, v. 1908
© Gelett Burgess, Musée Picasso
Mais par leur ‘redécouverte’, ces artistes européens ont aussi ouvert l’appétit des collectionneurs pour ces créations africaines, en leur faisant découvrir et surtout en leur donnant goût à des représentations somme toute très nouvelles et étrangères dans le paysage artistique occidental, si bien que, très rapidement, se développe, en parallèle, un important commerce de copies et de faux. Non seulement l’envolée des prix sur le marché de l’art, mais aussi la raréfaction grandissante des sculptures africains « authentiques » – raréfaction imputable soit à des disparitions naturelles (l’environnement), soit à des destructions (volontaires, par les populations africaines elles-mêmes, ou forcées, par les missionnaires européens notamment), soit enfin à la colonisation et aux pillages européens –, créées alors un terrain propice pour les faussaires. Se pose dès lors la question de l’« authenticité » des sculptures africaines. Qu’est-ce finalement qu’une sculpture africaine « authentique » ?
Pour bien définir « l’authentique », il nous semble tout d’abord intéressant de parler de pièces « inauthentiques », afin d’isoler deux types de sculptures fabriquées dans le seul but d’être vendues à un public amateur. Premièrement, il y a tout simplement les sculptures « fausses », c’est-à-dire le produit de la fraude, et autrement dit les sculptures africaines fabriquées avec la volonté patente de tromper et de fausser « le jugement porté sur une œuvre » [2]. Une sculpture africaine « fausse » pourrait ainsi se définir comme une création vidée de toute identité, de toute valeur ethnique, puisque crée en tant que produit et mis sur le marché de l’art pour tromper intentionnellement. Et il faut bien avoir à l’esprit qu’un « faux » masque africain, ou qu’une « fausse » statuette africaine, n’est jamais la création d’un faussaire de génie – comme nous pouvons le connaître en Occident avec la figure du faussaire-artiste isolé, tels Han van Meegeren (1889-1947) pour la peinture, André Mailfert (?-?) pour l’ébénisterie, Alceo Dossena (1878-1937) pour la sculpture, etc. –, mais il s’agit au contraire toujours de réseaux de faussaires, que ce soit en Afrique, en Amérique et en Europe, les artisans-faussaires travaillant en atelier, et donc en clandestinité, et presque toujours d’après des photos. Ainsi, c’est en juin 2013 qu’en France le plus grand réseau de faussaires en sculptures africaines a pu être démantelé dans la périphérie parisienne, donnant lieu à 22 interpellations (artisans, intermédiaires, rabatteurs, et galeristes) et plus de 500 « fausses » sculptures saisies (vendues généralement entre 100.000 et 400.000 euros pièce !). Mais alors, me direz-vous, qu’en est-il des sculptures-souvenirs que l’on peut trouver derrière les vitrines des boutiques de la plupart des musées africains ? En effet, au sein d’une boutique de musée, la copie de masques présentés ou non dans le parcours muséal, peut, paradoxalement, trouver toute sa place, comme nous avons pu encore le constater dernièrement dans la boutique d’un musée d’ethnographie, où seul un petit cartel légitime leur présence et, par conséquent, leur commercialisation et leur entrée dans le marché du « faux » :
« Ces masques sont des objets d’artisanat. Malgré leur qualité esthétique, il ne s’agit en aucun cas d’objets d’art issus de collections muséales. Ces masques ont été réalisés par des artistes africains contemporains. »
 Que faut-il en penser ? En quoi ces objets seraient-ils plus légitimes que les produits de la fraude, qui, eux-aussi, sont des « objets d’artisanat » puisque créés par des artisans-faussaires ? Est-ce simplement la traçabilité de la production des dits objets ? Car en dehors du cadre légal de commercialisation, à savoir l’espace boutique d’un musée, la différence une fois acheté, entre un « faux » masque produit de la fraude, et un « faux » masque proposé dans une boutique de musée, est quasi-inexistante…
Que faut-il en penser ? En quoi ces objets seraient-ils plus légitimes que les produits de la fraude, qui, eux-aussi, sont des « objets d’artisanat » puisque créés par des artisans-faussaires ? Est-ce simplement la traçabilité de la production des dits objets ? Car en dehors du cadre légal de commercialisation, à savoir l’espace boutique d’un musée, la différence une fois acheté, entre un « faux » masque produit de la fraude, et un « faux » masque proposé dans une boutique de musée, est quasi-inexistante…
Peigne Ashanti authentique, Bois et pigments (H. 23 cm)
© Coll. privée
Peigne Ashanti faux / Bois et pigments (H. 20 cm) Produit de la fraude, saisi en 2010, détruit
Deuxièmement, à côté de ces « fausses » sculptures contemporaines fabriquées au cours des XXe et – principalement – XXIe siècles pour tromper délibérément (si l’on écarte les « faux » des boutiques de musées) et qui, fort heureusement, n’ont aucune place dans les musées, nous distinguerons les sculptures que l’on peut qualifier de « vraies-fausses » ou « fausses par destination », c’est-à-dire des sculptures, bien plus anciennes collectées en Afrique, qui furent spécialement réalisées pour répondre à une demande coloniale, pour les colons européens qui fréquentèrent les côtes africaines à l’époque moderne ou, plus tard à partir du XIXe siècle, en poste ou de passage dans une colonie. Dans une de ses œuvres majeures, L’Afrique fantôme [1934], l’écrivain, poète, ethnologue et critique d’art français Michel Leiris (1901-1990) décrit justement comment des masques africains furent détournés de leurs utilisations rituelles traditionnelles lors de fêtes villageoises orchestrées par l’administration dans les colonies françaises au début du XXe siècle (pour la fête du 14 juillet par exemple), celle-ci faisant par la suite rapidement rentrer ces objets dans le marché de l’art colonial européen.
Masque-Cimier Ciwara utilisé dans une colonie française,lors des festivités du 14 juillet 1932
© Anonyme, in Derlon, Brigitte, La Passion de l’art primitif, Paris, Gallimard, 2008, p. 283
Mais ces « vraies-fausses » sculptures apparaissent finalement sur les places marchandes européennes dès le XVe siècle, par le biais des premiers contacts entretenus par des armateurs, explorateurs et marchands qui fréquentèrent les côtes subsahariennes du continent africain. Et les exemples sont nombreux : on peut citer, entre autre, l’importante figure du marchand français Jean Barbot (1655-1712) qui écrit, dans son Journal de voyage posthume [1732], avoir spécialement commandé auprès de certaines populations autochtones africaines des sculptures sur bois afin de les exporter ; ou bien encore l’on peut déceler, dans un panneau de retable peint en 1527 par le peintre portugais Lopes Grégório (v. 1490-1550), La Mort de la vierge, la présence d’une de ces fameuses cuillers en ivoire, dites « afro-portugaises » et que les Africains fabriquaient alors spécialement (sur les côtes du Golfe de Guinée) pour répondre à une demande européenne, « hybrides extraordinaires et raffinés, destinés uniquement à la clientèle coloniale »[3] qui, selon l’historienne et ethnologue Jacqueline Delange (1924-1991), s’apparentaient déjà à un véritable « art commercial »[4].
Grégório Lops, Morte da Virgem, huile surchêne, 1527,H.128,5 cm x L. 87 cm, détail © Lisbonne, Museum Nacional de Arte Antiga
Face à cette production de sculptures africaines « fausses par destination » et qui, à partir du milieu du XXe siècle vont véritablement envahir le marché de l’art européen, une réflexion autour de plusieurs critères d’appréciation commence alors à se construire à partir des années 1970-1980, autant chez des conservateurs de musées que chez des marchands et des experts ; critères jugés pertinents pour évaluer, non de l’« originalité » de ces pièces qui, effectivement, sont originales puisque présentant forcément de légères différences entre elles, mais de leur « authenticité ».
Il faut d’abord se méfier du parallèle que nous faisons implicitement, en tant qu’occidentaux, entre l’« ancienneté » d’une pièce et son « authenticité », puisque, en ce qui concerne les arts africains, celle-ci n’a strictement aucun rapport avec sa date de création. Cas assez unique, nous semble-t-il, en histoire de l’art, si nous prenons en exemple les sculptures africaines, nous nous rendons compte finalement qu’une pièce « inauthentique » peut s’avérer être antérieure, plus ancienne, qu’une pièce « authentique », et qu’une pièce « inauthentique » et une autre pièce « authentique » peuvent provenir de la main d’un même artiste. C’est le cas par exemple avec l’artiste gabonais Simon Misère (?-?) qui, dans les années 1970 à Libreville, pouvait tout aussi bien réaliser des sculptures destinées au culte de sa propre communauté (sculptures « authentiques »), que des sculptures « fausses par destination » puisque destinées tout spécialement aux colons européens, soit en travaillant sur commande pour la préparation de festivités coloniales, ou bien en réalisant tout simplement des sculptures de pure décoration ; objets réalisés par un seul et même artiste, avec le même savoir-faire, avec les mêmes matériaux, mais dont la destination finale, l’utilisation, fait toute la différence.
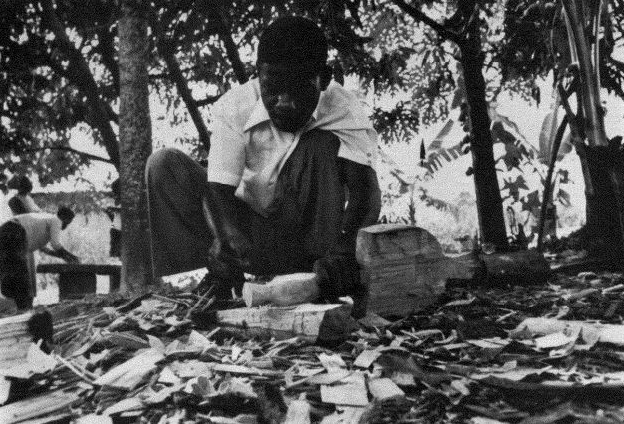
Simon Misère dans son atelier à Libreville (Gabon) dans les années 1970© Réginald Groux
Malheureusement, à défaut d’avoir un œil expert dans le domaine, nous remarquons qu’aujourd’hui encore, dans la grande majorité des musées d’art africain français, les sculptures « vraies-fausses » et celles « authentiques » ne se distinguent pas, puisque les cartels n’explicitent souvent pas le statut, la provenance et les particularités de chacune. Certains musées, tels que les Musées des Beaux-Arts de Grenoble, le Musée des Beaux-Arts d’Angoulême ou encore le Musée des Arts d’Afrique et d’Asie à Vichy, portent au contraire une grande attention à cette question, le cartel de chaque pièce exposée rattachant celle-ci à son contexte de fabrication et d’utilisation originelle, et lui donne une traçabilité visible en mentionnant son origine, si elle provient d’une collecte ou d’une collection particulière, etc. Le Musée de Vichy qui, justement, a organisé l’année dernière son exposition temporaire d’art africain avec pour fil directeur l’interrogation sur ce que furent ces objets dans leurs contextes d’origine, et sur ce qu’ils sont devenus suite aux contacts avec les occidentaux, et surtout sous le regard des occidentaux.
Un des critères fondamentaux de l’« authenticité » dans la sculpture africaine semblerait donc être la non-commercialisation : une sculpture africaine « authentique » n’est exécutée et destinée qu’à l’usage rituel ou fonctionnel de la communauté africaine dont il provient, fabriquée dans un but non lucratif, alors qu’en Occident toutes les formes d’art que nous connaissons sont presque toujours faites d’après une commande et pour être exposées et vendues. Admettons alors qu’une sculpture africaine n’est « authentique » que si elle a été fabriquée pour l’usage auquel elle correspond initialement, si elle est rentrée dans un système symbolique, dans des manifestations rituelles ou domestiques traditionnelles, devant, de fait, présenter une certaine patine d’usage attestant de son vécu. Mais en raison de l’avancée de la colonisation, du XVIe jusqu’au XXe siècle, et de ses effets sur les croyances et les cultures matérielles, le collectionneur et marchand d’art Henri Kamer, président de International Arts Experts Association, propose, dans un essai publié au début des années 1970, de distinguer trois grandes catégories de sculptures africaines pouvant être considérées comme « authentiques »[5] :
- - premièrement, les sculptures « n’ayant subi aucune influence extérieure », considérées comme un « art du début ».
- - deuxièmement, « les objets de la période intermédiaire », sur lesquels on peut constater des influences dues aux « apports étrangers à l’ethnie » (clous de cuivre, verroterie, peinture, etc. d’origine européenne).
- - et enfin, les sculptures de la « troisième période », présentant une influence qui peut-être aussi bien inter-tribale qu’européenne (les représentations de nus qui deviennent de plus en plus rares, par exemple).
Cependant, trente ans après la publication de cet essai, les recherches en histoire de l’art, mais aussi en histoire et en ethnographie, ont considérablement progressé en Afrique, et ce travail d’H. Kamer, bien qu’il fasse toujours référence dans le milieu de l’expertise des sculptures africaines, nous semble aujourd’hui discutable sur plusieurs points. Notamment, et pour ne prendre qu’un exemple assez significatif, cet essai peut être discutable au sujet du statut du créateur, puisqu’à l’époque d’H. Kamer, l’on considérait que le qualificatif d’« artiste » était impropre pour évoquer l’auteur d’une création africaine, mais que ce furent seulement des « artisans » qui exécutaient des commandes, et ce en suivant non leur inspiration propre mais des canons hérités dans leurs communautés ; H. Kamer parle alors, à ce propos, de « spontanéité du geste », et l’on considère, de fait, que les sculptures africaines (rituelles et domestiques) n’ont jamais été conçues en tant qu’œuvre d’art, mais que c’est uniquement le regard de l’amateur européen, éclairé, qui a pu révéler dans ces objets le caractère artistique. Or l’on sait aujourd’hui, grâce à certaines fouilles archéologiques menées en Afrique subsaharienne, qu’à côté des simples artisans, devant réaliser effectivement des objets pour répondre aux demandes de leurs communautés, des artistes ont bien existé en Afrique dès l’époque moderne – si ce n’est même antérieurement –, souvent réputés dans leurs sociétés et rattachés aux cours princières et royales de grands royaumes.
En somme, force nous est de constater que les critères pour déterminer l’« authenticité » d’une sculpture africaine n’ont cessé d’évoluer. Et ces critères montrent véritablement l’évolution du regard sur cet art particulier, « mettant clairement en évidence le fait que l’« authenticité » est un concept finalement assez large qui résulte d’un consensus entre collectionneurs sur l’origine d’un objet, les techniques de sa fabrication et ses usages ; critères qui renvoient implicitement à la construction même de la conception du monde et de la société dans une culture donnée »[6].
« Au sujet de l’art africain, les mots ‘’vrai’’ et ‘’faux’’ sont fréquemment employés comme qualificatifs pour décrire les objets faits au sud du Sahara. Pour moi, les termes ‘’vrai’’ et ‘’faux’’ me semblent être des notions extrêmement floues lorsqu’on parle d’art africain. Un ‘’vrai’’ quoi ? Un ‘’faux’’ quoi ? Ces termes simplistes sont employés pour appréhender un sujet extrêmement complexe. Dire d’un objet africain qu’il n’est pas ‘’vrai’’ signifie probablement ‘’n’ayant jamais été utilisé, ni fait pour être utilisé dans un but spirituel’’, par exemple un objet fait pour être vendu. Etant donné qu’un nombre de plus en plus grand d’objets de ces dernières décennies glissent peu à peu dans cette catégorie, une redéfinition du terme ‘’vrai’’ semble appropriée. Ces objets sont certainement ‘’vrais’’ dans le sens où ils font bien partie de la vie africaine. Certains sont indéniablement l’expression d’une vision individuelle en réponse à une forme sculpturale familière. À quel point un masque ou une statuette sacrée soi-disant ‘’vrais’’ sont-ils ‘’vrais’’ lorsqu’ils ne sont pas utilisés à des fins spirituelles ou cérémonielles ? Lorsqu’ils sont créés pour des festivités coloniales, exposés sous vitrine dans un musée ou accrochés au mur d’une chambre à coucher ?... »
WILSON, Fred (commissaire d’exposition), Cité in Flam, Jack, et Shapiro, Daniel, Western Artists / African Art, New York, Museum for African Art, 1994, p. 97
Pour en savoir plus :
- « Distinction Vrai-Faux : quelques réflexions sur la fabrication de « faux », sur creative-museum.com
- BONNAIN-DULON, Rolande, « ‘’Authenticité’’ et faux dans les Arts premiers », in BÉAUR, Gérard, BONIN, Hubert, LEMERCIER, Claire (dir.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006, pp. 183-196
- COULIBALY, Marc, Des masques culturels au masque muséifié : leurs usages et représentations, Binche, Musée international du Carnaval et du Masque, 2014
- DEGLI, Marine, et MAUZÉ, Marie, Arts premiers : le temps de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2000
- DELANGE, Jacqueline, Arts et peuples de l’Afrique noire : introduction à une analyse des créations plastiques, Paris, NRF Gallimard, 1967, p. 209
- DERLON, Brigitte, et JEUDY-BALLINI, Monique, La passion de l’art primitif : enquête sur les collectionneurs, Paris, Gallimard, 2008
- KAMER, Henri, « De l’authenticité des sculptures africaines », in Arts d’Afrique noire, 1974, n°12, pp. 17-40
- LEIRIS, Michel, L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard, 1992 [1934]
- MARCOUX, Camille Noé, Objets, de la Côte-de-l’Or à l’Europe des curiosités : échanges et regards (XVIe-XVIIIe siècles), Mémoire de master en Histoire de l’Art, réalisé sous la direction de Mme Catherine Cardinal, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2015
- MARTINEZ, Nadine, La réception des arts dits premiers ou archaïques en France, Paris, L’Harmattan, 2010
- SOMÉ, Roger, Art africain et esthétique occidentale, Paris, L’Harmattan, 1998
# arts premiers# sculptures africaines
# faux / authentiques
[1]EINSTEIN, Carl, La Sculpture nègre,Paris, L’Harmattan, 2002 [1915], p. 43
[2]BONNAIN-DULON, Rolande, « ‘’Authenticité’’ et faux dans les Artspremiers », in Béaur, Gérard, Bonin, Hubert, et Lemercier, Claire (dir.), Fraude, contrefaçon et contrebande, del’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006, p. 183
[3]BASSANI, Ezio, « Œuvres d’arts et objets africains dans l’Europe du XVIIesiècle », in Ouvertures sur l’artafricain, Paris, Dapper, 1986, p. 70
[4]DELANGE, Jacqueline, Arts et peuples del’Afrique noire : introduction à une analyse des créations plastiques,Paris, NRF Gallimard, 1967, p. 209
[5]KAMER, Henri, « De l’authenticité des sculptures africaines », in Arts d’Afrique noire, 1974, n°12, pp.17-40
[6]BONNAIN-DULON, Rolande, op. cit., p.189

D’entrée de jeu : le rôle des halls d'accueil de musées
Entrer dans un musée n’est pas chose aisée. Les barrières sociales, culturelles et symboliques à enjamber sont nombreuses. Pénétrer dans le hall d’entrée constitue déjà une petite victoire : ça y est, nous y sommes, le seuil est franchi. Le hall est une zone qui sert une double fonction, de séparation et de communication avec le monde extérieur. Essayons de mieux comprendre cet « espace liminaire » à travers l’étude de quatre institutions muséales bordelaises.
Image d'introduction : Envol au Musée d'Aquitaine © Barbara Goblot
Quel rôle joue le hall d’entrée dans l’expérience muséale ?
L’expérience muséale commence dès le hall d’accueil. Comme son nom l’indique, il doit jouer son rôle d’accueil,de réception du public. S’y trouve la billetterie, tenue par des agent.e.s ; parfois une boutique, un vestiaire, un café, des assises qui créent un espace de détente et de discussion. Il arrive qu’il présente un aperçu de la collection, par des objets isolés ou des vitrines. Les signalétiques y sont très importantes pour que le visiteur se repère dans les différents espaces, et sache par où commencer la visite, que ce soit vers les collections permanentes ou les expositions temporaires.
Dans son article « De l’espace public au musée. Le seuil comme espace de médiation » (Culture & Musées, 2015), Céline Schall explicite l’importance du passage de l’extérieur à l’intérieur du musée. C’est un espace physique, qui coupe les visiteurs des mouvements de la vie quotidienne pour l’inviter dans le monde des arts, des sciences, de la culture. Il joue également un rôle symbolique, que Schall identifie à la seconde phase des rites de passage décrits par Arnold Van Gennep (Les rites de passage,1909) : lorsque l’individu s’apprête à changer d’état, quand il devient adulte ou se marie par exemple, il est séparé du groupe, puis vit une phase de mise à la marge (dite « liminaire ») avant d’être réintégré avec son nouveau statut. De même, lorsque l’on pénètre dans un musée, on laisse derrière soi son statut de passant, de touriste, de consommateur pour endosser l’identité de visiteur. En tant qu’espace liminaire, le hall du musée doit aider à cette métamorphose.
Cette rupture semble impliquer une certaine violence envers le public. Selon Monique Renault (« Seuil du musée, deuil de la ville ? », La Lettre de l’Ocim, 2000), le musée d’art « veille à déposséder le visiteur de ses repères spatio-temporels coutumiers ». De là à demander à ce qu’il ait les yeux bandés et fasse trois tours sur lui-même avant d’entrer dans les salles, il n’y a qu’un pas ! Le visiteur doit vivre la rupture, la « décontextualisation » qu’ont connu les objets présentés lorsqu’ils sont devenus des objets de musée, pour en comprendre le sens et atteindre leur portée esthétique. Cet argument se fonde sur l’idée que l’expérience esthétique des œuvres advient non pas grâce à des connaissances préexistantes ou des outils de médiation, mais par une mise en situation radicale, un état de recueillement et de contemplation foncièrement intime, en rupture avec la temporalité du quotidien. Le visiteur, en plus de perdre tous ses repères, ressent donc un sentiment d’échec personnel, de manque de sa part s’il ne vit pas ce bouleversement esthétique. Proposant une approche plus nuancée, Céline Schall définit plutôt le seuil comme un « espace de médiation », qui ne coupe pas seulement le visiteur de son mouvement quotidien, mais l’accompagne dans sa métamorphose et prépare la découverte des objets présentés.
La première impression compte pour beaucoup dans l’image que nous construisons d’un musée. Du premier espace qui nous accueille, nous inférons, consciemment ou non, l’identité du lieu. Avant même d’avoir exploré les collections, nous imaginons ce qu’il contient, et l’expérience que nous allons y vivre. Céline Schall identifie le hall d’entrée du musée comme un paratexte. Tout comme ce qui précède et accompagne la lecture d’un ouvrage (titre, réputation de l’auteur, quatrième de couverture, préface…), le hall donne les clés de lecture du musée dans son ensemble, de ses objets et de son discours. Il partage ce rôle avec toutes les informations dont dispose le visiteur avant son entrée dans l’institution : communication, architecture extérieure… Le paratexte met également en place le contrat de communication entre l’émetteur du message, le musée, et le récepteur, le public. Ce contrat engage le musée, il crée l’attente d’un certain type de collection, d’un discours, d’une ambiance, et doit être honoré par l’expérience de visite, sous peine d’une perte de confiance de la part du public.
Comment ces rôles sont-ils incarnés par les halls d’entrée des musées ? En décembre, le Master MEM s’est rendu à Bordeaux pour un marathon muséal. Je propose ici une analyse des halls d’accueil de quatre institutions bordelaises, qui présentent une grande variété d’architectures. Certains se sont installés dans des bâtiments historiques, d’autres ont donné lieu à la construction d’un lieu spécifique. Des halls d’accueil majestueux, d’autres plus intimes, des propositions innovantes, des architectures symboliques : ouvrons la porte des musées bordelais et arrêtons-nous là, dans le hall d’entrée.
Le Musée d’Aquitaine et la MECA : quand l’architecture s’impose
Le Musée d’Aquitaine s’installe en 1987 dans les locaux de l’ancienne faculté des lettres et des sciences, construite dans les années 1880 par l’architecte Charles Durand. Le hall d’entrée présente un volume très large, et une architecture inspirée de l’Antiquité classique (colonnes corinthiennes, frontons triangulaires, médaillons…). L’espace monumental, imposant et solennel, correspond à l’image traditionnelle du musée-temple, institution de la culture légitime abritant des collections sacralisées. Le musée d’Aquitaine conserve en effet une collection extrêmement riche, traversant l’histoire de Bordeaux et de sa région de -400 000 à nos jours. Le musée ne s’inscrit pas organiquement dans le tissu urbain, c’est un lieu de recueillement à l'écart de l'agitation du quotidien. Des escaliers monumentaux mènent à ce hall, et participent du même effet. Ils créent ce que Renault nomme un « seuil ascendant », qui engage les visiteurs à un effort physique, un cheminement mental, un « oubli de soi » pour laisser place à l’expérience esthétique. Le rite d’initiation dont nous parlions plus haut est acté : se joue là une « cérémonie du franchissement » marquant nettement la métamorphose du passant en visiteur. Le musée et les visiteurs sont dans un rapport traditionnel de transmission des savoirs unilatéral.
Le Musée d’Aquitaine a pour volonté de nouer des liens forts avec les habitant.e.s actuel.le.s de la région, à travers des conférences, des ateliers, des évènements, notamment sur le rapport entre Bordeaux et le reste du monde. Cette position affirmée par le musée n’est pas transmise par le hall d’accueil. L’architecture n’encourage pas le lien au sein de la communauté. L’immense espace de pierre, à la grande hauteur de plafond, crée un environnement froid, dans lequel on ne souhaite pas s’attarder. Aucun espace avec des assises ne propose de se reposer, de discuter, d’utiliser le musée comme un lieu de détente ou d’échanges. Le hall est avant tout une zone utilitaire, qui permet d’acheter son billet d'entrée, de prendre des livrets-jeux pour les enfants, et de consommer dans la boutique. Les stands qui présentent les produits sont disposés de part et d’autre du hall, ce qui permet une déambulation agréable. Il est également un lieu de passage, de distribution des flux entre les différents espaces du musée.
Des éléments annexes en lien avec les expositions temporaires animent un peu le lieu et donnent une idée des objets que la visiteuse pourra découvrir à l’intérieur. Pour l’exposition Hugo Pratt - Lignes d’Horizon(mai 2021-février 2022) des bannières suspendues, décorées de dessins de l’artiste et de mouettes, dynamise le bâtiment classique. Ce sont les éléments de médiation et de paratexte les plus efficaces du hall.
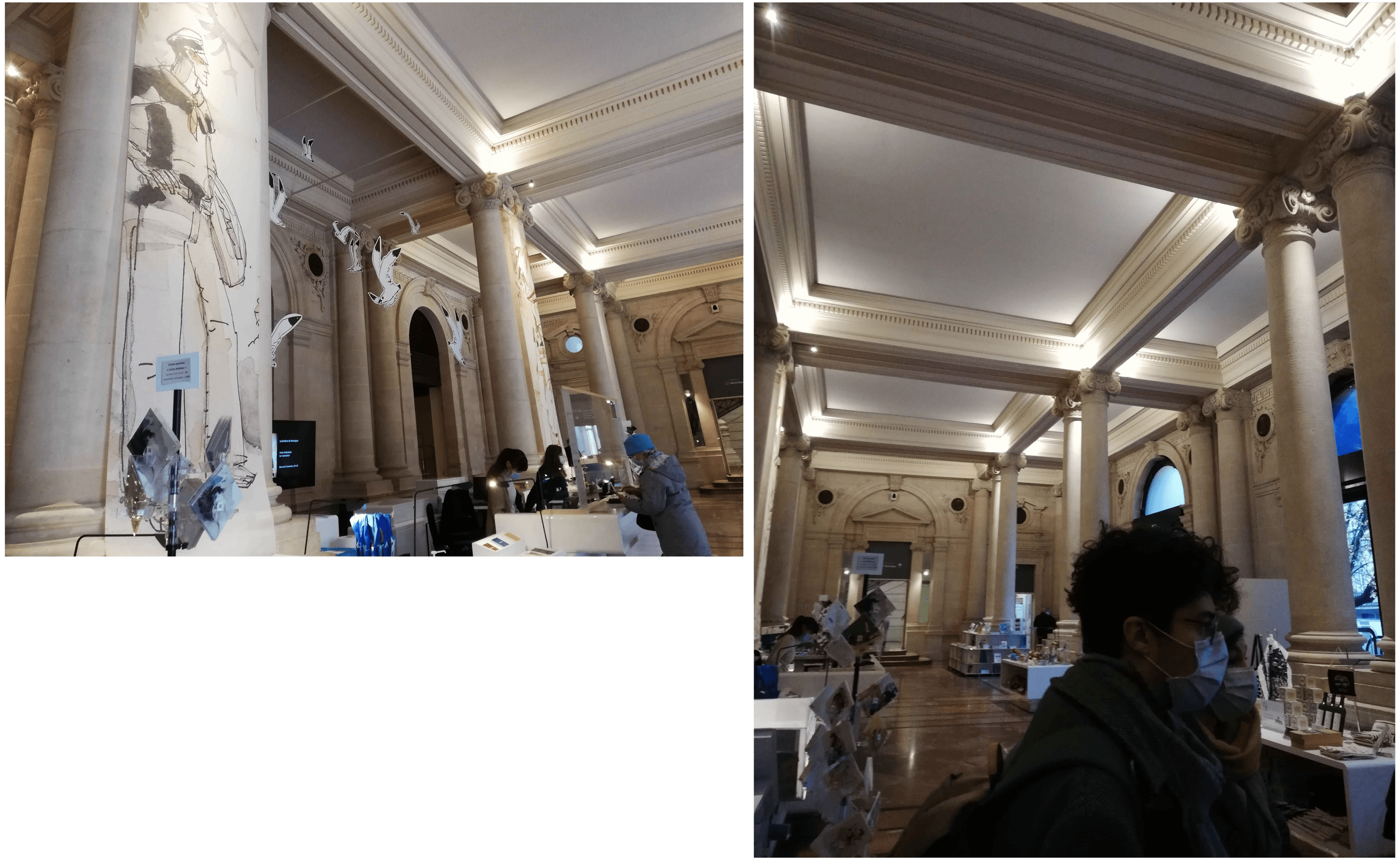
Le hall d'accueil imposant du Musée d'Aquitaine © Barbara Goblot
La MECA a été conçue par l’agence BIG en 2019. Le bâtiment héberge plusieurs agences culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine (le FRAC, l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) et l’Agence Livre Cinéma Audiovisuel (ALCA)). L’aménagement du hall, grand espace ouvert, est le résultat d’une réflexion sur les formes géométriques. A l’entrée, une sorte d’amphithéâtre circulaire accueille le public. La billetterie du FRAC, située devant les ascenseurs qui permettent de monter aux espaces d’exposition, est triangulaire. Enfin, la table du café-bar est en forme de croix symétrique. Le hall d'accueil sert bien sa fonction de distribution des flux entre le FRAC, l’OARA et l’ALCA : une signalétique claire indique les espaces occupées par chaque institution. L’espace est large, lumineux ; l’amphithéâtre et le café offrent au public des zones de repos et de discussion. Ce n’est pas seulement un lieu fonctionnel ou de passage, mais bien un espace pensé pour être vécu. Quelques œuvres d’art contemporain offrent un aperçu des collections conservées par le FRAC.
Cependant, l’espace est rendu froid et inhospitalier par les choix architecturaux opérés. Le béton brut est le matériau le plus présent, sans aucun décor ou ajout d’une matière plus chaleureuse. Ce manque est flagrant dans l’amphithéâtre, où aucun tissu ou coussin ne rend les assises confortables. Les formes géométriques, rigoureuses et austères, si elles témoignent d’un geste architectural fort, ne participent pas à faire du lieu un espace agréable, dans lequel les visiteurs ont envie de s’arrêter. Le hall de la MECA joue avant tout un rôle paratextuel : il donne les clés pour appréhender la visite, par la présence de l’architecture et de l’art contemporains. Cependant, il ne parvient pas à devenir un espace de médiation au sens où l’entend Schall.
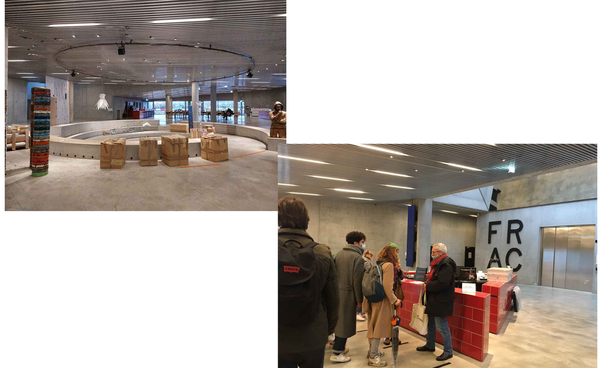
Un accueil mitigé à la MECA © Florie Gosselin / Marion Roy
Cap Sciences et le Muséum : des halls accueillant pour une entrée en douceur
Le bâtiment de Cap Sciences a été construit en 2002 par l’architecte Bernard Schweitzer spécifiquement pour le centre d’interprétation. Le hall d’entrée est spacieux mais à taille humaine, et d’une grande sobriété. Les couleurs neutres (gris, beige), les lignes géométriques et une lumière uniforme dominent. Le seul mobilier important du hall d’accueil est la billetterie, c’est un espace fonctionnel avant tout. Cependant, quelques éléments visuels en font un réel espace de médiation. Les différents espaces sont indiqués par des panneaux signalétiques qui reprennent les codes visuels du tableau périodique des éléments, ce qui nous plonge dès l’entrée dans le thème des sciences et des techniques. Le mur face à l’entrée est entièrement adapté à chaque nouvelle exposition, selon son identité visuelle. Cette signalétique et cet avant-goût de l’exposition jouent un rôle paratextuel, en nous préparant à la lecture des expositions du musée. Elles accompagnent également la métamorphose du passant en visiteur d’un musée de science, dont on attend esprit critique et curiosité.
Cap Sciences ne conserve pas de collections permanentes, ce sont les expositions temporaires qui donnent vie à l’institution. Celles-ci sont présentées et accessibles dès le hall d’accueil, de plein pied. Il y a peu de paliers entre la rue et l’exposition, qui donne l’impression d’une institution ouverte, accessible, bien loin d’un musée-écrin comme le musée d’Aquitaine. Cela contribue à l’image que le musée véhicule de la science comme terrain de jeu et d’exploration, qui ne nécessite pas le recueillement souvent attendu dans les musées d’art.

Curieux dès l'entrée à Cap Sciences © Barbara Goblot
Le Museum de Bordeaux est installé dans un ancien hôtel particulier. Il a rouvert en 2019 avec un bâtiment rénové, de nouveaux parcours d’exposition, et notamment un hall d’entrée entièrement reconstruit. Le projet a été mené par le cabinet d’architecture Basalt. Derrière la porte du musée, un sas d’entrée présente aux visiteurs deux spécimens empaillés, un adulte et un petit de la même espèce, changés régulièrement. Selon la conservatrice Nathalie Mémoire, ce sont des « éléments d’appel » qui servent d’introduction à la visite. Ainsi, le musée met en avant plusieurs caractéristiques : sa grande collection d’espèces naturalisées, et son « espace des Tout-petits », conçu pour les enfants de moins de six ans. C’est une manière intelligente d’accueillir le visiteur et de créer une entrée douce dans l’institution.
Cette volonté se poursuit dans le hall d’accueil proprement dit. Comme à Cap Sciences, l’architecture est d’une grande sobriété : couleur blanche, lignes simples légèrement courbes… Un carré central tient lieu de billetterie et de boutique. Sur les murs, des vitrines présentent des spécimens de la collection, sous l’angle de la diversité des espèces : des oiseaux, insectes et pierres précieuses sont rangés par couleur, un éléphant côtoie un rongeur de quelques centimètres. Ainsi, sans faire appel dès l’entrée aux fonctions cognitives des visiteurs, le musée met en valeur ses collections et suscite l’émerveillement et la curiosité du public, ce qui le place dans un bon état d’esprit pour commencer sa visite. Il se présente comme un espace de découverte et de plaisir, accessible à tous.tes, car chacun.e peut reconnaître les ressemblances et s’amuser des différences entre les spécimens présentés. Il devient ce que Schall appelle un « espace de concernation », qui « [interpelle] les visiteurs et ainsi les [fait] entrer dans les contenus scientifiques et leur [donne] envie de rencontrer ce contenu ». Le musée utilise également des vitrines traversantes, ce qui permet une transition naturelle vers la suite de la visite, puisque les objets du hall sont visibles depuis les couloirs qui l’entourent et réciproquement. Dans la salle menant aux escaliers, d’autres formes de diversité du vivant, de matières, donnent lieu à des dispositifs tactiles.
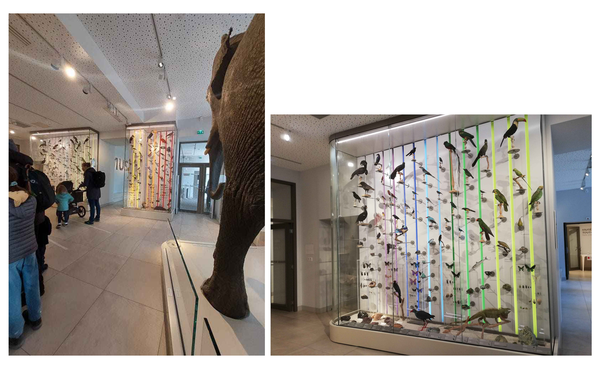
The elephant in the room nous accueille au Muséum de Bordeaux © Barbara Goblot
Le hall d’entrée du musée donne une image aux visiteurs de l’institution toute entière, il établit avec lui un contrat de communication sur lequel il est difficile de revenir. Il installe le public dans un certain état d’esprit : curieux, à l’aise, ou au contraire repoussé, agacé. Il est un espace essentiel de l’expérience muséale. Son rôle n'est pas seulement d'opérer une rupture avec le quotidien et d'inspirer le respect. Il doit également aider à surmonter les barrières qui s’imposent dans ces institutions encore élitistes. La métamorphose en visiteur se fait alors sans violence, avec enthousiasme et apaisement.
Barbara Goblot
Pour aller plus loin :
- L’article de Céline Schall, « De l’espace public au musée. Le seuil comme espace de médiation », Culture & Musées, 2015
- L’articlede Monique Renault, « Seuil du musée, deuil de la ville ? », La Lettre de l’Ocim, 2000
#muséesbordelais #accueilmusées #architecture

Depot Boijmans Van Beuningen, le dépôt aux multiples facettes
Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
Le Depot Boijmans Van Beuningen, conçu par le cabinet d’architectes néerlandais MVRDV et inauguré en 2021 s’impose dans le Museumpark de Rotterdam comme le premier entrepôt d’œuvres d’art au monde entièrement accessible au public. Son architecture circulaire recouverte de panneaux miroirs reflétant l’environnement urbain qui l’entoure est une attraction en elle-même. Au-delà de son apparence iconique, le Depot interroge la manière dont un musée peut repenser son rapport au public et à la conservation de l’art. Est-il un simple dépôt visitable, une extension muséale ou un concept hybride redéfinissant les règles de la présentation artistique ?
Provenance des collections et leur nature, données et graphiques par © Depot Boijmans Van Beuningen
Un projet pionnier qui bouscule les codes muséaux
Traditionnellement, les réserves des collections des musées sont en grande partie inaccessibles au public, pour des raisons de conservation et de place. Le Conseil international des musées (ICOM) estime que 80 à 90% des collections muséales ne sont pas exposées et restent en réserve. Cette situation soulève des interrogations tant pour le grand public, qui peut percevoir ces œuvres comme inaccessibles, que pour les partenaires, les mécènes et les élus locaux, qui s’interrogent sur la visibilité et la valorisation de ces collections.
Le Depot Boijmans Van Beuningen prend le contre-pied en rendant visible l’intégralité de la collection du musée Boijmans Van Beuningen, soit plus de 154 000 œuvres. Ce désir engendre des choix particuliers à l’organisation des réserves : les œuvres ne sont pas classées par période ou mouvement artistique, mais en les regroupant en fonction de leurs exigences climatiques et matérielles.
Autour d’un espace central, sorte d’atrium déstructuré par des escaliers et passerelles (qui me fait penser à l’école de sorciers Poudlard !), le dépôt fonctionne comme un immense coffre de verre. Cette ligne artistique pensée par la designeuse Marieke van Diemen permet l’observation — des œuvres, des réserves, des ateliers de restauration — sous de nouveaux angles.
Vues de l’atrium central conçu par Marieke van Diemen, Depot Boijmans Van Beuningen. ©NC
Explorer, observer, apprendre : quand la pédagogie s’invite au cœur du dépôt
Le dépôt n’est pas seulement un espace de stockage ouvert au public, il s’agit d’un lieu de travail à ciel ouvert. Depuis les passerelles vitrées, les visiteurs peuvent regarder les restaurateurs et conservateurs à l’œuvre, voir les objets d’art déballés ou préparés pour le transport. C’est l’occasion d’observer en direct une restauration d’une peinture, pour raviver le teint d’une joue, les reflets de soleil sur un ruisseau. Le dépôt donne l’occasion de comprendre le cycle de vie des objets d’art.
Vue sur les réserves, Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
L’absence de cartels classiques met en tension une expérience qui peut se révéler à la fois plus intimiste, grâce à la possibilité de voir les objets en vision 360 degrés, ou plus froide, en raison du détachement provoqué par l’absence initiale d’informations. Néanmoins, les visiteurs sont invités à scanner des QR codes pour obtenir des renseignements sur les œuvres, les plaçant dans une posture peut-être plus active de découverte.
À gauche : Les « chevalets en verre » de Lina Bo Bardi, 2022, © Boijmans Van Beuningen
À droite : Les QR codes © Boijmans Van Beuningen
Certains espaces du dépôt vont encore plus loin en proposant une hybridation entre exposition et atelier pédagogique en autonomie. Ils ne se contentent pas de montrer des œuvres : ils invitent le public à adopter la posture d’un chercheur en histoire de l’art. Un exemple marquant est l’initiative menée autour des dessins italiens de la Renaissance, où les visiteurs entrent dans la peau d’un expert : sans cartel explicatif immédiat, ils sont amenés à observer, comparer les styles, repérer des détails significatifs pour identifier les dessins.
Aperçu de Secrets of Italian Drawings, Dépôt Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024. © Lotte Stekelenburg.
Une identité hybride qui questionne le rôle des musées
Si le Depot Boijmans Van Beuningen se présente comme un projet visionnaire, il soulève néanmoins des interrogations sur son propre positionnement. Ce modèle où le public accède aux coulisses d’un musée est une innovation qui peut troubler ceux qui cherchent une narration claire ou une expérience d’exposition plus classique. L’absence de parcours structurant et l’utilisation du numérique pour accéder aux informations peuvent créer une distance avec les œuvres, rendant la visite déroutante pour certains.
Par ailleurs, en brouillant la frontière entre exposition et recherche, certains espaces du dépôt transforment la visite en une expérience participative, où le regard est plus analytique et interprétatif que contemplatif. Ce modèle, à mi-chemin entre la monstration d’œuvres et l’expérimentation pédagogique, introduit une nouvelle dynamique dans la médiation muséale, en faisant du spectateur un acteur actif de sa propre découverte.
Enfin, en raison des travaux de rénovation du musée Boijmans Van Beuningen, certains espaces du dépôt accueillent temporairement des expositions. Cette proximité permet au public de continuer à accéder aux collections du musée en dehors de ses dispositions habituelles. Ces installations confèrent au lieu une dimension muséale, bien que le Depot ne revendique pas ce statut. Cette ambiguïté interroge : est-on face à une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la notion même de musée ?
Un modèle d’avenir pour les institutions muséales ?
Le Depot Boijmans Van Beuningen préfigure-t-il une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la manière de concevoir l’accès aux collections muséales ? Il offre en tout cas une réflexion sur la transparence des institutions culturelles et sur la façon dont elles peuvent partager leurs ressources concrètes et intellectuelles avec le public. Une chose est certaine : en effaçant les barrières entre l’espace muséal et ses réserves, le Depot invite à repenser la relation entre conservation, exposition et interaction avec le public.
Nina Colpaert
#Rotterdam #muséeinsolite #réserves
Pour en savoir plus :
- Le site du dépôt : https://www.boijmans.nl/en/depot/about-depot
- Présentation de la médiation autour de l’exposition Secrets of Italian Drawings, Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024 : https://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/dans-la-peau-d-un-chercheur-sur-les-traces-des-dessins-italiens
- À propos des QR code présents dans le dépôt, un moyen de constituer sa propre réserve : https://www.boijmans.nl/en/depot/app

Dernière expo avant la fin du monde
En route pour la France !

Maurice Cullen, La Seine en hiver, Paris, 1902, huile sur toile, ©JR
Paris, bien sûr, à l’arrivée, la ville lumière pleine de promesses conquiert tous ces jeunes artistes. Et puis, passage obligé par Giverny, où Monet, toujours lui, a élu domicile et où se crée une colonie d’artistes assidûment fréquentée par nos Canadiens. Non loin de la capitale à la vie artistique foisonnante, et (souvent) débridée, Giverny offre des paysages sublimes de lumière et de verdure qui séduisent les jeunes artistes au premier coup d’œil.

Helen Mcnicoll, Septembre ensoleillé, 1913, huile sur toile, ©JR
Sur les côtes françaises
Paul Peel fait partie de ces artistes qui ont choisi de sortir de la capitale en plein été pour se diriger vers les côtes, en quête, sans doute, d’un peu de la douceur de leur pays natal. J’ai retenu de cette exposition son tableau intitulé La Jeune Glaneuse ou Les Papillons représentant une fillette descendant pieds nus une dune de sable, pleine de grâce, enfant joyeuse et insouciante, illuminée par les couleurs vibrantes de la nature.

Paul Peel, La Jeune Glaneuse ou Les Papillons, 1888, huile sur toile, ©JR
Univers féminin
Les impressionnistes Canadiens s’inscrivent dans une période résolument féministe et dans un contexte où l’émancipation des femmes est une priorité. Nombreuses sont celles qui, à l’instar d’Helen Mcnicoll, ont elles-mêmes fait partie de ce groupe de jeunes peintres et ont participé à la représentation des femmes au sein même de leur peinture. Henrietta Mabel May, si célèbre dans son pays, est notamment connue pour avoir été missionnée pendant le premier conflit mondial pour représenter le travail des ouvrières et leur accorde une place centrale dans sa peinture. Cette partie de l’exposition est particulièrement intéressante, et permet de replacer les artistes dans leur époque.
Nouveaux Horizons
Parmi eux, James Wilson Morrice et ses représentations de l’Italie du début du siècle, splendide et immobile sous un soleil de plomb. Morrice aime jouer avec l’eau et ses reflets, et Venise est, pour lui, un superbe terrain de jeu. D’un coup de pinceau assuré, il donne à voir églises et canaux entourés de personnages tranquilles, paisibles dans ses œuvres si gracieuses.

James Wilson Morrice, L’Eglise San Pietro di Castello, Venise, 1904 - 1905, huile sur toile, ©JR
Alors que certains choisissent l’Europe du Sud, et l’Italie, étape fondamentale depuis toujours dans la formation des jeunes peintres, d’autres poussent plus loin leur curiosité. L’exposition fait la part belle à ces peintres Canadiens partis de l’autre côté de la Méditerranée, visiter l’Afrique du Nord. Ils ont su saisir, alors, la beauté de la Tunisie et de l’Algérie, les couleurs chaudes des déserts de sable chaud, la sérénité des villes et des villages brûlés par le soleil et leur éclatante beauté, qu’ils nous retranscrivent dans un tourbillon de couleurs. Pour ces jeunes gens, toutes ces coutumes, ces costumes et ces langues qui leur sont étrangers, sont synonymes de nouveauté et de fascination. L’exposition le montre bien, à travers leurs œuvres, et l’on comprend parfaitement combien ils ont été séduits par tant de découvertes.
Retour au Canada
Artiste emblématique de cette période, Maurice Cullen est principalement connu pour ses paysages. Enneigés, tourmentés, tourbillonnants, ils provoquent l’impression de saisir un instant fugace, la beauté sauvage et furieuse du paysage qui se déchaine, comme un souffle glacé échappé du tableau.

Maurice Cullen, La Cathédrale Saint-Jacques, Carré Dominion, Montréal, v. 1909 – 1912, huile sur toile, ©JR
De l'impressionnnisme au modernisme
C’est à cette époque que se constitue le Groupe des Sept, sur lequel s’achève l’exposition. Héritiers des peintres impressionnistes, les membres de ce groupe d’artistes qui se constitue en 1920 cherchent à moderniser leur art et à créer une véritable identité canadienne dans la peinture. Ils choisissent de représenter leurs paysages, leurs villes et leurs campagnes, abandonnant les représentations humaines pour ne garder que la « substantifique moëlle » de ces paysages, peints de couleur vives et qui impressionnent grandement le spectateur. Cette partie finale de l’exposition montre comment ces artistes, retournés au pays, ont emmené avec eux une part de l’impressionnisme rencontré en venant en France.
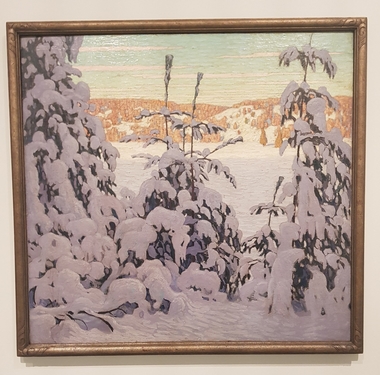
Lawren S. Harris, Neige II, 1915, huile sur toile, ©JR
Ainsi s’achève ce voyage au Canada à la rencontre de peintres dont je n’avais bien souvent jamais entendu parler. J’ai aimé le sujet original de cette exposition itinérante, qui fait à Montpellier son seul arrêt français avant d’être finalement présentée au Musée des Beaux-Arts d’Ottawa.
Juliette Regnault
#Canada
#MuséeFabre
#Impressionnisme

Devenir un artiste, un jeu d'enfant !

L’espace enfant dans l’atrium ©C.DC
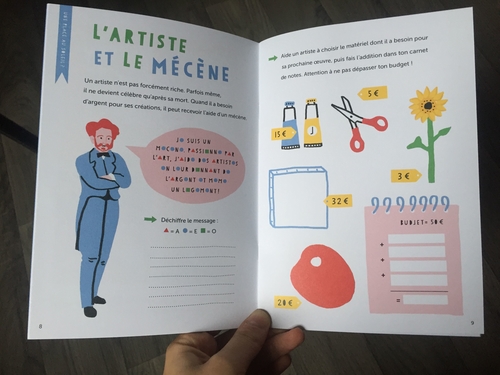
L’artiste et le mécène, extrait du livret enfant ©C.DC
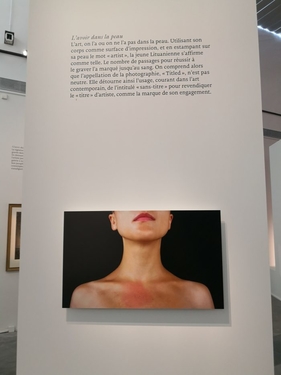
Des cartels intéressants mais trop hauts. © Stéphanie Devisscher
Une fois rentrée à la maison, je commence mon premier travail d’artiste : je reprends mon livret, je me dessine et j’ajoute un collier à fleurs et un perroquet sur l’épaule que je découpe dans le carnet. C’est décidé : moi aussi je veux devenir une artiste !
Clémence de CARVALHO
#artiste
#exposition
#parcoursenfant

Éco-conception et réutilisation du mobilier d'exposition, ou écrire des histoires originales avec des phrases analogues…
Montage Tano Lops
- Développer la sobriété (en matériaux et consommation), en lien avec les artistes, des scénographies et spectacles,
- Produire des matériels scénographiques démontables pour faciliter la réutilisation ou le recyclage des éléments, et éviter d’avoir un principe constructif à usage unique,
- Promouvoir l’approvisionnement en matériels d’occasions, nécessitant en amont d’identifier les lieux où se procurer en biens de réemploi. Il faut aussi utiliser des matériaux intégrant une part de matière recyclée.
- Une incertitude sur leur qualité de réaction au feu au regard de l’absence de documentation ;
- Une incertitude sur le maintien des performances évaluées dans le cadre des essais réalisés lors de leur mise initiale sur le marché pour leur nouvel emploi, selon la durée de vie précédente et les éventuelles modifications subies.

Espace d’exposition temporaire, Palais des Beaux-Arts de Lille

Jacques Averna, Les Régies, crédit : Jacques Averna
Tano Lops-Maitte
POUR EN SAVOIR PLUS :
- Réemploi des éléments de scénographie et règlementation ERP : le défi juridique du secteur de la culture, Elisabeth Gelot : https://skovavocats.fr/reemploi-elements-scenographie-et-reglementation-erp/
- Association Les Augures : https://lesaugures.com/L-association
- Définir des modes de production écoresponsables dans les différents secteurs : l’éco-production et le réemploi dans les décors et la scénographie, Ministère de la Culture :
- https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/transition-ecologique/definir-des-modes-de-production-ecoresponsables-dans-les-differents-secteurs-l-eco-production-et-le-reemploi-dans-les-decors-et-la-scenographie
- Retour sur l’exposition « Matière grise – matériaux, réemploi, architecture », Ville de Nice :
- https://cultivez-vous.nice.fr/exposition/forum-durbanisme-et-darchitecture/retour-sur-lexposition-matiere-grise-materiaux-reemploi-architecture/
- La Forêt magique, une exposition écologique pensée comme une ode à la forêt ! https://www.grandpalais.fr/fr/article/la-foret-magique-une-exposition-ecologique-pensee-comme-une-ode-la-foret#:~:text=à%20la%20forêt%20!-,La%20Forêt%20magique%2C%20une%20exposition%20écologique%20pensée,une%20ode%20à%20la%20forêt%20!&text=Nous%20plonger%20au%20coeur%20de,jusqu'au%2019%20septembre%202022%20!
- PDF RESTITUTION DU WORKSHOP, CONSTRUIRE LA DURABILITÉ DE NOS MUSÉES, Ville de Lille https://pba.lille.fr/content/download/6162/71025/file/WORKSHOP_Programme+complet.PDF
- DOSSIER TECHNIQUE DE STANDARDISATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCORS DU COLLECTIF 17H25 : https://www.uniondesscenographes.fr/documentation/eco-conception/dossier-technique-de-standardisation-delements-de-decors-du-collectif-17h25/
[1] The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition Francis Haskell
[2] Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées Métropolitains-Rouen Normandie
[3] Éco-conception : effort de conception portant sur l’ensemble de la chaîne de production d’une exposition (commissariat, scénographie physique et digitale, communication, action et accueil du public, édition, outils numériques) visant à réduire son impact environnemental et à maximiser son impact social en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des matériaux mobilisés.
[4] Article R*123-5 - Code de la construction et de l'habitation : Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
[5] Adeline Rispal, Architecte scénographe (Ateliers Adeline Rispal), Présidente d’XPO, Fédération des Concepteurs d’Expositions
#réemploi #scénographie #création

Et la lumière fut !
Cette année, Reims fête comme il se doit le huit centième anniversaire de sa cathédrale. Chef-d’œuvre de l’architecture gothique, cette dernière s’est vue ornée des nouveaux vitraux d’Imi Knoebel. L’artiste contemporain allemand répond ici à une commande publique soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce n’est pas la première fois que des vitraux d’édifices religieux rémois sont réalisés par des artistes contemporains. Leurs implantations témoignent du savoir-faire des maîtres verriers locaux tel que Simon Marq.
© Musée des Beaux-arts de Reims
À cette occasion, le musée des Beaux-arts de Reims présente une exposition dédiée aux vitraux et à leur changement de perception grâce à ces artistes. Cette irruption de l’art profane dans un contexte sacré et dans une spécification artisanale fait écho à la reconstruction de quantité d’édifices religieux après les grandes guerres mondiales. Tel est le fil conducteur de cette exposition intitulée Couleurs et lumières : Chagall, Sima, Knoebel, Soulages… des ateliers d’art sacré au vitrail d’artiste.
En parallèle avec la mise en lumière et couleur exceptionnelle de la façade de la cathédrale de Reims, les commissaires David Liot, directeur du musée et Catherine Delot, conservatrice en chef, nous entraînent dans un parcours initiatique avec le travail du verre, de la couleur et de la lumière. Dessins, croquis, préparations, mais aussi focus sur les artistes qui marquent le renouveau du vitrail et son évolution : cubisme, fauvisme, abstraction.
Ainsi, on retrouve le travail préparatoire d’Imi Knoebel : du rouge, du jaune et du bleu dans tous les sens ! Ces couleurs primaires, qui font partie de la palette de l’artiste, font résonance avec celles utilisées par les maîtres verriers jusqu’au 19ième siècle. Pour mettre son travail en condition, les commissaires de l’exposition ont opté pour une remarquable approche : un vitrail de l’artiste a directement été inséré au cœur de l’un des murs du musée ouvrant la perspective sur la cathédrale !
Ceux qu’il a réalisés pour la cathédrale de Reims prennent place de part et d’autres des vitraux qu’avait achevés en 1974 Marc Chagall. Dans cette lignée, le musée des Beaux-arts de Reims nous présente le travail de Chagall, bien-sûr la préparation des vitraux de la cathédrale de L’ange au sourire, mais aussi ceux qu’il a exécutés pour d’autres églises. Ainsi le travail de Sima, de Da Silva, qui ont eux aussi travaillé le verre sur d’autres édifices religieux rémois, mais aussi toute la genèse des vitraux de Pierre Soulages à l’abbaye de Conques sont exposés.
On comprend vite à quel point la création contemporaine a su saisir l’opportunité de s’immiscer là où l’on ne l’attendait plus. La lumière et le verre comme médium permettent de travailler la couleur, la translucidité et de révéler les architectures sacrées. Ainsi en témoigne le parti pris de la scénographie d’exposer sur des cimaises colorées, plongeant le visiteur dans l’ambiance émanant de chaque artiste. Les vitraux et esquisses sont d’une grande splendeur, leur mise en situation est vraiment très réussie, surtout pour une exposition consacrée aux vitraux et donc à la lumière. En effet, nombre d’entre eux sont exposés dans des caissons lumineux en fer forgé, tel le plomb d’un vitrail, laissant apercevoir les détails et autres imperfections du verre, devant nous, à posture humaine. Splendide !
Catalogue de l’exposition, Co-édition Point de vues et Musée des Beaux-arts de Reims
Heureusement, pour pallier ce bémol, un magnifique catalogue a été réalisé afin de pousser plus loin la réflexion sur le vitrail, rappelant les liens fondamentaux entre l’artiste et le maître verrier, la couleur, le verre et la lumière.
Romain Klapka
Explorateur : prends ton carnet, et pars à la conquête du musée
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l'Illustration, situé à Strasbourg, regroupe un fonds important d'environ 11 000 dessins, archives, jouets et revues donnés à sa ville natale par le dessinateur et illustrateur français Tomi Ungerer. C'est l'un des seuls musées consacrés entièrement à l’œuvre d'un artiste encore vivant à l'heure actuelle. L’ensemble de la collection est présenté dans un parcours thématique d’environ 300 œuvres originales comportant des dessins de livres pour enfants, des dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres érotiques. Son travail est également mis en parallèle avec d'autres grands illustrateurs du XXe et XXIe siècle, notamment grâce aux expositions temporaires renouvelées fréquemment.

© Musées de la Ville de Strasbourg
C'est dans le parcours permanent que s'inscrit le carnet « explorateurs du musée Tomi Ungerer » outil de médiation et d'aide à la visite. Clairement destiné au jeune public, ce livret est rempli d'images de l’artiste ainsi que de propositions pour rendre l'enfant actif dans le musée et mettre à profit son imagination.
 © Musées de la Ville de Strasbourg
© Musées de la Ville de Strasbourg
Commençons donc par étudier la forme donnée à cet outil de médiation. Le choix du support papier se réfère immédiatement aux carnets de croquis et livres illustrés présents ce qui en fait un choix évident. Les couleurs vives sont une référence à la quadrichromie employée dans l'imprimerie, Elles ont cependant été utilisées avec beaucoup trop de facilité. En efet, la conception globale est très classique, sans cachet, on ne retrouve pas du tout l'esprit de l'artste. Par chance, cela n'altère pas son utlisaton. L'alternance de visuels très diférents (photos, dessins) permet de garder l'attention de l'enfant et renouveler son imaginaire notamment grâce à des actvités dont les instructons restent très claires grâce à un discours familier facilitant la compréhension de chacun. Prenez pour exemple les extraits ci-contre, les couleurs sont vives, le message est clair, mais le tout manque clairement de liant.
A contrario, les activités proposées sont plutôt pertinentes, et vont permettre à l'enfant de mieux appréhender le musée, mais surtout l’œuvre de Tomi Ungerer. L'entrée dans son œuvre petit à petit, selon les titres suivants : qui es-tu ?, le trait, les supports et les outils, expression et émotions, mise en scène et cadrage, le texte et l'image, l'absurde et le collage, le bricolage et la récup', engagement et la cocote de Tomi. Comme attendu, le carnet laisse la part belle au dessin. En s'inspirant des œuvres présentées, cherchées, choisies par l'enfant dans le musée, l'enfant se réapproprie les principes de l’artiste pour créer ses propres personnages et histoires. On peut, par exemple, reproduire son style graphique à la ligne claire, en hachures ou en niveaux de gris en se basant sur un des éléments exposés dans le musée. La page suivante on assemblera ces différents objets en un seul pour tomber dans le domaine de l'absurde, notion souvent abordée par l’artiste. Le livret provoque des allers-retours constants entre les éléments exposés et les activités, l’exploration du lieu est mise à profit dans chaque parte. Ainsi, son utilisation pourrait se diviser en trois temps. Un temps d’observation où l'enfant devient un enquêteur au sein du musée afin de répondre aux questions posées, mais aussi s'inspirer pour la parte deux où il devient à son tour illustrateur en s'inspirant de tout le travail effectué par l’artiste et présenté dans le musée. Le troisième temps, qui correspond à la dernière partie du carnet propose une médiation hors du musée, directement au domicile de l'enfant. On crée sa propre sculpture avec les objets que l'on trouve à la maison et en bonus la dernière page se transforme en cocote, laquelle permet selon les citations découvertes de revisiter telle ou telle activité proposée précédemment dans le cahier.
Il vient donc en accompagnement de la visite. Distribué au jeune public à l'accueil du musée, il permet une visite autonome de l'enfant si celui-ci sait lire convenablement. Pour les autres, l’activité se fait en famille, les parents servant alors d'intermédiaires pour expliquer les activités à mener, l'aider dans ses recherches tout au long du parcours.
Alors faut-il vraiment mettre ce carnet d'explorateur entre toutes les mains des enfants qui entrent dans le musée ? La volonté du musée est de rendre l'enfant actif tout au long du parcours afin d'augmenter son intérêt et sa compréhension des pièces présentées semble être plus efficace qu'une visite traditionnelle avec un guide qui envoi des informations à des enfants passifs. En effet, on apprend bien quelques éléments clés sur l’œuvre de Tomi Ungerer et les techniques qu'il utilise, mais l'efficacité de l’outil aurait pu être amplifiée si la réalisation avait été menée avec plus de rigueur. Peut-être aurait-il été judicieux de s'inspirer du style graphique de l’artiste, afin de donner à ce carnet une plus grande personnalité.
En clair, un fond intéressant et pile dans la cible, mais une mise en forme qui réduit un peu l'impact de la médiation. Ce livret a vraiment sa place dans le musée, il faut juste espérer dans le futur avoir une réalisation plus rigoureuse afin de rendre l'objet incontournable pour la visite.
Anaïs Kraemer
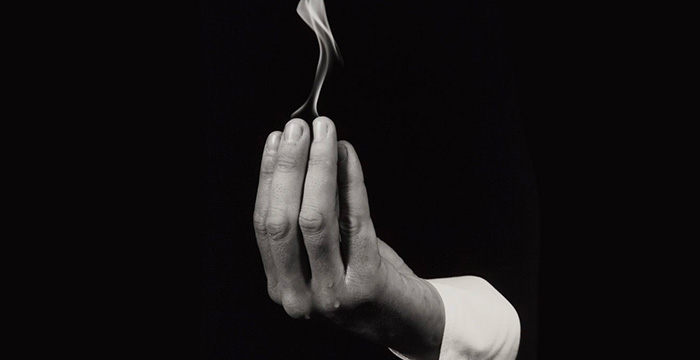
Exposer l'art contemporain dans un musée de beaux-arts, pour quoi faire ?
Depuis le début des années 1980, il existe en France les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (dit FRAC) dont les objectifs principaux sont de collecter, conserver et diffuser localement des œuvres d’art contemporain, toutes pratiques confondues. En créant ainsi une collection nationale, l’État souhaite soutenir les artistes nationaux et internationaux tout en décentralisant l’art de Paris pour l’apporter à tous.
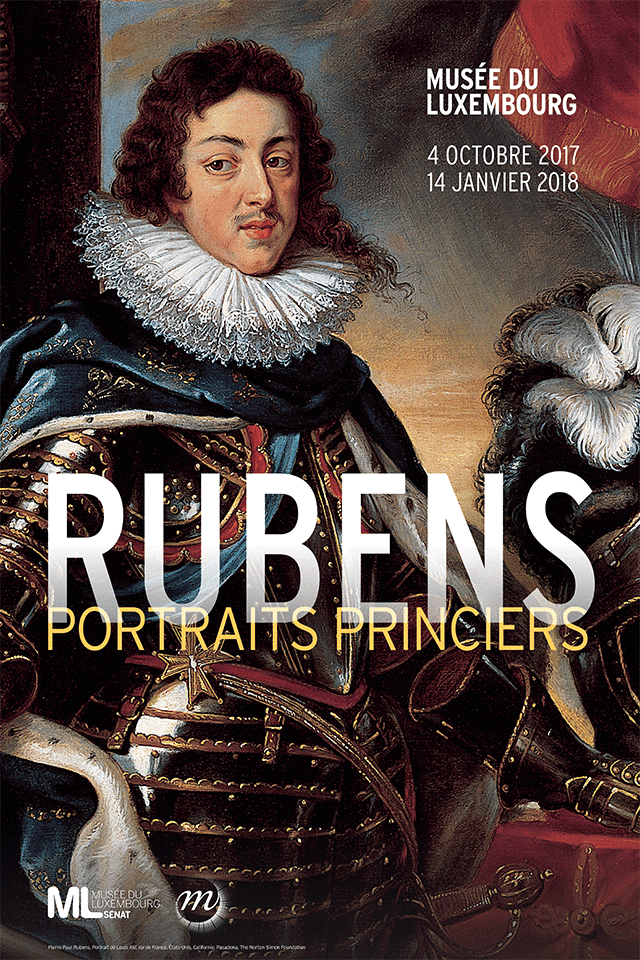
Exposition Rubens, autopsie d'une aura
L’exposition pensée par le muséographe commence quand on passe la porte. Mais la rencontre entre l’exposition et le visiteur commence bien plus tôt : dès qu’il l’imagine à partir de la communication, qu’il découvre certains contenus par des lectures ou des jeux, qu’il achète des objets sélectionnés ou créés pour l’exposition etc. Tout ce qui est autour de l’exposition constitue ce qu’on pourrait appeler une aura. Nous proposons d’en étudier une précisément.
Premier regard
Notre exemple est l’exposition « Rubens, portraits princiers » qui se tient au Musée du Luxembourg (en partenariat avec la réunion des monuments nationaux) du 4 octobre 2017 au 14 janvier 2018. De cet énoncé se dégage déjà de nombreux indices : le visiteur sait qu’il a affaire à une exposition d’art abordée sous 3 angles croisés : le peintre célèbre, un type de réalisation et une catégorie de sujets. Le lieu, central, royal, politique, ne dessert pas l’aura fastueuse de Rubens et de ses sujets princiers.
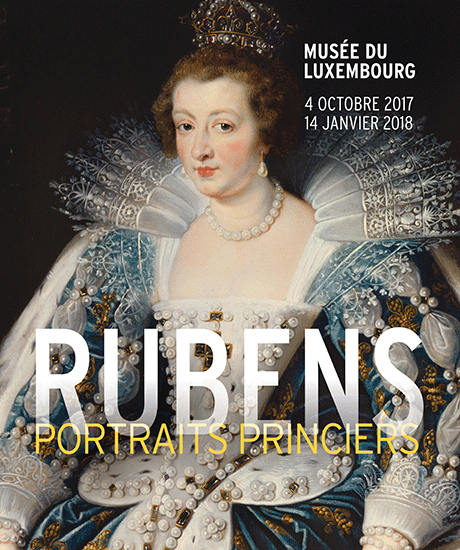
Affiches de l’exposition © Musée du Luxembourg
Les affiches complètent cette première impression : les tableaux choisis, un homme et une femme, font honneur aux détails vestimentaires des costumes d’apparat et à des visages altiers. Face au luxe des peintures, le graphisme se fait simple mais très explicite. Le titre « RUBENS » est immense et du même blanc que les dentelles de ses tableaux, souligné par un sous-titre « PORTRAITS PRINCIERS » en jaune d’or.
Il s’agirait presque d’inverser les rôles : Rubens avait signé en tout petit ses tableaux de personnages célèbres que chacun connaissait et révérait. Aujourd’hui, c’est la célébrité du peintre qui fait qu’on présente ces tableaux et sera prétexte à revenir sur l’identité de ces têtes couronnées.
Le communiqué officiel, synopsis ou dithyrambe ?
Le texte officiel de présentation de l’exposition est le suivant :
« Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord peintre de grands sujets historiques, il excella dans le domaine du portrait d’apparat, visitant les plus brillantes cours d’Europe. Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua aussi un rôle diplomatique important, jouissant d’une position sociale sans égale chez les artistes de son temps. Autour des portraits de Philippe IV, Louis XIII ou encore Marie de Médicis réalisés par Rubens et par quelques célèbres contemporains (Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle. »
Au premier abord, ce texte fait miroiter la réussite de Rubens sous tous ses angles : « immense portraitiste », « excella », « les plus brillantes cours d’Europe », « position sociale sans égale », « Philippe IV, Louis XIII ou encore Marie de Médicis » ou « célèbres contemporains (Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van Dyck) ». Ce choix pourrait nous inquiéter, impliquer que cette exposition ne serait fondée que sur la célébrité sans nuance et sans explication des peintres ou des sujets.
Mais, en seconde lecture, un portrait est esquissé, celui de Rubens lui-même. L’exposition semble s’appuyer sur les différentes facettes du personnage : ses qualités humaines, ses motivations professionnelles, ses compétences de peintre et sa position sociale.
La dernière phrase, enfin, lie tous ces grands noms par la promesse de plonger « au cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle ». Rubens devient alors le héros de notre nouvelle série historique préférée (enfin plutôt de notre future exposition préférée), chaque célébrité devient un personnage et le faste des palais devient le décor. La promesse d’entendre des histoires séduira peut-être les visiteurs encore indécis.
Les contenus complémentaires, des amuse-bouche ?
Avant ou après l’exposition, on trouve en ligne des aides à la visite (une vidéo promotionnelle, le guide de la visite, des applications mobiles à télécharger et le dossier pédagogique), et des contenus complémentaires (des articles, des liens vers d’autres productions et des jeux). Puisque ces derniers sont davantage autosuffisants c’est eux que nous étudierons pour avancer encore dans notre autopsie de l’aura de l’exposition Rubens.

Page d’accueil du jeu © Musée du Luxembourg
Le jeu et l’article permettent de rentrer dans le contenu de l’exposition par des biais aussi différents que l’action (le jeu) ou la réflexion (l’article). Elles ont des publics cibles probablement différents (le jeune public, les intellectuels) mais j’avoue avoir aimé autant l’un que l’autre. Elles construisent le suspense sans en révéler trop sur l’exposition.
Ces deux créations démontrent que cette exposition suit un cheminement, développe un contenu riche et ne se contente pas d’afficher des grands noms et des couronnes dans un Palais. Le jeu éduque notre regard aux détails de l’œuvre de Rubens, aux couleurs, à la symétrie, à la subtilité. Il nous implique aussi dans le geste de composition d’un tableau. Mais on n’a vu qu’un seul tableau !
L’article, quant à lui, est bref mais situe bien les enjeux des portraits au XVIIe siècle et, par l’intermédiaire d’une vidéo, introduit une comparaison avec les portraits officiels présidentiels et leurs symboles. Cette pensée ouverte donne des clés de compréhension tout en stimulant l’attention du visiteur et son esprit critique. Cela donne envie de voir si les textes de l’exposition sont de la même veine !
La boutique et les produits dérivés
La boutique, en ligne et sur place, étoffe encore cette aura par un étal varié et séduisant. Parmi les classiques, guide de l’exposition, presse, livres d’art ou de réflexion sur la thématique et parmi les produits sur mesure, un livre écrit pour l’occasion Rien que Rubens de Philippe Forest (éditeur : Réunion des Musées Nationaux), ainsi qu’un espace d’impression à la demande (sur toile ou papier) des œuvres de l’exposition. Une manière de rapporter plus qu’une carte postale pour afficher dans son salon. L’impression se fait sur place, remise en main propre ou à domicile pour des prix variés. Par ailleurs, la boutique du musée du Luxembourg est placée sous le regard d’un prince et d’une princesse, les mêmes que sur les affiches. En très grand format, ils surplombent la salle où différents objets vendus font écho au luxe de leur parure comme des bijoux imitant la dentelle ou bien des mouchoirs en véritable dentelle.
Pratique plus originale, la boutique étend ses « goodies » habituels (mugs, crayons, marque page, magnet …) à des couteaux (coupe papier), des bières et des spéculoos ! Les trois produits mettent en avant leur origine et on comprend que la géographie européenne (Belgique et Italie tout du moins) aura une importance toute particulière dans l’exposition.
L’aura de cette exposition est riche, dans tous les sens du terme.
Visitez l’exposition !
Et voyez si elle tient ses promesses ?
Eglantine Lelong
#rubens
#muséeluxembourg
#princes
Pour en savoir plus :
Vous pouvez trouver le jeu ici : http://jeunepublic.grandpalais.fr/puzzle-rubens/moyenEt l’article « Qu’est-ce qu’un portrait » ici : http://www.grandpalais.fr/fr/article/quest-ce-quun-portrait

Fantastique ! Deux expositions en une
Depuis quelques semaines déjà, une exposition au titre intrigant s’est installée au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris : « Fantastique ! » Alors que se cache t-il derrière ce titre évocateur et plein de promesses ?
L’exposition « Fantastique ! » est en réalité deux expositions en une. « Kuniyoshi le démon de l’estampe » compose la première partie du parcours complété par « L’estampe visionnaire, de Goya à Redon » en partenariat avec la BNF. Comme vous l’aurez compris, cette double exposition traite de l’estampe, à la fois japonaise et occidentale. Outre leur technique, leur thématique est également commune : le fantastique, c’est-à-dire la transgression du réel, l’imaginaire, le rêve mais aussi le surnaturel.

Affiche de l'exposition - © Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris
Ces deux espaces ont été pensés comme unparcours global et par un même scénographe, Didier Blin ; l’expérience etle discours sont liés et les expositions ne peuvent vivre l’une sans l’autre.
Kuniyoshi, le démon de l’estampe
Le Petit Palais met donc à l’honneur dans cette première partie du parcours un maître d’estampes japonaises du XIXesiècle moins connu que ses illustres confrères, Hokusai et Hiroshige, et pourtant tout aussi talentueux.
Le parcours, présenté de façon thématique, invite le visiteur à s’échapper avec des titres aussi évocateurs que poétiques : Légendes, guerriers et dragons, paysages au bord de l’eau, les plaisirs d’Edo... Les œuvres colorées et dynamiques de Kuniyoshi s’intègrent parfaitement dans une scénographie vive et joyeuse qui donne le rythme à une visite passionnante.
 Entrée de l'exposition © LT
Entrée de l'exposition © LT
Le cheminement se termine par un espace pédagogique qui introduit la technique de l’estampe japonaise à l’aide d’outils et de vidéos (mais peut-être un peu tard après avoir vu toutes les œuvres !). Confortablement installé dans des fauteuils colorés, le visiteur peut également lire des mangas mis à disposition pour comprendre à quel point Kuniyoshi a influencé ce genre littéraire.
L’estampe visionnaire, de Goya à Redon
Après une orgie de couleurs, et unetransition par des espaces de projections d’estampes animées, le visiteur entre dans la seconde exposition. La scénographie s’adapte aux œuvres présentées, uniquement des estampes en noir et blanc aux sujets très sombres et macabres, en ôtant toute joie et vivacité dans les couleurs.
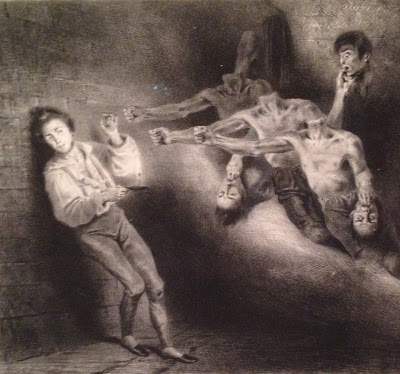 Les Spectres sans têtes - Lithographie d’après LouisBoulanger © Maison de Victor Hugo
Les Spectres sans têtes - Lithographie d’après LouisBoulanger © Maison de Victor Hugo
Goya, Redon, Doré... chaque estampe paraît plus stupéfiante et captivante que la précédente. Là encore, l’aspect pédagogique n’est pas oublié et une salle présente les différentes techniques d’estampes grâce à des vidéos, des œuvres et des outils.
On parcourt peut-être plus vite cette exposition, du fait de sa seconde position mais aussi troublé par la force des représentations de la mort, notamment par le très bel accrochage des pendus.
Fantastique ! est une des expositions de la rentrée à ne rater sous aucun prétexte : la qualité des œuvres et du discours et la poésie mais aussi l’horreur qui s’en dégagent devraient captiver le visiteur le plus exigeant !
Laura Tralongo
Exposition Fantastique !
Petit Palais, Musée des beaux-arts de laville de Paris
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Du 1er octobre 2015 au 17 janvier 2016
#fantastique
#estampe
#imaginaire

Faut-il crier au génie quand les artistes deviennent commissaires d’exposition au MAH ?
Il y a un an, c’est l’artiste Suisse Ugo Rondinone qui présentait « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP » et dans quelques mois, c’est l’artiste belge Win Wenders qui va présenter son exposition entre le mois de janvier et juin 2024, mais à quel prix ?
Surmontant la ville de Genève, le Musée d’Art et d’Histoire (MAH) est à la recherche d’un nouveau souffle à la suite au projet de rénovation de Jean Nouvel, qui fut révoqué par la population genevoise en 2016.
Suite à la prise de poste de Jean-Olivier Wahler le 1ᵉʳ novembre 2019, l’ancien directeur du Palais de Tokyo et du MSU BROAD MUSEUM, (Michigan State University, East Lansing, Etats-Unis), souhaite créer une nouvelle vision du MAH par le biais d’un nouveau programme culturel, modifiant complément l’identité du musée.
Dans son programme, fort critiqué par la population genevoise et tout particulièrement le comité scientifique, le directeur axe sa politique sur trois sujets : la rénovation et l’agrandissement du musée, les expositions (et plus particulièrement les cartes blanches) et l’implication du public dans les espaces muséaux par le biais d’évènements, d’afterworks, de conférence et de projets pluridisciplinaires et collaboratifs.
Le premier grand projet fut le lancement de ses « Cartes Blanches » d’exposition. Concernant cette typologie d’exposition du MAH, la « Carte Blanche » se définit comme une exposition XL, « mobilisant plusieurs champs de la collection, le plus souvent confiés à un.e commissaire invité.e, et appelées à modifier une large part des espaces. »[1]. Au bout de trois éditions, la première datant de 2021 avec l’artiste Jakob Lena Knebl, la seconde avec Jean Hubert Martin en 2022 et Ugo Rondinone en 2023, la saison 2024 de l’exposition « Carte Blanche » est confiée à l’artiste belge Wim Delvoye. En quoi ce concept d’invitation des artistes est-il pertinent pour la collection du MAH ? et le projet scientifique du musée ?

Vue de l’exposition, La chambre, Ramsès II, Genève, Musée d’Art et d’Histoire © MAH / J. Grémaud
Un projet scientifique et culturel uniquement lier à ses collections
Suite à deux ans de travail, le nouveau directeur du musée a souhaité recentrer son P.S.C (Projet Scientifique et Culturel) sur les collections du MAH, contenant plus ou moins 650 000 objets de tout genre, la question est donc la suivante : pourquoi ? et comment ?
En 2021, la première édition des « Carte Blanche » définit les règles : mise en avant des collections de tout genre (beaux-arts, archéologie, art graphique), des objets présents dans les réserves (sois 99% de la collection), scénographique dessinée par l’artiste, transformation de la totalité du 1ᵉʳ étage en espace d’exposition, publication d’un catalogue d’exposition et billetterie entièrement gratuite ou « Pay as you wish ».
Or, la première édition fut aussi celle des questionnements et de la réception du public, qui a l’habitude des expositions monographie et thématique et non pas d’une « carte blanche », un terme trop vaste pour le grand public.
L’exposition de Jakob Lena Knebl, première commissaire d’une série de grandes expositions « Carte Blanche » était ouverte du 28 janvier 2021 au 27 juin 2021, or suite aux restrictions sanitaires, l’exposition ne fut visible qu’à partir de mars, ce qui n’a pas empêché à 27 173 curieux d’explorer cette exposition, à la scénographie, étrange, métallique et tumultueuse.
En 2022, c’est le commissaire d’exposition Jean-Hubert Martin, reconnu pour son exposition le « Magiciens de la terre » en 1989 qui questionne et redistribue les cartes de la collection du MAH. Entre le 28 janvier 2022 et le 18 juin 2022, le commissaire renouvelle la présentation des collections du MAH, regroupant les objets par couleurs, une salle par couleur, tel un arc-en-ciel, des formes dans un accrochage ressemblant à un salon du 19ᵉ.
Il y a un an, c’est l’artiste Suisse Ugo Rondinone qui prend les rênes du projet pour présenter « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP », une exploration esthétique des collections autour des œuvres de deux figures suisses : Felix Vallotton et Ferdinand Hodler, et des créations contemporaines de Rondinone.
Dans quelques mois, c’est l’artiste belge Win Wenders qui va présenter son exposition entre le mois de janvier et juin 2024, à quel prix ?
Une présentation renouvelée, une collection renouvelée, mais temporaire.

Ugo Rondinone, salle “Espace rythmique. Dix piliers”, exposition When the sun goes down and the moon comes up, MAH, Genève, 2023 © Musée d’art et d’histoire de Genève, Ph. Stefan Altenburger
Dans le cadre de ces « carte blanche » annuelle, plusieurs questions se posent. Tout d’abord la temporalité de l’exposition, la première version de l’exposition se déroulait de janvier 2021 à mai 2021. Or, depuis la seconde version, l’exposition commence en mars pour se conclure en juin-juillet. Est-ce un changement d’agenda pour éviter la période creuse du musée ? ou rajouter des précieux mois aux artistes et aux équipes du musée pour finaliser ce projet ? Dans les deux cas, le fait d’avoir une exposition de plus ou moins 4-5 mois permet au public de revoir l’exposition, et en soit les œuvres méconnues du musée. La réalité est tout autre, souvent la scénographie de ce genre d’exposition prend énormément de temps, d’autant plus qu’en moyenne 300-500 objets, de toute taille et genre sont présentés, donc 600-1000 constats d’état, des litres de peintres, des milliers d’outils et, peut-être, peu de personnel. En dehors de ses objets, il y a aussi leurs états sanitaires, faut-il les restaurer, les préparer à leurs accrochages, etc.
D’autre part, la scénographie et la muséographie à plusieurs problématiques, dans aucune des nouvelles « carte blanche » il y a eu une réutilisation d’élément, aucune reprise d’assises, de socle, de couleur des salles, des cimaises ou des soclages. Or, tous ses éléments pourraient mettre des objets en avant dans d’autres expositions du musée, ou, encore mieux dans les collections permanente. En parlant de collection permanente, rares sont les œuvres qui reprennent la direction des collections, la plupart reviennent en réserve, ce qui pose la question de l’utilité technique et de conservation des œuvres, mais aussi du travail scientifique du projet.
En dehors de ces divers aspects, la communication des expositions est, dans ce cas, une bonne nouvelle. Que ce soit dans les flyers, les affiches, et tout support utilisé pour la promotion externe de l’exposition, le musée suit sa ligne graphique créée par le studio de graphisme zurichois Hubertus Design. Depuis 2019, celui-ci crée une nouvelle unité graphique, qui, de surcroit, est différente des autres musées genevois, mais semble trop contemporaine pour un musée d’art et d’histoire, selon la représentation classique que l’on s’en fait.
La question des liens, entre le musée et le marché de l’art
Dans le cas de ces expositions, une question éthique subsiste : quels sont les aspects juridiques conventionnés entre le plasticien et le musée ? Des droits du musée d’utiliser les œuvres (les droits à l’image dans la communication par exemple), à celui de l’artiste non censé vendre une œuvre via un musée public présentée durant l’exposition.
Lors de l’exposition « carte blanche » d'Ugo Rondinone, « WHEN THE SUN GOES DOWN AND THE MOON COMES UP » que penser de la galeriste qui le représente, la galerie Eva Presenhuber. Selon de nombreuses sources journalistiques, la galeriste a envoyé à ses bons clients la documentation de l’exposition actuelle du MAH, avec la liste complète des prix. Vous pourrez donc vous offrir un « showcase », le MAH, qui ne recevra aucune redevance des ventes. Le minimum serait de remercier le MAH par un don d’une ou deux des œuvres présentées au MAH, par exemple… ce qui ne fut jamais le cas depuis l’introduction des « carte blanche ».
GASGAR Lucas
#Suisse #Exposition #Contemporain
[1] https://www.mahmah.ch/sites/default/files/pdf/2023-06/Web_N.MAH_concept-musee_MAH_DEF.pdf

Goya, une expérience de l'écoresponsabilité du palais des Beaux-Arts de Lille
À l’heure où le développement durable est au cœur des préoccupations, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose pour la première fois une exposition écoconçue. L’ensemble est un dialogue entre œuvres picturales et cinématographiques plus contemporaines, s’inspirant de la vie du peintre. Et au cœur de cette exposition, deux toiles Les Jeunes et Les Vieilles du peintre espagnol Francisco Goya, que l’exposition décadre.
Image de couverture : Expérience Goya, atrium du Palais des Beaux-Arts © Marion Blaise
L'écoconception d'une exposition
Le développement durable est, selon l’INSEE, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». L’enjeu est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Répondre à ces trois problématiques, c’est le défi que s’est lancé le Palais des Beaux-Arts de Lille pour sa nouvelle exposition temporaire Expérience Goya. Soucieux de l’environnement, le musée souhaite maîtriser son impact environnemental et avoir une portée sociale forte.
La scénographie des expositions temporaires entraîne généralement de gros coûts financiers et environnementaux pour un temps court. Pour cette exposition, au moins 70% de la scénographie de la manifestation sera réutilisée pour les deux ou trois prochaines expositions temporaires du musée. C’est du moins ce qui est expliqué aux visiteurs dans un espace-couloir limitrophe à l’exposition.
Si les expositions temporaires sont souvent propices au transport d’œuvres dans le monde entier, l’Expérience Goya limite cette pratique. Les deux œuvres phares de l’exposition, Les Jeunes et Les Vieilles viennent des collections du Palais des Beaux-Arts tout comme la série d’eau forte Les Caprices, dont quatre-vingts planches sont conservées dans les réserves. Seulement deux tableaux ont été transportées par avion. Les prêts sont réalisés avec des pays très proches de la France comme la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. Le musée met en place cette volonté nouvelle de créer des expositions avec des musées voisins, en gardant toujours la qualité scientifique et esthétique comme principales préoccupations.
La volonté de médiation s’exprime à travers l’écriture des cartels. Ceux ne sont pas des cartels classiques qui sont proposés, comprenant le titre et la description de chaque œuvre, mais des cartels qui entrent dans un véritable parcours, celui de la vie et de l’œuvre de Goya. Cette proposition répond à l’enjeu social donnant le maximum de clés de compréhension aux visiteurs : contexte historique, contexte de réalisation de l’œuvre, réflexion du peintre.
Pour l’Expérience Goya, la musique, avec les ambiances sonores composées par Bruno Letort spécialement pour l’exposition et la projection vidéo sont utilisées consciemment, appuyant l’expérience du visiteur sans éclipser les peintures et les dessins présentés. Le numérique, bien présent dans l’exposition, dans la rotonde et sur les deux écrans géants au début et à la fin de la visite, engendre une pollution importante au même titre que le transport des œuvres ou la construction scénographique. Le Palais des Beaux-Arts de Lille utilise consciemment cet outil, comme support de compréhension pour le visiteur, mais somme toute uniquement sur trois grands écrans et sans dispositifs numériques tactiles moins collectifs. L’éclairage fort présent et nécessaire dans cette scénographie de l’ombre sublime les deux toiles, pièces maitresses du musée, dans une mise en scène finale qui clôt l’exposition en mettant à hauteur de visiteur et dos à dos ces toiles que l’habitué du musée ne voit que côte à côte et en hauteur.
Goya
L’exposition Expérience Goya invite à une plongée dans la vie de l’artiste. Deux œuvres, Les Jeunes et Les Vieilles, permettent de concentrer à elles seules l’histoire et la vie du peintre. Centrales dans le propos, elles ne sont pourtant présentées qu’à la fin, décadrées, dos à dos dans une salle circulaire.

Expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Francisco Goya est né en 1746 à Fuendetodos. Il épouse en 1773 Josefa Bayeu et de 1775 à 1792, la série des cartons de tapisserie pour la Manufacture Royale. En 1780, Goya est élu à l’académie royale des Beaux-Arts de Madrid. Il devient alors portraitiste de la noblesse espagnole et le peintre de la chambre du Roi en 1789.
En 1792 Goya devient sourd et cet incident marque un véritable tournant dans ses œuvres. En 1797 la série d’estampes Les Caprices est imprimée, dévoilant son regard sur la société espagnole. Dali réinterprète ces Caprices, en 1977, exagérant les symboliques posées par Goya. La scénographie de l’exposition permet aux visiteurs une lecture comparée des deux séries.

Expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
En 1808, Goya assiste à la guerre d’Indépendance d’Espagne, en décembre, Madrid se rend à Napoléon. Peintre du roi, Goya réalise des portraits de la famille de Charles IV, ce dernier étant contraint d’abdiquer avec Napoléon.
Témoin de cette période de guerre, Goya en retranscrit l’horreur dans ses peintures qui représentent des scènes funestes et macabres. La folie des asiles lui inspire la série d’eaux-fortes Les Désastres de la guerre. Au Palais des Beaux-Arts, les murs mauves et l’ambiance sonore lourde retranscrivent parfaitement l’atmosphère de la vie de l’artiste que l’on découvre au fil de l’exposition.
Bien après sa mort, Goya continue d’influencer de nombreux artistes, des cinéastes s’appuient sur des œuvres, ou des évènements de sa vie. Une dizaine d’extraits de films sont présentés au début et à la fin de l’exposition. Des extraits des fantômes de Goya, de Milos Forman en 2006, de Goya à Bordeaux, de Carlos Saura en 1999, de Mr. Arkadin, de Orson Welles en 1955, de Goya, l’hérétique, de Konrad Wolf en 1971 et de Passions, de Jean-Luc Godard en 1982, introduisent l’exposition pendant dix minutes. Cette dernière se conclut par d’autres extraits, plus sinistres, à l’image du propos, tel que Le Gasanova de Fellini, de Frederico Fellini en 1999, Tale of Tales, de Matteo Garrone en 1955, et qu’Il était une fois dans l’ouest, de Sergio Leone en 1982. En Espagne, les récompenses de cinéma sont d’ailleurs surnommées les Goyas.
« Maintenant je ne crains plus les sorcières, ni les esprits, ni les fantômes, ni les géants fanfarons, ni les poltrons, ni les malandrins, ni aucune classe de corps, je ne crains rien ni personne exceptés les humains… » Goya, avant 1789.
L'immersion
Outre l’ambiance sonore et des murs sombres évoquant la vie difficile du peintre, le musée propose aux visiteurs une immersion gratuite dans la vie de Goya dans l’atrium. Nous concluons sur cette véritable introduction à la vie de Goya, une rotonde qui de fait ouvre l’exposition. Sur l’extérieur de cette rotonde, une frise circulaire retrace en quarante dates la vie de Goya, la vie des deux toiles Les Veilles et Les Jeunes que possède le musée, et l’influence contemporaine de Goya notamment sur des peintres et des cinéastes. En son intérieur, la rotonde immersive propose à presque 360 degrés une expérience des tableaux du peintres.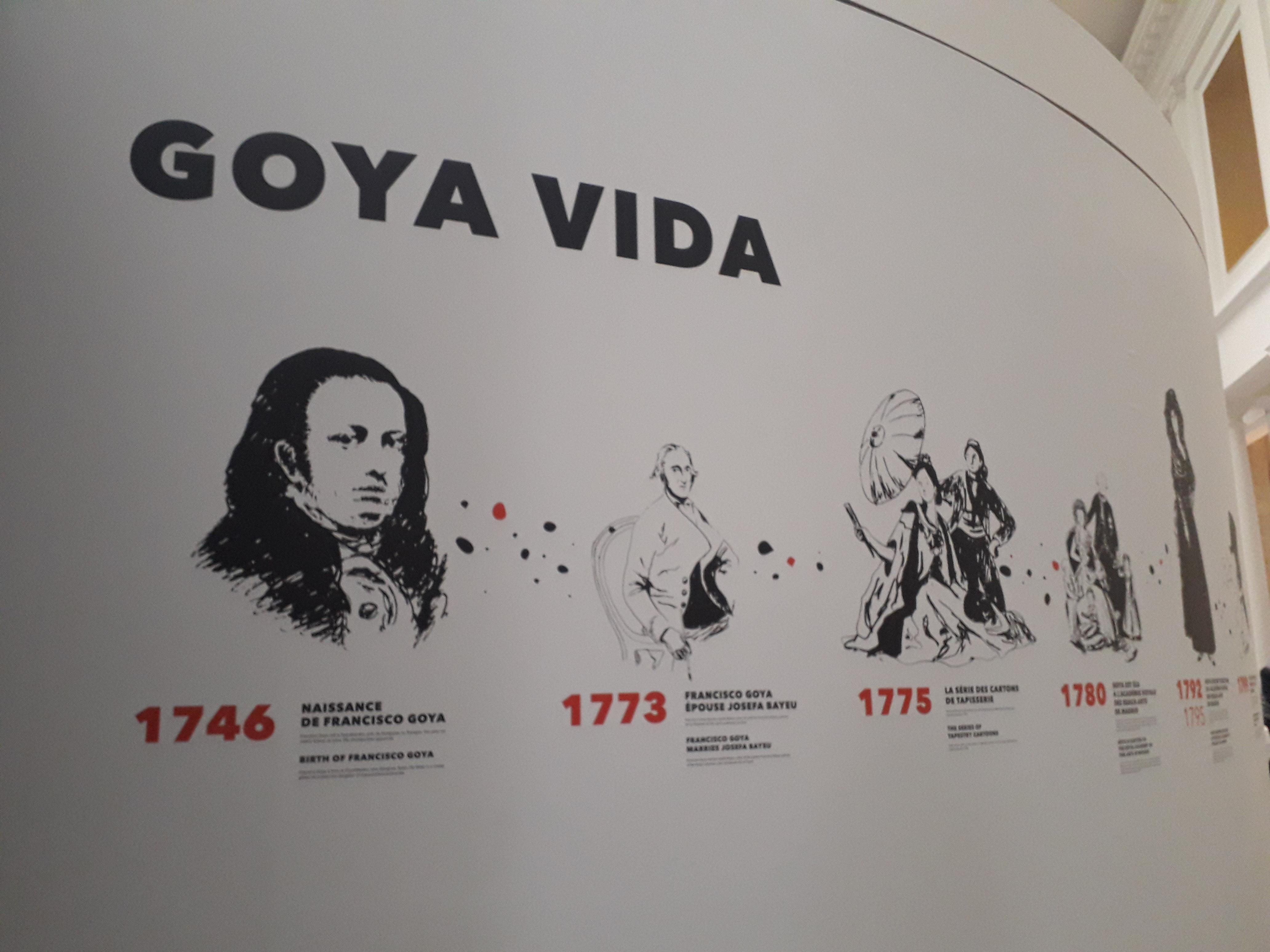
Expérience Goya, atrium Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Entourés de tableaux dont certains s'animent (les yeux bougent...), le visiteur est assis dans une pièce recréant un atelier de peintre. Les tableaux sont présentés par fragments dans le but d’une meilleure compréhension et donnent le ton : celui des expressions qui retranscrivent l’effroi, ce qui introduit bien les Caprices.

Expérience Goya, salle immersive, Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Pour aller plus loin :
EXPERIENCE GOYA / Agenda - Palais des Beaux Arts de Lille
Guide du Palais des Beaux Arts de Lille
#Ecoconception #Goya #Roman scénographique
Harriet Baker (1845 - 1932) : une artiste qui peint les femmes
Pour sa dernière exposition temporaire, le Musée d’Orsay nous dévoile, pour la première fois en France, une rétrospective de l’artiste peintre suédoise Harriet Backer. Cette exposition, qui retrace le parcours de l’artiste, met en lumière sa sensibilité et ses engagements de femme, dès la fin du XIXème siècle. Ce voyage singulier, musical et sensible, était visible du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025.
Fig 1 : Entrée de l’exposition « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Cette exposition initiée par le National Museum, Oslo et le Kode Bergen Art Museum, est organisée en collaboration avec le Nationalmuseum, Stockholm et le Musée d’Orsay, Paris. Elle permet au visiteur de découvrir l’œuvre de l’artiste grâce à cinq salles thématiques, animées au rythme de morceaux de musique joués par la sœur de l’artiste, de formes arrondies et de couleurs douces.
Une femme en avance sur son temps
Harriet Backer, née à Holmestrand en Norvège en 1845, est une artiste peintre déjà reconnue de son vivant dans son pays. Elle étudie la peinture dans de nombreuses villes européennes telles que Oslo, Munich, Berlin ou encore Paris et devient une figure majeure de la scène artistique norvégienne de son temps, aux traits singuliers et reconnaissables. Elle délaisse peu à peu les techniques dites « classiques » pour se rapprocher des influences impressionnistes. Cette évolution est d’ailleurs visible dans le parcours d’exposition puisqu’il regroupe aussi bien ses premiers tableaux que ses créations plus tardives.
Au cours de sa vie, Harriet Backer s’entoure de nombreuses femmes ; enseignantes, écrivaines, artistes - dont Kitty Kielland, Raga Nielsenn ou encore sa sœur, Agathe Backer Grøndahl, musicienne, dont elle est proche et souvent présente dans son œuvre. Ces femmes deviennent ses amies, des modèles qu’elle peint et dont elle s’inspire également. Une des salles de l’exposition met en lumière ces liens qu’elle entretient avec ses contemporaines et qui, avec certaines, durera jusqu’à sa mort.
À son retour en Norvège, Harriet Backer fonde une école de peinture où sont formés de nombreux artistes dont des femmes. Connaissant le succès de son vivant, elle présente ses œuvres aux expositions universelles, dont celle de Paris, où elle reçoit de la médaille d’argent en 1889 pour son tableau Chez moi datant de 1887 et représentant l'écrivaine Asta Lie jouant du piano.
En plus d’enseigner la peinture, Harriet Backer, en avance sur son temps, s’implique dans des causes politiques et féministes. Elle rejoint l’association norvégienne pour les droits de la femme aux côtés de ses amies proches, Kitty Kielland et Raga Nielsenn en 1889. Elle participe à une marche pour les droits des femmes en l’honneur Camilla Collet en 1893, deux ans avant la mort de l’autrice norvégienne féministe. Elle est nommée au conseil d’administration et au comité d’acquisition de la galerie nationale de Norvège par le gouvernement norvégien, place qu’elle occupe pendant plus de vingt ans. Harriet Backer est également nommée chevalier de l’Ordre de Saint-Olav, une des plus haute distinction norvégienne encore décernée aujourd’hui.
Toutes ces étapes clés de la vie de l’artiste sont expliquées dès la première salle de l’exposition. Une frise chronologique panoramique y résume ses événements marquants. Des repères sont donnés sur ses origines, sa famille, son éducation, ses voyages et son implication dans de nombreuses causes pour son pays, et notamment les luttes féministes.
Une femme qui peint les femmes
Harriet Backer peint la figure féminine comme peu d’autres artistes de son temps. Une femme qui peint les femmes, qui plus est celles de la vie quotidienne, n’est pas commun à la fin du XIXème siècle. En effet, à cette époque, les femmes ne sont pas considérées comme des citoyennes à part entière en Norvège (elles obtiennent le droit de vote au suffrage universel pour les scrutins nationaux en 1913). Cela met notamment en exergue la personnalité et les idées politiques que défend de l’artiste. Les portraits de femmes sont nombreux, voire au cœur de cette exposition. Et lorsqu’il ne s’agit pas de portraits, Harriet Backer peint la femme dans diverses scènes de la vie quotidienne.
La femme est toujours l’élément principal du tableau. Parfois jouant de la musique, parfois s’occupant du linge, parfois priant à l’église ou bien encore lors de scènes de baptêmes, mais également pour un adieu à la famille, scène d’émancipation d’une jeune fille qui part vivre à l’étranger, comme ce fut son cas. Les femmes sont parfois accompagnées d'hommes, mais dans la composition de la peinture, l’artiste n’en fait pas les éléments centraux du tableau.
Le visiteur plonge dès les premiers instants dans l’univers de l’artiste et surtout celui de son époque. Les couleurs y sont douces, du rose pâle, au rose poudré pour sublimer les intérieurs en passant par des bruns doux et chauds pour accompagner les scènes d’extérieur. La lumière est tamisée, elle met subtilement en valeur chaque tableau et nous pousse à nous concentrer sur les détails, les textures, les mouvements de son pinceau.
Dans la continuité de la salle introductive, autour de la frise chronologique, plusieurs portraits de femmes sont exposés, comme Intérieur Bleu, peint en 1883, qui représente son amie Asta Norregaard assise sur une chaise, un tissu à la main, mais aussi Autoportrait, (inachevé), que l’artiste peint en 1910.


Fig 2 et 3 : Première(s) salle de l’exposition « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
La deuxième salle, permet de faire écho au travail d’artistes contemporains à Harriet Backer, avec des œuvres d’artistes qui ont appartenu à son cercle d’amies proches et qui partageaient ses ambitions féministes. C’est un premier pas vers les sources d’inspirations de Harriet Backer et d'œuvres qui ont pu avoir un impact sur son travail. Cette mise en scène plante le décor et le point de vue de l’artiste dès le début de l’exposition.
Une femme qui peint l’intime
Plus tard, elle délaissera les portraits au détails réalistes pour les intérieurs, notamment les scènes dans les salons de musique, les pièces de vie de la maison dont plusieurs intérieurs norvégiens typiques, caractéristiques d’une des périodes phares de son œuvre. À travers ces scènes d’intérieurs, Harriet Backer peint l’intime.
Elle fait entrer celui qui regarde dans une atmosphère chaleureuse, douce et lumineuse, dont elle maîtrise la technique de manière unique. C’est d’ailleurs ce que l’on ressent dans les salles suivantes de l’exposition, où prennent place ces scènes d’intérieur et ces femmes, mises les unes à la suite des autres, parmi lesquelles : Védastine Aubert (1910), Au piano (1894), Femme cousant (1890), ou encore Lavande (1914). Cet accrochage leur donne d’autant plus de d’importance, au vu de leur nombre.
La salle centrale, salle maîtresse de l’exposition, est l’évocation du cocon du foyer, par ses formes douces, ses cimaises courbes et ses assises circulaires au centre. Le visiteur est transporté dans le temps grâce à une musique d’époque qui accompagne le parcours, faisant écho à l’amour que Harriet Backer et sa sœur avaient pour la musique. Cet amour est très souvent représenté à travers le mouvement de son geste dans ses tableaux.

Fig 4 : L’espace central : le foyer, « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Dans la suite du parcours, les œuvres nous transportent de l’autre côté des intérieurs que peint l’artiste. Le visiteur découvre une série de toiles représentant des espaces extérieurs, des lieux publics, du paysage Norvégiens : campagne, champs, bords de cours d’eau, église… Tout autant d’endroits dans lesquels Harriet Backer place de nouveau la femme comme sujet central, hors de la maison. C’est par exemple le cas de son huile sur toile intitulée ”Blanchiment du linge”, qu’elle réalise en 1886-1887 et qui met en avant trois femmes dans une scène de vie rurale norvégienne.
“Peindre les femmes” VS “Peindre les hommes”
En parallèle de cette rétrospective, le Musée d’Orsay présente dans son deuxième espace dédié aux expositions temporaires une exposition monographique sur l’artiste Gustave Caillebotte, intitulée « Caillebotte : Peindre les Hommes ». Cette juxtaposition des genres peut sembler être le pendant du travail de l’artiste norvégienne exposé juste en face. Caillebotte dépeint son environnement quotidien, offre une vision directe de son époque, questionnant l’intime, la place de l’homme dans la société et les différentes fonctions qu’il peut occuper. Il s'interroge sur la condition masculine, à l’image d’Harriet Backer qui le fait pour la figure féminine.
En effet, Gustave Caillebotte consacre une grande partie de sa carrière d’artiste à la peinture de sujets masculins, qu’ils s’agissent de portraits, de la figure de l’homme dans la ville ou encore l’homme sportif à travers ses séries de sportsmen. Ces tableaux datant de la même période que l'œuvre de Harriet Backer, mettent en avant deux approches radicalement différentes, un homme qui peint les hommes / une femme qui peint les femmes. Ces deux visions juxtaposées mettent en exergue une même question : la place de l’homme et de la femme dans la société dans laquelle évoluent respectivement chacun de ces deux artistes.
Les deux muséographies dialoguent, avec deux scénographies opposées : une aux couleurs chaudes, aux angles arrondis, l’autre aux tonalités plus froides, plus franches, accompagné d’un parcours d’apparence plus rectiligne. Ces deux sujets en vis à vis permettent aux visiteurs de se placer à hauteur d'œil des enjeux sociaux de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle en Europe, en réinterrogeant les normes et les conditions de genre à travers l’histoire de la peinture. Mais, l’une de ces visions n’efface-t-elle pas l’autre ?


Fig 5 : Deux femmes, Nenna Janson Nagel, née Backer Lunde, huile sur toile, 1896-1897, et Vedastine Aubert, huile sur toile, vers 1910, « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Fig 6 : Deux hommes, Portrait de Paul Hugo, 1878, et Portrait de Jean Daurelle en pied, huile sur toile, 1887, exposition « Caillebotte : peindre les hommes », Etablissement Public du Musée d’Orsay, 2024 - ©CT
Une programmation culturelle en résonance
Pour aller plus loin, le Musée d’Orsay propose une programmation culturelle en lien avec l’exposition monographique sur Harriet Backer. Aussi, il est possible de retrouver au mois de novembre le Festival Norvégiennes en Scène, qui propose une immersion au cœur de la création norvégienne. Cette initiative fait notamment écho à l’attache très forte entre Harriet Backer, peintre, et sa sœur, Agathe Backer Grøndahl, musicienne, deux femmes animées par leur passion commune pour les arts.
“Durant une semaine entière, ce festival pluridisciplinaire sera l’occasion d’une exploration musicale, chorégraphique, littéraire et esthétique du dynamisme de la création norvégienne, et plus particulièrement le travail des femmes artistes d’hier et d’aujourd’hui.” Musée d’Orsay.
Clotilde Trolet
#exposition #peinture #impressionnisme #féminisme
Pour en savoir plus :

Héritage provençal
C’est en parcourant les ruelles de Grasse, que je suis tombée sur un petit musée, qui pourrait passer complètement inaperçu, mais révèle un profond héritage historique que je ne soupçonnais pas. Grasse est souvent qualifiée de capitale mondiale du parfum. Il faut dire que la renommée de la ville repose avant tout sur le Musée International de la Parfumerie, de quoi voler la vedette aux autres musées gérés par la Communauté d’agglomération de Grasse. Quant à l’héritage vestimentaire de la ville, le Musée Provençal du Costume et du Bijou, propriété de la ville de Grasse, retrace l’histoire des femmes provençales en préservant une collection de costumes et de bijoux des XVIIIème et XIXème siècles. Sa collection privée a été assemblée par Hélène Costa.
Gravure de mode, Musée Provençal du Costume et du Bijou © A.E
Le musée est situé dans l’Hôtel particulier de Clapier-Cabris, ancienne demeure de la Marquise de Cabris, sœur de Mirabeau. Un emplacement d’une grande valeur qui devrait donc attirer les visiteurs. Mais à ma grande surprise, personne. Personne dans le musée si ce n’est une gardienne faisant office d’hôtesse d’accueil, ravie de nous accueillir en ce lieu visiblement déserté. Deux euros, seulement deux euros pour accéder à ce patrimoine qui n’a sûrement pas plus de valeur aux yeux des Grassois.
C’est donc en terrain inconnu que je monte le grand escalier central du musée, un lustre éclaire cet espace sombre. En entrant dans la première salle, je découvre sur une estrade une scène de vie : deux femmes provençales, dans une cuisine, habillées de leur robe, coiffe et tablier en dentelle. A la manière d’un musée de Folklore, les deux personnages sont mis en scène de façon à illustrer et conserver l’image de coutumes provençales. Un écriteau explique l’histoire des dentelles, de la fabrication manuelle à celle mécanique. Il s’agit d’un long texte, que je ne lis qu’en diagonale tant mes yeux sont rivés sur la minutie des détails apportés à la dentelle des costumes.
 Je poursuis ma visite dans une pièce, dont la scénographie m’intrigue. Des mannequins sont disposés de manière aléatoire, ces femmes elles-mêmes placées sous de grandes cloches cylindriques en verre. L’idée me paraît intéressante en ce qu’elle m’évoque la mise en flacon d’un parfum. Une scène du film « Le Parfum » me vient également à l’esprit, lorsque la femme est enfermée par Grenouille dans un cylindre de verre pour en distiller son odeur. Je m’interroge néanmoins sur la vocation de ce dispositif, le propos du musée n’ayant pas de rapport direct avec le thème du parfum. Vous me direz que je vois un lien là où il n’y en pas, que l’esprit de Grasse agit sur moi, distille dans mon inconscient sa trace et me pousse à faire cette relation directe alors que le scénographe n’y avait pas pensé.
Je poursuis ma visite dans une pièce, dont la scénographie m’intrigue. Des mannequins sont disposés de manière aléatoire, ces femmes elles-mêmes placées sous de grandes cloches cylindriques en verre. L’idée me paraît intéressante en ce qu’elle m’évoque la mise en flacon d’un parfum. Une scène du film « Le Parfum » me vient également à l’esprit, lorsque la femme est enfermée par Grenouille dans un cylindre de verre pour en distiller son odeur. Je m’interroge néanmoins sur la vocation de ce dispositif, le propos du musée n’ayant pas de rapport direct avec le thème du parfum. Vous me direz que je vois un lien là où il n’y en pas, que l’esprit de Grasse agit sur moi, distille dans mon inconscient sa trace et me pousse à faire cette relation directe alors que le scénographe n’y avait pas pensé.
Décor du film Le Parfum de Tom Tykwer © A.E


Mannequins sous « cloches » © A.E
La conservation des costumes est certainement à l’origine de ces dispositifs, ils sont préservés de tout contact avec les visiteurs. En cela, j’y vois une nouvelle ressemblance aux cloches de mariées qui visaient à préserver le bouquet de la mariée. Si cela provoque par conséquent une distance entre le contenu de ce musée et le visiteur, ce dernier peut cependant apprécier le vêtement sous toutes ses coutures en tournant autour de ces cylindres et ainsi observer tous les détails de la dentelle. Un jeu de lumière donne lieu à l’appréciation des mouvements du textile, les plis, bien que ces mannequins soient figés. Chacun représente l’habit typique d’une région à un moment donné. Toulon, Grasse, le Gard, Marseille, le Var … la collection illustre une richesse tant dans le nombre de costumes conservés que dans la diversité des villes représentées. Des gravures de mode accompagnent chacun des cartels et situent le costume dans son époque. Cela m’évoque immédiatement les gravures de Paul Iribe dans l’ouvrage Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, par le dessin de femmes de la bourgeoisie posant dans leurs riches tenues.

Gravure de mode, Musée Provençal du Costume et du Bijou © A.E
Je poursuis ma visite en déambulant dans ces pièces qui parfois présentent des scènes de vie préservant les vêtements portés derrière des paravents de verre, suggérant l’intimité de ces dames ainsi que la préciosité de leurs vêtements. Sur les murs sont inscrits des proverbes comme une voix narrative invitant à poursuivre la visite.
 Le décor change dans la salle dédiée à la présentation des bijoux provençaux : salle carrée sans source de lumière naturelle, où l’éclairage joue un rôle primordial. Un imposant lustre vient éclairer la vitrine centrale qui présente tout en longueur des parures et boucles de ceintures en argent. Sur chacun des murs sont alignées des vitrines encastrées. Il s’agit en quelque sorte de petites boîtes profondes où la lumière n’éclaire que le bijou. Ce procédé accentue ici encore la préciosité et une forme d’inaccessibilité pour les visiteurs. Paradoxalement, des cartels sont disposés sous ces vitrines de façon à révéler les techniques de fabrication de ces bijoux, ou bien leurs usages, leurs valeurs, leurs symboliques etc…
Le décor change dans la salle dédiée à la présentation des bijoux provençaux : salle carrée sans source de lumière naturelle, où l’éclairage joue un rôle primordial. Un imposant lustre vient éclairer la vitrine centrale qui présente tout en longueur des parures et boucles de ceintures en argent. Sur chacun des murs sont alignées des vitrines encastrées. Il s’agit en quelque sorte de petites boîtes profondes où la lumière n’éclaire que le bijou. Ce procédé accentue ici encore la préciosité et une forme d’inaccessibilité pour les visiteurs. Paradoxalement, des cartels sont disposés sous ces vitrines de façon à révéler les techniques de fabrication de ces bijoux, ou bien leurs usages, leurs valeurs, leurs symboliques etc…
Salle des bijoux et vitrine murale © A.E
 La visite se termine sur une touche graphique discrète où l’on perçoit les silhouettes de Provençales peintes au mur du dernier couloir, lui-même percé de fenêtres offrant un dernier regard sur les mannequins de la salle « des cloches en verre ».
La visite se termine sur une touche graphique discrète où l’on perçoit les silhouettes de Provençales peintes au mur du dernier couloir, lui-même percé de fenêtres offrant un dernier regard sur les mannequins de la salle « des cloches en verre ».
Un sentiment me traverse : la distance établie entre le visiteur et le contenu de cette collection mise sous verre est-elle à l’image de la méconnaissance du public vis-à-vis de ce musée ? En effet, les dispositifs de présentation ne permettent pas au visiteur de s’approprier le contenu du musée, tant les objets semblent préservés de tout contact. De la même façon l’absence de communication autour de la structure ainsi que son emplacement peu connu créent une réelle distance entre les visiteurs et le musée. Quelles techniques pourraient être mises en œuvre, par le biais d’une médiation par exemple, pour attirer davantage de visiteurs ? Quel est l’intérêt d’installer un musée d'artisanat dans une ville qui en possède déjà un autre très connu, pourquoi ne pas l'installer dans une autre commune ou voisinant celui du parfum pour inciter les gens à le visiter ?
Anna Erard
#grasse
#muséeprovençalducostumeetdubijou
#costume
Hiding Figure
Il est des expositions qui marquent. Des artistes que l’on découvre. Des œuvres que l’on oublie puis qui se rappellent à notre bon souvenir. Ce dimanche je triais mon dossier « photos d’expositions » quand mon objectif dominical a pris une toute autre tournure. J’ai retrouvé une œuvre. J’ai retrouvé une œuvre que j’ai vue, aimée puis oubliée. C’était il y a cinq ans, un samedi de Novembre, l’exposition Storm à la galerie Emmanuel Perrotin. C’est là que j’ai découvert le travail de l’artiste américain Daniel Arsham. Là que j’ai découvert Hiding figure…
L’année 2012 marque les vingt ans du cyclone Andrew, événement qui inspire le titre de l’exposition et laisse indéniablement sa trace sur les œuvres qui y sont exposées.
Et si l’artiste met en scène un monde glissant comme emporté dans la chute des murs nous entourant c’est que son œuvre est profondément marquée par un événement traumatique : le cyclone dévastateur qui toucha Miami en 1992. L’artiste avait douze ans. Il parle de cet évènement en ces termes « Ce fut ma première expérience avec ce qu’il y a à l’intérieur des murs : ils sont construits de manière à ce qu’on imagine que les buildings tiendront toujours debout, alors qu’en fait il y a tous ces déchets à l’intérieur d’eux ».
Daniel Arsham, Hidingfigure, 2012, fibre de verre, tissu, peinture, chaussures
Cette sculpture en trois dimensions a tout de la momie, de l’installation funéraire ; elle représente un homme pris dans un voile, plaqué de dos contre le mur, seules ses chaussures dépassent. Daniel Arsham raconte cette anecdote à propos de son œuvre : les gens l’ayant vu dans son atelier ont tous pensé à Han Solo (Star Wars) piégé dans de la carbonite.
Exposition Storm, galerie Emmanuel Perrotin, Paris, 3 Novembre – 22 Décembre 2012
C’est la notion de piège qui est ici intéressante. Absolument tout le monde est impacté par cette œuvre ; le génie de Daniel Arsham est ici d’arriver à créer / représenter / déclencher, de manière universelle et automatique la phobie. L’approche première de cette œuvre est donc « phobique » : le drame visuel qui se joue sous nos yeux nous pousse à imaginer l’agonie par suffocation du personnage.
Une idée de lutte prédomine dans cette installation, elle découle de la violence avec laquelle le personnage est plaqué par le drapé, les bras et les pieds légèrement écartés. La phobie peut être universelle mais ses raisons d’être sont propres à chacun, ainsi cette installation appelle à une introspection. Ce n’est pas par hasard si elle a déjà été mise en scène avec un danseur à ses côtés. Quoi de plus introspectif que l’exécution d’un pas de danse ? Que le choix de ce pas et pas d’un autre ?
D’ailleurs malgré l’universalité de son impact, c’est bien introspectivement que cette œuvre a été conçue : le moule du mannequin est réalisé sur l’artiste, il est la continuité, l’alter égo de Daniel Arsham. Tout de suite, on va donc situer l’œuvre comme l’expression du traumatisme subi lors du cyclone, et bien qu’indéniablement cette œuvre soit en lien avec cet événement il me semble que sa lecture n’est pas si évidente que ça.
En effet, lorsque Daniel Arsham s’exprime sur le positionnement de la figure il utilise le terme « hide » ou« cacher » en français. La notion de « cacher » fait automatiquement référence à la notion de danger mais aussi et surtout à la notion de refuge.
Selon les dires de Daniel Arsham, la figure serait donc « cachée derrière la surface du mur », ces mêmes murs, si fragiles qui se sont effondrés et n’ont su résister au cyclone lui ayant presque ôté la vie. En quelque sorte, c’est à cause de la fragilité de ces murs que l’artiste a failli mourir à l’âge de douze ans. Pourquoi donc les considère-t-ils comme un refuge ? Pourquoi les met-ils en scène comme le refuge de ce personnage plaqué, presque avalé par eux ?
Peut-être parce que Daniel Arsham à grandit et que cette date anniversaire marque sinon le surpassement de son traumatisme, son acceptation. Comme une sorte de réconciliation.
Peut-être aussi que ce surpassement est le signe de l’amour inconditionnel que l’artiste voue à l’architecture et la confiance qu’il lui porte.
Puisque Daniel Arsham considère l’architecture, et donc, ce mur comme « la forme la plus durable et la plus significative »alors Hiding figure serait -à notre plus grande surprise et contre notre première impression - l’œuvre la plus positive de l’exposition Storm, la seule à évoquer un refuge au milieu du chaos. Il arrive d’être dupé par ses sens, son instinct.
H.F
#artcontemporain
#architecture
#sculpture

Immersion au Musée Léon Dierx à la Réunion.
Bienvenue à tous sur l’île de la Réunion. Je vous invite à découvrir le musée des beaux-arts de ce département : le Musée Léon Dierx, du nom d’un peintre et poète réunionnais, qui a ouvert ses portes en 1912. Cette institution culturelle prend place dans l’ancien évêché de Saint-Denis, chef-lieu de la Réunion, au sein de l’emblématique rue de Paris.
L’entrée du Musée Léon Dierx, © LK
Sa collection permanente aborde les courants propres au 19ème siècle. Le parcours y est chronologique (le romantisme, l’école de Barbizon, l’impressionnisme etc) et thématique (le nu, les marines, le paysage urbain etc). Ces peintures relèvent de deux genres principaux, les portraits et les paysages. Les collections du musée, hors réserves, sont actuellement dotées également de sculptures et d’estampes. Les collectionneurs et marchands d’arts, pour la majorité réunionnais, qui ont enrichi le musée, ayant beaucoup voyagé, les paysages et les portraits proviennent de divers pays. Vous pouvez découvrir des œuvres de Cézanne, Chagall, Picasso, Gauguin, Valtat, Redon…
Une salle de la collection permanente du Musée Léon Dierx, © LK
L’espace du musée mesure environ 700 m2. Ce musée de petite taille entraîne un confort de visite et l’intimité d’une maison. Il est appréciable de s’y promener. Le musée est entouré d’un jardin très agréable, foisonnant de plantes locales. Le Musée Léon Dierx propose chaque année environ trois grandes expositions temporaires et deux petites. Les expositions ont toujours un lien avec l’art d’aujourd’hui. Le directeur et conservateur du musée souhaite, en effet, mettre en avant la création artistique réunionnaise et au-delà de l’Océan indien. Le musée appuie le propos d’une création actuelle en lien avec la société.
Le jeudi 2 juillet, nous avons accueilli plus de 500 visiteurs à l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition : L'Envers de l'île. Cette exposition tisse des liens entre l’art contemporain réunionnais et les archives anciennes, entre collections publiques et privées, entre artistes formés aux beaux-arts et autodidactes. Elle présente des œuvres qui ont été réalisées sur l’île de la Réunion, à des périodes très différentes. L’exposition est dédiée à tous, aux personnes qui connaissent l’île en profondeur, aux personnes qui rêvent de la découvrir. Elle se prête à provoquer un dialogue entre les visiteurs sur leur perception de l’île. La pluralité des œuvres est vouée à intéresser chacun, entre photographies, peintures, dessins, sculptures, installations…
L’entrée de l’exposition, avant l’arrivée de visiteurs © LK
Durant le vernissage, © LK
La scénographie de l’exposition nous emmène à la découverte et à l’ouverture dans cette île aux multiples facettes. L’exposition se compose de différentes salles, toutes ouvertes. La visite peut s’effectuer avec calme et légèreté. Nous pouvons ressentir une grande liberté en arpentant les espaces.
Des salles ouvertes, un sens de visite libre ©LK
Au fur et à mesure nous en découvrons davantage sur l’île depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur, pour arriver en son cœur. L’exposition nous dévoile d’abord le territoire et la représentation que nous pouvons nous faire de la Réunion : photographies du Piton de la fournaise et côtes terrestres, installation entre nuages et montagnes, cartes et dessins représentant le territoire de l’île de la Réunion, etc.
La Réunion, entre ciel et terre : un territoire aux représentations communes©LK
Notre cheminement nous entraîne plus près, à proximité de l’homme réunionnais, entre identités et pratiques culturelles plurielles. La population réunionnaise étant composée de personnes provenant de Madagascar, d’Inde, de Mayotte, des Comores, de France, d’Afrique et de nombreux lieux du globe. Cette richesse entraîne des pratiques culinaires, religieuses, culturelles d’une grande ouverture. Cette exposition, forte de sens, rassemble le public local autour d’un territoire. Elle reflète des fondements de cette société. Elle réunit chaque individu autour d’un patrimoine commun.
Une terre aux multiples pratiques©LK
Une terre aux multiples pratiques©LK
Une population diversifiée et tolérante©LK
Le travail de l’artiste Stéphanie Hoareau m’a particulièrement marquée. Première œuvre : une femme âgée en résine. Certains la frôlent, d’autres l’observent. Cette femme nommée Jacqueline est une sans domicile fixe de la Réunion. Elle est assise sur un banc, dans l’attente de quelque chose que nous ignorons. Puis dans une autre salle nous découvrons Jack le fou. « Qui est-il ?» demandais-je ? On me raconte alors des légendes sur cet homme nomade qui se déplace de villes en villes, cette figure emblématique que tous les Réunionnais connaissent. L’artiste souhaite honorer ces personnes considérées comme hors normes. Leur présence dans un espace muséal leur redonne une identité, une place dans la société. A travers plusieurs techniques, elle dresse les portraits des marginalisés.
Jacqueline, Sculpture en résine et bois,2014
Je laisse les derniers mots à Stéphanie Hoareau :
« Chacun a croisé au détour d’une rue, d’une place, ou d’un bâtiment, un personnage énigmatique, toujours présent, qui se fond dans le décor.
Chacun a entendu des histoires extraordinaires sur ces personnes qui font partie des récits folkloriques et de l’imaginaire commun des villes et des quartiers. Chacun les ignore, les observe, les craint, ou leur apporte soutien et bienveillance par compassion ou encore par empathie.
Mais personne ne peut les sortir de leur torpeur car personne ne peut les priver de ce qu’ils ont de plus cher : leur liberté».
Lilia Khadri
En savoir plus :
http://www.cg974.fr/culture/index.php/L%C3%A9on-Dierx/pr%C3%A9sentation-dierx/musee-leon-dierx.html
# Beaux-arts
# Identité
# La Réunion

Klimt à l’Atelier des Lumières : S’émerveiller là où on ne s’y attend pas
S’immerger dans un univers parallèle, s’émerveiller devant des images grandioses qui nous enveloppent, s’abandonner au son d’une musique puissante, sentir vibrer les basses au creux de son ventre, se laisser envahir par une foule d’émotions… Vous aussi vous êtes en quête de ces sensations ?
UN ESPACE POUR RÊVER
Gustav Klimt, Serpents aquatiques II (Les Amies), 1904-1907, huile sur toile, 80 x 145 cm, Collection privée, Photo © Akg-Images/Erich Lessing
ENTRÉE DANS LE TEMPLE DU NUMÉRIQUE
Poetic_Ai © Ouchhh
Hundertwasser, sur les pas de la sécession viennoise © Culturespaces / Eric Spiller
Je profite de ces deux vidéos d’introduction pour découvrir l’espace. À l’intérieur d’une « black box », des tablettes interactives sur socle invitent le visiteur à choisir des images extraites de la projection de Klimt et de les projeter sur les murs de la pièce. Comme souvent lorsqu’il s’agit de matériel numérique manipulé par un grand nombre, certaines tablettes ne fonctionnent plus et cette tentative de médiation sans explications apporte finalement peu d’intérêt vis-à-vis de la projection principale. À proximité, une seconde « black box » est recouverte de miroirs prolongeant l’espace et des images projetées à l’infini. Cette fois, je commence réellement à ressentir les symptômes de l’immersion m’impacter. Je perds mes repères et me laisse submerger par le mouvement des couleurs. Lorsque les murs redeviennent progressivement noirs, je m’empresse de sortir de cette pièce pour découvrir le programme Klimt et amplifier l’expérience sensorielle qui commence à s’emparer de moi.
Réserve aux miroirs infinis © Culturespaces / Eric Spiller
SURPRISE PAR L’ENNUI
Et là… surprise !
Projection Gustav Klimt © Laurence Louis
VOYAGE AU CŒUR DE LA MATIÈRE
« Colours x Colours » - Studio de l'Atelier des Lumières © Culturespaces
© Colours x Colours Thomas Blanchard/Oilhack
LE NUMÉRIQUE REMPLACERA-T-IL LES ŒUVRES D’ART ?
Laurence Louis
#AtelierDesLumieres
#Klimt
#Immersion
Pour en savoir plus :
14,5/13,5/11,5/9,5 €
Prolongations jusqu’au 6 janvier 2019
Du lundi au jeudi de 10h à 18h.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h
https://www.atelier-lumieres.com/fr/home
1 NAIVIN Bernard, « Klimt à l’Atelier des Lumières, ou la peinture à son état ectoplasmique » publié sur le blog AOC, le 20 août 2018, disponible sur https://aoc.media/,consulté le 10 novembre 2018.

L'Hôtel de la Marine : une expérience de visite immersive
Place de la Concorde à Paris : la gigantesque esplanade, bien qu’envahie par le dense trafic parisien, reste un des lieux les plus emblématiques de la capitale. Sur cette place, dans l’hôtel particulier jumeau de l’actuel Hôtel de Crillon, vient de s’ouvrir au public un monument dont la gestion a été confiée au Centre des monuments nationaux (CMN) : l’Hôtel de la Marine. Daté du XVIIIe siècle et très rarement ouvert au public, ce lieu a été le témoin de siècles d’Histoire, aujourd’hui relatés aux visiteurs par un parcours dans des reconstitutions de décors d’époque et agrémenté de dispositifs numériques innovants.
Un destin mouvementé
C’est la Ville de Paris qui, souhaitant rendre hommage au roi Louis XV, entreprend de faire construire une place royale monumentale dans la capitale, organisée autour d’une statue équestre du monarque. Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi, se voit confier la tâche.
Le bâtiment est érigé à partir de 1757 et il est décidé dès 1765 d’y installer le Garde-Meuble royal (ancêtre de l’actuel Mobilier National), et ce jusqu’en 1798. Ses intendants, Pierre-Elisabeth de Fontanieu puis Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray, sont chargés de l’aménagement du bâtiment et de la conservation du mobilier et des arts décoratifs de la collection royale, mais aussi des bijoux de la couronne et des armes d’apparat. Ils étaient également en charge de l’aménagement des résidences royales et de l’entretien du mobilier.
En 1776, le peuple avait la possibilité, à certains moments de l’année, de venir y admirer les collections royales. C’est le premier « musée des arts décoratifs » de Paris.

Salle à manger de l’Hôtel de la Marine © V.E.
Après une longue réflexion et la menace pendant un temps de sa privatisation, il est décidé en 2017 de restaurer l’hôtel et de lui redonner ses éléments d’origine des XVIIIe et XIXe siècles. Les peintures d’origine ont été mises au jour en retirant les multiples couches de peinture qui s’étaient succédées au fil des siècles, jusqu’à une vingtaine par endroits.
Les décorateurs chargés du projet, Michel Carrière et Joseph Achkar, ont eu pour mission de reconstituer le mobilier de l’hôtel en s’aidant des 900 pages de l’inventaire du lieu. Ils ont identifié les éléments qui ont été conservés, et cherché des équivalents chez les antiquaires pour ce qui a été perdu. Plus habitués aux commandes pour des particuliers qu’aux monuments historiques, ils n’ont pas hésité à ajouter des objets du quotidien pour donner aux appartements un aspect « habité ».
Les travaux ont duré cinq ans, et le monument a été inauguré le 10 juin dernier. Il compte en plus d’un parcours permanent de visite un espace d’exposition temporaire, un restaurant, un café et une librairie-boutique.
Le bâtiment accueille aussi des bureaux disponibles à la location, dans lesquels se sont installés le siège de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ainsi qu’une antenne de la Fédération internationale de football (FIFA).
Une muséographie classique mais enrichie par une visite sonore
Le parcours de visite et la muséographie sont assez classiques, le visiteur va de pièce en pièce et se laisse guider à travers des reconstitutions de décors d’époque, comme dans la plupart des châteaux et monuments historiques. Mais la présence de nombreux dispositifs numériques de médiation permet à l’Hôtel de la Marine de se démarquer et de proposer une visite plus riche.

Visiteurs dotés d’un « Confident » © V.E.
Un casque connecté nommé « le Confident » est remis à chaque visiteur avant le début de la visite. Il a été conçu en partenariat avec le Studio Radio France, dont les équipes sont spécialisées dans le son binaural et la narration immersive. Ce ne sont pas moins d’une centaine de personnes qui se sont investies dans ce projet, dont le tournage a eu lieu au Château de Rambouillet : plus de soixante comédiens, une vingtaine de musiciens ainsi qu’une équipe de production de vingt personnes. Les scenarii de ces parcours ont été imaginés par Didier Laval, Anne Carles et Karine Chaunac. Il constitue le fil rouge de la visite, sans lui, elle perdrait une grande partie de son intérêt puisqu’il n’y a aucun cartel ou support de médiation dans les salles.
Le visiteur doit d’abord faire son choix parmi trois parcours : « Voyage dans le temps », « En famille » ou « Le Siècle des lumières ». Puis la visite commence automatiquement, le casque détecte chaque mouvement du visiteur jusqu’à la direction de son regard, afin de le guider à travers les salles. Après un petit temps d’adaptation, il se laisse donc porter par le son. Ambiances sonores, musicales, scènes jouées par des comédiens se succèdent et invitent le visiteur à s’imaginer des personnages déambulant dans les reconstitutions qu’il a sous les yeux. Ainsi, il peut mieux saisir les préoccupations de l’époque et l’ambiance qui devait régner dans ces lieux au quotidien.
L’utilisation du son binaural rend la visite très immersive. Par exemple, un personnage peut nous interpeller dans notre dos, et il suffira de se retourner pour l’entendre de face.
Ce mode de visite a tout de même quelques inconvénients : le casque isole les visiteurs de leur environnement et de leur entourage. Certaines personnes font sonner des alarmes et ne s’en rendent même pas compte ! Difficile alors pour les agents chargés du gardiennage des salles de se faire entendre.
Précisons que la visite est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, certes sous une autre forme moins captivante : une web-application disponible sur smartphone ou sur des tablettes fournies à l’entrée. Cette interface propose une visite complète en langue des signes.
Un parcours mettant les dispositifs numériques à l’honneur
Dans les salons de réception, marquant la dernière partie du parcours, relevons cinq dispositifs numériques innovants permettent au public d’approfondir ses connaissances de manière plus théorique, mais toujours dans des formes originales.



Miroirs dansants © V.E. Galerie des portraits © V.E. Table des marins © V.E.
-
Les Miroirs dansants : plusieurs miroirs-écrans numériques rotatifs reconstituent les évènements qui ont pris place dans l’Hôtel de la Marine au fil des années, notamment les grands bals du XIXe siècle.
- La galerie des portraits : sur ce paravent s’animent des portraits de personnalités importantes pour l’histoire du monument. Interprétés par des comédiens, des dialogues permettent de mieux comprendre qui ils étaient et les relations qu’ils entretenaient.
- La table des marins : il s’agit d’une grande table ronde dotée d’un planisphère animé au centre. Différents écrans tactiles sont disponibles, sur lesquels les visiteurs peuvent choisir une expédition navale menée par la France. Une fois le navigateur sélectionné, on peut suivre son itinéraire sur le grand planisphère au centre, tout en écoutant le déroulé de l’expédition dans son casque.

Table de l’urbanisme © V.E.
- La table de l’urbanisme : un grand écran présentant un panorama vidéo de l’histoire de la place de la Concorde et de ses deux hôtels particuliers

L’Hôtel de la Marine à la loupe © V.E.
- l’Hôtel de la Marine à la loupe : il s’agit d’un plan de coupe de l’Hôtel animé par des silhouettes dont on entend les dialogues directement dans les Confidents. Ce grand écran illustre le déroulé d’une journée type au sein de l’Hôtel de la Marine.
Ce sont donc des dispositifs très modernes qui rendent la visite plus mémorable pour le public.
Quelques points à soulever
Toutefois, malgré la modernité des dispositifs de médiation, quelques bémols sont à apporter : le besoin de s’adapter aux contraintes du bâtiment existant implique parfois peu d’espace pour la circulation des visiteurs, ce qui pourrait s’avérer gênant en cas de forte affluence. C’est malheureusement un inconvénient que l'on retrouve fréquemment dans les monuments historiques, du fait qu’ils n’aient pas été créés à l’origine pour recevoir des visiteurs.
Autre point plus problématique pour le confort de visite : aucune assise n’est proposée au public durant toute la durée du parcours, long tout de même d’environ deux heures. Cela peut être fatiguant en particulier pour les personnes âgées ou les femmes enceintes.
Dernier point : il est important d’être conscient de la provenance des financements qui ont permis ces importantes restaurations. Ces travaux de réhabilitation ainsi que la mise en place de dispositifs numériques coûtent cher, et c’est par le biais de certains partenariats que le CMN a pu assumer de telles dépenses. En effet, Philippe Bélaval, le président du CMN, a indiqué que sa restauration n'avait "quasiment rien coûté aux contribuables" puisque moins de 10% de son coût de 130 millions d'euros a été supporté par l'Etat, le reste étant autofinancé (par la location de d’espaces professionnels notamment) ou soutenu par le mécénat à hauteur de 20 millions d’euros.
Parmi les accords de mécénat les plus importants citons la fondation Al Thani, organisme gérant la collection privée de la famille royale du Qatar. En échange d’une participation financière conséquente, celle-ci se verra disposer à partir de l’automne 2021 d’un espace d’exposition de 400m2 au sein du monument pour une durée de vingt ans. Ainsi, l’Hôtel de la Marine s’ajoute à la liste de plus en plus longue de lieux culturels français tissant des liens avec le gouvernement du Qatar. Le Qatar ne compte ni parti politique, ni force d’opposition, et cet état a bâti sa fortune économique sur des énergies non renouvelables (pétrole et surtout gaz). C’est aussi le pays le plus émetteur de dioxyde de carbone par habitant au monde. Un choix de mécène peu cohérent avec notre époque marquée par le réchauffement climatique.
Après quatorze ans de débats, sept ans de chantier, 135 millions d’euros de travaux, c’est un nouveau lieu qui ouvre ses portes à Paris, rendant accessible un hôtel particulier resté jusqu’ici très secret. Les Parisiens et les touristes du monde entier peuvent ainsi profiter de la vue sur de nombreux monuments parisiens et sur la Place de la Concorde réservée jusqu’à présent aux quelques privilégiés fréquentant le Palace le Crillon.
L’Hôtel de la Marine veut devenir un véritable lieu de vie au cœur du quartier de la Concorde avec ses espaces de restauration et ses cours intérieures accessibles gratuitement.
A voir :
Documentaire en replay sur Arte.tv sur le chantier de restauration : https://www.arte.tv/fr/videos/084723-000-A/hotel-de-la-marine-renaissance-d-un-palais/
#monumenthistorique #paris #médiationnumérique
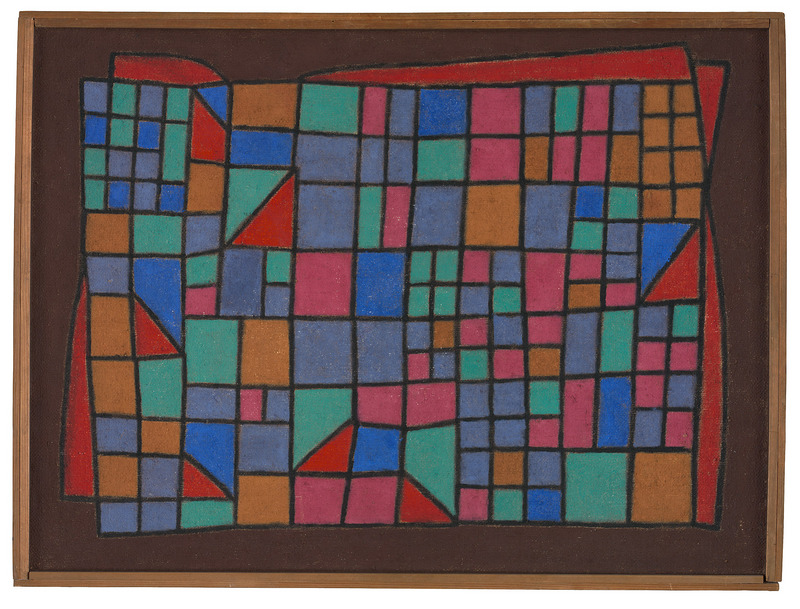
L’œuvre d’un homme, sans cesse renouvelée
Le Zentrum Paul Klee de Berne (Suisse) nous montre, comme chaque année, une nouvelle perspective sur sa collection de plus de 4 000 œuvres : à quel point cette présentation est-elle novatrice ?
Dans le cadre d’un travail sur la collection du musée, l’équipe du Zentrum Paul Klee et sa directrice, Nina Zimmer, ont cherché à renouveler la perception de l’œuvre de Paul Klee en invitant des enfants. Ce souci du public enfant est coutumier du lieu : le Zentrum Paul Klee cohabite avec « Creaviva » un musée pour les enfants, où des offres d’ateliers, gratuites ou payantes, permettent aux enfants et aux adultes d’approcher l’œuvre de l’artiste germano-suisse par sa technique et l’expérimentation des matériaux.
Cette action crée un lien plus fort entre ses deux institutions et laisse, pour une fois, des voix non professionnelles en charge de la présentation de l’œuvre de Paul Klee. Pour se faire, une équipe interne au musée et au centre « Creaviva » fut créée pour piloter le projet. Elle est composée de Martin Waldmeier (Commissaire), Eva Gradel (Responsable de la participation culturelle), Alyssa Pasquier (Assistante de Martin Waldmeier), Pia Lädrach (Responsable Kindermuseum Creaviva), Katja Lang (Assistante du Kindermuseum Creaviva), ainsi que 13 enfants âgés de 8 ans à 13 ans. Ils ont œuvré ensemble pour créer « Un secret lumineux. Klee exposé par des enfants » (22.05.2022 – 04.09.2022).
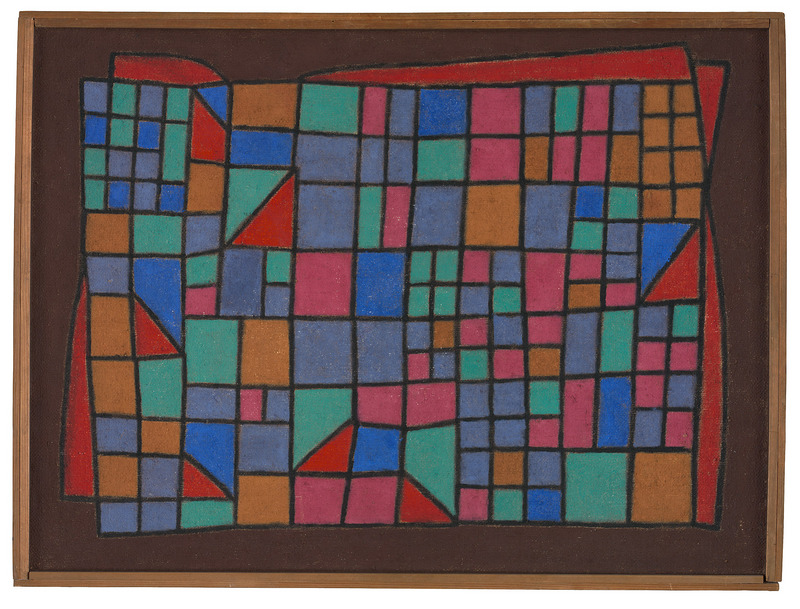
Paul Klee, Glas-Fassade [Glass-Facade], 1940, Wax paint on burlap on canvas, 71,3 x 95,7 cm,© Zentrum Paul Klee, Bern
Suite à de nombreuses activités avec l’équipe de travail, autour de l’écriture et de l’alphabet de Paul Klee ainsi que des techniques qu’il utilisait, le moment est venu de créer une exposition, un propos et donc une histoire autour de l’œuvre de l’artiste.
Le projet présente les nombreuses activités, recherches et adaptations faites sur une période de 13 mois, ce qui est présenté dans l’espace d’exposition avec des sections créées par des cimaises parallèles et horizontales et des œuvres variées telles que des œuvres graphiques, mais aussi des peintures, des archives et des photographies.
Cette aventure qui va au-delà de la figure de Paul Klee fut décidée avec un tableau commun « Glas-Fassade » de 1940. Cette grande toile tardive de l’artiste, faite de formes colorées dans un quadrillage abstrait, ouvre l’exposition sur une cimaise au ton aubergine, accompagnée d’une introduction du projet qui présente la nouvelle approche muséographique dont le but est d’impliquer les enfants dans la création d’une exposition.

© Martin Waldmeier, Zentrum Paul Klee
Dans le parcours, nous observons des différences notables entre les expositions des collections précédentes et celle-ci. En premier lieu, les cimaises s’habillent de tons colorés, allant du rouge, au jaune et à l’aubergine, des bancs à foison jalonnent les cloisons ainsi que des assises colorées qui imitent la couleur de l’œuvre « Glas-Fassade ».
Malgré ces ajouts colorés, aucun élément flagrant ne démontre la collaboration entre les enfants et les professionnels des musées « Créaviva » et le Zentrum Paul Klee. À côté de chaque œuvre exposée dans les 19 sections (l’église, l’architecture, du brisé et du recomposé et bien d’autres) il y a un cartel décrivant le titre, la technique, ainsi que la taille de l’œuvre, le tout traduit en français, allemand et italien comme il en est coutume dans un établissement cantonal et suisse. Sachant que le propos fut écrit et inventé avec des enfants, il aurait été judicieux de créer des textes simplifiés et/ou illustrés par un illustrateur, pour faire comprendre au public les différentes approches de l’œuvre de Paul Klee en fonction des âges.
Le seul ajout fut des boîtes de contreplaqué entre chaque section, qui diffusent des discussions des enfants autour de l’exposition. Or, le contenu est décousu car l’histoire de création de l’exposition, ne montre qu’un documentaire et un atelier participatif en fond de la salle, ne la mettant pas en valeur au centre de l’exposition, et in fine du processus.
Le processus de l’exposition en tant que tel est à souligner tant il est régulier et créatif. Lors des workshops, les enfants se sont concentrés sur de nombreuses approches plastiques autour de l’œuvre de l’artiste : création d’un alphabet, recherche d’un titre pour l’exposition, sélection des œuvres ainsi que leurs divisons par sections, question de l’histoire dans l’exposition. Or, au-delà de cette approche créative, le commissaire d’exposition a repris le pas pour l’accrochage, aucun enfant n’a donné son avis pour l’accrochage, la hauteur des œuvres, le texte d’introduction, les cartels, ou le guide de visite, qui de surcroit n’est pas adapté aux enfants.

© Martin Waldmeier, Zentrum Paul Klee
Alors, quelles sont les choses à garder de cette exposition « Un secret lumineux
Klee exposé par des enfants » (22.05.2022 – 04.09.2022) ? Comme le dirait Paul Klee lui-même « Car nous voyons tous la même chose, même si c’est sous des angles différents », la perception d’une œuvre et d’une exposition dépend largement d’un avis subjectif et lorsqu’un musée porte son discours à travers l’œil d’un commissaire ou d’un directeur, celui-ci est principalement historique et comparatif. Or, le visiteur, touriste ou local, a une perception tout autre, amateur, et souvent enfantine, il connait très peu la figure de Klee. Devant des œuvres, il manque d’une vraie explication, que ce soit du processus de création, des matériaux utilisés et de son contexte de création. Le but était d’imbriquer ces deux visions dans une exposition, où les enfants jouent un rôle central pour la présentation, la médiation et la sélection des œuvres, alors que le commissaire a pris la casquette d’un organisateur, d’un passeur entre l’équipe du musée et la vision des enfants.
Ce processus de partage, de sensibilisation et de liberté, a permis aux enfants et aux équipes des deux institutions de souffler un nouvel air sur l’œuvre de l’artiste ainsi que sur le rôle d’un projet lié à la collection/exposition et son lien avec le public. Alors que le public appréhende l’œuvre de Paul Klee lors de cette visite, il n’est pas si simple d’étudier ses lignes, sinueuses qui naviguent entre les lettres et les aplats colorés.
Ses œuvres ne sont pas réellement abstraites et figuratives, or les explications données restent généralistes, et ne discutent pas du contexte et des problématiques de la guerre. Une question persiste : comment tenir un discours universel et compréhensif par tous, cette exposition devait en être une réponse, or elle pose une autre question : celle de la hiérarchie des contenus. Le récit historique créé par les historiens de l’art prévaut sur celui des enfants ou du public, or les deux peuvent coexister dans le même espace, pour fournir des clés de lecture différentes, et donc, permettre à tous d’appréhender l’œuvre de Paul Klee.
Informations pratiques
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
3006 Berne
Tél. +41 31 359 01 01
Fax +41 31 359 01 02
Horaires
MAR—DIM 10h—17h
LUN fermé
LG
Pour en savoir plus
#Exposition #Suisse #Curator

La Bioinspiration dans les musées : quand l'art et la nature s'unissent
"Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur."
Cette citation de Léonard de Vinci résonne avec force dans le contexte actuel, où l’interaction entre la nature, l’architecture et les modes de fonctionnement deviennent une source d’inspiration pour l’art, la science, et même la préservation de nos écosystèmes.
De plus en plus, les musées adoptent cette approche, non seulement pour enrichir leur esthétique, mais aussi pour intégrer une dimension écologique essentielle dans la conservation des œuvres et la gestion de leurs infrastructures. La bioinspiration est une approche novatrice qui consiste à puiser dans les stratégies de la nature pour repenser nos façons de créer et de protéger l'environnement.
Une nouvelle vision artistique et architecturale
La bioinspiration fait référence à un processus créatif fondé sur l’observation des systèmes vivants – des micro-organismes aux écosystèmes entiers. Elle consiste à s’inspirer des solutions que la nature a développées au fil du temps pour résoudre des problèmes, dans le but d’innover dans divers domaines, y compris la muséographie.
Si la nature a toujours été une source d’inspiration pour les artistes et les scientifiques, elle a été largement délaissée pendant la révolution industrielle, lorsque les progrès
technologiques ont conduit à l’idée que la nature était imparfaite et ne pouvait plus être un modèle fiable. Pourtant, au XXIe siècle, nous redécouvrons l’importance de l’observation de la nature pour stimuler la créativité.
Les musées contemporains incarnent parfaitement cette alliance. Certains choisissent des emplacements insolites et éloignés des centres urbains, où la nature est non seulement un cadre de vie mais aussi une source d'inspiration.
Des musées biomimétiques dont l'architecture s’inspire de la nature
De nombreux musées contemporains intègrent des éléments biomimétiques dans leur conception, allant du simple esthétisme à une démarche éco-responsable. Ces espaces créent une atmosphère propice à l’immersion, à la contemplation et à l’introspection.
Le Musée Fabre à Tokyo, au Japon, a une architecture qui rappelle la tête d’un insecte, symbolisant ainsi l’interconnexion de la nature et de l’art. De même, le Musée des Confluences à Lyon adopte une forme évoquant un nuage, et est un autre exemple de l’utilisation du biomimétisme dans l’architecture muséale. Ces musées invitent les visiteurs à réfléchir aux possibles échanges entre différents éléments architecturaux et naturels, sans pour autant s’inspirer de leur écosystème.
La préservation d’un écosystème : la bioinspiration comme démarche écoresponsable
Les musées adoptent de plus en plus la bioinspiration pour intégrer des solutions écologiques dans leur architecture et la gestion de leurs ressources. Inspirés par la nature, ils imitent des processus naturels pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir la durabilité. Ces pratiques incluent l’utilisation de matériaux locaux, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’intégration de végétation pour réguler les températures et l'humidité. Voici quelques exemples :
Le Musée du Quai Branly à Paris présente par exemple 800 m² de murs végétaux conçus par Patrick Blanc. Composés de 15 000 plantes, ils régulent naturellement la température et l'humidité tout en favorisant la biodiversité urbaine. C’est également le cas du Centre de Conservation du Louvre à Liévin, qui préserve ses collections en ayant recours à un toit végétalisé qui stabilise le taux d’hygrométrie.

© Musée du Quai Branly, Photigule
De même, l'ArtScience Museum de Singapour, avec sa forme inspirée de la fleur de lotus, récupère l'eau de pluie qui est ensuite recyclée et réutilisée par le musée grâce à un système de cascade, et optimise la diffusion de la lumière.
Alliant mimétisme et renforcement, le Musée Ordos, situé dans la ville du même nom en Mongolie-Intérieure en Chine, utilise des panneaux métalliques pour se protéger des fréquentes tempêtes de sable et des vents froids d’hiver. Il s'adapte ainsi à son environnement désertique en tentant de s’y fondre grâce à son architecture aux allures de dunes ou de galet. Cette démarche se remarque autant qu’elle se questionne : le bâtiment relève-il vraiment du mimétisme, ou ne vise-t-il qu’un effet spectaculaire malgré son intégration au paysage ?

© Musée Ordos, Chine, Popolon Architects : Ma Yansong, Yosuke Hayano, Dang Qun from MAD Architects
Impulsé par le Muséum National d’Histoire naturelle, le projet Bioinspire-museum soutient et valorise cette pratique dans l’ensemble des activités du musée, tout en permettant l’émergence des matériaux de demain inspirés du vivant. L’accent est mis sur la bonne compréhension de la biologie, nécessaire au succès du projet.
Ces projets montrent que la bioinspiration peut permettre aux musées de renforcer leur engagement en faveur de l’écologie, mais aussi de créer des espaces plus durables et résilients face aux défis environnementaux actuels.
Et si la bioinspiration influençait la conservation préventive ?
La bio-inspiration offre également des pistes intéressantes pour une conservation préventive plus respectueuse de l’environnement. Il n’est pas rare que des œuvres soient face à des risques de moisissures ou de craquèlement dus à une mauvaise gestion du taux d’humidité de leur lieu de conservation. Le Musée des Beaux-arts de Brest voit ses portes fermées pour plusieurs années à la suite de moisissures sur 18 de ses 190 tableaux exposés. Il est obligé de réaliser de lourds travaux de réhabilitation voire même de reconstruction totale du bâtiment.
Le toit végétalisé du Centre de Conservation du Louvre à Liévin permet par exemple d’anticiper ce genre d’incidents en aidant naturellement et efficacement à la régulation du taux d’humidité et de la température intérieure.
Parfois même lorsque ce n’est pas prévu, la nature vient en aide à certains instituts : au Portugal, des chauves-souris ont été mises à contribution pour protéger les collections de bibliothèques, en régulant les populations d’insectes nuisibles de manière naturelle et sans produits chimiques. Bien entendu, leur présence implique une protection toute particulière des objets.
Ainsi, l’innovation et la nature peuvent tenter de se conjuguer pour préserver nos patrimoines tout en prenant en compte l’environnement. Mais ces bâtiments sont-ils capables de se fondre dans leur environnement de par leur taille ? Leur aspect reste industriel et leur impact écologique important.
Un modèle durable
Bien entendu, la bioinspiration ne se limite pas aux musées. Elle est un levier pour repenser les villes de demain. À l’horizon 2050, près de 80 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Il devient donc essentiel de repenser les villes comme des écosystèmes durables, capables de s’adapter aux changements climatiques et aux défis environnementaux. En tirant parti des principes du biomimétisme, il est possible de concevoir des bâtiments qui consomment moins d’énergie, qui recyclent les ressources et qui offrent des espaces de vie harmonieux avec la nature.
Ainsi, lorsque nous parcourons les expositions de ces lieux inspirés du vivant, nous ne faisons pas que contempler des œuvres. Nous vivons une expérience qui se veut immersive où l’art et la nature ne font plus qu’un, nous invitant à repenser notre rapport à l’environnement et à la préservation de notre planète. Mais l’est-elle réellement ?
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
- La bioinspiration expliquée par le Muséum National d’Histoire Naturelle : Biomimétisme : Quand la Nature nous inspire | MNHN
- Le projet Bioinspire-Muséum : https://www.mnhn.fr/fr/bioinspire-museum
- Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture : Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture - Design-Mat
Expositions en lien avec cette thématique :
- “Bio-inspirée” au Musée des Sciences et de l’Industrie (exposition permanente depuis septembre 2020) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/bio-inspiree/lexposition
- “Mimèsis. Un design vivant au Centre Pompidou-Metz (exposition temporaire :06/2022 - 06/2023) : Mimesis. Un design vivant
#Bioinspiration #Conservation #Ecoresponsabilité #Architecture

La Chambre des visiteurs : acte 2
Ayant profité des congés de Noël pour retourner dans ma terre natale normande, je suis allée visiter la fameuse « Chambre des visiteurs » au Museum d’Histoire naturelle de Rouen. Il fallait quand même voir le résultat, tant mon premier article à ce sujet m’avait posé de questions.
Petit résumé de l’initiative

Visuel du site © http://www.lachambredesvisiteurs.com/
Un manque de communication
Première constatation : rien à l’extérieur du Museum n’indique qu’à l’intérieur on puisse trouver une exposition d’œuvres choisies par les visiteurs. Aucun texte à l’accueil ne parle de l’initiative dont résulte l’exposition, pas de signalétique non plus. J’ai donc demandé où était la salle dans laquelle je pourrais trouver ce petit bijou participatif. « Au premier étage du Museum, en haut des escaliers à droite. » Ni une, ni deux, je gravis les quelques marches qui me séparent de la fameuse exposition, j’arrive au premier. Au second, j’entends un « brouhaha » phénoménal, mais ici, personne. Je franchis la porte de la « chambre » que je cherche, et tombe sur le texte de présentation de l’exposition.
Photo du texte de présentation de l'exposition © Chloé Méron
Une exposition classique
Vue d'ensemble © Chloé Méron
Bibliothèque © Chloé Méron
« À moitié »
C.M
#mbarouen
#commissariatparticipatif
#exposition

La Chartreuse de Douai, un musée à la médiation exemplaire
Une architecture incontournable
© http://www.musenor.com/Les-Musees/Douai-Musee-de-la-Chartreuse
La Chartreuse de Douai est un musée de beaux-arts municipal. Nous pouvons y accéder en franchissant un portillon et un petit parc recouvert de gravier blanc et de végétaux variés. Là nous découvrons une architecture très authentique qui nous invite à entrer dans ce bâtiment, ou plutôt monument. L'architecture est une partie prenante de ce lieu attrayant. Une des caractéristiques de ce musée est qu'il est installé dans un ancien couvent. Les noms des salles ont d'ailleurs été conservés tels quels : le petit cloître, le réfectoire, la salle capitulaire, et la chapelle.
Ce musée possède une large collection de peintures, sculptures, orfèvrerie et objets d'arts. Il s'inscrit dans un scénario chronologique, entre néo-classicisme et réalisme et parcourt diverses contrées.
Il prend en compte l'accessibilité tarifaire : le tarif réduit est de seulement 2,30 euros et le plein tarif est de 4,60 euros. Ceci est plutôt rare et permet d'attirer davantage le public ! Puis, pour chaque personne, des visites guidées gratuites sont organisées chaque premier dimanche du mois, ce qui permet au public d'appréhender les collections sous divers angles.
L'équipe de médiateurs, qui sont conférenciers ou plasticiens, est composée de six salariés très investis dirigés par une chargée des publics ancienne infirmière anesthésiste ! Ce qui est plutôt atypique ! Les médiateurs créent des contenus, des activités et des visites à destination du public scolaire et adulte et également à destination du public handicapé, hospitalier et pénitentiaire. Chaque personne est prise en considération et trouve sa place au sein de cet espace culturel.
De nombreux musées se cantonnent souvent à des actions culturelles envers les scolaires et les groupes d'adultes. Ici le musée saisit l’idée de démocratisation culturelle tout en l’élargissant. Il valorise ses collections en les proposant à une palette de publics très large. Malgré des périodes difficiles et un budget qui est plus faible que celui de grands musées nationaux, le musée est fort de propositions très attractives envers chacun.
Le musée propose ses activités à de nombreux acteurs tels que les associations, les comités d'entreprises, les centres sociaux et les centres de formation, les centres hospitaliers et les maisons d'arrêt. Il souhaite toucher un public vaste et créer des partenariats forts avec ces institutions. Les projets proposés sont d'ailleurs adaptés selon la demande de ces lieux.
Des actions culturelles en milieu pénitentiaire

Le cloître : lieu d'expression des publics
Crédits : Lilia Khadri
Les projets à destination du public handicapé sont à long terme, sur l'année, ce qui permet de mieux s'approprier les collections et de créer un lien fort avec l'art et le lieu.
Pour les malvoyants le musée a créé le musée au bout des doigts en s'appuyant sur le patrimoine architectural du lieu qui est intéressant à explorer. Pour cela une maquette tactile a été créée, elle comprend la distribution des salles mais aussi les époques de construction. De nombreux musées implantés dans ce type de lieu patrimonial pourraient s'inspirer de ce dispositif. De plus les personnes malvoyantes peuvent tout de même découvrir des œuvres du musée, durant des visites au sein desquelles le médiateur présente une collection d'œuvres qu'il a choisi, à travers des tables d'orientation accompagnées de commentaires audio et des équipements en braille.
Le public en situation de handicap mental est confronté lors d'évènements aux notions de temps, corps ou encore beauté.
La chapelle du musée Crédits :Lilia Khadri

Ce que chaque visiteur peut retenir de sa visite au sein de la Chartreuse est l’architecture remarquable, la collection très variée et bien mise en valeur, et un musée compréhensible par tous !
Lilia Khadri
En savoir plus :
- http://www.museedelachartreuse.fr/
# Musée pour tous
# Beaux-Arts
# Région des musées

La dame du château
Lorsque je l’aperçus pour la première fois, je notai en premier ses grands yeux noirs. Bordés de longs cils, empreints d’une tristesse qui contrastait avec le soleil d’automne qui illuminait les pierres blanches du donjon de Vincennes.
La forteresse avait à peine ouvert ses portes aux visiteurs. Je me souviens avoir pris mon temps pour ouvrir la grande porte de la Sainte-Chapelle. J’aimais ces moments de solitude absolue qu’elle seule m’offrait.
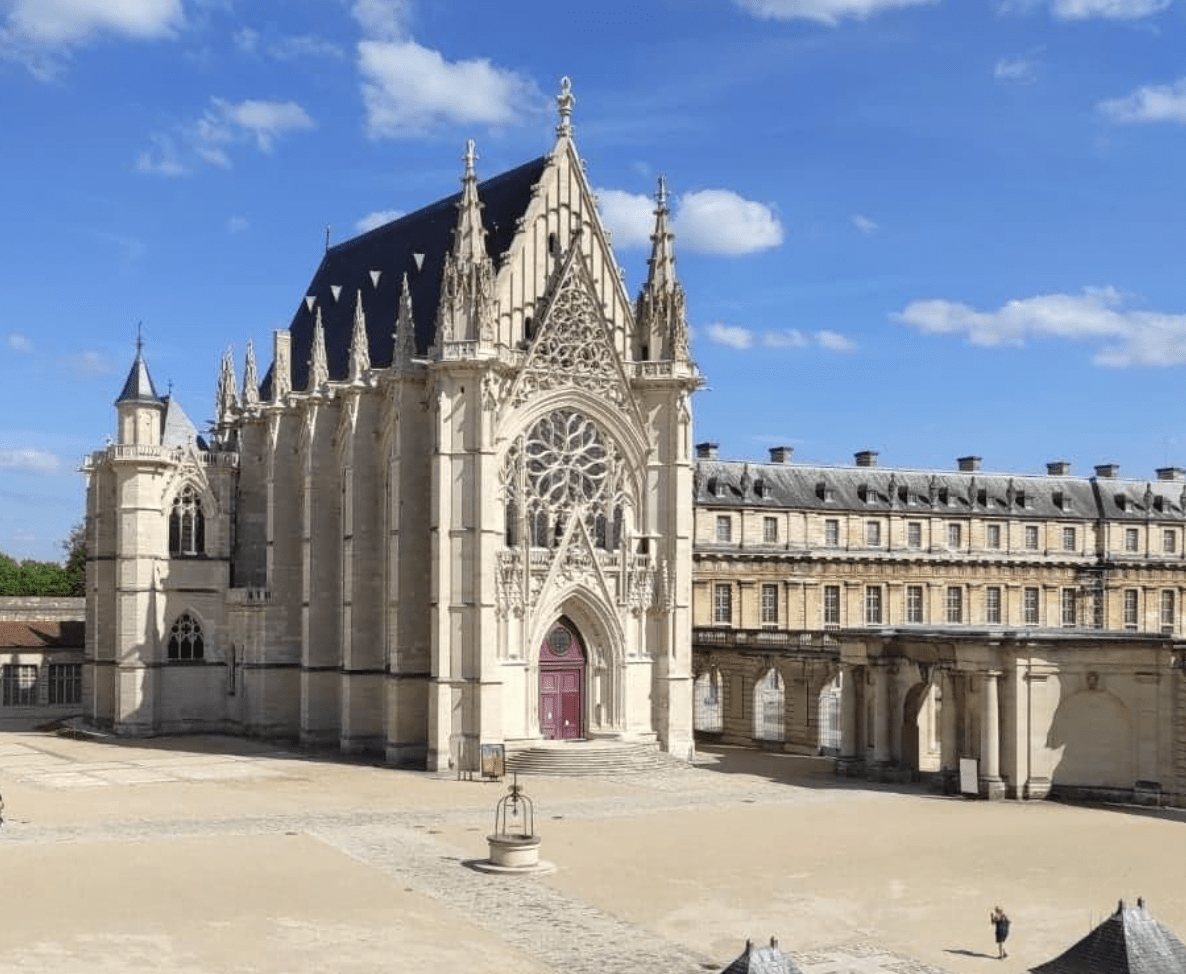
La Sainte-Chapelle, ©Sylvain Gaïo
Seule au milieu de la chapelle, je pouvais à mon aise et pendant quelques minutes profiter de sa quiétude, du silence et des vitraux. Comme à mon habitude, j’avais commencé par saluer Henri II, tranquillement agenouillé au bas du vitrail central. Dans le matin ensoleillé, illuminé, il m’éblouissait. Passant devant le tombeau du Duc d’Enghien, je fus, comme chaque fois, saisie d’un frisson. Pauvre duc enstatué, tué si misérablement et sans aucun panache…
En m’installant à la petite table où l’on contrôlait les tickets d’entrée des visiteurs, après avoir ouvert grandes les portes du bâtiment, je laissais vagabonder mes pensées. Il était aisé d’inventer une existence à tous ces gens de passage, que je ne reverrai jamais plus. Aisé d’imaginer que cet homme avec un enfant qui tenait à la main un ballon était un père célibataire à qui l’on avait brisé le cœur. Que ces jeunes gens, si studieux pendant la visite, ne songeaient en réalité qu’à la fête qu’ils rêvaient d’infiltrer le soir même. Ou que ces deux visiteurs, qui échangeaient au travers des questions qu’ils me posaient lors de la visite guidée, des regards brûlants, finiraient par vivre une grande histoire d’amour aux Maldives.
Et puis, en sortant de la Sainte-Chapelle, je l’avais vue, debout sur le pont-levis, statue si fragile qu’un coup de vent aurait pu la briser. Je m’approchai, sans trop savoir pourquoi, au lieu de l’attendre sagement dans ma guérite.
- Tout va bien ?
Elle fixa sur moi ses grands yeux de charbon. Et puis elle me coupa le souffle.
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider.
Sous le ton calme et posé, des émotions qui, rageusement, bouillonnaient sous la surface. Et sa voix…. Grave, profonde, une voix chaude d’outre-tombe.
- Comment…Perdu ?
Elle avait la grâce de ceux qui n’ont aucun défaut, de ces êtres parfaits qui n’existent que dans les légendes, ou dans les romans..
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider !
La supplique, cette fois, était bien audible, et me fit sortir de ma torpeur.
- Ici ? Dans le donjon ?
Il n’était aucun monument au monde que j’aimais plus que le château de Vincennes. J’étais depuis toujours hypnotisée par sa majesté. Haut de 52 mètres de hauteur, construit par Philippe IV de Valois et achevé par Charles V, son petit-fils, au XIVème siècle, le donjon de Vincennes n’avait rien perdu de sa splendeur passée de résidence royale.
La femme devant moi avait hoché la tête. Je décidai de l’accompagner dans le donjon à la recherche de son mari.
- Suivez-moi, Madame, je vais vous aider.
Alors elle me sourit, et je fus étrangement convaincue d’avoir pris la bonne décision. Je la menai dans la cour intérieure, depuis laquelle nous montâmes l’escalier qui menait à l’étude de Charles V. Première pièce à s’offrir à nous lorsque l’on montait l’escalier de service qui se trouvait à l’intérieur du châtelet, l’étude du roi devait avoir été un endroit somptueux en son temps. Il me plaisait assez d’y imaginer Christine de Pisan en pleine conversation avec Charles le Sage, devisant avec animation des dernières découvertes de l’époque. Malheureusement, le décor magnifique de la pièce avait été saccagé par les révolutionnaires français lors de leur arrivée dans la forteresse. L’ancien statut de résidence royale du lieu n’avait certes pas joué en sa faveur.
Je me tournai à nouveau vers la femme. Nous étions seules dans la pièce et elle se tenait derrière moi, des larmes nacrées dans ses yeux d’onyx.
- Tout va bien ?
Son « oui » du bout des lèvres m’effraya. Elle était fascinante autant qu’inquiétante. Nous traversâmes la passerelle qui menait à l’intérieur du donjon pour arriver au premier étage, dans la salle centrale qui avait servi de salle de bal et de salle du conseil du temps de Charles V. Le donjon était une construction carrée, flanquée aux angles de tourelles circulaires. Dans chacune de ces tourelles se trouvait une petite pièce.
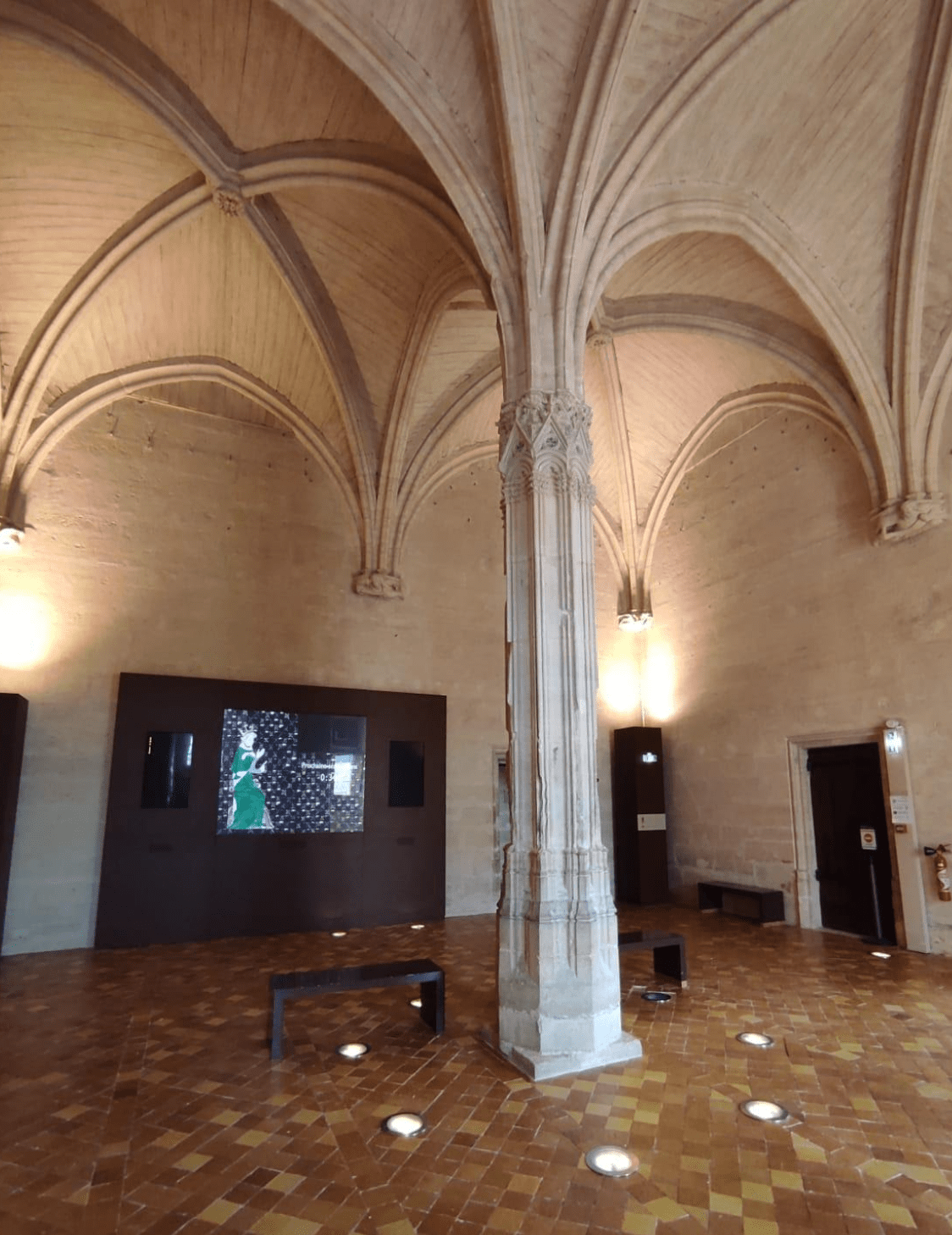
La Salle du Conseil, ©Sylvain Gaïo
J’eus, l’espace d’un instant, alors qu’elle marchait derrière moi, une impression très désagréable que je serais bien incapable de qualifier, et fus saisie d’un frisson.
Ma pièce préférée, au premier étage, était indéniablement la petite pièce circulaire qui avait servi, au XVIIIème siècle, à enfermer Mirabeau. Il régnait toujours à cet endroit du donjon une ambiance très particulière, au parfum d’aventure et de railleries, sur fond de Révolution. Depuis cette petite cellule dans laquelle il fut enfermé par lettre de cachet, Mirabeau avait maille à partir avec le marquis de Sade, enfermé au même moment dans une cellule voisine. Leurs échanges d’insultes en tous genre étaient devenus légendaires au château. Lorsque Charles V avait installé sa résidence favorite dans le Donjon de Vincennes en son temps, il était sans doute loin d’imaginer que ce dernier serait transformé en prison à La Renaissance, et que moult prisonniers célèbres dormiraient sur des paillasses dans ce qui fut un jour chapelles royales et garde-robes.
Mais au premier étage comme ailleurs, pas de trace du mari de ma visiteuse. Juste une vieille dame et sa petite-fille, admiratives des peintures du XVIIIème siècle, posées là par des prisonniers en proie à l’ennui, et sans doute, au froid terrible de l’hiver dans la prison de Vincennes.
Alors je l’emmenai à l’étage supérieur, dans ce qui fut un jour la chambre royale. Charles V y recevait ses invités les plus prestigieux, et j’étais chaque fois que j’y posais le pied, séduite par la beauté des peintures d’époque, qui subsistaient au plafond, conservées par les siècles de feux de cheminées, qui avaient déposé sur les pigments une couche de suie qui les avaient protégés. Rouge vif, bleu roi et fleurs de lys or accueillaient le visiteur dans une parade luxueuse et témoignaient à eux seuls de la splendeur passée de la pièce. Dans les tourelles d’angles, ou s’étaient un jour trouvées les latrines de Charles V et le trésor royal, pas de traces non plus d’un quelconque époux. Mon inconnue était toujours derrière moi, vêtue de noir jusqu’aux gants. Je me souviens avoir pensé qu’il était étrange de porter des gants un jour de grand soleil.
Je regardai alors en détail sa tenue. Elle semblait tout droit sortir d’un autre temps, avec sa robe noire et droite qui s’arrêtait au-dessus du genou et ses petites chaussures à talons bas. Elle portait un chapeau et des gants, noirs, qui me firent penser à ces photographies des années 30 ou 40 que l’on voyait parfois dans les livres d’histoire. Elle était déroutante, enchanteresse, et un peu effrayante. Je me demandais ce que j’étais en train de fabriquer, à chercher partout dans le donjon le mari de cette femme inconnue.
- Je suis désolée, Madame, mais je ne vois personne… Êtes-vous bien certaine que votre mari se trouve dans le donjon.
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider.
Je ne savais ni quoi faire ni quoi lui dire. Il me revint alors que l’un de mes collègues donnait une visite dans les parties hautes du donjon. Les trois derniers étages de la tour ; sans compter la terrasse qui accordait aux grimpeurs émérites des 250 marches qui y conduisaient, une vue imprenable sur la capitale qui s’étendait au pied de la forteresse ; n’étaient accessibles qu’à un petit nombre de personnes, certains jours de la semaine et avec un guide seulement. Désireuse de ne pas rester seule plus longtemps avec mon inconnue, et songeant que cet époux qu’elle cherchait se trouvait peut-être dans le groupe qui visitait les étages supérieurs, j’ouvris la grille et l’invitai à me suivre dans l’étroit escalier en colimaçon aux marches hautes. Comme aucun son ne nous parvenait des étages supérieurs, j’en déduisis que mon collègue devait déjà se trouver sur la terrasse.
Pour rompre le silence, je lui expliquais qu’au troisième étage du donjon se trouvait au Moyen-Age la chambre destinée au Dauphin de France, fils du roi. Mais le fils de Charles V, Charles IV, n’y avait jamais dormi. Lorsque sa chambre fut enfin prête à l’accueillir, il avait déjà obtenu ses 13 ans révolus, âge de la majorité, et succédé à son père. La chambre était restée vide. Elle avait retrouvé un usage quand Vincennes était devenu prison, et qu’on y avait enfermé jésuites et autres trouble-fêtes du temps des rois. Elle demeura sans rien dire, imperméable à mes explications.
Je passai l’étage, sachant pertinemment qu’aucun des visiteurs n’aurait pu s’y trouver isolé. Nous faisions toujours extrêmement attention à ne laisser personne en arrière dans cette partie du donjon.
Nous arrivâmes au quatrième étage. Je comptai me rendre directement sur la terrasse, mais j’entendis derrière moi la respiration de mon inconnue s’accélérer et la porte qui permettait d’accéder à la pièce centrale grincer.
- Paul !
Je me retournai, elle était déjà dans la pièce. Elle se tenait au pied du pilier central, seule. Pas de trace de son mari, contrairement à ce que semblait suggérer le prénom qu’elle venait de crier. Si l’on pouvait appeler cela un cri. Sa voix grave, presque caverneuse avait résonné dans la pièce. Je sentis s’accélérer les battements de mon cœur. Cette fois, j’avais peur, vraiment peur. J’aurais été bien incapable de dire si elle avait parlé, hurlé ou chuchoté.
J’entrai à mon tour dans la pièce. Et pour rompre mon malaise, je lui débitais l’histoire du lieu : la particularité du donjon de Vincennes, c’est que toutes les pièces centrales, bien que très hautes sous plafond, n’étaient soutenues que par un seul pilier central qui dégageait le reste de l’espace. Mais le pilier du quatrième étage était, de tous, le plus spécial. La pièce avait une histoire différente des autres. Il y régnait toujours une atmosphère particulière, presque solennelle. Elle était nue, les murs sans aucune trace de peinture, même substantielle, et des fenêtres partout. Au Moyen-Age, elle servait aux gardes pour leurs tours de ronde. Au XXème siècle, elle avait vu des soldats nazis s’installer entre ses murs pendant l’occupation. Des SS, mais pas seulement. Une unité de l’armée allemande, le NSKK, avait élu domicile à cet endroit du château. Cette unité était composée de soldats aux nombreuses nationalités, enrôlés par l’armée allemande dans les pays conquis. Ces soldats avaient laissé sur le pilier central leurs noms, graphités sur la pierre, fragile témoignage de leur présence à cet endroit du château, avant qu’ils ne soient délogés par l’armée américaine à la Libération. Au-dessus des noms allemands, triomphalement entouré au crayon pour signaler la victoire, un nom américain.
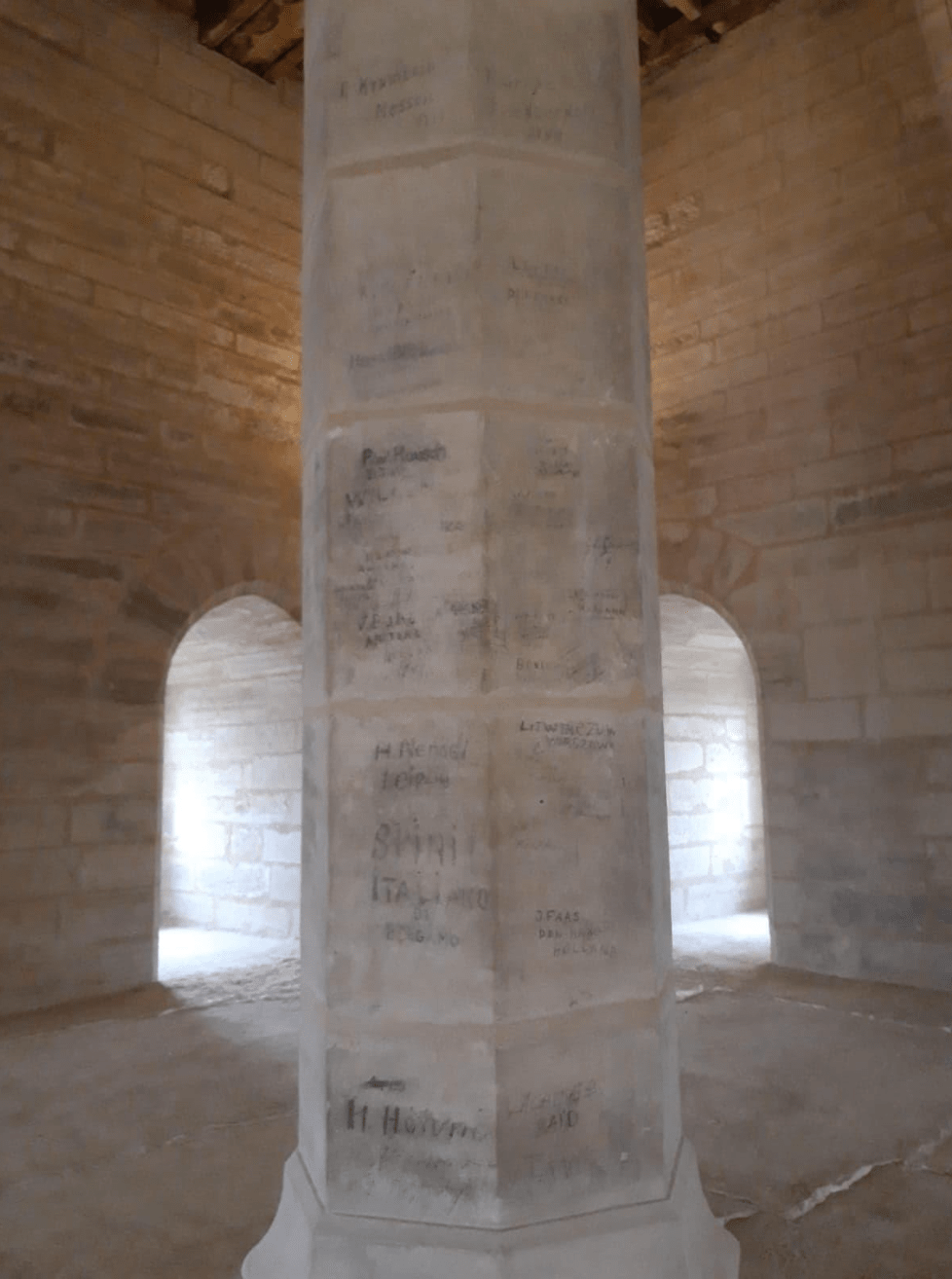
Le pilier du quatrième étage, ©Virginia Rossi
Mon inconnue s’était figée, tremblante, au pied du pilier. Je m’approchais d’elle. Dans ses yeux les mêmes tourments que dans sa voix. Ses grands yeux noirs étaient pleins de fureur et d’un chagrin que les mots ne sauraient exprimer. Espérant y voir ce qu’elle y voyait, je levai les yeux sur la colonne, qui portait pour toujours les stigmates de la guerre et de l’horreur graphités en même temps que les noms il y a plus de 70 années..
Qui étaient-ils ? Des nazis ? Ou bien des désignés volontaires, enrôlés de force par une armée dont ils ne partageaient ni la langue, ni les convictions ? Qui avaient-ils laissés au pays, quand ils étaient partis ? Des femmes ? Des enfants peut-être ? Des familles, qui attendaient leur retour ou leurs nouvelles avec une fiévreuse impatience, priant chaque soir pour les revoir en vie ? Il était arrivé, bien que rarement qu’un visiteur reconnaisse un nom sur la colonne, retrouve un aïeul ou un cousin. Nous avions reçu au château des lettres et des arbres généalogiques retraçant l’histoire d’un de ces noms laissés là par un soldat polonais ou néerlandais loin de chez lui. Je me demandai si mon inconnue avait elle-aussi retrouvé un nom qui lui semblait familier, qui aurait provoqué son émotion. Je détachai mes yeux du pilier central et tournai la tête pour lui demander.
Je sursautai.
Il n’y avait personne dans la pièce. J’étais seule devant la colonne. J’étais certaine pourtant, qu’elle n’aurait pu sortir sans que je ne l’entende. J’avais repoussé la vieille porte d’époque derrière nous, je l’aurais entendue grincer. Pourtant, je devais bien me rendre à l’évidence, elle n’était pas là.
Sans vraiment savoir pourquoi, je portai à nouveau le regard sur l’un des noms de la colonne. Un dénommé Paul Hoffmann des Pays Bas. Prise de panique, je sortis en courant de la pièce et fermai la porte derrière moi. Sur le pilier, en dessous du nom de Paul Hoffmann, deux grands yeux noirs comme le charbon avaient brillé, comme soulagés d’être enfin là où ils devaient être.
Essoufflée, mais terrifiée, je descendis quatre à quatre les marches de l’escalier en colimaçon, empoignai la grille qui séparait le troisième étage du deuxième, accessible à la visite et la fermai derrière moi
Reprenant ma respiration, je regardai autour de moi. J’étais seule dans la chambre royale et je me demandais si cette inconnue avait vraiment existé. Le château de Vincennes était un endroit propice à la rêverie, je pouvais très bien l’avoir imaginée…
Juliette REGNAULT
#architecture #châteaudevincennes #mystère
La fable d’un éveil à l’art
L’Enfance des Lumières se présente comme la nouvelle fable du musée Cognacq-Jay. Cette« expo pour s’éveiller à l’art »s’est installée sous les combles de la structure du 12 avril au 29 juillet 2018. Paris Musées en est l’initiateur, soucieux de participer à l’éducation du jeune public et d’aller à sa rencontre. Pour ce faire, cet établissement public a entrepris de créer une série d’expositions qui leur sont adressées. Destinées à l’itinérance, elles entendent présenter des thèmes en lien avec les musées et institutions dans lesquels elles s’implantent. Ces parcours, conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, sont confiés au commissariat d’Anne Stephan. Muséographe chargée des projets de médiation, elle s’emploie vivement à coordonner ces initiatives avec l’aide des équipes de Paris Musées et des structures d’accueil elles-mêmes. Fruit d’échanges entre multiples acteurs, L’Enfance des Lumières veut avant tout répondre aux attentes d’un public trop souvent délaissé.
Tapis de jeu de l'oie géant en l'honneur de M. Cognacq et Mme. Jay ©Emeline Larroudé

A l’instar des enfants du XVIIIe siècle, explorons l’exposition à travers les personnages des fables de La Fontaine, auteur du XVIIe, qui ont bercé les enfants du siècle suivant.
Salle d'exposition et modules ©Emeline Larroudé
La Cigale et le Musée
« Nuit et jour à tout venant, Je chantais, ne vous déplaise.»- La Cigale et la Fourmi, Jean de La Fontaine

Recomposition de visages enfantins issus de tableaux ©Emeline Larroudé
Le Lion et les Lumières
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi. »- Le Lion et le Rat, Jean de La Fontaine

Activité proposée dans le dernier tiroir du module éducation ©Emeline Larroudé
Le Renard et les Modules
« Et toi, Renard, a pris ce que l’on te demande. »- Le Loup plaidant contre le Renard par devant le Singe, Jean de La Fontaine
 De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
De grands livrets illustrés, à l’image de livres géants, approfondissent chacune des thématiques en six pages à feuilleter. Si la lecture rappelle une implication classique du visiteur qui s’en remet aux cartels, elle est essentielle. Cet incontournable se complète cependant par une mise en action systématique. Les renards sont invités à recourir à leur logique pour réaliser les nombreux puzzles présentés afin de reconstituer le tableau emblématique de chaque partie. Par ailleurs, une vitrine comparative les invite à faire le lien entre ce qui relève du familier et ce qui relève presque de l’inconnu. Ces dispositifs font place dans les différents tiroirs des modules, dont les derniers permettent l’expérimentation et la pratique en proposant de s’approprier des outils, objets ou costumes. Les sens, autant que l’intuition et la logique, sont vivement sollicités. Aussi, ces activités peuvent voire nécessitent, pour certaines, de s’envisager à plusieurs. La mise en action n’est plus solitaire mais collective, ce qui participe à l’enrichissement de cette exposition pleine d’aventures.
Vitrine comparative du module jeu ©Emeline Larroudé
Comment mieux impliquer le visiteur, d’autant plus lorsqu’il est avide d’interactivité et d’expériences, qu’en le rendant acteur ? L’Enfance des Lumières, initiatrice d’une série d’expositions lancée par Paris Musées, répond parfaitement aux attentes probablement insoupçonnées d’un public auquel peu s’adressent. Une multiplicité d’accès à l’information s’offre à lui afin qu’il saisisse et s’approprie le contenud’une exposition riche par le ou les biais qui lui conviennent. Tout comme le XVIIIe siècle s’est intéressé à l’enfant et son développement en lui consacrant une place nouvelle, cette initiative se place en digne successeuse de ces considérations en en faisant l’interlocuteur principal. De même, si le jeu s’est avéré être un élément constitutif du développement de l’enfant au siècle des Lumières, il est ici mis en exergue. Cohérence et pertinence se mêlent avec brio pour transmettre un message tout en exploitant le plus de sens possible.
#enfants
#jeunepublic
#jeu
Pour en savoir plus :http://www.museecognacqjay.paris.fr/fr/les-expositions/lenfance-des-lumieres
https://www.facebook.com/museecj/
http://www.parismusees.paris.fr/fr/expositions
La Halle aux Sucres, histoire d'un troisième lieu
La Halle aux sucres est une institution atypique qui regroupe en son sein le Learning center villes durables, l’Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, le Centre de la mémoire urbaine d’agglomérationainsi que l’Institut national spécialisé d’études territoriales. Toutes ces organisations sont liées à l’urbanisme dans un lieu résolument mis sous le signe de l’architecture, dès son entrée pensée par Pierre-Louis Faloci. A l’origine, le bâtiment était une grande halle qui servait à transformer la betterave en sucre. Aujourd’hui il est évidé et coupé en deux. Ne restent dans la nouvelle construction que les murs extérieurs. Ce nouveau lieu très moderne métamorphosé illustre le lien passé-présent-futur qui est central pour la Halle aux sucres.
L’entrée du site © Daniel Osso
Elle est également porteuse d’un regard ouvert sur l’international : en effet l’exposition du Learning center esquisse les différentes manières d’appréhender l’urbanisation dans le monde. Elle insiste sur ce qui se fait actuellement et les répercussions que cela pourrait avoir pour demain. Elle évoque différentes problématiques actuelles comme le transport, l’eau ou l’environnement et questionne les manières de faire et les problèmes actuels en essayant de montrer que des solutions existent.
Dunkerque est une ville parfaite pour porter ces enjeux, puisque la ville n’a eu de cesse de se renouveler au niveau urbain. On peut citer comme exemple magistral, l’opération dynamo de 1940, où la ville s’est elle-même inondée grâce à ses wateringues [1] pour résister aux assaillants nazis. Par ailleurs, un film de Christopher Nolan portera cette histoire sur grand écran cette année [2]. Cette opération a profondément changé la ville et son urbanisation en quelques heures seulement, faisant de Dunkerque une ville mouvante.
Le terme anglo-saxon de Learning center est utilisé pour désigner la double fonction du lieu : centre de ressources avec quantité d’ouvrages sur l’urbanisation, espace de vie chaleureux et lieu d’apprentissage porté par l’exposition.
L’exposition pensée par la muséographe Agnès Levillain, de la société Sens de Visite, se tient sur trois étages et repose sur les problématiques sociales, environnementales et économiques que soulève l’urbanisme. Pour que le visiteur s’interroge elle le rend actif, mobilise tous les sens avec la possibilité de sentir et d’entendre les différents bruits de la ville.
Dispositif sonore sur les bruits de la ville © MélineSannicolo
Elle évoque par exemple les différentes manières de se déplacer en ville, en montrant divers exemples de transports et de couloirs routiers. Ainsi on apprend qu’au Brésil des routes sont réservées aux bus, coupées du reste de la circulation. On peut voir les grandes autoroutes américaines remplies de voitures ou le développement des cyclistes dans le nord de l’Europe. Bien plus, elle laisse une grande place au numérique et aux médias participatifs. Il est d’ailleurs dommage que ceux-ci soient sous-exploités, un manque de témoignages empêche de les rendre lisibles. En effet, les contenus dépendent des visiteurs et utilisateurs de l’application [3] du musée, or peu d’entre eux fournissent des vidéos et photos pour rendre les médias participatifs, en témoignant sur leur ressenti de la ville.
Par exemple un dispositif interactif propose aux habitants de dessiner le chemin qu’ils font tous les jours dans la ville de Dunkerque sur l’application : aller à l’école ; s’arrêter pour prendre des croissants ; aller au boulot ; etc. Il montrerait les différentes manières de se déplacer dans la ville avec différents trajets proposés. Malheureusement ce dernier n’est pas actif, car peu d’habitants font leur « tracking » [4]. Cette absence de témoignages peut s’expliquer par le manque de visibilité de l’application dans la ville et par le côté anxiogène de la notion de « tracking ».
L’exposition se lit facilement avec des illustrations immenses et de la data vision. Enfin les exemples utilisés sont saisissants, entre dimension locale et internationale, insistant sur le fait que les enjeux d’urbanisme sont les enjeux de tous.
Un quatrième étage est destiné à l’exposition temporaire « Villes réelles, villes rêvées ». Son côté artisanal avec les cartels écrits à la main et la scénographie en carton, lui donne un certain charme et n’enlève rien à son propos scientifique sur les villes utopiques. Des jeux et des livres sont disséminés dans toute l’exposition incitant à y passer la journée.
Entrée de l’exposition temporaire © Annaëlle Lecry
La Halle aux sucres est donc un tiers lieu, c'est-à-dire un lieu hybride sur l’urbanisme, à la croisée du centre de documentation, du lieu de vie et de l’espace d’expositions qui s’implante parfaitement dans son territoire.
Océane De Souza
#Urbanisme
#Dunkerque
http://testweb.halleauxsucres.com/: le site du musée
https://www.urbanisme.fr/: pour en savoir plus sur l’urbanisme
[1] "Ensemble des travaux de dessèchement des pays situés au-dessous du niveau de la mer, dans le nord-ouest de la France, en Belgique et aux Pays-Bas." Dictionnaire Larousse
[2] http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240850.html
[3] http://itunes.apple.com/fr/app/la-halle-aux-sucres/id1063723812?l=en&mt=8
[4] Suivre le chemin d’une personne pour analyser son comportement, notion de marketing à la base.

La Neue Nationalgalerie, un lieu idéal d'exposition et de conservation des œuvres ?
Sortez donc du U-Bahn Potsdamer Platz – ce cher métro berlinois - et passez devant l'édifice qui abrite la Berliner Philarmoniker (l'orchestre philharmonique de Berlin), en suivant la Potsdamerstraße, vous voilà face à un bâtiment à l'architecture étonnante mais quasi-vide.
Vue extérieure de la Neue Nationalgalerie © Camille Françoise
Le bâtiment a été conçu par l'architecte américain d'origine allemande Ludwig Mies Van der Rohe pour abriter les collections d'art du 20ème siècle. Métal et verre, sont les principaux matériaux de ce qu'on nomme « le Temple de la lumière et du verre », le tout soutenu par des piliers d'acier donne à cette construction une allure lumineuse et épurée ; la dernière œuvre, réalisée du vivant, de MvDR est devenue un symbole de l'architecture moderne.
Mais cette architecture intrigante pour un musée laisse place à de nombreuses questions relatives à la conservation des œuvres. Comment est-il possible de concilier conservation des œuvres et expositions aux publics avec un édifice laissant une place aussi déterminante à la lumière ?
Vue intérieure de la Neue Nationalgalerie Crédits : Camille Françoise
L'entrée et la salle supérieure (espaces très lumineux) ne peuvent pas se permettre d'abriter tous les types d’œuvres. Le placement des œuvres se fait, donc, en fonction de la conception du bâtiment qui n'est pas adapté aux contraintes de conservation. La Neue Nationalgalerie fait donc le choix de mettre en place des expositions temporaires avec une scénographie adaptée à cet espace. Il s'agit ainsi de réaliser des cimaises protégeant l'intérieur de l'exposition et ses œuvres de l'extérieur très lumineux mais également des installations qui ne nécessitent pas une prévention aussi soignée.
Il est vrai que le bâtiment est un délice pour les yeux, mais c'est au dépend de la mise en valeur d'une partie des collections. Il est donc obligatoire de créer une scénographie en cimaises englobantes pour protéger les œuvres ou de mettre des œuvres inaltérables, et cette obligation à un prix. Cependant, le reste du musée est pensé en opposition à la lumière puisqu'il faut descendre dans le ventre du musée pour découvrir le reste des collections. C'est l'étage inférieur qui abrite les principales collections du 20ème siècle.
 Lux et Oriente 1959© Adolph Gottlieb
Lux et Oriente 1959© Adolph Gottlieb
Les salles sont présentées par thématique. La première nous ouvre les portes de la collection par une vision d'après-guerre avec le nom « les arlequins fous devant les ruines de la guerre » donnant à voir des œuvres de Wols, Hans Grundig ou encore Heinrich Ehmsen. Cette première salle est la seule qui propose une scénographie des œuvres, différente. En effet, le visiteur peut tourner autour des œuvres puisqu'elles sont encadrées par deux longues barres en métal verticales et disposées de manière faussement aléatoire. Les thèmes ne répondent pas à un standard mais plutôt à un sujet particulier ou sur un mouvement comme on peut le voir avec la salle « peinture informelle » avec des œuvres de Soulages, Tapies, Gottlieb, Yves Klein. On peut également y voir des œuvres des Nouveaux Réalistes, de Warhols, Bacon, et autres artistes de référence.
Cet édifice qui interroge sur les enjeux de l'architecture muséale, est un endroit complexe, jouant sur l'horizon vide jeté aux yeux du visiteur au premier abord, contrastant avec l'image du Musée « collectionneur de la profusion » et questionnant toujours sur la prise en compte des contraintes de conservation et des véritables volontés de l'architecte.

La part d’ombre d’une icône - L’exposition Warhol : Life, Death and Beauty
Pour marquer la réouverture de ses bâtiments au public, le BAM de Mons a frappé un grand coup en exposant l’un des plus célèbres artistes du XXème siècle : Andy Warhol. Ouverte jusqu’au 19 janvier 2014, cette exposition inédite, produite par le Musée Andy Warhol de Pittsburgh, présente plus de cent-quarante œuvres de l’artiste américain dans les espaces entièrement rénovés du musée.
J’entends déjà marmonner derrière vos écrans : « Encore une exposition blockbuster sur Warhol…». Oui, si vous vous rendez au BAM de Mons, vous allez pouvoir admirer, ou réadmirer, les célébrissimes sérigraphies de Marylin Monroe, de Jacky Kennedy ou encore les mythiques boîtes de soupe Campbell's. Life, Death and Beauty est une immanquable occasion de découvrir ou de redécouvrir les œuvres majeures du grand maître du Pop art mais pas seulement. La grande majorité des œuvres exposées au BAM sont inédites et méconnues du public provenant de musées internationaux ou de fonds de collectionneurs belges. Andy Wahrol est de ces artistes que nous pensons tous connaître et pourtant…
Andy Warhol est perçu pour beaucoup comme un artiste du showbiz, intéressé par l’argent, la notoriété, la gloire mais, sous la couche de couleurs acidulées, de paillettes et de célébrités, se cache le travail d’un artiste complexe, fragile, d’un homme obsédé et terrifié par la mort, par le temps qui s’échappe. Gianni Mercurio, spécialiste de l’art américain et commissaire de l’exposition,ne propose pas une rétrospective sur l’artiste mais une exposition aux thématiques originales qui apportent un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension de ses travaux.
Le Pape du Popart et ses icônes
The Last Supper, Andy Warhol, 1986
©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
La singularité de cette exposition réside dans les thématiques choisies et dans le corpus d’œuvres sélectionné. Vous serez sans doute étonné de découvrir la place énorme qu’occupaient la religion et la spiritualité dans le travail de l’artiste. L’une des salles de l’exposition, au rez-de-chaussée, est consacrée à cet aspect. Andy Warhol était en effet un homme très croyant. Les références religieuses fusent dans nombreuses de ses productions, parfois de manière évidente, parfois de manière plus subtile. J’ignorais qu’Andy Warhol avait travaillé sur le thème de la Vierge à l’Enfant, sur l’image du Christ ou encore sur le symbole de la croix. L’image du Christ entouré des apôtres a obsédé l’artiste tout au long de sa vie. Vous pourrez notamment découvrir quelques exemplaires d’une longue sérieréalisée quelques années avant sa mort intitulée The Last Supper. L’artiste revisite à la sauce Pop La Cène de Léonard de Vinci à partir d’une reproduction papier de l'oeuvre. Andy Warhol varie les couleurs, camoufle les personnages, déchire, triture cette scène biblique en plus d’une centaine de versions.
Les mythiques sérigraphies de Marylin Manroe © Avpress
Mais c’est aussi lorsqu’Andy Warhol tire le portrait sérigraphié de célébrités que la spiritualité se révèle. Qu’elles soient religieuses ou commerciales, l’artiste s’intéresse aux icônes. Marylin, icône de son temps, apparaît figée pour l’éternité dans une expression sans relief ni profondeur. Elle devient un motif, une image, presque un symbole. Placée sur un fond abstrait et coloré, l’image de Marylin rappelle celle des icônes religieuses peintes sur les panneaux de bois des églises orthodoxes.
L’obsession de la mort / Memento Mori
Self-portrait with Skull, Andy Warhol, 1978 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
Life, Death and Beautyest un titre particulièrement bien choisi qui exprime parfaitement la triade thématique qui sous-tend le travail d’Andy Warhol. La mort a côtoyé la vie de l’artiste, dès son enfance, avec la disparition de son père, la perte de nombreux de ses amis et sa tentative d’assassinat. Deux autoportraits exposés au BAM montrent Andy Warhol mis en scène d’une manière extrêmement inquiétante. Il y simule une scène d’étranglement et, sur le second, l’artiste se figure accompagné d’un crâne d’une manière très shakespearienne.
La mort est pour Andy Warhol à la fois un sujet et un motif. Elle apparaît avec violence dans Electric Chairmontrant une chaise électrique, instrument de supplice moderne, ou encore dans la série Disaster. Elle devient motif esthétique avec la série Skulls,œuvres qui s’apparentent à des vanités modernes. Et, si l’on songe un instant aux sérigraphies de célébrités comme Jackie Kennedy ou Marylin Monroe, Andy Warhol dresse le portrait de personnalités complexes et torturées sonnant comme des « Memento mori ». Ces deux femmes ont toutes deux connu un destin aussi glorieux que tragique. Les couleurs criardes de leurs portraits, leurs images souriantes, cachent en réalité un grand désarroi. L’exposition m’a fait réaliser qu’Andy Warhol n’est pas seulement « l’artiste du consumérisme ». L’ensemble de son travail a une gravité que j'ignorais.
Skulls, Andy Warhol© Sami Belloumi –Voix du Nord
L’exposition donne un bel avant-goût de l'événement Mons 2015-Capitale Européenne de la Culture et des futures expositions du BAM. Le musée a résolument choisi de proposer des expositions de grande ampleur à portée internationale. La prochaine grande exposition sera consacrée à un artiste mythique du XIXème siècle : Vincent van Gogh.
En attendant janvier 2015 >> Mons - Capitale Européenne de la Culture 2015
Astrid Molitor
Pour en savoir plus :
Andy Warhol. Life, Death and Beauty - Exposition inaugurale de réouverture du BAM
#exposition
#Warhol
#BAM
La place du radiateur et la place de l'oeuvre
Le musée de la photographie de Charleroi est un beau musée.
Si on pouvait installer le chauffage au plafond par toile tendue, le musée de la photographie de Charleroi serait un très beau musée.
Oui, voilà, tout est beau, tout est propre, tout est lisse mais les radiateurs, eux, font tâche. Parfois peint, caché derrière une grille ou perché au dessus de nos têtes, le radiateur est et doit absolument être dissimulé. On pourrait en déduire une formule infaillible : belle collection + radiateur caché = beau musée.

Radiateur peint au Musée de la photographie, Charleroi.
C’est le cas, à Charleroi. Installé dans un ancien cloître, le musée s’est agrandi en 2008. Une belle réalisation architecturale est venue se greffer à l’ancien pour accueillir les nouvelles œuvres photographiques, dont les tirages sont de plus en plus grands.
Cette extension est pour le musée l’occasion de repenser l’organisation, le flux des visiteurs, leurs déplacements dans chaque espace d’exposition, l’accueil, la cafeteria, l’auditorium, la bibliothèque et même le parc. Tout est pensé pour faciliter une circulation fluide, sans obstacle, où l’on ne pense qu’aux œuvres. Mais voilà, les radiateurs c’est plus compliqué, toujours là où on ne les attend pas ceux-là. La place du visiteur, OK. La place de l’œuvre, OK. La place de la technique, derrière.
Pourtant, ce qui fait la richesse d’une mise en exposition, temporaire ou permanente, c’est davantage l’interaction entre ces trois acteurs que la place de chacun. Ainsi, dans chaque partie du musée, l’œuvre fait face au visiteur. Celui-ci la regarde, celle-ci le regarde. Droit dans les yeux, face à face, comme figés dans le même cadrage, le visiteur et l’œuvre sont en tête à tête.
Le musée en tant que contenant est pourtant bien loin d’être une simple boîte à chaussure, ou même un « white cube » idolâtré par les musées d’art contemporain. L’ancien cloître a été rénové avec soin, son charme est intact. Les parquets qui craquent sous nos pas nous rappellent au temps passé, comme une vieille maison qui grince et dans laquelle on retrouve de vieilles photos jaunies. La partie récente du bâtiment offre tout autant aux usagers. Les jeux de volumes et de lumière, créent des espaces riches et travaillés.
Mais voilà, reste l’obsession du « lisse » et du « beau ». A force, le musée semble figé comme placé sous son plus beau profil en attendant qu’on lui tire son portrait. Paradoxalement celui qui bouge là-dedans c’est lui, le fameux, le gênant ; le radiateur. Contrairement à l’œuvre fixée inexorablement au milieu du mur blanc, le radiateur explore l’espace muséal.
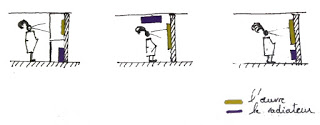 Le radiateur explore l'espace tandis que l’œuvre reste fixe.
Le radiateur explore l'espace tandis que l’œuvre reste fixe.
Et si c’était l’inverse ? Si on réinventait chaque fois, la relation entre l’œuvre et le visiteur. Si l’œuvre bouge et que le radiateur reste fixe ? lequel des deux sera le plus mis en valeur ?
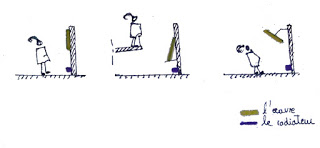 L’œuvre explore l'espace muséal tandis que le radiateur reste fixe.
L’œuvre explore l'espace muséal tandis que le radiateur reste fixe.
Cette question bien qu’anecdotique révèle une obsession de la perfection, du beau. A l’origine, le musée et les beaux-arts étaient des notions fondamentalement liées. Malgré l’élargissement de la notion d’art et le renouvellement des musées, une « tenue correcte exigée » semble persister dans les espaces d’exposition. Belle réalisation, le musée de la photographie, pourrait presque être un lieu de vie et d’animation. Le parc du musée, où l’on peut se promener, mais où l’on ne peut pas amener de musique, ni d’animaux, montre que ce beau musée n’est pas prêt à se transformer en lieu d’action culturelle plus que d’exposition.
L’extérieur est présent à chaque recoin du musée mais rien ne semble bouger à l’extérieur, fixe comme les paysages captés sur pellicule. Les possibilités sont là, le carcan aussi. Alors, les radiateurs rebelles du musée de la photographie de Charleroi sont des précurseurs d’une libération créatrice, saccageant la pureté et libérant les espaces d’exposition !
Oiseau en sticker collé sur une vitre dans la cage d’escalier, musée de la photographie, Charleroi.
En 1929, au Bauhaus de Dassau, un radiateur était exposé, comme chef d’œuvre du génie moderne et industriel, dans la cage d’escalier principal de la prestigieuse école d’art. Les révolutions prennent parfois du temps !
Margot Delobelle
#scénographie
#photographie#musée

La Tour Abbatiale : un musée de territoire témoin d'une historie locale
Situé à une quinzaine de kilomètres de Valenciennes, le musée municipal de Saint-Amand-les-Eaux est abrité dans la tour de l’ancienne église abbatiale. Cet édifice du XVIIème siècle, classé Monument Historique depuis 1846, a subi d’importantes rénovations de 2004 à 2012. Le musée bénéficie d’un cadre remarquable, et tient à conserver cette vocation intellectuelle et créative qui a fait la renommée de cet ancien édifice religieux influent.
Musée de la Tour Abbatiale © Idhem Mehdi
Des expositions temporaires qui traitent de l’histoire de la commune :
La visite débute dans la salle Lannoy, attenante à la boutique, et abritée sous une voûte sculptée en pierre. C’est ici que sont présentées les expositions temporaires tout au long de l’année, en rapport avec les collections permanentes, ou dans la continuité de la programmation culturelle municipale. Ces expositions abordent des thèmes particulièrement variés : art moderne et contemporain, faïences, histoire de l’édifice entre autres.
Celle qui s’y déroule actuellement depuis le 8 octobre 2016, et qui s’achèvera le 31 décembre 2016 s’intitule : « Par les Villes et les Champs, Regards d’artistes sur la vie quotidienne dans le Nord (1890-1950). » Le second volet de cette exposition est présenté au Musée d’Archéologie et d’Histoire Locale de Denain depuis le 19 octobre 2016, et jusqu’au 8 janvier 2017. Cette exposition temporaire traite des évolutions économiques et sociales ayant marqué la région au cours des XIXème, et XXème siècle.
« Par les Villes et les Champs » © Ville de Saint-Amand-les-Eaux
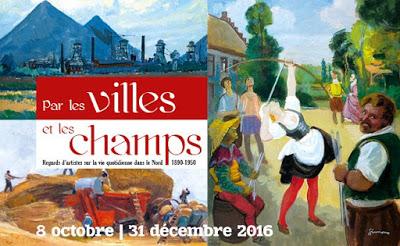 En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
L’exposition tient à refléter cette sensation de « bon vieux temps » auprès du visiteur contemporain, à travers une reconstitution qui placent ces œuvres dans leur contexte historique. La scénographie est sobre, et tient à mettre naturellement en valeur le style architectural de l’édifice. La couleur rouge des cimaises valorise les œuvres exposées, et renforce le message chaleureux véhiculé au travers des tableaux. Les choix en matière de lumière privilégient un éclairage doux, ce qui rehausse l’architecture du bâtiment.
Salle d’exposition temporaire © Lucie Taverne
 Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Une collection permanente qui révèle un savoir-faire traditionnel :
La suite de la visite se poursuit à l’étage de la tour, où sont présentées les collections permanentes du musée municipal. Elles se sont constituées au début des années 1950 autour de la céramique amandinoise, avec plus de trois cent pièces de faïences du XVIIIème siècle. Une première salle expose des faïences anciennes et contemporaines, de même que leur technique de fabrication. Ces pièces témoignent de la renommée de la tradition céramique à Saint-Amand-les-Eaux, marquée par l’implantation de manufactures de porcelaine au sein de la ville à partir de 1705.
En effet, la commune disposait d’un environnement adéquat à l’installation d’une usine de faïence : un réseau routier qui facilitait le transport de la porcelaine, et la présence d’une forêt à proximité, permettait de disposer facilement de bois pour les fours. Une seconde salle, située sous une voûte à arcs brisés, présente des œuvres consacrées à l’histoire de l’abbaye. Sont aussi exposées des peintures et sculptures religieuses du XVIème au XVIIIème siècle des anciens Pays-Bas du Sud ; ainsi que des objets en lien avec l’art campanaire (claviers, cloches).
Salle d’exposition permanente © Tripadvisor
 Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Un édifice municipal classé qui s’efforce de rester accessible :
La question de l’accessibilité se pose dès l’arrivée au musée puisque l’entrée s’effectue par une porte située sur la façade est de la tour ; porte qui est trop étroite pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de pouvoir y accéder. Tout comme l’accès au premier étage, qui s’effectue par un escalier à vis situé près de l’entrée. Sachant que l’édifice n’est pas équipé d’un ascenseur, le musée demeure donc difficilement accessible pour certains types de publics. La mise en accès de l’édifice pour les personnes à mobilité réduite semble difficilement envisageable du fait que le monument soit classé, et compte-tenu aussi du manque de moyens en termes financiers et humains dont dispose le musée.
En matière de signalétique, seul un panneau dans la salle d’accueil indique la direction à suivre pour accéder à l’exposition temporaire et les collections permanentes. Panneau qui n’est pas forcément visible de prime abord. D’autant que certaines œuvres de la collection permanente qui sont présentées en vitrines ne possèdent pas de cartels. Malgré tout, certains éléments portent à croire que le Musée de la Tour Abbatiale s’applique à élargir son accès au plus grand nombre. Tout d’abord, le fait que le musée soit ouvert toute l’année, et tous les jours de la semaine (excepté le mardi).
La visite est gratuite, il suffit simplement d’indiquer son code postal à son arrivée. Bien qu’il n’existe pas d’outils d’aide de compréhension à la visite, l’accueil du musée qui fait également office de boutique, propose en libre-service divers documents : catalogues d’exposition, documents informatifs sur l’édifice, programmes d’activités, etc. Des cartels et panneaux explicatifs clair et illustrés aident à la compréhension du visiteur, aussi bien dans la salle d’exposition temporaire que permanente. Les informations mentionnées sont aisément compréhensibles, et s’adressent de ce fait à un large public.
Des activités de médiation de qualité adaptées à tous sont organisées tout le long de l’année. D’autres sont proposées de manière ponctuelle dans le cadre des expositions temporaires. La plupart sont gratuites, et s’adressent à un public familial, ou demeurent à un prix relativement accessible. La Tour Abbatiale assume ainsi pleinement son identité de musée municipal ancré dans son territoire. Un musée municipal prometteur, qui s’évertue à se réinventer, et à demeurer ouvert au public le plus large.
Joanna Labussière
#Architecture
#Céramique
#Monument Historique
Pour plus d’informations : http://www.saint-amand-les-eaux.fr/fr/culture/musee-expositions/musee.htm
Le Cabinet des Merveilles : plongée dans les collections strasbourgeoises
L’exposition temporaire pour mettre en valeur ses collections et la diversité d’un réseau de musée municipal.
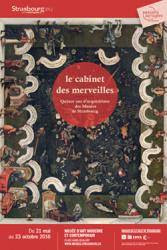
Affiche de l'exposition © MAMCS
Le Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMCS) de la Ville de Strasbourg proposait du 21 mai au 23 octobre 2016 l’exposition Le Cabinet des Merveilles, Quinze ans d’acquisitions des Musées de Strasbourg.
La direction commune des musées de la Ville de Strasbourg est constituée de onze établissements très divers : le Musée Archéologique, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts décoratifs, le Musée de l’Œuvre Notre-Dame, le Musée Historique, le Musée Alsacien, le Cabinet des estampes et des dessins, le Musée d’Art Moderne et Contemporain, le Musée Tomi Ungerer, l’Aubette 1928 et le Musée Zoologique.
Réalisée par des conservateurs de plusieurs musées municipaux dans le cadre de la saison « Passions Partagées. Au cœur des collections » regroupant un ensemble d’expositions dédiées à la valorisation des collections des musées de Strasbourg, elle s’inscrit dans un mouvement plus large dont je n’ai malheureusement pu voir que cette exposition.
L’exposition est conçue comme un parcours thématique, et non chronologique, qui inviterait à une « déambulation jubilatoire », pour « découvrir », de manière « sensible »… selon les mots du « Petit Journal » de l’exposition. Elle présente ensemble et sans distinction les acquisitions des onze musées de la Ville de Strasbourg (le musée d’appartenance est simplement précisé dans les cartels). Ce choix montre une action unifiée, cohérente et permettant de mettre en valeur la diversité des structures muséales de la ville.
Si les pièces étaient séparées par musée non seulement nous nous dirigerions probablement encore plus vers nos thèmes ou disciplines de prédilection, en négligeant peut-être d’autres œuvres et n’aurions-nous pas une impression « de chacun pour soi ». Ne serions-nous pas naturellement encouragés à la comparaison entre les différents établissements ? Le fait de ne pas signaler particulièrement la provenance des pièces montre une unité dans la diversité, décloisonne les disciplines et donne plus de sens à une exposition commune qui démontre une complémentarité.
En matière de dialogue, sans donner un exemple précis, nous voulons insister sur le décloisonnement de « disciplines » et le travail collaboratif au sein d’une ville. Subtilité relative que l’on retrouve dans la scénographie entre cabinet de curiosité et « white cube ». L’utilisation du bois se révèle très judicieuse dans la mise en valeur des œuvres présentées et l’espace reste clair et aéré la majeure partie de l’exposition. Ainsi cette exposition réussit-elle plusieurs « missions » : mettre en valeur les acquisitions, les collections des musées de Strasbourg, présenter une image unifiée et complémentaire des établissements… et encourager la curiosité ?
Salambô Goudal
#collections
#miseenvaleur
#réseau
Pour en savoir plus :Exposition présentée du 21 mai au 23 octobre 2016 au MAMCS à Strasbourg. http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-dart-moderne-et-contemporain-mamcs
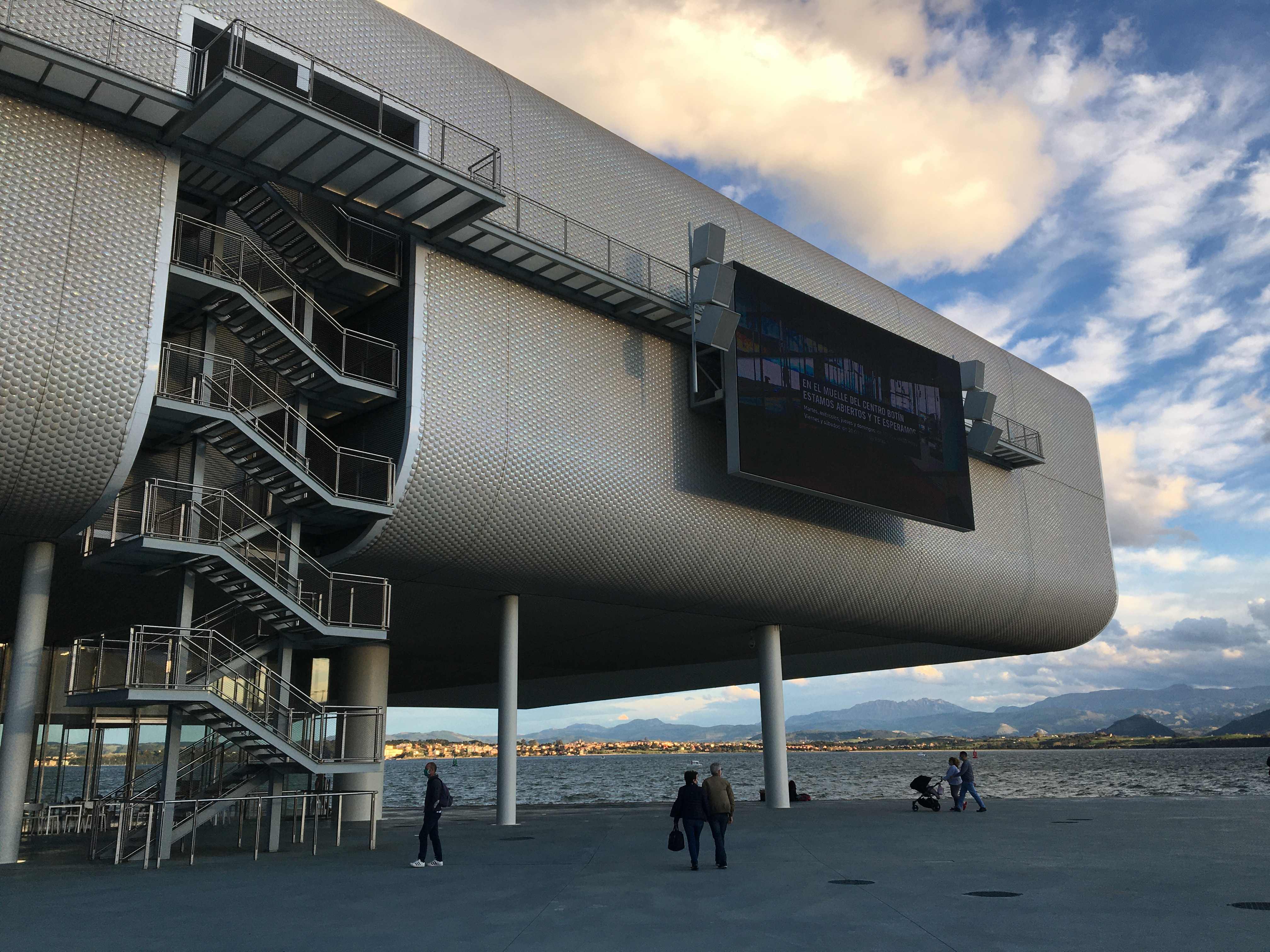
Le Centre Botin, défi réussi d’une architecture muséale
Analyse de la relation entre une architecture muséale et son environnement proche : le Centre Botin à Santander réalisé par Renzo Piano, est pensé comme levier de développement de son territoire.
Le Centre Botin est un centre d’art de référence à Santander, en Espagne, inspiré par l’impact du Guggenheim de Frank Gehry sur le développement de Bilbao qui se situe à une centaine de kilomètres de Santander. Le Centre Botin est inauguré en 2017 par l’architecte Renzo Piano, architecte du Centre Pompidou à Paris et de Luis Vidal. Il est conçu comme un nouveau point de repère sur le front de mer, un lieu vivant, de rencontres, partages, loisirs, découvertes et réflexions.

© Suzon Auber
L’architecture du musée
Le projet est composé de deux volumes reliés entre eux par des places et des passerelles. Chaque volume est ouvert d’un côté vers la mer, de l’autre vers la ville et les jardins de la Pereda. C’est un bâtiment léger presque flottant en porte-à-faux au-dessus de la mer. L’utilisation de piliers et de colonnes à hauteur de la cime des arbres environnants libère l’espace public au rez-de-chaussée et laisse passer la lumière. Renzo Piano utilise très souvent du métal, de grandes baies vitrées et des structures apparentes : escaliers, terrasses, passerelles. Comme un phare sur la côte, le musée est un point de repère s’intégrant parfaitement à son environnement.
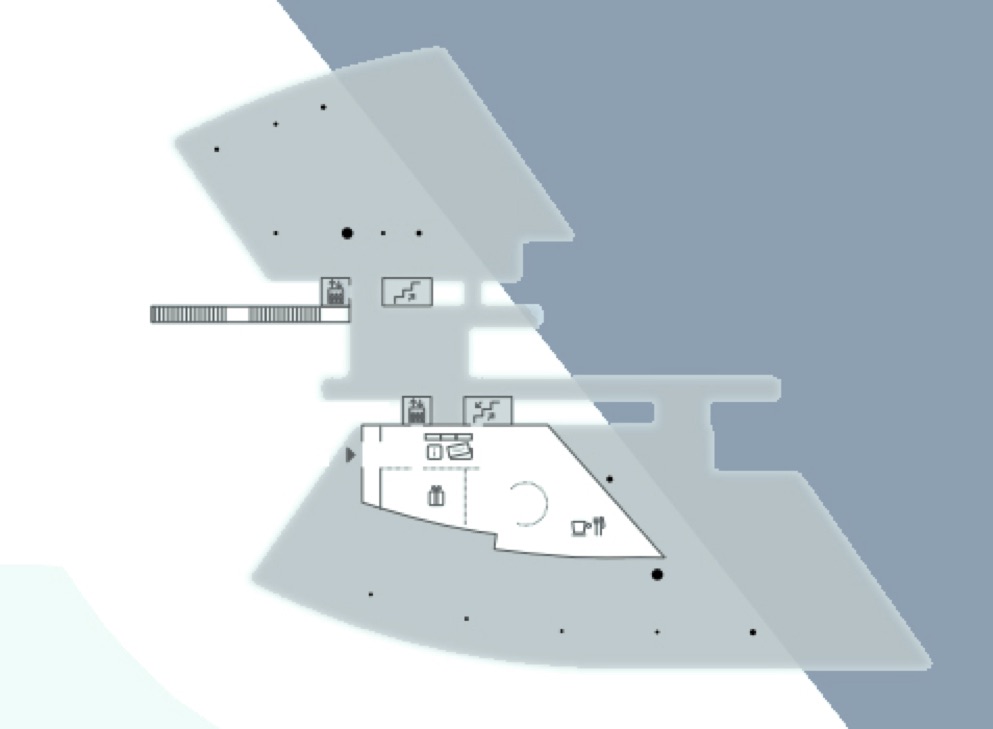
© Suzon Auber
Intégration du musée dans son contexte
L’intégration d’un musée dans la ville par l’aménagement urbain est primordiale et à ne pas négliger. Ici, l’espace public est valorisé avec un chemin piétonnier sur le front de mer. Les espaces entièrement vitrés au rez-de-chaussée prolongent l’espace public jusqu’à l’intérieur du musée. Ce jeu de transparences crée de nombreuses percées visuelles libérant la frontière entre le musée et l’espace public. A l’est, au rez-de-chaussée se situent l’accueil, la boutique et un lieu de restauration. A l’ouest, un amphithéâtre extérieur permet de faire sur la place publique un cinéma et des concerts en plein air.
Le bâtiment surélevé permet de créer un espace couvert de 950m2, un lieu de rencontres entre les habitants. Ensuite, de nombreuses passerelles et places sont accessibles à tous les niveaux, elles surplombent la mer et nous offrent un autre regard sur le musée et son environnement. Le musée devient un outil de développement de son territoire, bien plus qu’une simple enveloppe qui présente des collections. Le musée dynamise la vie de la ville et enrichit le tissu social et culturel.
Par son architecture, le musée devient œuvre à son tour, sans pour autant interférer négativement avec les œuvres en son sein. Au contraire, le musée permet aux œuvres de raconter une autre histoire et de dialoguer avec le lieu.
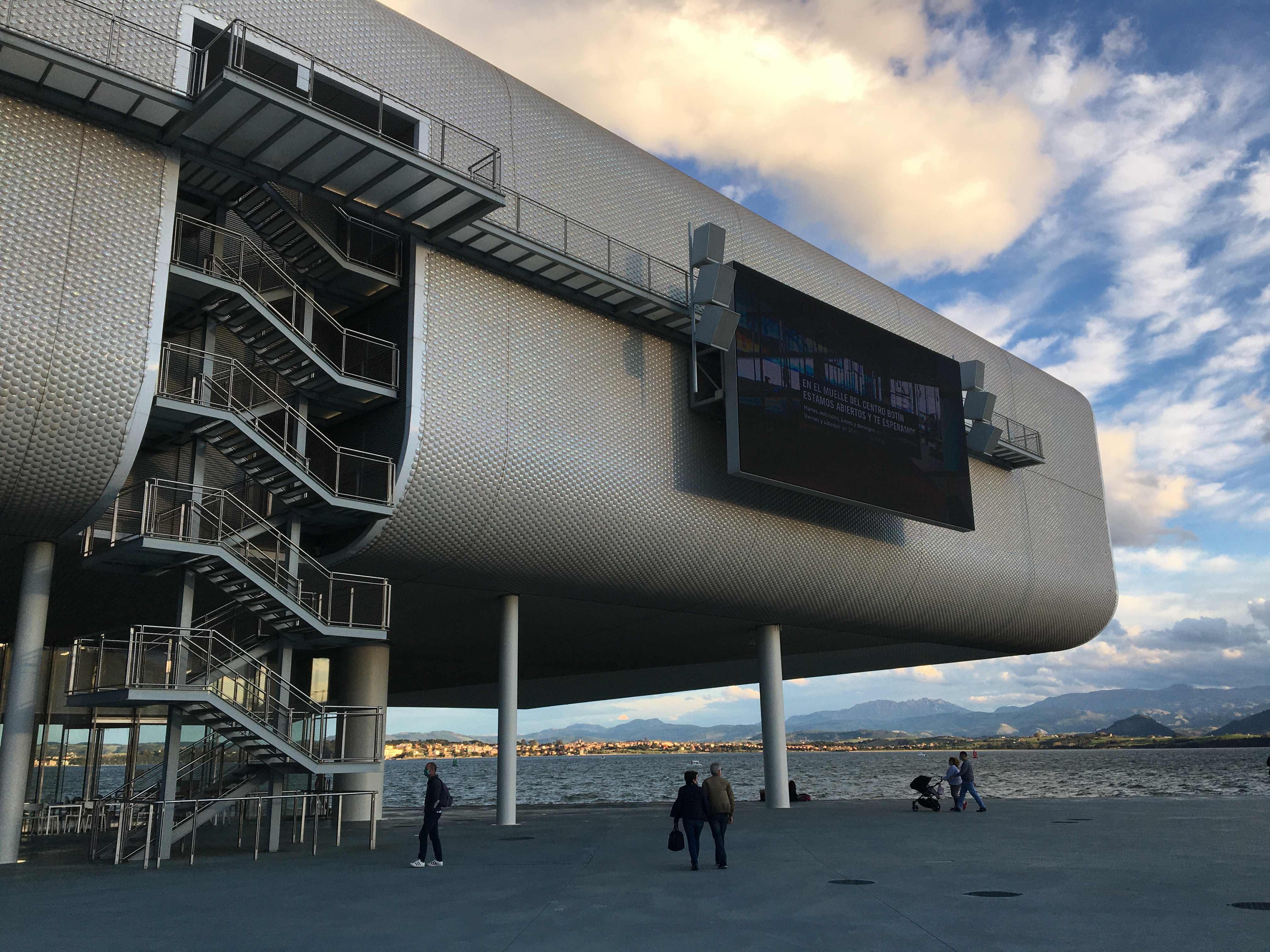

© Suzon Auber
Quelle relation entre les œuvres et le bâtiment ?
A l’est, le bâtiment comporte un auditorium, des espaces pour des activités éducatives et sur le toit une terrasse donnant sur la baie de Santander. A l’ouest le bâtiment est consacré aux expositions sur deux niveaux pour une surface d’environ 2500m2.
Le souvenir d’une exposition peut être marqué par son cadre, ses vues, ses perspectives, et bien sûr par la cohérence de l’exposition dans le lieu choisi. Ce sont des enjeux de l’architecture muséale : comment créer un équilibre entre l’architecture et les œuvres exposées et comment favoriser la rencontre de l’œuvre avec l’Homme ?
La Fondation Botin possède une collection d’art depuis 1993, centrée sur l’art contemporain, elle comprend des œuvres de diverses disciplines : peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo et installation… L’exposition permanente est renouvelée chaque année tandis que les expositions temporaires durent de six à sept mois.
Les espaces d’exposition du Centre Botin entretiennent une relation directe avec les œuvres. Par exemple, le Centre Botin a accueilli des œuvres de Alexander Calder scénographiées par Renzo Piano. Les œuvres entretiennent un dialogue direct avec le musée, le bâtiment comme les œuvres de Calder étaient comme un mobile flottant au-dessus du sol.

© Suzon Auber
Les thématiques abordées par le musée sont directement en lien avec le Centre Botin et son architecture authentique considérée comme œuvre d’art. « Arte y architecture: un diálogo » examine le rapport de l’artiste à l’architecture. L’exposition explore les influences réciproques que l’art et l’architecture peuvent avoir les uns sur les autres, que ce soit d’un point de vue conceptuel ou formel. L’histoire de l’art et celle de l’architecture sont intrinsèquement liées. Au fil du temps, artistes et architectes ont collaboré. Le musée, un espace public dont la première fonction est de collecter et conserver l’art, modifié la dynamique de cette relation. En effet, si le bâtiment devient le dépositaire de l’œuvre d’art, la question de son importance en tant que contexte devient plus saillant.
Une autre question peut émerger : comment l’architecture peut-elle affecter l’œuvre de l’artiste ? L’artiste Sol Lewitt a considéré dans ce musée, l’espace d’exposition comme partie intégrante de son travail. Ainsi, sa peinture Wall drawing 499 directement sur le mur de l’exposition, enlève toute sorte de frontière en l’œuvre et l’architecture, sans toiles, ni cadre.
L’effet Bilbao a-t-il fonctionné pour le Centre Botin ?
En 2019, le bâtiment, ses places et ses espaces extérieurs ont attiré plus d'un million de visites, dont 186 606 visiteurs au musée, en provenance de 95 pays, 145 256 visiteurs se rendaient aux expositions et 41 350 personnes ont participé aux activités culturelles et éducatives. Les expositions ont attiré 68 000 habitants de la région de Cantabria : ces chiffres montrent que le Centro Botín est un lieu vivant et pleinement intégré dans la ville. Le musée remplit sa mission de développement de son territoire, générant de la richesse économique et sociale à Santander, cela confirme la réussite de l’effet Bilbao pour le Centre Botin.
Suzon Auber
#Centrobotin #Architecture #Museum #Santander

Le choix de la raison pour le projet de rénovation du Musée lorrain
Situé à Nancy, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain regroupe trois sites classés monuments historiques : le Palais Ducal et son jardin, l’église et le couvent des Cordeliers, ainsi que le Palais du Gouvernement.
Le Palais Ducal est construit à partir de la fin du XIVème siècle, à la suite de la victoire du duc René II de Lorraine à la bataille de Nancy1. À partir de 1739, les bâtiments deviennent propriété de la Ville, et une partie est détruite afin d’édifier le palais de la Nouvelle Intendance, l’actuel Palais du Gouvernement inaugurée en 1755.
Au nord du Palais Ducal, l’église et le couvent des Cordeliers, bâtis à la fin du XVe siècle, se distinguent par une particularité rare : l’église, toujours affectée au culte, reste consacrée au sein même d’un ensemble muséal.
Fermé au public depuis 2018, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain connaît un tournant décisif. Face aux critiques récurrentes d’associations patrimoniales, le projet d’extension a été abandonné en juin 2025 au profit d’une restructuration plus sobre et recentrée sur le bâti existant.
La rénovation du Musée lorrain soulève des questions fondamentales sur notre rapport au patrimoine. Entre respect de l’histoire et exigences contemporaines, comment intervenir sans figer ni trahir ?
Du palais au musée : l’épopée du Musée Lorrain
Dès 1829, la Société d’Archéologie lorraine s’efforce de créer un musée au sein du Palais Ducal pour rassembler les antiquités de la région et les œuvres de ses figures illustres. Malgré plusieurs échecs, le projet aboutit en 1851 avec l’ouverture du Musée historique lorrain dans une partie du vestibule du palais, inscrit dès 1840 sur la première liste des monuments historiques.
Adolphe Maugendre, Les débuts du Musée historique lorrain, dessin au graphite coloré à l'aquarelle, 1860, conservé au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, Nancy. © Palais des ducs de Lorraine, Musée Lorrain, Nancy
Grâce à de nombreux dons (peintures, tentures, sculptures, objets d’art), le musée s’enrichit et est inauguré en 1862 dans la galerie des Cerfs. En 1869, un catalogue recense déjà 1 415 œuvres.
Mais dans la nuit du 16 juillet 1871, un incendie éclate dans le bâtiment de la gendarmerie, une partie voisine de l'église des Cordeliers. Le feu ravage une aile restaurée, la galerie des Cerfs, le plafond et la toiture du palais. Si quelques œuvres sont sauvées, la majorité, dont des portraits ducaux et toute la bibliothèque de la Société d’archéologie lorraine disparaît. Seul le rez-de-chaussée abritant les collections d’archéologie et de sculpture est épargné ; au moins la moitié des œuvres sont détruites.
Quelques mois après le sinistre, la Ville de Nancy décide de construire une caserne de gendarmerie à la place du jardin des Cordeliers. En échange, elle obtient l’usage complet des ruines du palais ducal, dont la restauration est prise en charge par l’État. Mais la municipalité choisit ensuite d’y bâtir une école supérieure de garçons, obligeant la Société d’Archéologie lorraine à renoncer au fait d’installer le musée dans l’ensemble du palais. Après d’importants travaux, le musée rouvre en 1875.
En 1895, les collections du musée atteignent près de 3 000 objets, soit presque le double qu’en 1869. En 1908, il est réorganisé en quatre sections (archéologie ; objets d’art et mobilier ; estampes, livres et sceaux ; numismatique), chacune confiée à un conservateur bénévole de la Société. Deux ans plus tard, une section dédiée à l’art populaire est créée, accompagnée de nouveaux espaces d’exposition, tandis que l’École supérieure de garçons est transférée dans les bâtiments du jardin.
Un nouveau plan de restructuration lancé en 1934 aboutit à l’inauguration du nouveau Musée lorrain le 6 décembre 1937, avec une muséographie repensée comprenant 31 salles contre 7 auparavant. Le musée s’enrichit ensuite d’une salle sur le judaïsme, puis d’un laboratoire d’archéologie des métaux, à l’origine en 1966 du musée de l’histoire du fer à Jarville-la-Malgrange (l’actuel Féru des Sciences).
Toujours en expansion, le musée manque de place et réorganise sans cesse ses espaces. Il est préconisé en 1995 de faire de l’établissement « un musée de synthèse au niveau régional dans les domaines qui sont les siens : archéologie, art, histoire, ethnographie », et de le rendre davantage accessible aux publics.
Musée Lorrain de Nancy © Agence DUBOIS & Associés / Agence MIL-LIEUX / Patrice CALVEL / Atelier du Paysage
Un projet de rénovation et d'extension contesté
Le projet de rénovation et d’extension du musée est lancé dans les années 2000, après l’approbation de son projet scientifique et culturel. Il réunit la Ville de Nancy (maître d’ouvrage), la Société d’histoire de la Lorraine et du Musée lorrain, l’État et la Région.
Des fouilles révèlent des objets liés à la vie de cour entre les XVème et XVIIIème siècles, tandis qu’un chantier des collections recense près de 155 000 pièces. En 2013, le musée adopte son nom actuel : le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain.
En avril 2018, cinq ans après le concours international d’architecture remporté par l’agence Dubois & Associés, le musée ferme ses portes au public.
La Commission nationale des monuments historiques émet un avis favorable sur le projet architectural en septembre 2014. Cependant, des fouilles menées par l’INRAP révèlent l’importance du « mur de Baligand », construit vers 1745. Face à cette découverte, le Ministère de la Culture demande une révision du projet pour préserver ce vestige, initialement destiné à être détruit. La Ville de Nancy adapte donc le projet, qui est approuvé par la Commission en octobre 2016.
Après trois tentatives infructueuses d'appel d'offres entre 2018 et 2019, le projet remanié trouve enfin preneur après cinq années d’attente.
Le projet prévoyait la construction d’un pavillon en verre sérigraphié de 35 mètres de long à la place des bâtiments dits de « fond de cour », jugés sans intérêt patrimonial par la Ville.
Ces bâtiments comprenaient : le mur de Baligand et l’écurie du XVIIIème siècle qui auraient été déconstruits puis remontés, avec des ajouts contemporains, ainsi que l’ancienne gendarmerie du XIXème siècle ayant aussi servi d’établissement scolaire. Face à la mobilisation des opposants, cette partie du projet a été annulée en 2021.
Toutefois, malgré un projet allégé, les critiques persistent. En réaction au lancement des opérations préliminaires, les associations Sites & Monuments (association nationale) et Défense et avenir du patrimoine nancéien ont déposé un référé-suspension, invoquant l’interdiction de démolir un bâtiment classé sans déclassement préalable par le Conseil d’État.
Le tribunal administratif a donné raison aux opposants le 12 février 2025, ordonnant la suspension des travaux sur cette partie du chantier.
Selon les opposants, le projet viole le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui sert à protéger, restaurer et encadrer l'évolution des secteurs historiques dans le but de préserver le patrimoine. Les opposants ne remettent pas en cause le principe d’une extension, mais critiquent son architecture, jugée incompatible avec l’environnement historique, notamment le bâtiment en verre sérigraphié, perçu comme trop intrusif.
Juin 2025 : un nouveau tournant majeur
Lors d'une conférence de presse, le maire de Nancy a annoncé l’abandon du projet d’extension. Face à une explosion des coûts passés de 43 à 54,5 millions d’euros en huit ans, la municipalité opte pour une révision complète du projet. Désormais recentré sur la seule restructuration du palais ducal, le nouveau plan prévoit de réaménager les espaces existants sans creuser de nouveaux volumes en sous-sol.
Si cela implique une possible réduction des surfaces dédiées aux expositions temporaires, les espaces d’exposition permanente seront conservés.
Le nouveau calendrier fixe la désignation du maître d’œuvre à 2028, avec un début des travaux en 2029 et une réouverture envisagée à l’horizon 2033.
Ce temps de redéfinition est aussi, selon le directeur Richard Dagorne, l’occasion de repenser en profondeur les contenus du musée à l’aune des enjeux contemporains (genre, pouvoir, mémoire) et d’opérer un retour aux fondations, à la fois architecturales et intellectuelles, du projet muséal.
Ainsi, une question essentielle se pose : comment intervenir sur un bâtiment historique sans trahir son essence, tout en lui permettant de répondre aux exigences contemporaines ? Rénover un bâtiment historique, c’est marcher sur une ligne de crête entre deux écueils : la destruction excessive au nom de la modernité, et la conservation figée qui empêche toute évolution.
Dans ce débat, la nuance requiert justement de considérer chaque bâtiment, chaque usage, chaque époque.
Il est temps de faire preuve de bon sens : intervenir, non pas pour effacer l’histoire, mais pour lui permettre de continuer. Restaurer et adapter sans figer, tel est le défi. La réponse n’est ni dans la pure conservation, ni dans la rupture, mais dans un dialogue intelligent entre passé et présent.
Solène Bérus
Pour en savoir plus :
Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain - Le projet de rénovation : https://musee-lorrain.nancy.fr/le-musee/le-projet-de-renovation-1
Beaudouin architectes - Musée lorrain Nancy : http://www.beaudouin-architectes.fr/2013/11/projet-musee-lorrain-nancy/
Le Journal des arts, https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/nouveau-rebondissement-dans-le-projet-du-musee-lorrain-178436, Nouveau rebondissement dans le projet du Musée lorrain, Marion Krauze, publié le 19/06/25, [consulté le 29/06/25].
Bibliographie:
Jean-Marie Collin, « Le palais ducal de Nancy, de Charles IV à Stanislas », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Lonny Bourada et Hélène Duval, « Les apports de l’archéologie à la connaissance de l’histoire du palais ducal au XVIIIe siècle », Pays Lorrain, vol. 99, 2018.
Laurent Jalabert et Pierre-Hippolyte Pénet, La Lorraine pour horizon. La France et les duchés, de René II à Stanislas, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2016.
Étienne Martin et Pierre-Hippolyte Pénet, L’église des Cordeliers : Le sanctuaire des ducs de Lorrain à Nancy, Nancy, Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain, 2022.
Bénédicte Pasques, « Brève histoire illustrée du Musée lorrain », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Martine Mathias, « Anciennes muséographies et perspectives nouvelles pour le Musée Lorrain », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Thierry Dechezleprêtre et Marie Gloc, « La restauration du palais ducal de Nancy au XIXe siècle », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Pierre Marot, « Le Musée historique lorrain : œuvre de patriotisme, instrument de culture », Pays Lorrain, vol. 1, 1976.
Paul Sadoul, « Le Musée Lorrain, mémoire de la Lorraine », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Fabrice Mazaud, « Un regard sur le projet architectural », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Sophie Mouton, « Le musée en partage », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Le Journal des arts, https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/musee-lorrain-quest-ce-qui-gene-les-associations-patrimoniales-170916, Musée lorrain, qu’est-ce qui gêne les associations patrimoniales ?, Marion Krauze, publié le 14 février 2024, [consulté le 05/05/25].
#PalaisdesducsdeLorraine–Musée lorrain #Défenseursdupatrimoine #Extension #Rénovation

Le City-trip immobile au Pavillon de l’Arsenal La nouvelle maquette numérique
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité? Le city-trip immobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal.
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité ? Le city-tripimmobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal. Ré-ouvert le 14décembre 2011, la nouvelle exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal, lieu chargé d’exposer l’histoire urbanistique et architecturale de la capitale, intègre une gigantesque maquette numérique « Paris, métropole 2020 », créée par le Pavillon en partenariat avec Google et JC Decaux.
Ce projet de 37m² règne en maître des lieux dans le hall. Aménagé sous la forme d’un patio et centré par rapport à la mezzanine, il cohabite parfaitement avec l’architecture des lieux. Au total, ce sont 4 pupitres tactiles multipoints, 17 ordinateurs, 48 écrans LCD basse consommation, donc 48 Google Earth synchronisés, cent millions de pixels et mille mètres de câbles, qui rassemblent 1300 projets en 2D ou en 3D. Absolument impressionnant, ce dispositif haute technologie, conçu sur le principe cartographique du logiciel Google Earth, procure une expérience interactive unique, ludique et pédagogique. Sur le site internet, vous pouvez admirer la vidéo de l’installation de la maquette. En une minute quarante-cinq, celle-ci montre en accéléré les quelques jours de montage et la complexité du matériel utilisé, nécessitant de s’armer de techniciens expérimentés et d’informaticiens ingénieux.
Ce projet multimédia permet au Pavillon de l’Arsenal de dépasser les limites géographiques de l’ancienne maquette en carton, précédemment à cet emplacement, qui ne reprenait que le centre « construit » de Paris. Actuellement, ce sont plus de 12 000 km² du territoire métropolitain que l’on survole d’un doigt, de 15m à 50km d’altitude, permettant de traverser « les grands territoires de projets en mutation, les nouveaux ou futurs réseaux de transport et les architectures emblématiques de la ville de demain ou déjà en construction dans la métropole parisienne ». L’utopie n’est pas de mise, l’ensemble ne reprend que les projets déjà pourvu d’un permis de construire.
Cette première mondiale donne donc la possibilité unique de présenter simultanément l’existantet le futur d’une agglomération sur Google Earth, pour découvriraujourd’hui les quartiers de demain : voir en 3D les projets de la Philharmonie, des Halles, la fondation Louis Vuitton pour la Création, … . Au travers d’une “navigation libre ou thématique”, elle propose des visites guidées (bientôt disponibles), thématiques – architecture, urbanisme, transports- ou par recherche libre. Facilement manipulable et étonnamment fluide, il faut cependant prendre le temps de comprendre son fonctionnement car le doigté n’est ni celui du MACbook, ni celui connu de Google Earth. Le zoom, l’inclinaison, et la rotation nécessite une dextérité particulière comme de retourner chaque fois en bas de l’écran pour utiliser les flèches et icônes de l’option en question.
Cet outil, permettant bien des surprises, paraît cependant encore bien incomplet. Les principaux bâtiments et monuments y sont déjà modélisés (de la même façon qu’une bonne partie des villes de New-York et de San Francisco l’ont été faites), mais beaucoup de travail attend encore la communauté d’internautes de Google Earth pour lui assurer un ensemble harmonieux et cohérent. Fort heureusement, il a été conçu pour être « constamment et simplement complété et actualisé » car c’est bien un outil commun aux acteurs qui façonnent notre lieu de vie. Terrible challengede rassembler tous les projets d'architecture et d'urbanisme en cours d'élaboration pour donner une pré-vision complètement unifiée.
Ses concepteurs ont la volonté que cet outil soit « accessible à tous, jeunes, étudiants, parisiens et franciliens, professionnels français ou étrangers ». Il ne l’est cependant pas totalement car, certainement par soucis de pureté, il manque de clarté : les noms des rues et des arrondissements ne sont malheureusement pas indiqués, ce qui ne rend pas évident l’orientation. Les fiches techniques sont elles aussi bien inégales dans leurs informations. On trouve parfois une date, parfois une photo, parfois un texte informatif sur le projet, mais bien souvent, elles sont en attente de traitement.
L’application « Paris, métropole 2020 » sera bientôt téléchargeable pour vivre cette expérience chez soi, bien installé dans son divan. La question qui se pose est : qu’offre-t-elle de plus au Pavillon de l’Arsenal ? Sa force première est bel et bien les différents points de vue qu’offre son emplacement. Sa taille monumentale en fait aussi l’élément agréable qui permet de s'accouder à la balustrade de lamezzanine pour se laisser guider par un autre utilisateur, qui mène la barque un étage plus bas.
Cette innovation technologique questionne, comme bien d’autres, l’utilité qu’offrent de tels outils. Pour le moment, ce sont surtout les fantasmes de la transposition des supports qu’elle révèle, s'avérant des limites plutôt qu'un avantage. Le manque de contenu induit cette envie technophile d’attirer, de surcroit avec des grands partenaires tels que Google et JC Decaux. Cette technologie avant-gardiste devrait avant tout être conçue comme un élément de médiation permettant une meilleure accessibilité au contenu. Ne serait-est pas nécessaire d’y amener le jeu pour que les plus petits découvrent et apprennent eux aussi en s’amusant ? Des animations ou diverses vidéos lui permettraient d’acquérir l’ensemble des possibilités et des opportunités du multimédia, complémentaires à l’exposition permanente, réalisée de panneaux traditionnels et exposée sur les murs du Pavillon de l’Arsenal.
Clara Louppe
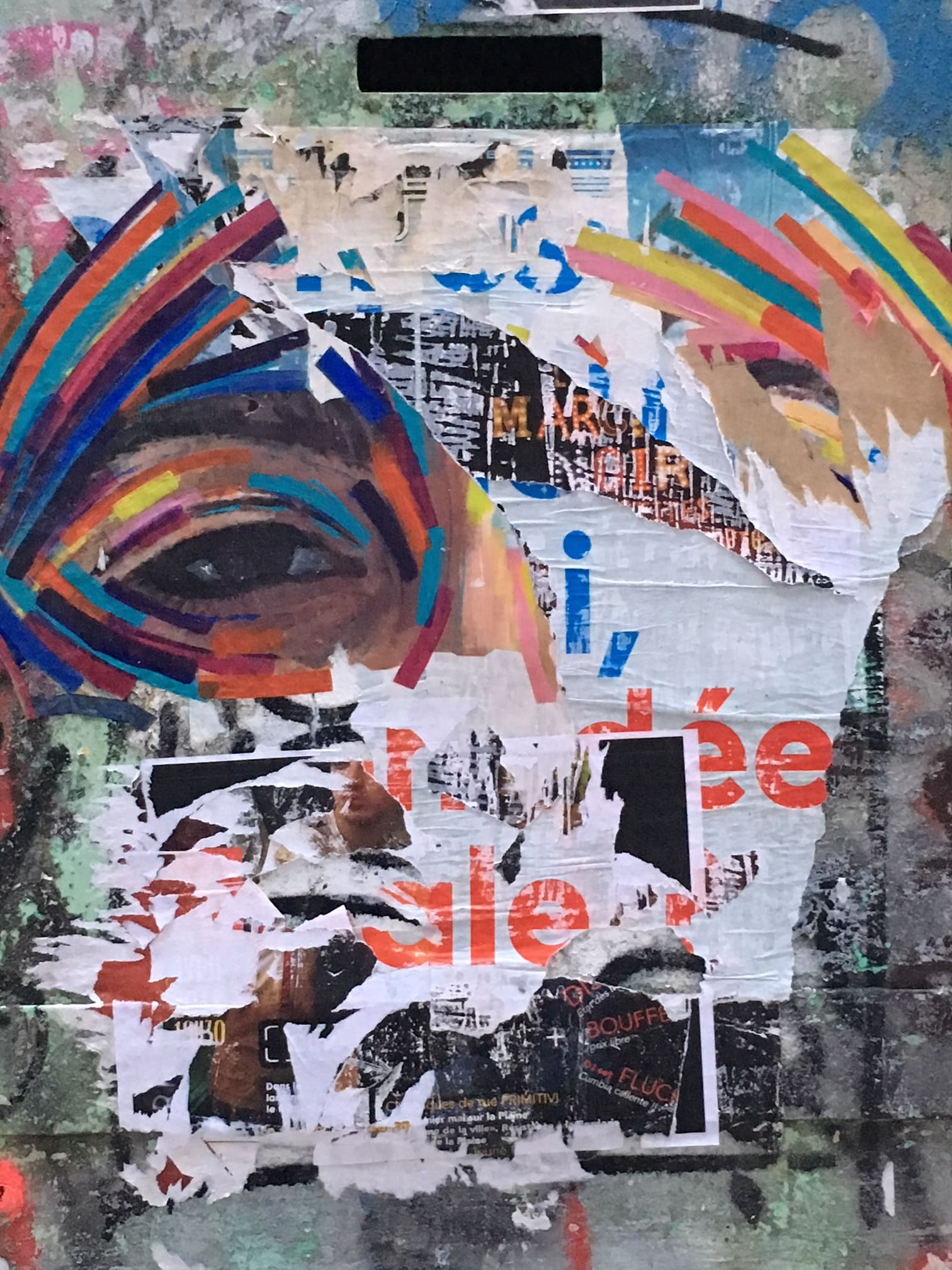
Le crew Dantès
Je ne sais pas vous, mais les musées, moi, je n’en peux plus. Trève de black box et de white cube, fini la scénographie immersive, je ne veux plus entendre parler de musées : je vais dehors me balader et prendre l’air.
Je vais dehors, en ville, m’imprégner de la culture urbaine. En passant rue Curiol, je suis en bas du conservatoire, j’y entends du violon pendant qu’en contrebas des gamins passent des basses sur leurs portables, je continue mon chemin et j’arrive rue Boris Vian : ça y est je suis dans la rue de la bibliothèque et je m’engouffre dans les boyaux marseillais qui serpentent derrière le cours Julien.
Je parle de boyaux car on y voit des tripes sur les murs: des personnes qui y ont projeté la rencontre sérigraphiée du troisième type entre une tortue géante et un plongeur, des squelettes bien vivants qui dansent sur les murs d’un bar. Je me sens bien ici, au milieu de ces ruelles que les graffeurs ont parées de leurs peintures nitro alkyde ou d’acryliques. Plus loin je croise le regard d’un fakir et celui d’une femme qui allaite son enfant multicolore. Ici, ce sont des fresques spontanées, là ce sont des prises de parole intempestives qui surgissent dans les rues insoumises de Marseille. J’ignore pourquoi j’ai cet attrait pour le mur peint : les blagues qu’il me propose, les illustrations qu’il m’inspire… j’ai l’impression que la ville est une pote plus qu’une amie, qui me fait rire, me fait penser, me fait divaguer.

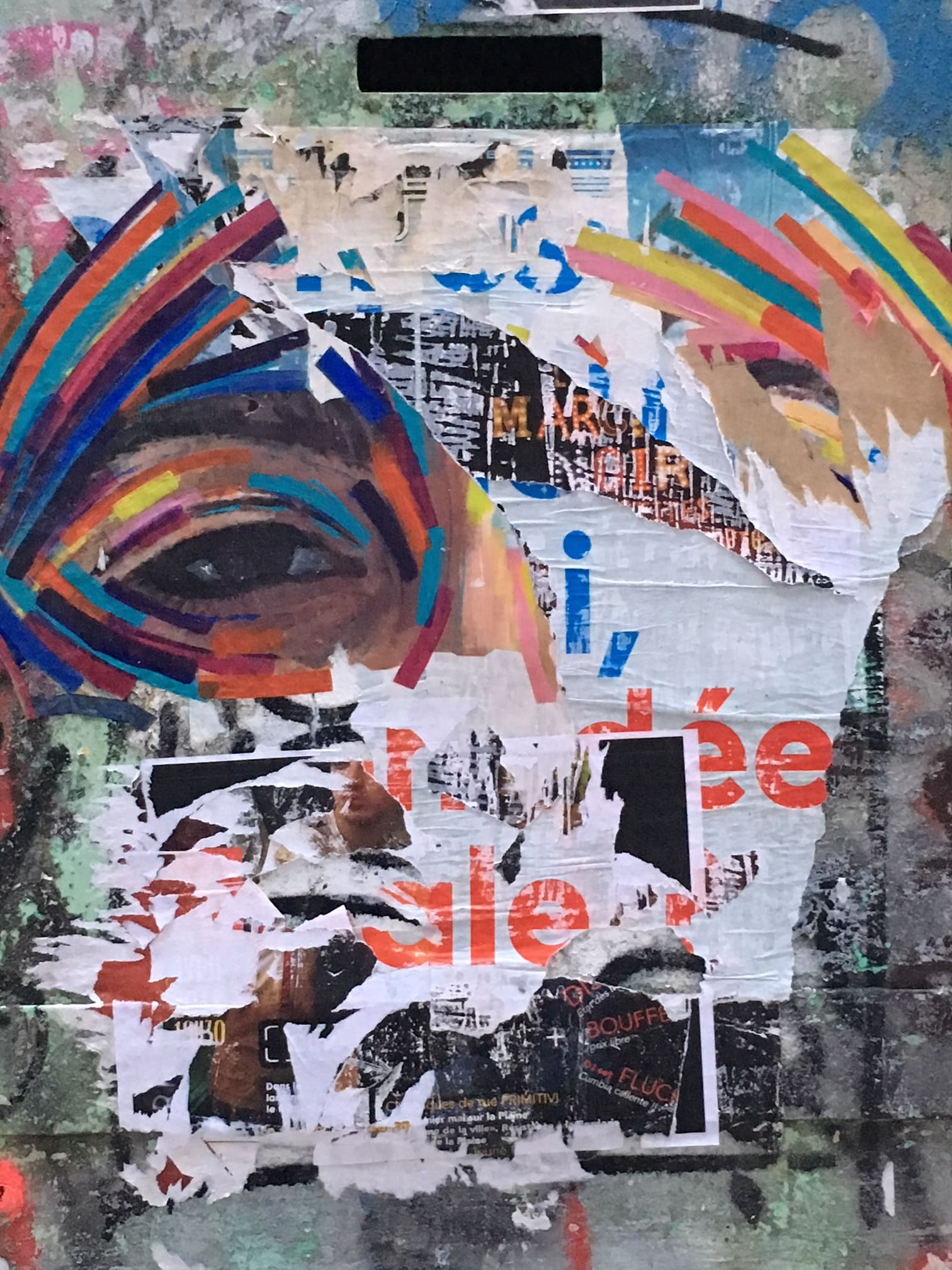
Changements d’échelles entre fresque et reste de sketch © CC
Mais pensez vous que la route s’arrête ici? Certes non, à l’aventure! Direction le Château d’If, fier bout de caillou dans lequel je ne pense pas que j’aurais aimé croupir. Depuis 1529 il est construit afin d’être une prison : contrôle du passage maritime et des penchants révolutionnaires marseillais..: pour quelqu’un qui ne voulait pas s’enfermer! Aujourd’hui il est un bâtiment dirigé par le Centre des Monuments Nationaux, c’est un lieu de patrimoine où on aime se perdre pour mieux en explorer les recoins. Quoi de mieux alors que de se risquer dans les pas d’Edmond Dantès? Je m’évade peu à peu, en guettant les graffitis : vous me voyez venir, il y en a plein.
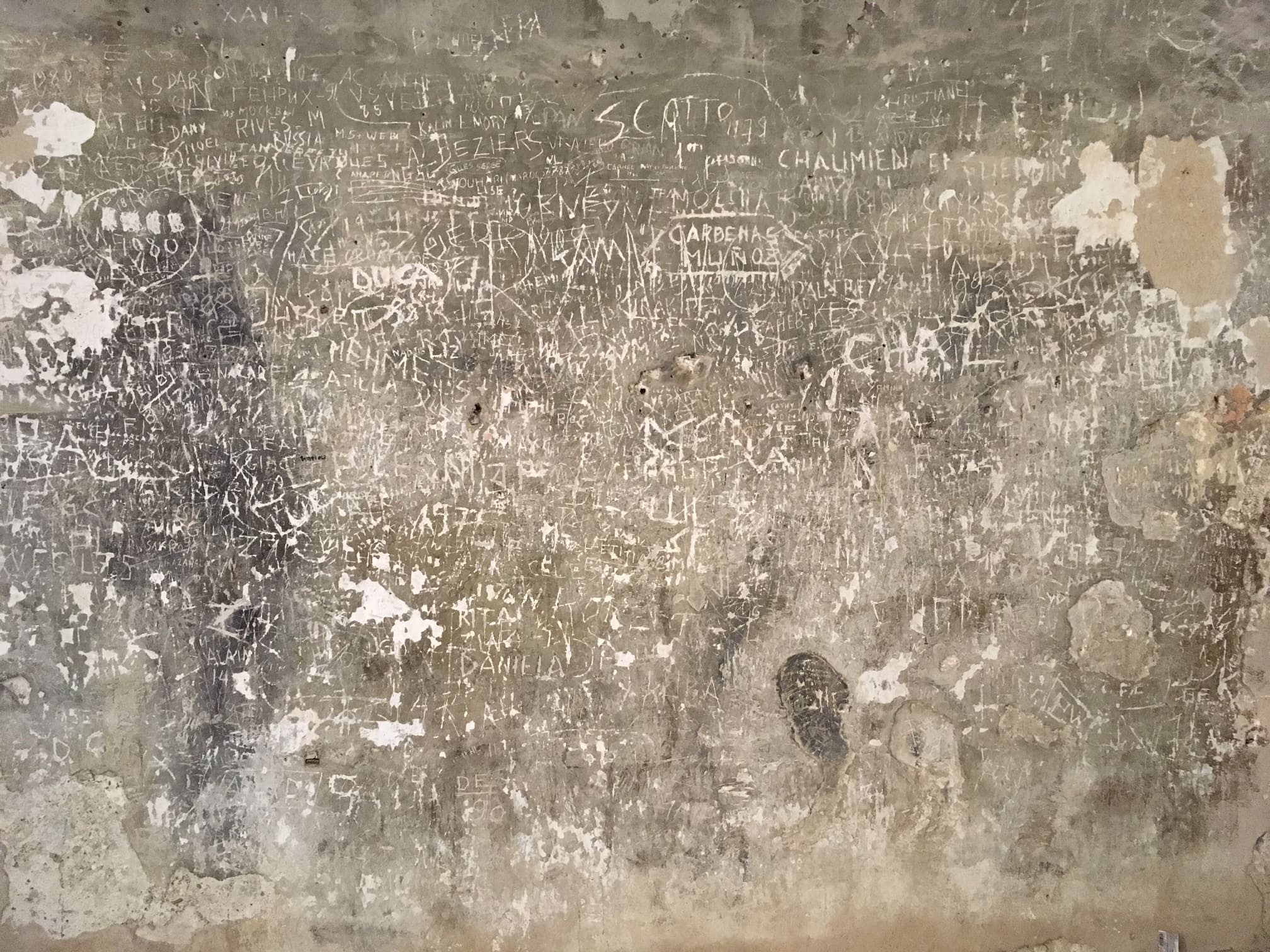
Graffitis sur le mur d’une geôle du Chateau d’If © CC
Bien entendu, il y a ceux des prisonniers, puis ceux des soldats, mais il y a aussi et surtout ceux des curieux qui viennent découvrir le Château d’If depuis son ouverture à la visite en 1880. Et en cherchant leurs marques, je finis par en trouver d’autres à l’air curieux.

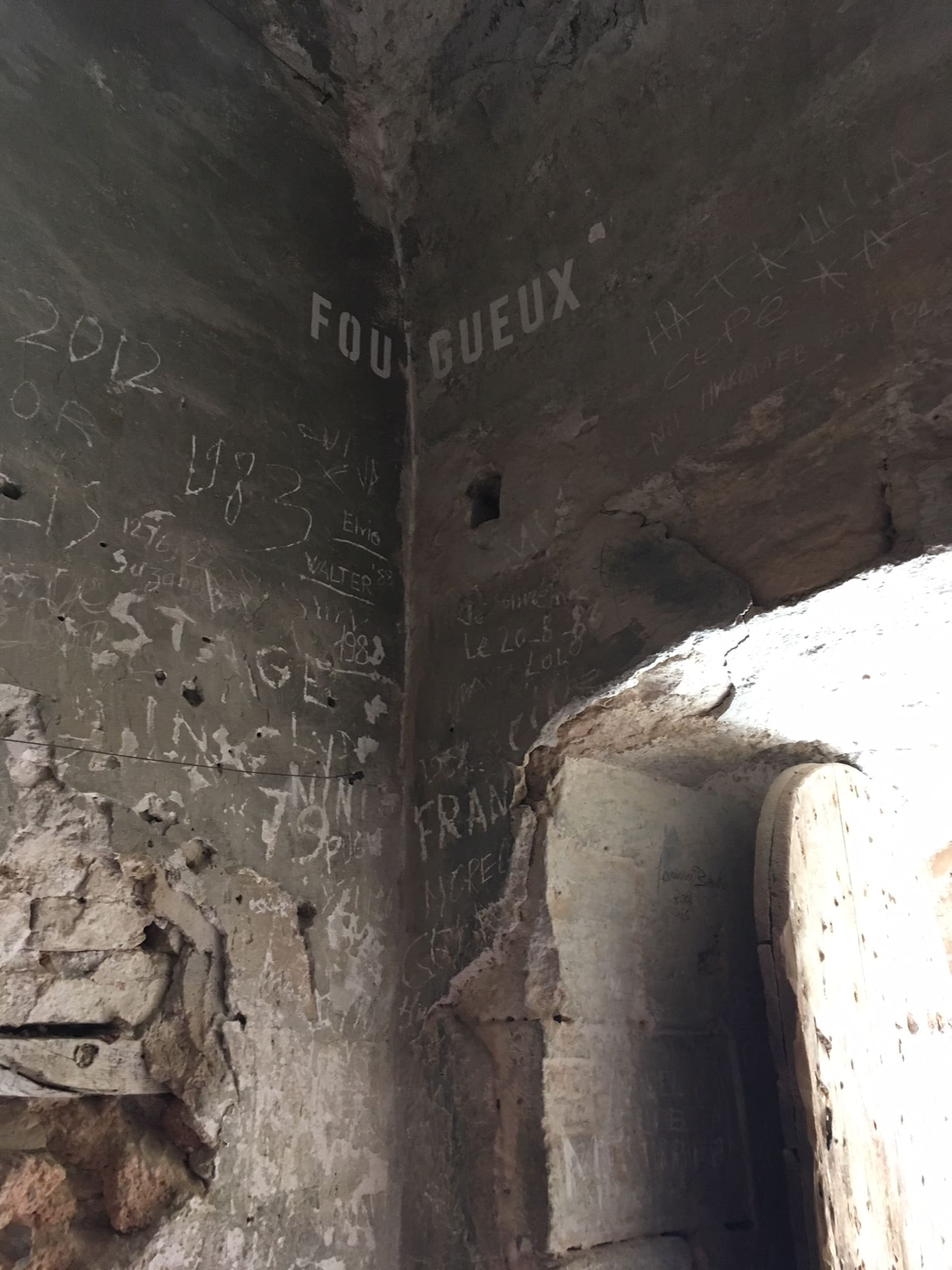

En levant les yeux, des mots-d’angles de David Poullard et Marie Chené © CC
Effectivement, de mai à novembre 2018, l’exposition “Un amour de graffiti”, prend place dans les geôles et sur les murs de l’ancienne prison. A la croisée des initiatives de MP2018 Quel Amour et de la saison nationale du Centre des monuments nationaux « Sur les murs, histoire(s) de graffitis », l’exposition propose à des acteurs originaux du graff de prendre leurs marques sur place. Cinq ans après MP2013, le bassin marseillais se gorge d’une programmation culturelle amoureuse qui dynamise le territoire et qui rencontre parfois des démarches nationales comme celle du CMN qui cherche à comprendre ce qui pousse à prendre la parole sur les murs. Au programme au Château d’If: des recherches sur les mots, une installation de Madame, mais aussi des zooms sur les graffitis que vous n’auriez pas relevés au milieu de ce brouhaha scriptural.
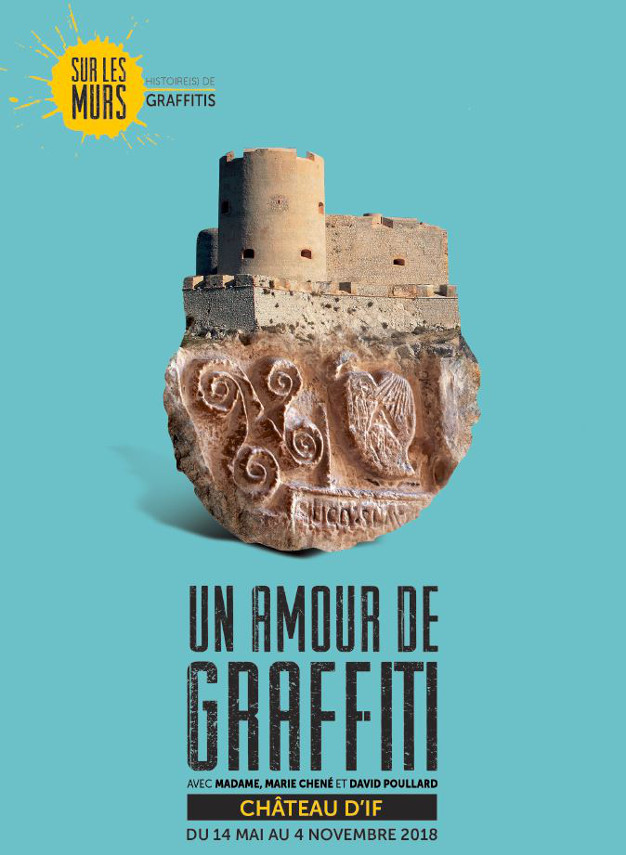
Affiche de l'exposition
En sortant de là, qu’est ce que je me dis? Je me dis que je suis touchée, de ces gens qui ont spontanément pris la parole. En fait peu importe le discours que l’histoire de l’art a et aura sur le graffiti, j’aime l’expression lire / libre que tout un chacun aura fait jaillir sur les murs. Peu importe le propriétaire du mur : collectivité, mairie, copropriété…l’important est la pensée ou le bon mot qu’il véhicule. Je vous en prie, vous même, prenez vos stylos,vos sprays,vos pochoirs, vos burins, vos stylets, dites que vous êtes passés par là, que vous vous êtes aimés ici, que vous comptez les jours qui nous séparents, criez vos questions, avec ou sans fautes d’orthographes, avec ou sans signature, l’important est d’y mettre ses tripes.
Coline Cabouret
#Graff
#Sur les murs
#Château d’If
#Tripes
Pour en savoir plus sur la programmation de MP2018:
http://www.mp2018.com/presentation/
Pour vous faire prendre l’air:
http://graffitivre.tumblr.com/

Le MUba Eugène Leroy un musée en perpétuel questionnement et renouvellement
A l’occasion d’un stage au MUba Eugène Leroy de Tourcoing, j’ai eu la chance de participer au premier renouvellement des collections pour l’année 2014. Créé en 1860, et anciennement dénommé Beaux-Arts de Tourcoing, le MUba Eugène Leroy présente ses collections dans un dialogue permanent entre art classique, art moderne et artcontemporain. Peintures, dessins, estampes, sculptures se côtoient dans les parcours où l’on croise par exemple Boilly ou Rembrandt en écho avec les contemporains Antoine Petitprez, Philippe Cazal ou encore avec des figures du xxe siècle comme Martin Barré ou bien sûr Eugène Leroy.
Les collections permanentes occupent la moitié de la surface d'exposition. Leur accrochage est régulièrement renouvelé pour faire écho aux grandes expositions temporaires programmées deux fois par an. L’exposition Permanente / Provisoire a été repensée à travers le thème de la forme et de la sculpture afin de faire écho aux deux expositions temporaires réalisées par le MUba. Le musée des Beaux-arts de la ville propose une grande rétrospective de l’œuvre de l’artiste contemporain autrichien Elmar Trenkwalderet une exposition plus réduite sur la forme et le design pratiquée à la Manufacture de Sèvres par le biais de vases. Ces expositions sont visitables depuis le 17 avril jusqu’au 24 novembre 2014, alors n’hésitez pas à vous y rendre car les expositions mais aussi le lieu valent le détour!
Vue de la salle d'exposition temporaire (c) F.Kleinefenn
L’exposition phare du moment "Ornement et Obsession" est la première rétrospective organisée autour de l’œuvre fantasmagorique d’Elmar Trenkwalder. L’amateur confronté pour la première fois à l’art de cet artiste autrichien, qu’il s’agisse de ses dessins, de ses premières peintures ou des sculptures de terre cuites des dernières années, n’a pas fini de s’étonner. Installé à Cologne au milieu des années 1980, l’artiste né en 1959 et qui vit aujourd’hui à Innsbruck,connaît un succès rapide avec des dessins et des tableaux d’inspiration symboliste dont les cadres, d’abord en moquette, puis en terre, font reculer le contenu du tableau vers la périphérie et l’élargissent. Les premiers travaux en terre émaillée de couleur frappent par l’extraordinaire expression physique du corps masculin dans la droite ligne d’une certaine tradition autrichienne de transgression des limites sexuelles.
Cette grande expositionprésente l’œuvre monumentale de l’artiste, des peintures et dessins, en incluant et mettant en perspective les œuvres acquises par le MUba. Elmar Trenkwalder crée des sculptures monumentales en céramique. Ses structures et ses architectures qui rappellent l’art flamboyant du gothique tardif, fusionnent des formes imaginaires biomorphiques et végétales. La représentation figurative, quant à elle, est déformée, elle joue de symboles féminins et masculins. L'artiste dresse un panorama complexe, fantastique et délirant empreint de formes de l’histoire de l’art, des arts appliqués ou des arts populaires. La grande nef du MUba est emplie de ses œuvres créant une atmosphère particulière, quasi-magique.
 Vue de la salle d'exposition Permanente/Provisoire(c) D. Knoff
Vue de la salle d'exposition Permanente/Provisoire(c) D. Knoff
En liaison avec l’exposition "ElmarTrenkwalder - Ornement et obsession" , l’exposition Permanente /Provisoire intitulée en réponse à la formule de Baudelaire "Un objet pas si ennuyeux que ça, la sculpture?", s’est façonnée à partir de la collection de sculptures du MUba, qui sont ainsi interrogées dans un parcours dynamique sur toutes les composantes de la sculpture, sa matière du marbre à la simple planche de contreplaqué, du bronze à la céramique, en passant par le bois de récupération, de la fonte d’aluminium au plâtre en passant par la terre ; son accrochage, sur un socle, sur le mur, directement au sol, dans l’espace, ou simplement représentée ; ou encore son sujet figuré, réaliste, suggéré ou abstrait. L’exposition Permanente / Provisoire est repensée comme une exposition temporaire, dont la présentation est renouvelée régulièrement. Le parcours de l’exposition propose une déambulation au rythme des œuvres exposées autour de la question de la sculpture selon le concept de la relation de l’art contemporain et l’art ancien. Ces nouvelles relations apportent un nouveau regard sur les œuvres en établissant entre elles des parallèles, multipliant ainsi les lectures possibles de l’œuvre. L’exposition permet de mettre au centre la question du rapport de l’œuvre au lieu et de son expérience.
Autour de ces expositions, le MUba Eugène Leroy, toujours dans un souci de faire dialoguer les arts et les formes, a pensé une exposition temporaire, "V de S", en étroit lien avec la Cité de la Céramique. Le parcours de l’exposition propose de circuler autour des vases et formes emblématiques de la Manufacture autour de la question du renouvellement des formes des vases et de l’étroit lien entre l’art ancien et l’art contemporain. Ces nouvelles relations, associant les plus grands créateurs internationaux aux collections du patrimoine national, apportent un nouveau regard sur les œuvres, multipliant ainsi les grilles de lectures possibles. La Cité de la Céramique représente l’excellence des métiers d’art et de lacréation en France. Les résidences exploratoires d’artistes et de designers qui s’enchaînent depuis des décennies à la Cité de la Céramique, occupent quotidiennement plus d’une centaine de céramistes d’art, et ouvrent l’horizon sur de nouveaux territoires et de nouvelles potentialités artistiques encore inédites. L’exposition propose un parcours au travers d’une double perspective : la continuité de la forme en blanc, que l’on retrouve chez Charpin, Arp ou encore Renonciat et les ruptures, qui ne sont qu’apparentes, proposées par de nombreux artistes et designers tels que Sottsass ou Biecher.
Pour tout cela et bien plus encore, venez découvrir ces expositions particulières et différentes mais toujours en dialogue les unes avec les autres et participant à l’éternelle quête de questionnement et de renouvellement que suit le MUba Eugène Leroy, exemple dont pourrait bien s’inspirer nombreuses autres structures.
Elisa Bellancourt

Le Musée Communal Jeanne Devos ou la maison des souvenirs.
Face à l’église Saint-Martin de Wormhout, une ruelle mène au Musée Communal Jeanne Devos. Un musée ? Une maison en réalité. C’est à peine si l’on ose passer le pas de la porte de son propre chef, craignant de s’introduire avec désinvolture

© Katia Fournier
Face à l’église Saint-Martin de Wormhout, une ruelle mène au Musée Communal Jeanne Devos. Un musée ? Une maison en réalité. C’est à peine si l’on ose passer le pas de la porte de son propre chef, craignant de s’introduire avec désinvolture dans une propriété privée. Une fois qu’on vous a invité à entrer, ne cherchez pas de signalétique, vous venez de pénétrer dans la maison de Mademoiselle Devos.
La guide et gardienne de ce lieu sanctifié est la dernière personne ayant vécu auprès de « Mademoiselle » comme elle le raconte. Yvonne, de son prénom, fera la médiation mieux qu’aucun dispositif ne pourrait le faire. Elle vous invite à vous asseoir dans une petite salle, autour d’une table recouverte de prospectus et de flyers comme en sont remplis les présentoirs à l’accueil des musées. C’est là que débute l’histoire. Comment Jeanne Devos est-elle devenue propriétaire de cet ancien presbytère ? Pourquoi est-elle devenue photographe ? Comment s’est déroulée sa vie ? Après cette introduction biographique, nous sommes invités à visiter la maison. Au fil des salles, la guide détaille le mobilier, précise sa provenance et leurs créateurs qui sont de nombreux admirateurs et amis de Melle Devos. Chaque pièce semble avoir été laissée telle quelle après la mort de Mademoiselle Devos, et c’est bien le cas.
Le plus frappant lors de la visite de ce musée, est le comportement que l’on y adopte. Loin des conventions imposées dans certains musées contrariés par la trop grande proximité entre le visiteur et l’œuvre, au Musée Communal Jeanne Devos, la guide invite à manipuler les stéréoscopes, ou à feuilleter les albums durant des heures si le cœur nous en dit. Mais le plus incroyable, est la simplicité avec laquelle nous sommes reçus. S’asseoir à table, dans la cuisine de Jeanne Devos, autour d’une cannette de jus de fruit, tout en discutant des mœurs d’antan, cela frôle le surnaturel. En apparence, la maison s’est figée. Du rez-de-chaussée au grenier, ustensiles de cuisines, mobilier, jouets d’antan, photographies et bien d’autres objets de l’époque permettent cet arrêt sur image. Cependant, le musée vit. Comme propulsé vers le passé, le visiteur qui fera la connaissance d’Yvonne, vivra avec elle au temps où Mademoiselle parcourrait encore les différents étages de la maison.
Le temps nous échappe lorsque l’on « fouine » dans cette maison comme on le ferait dans le grenier de l’un de nos aïeuls. Pour s’arracher à cette curiosité qui nous pousse à parcourir tous ces albums qui se sont accumulés sur les tables, il suffit d’apercevoir le magnifique jardin qui s’étend derrière la maison. La guide vous y attendra par beau temps, assise au soleil, sur l’une des jolies chaises du salon de jardin. Dans le fond, nous sommes peut-être chez Jeanne Devos, mais aussi chez Yvonne.
Ce jardin a une particularité très surprenante. Au bout du sentier s’élève une stèle où reposent Jeanne Devos et l’abbé Lamps, qui a permis à Mademoiselle Devos de découvrir ce talent de photographe qui sommeillait en elle.
Le Musée Communal Jeanne Devos est une curiosité à ne pas manquer. Les amateurs de la photographie y découvriront ou y redécouvriront les clichés de Mademoiselle Devos. Les amoureux du Nord-Pas-de-Calais se délecteront des souvenirs figés en noir et blanc mais aussi en couleur de la région. Les amateurs de musées y trouveront un concept de « musée-témoin-vivant » qui incite à la réflexion quant à l’importance et à la portée des témoins réels. Yvonne vous accueille du 1er avril au 31octobre contre 2 euros, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 14h00 à 17h00. Et le 1er dimanche du mois de 15h00 à 18h00. Et du 1er novembre au 31 mars, les lundis, jeudis et samedis de 14h à 17h.
Katia Fournier

Le musée des beaux arts de La Rochelle, le MBA qui donne envie d’y retourner !
Au 28 rue Gargoulleau de La Rochelle se trouve l’hôtel Crussol d’Uzès, construit sous Louis XVI. Cet imposant bâtiment, caché dans une rue semi-piétonne proche du port, abrite deux institutions qui habituellement sont radicalement opposées : l’Espace d’Art Contemporain, qui occupe le rez-de-chaussée, et le Musée des Beaux-Arts, installé depuis 1844 dans les deux autres étages. Une cohabitation intéressante qui permet de casser tous les préjugés sur les lieux d’accès à la culture et de diffusion de l’art. Cet article sera consacré au musée des Beaux-Arts.
Le Musée des Beaux Arts, chaleureux, accessible, et engagé.
Même si la porte fermée du deuxième étage intimide un tantinet le visiteur, l’accueil qui lui est réservé derrière celle-ci, est des plus appréciables. Lors de ma visite, deux agréables personnes me reçoivent et me donnent tout de suite des indications : le 2ème étage est réservé aux collections« permanentes », et le premier étage est consacré aux expositions temporaires d'art contemporain.
Elles me précisent aussi qu’il n’existe pas de livret explicatif gratuit de la collection, mais seulement une édition,disponible pour 10€.
Au deuxième étage, la visite se fait en deux temps. Dans la première partie, un chapeau introductif informe que la collection s’est faite petit à petit par un groupe d’amateur d’art depuis 1841, grâce à des dons, des legs, et des achats à hauteur de leurs moyens, ce qui explique pourquoi la collection comporte en majeur partie des œuvres de 1840 à 1930.
Un deuxième texte explique au visiteur que la collection comporte plus de 900 œuvres, mais que l’espace d’exposition disponible ne permet pas de toutes les montrer. C’est pourquoi, l’exposition change tous les ans. La particularité de ces expositions, c’est qu’elles sont réalisées par une personne ou un groupe de personnes lambda(s) qui choisissent eux-mêmes le thème, les tableaux, et créent la scénographie. Ces personnes sont des acteurs de la vie Rochelaise, qui ne sont pas forcement initiés à l’art. Pour la sixième édition (du 06 septembre 2012 au 31 août 2013), c’est le Centre Technique Municipal qui a accepté cette mission. Le thème choisi a été « De l’ombre à la lumière… » à travers plusieurs sous thèmes : scènes quotidiennes, marines et pêcheurs, paysages, et portraits plébéiens. Une politique innovante de la part de la conservatrice Annick NOTTER qui a compris comment prendre en compte le public.
C’est à travers une centaine d’œuvres que le visiteur découvre sur différents thèmes des jeux de clairs-obscurs et un travail pictural de la lumière qui séduit tout un chacun. Il est donc surprenant, mais pas inintéressant, de trouver dans le même espace, une lithographie du XIXème siècle, une huile sur toile réaliste de 1861, une peinture impressionniste de 1904, une sculpture de la fin du XXème, et une photographie de 1980, qui se complètent avec des notions autres que des liens chronologiques.
La visite est rapide et accessible à tous, et en plus, des espaces de repos sont idéalement positionnés en face des grands tableaux.
Salle Eugène Fromentin Crédits : M. T.
Dans la deuxième partie, de l’autre côté de l’accueil, on explore une salle sur Eugène Fromentin, un peintre rochelais qui a passé une longue période de sa vie au Maghreb, ce qui influença considérablement ses sujets et sa technique picturale. Ici l’organisation est un peu plus chaotique. Le chapeau explicatif sur cet artiste est à la sortie de la salle, ce qui n’est pas l’endroit le plus stratégique. En revanche, il est proche d’une banquette, et cela est important car ce chapeau est long. Mais il est facile à lire et essentiel pour comprendre la pièce, les œuvres et la mise en ambiance. En effet, pour immerger le visiteur dans une ambiance orientale, la scénographie propose un procédé poétique pour lier le public avec les œuvres et leur contexte. On est donc bercé par une lumière tamisée et la banquette est recouverte de tapis colorés, ce qui nous plonge dans une atmosphère chaleureuse.
Enfin, on accède à la dernière pièce de l’étage, où l’on retrouve le parti-pris de faire côtoyer des œuvres qui ne sont pas des mêmes époques. Cependant, la compréhension de cette salle n’est pas aisée : la plupart des œuvres n’ont pas de cartel, et aucun texte n’introduit à une quelconque problématique ou réflexion. C’est très dommage,car on aimerait savoir pourquoi une huile de Gustave Doré se retrouve entre une Vénus de 1904, une toile de Chaissac, et des paysages de Corot.
Quand l’art contemporain trouve sa place au MBA
Suite et fin de ma visite au premier étage, avec l'exposition temporaire et itinérante de Sylvie Tubiana, intitulée « Japons » qui était présentée du 19 octobre 2012 au 28 janvier 2013. L'exposition proposait dans un premier temps un travail photographique de l’artiste : suite à des choix d’estampes japonaises, celles-ci ont été projetées sur des corps nus de femmes agenouillées, suivi d’un travail de photographie de ces projections. L’aspect esthétique et le rapport au corps présent dans ces photos sont déjà à eux seuls d’un intérêt particulier, mais les photographies étaient également confrontées à de vieilles estampes japonaises, issues de la collection du musée de la Roche-sur-Yon. La collaboration continuait avec des vitrines montrant divers objets nippons très anciens. Dans les dernières salles, des installations immergeaient le spectateur dans un environnement particulier, mêlant toujours l’ancien et l’actuel. Le dépaysement est total, on oublie le lieu, l’hôtel Crussol d’Uzès, La Rochelle, le port. Nous voilà au Japon.
Exposition de Sylvie Tubiana, « Japons » Crédits : M. T.
Le musée des Beaux-Arts de la Rochelle (labellisé Musée de France) a donc très bien intégré l’art contemporain au sein de ses murs, en lui donnant une place importante, et non en lui laissant la place d’une statue dans une cour pour intriguer le passant et essayer d’être attractif (comme dans beaucoup de MBA qui prétendent s’ouvrir à l’art contemporain). La moitié du musée est consacrée à l’exposition d’art contemporain. Et quand cela s’ajoute à une politique d’accessibilité à tous (plein tarif à 4€, expositions collaboratives réalisées par les citoyens, lycéens, agent de la mairie, association…), enfin on peut dire qu’un musée est vraiment accessible et dynamique. Enfin un musée qui ne se sclérose pas et évolue avec son temps ! Et cela ne veut pas dire être rempli des derniers outils de médiation issus des nouvelles technologies. Le prochain effort à faire se situe du côté des publics handicapés, mais pour le reste, on a envie de savoir qui seront les prochains commissaires d’exposition, et on court voir la nouvelle expo au premier étage "Mille et un bols : hommage à un bol de thé indien" (du 15 février 2013 au 17 juin 2013).
Mélanie TOURNAIRE
Pour en savoir plus :
La-Rochelle/Musee-des-Beaux-Arts/Vie-du-musee-actualites/Mille-et-un-bols
Le musée Soulages à Rodez : un succès ?
Dans les années 2000 la ville de Rodez a décidé de dédier un musée à Pierre Soulages, natif de la ville. Marc Censi, maire à ce moment-là, dut d’abord convaincre Pierre Soulages qui avait auparavant déjà refusé qu’on lui consacre un musée à Montpellier. À Rodez il n’accepta qu’à la condition qu’un espace de 500m2 soit réservé à des expositions temporaires consacrées à d’autres artistes, il en donne l’explication dans un article pour Geo Voyage :
« Ce n’est pas une question de modestie : un musée d’artiste, on y vient trois ans, pas plus, et puis ça lasse… et le musée meurt. Je ne veux pas d’un mausolée Soulages ».

Vue extérieure du musée © tourisme.grand-rodez.com
Un artiste très impliqué dans la création de son musée
Le musée est donc dès ses débuts fortement marqué par la volonté de Pierre Soulages dont l’implication a rendu possible la création du musée. Au-delà de sa participation à la définition du concept, il s’est aussi engagé sur le plan matériel. Cette donation initiale de 250 œuvres et 250 documents en 2005 a vraiment marqué la concrétisation du projet du musée. La collection est enrichie ensuite en 2012 par une autre donation et par des dépôts de l’artiste. Au total il a donné 500 œuvres à la ville. Quand il est question de la très grande valeur des donations, (évaluées à une trentaine de millions d’euros) Pierre Soulages répond qu’il ne s’intéresse pas aux questions d’argent et que justement il aime l’idée qu’un public large puisse apprécier son travail. C’est aussi en lui proposant d’exposer des aspects moins connus de son travail que Marc Censi a convaincu Pierre Soulages. L’exposition permanente actuelle présente ainsi ses œuvres de gravure et les travaux préparatoires des vitraux de Conques, mettant ainsi le musée en lien avec un autre lieu emblématique de la région.
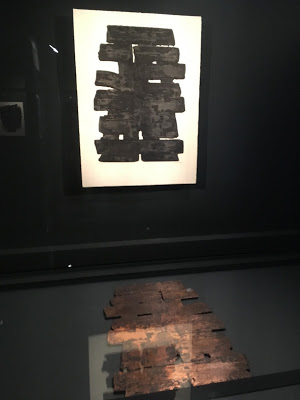
Présentation de son travail de gravure © Salambô Goudal
Le musée comme moteur de développement local
Comme de nombreuses villes Rodez a misé sur la création d’un nouveau musée pour entrainer le développement local grâce à l’accroissement espéré du tourisme. Le plan de redynamisation du centre-ville impulsé en parallèle de la construction du musée fait partie de cet effort en faveur du tourisme, d’où les travaux urbanistiques, notamment la rénovation et le développement du parc du Foirail qui borde le musée.
L’importance du public touristique pour le musée est visible dans les horaires du musée dont l’amplitude est plus élevée en été. Du 1er juillet au 31 août le musée est ouvert tous les jours, le lundi de 14 heures à 19 heures et de 10 heures à 19 heures du mardi au dimanche. En revanche, entre le 1er octobre et le 31 mars le musée ferme le lundi, entre midi et deux heures en semaine et le soir à 18 heures.
Les habitants de Rodez et sa région sont un public à ne pas négliger puisque le musée se veut comme un lieu de vie, volonté partagée par de nombreux musées. Les Ruthénois ne sont en effet pas oubliés, outre les bénéfices qu’ils retirent des aménagements du centre-ville et de l’accroissement du tourisme, le musée enrichi la vie culturelle de la région.
Les espaces du musées permettent d’accueillir les œuvres d’artistes très connus et d’en faire profiter la population locale. C’était le cas de l’exposition Picasso à l’été 2016, dont le public venait majoritairement d’Occitanie. Le musée participe également à la vie locale par les visites et activités qu’il propose aux scolaires et groupes issus du secteur social.
La visite du musée
Comme de nombreux visiteurs, je suis allée au musée Soulages en m’attendant à retrouver des peintures noires, ses œuvres les plus connues du grand public. Je pensais à peu près savoir à quoi m’attendre en entrant dans un tel musée ! J’ai été au contraire agréablement surprise par la diversité des œuvres exposées. Dans le parcours permanent sont exposées des œuvres des différentes pratiques de Pierre Soulages, les travaux de préparation des vitraux de Conques, ses eaux-fortes et enfin ses tableaux.
Le parcours mêlant chronologique et thématique, permet de bien appréhender la personnalité et les œuvres de l’artiste dans l’ensemble qu’elles composent, sa longueur est adaptée aux propos et agréable.Pourtant, je n’ai pas pu l’apprécier pleinement, je me suis très rapidement sentie oppressée par l’atmosphère du lieu crée par l’architecture et la scénographie. De nombreux espaces de l’exposition temporaires sont semblables à des boites noires : très sombres avec peu de hauteur de plafond, ce qui crée une ambiance, pensée pour les œuvres de Soulages, mais construit des espaces très fermés qui ne proposent pas de respiration. De tels espaces posent donc la question de l’arbitrage entre immersion dans un univers et bien-être des visiteurs. Les espaces latéraux présentant les grands tableaux gardent la même ambiance tout en étant moins oppressants grâce à leur grande taille et à la présence de fenêtres.

Les espaces « boîtes noires » © tourisme.grand-rodez.com
En entrant dans l’exposition temporaire de l’été 2017 consacrée à Alexander Calder, le contraste est saisissant que ce soit par le fond comme par la forme. Dans l’espace dédié aux expositions temporaires les œuvres souvent très colorées d’Alexander Calder étaient exposées dans un espace entièrement blanc. Ce contraste peut être bénéfique en mettant en valeur les spécificités des deux artistes présentés dans le musée. Vraie plus-value pour le musée, le contraste crée par les deux expositions temporaires par an permet de maintenir l’intérêt du public et de le faire revenir au musée.

L’exposition Calder © Salambô Goudal
Le musée est un franc succès : il réussit à montrer les œuvres de Pierre Soulages sans être un mausolée et à être un pôle d’attraction dans la région, en septembre 2016 un peu plus de deux ans après son ouverture la barre du demi-millions de visiteurs a été franchie !
Bethsabée Goudal
#MuséeSoulages#Calder#Rodez

Le street art en mouvement : quelles actions culturelles ?
Né dans les rues de Philadelphie dans les années 1960, de mouvement marginal à phénomène mondial, le street art façonne désormais nos villes. Cet art de plus en plus reconnu trouve aujourd’hui sa place, porté par une multitude d’actions culturelles visant à le valoriser sous toutes ses formes.
Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Vers une valorisation des toiles urbaines ?
C’est dans les années 1960, aux États-Unis et plus particulièrement à Philadelphie, que le street art, d’abord appelé graffiti writing, est apparu sous l’égide de deux artistes, Cornbread et Cool Earl. En France, il est porté par Ernest Pignon-Ernest dans les années 1970 et n’explosera qu’à partir des années 1980. Depuis ses origines modestes sur les murs des quartiers marginaux, le street art a évolué pour devenir un mouvement artistique d’envergure mondiale. Se distinguant par sa nature éphémère, il transforme les espaces urbains en expressions artistiques, allant de fresques murales monumentales aux petites interventions cachées, graffitis et pochoirs. Maintenant démocratisé par des artistes phares, il reste néanmoins un art qui ne fait pas l’unanimité. Mais une profusion d’actions culturelles initiées par divers acteurs tels que des artistes, amateurs, associations, institutions culturelles, collectivités sont autant d’actes de reconnaissance. Ces initiatives visent à sensibiliser et à valoriser le street art sous de multiples formes.
Participation et inclusion
Au-delà de son aspect contemplatif, esthétique ou engagé, le street art est aussi une œuvre sociale, élaborée dans les échanges et rencontres. Les festivals et événements autour du street art se multiplient, offrant une possibilité aux artistes de créer et d’interagir directement avec le public. Des festivals de street art aux ateliers artistiques en plein air renforcent les liens sociaux et favorisent l’échange. Cette année le Street Art Fest Grenoble-Alpes, festival sensibilisant aux formes d’expression artistique urbaine telles que le graffiti, les fresques murales, les installations, et les performances en direct, lance sa 10ème édition. Transcendant le cadre d’un évènement artistique, il est porteur d’actions culturelles autour du street art dans près de dix villes partenaires favorisant la participation active des habitants. Les ateliers artistiques, les visites guidées et les conférences organisés dans le cadre du festival visent à sensibiliser le public au street art. Des projets collaboratifs et participatifs encouragent les habitants à s’approprier l’espace public et à contribuer à la création d’œuvres collectives. Ces activités permettent de mieux comprendre les techniques, les styles et les enjeux sociaux et culturels du mouvement, contribuant ainsi à changer les regards sur cet art souvent mal compris.


Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Un outil de sensibilisation, dialogue et contestation
Le street art est également devenu un outil important de sensibilisation sociale et environnementale. De nombreux artistes abordent des questions cruciales telles que les droits de l’homme, la justice sociale, ou encore la préservation de l’environnement. L’artiste et vidéaste italien Blu est connu pour ses multiples graffitis disséminés à travers le monde, notamment à Barcelone, New York, Varsovie, Londres et Rennes. Ses fresques abordent des sujets politiquement chargés, complexes et aux enjeux internationaux. Ici, une gigantesque bouche, dont les dents évoquent des immeubles, semble prête à dévorer un arbre aux feuilles verdoyantes. Cette représentation saisissante évoque le fléau de la déforestation.
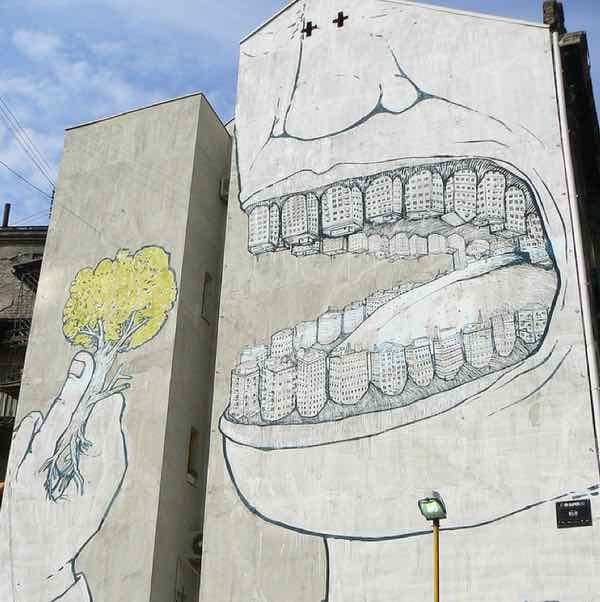
Peinture murale sur la déforestation réalisée par l’artiste Blu, en Serbie, crédits : La boite verte
Les artistes choisissent soigneusement leurs emplacements, tenant compte de l’architecture, de l’histoire locale et des dynamiques sociales. C’est le parti-pris que prend l’artiste JR en réalisant un projet artistique 28 Millimètres : Les Bosquets en 2004. Situé dans la banlieue parisienne, plus précisément à Montfermeil, Les Bosquets est un quartier marqué par les difficultés sociales et économiques. En 2006, en réaction à la stigmatisation médiatique de la jeunesse populaire, JR choisit de photographier les habitants des Bosquets, en leur demandant de se caricaturer et de se montrer sous un jour menaçant. Ce projet confronte les passants à des portraits caricaturaux des jeunes déployés vers divers quartiers de Paris, les invitant à réfléchir sur la représentation de la jeunesse des quartiers populaires. Né d'une volonté de donner une voix, JR engage ces habitants souvent marginalisés et stigmatisés dans un processus de création artistique qui démontre le potentiel du street art comme outil de collaboration et de dénonciation.
Une reconnaissance institutionnelle croissante
Face à l’engouement croissant pour le street art, de nombreuses institutions culturelles comme le Musée en Herbe avec l’exposition du graffeur Seth et le Grand Palais immersif présentant Loading. L’art urbain à l’ère numérique, reconnaissent désormais sa valeur artistique et sociale. Ce mouvement de reconnaissance témoigne de l’évolution de la perception de cette forme artistique autrefois marginalisée. En décembre 2023, le musée de l’Hospice Comtesse à Lille dédiait son exposition temporaire à l’artiste Jef Aérosol, un des pionniers du mouvement en France. Ses œuvres emblématiques furent exposées dans les salles historiques de cet ancien hospice, offrant ainsi un mélange surprenant entre l'art contemporain et le patrimoine historique. Cette exposition a attiré un large public, allant des passionnés d’art urbain aux visiteurs curieux. En présentant le travail de Jef Aérosol dans un cadre muséal, et en laissant les visiteurs investir une des cimaises de l’exposition, l’Hospice Comtesse contribue à son tour à la valorisation du street art en tant qu’expression artistique légitime. D’autres musées entièrement dédiés au street art émergent, comme le Art 42 à Paris ouvert en 2016 ou encore le Musée vivant d’Art Urbain et de Street Art à Neuf Brisach ouvert en 2018. En intégrant le street art en leur sein, les musées sensibilisent les publics plus sceptiques tout en valorisant ce mouvement soulevant généralement des questions sociales et politiques. Parallèlement, les villes collaborent de plus en plus avec les artistes pour intégrer le street art dans les projets de réhabilitation urbaine et de revitalisation des quartiers. C’est le cas de la ville de Charleville Mézières qui, en 2015, fait un appel à projet pour la création d’un parcours « art urbain » autour des poèmes d’Arthur Rimbaud. En réinvestissant les espaces vides, négligés ou abandonnés, le street art redonne vie à des murs amochés, invite les passants à redécouvrir leur ville et crée au fil des années un parcours de visite urbain, en lien avec Rimbaud, dans sa ville natale.


Vue aérienne de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Cimaise de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Des actions engagées
Les actions culturelles, événements et festivals autour du street art sont bien plus que de simples occasions de divertissement ou de contemplation artistique. Ils représentent des opérations dynamiques qui valorisent les différentes formes du street art. En favorisant la reconnaissance des artistes, ces initiatives enrichissent le paysage artistique contemporain et encouragent la diversité culturelle. De plus, en permettant aux artistes de créer directement avec le public, ces événements favorisent un échange culturel riche et stimulant, renforçant ainsi les liens sociaux et communautaires. Par leur capacité à sensibiliser aux enjeux sociaux, politiques et environnementaux, les actions culturelles deviennent également des outils de dialogue et de changement social. En encourageant l’inclusion, la créativité et l’expression individuelle, elles contribuent à façonner des sociétés plus ouvertes.
Léa Sauvage
#streetart #arturbain #actionsculturelles
Pour en savoir plus :

Le syndrome de l'expositionnite
Devant l’ampleur que prenait ce phénomène, deux professeurs d’Histoire de l’art du bel paese ont pris la plume pour dénoncer les complications auxquelles pourrait mener la situation. Tomaso Montanari et Vincenzo Trione sont deux historiens de l’art, professeurs à l’université de Naples (respectivement d’art baroque et d’art contemporain), éditorialistes et critiques d’art pour la presse italienne (ils écrivent notamment pour le Corriere della sera et pour Reppublica). Ils ont publié en octobre 2017 aux éditions Giorgio Einaudi un ouvrage intitulé « Contro le mostre », littéralement « Contre les expositions ». Et le sous-titre de confirmer la thèse suggérée par le titre : « Un système de sociétés commerciales, de « commissaires en série », d’élus déboussolés et de directeurs de musées asservis au politique aboutit à la production continue d’expositions bankable, creuses et dangereuses pour les œuvres d’art. Il est temps de développer des anticorps intellectuels, recommencer à faire des expositions sérieuses, et redécouvrir le territoire italien ». Le ton est donné.
© ibs.it
Montanari et Trione dénoncent donc cette « expositionnite » dont l’Italie est, selon eux, devenue la patrie, et critiquent en particulier le torrent d’expositions « blockbusters » toujours composées des mêmes éléments : le Caravage, Léonard de Vinci, les impressionnistes, Van Gogh, Dalì et Warhol. Pour les deux historiens de l’art, ces expositions relèvent presque toujours du pur divertissement, cher et de piètre qualité. Ils regrettent qu’il n’y ait quasiment jamais de recherche originale derrière le projet, voire même rien à apprendre, rien à découvrir. Et surtout, ils insistent sur le fait que ces expositions soient impulsées par des privés « sans scrupules » et des institutions publiques « sans projet » mettent en péril des œuvres uniques, dont la valeur artistique et financière est souvent extrêmement élevée.
Mais qui sont donc ces « privés sans scrupules » dont il a été fait mention à plusieurs reprises ? Parmi les responsables de cette situation, il y a, selon Montanari et Trione, des hommes comme Marco Goldin : mi-historien de l’art, mi-entrepreneur, mi-producteur, mi-manager, Goldin a inventé dans les années 90 un format d’exposition qui a connu un succès particulier. Depuis près de trente ans, il est à l’origine d’une ribambelle d’expositions qu’il décrit comme non-élitistes, faciles d’accès, dédiées à un public familial.
- Des artistes phares soigneusement choisis parmi les stars de l’art moderne, ou d’un mouvement ultra-populaire (les impressionnistes, de préférence)
- Des chefs d’œuvres à volonté, qu’importe la distance qu’ils devront parcourir
- Une thématique simple, si possible en rapport avec la nature (l’eau, l’or, la nuit, la neige…)
- Un prix d’entrée épicé (compter 15€ à 17€ pour une entrée adulte)
… Quitte à ce que le résultat laisse à première vue perplexe. On pense notamment ici à l’exposition « Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento » (« Toutânkhamon Caravage Van Gogh. Le soir et les nocturnes des Égyptiens au XXème siècle »), qu’a accueilli la Basilique palladienne de Vicence entre décembre 2014 et juin 2015. Les quelques photographies de l’exposition que l’on trouve sur le web témoignent d’une scénographie simple (les murs sont unis, la médiation écrite consiste à première vue en des blocs de texte justifiés), ce qui laisse à penser que le budget colossal engagé dans la conception de ces expositions serait absorbé par le prêt d’œuvres prestigieuses de grands maîtres (voir la photo ci-dessous).

Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento © domanipress.it
La critique de Montanari et Trione est acerbe, et extrême à de nombreux égards. D’un autre côté, placer un business-man comme Marco Goldin en position d’évangélisateur, prêt à tout pour porter l’Art à un large public serait peu à propos. Qu’il s’agisse de Montanari, de Trione, ou de Goldin, tous semblent réduire l’exposition à une simple monstration d’œuvres d’art. Et non des moindres, puisqu’il s’agit ici des « grandes œuvres de l’humanité » : des chefs d’œuvres ou rien !
Mais alors, quelle place y a-t-il pour les publics dans cette conception de la muséographie ?
Celle du porte-monnaie, en premier lieu. Même si, en regrettant le manque de fond de certaines expositions « blockbuster », les deux professeurs de l’université de Naples soulèvent un point important ; car ce n’est a priori pas le concept d’exposition « blockbuster » que Montanari et Trione rejettent, mais bien la vacuité du propos de certaines de ces expositions, qui ne poussent pas le visiteur à se questionner, qui ne l’accompagnent pas dans la découverte d’un sujet, d’un artiste, mais qui le placent simplement face à une œuvre considérée comme étant exceptionnelle, selon des critères qu’il peut d’ailleurs ne pas connaître. Il semble en effet que la médiation ne soit pas la priorité des commissaires de ces expositions, le travail sur les publics encore moins. D’ailleurs, la popularité de ces dernières repose parfois sur le prestige et la renommée de l’institution qui les accueille, comme c’est le cas pour le Vittoriano à Rome, qui bénéficie de sa position stratégique (juste derrière les forums impériaux) et qui ne propose, sauf erreur de ma part, pour seule programmation culturelle autour des expositions qu’il reçoit, que des visites guidées adaptées au public qui les suivra (et un atelier pour enfants d’une durée de deux heures, pour seulement l’une des deux grandes expositions qu’il accueille sur le moment).
En soi, l’exposition « blockbuster » peut être un outil ingénieux pour intéresser un public large. Concrètement, il n’y a aucun mal à organiser une exposition autour d’un grand nom de l’Histoire de l’art, ou d’une période appréciée du grand public ; bien au contraire, les « super-expositions » peuvent donner envie à des publics réticents de faire un premier pas fans le monde des musées. Utilisé à bon escient, ce type d’expositions peut constituer un moyen ludique et efficace de toucher un public diversifié, bien que l’on puisse regretter le fait qu’il s’inscrive dans une logique de démocratisation culturelle, et propose (impose ?) une perception verticale et très hiérarchisée de l’art. Là où le bât blesse, c’est que cette entreprise de démocratisation peut éclipser un autre phénomène : celui de la marchandisation artistique, qui pousse à évaluer le succès d’une exposition, ou de manière générale une manifestation culturelle, à sa fréquentation. Ainsi l’impératif de fréquentation pousse-t-il les institutions à penser l’exposition en termes de rentabilité, parfois au détriment de la construction d’un discours original sur un sujet. De même, ce phénomène pourrait laisser penser que seules les expositions présentant des pièces de maîtres sont dignes d’intérêt ; expositions présentées, les trois quarts du temps, par des institutions bénéficiant déjà d’une bonne visibilité au niveau national et international. Ainsi, ces « super-expositions », qui bénéficient de campagnes de communication soignées et dont la fréquentation n’en sera que meilleure, occultent des expositions plus petites, pourtant parfois plus pertinentes mais moins médiatisées, donc moins visitées, qui pourraient finir par être délaissées par le public. Finalement, ce sont moins la qualité de l’exposition et la pertinence de son discours qui attestent de la qualité de l’exposition que sa fréquentation et sa rentabilité.
Peut-être Marco Goldin devrait-il prendre exemple sur les « super-expositions » de sciences, qui utilisent la pop-culture pour faire passer un message scientifique à tous types de publics : on pense notamment ici à l’exposition Jurassic World à la Cité du Cinéma à Paris, où derrière les dinosaures géants se cachait un propos scientifique parfaitement vulgarisé, clair et accessible. Une exposition de chefs d’œuvre n’est pas toujours une « exposition chef d’œuvre »…
Solène Poch
#Blockbuster
#Beaux-arts
#Italie
Sources :
- Article « Tutankhamon Caravaggio Van Gogh a Vicenza. Mummie o mignotte purché sia notte » sur ArtsLife, consulté le 11 novembre 2018
- Article « Se il mostrismo fa male al museo » sur Il giornale dell’architettura consulté le 11 novembre 2018
http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2015/04/11/se-il-mostrismo-fa-male-al-museo/
- Article « Il pamphlet di Montanari e Trione. Le mostre sono i mostri dell’arte » sur Corriere della sera, consulté le 11 novembre 2018
- Article « Art : problématique des expositions blockbuster » sur Fastncurious, consulté le 13 novembre 2018
http://fastncurious.fr/asymetrie/exposition.html/
- Article « Un approccio idiota all'arte: a proposito delle mostre blockbuster » sur Finestre sull’arte, consulté le 14 novembre 2018
https://www.finestresullarte.info/309n_mostre-blockbuster-approccio-idiota-all-arte.php
Le XVIIIe, un siècle où l'on s'expose !
Paris met à l’honneur, cet automne 2015, les plaisirs raffinés du siècle des Lumières en exposant ses plus illustres artistes comme Fragonard, Louise Elisabeth Vigée-Lebrun et ses plaisirs matériels les plus exquis à travers le biscuit tendre de Sèvres et les boissons exotiques.
Scène pastorale, Höchst XVIIIe siècle © Rmn-GP
 Ce condensé de saveurs me conduit, en visitant ces expositions, à m’interroger : Pourquoi en tant qu’étudiante en muséologie puis-je sentir ce siècle comme proche de mes goûts et préoccupations professionnelles en matière d’exposition ?
Ce condensé de saveurs me conduit, en visitant ces expositions, à m’interroger : Pourquoi en tant qu’étudiante en muséologie puis-je sentir ce siècle comme proche de mes goûts et préoccupations professionnelles en matière d’exposition ?
Cette affinité se situe-t-elle du côté de tout ce qu’est et ce qui fait l’art au 18e : le raffinement, la délicatesse, le plaisir de vivre, le développement du jugement esthétique, l’apparition des salons, comme premières formes d’exposition et que sais-je encore ? C’est l’époque où l’individu prend de plus en plus de place au sein de la société. La vie devient une xercice de représentation, pour ne pas dire une exposition maitrisée de sa personne. A mon sens, l’idée que nous nous faisons de ce siècle a un lien à avoir avec l’univers expographique actuel ! Voyons les différents mediums qui à l’époque ont facilité cet exercice de représentation de soi.
A l’origine… le latin : Expono, is, ere, posui, positum !
Au 1ersens donné du terme, « exponere » signifie expliquer, présenter. Si on ledécompose, le « ex » renvoie à l’idée d’extériorité. « Ponere » tout seul (en dehors que c’est un composé de possum !) veut tout simplement dire poser. « Exponere » est donc l'action de mettre, situer, poser, installer en direction de l'extérieur. Cette idée s’inscrit donc dans une logique de monstration. Elle peut concerner les objets mais aussi les personnes. Comme verbe pronominal réfléchi, s’exposer exprime une action que le sujet fait sur lui-même…intéressant pour notre démonstration !
« S’exposer » c’est « mettre en péril »
Exposer ses propres idées sur un sujet tabou peut s’avérer dangereux…Pour l’exposition « Fragonard Amoureux, galant et libertin» au Musée du Luxembourg, le discours de l’exposition portait sur le traitement pictural des comportements amoureux, allant de la galanterie à l’érotisme. La section 7 du parcours montre au public comment le peintre a réussi à promouvoir dans son art une imagerie dite « licencieuse ». Les tableaux que nous pouvons voir actuellement au musée, résultaient à l’origine de commandes très privées, pour décorer les appartements de riches aristocrates. Ces initiatives restaient secrètes par peur du scandale.
Autre exemple : dans une partie de l’exposition « Louise Elisabeth Vigée-Lebrun » au Grand Palais, un tableau de 1783 représente la reine Marie Antoinette en robe de Gaulle, robe de gaze blanche légère qui était considérée comme indécente à l’époque. On sait que ce portrait de la reine a fait scandale au Louvre et que le tableau a aussitôt été retiré. Ainsi un tableau exposé au Salon peut mettre à mal la réputation de son peintre s’il a enfreint les codes établis.
Marie Antoinette en robe de mousseline dite en gaulle.1783Kronberg, © Rmn-Grand Palais
Une définition toujours d'actualité au XXIe !
« Exposer, c'estdéranger le visiteur dans son confort intellectuel ».
Jacques Hainard
Le portrait : exposer au sens moderne de la « théâtralisation ».
Point d’orgue de cette volonté de représentation de soi : l’art du portrait. Avoir son portrait permet de revendiquer sa position sociale. Louise Elisabeth Vigée Lebrun est une des plus illustres portraitistes de son temps qui s’attache à saisir la ressemblance de ses modèles tout en l’idéalisant. Ces portraits sont destinés à être diffusés. Ce sont des outils politiques.
Le portrait ne s’arrête pas qu’à la peinture ! L’exposition à la Manufacture de Sèvres « La sculpture de Louis XV à la Révolution » donne à voir les bustes des grandes personnalités en biscuit de porcelaine tendre. L’épisode révolutionnaire eut à cœur de mettre en valeur les défenseurs de la liberté et la production de médaillons sculptés permit de diffuser plus facilement les idées de la Révolution.
S’exposer par des objets, signes extérieurs de richesse
Vouloir exposer son goût pour le « beau » relève d’une mise en scène de son propre mode de vie, souvent souhaité comme modèle. C’est ce qu’illustre l’exposition « Thé, café ou chocolat » au musée Cognacq-Jay qui s’intéresse à un nouvel art de la sociabilité, celui des boissons exotiques. Des tableaux de François Boucher ou de Jean Siméon Chardin nous permettent de comprendre que ces boissons servies dans un apparat de luxe participaient activement à l’exercice de représentation de soi.
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet
Exposer, c’est raconter une histoire, expliquer, faire connaitre…
Cette définition se rapproche plus de celle que l’on connait, dans son acceptation muséale actuelle. L’exposition est un récit espace-temps que l’on a matérialisé et que l’on offre à la vue et à la critique du public. Le discours choisi pour l’exposition sur Elisabeth Vigée-Lebrun est en cela très évocateur puisqu’il s’agit d’une rétrospective visant à réunir les plus belles productions picturales de l’artiste. Cette exposition est organisée comme un livre où le récit est ponctué par divers chapitres. On nous raconte la fabuleuse destinée de cette femme peintre, de ses débuts de formation à sa consécration auprès de la famille royale à Versailles et des cours européennes.
Le pan de mur "1789" divisant l'exposition en deux © Sandra pain
Le cheminement séquentiel est marqué au milieu par la rupture symbolique, à la fois scénographique et historique de 1789. Cette date marque ici la frontière psychique et mentale, le passage vers un autre monde, comme le IIèmetome de sa vie.
Du latin à aujourd’hui, quels sens pour ce geste d’exposer ?
Que de définitions juxtaposées et de significations multiples autour de la notion d’exposition ! Prendre les différentes visions que l’on a de l’exposition du 18e pour les confronter et les confondre avec celles du 21e… est une démarcheque j’ai voulu vous proposer pour rendre à l’exposition sa polysémie, elle qui est tout à la fois monstration, mise en scène des objets, théâtralisation de soi, mise en péril, histoire, déduction de faits…et que sais-je encore ? Et vous, quelle est votre définition personnelle de l’exposition ?
A mes yeux, au-delà de tous les aspects techniques qu’elle peut revêtir aujourd’hui, l’exposition est la mise en forme et en action d’une pensée à transmettre. Elle est ce qui nous renvoie à notre humanité puisqu’elle nous permet de réfléchir sur des sujets qui nous tiennent à cœur.
Sandra Pain
Pour en savoir plus, le site de l'exposition de la portraitiste au RMN-GP :
http://www.grandpalais.fr/fr/article/elisabeth-louise-vigee-le-brun-toute-lexpo
# louise-elisabeth-vigée-lebrun
# biscuit de porcelaine
# fragonard

Le(s) rôle(s) de l’architecture pour un musée
L’intérêt est souvent porté sur ce qui se passe à l’intérieur des musées, sur les expositions et leur scénographie. Pourtant, un musée c’est avant tout un bâtiment. S’intéresser au bâti d’une institution culturelle et à son architecture, c’est en apprendre plus sur son histoire, sur le lieu et ses ambitions. Comment concilier un programme muséographique avec un programme architectural ? Quelle est l’importance du bâti dans la vie d’une institution ? L’architecture muséal a beaucoup à nous dire !
Image d'intro : La cité du vin, Bordeaux © Manon Deboes
L’architecture : un outil-message pour les musées.
La façade est ce que les publics aperçoivent en premier. Elle est la grande vitrine du musée qui donne sur la ville et elle dit beaucoup de choses... ou parfois rien du tout ! C’est là que s'opposent des architectures considérées comme plus contemporaines aux bâtiments d’origine plus ancienne. L’aspect extérieur du musée peut être en corrélation avec ce qui est exposé à l’intérieur. Le classicisme d’une façade peut alors nous indiquer la teneur des collections que renferment ses murs. Les musées des Beaux-arts sont effectivement le plus souvent au cœur d’architecture basée sur la symétrie typique du classicisme romain auquel s'ajoutent des influences du baroque français et italien. Ce n’est pas pour rien que ce style se nomme l’architecture des Beaux-Arts !

Vincent VALENTIN, © BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
A contrario, les publics peuvent être moins enclins à deviner ce qui se cache derrière les murs de certaines institutions à l’architecture plus contemporaine. Les exemples ne manquent pas en France et à travers le monde. L’architecture moderne des institutions comme le Frac MECA à Bordeaux, la Cité du vin à Bordeaux, le Centre Pompidou-Metz et bien d’autres, ne permet pas d’affirmer sa fonction d’un simple coup d'œil. Ces édifices attirent néanmoins le regard par leur forme atypique et invitent à en découvrir plus. De fait, depuis quelques années, les nombreux musées à l’architecture contemporaine qui voient le jour tentent d’attirer de nouveaux visiteurs et visiteuses, en misant sur des expositions et des événements inédits mais aussi sur l’aspect remarquable de leur architecture. Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou à Paris, ouvert en 1977, traduit bien cette volonté. C’est d’ailleurs l’un des premiers musées à avoir misé son attractivité sur l’aspect extérieur du bâtiment. Pari réussi, puisqu’aujourd’hui les publics viennent en nombre voir ce musée à l’architecture originale où tous les éléments de circulation sont visibles de l’extérieur. L’importance du bâti dans la vie du musée est manifeste lorsqu’il devient l’emblème d’une ville. A Paris, le Centre Pompidou est effectivement devenu un incontournable. L’architecture peut ainsi jouer sur la réputation et la fréquentation d’une institution en devenant un outil diffusant le message d’une ville tournée vers la culture. L’exemple mondialement connu reste le musée Guggenheim à Bilbao, qui a ouvert ses portes aux publics en 1997. C’est autant son architecture sculpturale et spectaculaire qui fait parler de lui que son architecte reconnu dans le monde entier : Frank Gehry.

Naotake Murayama from San Francisco, CA, USA, © BY 2.0 via Wikimedia Commons
L’architecture du musée devient une œuvre à part entière et le musée mise aussi sur la notoriété de son.sa créateur.ice. Cette tendance à se tourner vers les “starchitectes” s’explique alors par cette volonté de devenir le nouvel emblème d’une ville et de marcher sur les pas de “l’effet Bilbao”. Cette architecture atypique a permis de redynamiser l’ancienne cité portuaire industrielle de cette ville du Nord de l’Espagne. C’est dans cette optique d’édifier un nouveau pôle culturel attractif dans des quartiers sur le déclin que certaines villes misent sur cet “effet Bilbao”. Parmi les exemples les plus connus en France, le Louvre-Lens en 2012, le Mucem à Marseille l’année suivante et le musée des Confluences à Lyon en 2014.
La programmation : un défi architectural et muséographique.
La lisibilité de l’architecture d’un musée a tout autant son importance de l'extérieur - pour diffuser le message d’une ville culturellement dynamique - qu’à l’intérieur. Comme le souligne Kali Tzortzi, la forme architecturale et spatiale d’un musée influe sur l’expérience de visite des publics.1. Or, si ces derniers rencontrent des difficultés à se déplacer, à comprendre la distribution des différents espaces, leur visite en sera forcément impactée. D’autant plus qu’au cours de ces 20 dernières années, certains musées se sont vu doter de nouveaux espaces. Ces derniers ne répondent pas aux missions de conservation, de recherche et de documentation de ces institutions mais viennent assurer d’autres besoins auxquels les établissements recevant du public font face. Ce sont des espaces de services tels que les cafétérias, les boutiques et les lieux de repos. Ils demandent ainsi une distribution de l’espace que les architectes de musées doivent prendre en compte. Bien que la signalétique ait aussi un rôle à jouer, la gestion des flux et de création d’espace aux fonctions bien définies doit être pensée en amont et donc prise en compte dans le programme architectural.
La programmation architecturale - dans la construction d’un musée ou de tout autre bâtiment - est un document qui vient décrire le projet pour que l’équipe de maîtrise d'œuvre - l’architecte ou l’agence d’architecture - puisse bien comprendre la demande. Elle rappelle les enjeux et besoins du ou des commanditaires, appelés aussi maîtres d’ouvrage, dans ce cas-ci le musée. C’est la ligne de conduite à ne pas perdre de vue pendant toute la durée du chantier, tout en respectant le programme muséographique.
Dans le cas de la création d’un nouveau musée, la programmation architecturale doit prendre en compte les enjeux du programme muséographique et tenter de répondre à ses besoins. Le programme muséographique, au même titre que la programmation architecturale, vient définir les contenus du ou des parcours d’exposition en s’appuyant sur le projet scientifique et culturel (PSC). Ce dernier décrit quant à lui, l’identité et les grandes orientations du musée. Tous ces documents sont nécessairement produits en amont des lancements du chantier.
Le fait de sortir entièrement un bâtiment, un nouveau musée de terre demande, en effet, une grande organisation - et de nombreuses études et documents au préalable - pour bien définir les besoins et enjeux du projet. Pour cela, il importe de bien comprendre les rôles de chacun des corps de métier qui interviennent et interviendront dans le projet pour les coordonner au mieux aux différentes étapes.
Les métiers de la muséographie, de la conservation préventive et de la muséologie sont des domaines spécialisés dont les enjeux sont peu compréhensibles aux non-initiés. Comme cela peut être le cas dans le milieu de la construction et du bâtiment. Cette méconnaissance entre les exigences architecturales et les besoins muséologiques se voit renforcée par l’usage d’un vocabulaire propre à chaque discipline débouchant généralement sur des difficultés de communication. Ce n’est néanmoins pas une fatalité. Cette difficulté peut être évitée avec une bonne préparation en amont des programmes muséographique et architectural qui définissent avec précision les besoins de chacun. Bien que chaque projet soit unique, cela offrira une meilleure compréhension afin de travailler en harmonie dans la réalisation.
Ces chantiers lancés quelques années après la fin des derniers ne sont parfois pas un problème de coordination entre le programme architectural et muséographique, entre les équipes de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d’ouvrage. Ils répondent aux constantes évolutions des musées et de leurs objectifs. Comme le souligne l’architecte, scénographe, Adeline Rispal, la pérennité d’un projet architectural et muséographique ne peut être possible qu’à condition que ce dernier réponde « (...) à la variabilité des contenus et donc en organisant la flexibilité des installations pour en permettre l’adaptation régulière aux fruits de la recherche scientifique. »2.
Cependant, cette prouesse architecturale et muséographique n’est pas toujours possible. Notamment quand les musées sont implantés dans des monuments classés qui sont régis par de nombreuses protections. Les sites classés font les frais d’une politique de patrimonialisation, qui vise à « figer » un bâtiment, ralentissant de ce fait les ambitions de bon nombre d’institutions. Selon le point de vue, cela les pousse aussi à redoubler de créativité pour atteindre leurs objectifs.
Les besoins des musées évoluent constamment, parfois liés aux envies des publics toujours avides de nouvelles découvertes d’offres muséales. Cette mutation mène parfois à une muséographie et une scénographie vite obsolète au point que l’institution doit se remettre au goût du jour, voire être rénovée.
Qu’il soit ancien, de forme classique, plus contemporain et source de modernité et d’expérimentation, le bâti occupe une place importante dans la vie de l’institution. Cela est le cas autant d’un point de vue extérieur qu’intérieur. L’architecture d’un musée, par sa distribution des espaces, est la traduction directe de son projet culturel et scientifique. Que le bâti soit protégé par son statut, ou qu’il soit l’objet d’un chantier de rénovation, il est l’enveloppe d’une ambition scientifique et culturelle à l’échelle de l’institution et d’une ville.
Manon Deboes
Références :
1.Interroger le rôle de l’espace dans le musée, Tzortzi Kali, La Lettre de l’OCIM, n°169, 2017, p. 12-18 ↩
2.Rispal, Adeline., « L’architecture et la muséographie comme médiation sensible ». Muséologies, 3(2), 2009, 90–101. ↩
#Architecture #Programmationarchitecturale #Musées

Les « Tableaux Fantômes » du musée Benoît-de-Puydt
Il est coutumier pour les musées d’exposer un évènement passé, une tradition oubliée, des techniques ou savoirs faires anciens, une période révolue ou méconnue… En revanche, matérialiser des œuvres d’art disparues est bien moins fréquent. Le musée Benoît-De-Puydt a pourtant choisi de consacrer une partie de son parcours permanent aux « Tableaux Fantômes », détruits lors de la Première Guerre mondiale…
Image d'introduction : Des tableaux fantômes ? © Doriane Blin
Un bref historique du musée
Benoît-De-Puydt naît en 1782 et décède à Bailleul en 1859. Riche collectionneur, il détient une importante collection d’art, de cabinets de curiosités et de céramiques. N’ayant aucun héritier, il lègue l’entièreté de sa collection ainsi que sa maison à la ville de Bailleul. Et ce, sous deux conditions, la première : créer une académie de dessin, de peinture et d’architecture, la seconde : que l’on donne une messe en son honneur tous les ans. Ses prescriptions seront respectées : l’académie et le musée ouvrent en 1861. Grâce au legs de Louis- Henri Hans, de nouvelles œuvres intègrent les collections du musée. Edward Swynghedauw, conservateur du musée de 1881 à 1912, effectue un travail d’inventaire particulièrement précis. Il décrit avec minutie les 133 œuvres de ce legs et référence leurs dimensions exactes.
Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La ville de Bailleul, non loin du front, est géographiquement inquiétée par les offensives allemandes. Cependant, durant les trois premières années de conflit, le musée continue d’accueillir des visiteurs. Ce n’est qu’en 1918 que la population fuit Bailleul et laisse la ville uniquement peuplée de soldats. Le musée est alors contraint de fermer ses portes. En février 1918, le lieutenant Fernand Sabbaté est dépêché par le Service de protection des œuvres d’arts du front Nord pour faire état de la situation. Il décide d’évacuer la collection. Fernand Sabbaté revient avec seulement deux camions pour évacuer les œuvres. A l’époque, le bois manque pour réaliser les caisses de transport. Il est impossible de sauver l’entièreté de la collection. Priorité est donnée notamment aux cabinets flamands, tandis que d’autres œuvres restent sur place et connaitront leur perte le 22 mars 1918 lors du bombardement de la ville. Le musée est intégralement détruit. Outre les œuvres pillées, celles restées sur place ne sont plus que décombres parmi les ruines du bâti. Après une évaluation des dommages de guerre, il est question de trouver un nouveau lieu pour accueillir les œuvres sauvées, évaluées entre 10 et 20% du total de la collection initiale.
Le musée Benoît-De-Puydt est aujourd’hui installé dans un bâtiment reconstruit par Maurice Dupire, au même emplacement que l’ancien musée.

La façade du musée aujourd’hui © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Exposer des « Tableaux Fantômes » ou redonner vie à des œuvres disparues
L’histoire du musée Benoît-De-Puydt ne s’arrête pas là. A partir de l’inventaire d’Edward Swynghedauw retrouvé en 1990, Laurent Guillaut propose d’exposer les œuvres disparues : il fait écrire sur des panneaux de mêmes dimensions que les œuvres originelles, leur description, telle une incarnation de leur disparition. Ces « Tableaux Fantômes » prennent alors place aux côtés d’autres ayant pu être conservés.

Salle des « Tableaux Fantômes » © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Comment expliquer ce choix d’exposer le disparu ? Nous avons interviewé Chloé Jacqmart, chargée de développement et des publics au musée Benoît-De-Puydt.
Pouvez-vous commenter l’initiative d’exposer les « Tableaux Fantômes » dans le musée ? Quel message y-a-t-il derrière cet accrochage ? Quel parti-pris muséographique ?
Chloé Jacqmart : L'initiative est celle de Laurent Guillaut, conservateur des musées Benoît-De-Puydt et de Cassel entre 1991 et 2000.
Cette démarche avait notamment pour volonté de marquer l'histoire de la Grande-Guerre dans un musée reconstitué à l'image d'une maison de collectionneur. Au sein d'un musée dont les espaces de présentation des collections rappellent celui d'un intérieur bourgeois du XIXe, les « Tableaux Fantômes » rappellent l'histoire plus contemporaine et l'impact non seulement sur les collections, mais sur la ville et le territoire. Le parti-pris muséographique est celui d'un intérieur de maison de collectionneur reconstitué, mais également réinventé. Les descriptions des œuvres disparues ne sont pas seulement visibles du public, elles sont présentées comme pourraient l'être les œuvres si elles faisaient encore partie du fonds. Elles n'accompagnent pas les collections, elles incarnent les collections.
C'est également, de manière peut-être plus indirecte, une manière de mettre en lumière le travail exceptionnel de description réalisé par Edward Swynghedauw, second conservateur du musée et directeur de l'Académie de peinture, dessin et architecture Benoît-De-Puydt, qui maîtrisait aussi bien la plume que le crayon. Il décrit les objets du musée tel un naturaliste, et c'est une approche scientifique et méthodique des collections à un instant T dont les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui le témoin.
« Sur une pelouse, devant un épais massif de verdure, près d’un piédestal surmonté d’un grand vase de fleurs et qui occupe le premier plan de droite parmi des fleurs variées, tout un groupe de petits garçons, au nombre de neuf, s’amusent à faire monter un ballon que l’un d’entre eux tient par la ficelle. Devant celui-ci un petit chien blanc taché de brun aboie après le joujou qui est de diverses couleurs et qui a le don d’amuser singulièrement ces enfants. »
Description de l’une des œuvres aujourd’hui disparue par Edward Swynghedauw
Comment se nomme la salle dans laquelle se trouvent les « Tableaux Fantômes » ?
C. J. : Cette salle n'a pas de nom en particulier, si ce n'est salle B, mais il s'agit d'un repère pour le parcours de visite. En revanche la situation du mur qui présente les « Tableaux Fantômes » au rez-de-chaussée fait partie intégrante du parti pris muséographique de l'ensemble de ce niveau, à savoir une immersion au cœur d’un musée de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. La naissance du concept des « Tableaux Fantômes » est certes postérieure à ce type de muséographie mais la collection concernée fait partie du fonds antérieur au conflit de 14-18, et de fait l'incarnation de la disparition fait sens dans cet espace musée-maison de collectionneur réinventé.
Le nombre de tableaux disparus est considérable. Savez-vous pourquoi ceux exposés ont été choisis ?
C. J. : Pour ce qui est des œuvres exposées sur le mur présentant les « Tableaux Fantômes », le choix s'explique dès l'origine du projet. Le choix de Laurent Guillaut se porte sur le Legs Louis-Henri Hans (1879), constitué d'une centaine d'objets et dont il reste après la guerre seulement 5 tableaux et 1 bénitier en ivoire. Les notices incarnant les « Tableaux Fantômes » sont une partie des œuvres de ce legs.
Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer sur le choix de M. Guillaut, mais à mon sens cet ensemble renforce le propos et le message en ce qu'il représente l'importance de la disparition en s'appuyant sur une partie de la collection : les 6 objets sauvés face à la centaine initialement léguée et présentée au sein du musée avant 1918 illustrent particulièrement bien l'ampleur des pertes subies.
Que vous évoque, personnellement, ce choix d’exposer « matériellement » le disparu, la perte ?
C. J. : Au même titre que de nombreux ensembles, monuments, commémorations, etc. qui découlent de la Grande-Guerre, les « Tableaux Fantômes » contribuent au travail de mémoire, leur existence directement due à cet événement. Ce choix d'exposer est également à mon sens une forme de représentation de ce qu'est un musée, de son rôle : au-delà de la fonction de conservation, il interroge la place et la trace des objets. Lieu de délectation le musée est aussi un lieu de réflexion qui se doit d'interroger l'évolution des sociétés dont il conserve les vestiges.
Les « Tableaux Fantômes » font prendre une toute autre dimension aux œuvres disparues et en modifient le statut, et de fait le rapport qu'elles ont avec le spectateur. Mais bien qu'elles ne soient plus visibles, ces œuvres disparues conservent un rapport avec l'esthétisme, créé par l'ensemble des impressions graphiques présentées comme des œuvres, et à travers l'imagination suscitée par les descriptions. Le rapport à l'image est différent mais toujours présent.
Les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui une étape incontournable de la visite et font partie intégrante du parcours permanent du musée. Outre les témoins et marqueurs de l'histoire du musée, ces « Tableaux Fantômes » font aujourd'hui partie de son identité, et de l'expérience qu'il fait vivre à ses publics.
Ce choix muséographique provoque-t-il des réactions de la part des visiteurs ? Si oui, quelles sont-elles ?
C. J. : Les visiteurs sont très souvent intrigués par cette présentation et, curieux d'en savoir plus, ils apprécient d'échanger avec la personne assurant l'accueil ou les médiateurs présents. Éclairés sur l'histoire du musée, ils appréhendent différemment les lieux et les collections.
Une réinterprétation par des artistes contemporains
Non seulement les « Tableaux Fantômes » deviennent eux-mêmes des objets de collection en ce qu’ils sont exposés ainsi au sein du musée, mais ils deviennent support à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire. Sur l’initiative de Luc Hossepied, en 2018 – centenaire de la Grande Guerre - des artistes contemporains réinterprètent les tableaux et donnent naissance à de nouvelles œuvres d’art. Valorisées à l’occasion de l’exposition itinérante intitulée « Les Tableaux Fantômes » à travers les Hauts-de- France, les œuvres ont été accueillies dans 8 institutions, parmi elles : la médiathèque de Bailleul, le Muba, la Bibliothèque du Fort-de-Mons ou encore la Piscine de Roubaix… Les visiteurs ont pu admirer 91 créations contemporaines toutes inspirées des précieuses descriptions d’Edward Swynghedauw et respectant le format des œuvres initiales. Le commissariat de cette exposition a été assuré par Luc Hossepied, Eric Rigollaud, Nicolas Tourte et Sylvette Botella-Gaudichon.
Comment est né le projet de réinterprétation de ces œuvres par des artistes contemporains ? Que cela signifie-t-il pour le musée et pour la ville de Bailleul ?
C. J. : Le projet a été imaginé et initié par des acteurs extérieurs au musée, preuve non seulement que le concept et l'histoire des « Tableaux Fantômes » laissent difficilement indifférent mais qu'il inspire et invite à réfléchir, réagir, et créer.
C'est aussi une forme de manifestation de l'appropriation de notre Histoire contemporaine sous forme de création artistique, via les différentes empreintes qu'elle laisse et qu'elle invite à explorer. La création, l'interprétation et la réinterprétation se mêlent et contribuent à écrire l'histoire du musée et de la création artistique.
Se rencontrent ici des écoles artistiques, des pratiques artistiques, des contextes de créations, des inspirations, etc. L'art est constamment en mouvement et rarement (voire jamais) en rupture totale avec le passé, et une histoire comme celle des « Tableaux Fantômes » écrit une histoire de l'art à travers le temps.
Il ne s'agissait pas de combler un manque mais bien d'écrire une nouvelle histoire en s'inspirant de ce qui a été. Pour le musée, ces œuvres contemporaines symbolisent le lien entre création artistique et patrimoine. Elles sont également une nouvelle page de l'histoire des œuvres disparues et de l'histoire du musée.
Nous remercions Chloé Jacqmart pour son éclairage sur l’histoire des collections du Musée Benoît-De-Puydt qui continue de s’écrire.
Pour aller plus loin :
- Le site internet du musée : https://www.musee-bailleul.fr/
- Cloé Alriquet, plateforme des médiations muséales : http://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/salle-des-tableaux-fantomes
- Reportage de France 3 : les tableaux fantômes, exposés à la Piscine de Roubaix : https://www.youtube.com/watch?v=JicI_9qypnI&ab_channel=France3Hauts-de-France
#TableauxFantômes #Benoît-De-Puydt #Bailleul

Les enjeux de l'architecture muséale
Lorsque l’évènement est éphémère, tel qu’un colloque ou une exposition temporaire, les traces peuvent se manifester sous différentes formes. La mémoire de l’exposition se fera à travers son catalogue, un colloque peut faire de même en éditant les actes de la manifestation. Ces ouvrages permettent aux personnes présentes comme à celles n’ayant eu la possibilité de s’y rendre ou ayant eu vent de la rencontre après sa date effective, de découvrir ou compléter les réflexions abordées.
Les textes réunis dans « Architecture et musée » sont les actes d’un colloque organisé au Musée Royal de Mariemont en janvier 1998. L’ouvrage en question m’a donc permis de revivre la rencontre par la lecture attentive des articles débattant sur une question qui m’interpelle : « le bâtiment muséal, aujourd’hui, doit-il apparaitre comme une simple « coque » servant de réceptacle minimaliste aux pièces exposées ; ou bien, tout au contraire, la structure architecturale du musée doit-elle devenir œuvre à son tour, au risque d’interférer dangereusement avec les autres œuvres présentées en son sein ? ».
 L’ouvrage, à son grand avantage, regroupe un panel d’acteurs de la sphère muséale. Spécialistes et hommes de terrains, ceux-ci sont issus de formations diverses : conservateurs, historiens, architectes, muséologues (théoricienet praticiens), critiques et gestionnaires culturels, ce qui permet d’aborder la question sous divers angles, confrontant les points de vues professionnels. Certains textes abordent une réflexion sur un thème particulier comme « Sustainable Museum, les musées de demain », « de la nécessité d’une architecture muséologique », « surface d’exposition ou espaced’exposition : lorsque la muséographie fait place à la muséologie », « si le musée sortait de ses pompes ! », d’autres textes traitent de thèmes précis comme « le message et l’image », « œuvre et lieu », « muséographie et design de communication ». D’autres encore abordent des cas précis d’architecture muséale locale et internationale de Louvain-la-Neuve, Liège, Gand et Bruxelles à Saint-Etienne, Aix-la-Chapelle, Péronne, Copenhague, Québec, … L’ouvrage aborde peu la problématique de l’institution prenant place dans un bâtiment ancien. Étant forcément soumis aux difficultés de conservations, d’entretien, de restriction liées au bâtiment, accentuées si celui-ci est classé, ce cas de figure peut faire l’objet d’un colloque dans sa totalité.
L’ouvrage, à son grand avantage, regroupe un panel d’acteurs de la sphère muséale. Spécialistes et hommes de terrains, ceux-ci sont issus de formations diverses : conservateurs, historiens, architectes, muséologues (théoricienet praticiens), critiques et gestionnaires culturels, ce qui permet d’aborder la question sous divers angles, confrontant les points de vues professionnels. Certains textes abordent une réflexion sur un thème particulier comme « Sustainable Museum, les musées de demain », « de la nécessité d’une architecture muséologique », « surface d’exposition ou espaced’exposition : lorsque la muséographie fait place à la muséologie », « si le musée sortait de ses pompes ! », d’autres textes traitent de thèmes précis comme « le message et l’image », « œuvre et lieu », « muséographie et design de communication ». D’autres encore abordent des cas précis d’architecture muséale locale et internationale de Louvain-la-Neuve, Liège, Gand et Bruxelles à Saint-Etienne, Aix-la-Chapelle, Péronne, Copenhague, Québec, … L’ouvrage aborde peu la problématique de l’institution prenant place dans un bâtiment ancien. Étant forcément soumis aux difficultés de conservations, d’entretien, de restriction liées au bâtiment, accentuées si celui-ci est classé, ce cas de figure peut faire l’objet d’un colloque dans sa totalité.
Couverture de Architecture et Musée
Un atelier d'architecture
Avant de détailler quelque peu le contenu de l’ouvrage, il me semble important depréciser le cadre dans lequel s’est développé le colloque. Deux professeurs de l’institut supérieur d’architecture de Tournai, Pierre Coussement et Michel Dussart, sont à l’initiative du projet. Dans le cadre de leur atelier d’architecture pour les quatrièmes années, ils ont proposés aux membres du musée de Mariemont de réfléchir ensemble à de nouvelles implantations, extensions du musée. Suite à l’exercice, une exposition a pris lieu au deuxième étage du musée, intitulée Muséofolie,relatant une douzaine de réponses graphiques, créatives et imaginatives, présentées sous forme de plans détaillés, maquettes, dessins d’architecture et vidéos expliquant la nature et les caractéristiques des projets d’étudiants. Cet exercice est à admirer car, ayant moi-même étudié l’architecture, le même travail est effectué dans d’autres écoles sans sortir de l’atelier, impliquant un manque d’échange avec les théoriciens du monde muséal et les professionnels ou sans aller à la rencontre des visiteurs réguliers.
Le texte de Philippe Samyn, figure majeure de l’architecture belge aujourd’hui,énonce que le rôle de l’architecte est de répondre à la demande du maître d’ouvrage, des pouvoirs publics, municipalités… en apportant sa vision, ses critères et son expérience. L’architecture des nouveaux musées, quelques fois relevant de la folie, de l’ambition s’avèrent être parfois de grandes boites vides extrêmement coûteuses à l’usage. L’architecte se doit de répondre aussi à ce critère en pensant aux frais d’entretien et de maintenance que devront assumer par la suite les collectivités. Jean Barthélémy, professeur à l’école polytechnique de Mons, relève aussi dans son texte la question d’une architecture muséale spectaculaire conduisant quelques fois à des dérives « dans la mesure où le souci de remporter la course à la notoriété l’emporteraient sur l’authenticité de la recherche ».
Une architecture pour les visiteurs
La principale question du colloque aborde la problématique de l’édification muséale en relevant les relations parfois difficiles entre les œuvres et les bâtiments qui les abritent. Une autre donnée semble importante et revient dans divers articles de l’ouvrage, dont celui d’André Juneau, directeur de la recherche et de la conservation au musée de la Civilisation à Québec. L’architecte ne peut concevoir un édifice muséal sans avoir une idée de qui un jour viendra le fréquenter ponctuellement ou régulièrement : donc connaître les publics potentiels, leurs gouts, leurs attentes, leurs pratiques. Les équipements muséologiques doivent être conçus comme des lieux de rencontre, de découverte, de réflexion, d’apprentissage, de loisir ; « un endroit privilégié dans nos sociétés modernes pour la médiation, la communication, la compréhension entre les peuples ». Les planificateurs ne devraient-il dès lors pas penser les musées comme des espaces de rencontre et non comme des lieux d’exposition ? « Le musée doit ressembler à la vie puisqu’il veut en être le reflet au passé et au présent ».
Les réflexions abordées dans l’ouvrage édité en 2001 restent d’actualité. L’institution muséale soulève encore bien des questionnements. Dans moins d’un mois, nous vivrons l’ouverture d’un grand musée en province, l’arrivée du Louvre à Lens relève aujourd’hui divers défis. Ce musée ressemblera-t-il à la vie ? Un musée comme acteur social, lieu d’interaction et d’expertise. Ce musée, vu par ses concepteurs comme « nouveau modèle » de par son architecture et sa programmation, arrivera-t-il à dépasser une attitude, une pensée à son égard, perçue comme « pyramide des temps passés » ?
Clara Louppe

Les Pokémon débarquent au musée Van Gogh
Quand Pikachu rencontre le maître néerlandais…
Pokémon x Van Gogh Museum presentation ©Sven Mooij
Que se passe-t-il au musée Van Gogh ?
Pour célébrer son 50e anniversaire, le musée Van Gogh d'Amsterdam a collaboré avec la franchise Pokémon créant une exposition inédite : L’aventure Pokémon, un jeu de piste qui permet aux visiteurs de découvrir les chefs-d'œuvre de Vincent Van Gogh à travers le prisme des Pokémon.
Créée par Satoshi Tajiri, créateur et producteur de jeux vidéo japonnais, en 1995, Pokémon est une franchise japonaise de jeux vidéo, de cartes à collectionner, d'animes, de mangas et de jouets. Les Pokémon sont des créatures fictives, souvent anthropomorphes, qui possèdent des pouvoirs et des capacités uniques. Ils sont répartis en plusieurs types, chacun ayant ses propres forces et faiblesses, une des créatures les plus connues n’est autre que Pikachu, une petite souris jaune pouvant manier l’électricité.
Trois célèbres illustrateurs du jeu de cartes Pokémon ont participé à cette campagne, créant des réinterprétations originales des œuvres de Van Gogh. Pikachu inspiré par l'Autoportrait au chapeau de feutre, Héliotronc dans Les Tournesols et Goinfrex Ronflex dans la Chambre à coucher sont quelques-uns des exemples de ces illustrations.

Pikachu inspired by Self-Portrait with Grey Felt Hat, Naoyo Kimura (1960), The Pokémon CompanyInternational.
Sunflora inspired by Sunflowers, 2022, Tomokazu Komiya (1973), The Pokémon Company International
Munchlax & Snorlax inspired by The Bedroom, sowsow (1988), The Pokémon Company International
Lors de la seconde édition de l’Open Museum du Palais des Beaux-Arts de Lille, en 2015, des réinterprétations d’œuvres iconiques étaient réalisées par le collectif InterDuck. Ainsi, les visiteurs pouvaient apprécier Le Canard à la Perle ou encore le sarcophage du roi Duckamon Ier, version affublée d’un bec à la Donald Duck. Les réinterprétations d’œuvres d’art permettent d’attirer de nouveaux visiteurs. C’est en intégrant la pop-culture que les musées tentent de rajeunir leur image. L’Open Museum est une initiative lancée par le Palais des Beaux-Arts de Lille, en 2014, qui a pour objectif d’offrir une nouvelle expérience à son public. Cette année, pour sa 8e édition, l’institution a intégré dans son parcours la thématique des jeux vidéo, questionnant à nouveau le rapport entre le musée et une entreprise commerciale, dans ce cas précis les deux studios Ankama et Spiders.

Sarcophage du roi Duckamon Ier par InterDuck - M.Libert / 20 Minutes
Le Canard à la Perle, réinterprétation de La Jeune fille à la perle de J. Vermeer, par InterDuck
Affiche de la seconde édition de l’Open Museum du Palais des Beaux-Arts de Lille mettant en avant les artistes du collectif allemand InterDuck. 10 avril - 05 juillet 2015
Mais pourquoi avoir choisi la franchise ?
Emilie Gordenker, directrice générale du musée, affirme dans un communiqué de presse que ce choix n’est pas anodin. L’influence de l'art japonais sur Van Gogh est indéniable. Ses estampes japonaises, avec leurs couleurs vives, leurs compositions innovantes et leurs représentations de la nature et de la vie quotidienne, ont laissé une empreinte indélébile sur l’artiste : Les Tournesols et La Nuit étoilée.
Comment s’interprète cette collaboration ?
Le musée Van Gogh a créé le parcours L’Aventure Pokémon dans un but éducatif, destiné aux enfants de six ans et plus. Grâce à un livret fourni par le musée, disponible en néerlandais, anglais, espagnol, français et italien, les visiteurs sont guidés à travers les chefs-d’œuvre emblématiques de Vincent Van Gogh qui ont inspiré les illustrateurs de la franchise Pokémon. Par le biais de ce jeu de piste, le public est immergé dans les histoires cachées des œuvres majeures. Une fois le livret complété, une surprise attend chaque visiteur : une carte Pokémon exclusive représentant la réinterprétation de Pikachu par Naoyo Kimura.
Une variété d'activités sont offertes, allant de cours de dessin visant à capturer le style graphique Pokémon à des leçons adaptées aux élèves de fin de primaire et de début de collège. Ces cours sont également accessibles en ligne via la plateforme Van Gogh at School. Cette collaboration se manifeste également dans ses aspects marketing à travers la vente de produits dérivés exclusifs, destinés tant aux visiteurs qu'aux fans de la franchise. Parmi ces produits : des cartes postales classiques, des affiches, des crayons et des stylos ornés de l'univers de Pokémon.
Une collaboration victime de son succès
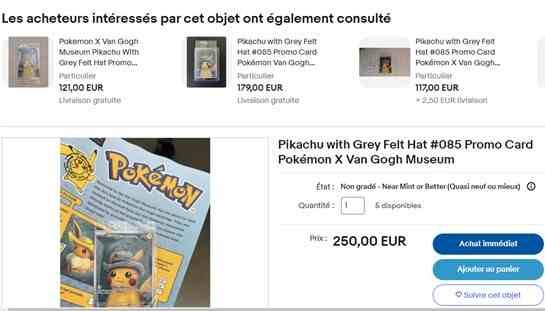
Capture d’écran du site eBay hébergeant des reventes de la carte exclusive de Pikachu au chapeau de feutre gris, 25 octobre 2023 ©E. LAVERDURE
L'initiative a suscité une diffusion massive à travers les plateformes de médias sociaux, précipitant ainsi une déferlante de fans en direction du musée Van Gogh. L’objet de toutes les convoitises était la carte exclusive de Pikachu, offerte aux visiteurs qui se prêtaient au jeu de piste. Cette carte a engendré des attroupements chaotiques au sein du musée, où des amateurs de cartes Pokémon se sont précipités sans ordre établi pour mettre la main sur ces objets tant désirés, comme l’attestent les vidéos postées par des visiteurs sur les réseaux sociaux.
En l'espace de quelques jours seulement, cette carte ainsi que la plupart des produits dérivés ont été épuisés. Le musée s'est trouvé dans l'incapacité de gérer l'engouement suscité. En conséquence, l'institution a dû annoncer l'interruption de la distribution de la carte la rendant d’autant plus rare. Cette situation a déclenché des spéculations, la carte, qui était initialement offerte, se négocie désormais aux alentours de 200 euros.
Quelle conclusion ?
Ce cas constitue une illustration révélatrice des contraintes inhérentes aux partenariats entre certaines institutions culturelles et des entreprises internationales. Ce projet, initialement conçu avec des objectifs éducatifs novateurs et étayé par un programme de médiation particulièrement élaboré, a transformé le musée Van Gogh en un lieu de divertissement.
Le musée Van Gogh avait déjà établi sa réputation en tant que défenseur actif de la médiation culturelle pour les jeunes, en proposant des cours en ligne depuis plusieurs années, en organisant des "Family Days" et en créant des chasses au trésor. Cependant, l'expérience des visiteurs a pris un virage inattendu, ces derniers étant désormais davantage attirés par les produits dérivés et les activités liées à Pikachu que par les chefs-d'œuvre de Vincent Van Gogh. Une question se pose alors : aurait-il été possible pour le musée néerlandais d'éviter cette marée humaine en refusant de céder à la tentation des bénéfices immédiats, notamment en ce qui concerne la vente de produits dérivés ou la distribution de cette carte inédite ? La prise en compte de l'impact colossal de Pokémon a peut-être été minorée quant aux comportements des joueurs.
La collaboration, innovante et populaire, a entraîné le musée dans les méandres des médias de masse. Pris de vitesse par la diffusion de l’information, il a été contraint de composer avec les complexités inhérentes aux partenariats culturels avec des géants de l'industrie.
Emma LAVERDURE
Pour en savoir plus
- Communiqué de presse de l’exposition Pokémon x Musée Vincent Van Gogh : https://www.vangoghmuseum.nl/en/about/news-and-press/press-releases/20230927-the-van-gogh-museum-partners-with-the-pokemon-company-international
- L’influence nipponne dans l’art de Vincent Van Gogh : https://www.beauxarts.com/grand-format/van-gogh-le-japon-dans-la-peau/
#VanGogh #Pokémon #collaboration

Les toiles prennent leur envol
Du rouge, du bleu, du noir, du orange, tels des cerf-volants, d'amples voilures émergent au loin sur la place de la République, derrière l'Hôtel de ville de Cambrai. Une sorte de cirque, entendrons nous dire par quelques curieux passants. Oui, mais pas tout à fait. Sur la place, s'élèvent trois longues tentes triangulaires et colorées desquelles vibre une certaine légèreté. Cette structure, simplement montée comme un chapiteau de cirque, appelle le marcheur comme à la fête foraine. Cette sensation d'intimité, cette invitation, tend à favoriser le désir de pénétrer au sein de ces curieuses toiles.
© D.R
©D.R
Ni structure lourde, ni tendeurs métalliques, ni parpaings disgracieux, mais huit sacs à voiles de marins emplis d'eau ancrent l'ensemble au sol. Pas d'édifice imposant, pas d'antique portique effrayant, un simple sas de toile permet à « tout un chacun » d'entrer sous ces chapiteaux accueillants.
L'entrée se fait librement et l'accès aux différents espaces est gratuit. Mais qu'est-ce donc ? Pas de clowns amusants, ni d'animaux exotiques. Il semblerait que l'appât des couleurs vives et des formes familières ait marché. Le visiteur égayé se laisse généralement emballer par la proposition de cet étrange lieu.
« Un musée mobile ! », lui dit-on. Un musée tout en kit conçu pour abriter une dizaine d’œuvres d'art tout droit sorties des collections du Centre Beaubourg. A l'intérieur, une ambiance ouatée et sobre enveloppe le visiteur. Les volumes, tous teintés de blanc, se mettent au service des œuvres exposées et accompagnent les flâneurs au gré de la couleur mise en exergue tout spécialement pour cette première exposition. En effet, le thème de cette initiative est la couleur. Une idée forte qui touche un tout public en étant également au coeur des préoccupations de l'art contemporain. Cet éloge de la couleur est en effet représenté par des joyaux de grands maîtres classiques et contemporains tels Pablo Picasso, Françis Picabia, Sonia Delaunay, Yves Klein, Fernand Leger, Alexander Calder mais également l'artiste contemporain Olafur Eliasson.
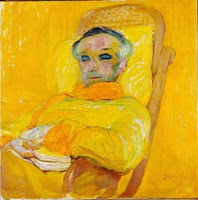 Frantisek Kupka La gamme jaune
Frantisek Kupka La gamme jaune
Pour accentuer cette impression d'intimité, de modestes cimaises protègent et sécurisent les œuvres tout en laissant paraître un sentiment d'étroite proximité. Ainsi, les tableaux sont fixés au sein des cimaise-caissons et se dévoilent au travers d'humbles vitres. Ce parcours, signé par la commissaire de l'exposition et conservatrice du Centre Pompidou Emma Lavigne, raconte alors une histoire de la couleur accessible et qui met en lumière une façon originale et ludique d'appréhender l'art en général. Cette histoire de la couleur est alors réinventée par une médiation nouvelle et très particulière. Non pas des clowns, ni des mimes ou des farceurs mais des comédiens issus de l'art du spectacle sont appelés à mettre en scène les œuvres. Cette approche, quelque peu surprenante, permet tout de même aux plus novices de stimuler une certaine construction d'un regard sensible sur l’œuvre. Pas de longs cartels à déchiffrer, point de mots savants incompréhensibles, La gamme jaune de Frantisek Kupka parle tout simplement d'elle-même.
Toutefois, un bémol vient s'inscrire dans cette si belle proposition : une médiation culturelle quelque peu restreinte et cloîtrée dans un scénario rigide et peu enclin à l'échange. Ainsi, les comédiens évoqués précédemment prétextent un mauvais rhume les empêchant de mener à bien leur rôle de « guide ». Ces derniers délèguent alors la majorité de leur prestation orale à une tablette tactile qu'ils utilisent comme une télécommande pour actionner tel ou tel fond sonore. L'idée est intéressante finalement car elle est abordable et appréciable par le plus grand nombre des publics. Cependant, il est impossible de suggérer un échange avec le médiateur, tant celui-ci est conformé dans son texte et ses différents outils. Il faut déplorer aussi le peu d'informations et de formation (!) dont ils ont disposé.
Cette idée de l'écrin, les voiles colorées, les œuvres protégées, est actionnée depuis l'année 2007 par le directeur du Centre Pompidou parisien, dans la continuité du Centre Pompidou-Metz. En effet, ces baldaquins, comme dirait l'architecte des lieux, Patrick Bouchain, sont à l'initiative du directeur de Beaubourg. La direction de ce musée d'art moderne et contemporain, dont les collections font parties des plus fournies dans le monde, a fait le pari de miser sur une itinérance de ses collections.
 François Lacour CHANEL Mobile Art
François Lacour CHANEL Mobile Art
Beaucoup diront que c'est une première dans le monde muséal. Mais il est à souligner que d'autres avant le Musée National d'Art Moderne avaient imaginé pareille entreprise. Le Corbusier par exemple, avait rêvé d'un musée itinérant dès les années 1930 ! Sans oublier André Malraux pour qui la décentralisation culturelle était une priorité dans la création de son ministère de la culture dans les années 1960. Pour les évoquer seulement, il existe aussi le CHANEL Mobile Art, pavillon d'exposition itinérant financé par la marque Chanel et offert à l'Institut du Monde Arabe de Paris ; le MuMo, pour musée mobile destiné aux enfants, qui fait également son entrée sur la route de la culture nomade ; ainsi que le Musée Précaire Albinet ayant pour objectif d'exposer des œuvres clefs de l'histoire de l'art du XXe siècle, en partenariat avec le Centre Pompidou et le Fonds National d'Art Contemporain, en impliquant les habitants du quartier dans toutes les phases du projet.
© D.R MuMo
Le Pompidou Mobile, projet de démocratisation culturelle, est calibré et modulable afin de lui permettre une implantation facile qu'il soit posé sur une friche industrielle, un site portuaire ou une place de marché. Ce centre veut privilégier avant tout les villes composées de 20 000 à 30 000 habitants parmi des zones rurales ou péri-urbaines culturellement défavorisées. Mais en s'installant sur des terres sous-équipées en lieux culturels, cette installation compensera-t-elle les inégalités territoriales ? Est-elle vraiment indispensable pour une ville comme Nantes lorsque l'on connait sa programmation artistique et culturelle ?
Soulignant la spontanéité de la rencontre avec les œuvres, ce projet donne tout de même à voir qu'une manifestation populaire peut aussi être un événement de qualité. Pour citer Bourdieu dans sa publication L'Amour de l'art : «... le plus important, c'est la médiation. Il faut donner au public les moyens de s'approprier les œuvres... ».
Jennifer Bouche

Louis Boilly - Un artiste régional au rayonnement national
En ce jour ensoleillé du Jeudi 2 Février 2012, je me hâte avec curiosité vers le Palais des Beaux arts de Lille, plus communément appelé le PBA où du 4 novembre 2011 au 6 Février 2012, a eu lieu une exposition permettant de découvrir, parait-il, un des plus talentueux artistes français des XVIIIème et XIXème siècles à savoir Louis Léopold Boilly.
Son nom vous est peut-être étranger, mais sûrement pas ses œuvres, notamment ses célèbres mini-portraits ainsi que ses caricatures. Cet artiste polyvalent, né le 5 Juillet 1761 à La Bassée et décédé le 4 Janvier 1845 à Paris, originaire de notre région du Nord-Pas de Calais, est ici mis à l'honneur à l'occasion de la célébration du 250ème anniversaire de sa naissance.

© Droits réservés.
Sa carrière fut des plus brillantes et des plus enviées puisqu'il connut un succès triomphant et ce, dès son vivant, en France comme à l'étranger. C'est donc bille-en-tête que je m'engouffre dans ce magnifique Palais qu'est le musée des Beaux-arts de Lille, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que l’exposition, annoncée comme un vibrant hommage à cet artiste, se déroule … au sous-sol du musée. Ma stupéfaction s’est accrue subitement pour mieux disparaître lorsque j’ai vu cet espace, d’une luminosité exceptionnelle due à son plafond constitué d’une immense verrière, offrant ainsi un écrin étincelant à la collection exposée. Thierry Germe, architecte diplômé DPLG, a conçu un parcours scénographique des plus étonnants. En effet, le visiteur découvre une scénographie géométrique réfléchie, alternant niches et ouvertures, permettant tantôt d’abriter quelques bustes et autres sculptures qui s’offrent inopinément à la vue du visiteur, tantôt d’entrevoir la prochaine salle mais sans trop en dévoiler, laissant ainsi la surprise au visiteur.
C’est ainsi que, suivant un parcours formant une boucle, les sept salles se suivent mais ne se ressemblent pas, chacune ayant une thématique prédéfinie, citons notamment la salle exposant les caricatures, et correspondant à une chronologie précise tel le Directoire ou encore l’Empire, renforcée par une ambiance coloriste sobre propre à chaque salle, mélangeant simplement mais habilement les teintes des cimaises de manière à s’adapter aux divers moments de la carrière de Boilly.
Ce travail simple et complexe à la fois laisse au visiteur le plaisir immense de (re)découvrir la richesse et la variété des productions de cet artiste qui comprennent notamment des peintures, des sculptures, des pastels et autres merveilles graphiques, tels les mobiliers décorés de trompe-l’œil, qui se succède à sa vue.Au total, pas moins de 190 œuvres, dont des dessins, lithographies, miniatures et pièces de mobilier prêtées par de nombreux collectionneurs particuliers et par les plus grandes institutions internationales, britanniques ou américaines telles la National Gallery de Londres ou le Paul Getty Museum de Los Angeles, allemandes ou russes avec ou le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, ainsi que par les grands musées français notamment le musée du Louvre et le musée des Arts décoratifs de Paris, viennent compléter la collection possédée par le Palais des Beaux-arts de Lille.
Une succession d’œuvres, pour ne pas dire chefs-d’œuvre, qui pourraient se suffire à elles-mêmes mais l’on peut déplorer l’absence de technologie dans cette exposition, à l’heure des tables tactiles et du Web 3.0. Henry Harrisse a dit : « Une exposition publique de l’œuvre de Louis Boilly s’impose. C’est alors, et alors seulement, qu’on lui rendra pleine justice ».
C'est désormais chose faite, avec cette rétrospective, hommage vibrant et brillant puisqu’ayant accueilli 52000 visiteurs, qui a su rendre sa juste place à ce très grand peintre français originaire de notre région, que le public a pu apprécier et, pour beaucoup, découvrir.
Céline DESCHAMPS

Louvre Lens, à l'ère du post internet art ?
La Galerie du Temps au Louvre Lens se veut innovatrice dans la conception muséale. La disposition des œuvres en attente dans ce grand hall surprend. Cette organisation dans l'espace renvoie à une relation particulière de l'image objet mentionnée par la culture Post-Internet, notamment le Post-Internet art.
© C. Camarella, La Galerie du Temps, Louvre Lens
Le Post-Internet art, qu'est-ce que c'est ?
Le Post-Internet art est un nouveau terme pour qualifier le travail des artistes contemporains qui utilisent internet comme un outil. L'idée de l'art est produite dans un contexte numérique. On peut le situer entre le New Média et le Conceptualisme, c'est à dire un travail avec les nouvelles technologies et leur matérialité, et l'utilisation de méthodes de diffusion comme concept.
Cela s'inscrit dans une démocratisation des nouveaux médias et tout à la fois dans une certaine désacralisation des œuvres d'art due à leur utilisation sur le web.
Certains artistes, Artie Vierkant, Marisa Olson ou Gene McHugh, ont mis des mots sur ces nouvelles conditions de création et productions artistiques rassemblées sous ce terme.
© Artie Vierkant, Image Objects, installation view, 2013
Marisa Olson le dit simplement, après avoir utilisé internet elle « fait de l'art » tandis que McHugh s'intéresse plus à définir une époque, quand internet est autant indispensable pour les programmeurs que pour tous dans la vie quotidienne.
© Katja Novitskova, Pattern of Activation, installation, 2014
Le résultat n'est que très rarement un objet physique, et majoritairement un objet virtuel sans indication de source et de techniques utilisées qui donneraient un repère à l'internaute : l'artiste joue entre la réalité et le virtuel, le matériel et l'immatériel, si bien que vous ne savez si plus si l'artiste est l'auteur ou non de la photo retravaillée, ou élaboré et peint à même l'espace.
Notons aussi la pluridisciplinarité engendrée par ses nouveaux outils de création artistique.
De plus le Post-Internet art pose des questions sur l'utilisation massive des réseaux sociaux, le flux continu d'informations et d'images, des liens entre les ressources qui ne sont plus évidentes, et une liberté d'utilisation à la convenance des personnes qui en font un outil de la création contemporaine.
Scénographie et dispositifs
Imaginons ici un parallèle entre La Galerie du Temps et le Post-Internet art au regard de la scénographie.
La scénographie prend le parti de créer une grande étendue laissant libre cours à l'expérience, que ce soit de circulation, de points de vue, d'approches concernant l'ensemble des œuvres. Du côté des artistes post internet la création de variations d'un même objet dans une reproductibilité infinie affirme un principe d’ouverture, loin de tout état fixe.
Le parcours propose un long cheminement à travers les œuvres du Louvre retraçant l'Histoire de l'art, de la naissance de l'écriture au 4e millénaire avant notre ère,jusqu'à la révolution industrielle.
Les œuvres ne sont pas classées dans une salle peinture ou une salle sculpture, la scénographie mélange les médias et crée un ensemble pluridisciplinaire entre les périodes, les techniques et les civilisations.
Selon un même principe de décloisonnement, les objets et images post-internet sont développés avec un intérêt particulier pour la matérialité des techniques, les outils et médias ainsi que la variété des méthodes de présentation et de diffusion.
Si le Post-Internet art questionne quant au respect des droits d'auteurs, les cartels dans l'exposition, eux, ne manquent pas de rappeler que les œuvres sont la propriété du Louvre.
La salle offre différents points de vue, renouvelés et réinventés à chaque déplacement du spectateur. D’où un renouvellement annoncé par le Louvre (qui promet une rotation d’œuvres), qui reste cependant bien plus figé qu'internet, avec son flux d'informations nouveau chaque jour.
Sous vitrine,sur socle, rond, carré, rectangulaire, estrade, groupé ou seul, à l'horizontal ou à la verticale, ou sur table : la profusion de dispositifs de soclage s'adapte à l’œuvre et aux médias, et intensifient le groupement de données que l'on retrouve dans cette esthétique particulière du post internet.
Cette scénographie a le point positif de réellement mettre en action le visiteur.
Les vitrines sont rares et certaines sculptures sont à hauteur d’homme, mais il ne faut pas s'appuyer sur les socles ou autres dispositifs mis sous alarme... une mise à distance contraire à l’accessibilité sur le web.
© C. Camarella, la Galerie du Temps, dispositifs scénographiques
Et le visiteur ?
Le spectateur déambule, au gré de ses envies, tout droit, en diagonale, tourne en rond, fait demi-tour, s'arrête, repart. Le seul élément semblant maintenir l'ordre est une frise chronologique du Temps sur le mur. Il choisit, pioche les informations,sans pression historique. Cette liberté rappelle certains comportements lorsque nous surfons sur internet. Nous serions dans un musée d'hyper connexions ?
Un click, un retour, une lecture, une autre page. L'avancée du visiteur au long de l'exposition dans un espace linéaire se compare à une page internet qui défile,un arrêt devant cette œuvre, un click sur cette page, ce qui renvoie à une autre œuvre et une autre page dans un flux d'images et d’œuvres en perpétuel mouvement.
© C. Camarella, capture d'écran retravaillée, Galerie d'images
© SANAA - Kazuyo Sejima - Ryue Nishizawa,retravaillée sur photoshop, Plan Galerie du Temps
Si le chemin du visiteur devait être tracé, on le verrait comme une souris de clavier qui se déplace dans une galerie d'images sur internet.
Comment l'espace d'exposition et les œuvres sont-elles finalement abordées ?
Le Post-Internet art est un mouvement artistique qui s'ancre aussi dans un contexte social comprenant les évolutions des technologies, l'accessibilité à internet et le monde tramé par les réseaux.
Pas de quartiers, les œuvres et médias se mélangent pour créer un ensemble à disposition des points de vue dans une seule échelle du temps. Il n'y a pas de médium plus ou mieux présenté qu'un autre, toute forme d'art se vaut. C'est cette ensemble montré qui construit le Temps et l'histoire des arts.
Acteur principal, le visiteur est autonome, c'est lui qui accorde de l'importance à telle ou telle œuvre. Cherchant habituellement à échapper au parcours prévu,une avancée vers le fond de la salle, les recoins, objets cachés, dénivelés sont appréciés. Le visiteur fera autant attention à ces détails qu'aux œuvres.La scénographie joue avec les œuvres et les visiteurs.
Dans un réseau, la perte de rationalité et de repère est inévitable entre toutes les informations.La démocratisation des outils et médias nous donne pour le moment de nouveaux champs d'actions et la possibilité de faire évoluer les caractéristiques ancrées que ce soit dans les dispositifs muséaux, les idéologies ou doctrines communes par rapport à l'art et ses représentations.
Charlène C.
#LouvreLens
#Post-Internet art
#scénographie
#médias
Pour en savoir plus :
Marisa Olson : http://we-make-money-not-art.com/how_does_one_become_marisa/
La Galerie du Temps au Louvre Lens : http://www.louvrelens.fr/galerie-du-temps
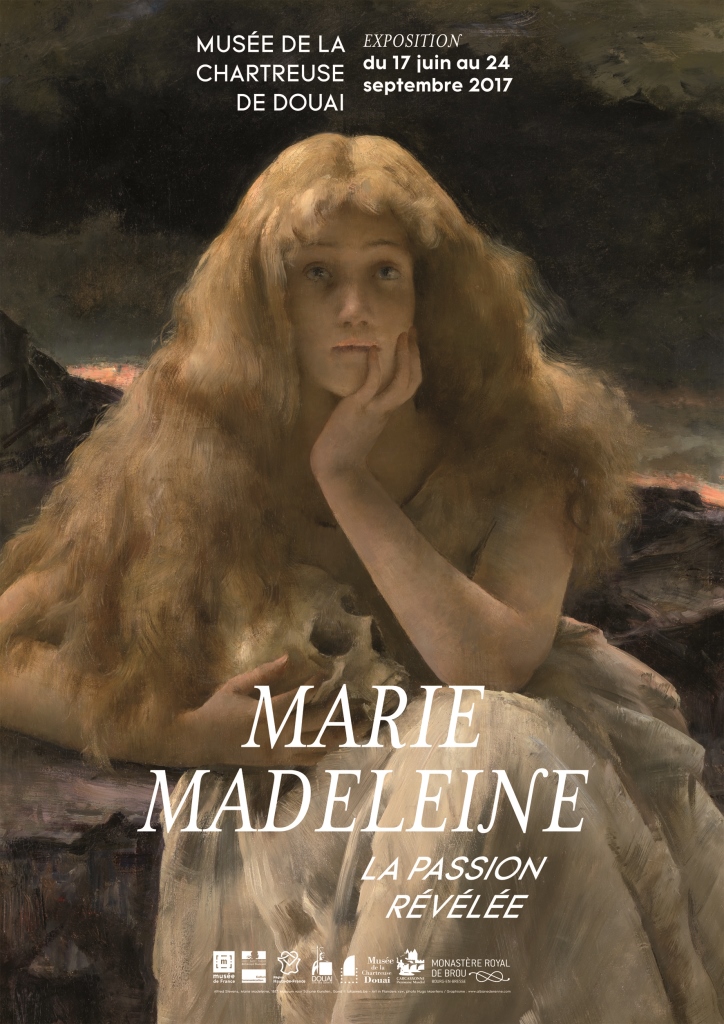
Marie-Madeleine révélée
L’inauguration d’une exposition est un moment particulier tout comme une avant-première au théâtre. C’est le Grand Soir où toute l’équipe du musée et ses partenaires, un peu stressés, présentent le fruit de longs mois de travail. Bien sûr, la présentation de l’exposition ne s’arrête pas à une seule soirée : elle demeurera pendant plusieurs mois et les visiteurs du soir du vernissage ne sont pas représentatifs de l’ensemble du public qui passera les portes du musée jusqu’à la fermeture de l’exposition. Mais tout de même, la première impression, même si elle n’est pas toujours bonne, est la plus importante: les journalistes présents peuvent donner envie ou non au public potentiel de franchir l’entrée du musée, tout comme les premiers visiteurs peuvent faire bonne ou mauvaise publicité auprès de leurs proches. Les élus ainsi que les agents de la collectivité, aussi présents, ont également l’occasion de voir l’œuvre de leurs collègues du service musée. Des jugements éventuels peuvent mettre une certaine pression à l’équipe du musée en représentation, en particulier le conservateur et les commissaires d’exposition sous les feux des projecteurs. On se demande ce que vont penser les visiteurs du contenu scientifique, de la rédaction des textes des cartels, ou encore du choix des œuvres…Tout le travail réalisé a été fait pour eux.

© Camille Roussel-Bulteel, première salle de l’exposition abordant le développement du culte de Marie-Madeleine.
Apprentie en régie des collections et des expositions au Musée de la Chartreuse de Douai, j’étais donc curieuse des avis des visiteurs concernant le montage de l’exposition « Marie Madeleine, la Passion révélée », le soir du vendredi 16 juin 2017.
Parmi les professions passionnantes du monde muséal, nous retrouvons le métier de régisseur des collections et des expositions, que j’ai la chance d’apprendre lors de cette riche année d’étude de Master 2. Ce poste a pour mission, dans le cadre d’un projet d’exposition temporaire, de coordonner, avec l’aide de l’équipe du musée, les mouvements des œuvres et leur accrochage, c’est-à-dire la mise en place des objets muséaux dans l’exposition: il peut aussi bien s’agir de tableaux fixés aux cimaises, de sculptures posées sur des socles, ou encore de documents placés en vitrine. Pour se faire, il est primordial de bien connaître le contenu de l’exposition.
Ainsi, le travail de montage pour l’exposition « Marie Madeleine, la Passion révélée » a débuté environ 4 mois avant son ouverture. Dans un premier temps, il a fallu s’imprégner des œuvres sélectionnées. La grande difficulté du montage de cette exposition réside dans la coproduction par trois musées différents, nécessitant un important travail scientifique préalable (rôle des commissaires scientifiques), ainsi qu’une préparation anticipée bien en amont (rôle des directeurs d’établissements, qui deviennent pour l’occasion les commissaires généraux du projet, c’est-à-dire ceux qui l’organisent concrètement en se chargeant de la passation des marchés de transport, de communication et d’édition – entre autres). Avant de s’installer à Douai, l’exposition s’est arrêtée au Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse puis au Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. La majorité des œuvres sont présentées dans les trois musées organisateurs mais pas toutes : certaines œuvres visibles à Bourg-en-Bresse ou à Carcassonne ne le sont pas à Douai. D’autres œuvres ont une présence exceptionnelle au Musée de la Chartreuse comme la Marie Madeleine de Van Scorel, chef d’œuvre conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam. Ainsi, il fallait bien différencier les œuvres qui arrivent de Carcassonne, la deuxième étape, et celles qui arrivent directement de leurs musées d’origine étant des prêts bien spécifiques à Douai. Afin d’effectuer ce travail d’immersion, l’étude du catalogue, déjà édité au moment de la préparation du montage, et contenant la totalité des visuels des items, a facilité cette imprégnation.
Parallèlement, le tableau de dépouillement des fiches de prêts, d’abord réalisé par la conservatrice et l’assistante de direction, puis vérifié et complété par le service de la régie auquel j’appartiens depuis le mois d’octobre dernier, permet la préparation en amont du montage : quelles sont les conditions de prêt ? Faut-il une mise à distance ? Le musée prêteur demande-t-il des relevés climatiques ? Le visiteur est-il autorisé à photographier l’œuvre ? Y aura-t-il la présence d’un convoyeur ? Quelles sont ses conditions de voyage ? Existe-t-il des exigences concernant l’accrochage ? Faut-il des tiges sécurisées, des pattes de fixations, un support de présentation particulier ? Par ce travail d’analyse approfondi il était par la suite aisé de se souvenir de tête, pour les 90 œuvres, du numéro de catalogue, du musée prêteur, du titre, de l’artiste, et de l’emplacement dans l’espace d’exposition.

© Camille Roussel-Bulteel, deuxième salle de l’exposition abordant Marie Madeleine représentée en courtisane et myrrophore. A gauche, dans un caisson climatique, la Marie Madeleine de Van Scorel, chef-d’œuvre conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.
Arrivent également les questions d’assurance : le service de la régie demande les devis, tandis que la conservatrice et l’assistante de direction s’occupent de l’établissement des bons d’engagement et des contrats au nom de la Ville de Douai. Chaque mouvement d’un objet muséal comporte des risques : casse, vol, dégradation. Chaque œuvre empruntée dans le cadre d’une exposition temporaire est assurée. Cette protection assure le financement d’une restauration ou d’une indemnisation dans le cas où un dommage serait subi. Les musées prêteurs exigent de recevoir le certificat d’assurance avant le départ de l’œuvre pour le lieu d’exposition. Cette protection assurée « clou à clou », débute un mois avant l’ouverture de l’exposition et se termine un mois après la fermeture. Ainsi, l’œuvre est protégée durant toute la période de transport, de manipulation et de présentation dans le musée emprunteur. C’est à ce dernier qu’il incombe de souscrire l’assurance auprès d’un assureur spécialisé au nom du musée prêteur, qui fait part de ces exigences en termes d’assurance. Les assureurs sont différents pour la France et l’étranger.
Une autre partie du travail consiste à contacter l’entreprise de transport et de conditionnement d’œuvres d’art retenu. De nombreux échanges entre l’entreprise et le service de la régie se mettent en place afin d’organiser au mieux l’accrochage. Le musée remet la liste des œuvres concernées, puis des discussions s’établissent afin de faire un point sur la présence de convoyeurs, le nombre d’œuvres venant de Carcassonne, le nombre des œuvres venant de leurs musées d’origine et les optimalisations possibles concernant leurs acheminements jusque Douai. Fruit de ces échanges, la liste de colisage et les plannings d’arrivées des œuvres et des convoyeurs sont établis et partagés.
Parallèlement à ces préparatifs, les salles du musée et leurs lettrines ainsi que les socles sont repeints grâce à l’aide du service Bâtiment de la Ville et d’un médiateur culturel du musée: du jaune, du bleu, du rouge, des couleurs qui feront ressortir les œuvres. La conservatrice des lieux ainsi que la commissaire d’exposition établissent le plan d’accrochage. Il faut adapter l’exposition aux salles du musée de la Chartreuse et aux matériels disponibles tout en respectant le discours commun aux trois musées partenaires. Ainsi, la seule salle d’exposition se trouvant au rez-de-chaussée accueille une sculpture en pierre trop lourde pour être exposée à l’étage. Sur le plan, adapté par le service de la régie, apparaissent des notes tirées du travail d’épluchage des contrats de prêts qui a permis de répertorier les conditions des prêteurs : tiges sécurisés, numéros des socles avec ou sans capot, mises à distance. Quelques fantômes sont réalisés afin de s’assurer de la capacité d’accueil de certaines cimaises.

© Camille Roussel-Bulteel, quatrième salle de l’exposition, présentant les épisodes de la crucifixion et du Noli me tangere.

© Camille Roussel-Bulteel, sixième salle de l’exposition, la Marie Madeleine, statue réalisée par Roulland, était trop lourde pour être présentée à l’étage.
Les œuvres venant des autres musées, autres que les Beaux-Arts de Carcassonne, arrivent tout au long des deux semaines d’accrochage. Les œuvres exposées à Carcassonne, quant à elles, arrivent en même temps, convoyées par le régisseur et le documentaliste. A leur arrivée à Douai, leurs caisses sont entreposées dans la salle capitulaire soit la salle d’exposition du musée convertie en salle de stockage de caisse. La taille de l’exposition étant relativement importante, cette dernière est accrochée sur tout l’étage du musée. L’étage avait été démuni de ses collections permanentes dans le contexte des travaux de toitures qui sont interrompus le temps de l’évènement.
Après cette livraison, débute une semaine de montage avec l’aide d’accrocheurs. Les membres de l’équipe du musée donnent les directives : la régisseur et moi-même, l’assistant de régie des collections, la conservatrice, le documentaliste. Dans la salle capitulaire du musée sont déballées les œuvres qui sont ensuite montées par les escaliers des anciennes réserves jusqu’aux salles d’exposition où est fait le constat d’état, un document qui permet de vérifier qu’aucune dégradation n’a eu lieu sur l’œuvre lors du voyage. Parallèlement toutes les caisses sont pointées à l’aide de la liste de colisage. Une fois le constat d’état signé, l’œuvre est placée. Sur les cimaises, les œuvres sont accrochées toutes ensembles simultanément afin de pouvoir calculer les espacements. Des petits supports sont fabriqués pour les objets exposés en vitrine à l’aide de plastazote ou de mélinex soient des matériaux neutres pour la conservation des objets patrimoniaux.
Quand l’œuvre est convoyée, toutes les opérations, (le déballage, le constat d’état et l’accrochage) sont réalisées en présence du convoyeur, c’est-à-dire du représentant du musée prêteur. Il n’est plus possible de manipuler à nouveau l’œuvre une fois le convoyeur parti… Le musée prêteur choisit d’envoyer un convoyeur quand l’œuvre est particulièrement fragile ou difficile à installer. Les grands moyens ont dû être employés pour l’installation de l’œuvre Jésus chez Marthe et Marie conservée au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes d’Erasmus II Quellinus et d’Adrien Van Utrecht. Cette huile sur toile d’une dimension de 1m75 de haut et de 2m43 de large a accédé à l’étage grâce à la trappe du musée.

© Camille Roussel-Bulteel, le repas chez Simon, et Jésus chez Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, sont les épisodes bibliques abordées dans cette troisième salle de l’exposition. Au fond, l’œuvre des Beaux-Arts de Valenciennes passée par la trappe.

© Camille Roussel-Bulteel, l’œuvre des Beaux-Arts de Valenciennes était trop volumineuse pour passer par les escaliers des anciennes réserves du musée. Les grands moyens ont donc été employés.
Il est fort émouvant de découvrir les œuvres vues tant de fois dans le catalogue. Leur matérialité révélée ! Des œuvres interpellent plus que d’autres, comme une huile sur marbre, un Noli me tangere, conservée au musée de Dole. L’artiste a utilisé un motif naturel de la pierre afin de l’intégrer à sa composition. Un petit ivoire réalisé par Jean-Antoine Belleteste représentant une crucifixion et appartenant aux collections du musée-château de Dieppe, est une véritable merveille.

© B.Legros, Jean Antoine BELLETESTE, Crucifixion, 1797, ronde bosse en ivoire, caisse en ébène et poirier noirci, fermoirs en bronze, Dieppe, musée-château

© Henri Bertrand, Italie, Le Christ et la Madeleine, Noli me tangere, huile sur marbre collé sur ardoise, Dole, musée des Beaux-Arts
Une fois l’ensemble des œuvres accrochées, l’équipe du musée maintient les efforts : les kakémonos sont mis en place, les mises à distance sont installées pour les œuvres qui en avaient besoin. Les électriciens interviennent alors sous la supervision de la commissaire d’exposition. La fabrication des cartels et leur pose sont les dernières étapes qui précédent les petites finitions juste avant le vernissage, aussi activement préparé.

© Camille Roussel-Bulteel, la cinquième salle de l’exposition dévoile des Madeleines pénitentes.
Pour le vernissage : une dégustation de madeleines. Le buffet déclinait la douceur préférée de Proust sous des formes surprenantes : au sucre, au foie gras, au citron, et même aux asperges (légume que l’on retrouve dans certaines œuvres de l’exposition, étant un symbole lié au personnage de Marie Madeleine)…
Et les avis des premiers visiteurs ? Ils sont plutôt positifs. Quelques jours après l’ouverture, de petites remarques concernant la disposition des cartels impactant le confort de lecture furent faites aux surveillants qui n’ont pas tardé à le signaler. Les modifications sont donc exécutées dans les plus brefs délais.
Pari donc réussi grâce à un travail d’équipe organisé sans lequel le montage n’aurait pas été possible. L’appréhension du soir du vernissage laisse alors place à la fierté.
Quelques mots tout de même sur le contenu de l’exposition ? « Marie Madeleine, la passion révélée » aborde la figure du personnage biblique qu’est Marie Madeleine à travers des œuvres du Moyen Âge à nos jours. Le Musée de la Chartreuse accueille 90 œuvres prêtées par des musées, bibliothèques, archives, et collectionneurs privés. Cette manifestation est exceptionnelle : très peu d’expositions ont abordé le sujet, si ce n’est à Florence en 1986 et à Gand en 2002. C’est une première en France. Le pays est pourtant fortement attaché à cette Sainte, qui selon la légende dorée de Jacques de Voragine, est venue évangéliser la Provence après la mort du Christ.
Marie Madeleine est connue pour avoir été l’une des plus fidèles disciples du Christ qui l’a accompagné jusqu'à sa mise en croix.Elle est également considérée comme la première personne à qui il est apparu après sa résurrection. Dans l’imaginaire collectif, elle s’est repentie après avoir vécu une vie de femme futile. En réalité, elle est la fusion de plusieurs femmes citées dans les évangiles canoniques de Marc, Matthieu, Jean et Luc. C’est le Pape Grégoire le Grand qui affirma son identité multiple vers 591. Ainsi, elle est à la fois Marie de Magdala, que le Christ a libérée des 7 sept démons, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare ressuscité par le Christ, et la femme qui lave les pieds du Christ lors du repas chez Simon. On l’a aussi confondue avec Sainte Marie l’Égyptienne, une prostituée portant une très longue chevelure, qui se repent dans le désert. Enfin, le best-seller de Dan Brown, le Da Vinci Code, l’a faite connaître auprès du grand public en tant qu’épouse du Christ et mère de son enfant, Sarah.
Plus d’informations se trouvent sur la page facebook du musée où je poste chaque semaine une anecdote sur l’une des œuvres exposées: https://www.facebook.com/museedelachartreuse/?pnref=story
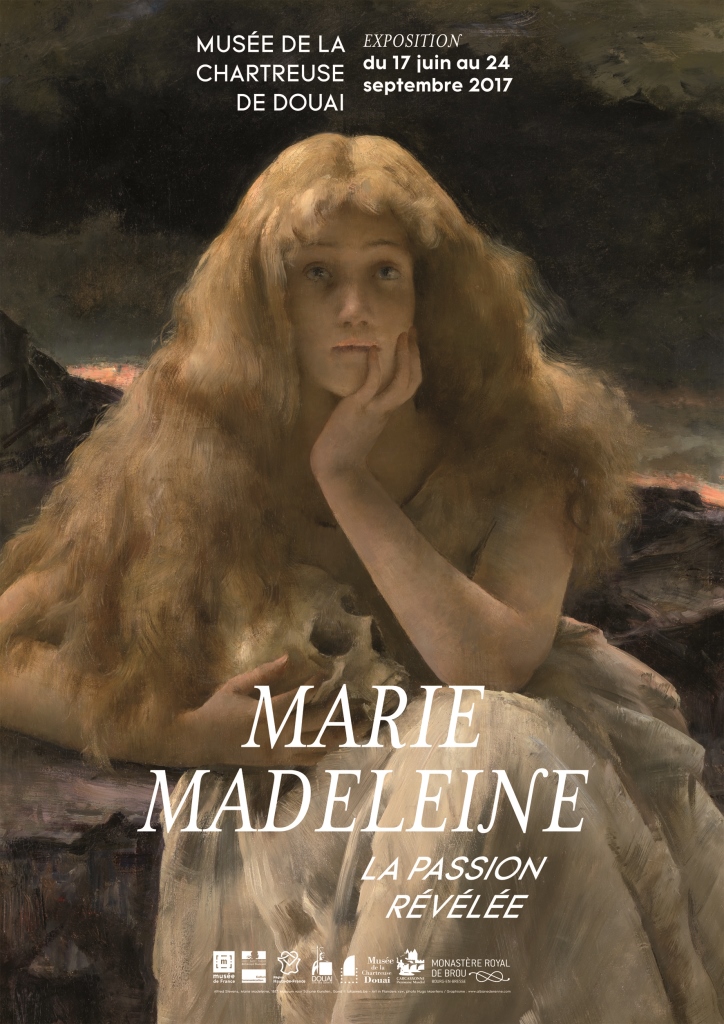
« Marie Madeleine, la Passion révélée », du 17 juin au 24 septembre 2017, au Musée de la Chartreuse, situé au 130 rue des Chartreux, 59500 DOUAI. Informations pratiques sur :http://www.museedelachartreuse.fr/
Commissariat scientifique de l’exposition : Marie-Paule BOTTE, historienne de l’art, Magali BRIAT-PHILIPPE, conservatrice du Monastère Royal de Brou à Bourg-en-Bresse, Pierre-Gilles GIRAULT, administrateur du Monastère Royal de Brou à Bourg-en-Bresse, Anne LABOURDETTE, conservatrice du Musée de la Chartreuse de Douai, Marie-Noëlle MAYNARD, conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne.
Catalogue de l’exposition, Marie Madeleine, la passion révélée, 2016, 216 pages
BENAITEAU Carole, BERTHON Olivia, BENAITEAU Marion, LEMONNIER Anne, Concevoir et réaliser une exposition, les métiers, les méthodes, 2ème édition augmentée exposer à l’ère numérique, Eyrolles, 192 pages.
Camille Roussel-Buteel
#Régie des expositions
#Marie Madeleine, la Passion révélée
#Musée de la Chartreuse
Millet en rose et bleu
Un de mes premiers dimanche lillois. Il fait beau, je n’ai pas envie de rester enfermée chez moi. Je retrouve l’invitation pour le vernissage de l’exposition Millet au PBA… qui date un peu. Bon et si j’y allais? 8€ l’entrée tout de même, pour un peintre dont je ne connais pas grand chose si ce n’est l’Angélus, est ce que ça vaut le coup ? Comme c’est gratuit pour les étudiants en histoire de l’art, cela devrait l’être pour ceux de muséographie.
Me voici devant le musée, en travaux, une petite porte sur le côté fait office d’entrée. A l’intérieur personne… en même temps il fait beau et chaud, quelle idée d’aller s’enfermer dans un musée.
« Bonjour, je voudrais un billet pour l’expo Millet. Je suis étudiante en muséographie, est ce que cela rentre dans les conditions de gratuité du musée? » - J’obtiens l’entrée gratuite.
Armée de mon ticket, j’erre un peu et finis par trouver l’escalier pour descendre vers l’expo. Il fait sombre, des écrans diffusent des vidéos. Pas de cartel, pas de signalétique visible… d’un côté une inscription indique des plans reliefs (je ne suis pas de la région, je découvre le musée), je me dis que ça ne doit pas être par là et me dirige donc dans la direction opposée. J’arrive dans un espace consacré à Millet USA, des parallèles sont fait avec des photographes américains du début du siècle, chouette j’adore Walker Evans !
Allie Mae Burroughs, Wife of a Cotton Sharecropper, Alabama, Walker Evans, 1936
Mais c’est un peu étrange de commencer par des parallèles alors que je n’ai toujours pas vu une œuvre de Millet...
Je fais le tour et descends à nouveau des escaliers avant de comprendre que j’arrive en fait tout juste devant la véritable entrée de l’exposition… serait-ce qu’il y a deux expositions ? Les héritiers avant de parler du maître ? … pas très logique ! Je montre à nouveau mon ticket, et me voici dans un espace rose, un rose franchement laid, sur lequel les dates blanches sont peu lisibles, et un accrochage très classique de tableaux dans des gros cadres, avec des cartels sur le côté, à priori rien de très fun. Je m’approche de quelques portraits mais ce n’est pas vraiment ma tasse de thé… ah et puis maintenant des murs bleus…une sorte de division binaire : mur rose = tableaux et mur bleu = dessins (puisque des dessins sont accrochés à ces murs bleus).
© J. S.
Je passe vite la partie tableaux, je m’attarde un peu plus sur les dessins, qui sont d’une précision et d’une finesse très agréable. Et puis vers la fin, un espace avec des tableaux de paysages où les murs sont couleur bordeaux, ce qui fait ressortir de superbes lumières dans les paysages.
© J. S.
Par contre c’est déjà la dernière salle. Une exposition plutôt petite donc, qui se visite assez rapidement.
Je retourne vers ce qui était en fait la fin de l’exposition et peux pleinement apprécier et comprendre ces parallèles avec ces photographes américains ainsi qu’avec Edward Hopper. Plus qu’une simple rétrospective, ces liens mis en avant paraissent vraiment évidents, pointant des similitudes entre les photos des artistes américains, et le travail de Millet. Le travail cinématographique de Terence Malick vient donner vie à l’œuvre picturale de Millet, dans la même volonté de magnifier l’image du paysan et de sa terre.
Malgré un bilan un peu mitigé, je ne suis pas très sensible au sujet, vous l’aurez compris, Millet ce n’est pas trop mon truc… je reste sur une bonne impression notamment grâce aux œuvres de Hopper, aux incontournables photos de Evans et contente d’avoir découvert des dessins de Millet. Je garde aussi en mémoire les couleurs de ses paysages. Etrangement, j’en oublierais même peut-être l’Angélus, qui était la seule peinture de l’artiste que je connaissais avant de voir l’exposition.
Dans ma tête, des images de paysans, de campagne, de nature, et de belles couleurs se prolongent encore un peu en retrouvant le soleil dehors.
Julie Schafir
#millet
#PBA
#BeauxArts
#USA
Pour en savoir plus :

Musées en bulles : la BD comme porte d’entrée vers les collections
VIGNETTE : Station « La salle sans fond – Une Chapelle Sixtine à l’envers » - Photo E. Brousse
Durant l’été 2021, pour l’Open Museum du Palais des Beaux-arts de Lille, le dessinateur et bédéiste François Boucq investit l’espace muséal avec son personnage Jérôme Moucherot. A l’instar de certains récits sur version papier, au musée, le protagoniste évolue dans les méandres de la jungle urbaine. Sauvagement, le parcours pensé par le dessinateur fait irruption dans la collection permanente du Palais des Beaux-Arts. Quinze stations ont été pensées par Boucq à commencer par un tunnel hypnotique dans lequel les visiteurs s’immergent dans le trait du créateur, un motif léopard en noir et blanc duquel naissent divers animaux. A sa sortie quelques mètres plus loin, les tâches félines semblent imprégner le regard du visiteur et tournoient encore sur les statues de marbres. Que se passe-t-il ? Les collections sont-elles devenues indomptables ? Non… il s’agit d’une projection (mapping) de motifs animaliers en noir et blanc sur les blanches statues. Le safari muséal peut commencer.

IMAGE 1 Station « Une mise en route déroutante – Entrez dans le vortex de François Boucq » - Photo E. Brousse
Déconcerté par cette entrée en matière, le visiteur déambule à la recherche des farces du bédéiste. Dispatchées dans tout l’espace, soit les interventions bestiales sont des outils pour mieux comprendre les œuvres d’art ou leur composition, soit elles jouent un discours méta-muséographique en moquant l’attitude des visiteurs eux-mêmes.
Installations artistiques ou dispositifs muséaux ?
Dans une salle, le long du mur, un fil bleu est tendu devant les toiles, il se positionne au niveau de l’horizon sur chacune d’entre elles et met en valeur cette ligne cruciale qui marque systématiquement toutes représentations de paysages. Entre installation artistique et dispositif muséal, ce fil permet de saisir la composition de la catégorie picturale du paysage. Plus loin, une autre station permet d’appréhender via une installation l’illusion d’optique qu’est l’anamorphose.

IMAGE 2 Station « De l’anamorphose et au-delà – Une question de point de vue » - Photo E. Brousse
Ces interventions décalées de Boucq seraient presque des dispositifs de médiation destinés à la compréhension de techniques picturales. Par ailleurs, sur un mode plus ludique, François Boucq exploite la notion de « hors-cadre ». Au pied de deux natures mortes, il fait jaillir une abondance de fruits et légumes gigantesques qui s’amoncèlent sur le sol et ravissent le nez du public de leurs senteurs grâce à un dispositif olfactif. Autour de toiles abstraites, hors du cadre, Boucq brise également les frontières entre les œuvres : il prolonge sur le mur la composition de cinq tableaux différents. Il fait se rejoindre les motifs qui finissent par former une seule et même grande composition. Il est l’artiste qui lie les artistes à travers le temps et l’espace.
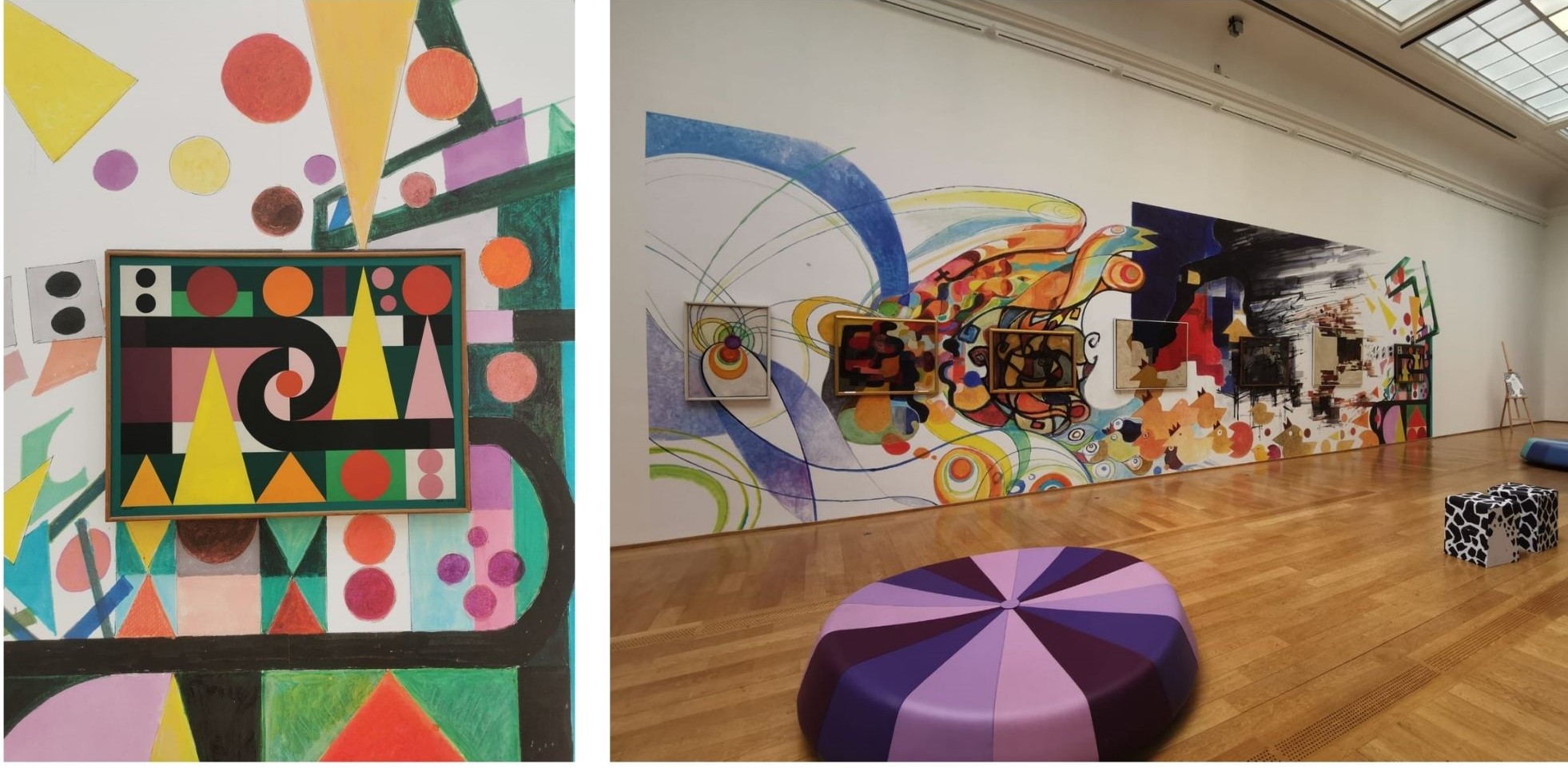
IMAGE 3 Station « Une bande dessinée de tableaux – Sortir du cadre » - Photos E. Brousse
Singer le visiteur
Ce jeu sur la composition des toiles se poursuit dans une salle réservée à la présentation de portraits. Ces derniers, selon l’illustrateur, paraissent souvent regarder le visiteur. L’effet est décuplé car les tableaux sont disposés à touche-touche (comme dans la salle des paysages), c’est donc une myriade d’yeux qui regardent le visiteur avec insistance. Au centre de l’espace, une installation tournant sur elle-même accentue davantage ce sentiment de voyeurisme puisqu’elle présente de grands cadres remplis de miroirs dans lesquels le visiteur se voit entouré des portraits. Il se photographie d’ailleurs systématiquement, dans les miroirs et joue avec ce décor. Par ce dispositif, le narcissisme du public et son attitude au musée sont gentiment moqués. Depuis deux enceintes placées aux angles de la pièce, des chuchotements (« on dirait qu’il me regarde ») se font entendre. Il s’agit de commentaires croustillants de visiteurs qui sont diffusés pour confronter le visiteur à son attitude face aux œuvres, le parodier.

IMAGE 4 Station « Se voir en peinture – Miroirs miroirs » - Photo E. Brousse
Au rez-de-chaussée, un violent bris de verre retentit dans le couloir des porcelaines. Le public cherche activement l’incivilisé qui a brisé une œuvre dans une sacro-sainte institution muséale avant de s’apercevoir naïvement que c’est encore un piège de François Boucq. Il a pris le musée pour terrain de jeu, le visiteur se retrouve confronté à son propre comportement. Il devient éléphant dans un magasin de porcelaine mais aussi singe dans d’autres espaces.
Collection de bulles
Avec cet Open-Museum, le Palais des Beaux-arts de Lille ouvre une seconde fois (la première avec ZEP lors de la troisième édition de l’Open Museum en 2016) les portes de son institution à la BD, encore trop peu présente dans les musées de beaux-arts. Le tour de passe-passe de François Boucq est une réussite ! Le bédéiste devient presque muséographe avec des dispositifs qui font réfléchir le visiteur et lui livrent des clés de compréhension sur les collections du musée. Ces dispositifs désacralisent aussi les œuvres. Pour en citer un dernier et non des moins marquants, une animation sous forme d’hologramme dans un cadre fait descendre Jésus de la Croix à partir de l’œuvre La Descente de Croix de Rubens. Un acteur vêtu comme le Christ sort virtuellement de l’œuvre pour venir s’assoir devant et interagir avec d’autres toiles. Ici, Boucq exploite encore une manière de « sortir du cadre ».
A l’occasion de cet évènement, François Boucq a fait une donation de près de 400 dessins au Palais des Beaux-Arts de Lille. Comme il le dit lui-même, c’est assez exceptionnel pour être noté car les exigences artistiques de la BD ne sont pas réellement reconnues.
Pour diverses expositions, la bande-dessinée a été la porte d’entrée vers les collections muséales. Par son graphisme et sa didactique, elle constitue un biais muséographique original. Pour citer un autre exemple hors-Beaux-Arts, l’exposition « Derrière les cases de la mission » (collaboration entre le Musée d’ethnographie de Neuchâtel et le Musée d’art et d’histoire de Lausanne) proposait une adaptation de la bande-dessinée Capitão de Stefano Boroni et Yann Karlen. Le public y poussait des reproductions de cases des planches agrandies et imprimées sur d’immenses rideaux pour accéder à une mise en scène. Derrière ces cases et par le biais d’objets ethnographiques, c’est l’entreprise missionnaire suisse au Mozambique qui était explicitée.
E. Brousse
#bd #openmuseum #lille
Pour aller plus loin
Le site du PBA de Lille: https://pba.lille.fr/Agenda/OPEN-MUSEUM-FRANCOIS-BOUCQ
Le site du Musée d’ethnographie de Neuchâtel : https://www.men.ch/fr/expositions/a-laffiche/derriere-les-cases-de-la-mission/#:~:text=d%C3%A9sinscrire%2C%20cliquez%20ici-,Derri%C3%A8re%20les%20cases%20de%20la%20mission,.2020%E2%80%9301.08.2021)&text=tels%20sont%20les%20ingr%C3%A9dients%20de,et%20d'histoire%20%C3%A0%20Lausanne.
Un précédent open museum du PBA relaté dans le blog : http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1213-open-museum-passard-une-mission-reussie

Ne rien lire sur les murs, ou si peu
L’article de la semaine dernière vous parlait de Lire sur les murs, poursuivons à travers une expérience critique de visite au Musée Magritte de Bruxelles. La question porte toujours sur ce que nous offrent les murs des musées.
Façade du Musée Magritte lors de travaux © Routard
Sur les murs du Musée Magritte de Bruxelles, que voir ?
1. Les œuvres (ce qui semble normal pour un musée Magritte)
2. De longues frises chronologiques illustrées à l’entrée de chaque étage. Vous savez, là où tout le monde se presse, entre par paquets et vous invite à surtout ne pas stationner.
3. Des citations. De courtes citations, qui permettent demieux connaître l’artiste, d’entrer dans ses pensées. Ces citations sont belleset s’intègrent parfaitement à la scénographie. Elles sont écrites en creux sur les murs, se détachant par leur couleur bois clair sur le fond bleu foncé des salles. C’est beau, c’est réussi. Mais aucune information ne nous est donnée sur la provenance de ces citations. Viennent-elles d’un écrit singulier ou sont-elles piochées dans plusieurs ? J’ai demandé à un gardien de salle qui n’était pas certain que toutes les citations soient bien de Magritte… Je n’ai pas insisté auprès du gardien de salle croisé ensuite, occupé à interdire les photographies.
4. Des cartels. Mais pas développés. Juste le strict minimum d’informations sur les œuvres. Le titre, la date, le numéro d’inventaire…
Exemple de cimaises du Musée Magrittede Bruxelles © Musée Magritte de Bruxelles (magritte.be)
Ce qui est bien au Musée Magritte, c’est que les cartels sont disposés juste à côté des œuvres. Vous n’avez pas besoin de parcourir plusieurs mètres pour avoir une information. De plus, ils sont plutôt lisibles et situés à une hauteur adéquate. Ce pourrait être une belle réussite muséographique si l’on tient compte des remarques évoquées dans l’article précédent… mais le problème vient du manque d’informations dans toute l’exposition !
Les frises chronologiques sont les seuls moyens d’en apprendre plus sur Magritte, sa vie et son œuvre. Malheureusement, les conditions ne sont pas des plus propices. Elles sont situées à l’entrée des étages, dans une sorte de couloir qui n’est pas assez large pour permettre de stationner tandis que d’autres y circulent simultanément. Cela est particulièrement visible à l’entrée du premier étage auquel nous accédons par groupes en sortant de l’ascenseur qui donne accès à l’exposition.
Le parti-pris du Musée Magritte est de laisser le visiteur se plonger dans l’univers de l’artiste. Il est vrai que l’œuvre du peintre mérite de se laisser porter, de voyager par nous même dans ce monde, sans interférences. La balade de tableau en tableau proposée par le Musée Magritte est plaisante : les citations font écho aux œuvres, nous plongeons facilement dans leur contemplation.
Mais nous passons parfois à côté d’éléments et nous ne comprenons pas forcément tout le parcours suivi par Magritte. C’est finalement le guide feuilleté à la librairie en fin de visite qui nous livre certaines clefs et donne l’envie de retourner dans les salles regarder plus attentivement un tableau dont nous n’avions pas saisi le sens en le croisant dans une salle.
Aénora Le Belleguic-Chassagne
Pour en savoir plus :
- http://www.musee-magritte-museum.be
#Textes
#Magritte
#Exposition

Non, les porcelaines ne sont pas ringardes
Qui a dit que les porcelaines étaient vieillottes ? Allez ne me dites pas que vous n’y avez jamais pensé ! Oui, on connait tous la petite porcelaine blanche de grand-mère dans le beau meuble de la salle à manger. Et c’est vrai, elle n’est pas toute jeune ! (Je parle de la porcelaine, je ne dis pas que votre grand-mère est vieille).
En vérité, le monde de la porcelaine est passionnant ! Peut-être que j’exagère mais il y a tellement plus que la petite porcelaine du placard de mémé.
Alors je vous embarque là où j’ai été agréablement surprise, au pays de la porcelaine ! Et vraiment, continuez à lire, ça va être sympa.
Pour commencer, une mise au point s’impose. Pour ceux qui ne distingueraient pas la porcelaine de la céramique, voici la différence. Tidam ! La céramique, mélange d’argile et d’eau (pour simplifier), peut être cuite de plusieurs façons, ce qui donne la porcelaine lorsque la température est élevée : jusqu’à 1400°C. Il y a aussi le grès, la faïence et la poterie qui sont d’autres techniques de la famille de la céramique.
Un musée de porcelaines
Cette année, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs musées de beaux-arts, dont ceux d’Arras et de Tournai. Devant les collections de porcelaines, je me suis sentie privilégiée d’observer ces services de table. Et puis, alors qu’il y a quelques temps je me trouvais à Limoges chez mes grands-parents (elle est là ma mémé), il m’a semblé évident que je devais aller visiter un musée de porcelaine : le Musée National Adrien Dubouché de Limoges.
Pourquoi Limoges ? Qui est Adrien Dubouché ? C’est parti pour la minute tourisme ! Considérée comme la capitale des arts et du feu, Limoges s’inscrit dans une tradition de travail de l’émail et de la porcelaine. Quant à Adrien Dubouché, il fut directeur du musée à partir de 1865 et porta un intérêt tout particulier à la partie céramique, qu’il enrichit grâce à des dons comme ceux d’Albert Jacquemart ou des achats par exemple de Paul Gasnault, ancien conservateur du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Pour permettre une production artisanale, une Ecole Nationale des Arts Décoratifs est créée juste à côté. Il fallait bien que les apprentis s’inspirent des collections pour se former artistes et artisans ! D’autant que les manufactures de porcelaines connaissent à cette période un fort engouement ; rien qu’à Limoges on comptait une vingtaine de fabriques et une vingtaine d’ateliers de décors en 1848. Ainsi, Limoges est devenu un des principaux centres de fabrication de porcelaine en France dès le 19ème siècle.
Un parcours chronologique
Le musée s’attache évidemment à l’histoire de cette fabrication et le début de la visite propose de comprendre les techniques utilisées. Tout le processus de la conception en passant par la réalisation puis en tournant vers le décor pour finir sur l’usage est expliqué. Les machines et les matériaux utilisés sont mis en valeur par une scénographie qui se veut évocatrice de l’univers industriel en jouant sur les volumes des socles, des machines, des matériaux et des œuvres. Et si l’on veut toucher de la porcelaine, il suffit d’effleurer les cartels en porcelaine. C’est plutôt approprié et unique !
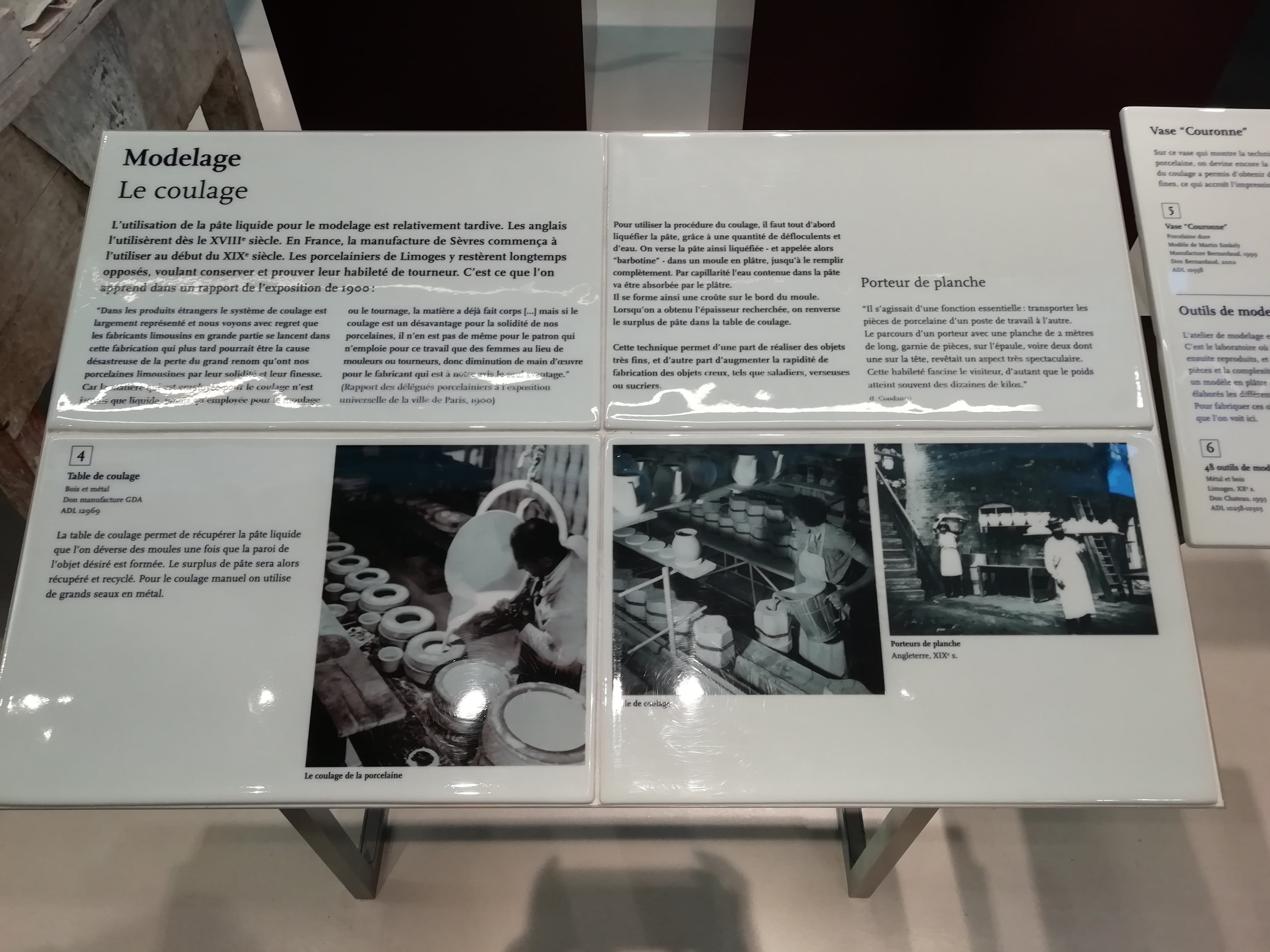
Cartel « modelage : coulage » dans la salle Mezzanine des techniques © L.L.
Le parcours chronologique nous invite à traverser les salles de l’Antiquité au 18e siècle où les petites porcelaines sont installées en famille dans une enfilade de vitrines de 1900 jusqu’aux salles contemporaines où trônent des vitrines colorées dans une salle, alvéolées et osées dans une autre ! Ces deux partis muséographiques fonctionnent-ils ? Certains visiteurs sont familiers de musées datant du 20e siècle dans lesquels les vitrines d’origine sont encore présentes. Le musée ancre ses origines : c’est le musée tel qu’il a été pensé à ses débuts. En revanche, l’inconvénient majeur de ces vitrines est leur disposition qui induit un parcours de visiteur gauche-droite-gauche-droite, la salle possédant une entrée et une sortie. Toutes ces vitrines disposées ainsi peuvent décourager le visiteur qui se contentera de marcher au centre et de tourner la tête. Toutefois, une fois convaincue - « Allez ! Courage ! Il y a peut-être une œuvre incroyable à ne pas louper ?! » -, me voilà surprise par la richesse des collections, non pas uniquement des porcelaines de Limoges mais aussi de Chine, d’Allemagne, d’Italie. Cela permet de faire des comparaisons de formes, de couleurs, de motifs et d’images.

Salle La céramique de l’Antiquité au XVIIIe siècle © L.L.
Pour le deuxième type de vitrines, je vous laisse un aperçu en images. Les couleurs apportent un réel atout à la pièce et rend les œuvres (même les cartels !!) élégants. Il est vrai que la porcelaine est riche en couleurs et cette salle témoigne de l’éclectisme des arts décoratifs à partir des années 1850. Là aussi le parti-pris de ces couleurs et formes géométriques contemporaines est assez osé, il accroche l’œil curieux du visiteur.
Salle La céramique du XIXe siècle à nos jours © L.L.
Enfin, les vitrines alvéolées. Jamais je n’avais vu pareilles choses ! Vous êtes surpris vous aussi ? Ces vitrines de formes très contemporaines exposent les collections de la Porcelaine de Limoges.

Salle La Porcelaine de Limoges © L.L.
Alors, reprenons, si je vous dis porcelaine, attention fermez les yeux, 1, 2, 3, qu’est-ce que vous voyez ? Oui ? Une tasse ? Pas très original. En effet, notre inconscient nous renvoie à une image que l’on a intériorisée, la céramique étant présente dans notre quotidien. Pour ma part, la tasse fait directement référence à la Belle et la Bête (vous savez cette petite tasse ébréchée qui parle !).
La préservation d’un art
La porcelaine n’est pas seulement un ensemble d’objets bien sagement présentés et dont l’usage est décontextualisé. Ils sont là parce qu’ils ont vécu et ont outrepassé les générations. Et si nous, êtres humains mourront, l’art évolue mais ne meurt pas. Pourtant, en quelques secondes cette tasse peut tomber et se fracasser au sol, en mille petites pièces. Celles qui sont encore là le sont parce que nous avons compris qu’en les préservant, elles préservaient l’humanité et les générations précédentes. Evidement il n’y a pas que la porcelaine, mais notre patrimoine quel qu’il soit mérite qu’on le dorlote. Et les œuvres contemporaines seront aussi à leur tour conservées.

Vitrine de la salle La céramique du XIXe à nos jours, œuvres de Ettore Sottsass, 1987 © L.L.
Tout évolue. La porcelaine, les toiles, la mode, la gastronomie en témoignent. Comme le futur est inconnu, c’est aujourd’hui que l’on doit montrer nos richesses, y compris la porcelaine mise en avant dans nos musées Beaux-Arts ! En plus, une multitude de parallèles sont possibles : porcelaines plus anciennes, thèmes iconographiques, pop culture, porcelaines étrangères, etc.
Après la minute tourisme, voici la minute actu : à Lyon, le Salon International de Peinture sur Porcelaine attire du monde et s’est tenu durant quatre jours en mars. A Limoges du 15 juin 2018 au 30 mars 2019 se tenait à la Fondation d’entreprise Bernardaud l’exposition « Sans les mains ! » où des artistes exposaient leurs œuvres (attention vous n’êtes pas prêts) réalisée en porcelaine à l’aide de machines numériques, telle que la machine 3D. Il est merveilleux n’est-ce pas de voir que la céramique puisse encore vivre de nouveaux jours ! Toujours à Limoges se tient cette année la 8e édition de la Biennale Toques et Porcelaine, mélange d’art de la table et de gastronomie. Ces évènements témoignent d’une part, d’une véritable identité de territoire, de Limoges, mais aussi l’envie de partager une technique artistique.
Tous ces événements visent à rendre la porcelaine, plus vivante et contemporaine.
Mais je laisse les derniers mots à ma mémé dont les jeux préférés sont les mots-croisés.
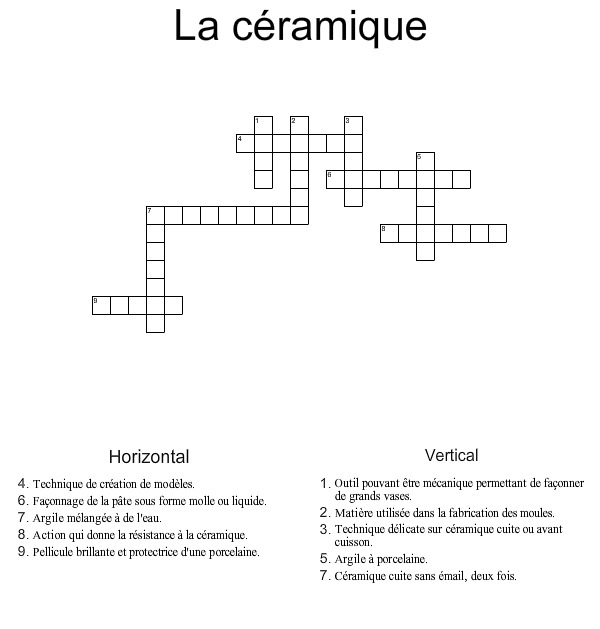
L.L.
#Porcelaine
#Anosgrandsmères
#Artcontemporain
Pour en savoir plus :
http://www.musee-adriendubouche.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ujg16ItuUEE
Réponses :
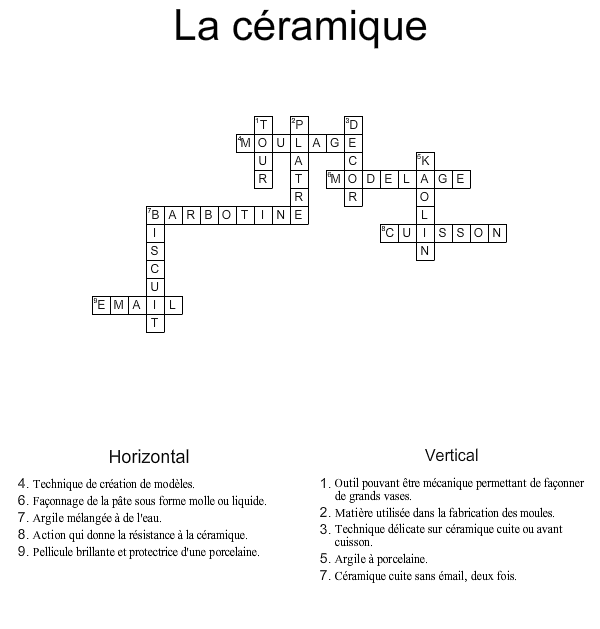
Open Museum Passard, une mission réussie ?
Le Palais des Beaux-Arts de Lille a choisi un chef étoilé pour donner un nouveau regard sur ses collections, sa mission est-elle remplie ?
Je commence un stage en médiation dans cette incroyable structure. Le musée est en pleine effervescence : conception de son nouveau projet scientifique et culturel dédié aux publics, projet de réaménagement de l’Atrium, réalisation de l’Open Museum ZEP…
Tout en m’imprégnant des objectifs de cet Open Museum, revisiter l’histoire de l’art et attirer de nouveaux visages, ma principale mission était d’aider à la mise en place du vernissage enfants en réalisant les fiches des œuvres que ZEP a choisi de mettre en lumière. Faire le lien entre ces deux univers pour que les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants soient les meilleurs guides d’un jour.
Affiche d’Open Museum #4 © PBA
Décembre 2015 – Palais des Beaux-Arts, Lille.
Je me sentais presque privilégiée de voir les dessins et animations exclusives que l’auteur de BD avait réalisés en s’appuyant sur les chefs d’œuvre du musée. Le pari était gagné. J’en étais certaine, cet Open Museum ferait un carton. Le père de Titeuf avait réussi à décomplexer notre rapport à l’histoire de l’art et à capter l’attention de ses amateurs mais aussi de ses initiés. On irait au musée par plaisir, on rirait devant des œuvres, on comprendrait leur histoire et sortirait avec l’envie de revenir l’année prochaine en se demandant ce que le PBA pourrait bien nous réserver.
Février 2016 – même lieu.
Ce questionnement, je l’ai moi-même eu. Discrètement, j’ai donc demandé à ma tutrice de stage si le musée avait une idée du nouvel invité de la quatrième édition de l’Open Museum. J’appris alors que le directeur, Brunon Girveau, était en discussion avec Alain Passard, le chef étoilé du restaurant l’Arpège, mais que rien n’était encore fixé. Décidément, le PBA me surprendrait toujours.
J’avais laissé libre cours à mon imagination : comment un chef pouvait apporter un regard nouveau sur les collections du Palais des Beaux-Arts ? Quel nouveau public pouvait-il attirer ? Quelle forme prendrait cet Open Museum ? Et puis, j’avais attendu patiemment son ouverture, sans savoir si Passard serait définitivement l’heureux élu.
Septembre 2016 – chez moi, Lille.
Ça y est, c’est officiel. Cela sera bien Alain Passard le centre de l’attention pour l’Open Museum #4. Le PBA lui offre sa fameuse carte blanche devenue un rendez-vous annuel. Que cela va-t-il bien donner ?
Je lis quelques articles de presse qui annoncent l’événement, me documente et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce chef Passard avait lui-même une pratique artistique autre que la cuisine. Ce féru d’art contemporain fait d’ailleurs ressentir dans sa cuisine ses autres passions : la sculpture, le collage à travers des associations de matières ou de formes…
Mars 2017 – le Sweet Flamingo, Lille.
Je déjeune avec mon ancienne tutrice de stage. Elle m’avait envoyé les documents de communication pour que je cerne cet Open Museum dont j’avais entendu quelques remarques par une amie agent d’accueil…
Surprise, Alain Passard est le commissaire de l’exposition et présentera quelques-unes de ses œuvres, mais, il donnera aussi la primauté à d’autres artistes contemporains. Il partagera l’événement avec Valentine Meyer, une curatrice indépendante et bien sûr Bruno Girveau et Régis Cotentin, le chargé de la programmation contemporaine.
À partir de ce moment, je doute. Je ne suis pas une initiée de l’art contemporain, et pourtant, je travaille dans le milieu culturel, qui plus est dans celui des musées. Alors, je me mets à la place de ceux qui ne sont pas des habitués, ceux qui sont éloignés de ces problématiques. Comment un Open Museum peut-il attirer de nouveaux venus en proposant un événement intégrant de l’art contemporain, qui peut selon moi, autant réunir qu’exclure. En choisissant cette orientation, le PBA s’est lancé dans un pari risqué mais conscient. Comment allait-il réussir son coup ?
30 avril 2017 – Palais des Beaux-Arts, Lille.
J’entre dans le PBA curieuse et décidée à m’ouvrir aux méandres de l’art contemporain. Je trouve toujours génialel’idée d’inviter un chef dans un musée mais je m’interroge quant à la façon de procéder. Ticket et livret d’aide à la visite en main, nous voilà lancées, Joanna et moi. Nous n’avons pas bien vu la première installation, les grandes pinces de homard installées dans l’entrée, dommage. Peut-être mériteraient-elles plus de lumières ou un autre lieu d’exposition… Mais nous nous sommes arrêtées un moment dans l’atrium. Les Marmites enragées de Pilar Albarracín qui reprennent l’Internationale nous font sourire et nous partons confiantes. L’art de la cuisine ou la cuisine de l’art est un monde à découvrir.

Les Marmites enragées de Pilar Albarracin © L.T.
Nous tentons de suivre le parcours, nous devons certainement rater quelques œuvres, nous passons plus ou moins de temps devant d’autres, nous nous promenons à tous les étagesdu musée. Certaines nous posent question : pourquoi ce choix ? quel lien ? quelle utilité ? Nous sommes parfois dubitatives. Malheureusement, ce n’est pas avec l’Open Museum Passard que je vais m’ouvrir plus largement à l’art contemporain, ; ce n’est pas l’art en lui-même qui me dérange, ici c’est la façon dont il intervient sur le parcours et le lien entre le musée et la cuisine. Le propos peut être évident lorsque l’on croise sur son chemin une tenue de cuisinier. Le montage vidéo avec Le Gobelet d’Argent de Chardin est intéressant : voir le chef à l’ouvrage dans le reflet des instruments de cuisine… Je reste sur ma faim. J’aurais souhaité que les liens avec les œuvres du musée soient plus intuitifs. Le dialogue entre la sculpture du vendeur ambulant indien faite de montres (Mumbai Dabbawala de Valey Shende, 2015) et d’un tableau qui évoque l’Orient avec L’adoration des mages n’est pas évident pour tout le monde… Pour avoir travaillé sur une édition précédente, je sais que les œuvres de l’Open Museum ne sont pas placées là par hasard, alors pourquoi en ai-je la sensation pour cette quatrième saison ?
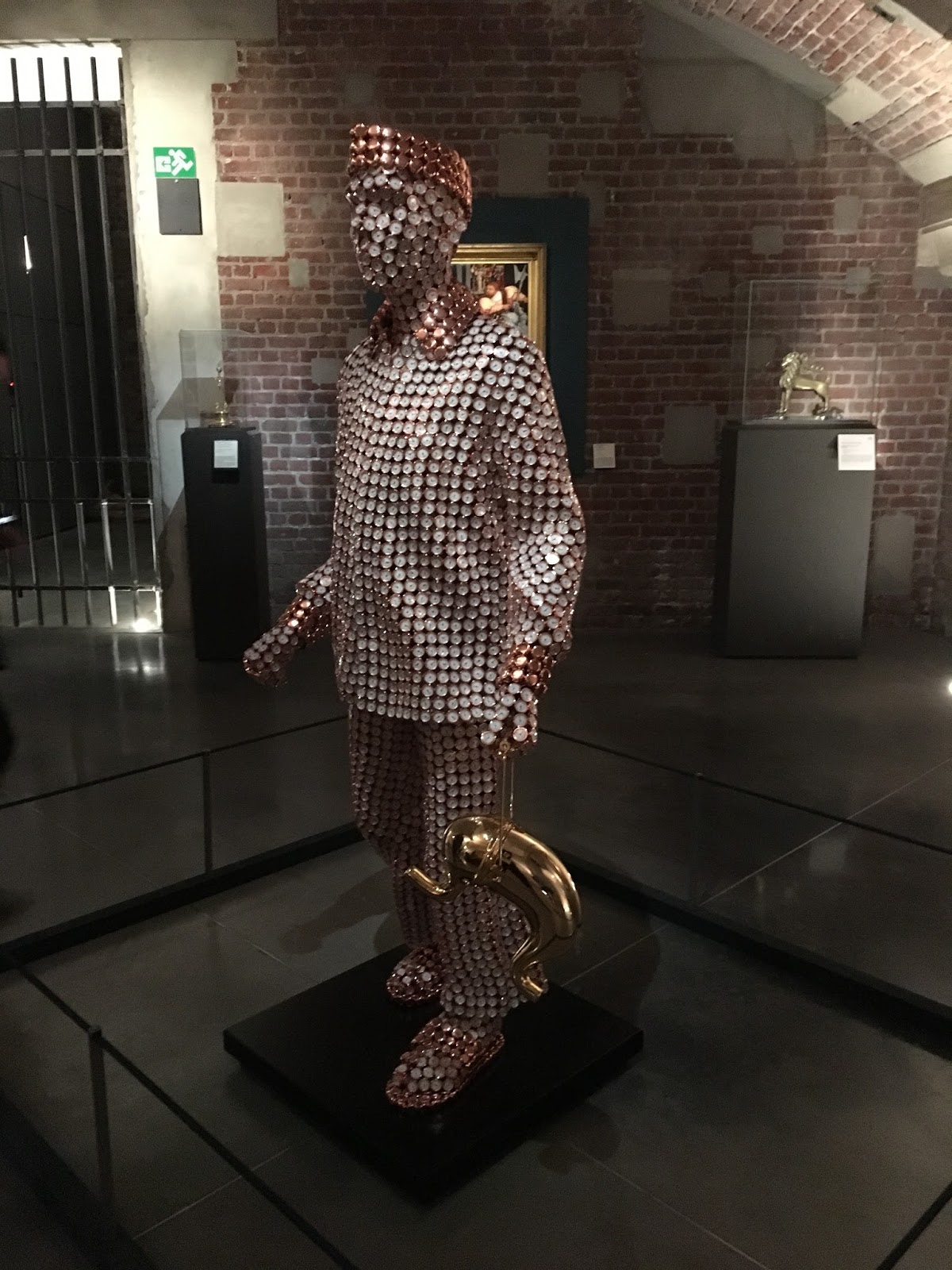
Mumbai Dabbawala de Valey Shende, 2015 ©L.T.
Mai 2017 – chez moi, Lille.
En écrivant cet article, je me rends compte que je ne sais toujours pas ce que je pense de cette quatrième édition, Open Museum Passard. J’avais envie d’aimer. Je n’avais pas envie de ne pas aimer. Mais je dois me l’avouer, j’espérais que cela soit différent : plus de choses à toucher, sentir, plus de sons, d’effervescence. Bref, vivre et ressentir l’atmosphère même d’une cuisine, découvrir qu’en tant que lieu de travail, que contenant d’autres objets et personnages à l’ouvrage, en tant qu’ambiance, la Cuisine était une œuvre d’art, un art en elle-même. Passer après ZEP et son humour décalé était une difficulté en soi et créait chez le visiteur une véritable attente : inviter un chef lors de cette édition laissait à penser que cela serait surtout son métier d’artiste culinaire qui serait mis à jour et que des liens seraient tissés par ce biais. Cela est parfois chose faite grâce à l’exposition des menus qui selon qu’ils soient lus dans un restaurant ou dans un musée n’ont pas le même effet… De fait, le PBA nous a bien étonnées et continuera de tisser des liens entre les différents pans de la culture, des arts. Il fallait oser.
Lucie Taverne
#openmuseum
#pba

Opération Wikimuseum au Palais des Beaux-Arts de Lille
Le rayonnement des collections des institutions muséales, se joue désormais dans le partage et dans les actions participatives en ligne. Le Palais des Beaux-Arts de Lille a lancé fin 2016, l'action Wikimuseum pour inciter les visiteurs à publier leurs documents personnels liés au musée (photos, dessins, écrits...). Sur la plateforme collaborative Wikimuseum, les documents sont mis en ligne par le grand public. Des "wikipermanences" organisées dans le musée aident les néophytes à se lancer dans le partage de documents parfois précieux ou insolites.
En savoir plus : • Lancement de la collecte de photos en ligne par le Palais des Beaux-Arts de Lille • Projet Wikimuseum sur le portail de Wikipedia •
Exemple de document numérisé : Charles Patelle-Bluttel, "L'Ecole hollandaise de Lille"
Hélène Prigent
16 mars 2017
#collecte
#numérique
#collaboratif

Plans-reliefs et questionnaire de Woolf
Aujourd’hui, notre journaliste retrouve Monsieur Plans-Reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille, pour un questions-réponses un peu décalé.
Coline C. : Bonjour Monsieur Plans-Reliefs.
Plans-Reliefs : Bonjour, Bonjour.
CC : Monsieur, nous allons procéder à une série de questions réponses dont le but est d’être le plus naturel possible, vous êtes prêts ?
PR : Tout à fait, c’est parti !
Monsieur Plans-Reliefs se tenant prêt face à nos questions © CC
CC : Les livres marquants de la bibliothèque de vos parents…
PR : Gargantua : cette manière de voir le monde de haut me faisait beaucoup rire.
CC : Les lieux de votre enfance ?
PR : Laissez-moi réfléchir… Dunkerque je crois, oui, Dunkerque. Le marquis de Louvois était alors secrétaire d’Etat à la guerre et avait demandé à Vauban de réaliser un plan-relief de la ville, pour imaginer les fortifications des villes conquises ou en passe de l’être par la couronne française. Moi je me rappelle des dunes, et des premiers bouts de carton.
CC : Dites-moi, avec qui aimeriez-vous entretenir une longue correspondance et pourquoi ?
PR : Les cartes IGN en relief, leur vision naturelle de la géographie m’émeut. Pour moi il s’agit plutôt d’aménagement du territoire, de logique de circulation et de stratégie militaire. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre.
CC : Que faites-vous dans vos périodes de dépression ?
PR : J’imagine toutes les façons de me détruire : adopter un bataillon d’insectes xylophages, me mettre à fumer, déjouer le système de climatisation pour causer une fuite d’eau…
CC : Et dans vos périodes d’excitation ?
PR : Je pilote une drône et je regarde le monde devenir mon propre plan-relief.
CC : Votre remède contre la folie ?
PR : Je lis tout ce qui me passe par la main ! J’ai un accord secret avec les gardiens du musée qui m’apportent un peu de leur bibliothèque personnelle, je glane deux trois titres dans les sacs des visiteurs et je demande au personnel de nettoyage de me les emprunter à la bibliothèque. Bien entendu, ma proximité avec la bibliothèque du PBA m’aide aussi beaucoup.
CC : Dans le cas où vous créez une maison d’édition, qui publiez-vous?
PR : Prévert pour rire, un type qui écrit « Quelle connerie la guerre », ce doit être un type chouette.
CC : Vous tenez salon, qui invitez-vous ?
PR : J’ai un goût certain pour l’exploration donc Abd al-Rahman al-Sufi, pour l’amour de la cartographie, la famille Cassini pour les relevés, Bill Ingals pour ses photographies de l’espace. Il y a là tout un univers à découvrir, c’est passionnant.

Monsieur Plans-Reliefs en grand moment de réflexion © CC
CC : Le secret d’un couple qui fonctionne ?
PR : Une heure de TGV entre les protagonistes.
CC : La chose indispensable à votre liberté ?
PR : Les horaires de fermeture du PBA. Ça fait du bien.
CC : Le deuil dont vous ne vous remettrez jamais ?
PR : Les villes que j’ai perdues lors du bombardement du musée des armes et de la guerre à Berlin lors de la Seconde Guerre mondiale. J’ai passé effectivement une partie de ma vie en Allemagne.
CC : C’est un peu intime mais, que trouve – t – on de particulier dans votre chambre ?
PR : Des étoiles phosphorescentes au plafond et une tapisserie que je n’ai jamais eu le temps finir.
CC : A quoi reconnait-on un ami ?
PR : Au regard qu’il porte sur vous. Et à ses pinceaux et ses micro-aspirations. Au temps qu’il ou elle met à vous remettre sur pieds.
Détails sur des ponts lors de la restauration des plans de Tournai par les « amies » de Monsieur Plans-Reliefs © CC
CC : Qui occupe vos pensées nuit et jour ?
PR : Une aiguière à casque bleue et blanche dans le département des objets d’art au rez-de-chaussée du musée. Elle veille sur moi, je veille sur elle.
CC : Vous démarrez un journal intime, quelle est la première phrase ?
PR : Cejourd’huy, vingt-quatriesme jour du mois d’avril 1668, j’ai commencé mon journal pour narrer comment moi, plan-relief sis en ceste bonne ville de Lille, voulus dire les mémoires de ma vie…
CC : Monsieur Plans-Reliefs, merci beaucoup de votre sincérité et de votre spontanéité.
PR : Mais je vous en prie. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, vous pourrez me retrouver au sous-sol du PBA de Lille aux horaires d’ouverture du musée.
Coline Cabouret
#plansreliefs
#hybridité
#stratégie
Pour plus de renseignements au sujet des collections de plans-reliefs en France:
http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Plans-Reliefs
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/index.php/le-musee/presentation-de-la-collection/histoire
Un chaleureux remerciement à Florence Raymond pour sa patience et son attention à l’article, ainsi qu’à Alain Mercier, pour la traduction du journal intime dans la langue de Molière.

Plongez dans l'univers du peintre Louis Boilly !
C’est toujours avec enthousiasme que nous découvrons les expositions du Palais des Beaux-arts de Lille, et c'est encore une fois une belle réussite de la part de ce musée. Le PBA accueil du 4 novembre au 6 février 2012, une très belle rétrospective du peintre L. Boilly originaire de la région du Nord Pas-de-Calais.
Le début du catalogue de l’exposition laisse place à une citation de Henry Harrisse, résumant bien cette rétrospective : « On ne pardonne pas à Boilly d’avoir tant d’esprit, ni au public de prendre si grand plaisir à regarder ses tableaux ».
Une figure marquante peu connue cependant présente dans de nombreux musées de par le monde.
Cette rétrospective marque le 250ème anniversaire du peintre, à cette occasion le PBA rassemble les plus grands chefs d’œuvres de L. Boilly, avec de nombreux prêteurs venant de plusieurs institutions de Grande Bretagne, des États-Unis, d’Allemagne, de Russie, et de collections particulières, ce qui en fait une exposition éblouissante, de par le caractère ubiquiste du peintre et des œuvres présentées.
 © Droits réservés.
© Droits réservés.
L’entrée de l’exposition est surprenante, le visiteur sera accueilli par une série de petits portraits exceptionnels. Le tempo de l’exposition est lancé, et les salles vont de surprises en surprises.
Le fil de l'exposition se fait tout simplement de manière chronologique, surtout de l’évolution artistique, culturelle et politique de Boilly.
Une exploration à travers le temps à partir des XVIIIème et XIXèmesiècles, avec non seulement des évolutions artistiques mais aussi ethnographiques, historiques et patrimoniales faites à cette époque.
Boilly se penche sur toutes les mutations des sociétés de cette époque, cela rend l’exposition d’autant plus fascinante et attrayante pour le visiteur et l’homme d’aujourd’hui.
En effet, chaque salle, représente une époque, une influence artistique de l'artiste. Au total, sept grandes sections chronologiques et thématiques, et à travers ces sections des petites salles découpées par parcours.
Ces salles sont à la fois traversées par la « tourmente révolutionnaire » de l’artiste, des figures marquantes de la Révolution, comme en témoigne ses magnifiques dessins de portraits réalisés avec une tendresse et une sincérité stupéfiantes des scènes de genre. Boilly se faisant sociologue, le visiteur peut constater les évolutions et les mutations de la vie sociale, des situations familiales et aussi politiques.
Le parcours de l'exposition est agréable, et offre des espaces clairs, dynamiques, grâce à la rythmique des espaces mise en place pour accorder une fluidité de circulation et entre les œuvres. Le visiteur est transporté de salle en salle, d'époque en époque.
La scénographie fait partie aussi de la valeur du PBA, un décor "propre", soigné, mais finalement classique, toutefois cela participe au charme de l’exposition et s’accorde bien avec les œuvres. Les salles se présentent sous la forme de petits salons, sans nul doute pour rappeler les Salons de ces époques et dont l’artiste fut un participant assidu et ce, à de multiples reprises.
Après coup, la scénographie ne semble pas si classique, il y a une dynamique, les salles se présentent comme des petites saynètes (pour chaque époque et mouvement artistique) avec des petites ouvertures et des niches entre les cloisons, cela permet d'entrecroiser les autres salles, mais sans trop en dévoiler sur le sujet. Ces petites niches instaurent cette dynamique et, avec un va-et-vient donnant lieu à un jeu du regard sur ces œuvres. En conclusion, on ne ressent aucune superposition des courants artistiques ou historiques.
Une métaphore donc sur notre regard contemporain sur l’histoire de l’art, qui n’est pas juste une histoire linéaire de ces différents courants, on porte toujours un avis comparatif sur le passé. C’est pourquoi, les œuvres se reflètent à travers leurs époques, comme un effet miroir sur la vie de L. Boilly.
C’est aussi créer un choc par rapport aux représentations artistiques et des transformations des courants artistiques du travail du peintre.
Une exposition montrant la grande virtuosité de cet artiste, et plus particulièrement les domaines où il excelle, à savoir l’art du portrait et celui du trompe-l’œil, à qui la dernière salle est consacrée, et qui semble la plus attendue pour le visiteur.
Enfin, cette exposition qui a un grand succès à Lille et honore la mémoire de cet artiste exceptionnel, qui propose encore une fois, une surprise totale sur son travail.
Chloé Meunier

Pompidou-Metz : entre centre d’art et musée…
Rencontre avec Hélène Guénin, responsable adjointe du pôle programmation
Découvrir par matin d’hiver, le centre Pompidou-Metz endormi sous une fine couche de givre blanc relève d’un bel instant de grâce… C’est une œuvre architecturale absolument impressionnante quand on sait que la source d’inspiration de l’architecte Shigeru Ban est née de l’achat d’un simple chapeau traditionnel chinois acheté à la Maison de la Chine à Paris ! Le bâtiment se présente coiffé d’un assemblage de poutres d’épicéa en lamelles collées qui s’entrelacent pour former un maillage hexagonal recouvert d’une fine membrane de téflon opaque et transparente de nuit.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval
On retrouve l’idée de l’hexagone dans l’architecture globale de l’édifice avec trois galeries auto portées traversant l’espace en se croisant. Ces trois galeries sont apposées à une colonne métallique sur laquelle est suspendue la toiture, laquelle va se reposer sur plusieurs poteaux-tulipes contournant le bâtiment. Passé le seuil de l’édifice, on entre alors dans une véritable relation sensorielle jouant entre l’espace architectural intérieur et l’environnement extérieur. Celui ci se dévoile à chaque étage par des pans de murs vitrés mettant en œuvre une magnifique interaction avec le panorama de la ville de Metz.
La structure se décline en trois parties avec ses trois galeries, un bâtiment annexe administratif, et un studio ; espace modulable de 500 m² dédié aux arts vivants. La grande nef, vaste hall translucide, permet d’accueillir une diversité d’évènements et dispose d’un premier espace d’exposition. Un auditorium pouvant diffuser films et conférences dont la particularité originale et innovante est attribuée à la réalisation de Shigeru Ban. Le plafond en forme de vagues conçues en tubes cartonnés contribue ainsi à la performance acoustique du lieu. Restaurant, café, bibliothèque, boutique terrasses et jardins enrichissent le lieu.
Le projet visant le mouvement de décentralisationdes collections nationales a été amorcé en 2003 et développé sous le ministère de la Culture dirigé par Jean-Jacques Aillagon. Il représente donc la première expérience de ce type en France. Metz a été retenue pour combler un manque en matière de structures régionales d’art moderne. La ville disposait d’une implantation urbaine et géographique intéressante avec l’idée de construire le musée dans le quartier de l’amphithéâtre (lieu d’anciennes friches ferroviaires). Plus d’une centaine d’hectares autour de l’édifice est dédiée à la construction de centres d’affaires, de commerces et d’habitations dans une démarche de projet HQE[1].
Un fonctionnement autonome
Le centre Pompidou-Metz est un EPCC[2]. Ce fonctionnement autonome lui confère également une plus grande liberté au niveau du choix de la programmation scientifique et culturelle qui cependant est validée et entérinée par Beaubourg. L’établissement ne possède pas de collections propres. Celles-ci ne dépendent pas non plus uniquement de Beaubourg mais peuvent passer par les circuits internationaux et nationaux. Les expositions reçues peuvent être itinérantes comme l’une des prochaines d’Hans Richter, programmée en septembre 2013 et coproduite avec le Lacma de Los-Angeles.
L’un des objectifs du projet scientifique et culturel est de mettre en avant la pluridisciplinarité, en présentant les arts vivants (danse, performance, musique, théâtres, cirque), le cinéma ou des cycles de conférences variés. Le budget alloué aux arts vivants ne représente que 10% du budget global mais cette programmation dans le prolongement des expositions et permettant de mettre en lien un chorégraphe avec un artiste ou un auteur comble les visiteurs. Ainsi dans le cadre d’un partenariat, et sous forme de coproduction avec l’EPCC Metz/Arsenal, l’œuvre majeure Fasede la chorégraphe Thérésa de Keersmaeker sera présentée au mois de janvier 2013 accompagnée d’une conférence Danse les années 80 et la naissance de l’auteur.
Actuellement la danse s’expose, la grande nef présente Parade, ballet présenté en 1917 au théâtre du Châtelet à Paris. Evènement exceptionnel dans l’histoire des arts qui rassembla Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso, Léonil de Massine et Serge Diaghilev autour d’une œuvre magistrale de l’histoire de la danse. De la genèse au processus de création le visiteur défile au gré d’un parcours circulaire aux tons nacrés parmi une sélection documentaire exceptionnelle et centralisé par l’œuvre incontournable du rideau peint de Picasso.
Le FRAC au Pompidou Metz

Crédits : Isabelle Capitani
Au niveau de la galerie 2 est présentée une rétrospective sans précédent en Europe de l’artiste conceptuel américain Sol Lewitt (1928-2007). Trente-trois œuvres murales s’imposent magistralement à travers plusieurs combinaisons de noir et blanc, composées de lignes ou de formes géométriques. Contrairementaux deux autres expositions le parcours se poursuit rectiligne suivant l‘espace parallélépipède rectangle de la galerie.
Œuvre en lui-même, le centre Pompidou Metz rayonne au cœur d’un espace encore en construction ; contraste qui justifie la grandeur de l’art au service dudéveloppement culturel et économique d’une région et l’on ne peut éviter le clin d’œil au petit frère Louvre Lens en lui souhaitant un même second et grand succès dans la nouvelle conquête du territoire Nord-Pas de Calais…
Nous remercions chaleureusement Hélène Guénin pour son aimable présentation de l’institution.
Isabelle Capitani
[1] haute qualité environnementale
[2] établissement public de coopération culturelle

Promenons-nous dans les bois ?
Vous venez de terminer votre balade dans les jardins du Luxembourg, mais peut-être n’avez-vous aucune envie de rentrer tout de suite chez vous, même si le froid vous pique le visage. Vous errez alors dans les rues parisiennes et arrivez sans même vous en apercevoir devant un panneau “Musée Zadkine”. Vous ne vous attendiez pas à rencontrer un musée caché entre deux immeubles et pourtant vous voilà déjà franchissant la grille et vous aventurant dans une petite cour. Encore quelques pas, et vous voici devant une petite maison : poussez-donc la porte, et laissez-vous guider.
En l’espace de quelques mètres, c’est dans un univers carrollien que vous vous apprêtez à voyager. Vous vous trouvez à la lisière de l’exposition, à la lisière de la forêt. Comme tant d’artistes avant vous, vous allez pénétrer un lieu sauvage et sacré, puissamment empreint d’inspiration artistique. Si des vues de forêts d’artistes contemporains, comme Estefania Peñafel Loaza ou Patrick Bard, permettent d’embrasser un large champ, votre regard est néanmoins arrêté par des troncs d’arbres, placés au cœur de la pièce. Vous n’avez nul autre choix que de les contourner, pour enfin les voir se muer en des corps sculptés de la main d’Ossip Zadkine.
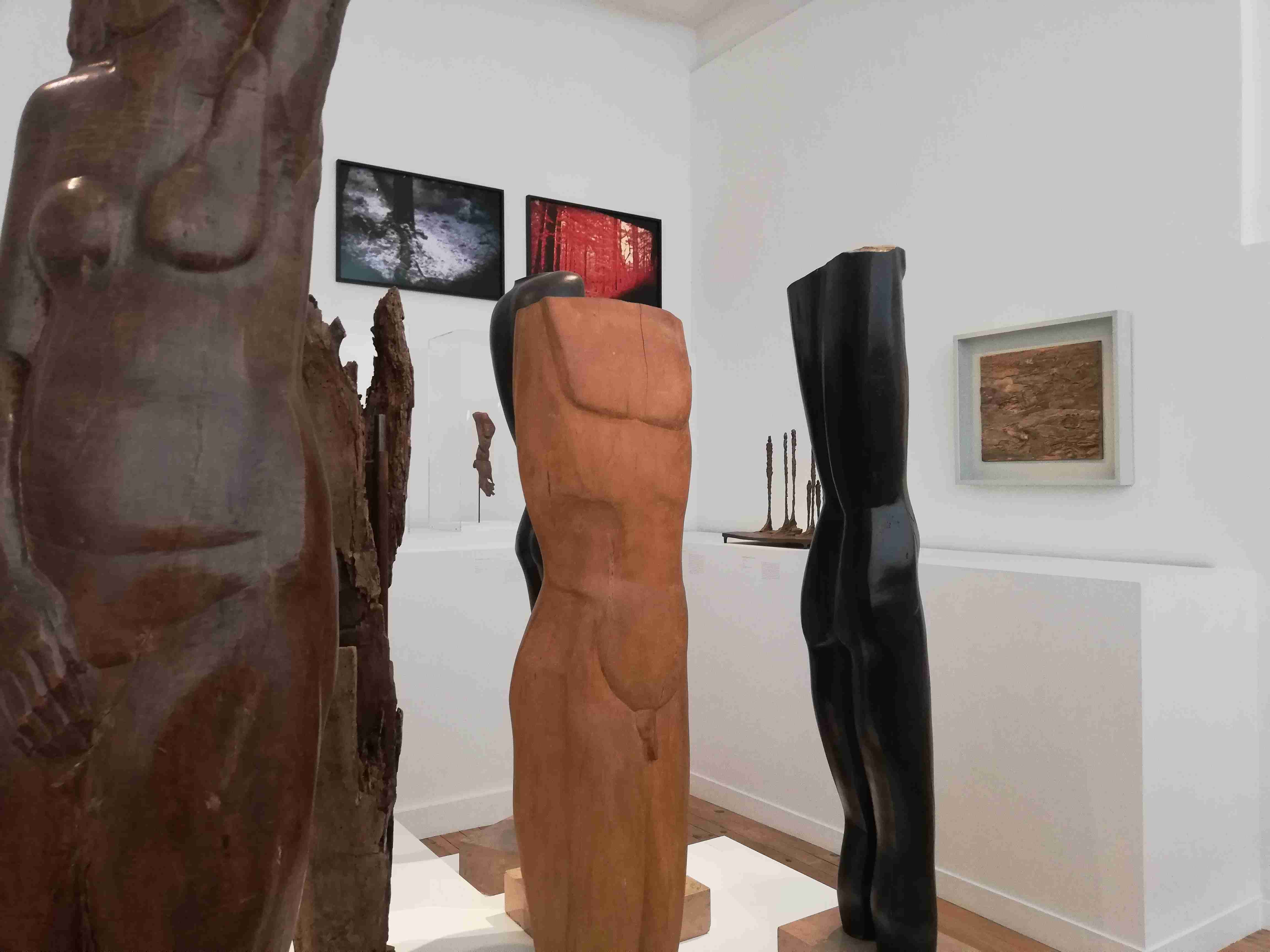
Première salle de l’exposition, sculptures de Zadkine © Jade Garcin
Comme à son habitude, le musée Zadkine met en avant la matérialité de ses collections. C’est pourquoi, les mains, encore engourdies de froid dans vos poches, vous percevez tout de même la douceur de ce bois, sa rugosité, et parviendriez même à le toucher, s’il n’était derrière sa vitre. Le lien entre vous et la forêt commence à se tisser, et vous mène ainsi un peu plus loin dans les bosquets, un peu plus loin dans la création.

Œuvre de Dubuffet / © Jade Garcin
C’est ici que tout commence peut-être à vous échapper. Des formes inconnues se détachent, des bruits vous parviennent, heureusement, quelques figures connues et rassurantes sont là elles aussi. Les meilleurs botanistes de l’exposition s’apercevront de la diversité des espèces : ici, la graine du Sein dans la forêt de Raoul Ubac a donné naissance au Parle Ment Branche (1) et (2) de Laure Prouvost, de 82 ans son cadet.

Les œuvres de Raoul Ubac et Laure Prouvost © Jade Garcin
C’est également un espace de grande liberté, où les formes sont inspirées de développements naturels, par des processus de morphogénèse. Les sons qui nous parviennent dépendent eux aussi de nos actions, comme le serait le craquement des branches au sol.
Vous sortez finalement dans le jardin de sculptures, pas encore prête à retrouver la rue parisienne. L’atelier vous offre alors un dernier moment de rêverie auprès de différents personnages sylvestres, avant de retourner à une réalité plus prosaïque.
Pour vivre cette expérience, vous avez jusqu’au 23 février 2020 pour vous rendre au musée Zadkine.
Jade Garcin
#Zadkine
#Forêt
#Rêveur

Quand je suis devenu peintre
Une après-midi de libre, les beaux jours qui font leur retour timide, une envie de balade muséale agrémentée d’un thé et d’un macaron servis au café … Voilà un contexte bien approprié pour décider d’aller errer dans l’écrin XIXe du Petit Palais.
Malette de peintre et dispositifs de médiation divers © Emeline Larroudé
Sous la hauteur des plafonds peints dans un style fin de siècle, c’est moins l’écrasement d’une architecture monumentale que l’apaisement devant des figures lascives aux colorations douces qui s’opère. Moi, primo visiteur ? Que nenni. Devant cette magnificence, difficile de rester impassible, si bien que s’y rendre devient presque régulier. Et pourtant ! Voilà que cet établissement si souvent arpenté arrive encore à me surprendre. Dans une partie des galeries longeant les jardins fleuris se déploient des expositions temporaires. J’ai eu le loisir d’apprendre, une fois traversé le pont depuis les Invalides, que du 6 février au 13 mai 2018 se tient Les Hollandais à Paris, 1789-1914. Ma foi, un témoignage des échanges artistiques fréquents et souvent emblématiques des artistes peut être enrichissant. D’autant plus que l’affiche mentionne Van Gogh et Mondrian. Si l’un me laisse perplexe, l’autre m’éblouit par sa touche, et la mention de ces personnalités aux styles hétérogènes trahit déjà la richesse du contenu développé. De fait, j’ai rarement été déçu par une des expositions proposées par ce musée municipal Beaux-Arts. C’est alors le pas léger et l’estomac presque vide que je m’avance un peu nonchalant vers les espaces dédiés après avoir pris mon billet. Je salue l’agent de surveillance, je m’imprègne du sujet en parcourant l’introduction, je papillonne sous la verrière de chefs-d’œuvre et continue mon chemin de salle en salle, m’arrêtant ci et là lorsque mon regard se trouve inexplicablement attiré par une composition élancée ou des couleurs vives.
Copie en cours d’un chef-d’œuvre des collections du musée © E. L.
Là, après avoir traversé plusieurs salles présentant les travaux d’artistes qui, avouons-le, ne m’étaient pas familiers, je me plonge dans un Van Gogh qui se cherche, assez peu exploité. Je croise, amusé, des regards perplexes. C’est alors que, tandis que mes yeux longent les murs, j’aperçois une inscription blanche fléchée bien discrète sur ce fond bleu marin, « espace pédagogique ». Espace pédagogique ? Que peuvent-ils bien entendre par-là ? Ne puis-je y entrer sans petits-enfants pour prétexte ? Qu’ont-ils à leur proposer ? De la pratique ? Cela fait-il partie de l’exposition ou est-ce une annexe ? Je m’attarde à proximité, me retourne intrigué pour voir si je suis le seul à avoir remarqué cette signalétique, et constate qu’il y a du passage. La curiosité trop piquée, je ne peux m’empêcher de franchir précautionneusement le seuil d’entrée de cette salle qui, dans l’angle de la porte, semble déjà éblouir de sa lumière comme la source éclairée d’un tableau clair-obscur. Je m’arrête, saisi par la clarté qu’offrent ces grandes fenêtres donnant sur l’extérieur dans cette pièce qui retrouve une hauteur de plafond non-négligeable. Déjà, c’est l’agréable surprise, je me retrouve émerveillé dans un environnement auquel je ne m’attendais pas. Je guette et découvre, après avoir tenté de poser mon regard sur tout ce qui y est installé, que je me trouve en réalité dans L’Atelier du peintre. D’évidence, le public n’est pas plus bambin qu’ailleurs, et bien que quelque peu déstabilisé par la proposition, je me redonne toute légitimité à la parcourir.
Dispositif Dessiner par la fenêtre © E. L.
Réalisation en cours de la plasticienne © E. L.
En effet, se dressent cinq ou six chevalets et leurs tabourets associés au centre de la pièce. Que font-ils ? Faut-il réserver pour participer ? Guidés par une plasticienne, certains visiteurs s’attèlent à tenter de reproduire des chefs-d’œuvre mentionnés par le catalogue de l’exposition. Celle-ci en profite pour m’informer de la gratuité de la participation, des horaires des ateliers, et du reste des informations pratiques qui se trouvent sur le panneau de présentation à l’entrée. Pardonnez ma méprise, mais ce texte tout en longueur est bien la chose la moins attrayante ici. Quand bien même, nous sommes un vendredi après-midi, et le vendredi après-midi, c’est donc atelier Dessiner pour voir. Ma petite fringale tente de me rappeler à l’ordre, mais je suis bien trop obnubilé par les créations en train de prendre forme. Quel exercice laborieux se doit être, mais quel plaisir de contempler ces travaux s’exécuter dans une concentration pleine de sérénité. Regarder, c’est déjà se libérer, profiter d’un apaisement sans commune mesure. La tentation de prendre part est là, mais d’aucun pourrait se raviser devant la peur de mal faire, de n’avoir jamais fait ou de ne pas être à la hauteur (quelle hauteur ?). Si je n’ai jusqu’alors jamais dépassé le stade de novice, j’entends bien cependant que le dessin peut être considéré comme une activité très personnelle et intime, que l’on ne souhaite pas partager avec d’illustres inconnus nous observant avec insistance.
Dessin effectué par un visiteur durant l’atelier Dessiner pour voir © E. L.
Mais le dessin, pour moi, c’est avant tout les croquis esquissés dans le jardin de ma grand-mère, à retranscrire les paysages. C’est l’herbier crayonné en récoltant diverses feuilles. C’est aussi mon oncle qui, peintre amateur, s’est tenté à une carrière d’artiste. C’est un passe-temps trop longtemps délaissé, fruit dont j’ai encore le souvenir du goût, mais que j’ai cessé de croquer. Peut-être que le moment est venu pour moi d’y revenir, dans une émulation mutuelle, ici, dans les espaces aménagés du Petit Palais. Oui, je sens les craies et fusains qui m’attirent. Le café et les macarons vont attendre, la résignation aussi.
Emeline Larroudé
Liens internet :
http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/content/scholar-kits/latelier_du_peintre.pdf
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/les-hollandais-paris-1789-1914
https://www.facebook.com/Petit-Palais-mus%C3%A9e-des-Beaux-arts-de-la-Ville-de-Paris-273861966942/
Quand Vincent devint Van Gogh
Le peintre néerlandais est à l'honneur de la ville européenne de la culture 2015, avec une exposition de soixante-dix peintures,dessins et lettres, à découvrir au BAM (Musée des beaux-arts de Mons) jusqu’au17 mai 2015.
Van Gogh au Borinage, lanaissance d’un artiste retentit comme un blockbuster. Le Borinage est un ancien site minier qui donnait jadis du charbon à l'affleurement avant de creuser des mines. Le nom viendrait du néerlandais « boren » qui signifie « creuser ». C’est là, entre 1878 et 1880 que Vincent Van Gogh décida de se consacrer à la vie d’artiste. L'exposition du BAM n’offrepas seulement les débuts artistiques du peintre, elle dresse aussi un portrait des terribles conditions de vie, dans le Borinage de cette époque qui ne conjuguent que labeurs et misères. Enfin, la plume magnifique de Vincent Van Gogh nous plonge dans son cheminement intérieur, semé de doutes et d’émotions. Elle présente l’être humain derrière le « monstre sacré » et gagne le pari de traiter d’un sujet complexe et sombre.
©DR
La dimension dramatique est franche : salles immenses, murs colorés mats, accrochage minimaliste. Les œuvres, dans des cadres classiques dorés sont éclairées par des spots directionnels. Positionnées à une hauteur imposante, elles obligent au recul sans nécessiter de mise à distance. Malgré l’affluence de ce dimanche après-midi, on n’entend que le parquet s’exprimer.
© DR
Les coloris choisis pour les murs d’accrochage mènent la conversation. Ils reprennent la palette de couleurs des toiles de Van Gogh : bleu céleste, orange, rose, vermillon, jaune très vif, vert clair, le rouge clair du vin, violet. Sans doute, pour mieux souligner ses travaux à la craie noire, au fusain à la mine de plomb et mettre en perspective son génie de la couleur, mais ils interpellent nos mémoires en nous renvoyant sans cesse aux images que nous avons de l’œuvre de Van Gogh. Par ailleurs, l’exposition intègre plus de 20 œuvres que l’artiste copia ou qui influencèrent son travail et qui le rendent plus proche, plus compréhensible.
Pour garder la concentration des visiteurs, un court paragraphe informatif en français, néerlandais et anglais introduit les séquences de l’exposition. De plus, un diaporama de 4 minutes joué en boucle résume le parcours. Les commentaires diffusés sous des bulles sonores permettent un visionnage en simultané dans les 3 langues. On prend avec plaisir ces fils qui nous guident.
L’atmosphère, la lumière douce, appartiennent au répertoire de la confidence et de l’intimité. Dans chaque salle, de confortables divans blancs permettent de s’assoir. Un livret de visite reprend des extraits de la correspondance du peintre, les textes introductifs et explique chaque œuvre. Les textes sont clairs, le niveau de langage et le vocabulaire accessibles, sans termes recherchés ou spécialisés. Dans une salle dédiée, on feuillette les lettres de Vincent Van Gogh sur des tables numériques ou des lutrins. Les lettres numérisées sont retranscrites et illustrées de photos ou des croquis auxquels elles se réfèrent.
© MRH
Enfin, au sein de l’exposition, les visiteurs sont invités à re-colorier La chambre en 3D. Au départ imaginée pour répondre aux besoins de jouer et de toucher des enfants, la chambre blanche est maintenant couverte de ronds de couleurs. Il s’agit de coller des pastilles colorées sur des moulages de meubles identiques au tableau. Comme si chaque visiteur possédait un peu de ce talent qui fait les artistes, adultes, adolescents, enfants et grands-parents jouent de la gommette au petit bonheur, comme une touche de pinceau, et participent avec humour à cette œuvre naissante.
VanGogh au Borinage, la naissance d'un artiste,jusqu'au 17 mai au musée des Beaux-Arts de Mons (Belgique).
Murielle
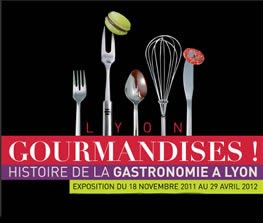
Quenelles, grattons, bugnes et autres spécialités des bouchons à l’honneur !
À l’heure où le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et où la ville de Lyon serait candidate pour accueillir la future cité de la gastronomie française, le Musée Gadagne présente pendant plus de cinq mois une exposition consacrée à la gastronomie lyonnaise.
Intitulée Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon, l’exposition se divise en trois sections : Lyon capitale de la gastronomie : construction d’une légende, les années glorieuses et modernité et nouvelles tendances de la gastronomie lyonnaise. Un parcours chronologique qui permet une approche historique simple et méthodique pour les Lyonnais comme pour les « étrangers » qui ne sont pas spécialistes. Au fil de l’exposition, le visiteur découvre témoignages littéraires, photographies, recettes, affiches, vidéos présentant ou prenant parti pour la cuisine rhônaise. Mis à l’honneur, le patrimoine culinaire de Lyon est célébré, honoré voire glorifié. La guide de l’exposition insiste particulièrement sur les comparaisons faites entre Lyon et les autres villes, terminant ses phrases par un trait chauvinisme non masqué. Certes, si une telle exposition est présentée au Musée d’histoire de Lyon, le Musée Gadagne, un point de vue « patriote » était inévitable… Pourtant peu ancré dans les dispositifs écrits de la muséographie, il a tout de même troublé ma visite par cette guide insistante et son groupe qui semblait me poursuivre dans les salles.
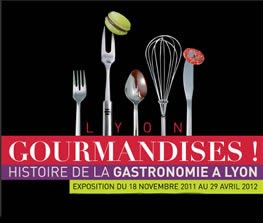
© Musée Gadagne
Mention spéciale pour la scénographie : l’espace d’exposition pas très grand est bien mis en valeur. Deux petites salles nous emmènent dans une cuisine, peinte en vert pomme, qui regorge de meubles (de cuisine bien sûr !) où tiroirs et autres placards deviennent des dispositifs de médiation. Le spectateur, piqué dans sa curiosité, se retrouve comme un enfant dans un terrain de jeu… ouvrant les buffets pour découvrir leurs trésors. La présence de ces outils est une très bonne initiative : les expôts étant principalement des documents écrits et visuellement peu attractifs (lettres, journaux, conseils culinaires, anciennes recettes…), le public n’y jette qu’un bref coup d’œil. Devoir ouvrir un casier et découvrir ce qui s’y cache, capte beaucoup plus l’attention du visiteur, adulte ou enfant.
Nous laissons, ensuite, derrière nous cette cuisine familiale pour nous retrouver dans une ambiance de restaurant… un peu chamboulée ! Ici, les tables se retrouvent sur les murs et les « dessous de bar » servent de cuisine ! En effet, en entrant le visiteur aperçoit sur le mur de droite, les nappes traditionnelles quadrillées de rouge et blanc typiques des « bouchons » (restaurant populaire lyonnais) ; et sur sa gauche, les nappes blanches qui rappellent un autre standing. Le bar du centre sert à la fois de lieu de repos, en nous transportant dans un environnement connu (les discussions s’engagent sans effort, on se retrouve au bistrot du coin…), et de dispositif de médiation pour les enfants qui préparent des plats faits de laine et tissu pour nous les présenter sous la cloche transparente du bar. De nombreux jeux permettent également de découvrir le « parler culinaire lyonnais », les odeurs typiques des mets ou encore leur composition.
D’autres initiatives sont à noter… Durant le temps de l’exposition, les Lyonnais (mais aussi les touristes qui s’initient au plaisir de la gastronomie lyonnaise) sont invités à envoyer témoignages, photos et/ou vidéos qui sont présentés à l’entrée. À la fin, les visiteurs trouveront une nouvelle cuisine scénographiée, plus petite et plus spartiate (celle d’un petit appartement lyonnais ?) où des livres sont proposés à la lecture.
Je regretterai, pour ma part, l’absence de dégustation à la fin de la visite… Entendre parler de cuisine pendant une heure donne envie de se mettre quelque chose sous la dent ! Cependant, c’est que je ne suis pas tombée au bon moment car en regardant le catalogue et le programme de l’exposition, on découvre les différentes propositions. Des rencontres gustatives aux « déjeuners-barvardage » en passant par les conférences ou les balades culinaires dans Lyon, le goût est bien présent dans cette manifestation autant que la vue ou l’odorat. Et pour les gens qui, comme moi, ne peuvent juste voir l’exposition, en sortant de musée le Vieux Lyon s’offre à nous avec toutes ses spécialités gastronomiques.
Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon,
Musée Gadagne, le musée d’histoire de Lyon,
du 18 novembre 2011 au 29 avril 2012.

Rencontre du troisième regard
À la promesse de réouverture au 16 décembre pour les musées français, bon nombre d’expositions ont été montées, prêtes à être découvertes par le public à grands renfort de gel hydroalcoolique.
Parmi ces expositions installées mais fermées au public, il y a Le Regard d’Hélène. Au cœur du Palais des Beaux-Arts de Lille, la photographe Hélène Marcoz propose un dialogue entre ses images et les œuvres du parcours permanent. C’est Jean-Marie Dautel, commissaire de l’exposition, qui m’a accompagnée pour cette visite, l’occasion d’un riche échange autour du regard porté sur l’image photographique :
« - La photo, c’est aussi des goûts qu'on apprend à aimer. Il faut savoir aussi que je n'emploie jamais le mot photo, j'emploie toujours le mot image.
Il me montre Sainte Marie-Madeleine en extase de Rubens, devant laquelle nous sommes assis,
- Vous voyez, c'est une photo, c'est une image. Le processus, le raisonnement est le même. Je me trompe peut-être et il y aura toujours un historien de la photo pour dire le contraire. Mais pour moi c'est la même chose, une photo se compose exactement de la même manière que Rubens a fait pour composer sa mort de la vierge. On va voir la première photo d'Hélène ? »
Le regard d’Hélène : le regard d’Hélène Marcoz
Le regard d’Hélène… pour Jean-Marie Dautel est un titre qui fait référence à Rhomer, au film Le genou de Claire. Mais c’est surtout le terme de « regard » qui m’intéresse. Le regard, c’est ce qui émane des images d’Hélène, c’est ce qui m’attrape, et pourtant, rares sont les visages photographiés. Utiliser le terme de « regard », c’est aussi ce qu’on peut mettre « en regard de » c’est à dire « à côté de » et ça c’est la véritable vision qu’Hélène a apportée, c’est son regard sur le musée, sur les rapports de construction de composition entre peinture et photographie, et enfin le regard qu’elle porte sur les visiteurs.
Les premières photographies sont distillées dans le parcours permanent, installées proches des peintures au gré des associations thématiques et graphiques. Ce sont des images tirées de séries réalisées entre 1998 et 2020. Jean-Marie Dautel m’explique que les choix de positionnements se sont faits en totale harmonie avec l’artiste.
« - Là où c'est une très belle expérience, c'est que tout ce qu'elle a proposé, c'est exactement ce que moi aussi j'aurais proposé. »
Il est clair qu’aucun positionnement n’est anodin, et cela se ressent très fort une fois face à l’œuvre. Le regard ne s’arrête pas aux bords de l’image, il glisse et s’égare sur le mur et les toiles de maîtres à côté desquelles Hélène Marcoz a installé sa photographie. L’image par laquelle je débute mon parcours est un bouquet de lys blanc, de la série Still Alive accrochée à côté d’une vanité de Van Hemessen. De loin c’est un simple bouquet, rien de bien compliqué. Je m’approche, et me fais surprendre par sa réelle complexité : c’est une image multiple, qui semble très animée pour une nature morte !
Je m’interroge sur l’apparente simplicité des images comparé au travail accompli et Jean-Marie Dautel abonde : « - elles paraissent évidentes ! Mais souvent - je m'en suis rendu compte au fil des années dans mon métier - plus une chose est simple, plus en réalité derrière y'a du boulot ! Il y a énormément de boulot pour obtenir la simplicité.
- Un travail bien fait est un travail qui ne se voit pas.
- Oui. Exactement ! Effectivement c'est un vase de forme globulaire avec des fleurs, on pourrait très bien ne lire cette photo que comme ça, mais en réalité ça va beaucoup plus loin, il faut s'approcher, il faut regarder, et il faut prendre le temps de regarder pour s'apercevoir que c'est une vanité.
- Au regard d'une vanité.
- Au regard d'une vanité, qui la regarde. Exactement. C’est ça aussi, le regard. »
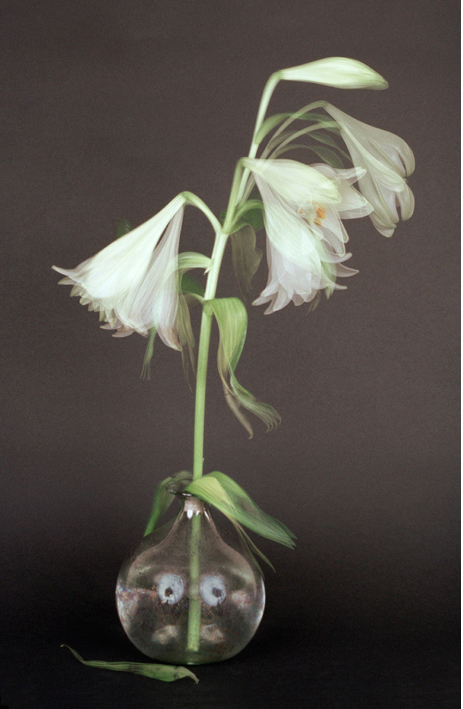
Still alive, Lys blanc, 2010, ©Hélène Marcoz

Le regard d’Hélène, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2020-2021 ©Jean-Marie Dautel
« - Le procédé photographique qu'elle a depuis de très nombreuses années, c'est de la surexposition. Grosso modo, cela peut prendre une à deux semaines de prises de vues : dans son atelier, elle fait son éclairage, règle son trépied, son appareil est posé. Elle ne touche plus à rien et laisse faire le temps. Première prise de vue, elle revient deux ou trois jours après, deuxième prise de vue, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en une seule image, il y en a plusieurs - un peu comme Muybridge ou Marey. La vie qui coule, la vie qui passe. Les fleurs s'affaissent, un pétale qui disparait, dans certains vases on voit même le niveau d'eau qui descend. »

Etienne-Jules Marey, Arab Horse Gallup, 1887 ©CC
Les images d’Hélène rappellent beaucoup la chronophotographie, mais cette technique a été appliquée pour pousser à bout la technique photographique, et décomposer un mouvement rapide, qui ne pouvait être vu à l’œil nu (le galop d’un cheval pour Etienne-Jules Marey). Ici Hélène œuvre sur la chronophotographie du lent, de ce qui ne se voit pas, non pas parce cela va trop vite, par ce qu’on ne prend pas le temps de le regarder. Dans le fond, c’est aussi un éloge à l’attente, à la lenteur, en accéléré. En une image il y a deux semaines de temps. Que ce soit dans sa série Still Alive ou Concrete Jungle (où elle capture la course du soleil) c’est une sensation, une surprise au-delà de l’image, qui nous est offerte.
Les associations à faire sont multiples, tout aussi évidentes que subtiles. Plus loin, une seconde nature morte - des cosmos - à côté d’un bouquet de roses peint par Vuillard. Ces deux bouquets semblent identiques, même techniquement, c’en est troublant. Que ce soit graphiquement ou thématiquement, les liens sont là. À côté d’un paysage de marine, il y a un drapeau de sa série Au vent. Le rapport semble évident entre le drapeau et les voiles des bateaux sur la mer, gonflées par le vent annonçant une tempête dans le port. L’association graphique ne vient que dans un second temps, grâce aux ciels : dans les deux images il y a un petit trou de ciel bleu et un nuage très sombre. Les ciels sont aussi dramatiques et travaillés dans la peinture que dans sa photo, soulignant le soin qu’a pris Hélène Marcoz pour choisir et positionner ses images.

Le regard d’Hélène, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2020-2021 ©Jean-Marie Dautel

Le regard d’Hélène, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2020-2021 ©Jean-Marie Dautel
Dans une autre salle, une vidéo, d’une durée de 10 minutes, est un plan fixe du parc Vauban, à Lille, une brise printanière irise la surface de l’étang et joue entre les feuilles des bambous, un héron passe… Les toiles accrochées au-dessus, à côté sont des paysages romantiques que je n’aurais pas pris le temps de regarder aussi longuement s’il n’y avait pas eu cette vidéo. Surprise : c’est l’hiver ! L’étang est gelé, et les arbres nus. Puis l’herbe verdit à nouveau et le ciel se dégage mais l’étang est toujours gelé… Hélène Marcoz a réussi le tour de force technique de faire passer les quatre saisons en un seul temps.

Le regard d’Hélène, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2020-2021 ©Jean-Marie Dautel
Après

D’après Barthel Bruyn, 2019 ©Hélène Marcoz
C’est enfin au sous-sol, dans le grand couloir devant l’entrée des plans-reliefs, que se visite la série D’après. Commencée en 2018 et toujours en cours, ce sont les images que les visiteur·euse·s s’attendent le plus à voir, le PBA ayant pensé toute la communication de l’exposition autour de cette série. C’est encore la question de son regard sur le musée qu’Hélène expose, mais loin de l’installation formelle des œuvres les unes par rapport aux autres, elle fait rentrer cette interrogation dans le cœur de son œuvre.
« - Pour série D'après, est ce qu'on met les œuvres de sa série en regard des tableaux originaux ? On s'est posés la question, mais on s'est tous les deux dit « non, ça serait trop littéraire ». Est-ce que dans ce cas on ne présenterait pas une seule des œuvres du musée avec la série D'après ?
- Que vous auriez descendu dans la galerie devant les plans reliefs ?
- Oui pourquoi pas, mais on ne l'a pas fait et je trouve qu'on a eu raison. Quand quelque chose se suffit à soi-même on n'a pas besoin d'en rajouter. Il faut arrêter de croire que Mr. et Mme Lambda sont complètement cons, Mr. et Mme Lambda ils comprennent. S'ils ne comprennent pas c'est pas grave, ils ont une belle vision devant eux. Donc la série D'après est bien isolée, sans regard avec les œuvres originales qui, de toute façon, sont sur la photo. »
Sa recherche pour que la technique photographique réponde à une idée conceptuelle fait mouche. C’est une rare satisfaction que de regarder la permanence des toiles et l’évanescence des personnages.

Le regard d’Hélène, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2020-2021 ©Jean-Marie Dautel
Tout est sensible dans ces images, chaque détail tombe juste et les modèles résonnent avec les peintures. C’est doux et intime, un regard à la volée d’une personne qui danse avec l’œuvre, qui joue dans l’œuvre.
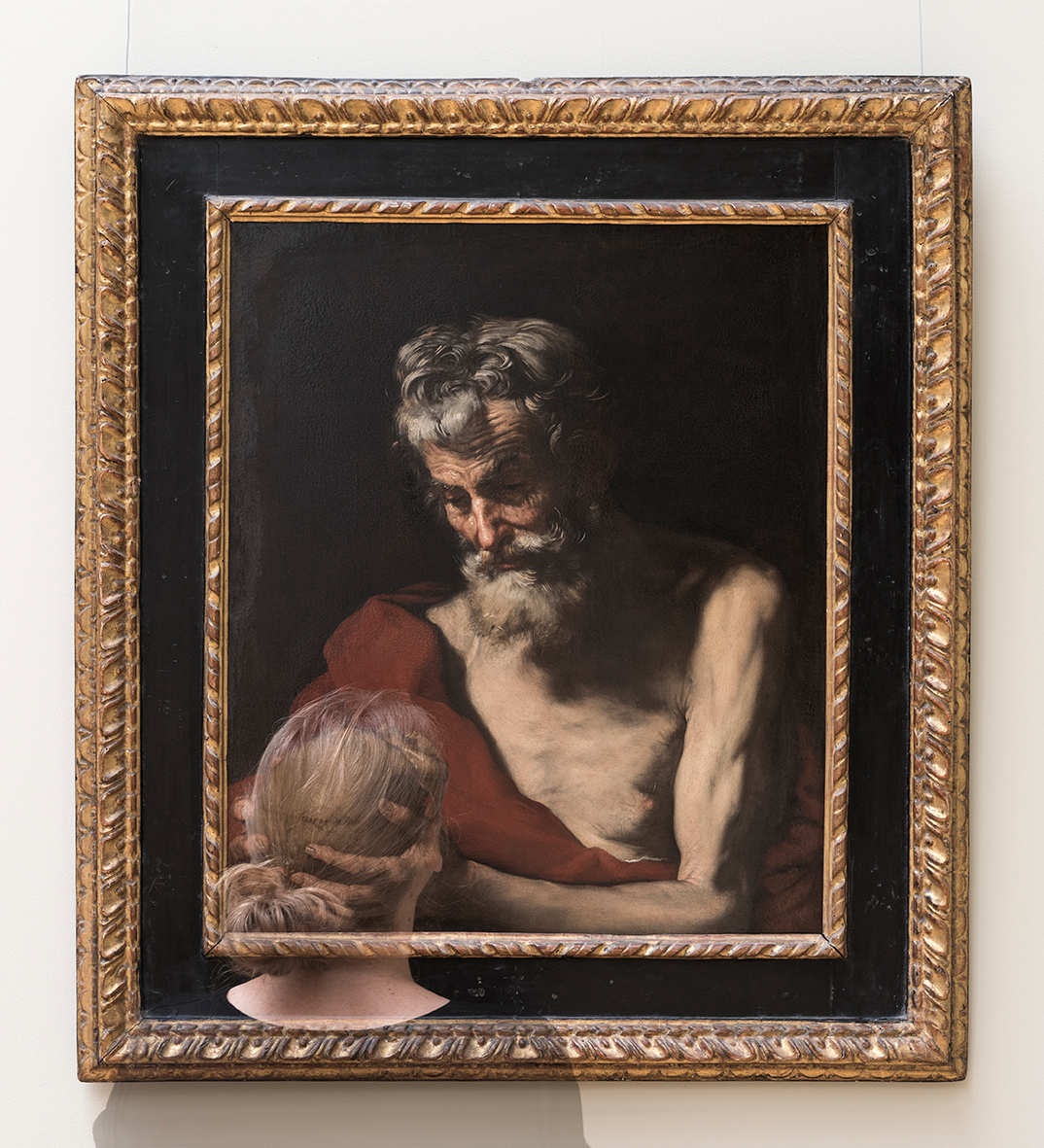

D’après Giuseppe Ribéra, et détail, 2018 ©Hélène Marcoz
Je me sens dans et hors de l’image, je comprends que l’œuvre reste et que moi, je pars. Les œuvres d’art ne font-elles œuvre qu’une fois exposées et regardées ? Ce travail c’est la recherche de la rémanence de l’art dans la mémoire, mais aussi celle des visiteur·euse·s au sein des musées.
Ceci n’est pas un catalogue
Avec le concours du Palais des Beaux-Arts, Hélène Marcoz a pu réaliser une publication où l’exposition devient en fait un prétexte à une réflexion sur le rapport entre la peinture et la photographie. Ce n’est pas un catalogue d’exposition mais bien un ouvrage pour penser et repenser, encore, la photographie et ses enjeux dans les musées. Les différent·e·s auteurs et autrices lèvent ici la question de la naissance du regard photographique, de ce que la photographie et la peinture s’échangent et s’apportent mutuellement au gré des mouvements artistiques. « - On a sollicité des auteurs comme Dominique De Font-Réaulx — Conservatrice générale du Musée du Louvre — qui s'interroge depuis une 20aine d'années sur la relation peinture-photo. Hélène a demandé à Héloise Conésa — conservatrice à la BNF, responsable des collections contemporaines, Sonia Cheval-Floriant — sémiologue. C’est un beau prétexte pour que des gens puissent réfléchir[à travers leurs recherches et le travail d’Hélène] sur le musée en tant qu'objet photographiable. »
Sophie Delmas
L’artiste photographe, avec le PBA, met à disposition une série de six vidéos sur l’exposition, diffusées au fur et à mesure du temps de l’exposition, pour permettre à tou·s·tes d’avoir un peu du regard d’Hélène.
C’est une visite privée où elle parle de son travail et des procédés mis en place dans sa pratique de la photographie. On peut les retrouver la série complète sur la plateforme Viméo, sur laquelle elle publie aussi ses œuvres vidéos : https://vimeo.com/helenemarcoz/videos
L’ensemble de ses travaux est disponible sur son site internet : http://helenemarcoz.fr/
L’exposition sur le site du Palais des Beaux-Arts : https://pba.lille.fr/Agenda/Le-Regard-d-Helene
Merci à Jean-Marie Dautel qui a rendu ce croisement de regards possible.
Rêver l'architecture, parcourir l'imaginaire
Rêver c'est se permettre toute sorte de transgression, c'est l'imaginaire en liberté. Le rêve est créatif et les artistes aiment rêver.« Marcher dans le rêve d'un autre », voilà le titre de la Biennale d'Architecture d'Orléans organisée par le FRAC Centre-Val de Loire.
© Patrick Bouchain
Pour« Marcher dans le rêve d'un autre », il faut parcourir l'imaginaire. Il n'y a pas qu'au FRAC que la Biennale prend lieu, il faut marcher dans la ville, dans la région. Il faut véritablement se mettre en mouvement physiquement et intellectuellement pour rêver. Les rêves s'inspirent de nos habitudes, mais les rêves sont absurdes. La Biennale bouleverse alors le FRAC, la ville d'Orléans,et la région Centre-Val de Loire en créant de l'imaginaire, en nous faisant vivre autrement les espaces.
Tout commence avec le FRAC. Patrick Bouchain, l'architecte invité d'honneur de la Biennale, a décidé de retourner le bâtiment. Je suis orléanaise et j'ai l'habitude d'aller au FRAC mais cette fois-ci tout est inversé. L'entrée est à gauche et non plus sur la droite, le parcours commence par ce qui auparavant le terminait et le visiteur a accès à de nouveaux espaces. Ce geste permet de découvrir l'espace autrement, d'avoir un regard nouveau. Ce qui était avant le hall avec l'espace d'atelier est maintenant devenu le« Haut lieu de l'Hospitalité » pensé par Patrick Bouchain.
Comme dans beaucoup de ses projets, c'est la vie qui est au centre. Le nouvel espace est donc plus accueillant, il invite à s'asseoir, s'installer, lire, discuter, échanger. L'ambiance est intimiste, beaucoup de voiles sont déployés sur la structure intérieure du bâtiment et les lumières sont douces. Même si peu de visiteurs s'installent vraiment dans ce « Haut lieu de l'hospitalité » comme le définit Patrick Bouchain, cela permet de voir le musée autrement. C'est un espace qui accueille la vie et non des œuvres mortes. Ce lieu de partage coloré et reposant crée surtout un vrai temps de pause dans la visite de l'exposition. Pour continuer à rêver et « Marcher dans le rêve d'un autre », des installations d'artistes invités pour la Biennale prennent place dans ce lieu de convivialité (puits de lumière de Lucia Koch, livres de Lukas Feireiss, sculptures de Pierre Bernard).
Haut lieu de l'Hospitalité » © C.D.
Puits de lumière, Lucia Koch © FRAC Centre. Sculptures Pierre Bernard ©C.D.
Dans l'exposition, des éléments appellent au rêve et à l'imaginaire.Beaucoup de couleurs, des lumières intimistes, des passages par des rideaux à ouvrir qui suscitent la découverte, des maquettes disposées de façon anecdotique. Les titres des séquences déterminent les liens entre le fond du FRAC sur l'architecture et cette biennale sur le rêve : « Utopies »,« Paysages », « Architectures », « Haut lieu de l'Hospitalité », « Patrick Bouchain :tracer, transmettre », « Emotions ». Il s'agit d'une biennale de collection et donc certains projets et certaines œuvres ont déjà été présentés lors d'expositions antérieures.Même s'ils sont montrés selon une thématique nouvelle et en regard avec d'autres œuvres, le FRAC a demandé aux artistes invités de créer des œuvres originales spécialement pour cette biennale, ce qui évite l'impression de visiter toujours la même exposition.
Portes rideaux, « Emotive City » Minimaforms, « How to Build Without a Land Blueprint » Saba Innab, ©C.D.
La séquence de cette exposition la plus inédite reste celle dédiée à Patrick Bouchain qui a fait don de ses archives au FRAC en 2016. Il s'agit d'une monographie de l'architecte, en lien avec la thématique de la biennale. La diversité des archives rend la monographie dynamique : maquettes, carnets de recherche, documents d'archives, photographies,etc. Cette séquence est pensée comme l'entrée dans le cabinet de curiosité de l'architecte, dans son atelier mental où le visiteur peut avoir accès à son imaginaire et donc est lui-même invité à rêver. Beaucoup de ses carnets sont exposés et des reproductions sont mises à disposition du public pour pouvoir les manipuler et être au plus près du processus de réflexion et de création.
Séquence« Patrick Bouchain : tracer, transmettre », © C.D.
La visite au FRAC une fois achevée, le rêve n'est pas terminé. C'est finalement en sortant qu'on se rend compte que tout fait écho et que le rêve continue. Impression de déjà vu face à ce drapeau et à cette installation à l'entrée du FRAC. Dans la ville, je peux encore imaginer. Rue de Jeanne-d'Arc, les drapeaux traditionnels ont été remplacés par des drapeaux d'architecture expérimentale conçus pour l'occasion par la scène espagnole, les motifs me sont familiers car vus au FRAC. Le rêve peut même se poursuivre dans d'autre villes, dans toute la région. Si je vais à Fleury-les-Aubrais je peux découvrir les œuvres de Mengzhi-Zeng en résidence au Centre Hospitalier Daumezon et dont des maquettes sont présentées au FRAC. Et à Amilly je peux découvrir les projets rêvés par Guy Rottier.
Nidhal Chamekh ©C.D., Anonyme © C.D., José Maria Yturralde © C.D., Rue Jeanne-d'Arc © FRAC Centre
Pour« Marcher dans le rêve d'un autre » il faut franchir les espaces s'autoriser la divagation, l'absurde, la transgression, comme ont pu le faire les architectes et artistes présentés à la Biennale.
C.D.
#architecture#rêve#imaginaire
Pour en savoir plus :
Biennale d'architecture d'Orléans du 13/10/2017 au 01/04/2018
Lieux de la Biennale :
Dans la ville :
Dans la région :
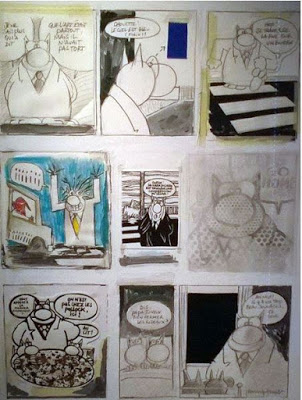
Ronronner de plaisir avec l'art !
La BD au musée
Le Musée en Herbe, situé à Paris, privilégie depuis 40 ans la rencontre entre l’art et les enfants en prenant soin d’aborder les expositions avec humour tout en alliant l’art au jeu. De février à décembre 2016, le musée prouve encore une fois cette dynamique en présentant dessins, sculptures et peintures de Philippe Geluck avec l’exposition L’Art et le Chat. Né le 22 mars 1983 dans les pages du journal Le Soir, Geluck et son Chat acquièrent rapidement un grand succès entre publications, albums et expositions.
L’entrée du 9e art au musée
Depuis peu, la bande dessinée s’impose dans les musées et les expositions qui lui sont consacrées sont en plein boom. De Nicolas de Crécy au Quartier, le centre d’artcontemporain de Quimper aux installations de Blutch, Winshluss et Blanquet à la Ferme du Buisson, la scène nationale de Marne-La-Vallée, en passant par l’intervention de Zep, le père de Titeuf au Palais des Beaux-Arts de Lille, le 9e art envahit les musées. Et ce n’est pas terminé puisque Hergé sera mis à l’honneur en septembre au Grand Palais. Les musées misent sur la bande dessinée pour attirer un nouveau public. Et cela fonctionne, le Palais des Beaux-Arts de Lille avait attiré en 2015, 80 000 visiteurs dont 70% étant des primo-visiteurs[1] lors de l’Open Museum interDuck. Un collectif de peintres allemands parodiait des œuvres célèbres de bande dessinée américaine en y ajoutant des têtes de canard : une statue de Toutankhamon devenant ainsi Duckankhamon.
La collaboration entre Geluck et le Musée en Herbe participe à cet enthousiasme pour l’entrée de la bande dessinée dans les lieux institutionnels. La volonté d’attirer un public nouveau mais surtout de faire aimer l’univers muséal aux enfants semble être l’objectif principal de l’exposition. Le tête-à-tête entrebande dessinée et Art, ne fait alors que commencer !
Le chat joue au critique d’art
L’art et Le Chatpropose tout au long du parcours, un face à face entre les pensées humoristiques du Chat de Geluck et les œuvres de grands noms tels que Pierre Soulages, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jeff Koons ou encore Jean-Michel Basquiat. Pour Geluck, il est question de rendre hommage à ces artistes tout en portant une réflexion sur l’Art.
À gauche une œuvre de l’artiste César, à droite la « Salade César » de Geluck. © TorreLaurence
Une trentaine de chefs d’œuvre de l’antiquité à aujourd’hui et mêlant tous les styles sont alors confrontés au regard critique et à l’humour du Chat. Ainsi nous rencontrons un Chat qui « réfléchit », une « Salade César » ou la vision du cubisme par le Chat. Chaque œuvre possède son pendant signé Geluck et un clin d’œil humoristique nous rappelle même le plafond de la Chapelle Sixtine.
©Torre Laurence
L’art et le Chat est une exposition qui nous met en confiance avec l’art, elle nous permet de l’appréhender avec humour et offre de nouvelles clés de lecture des œuvres.
« De 3 à 103 ans »
L’exposition vise un public large et, comme le Musée en Herbe voit large, il considère les personnes de 3 à 103 ans ! Les premiers visiteurs ciblés sont les enfants, les œuvres de l’exposition sont d’ailleurs accrochées à 90 centimètres en général afin d’être à leur hauteur.
Lesœuvres sont alors plus facilement visibles pour les tout-petits, tout en évitant les reflets. En plus d’un programme d’activités complet destiné aux enfants, un carnet de jeu de piste est offert à l’entrée. Il est proposé en deux niveaux de difficultés différents : pour les chats et les chatons. La difficulté des questions s’adapte alors à l’âge de l’enfant puisque le livret chaton est destiné à ceux ne sachant pas encore lire.
À la fin du parcours, une fois les énigmes autour du Chat et des œuvres résolues, un chocolat à l’effigie du matou est alors offert à l’enfant comme récompense. Des jeux, en rapport avec les œuvres, sont également mis à disposition sur le parcours comme par exemple des cubes devant un tableau de Picasso. Ainsi, tous les éléments sont regroupés afin que la rencontre entre l’art et les enfants soit la plus positive et interactive possible. Mais cette exposition plaît autant aux adultes puisque l’humour de Geluck ne laisse personne insensible. Jeux de mot et clins d’œil entre les œuvres nous poussent à réfléchir et à redécouvrir l’art à travers un regard différent.
Des médiateurs sont également présents sur l’ensemble du parcours afin de donner quelques clefs de compréhension et d’échanger avec les visiteurs sur les sens cachés des œuvres et autres plaisanteries de la part de Geluck.
© Torre Laurence
Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre des rires dans le musée et ce jusque dans les toilettes… Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse aller découvrir l’exposition, ouverte jusque décembre 2016.
C.B.
Pour en savoir plus :
#Le Chat # Geluck # Musée en Herbe
[1]Potet Frédéric, Au musée, la BD en ébullition,15 avril 2016,Le Monde [en ligne] http://www.lemonde.fr/arts/visuel/2016/04/15/la-bd-entre-au-musee_4903162_1655012.html

Sade, attaquer le soleil
Lorsque le musée d'Orsay ouvre une exposition temporaire, il est difficile de l'ignorer. Quand on ajoute les cris poussés par le grand public à la vue d'un clip de promotion plutôt sensuel, mettant en scène des corps nus, tordus, pressés les uns contre les autres, allant jusqu'à en restreindre l'accès à la vidéo au moins de 18 ans, cela devient impossible. A force d'en entendre parler, et pour peu que le sujet soit intéressant, ou même juste intriguant, il y a forcément un moment où on trouve le moyen d'y aller (de préférence le jour où l'entrée est gratuite).
Et donc, au cas où personne ne le saurait, l'exposition « Sade. Attaquer le soleil » a ouvert, le 14 octobre 2014 et fermera le 25 janvier 2015. Déjà, le nom de l'exposition a de quoi attirer l'attention : une exposition parlant d'un personnage aussi controversé ? Je demandais à voir ! Parce que oui, la façon dont un sujet tel que cet homme, dont certains trouvent, qu'il avait du génie alors que d'autres ne veulent pas en entendre parler comme d'un véritable auteur, me questionnait. Et puis l'intitulé restait, pour moi, assez mystérieux.
Le résumé de la thématique consulté sur le site d'Orsay indiquait que la dimension qui serait abordée serait celle des micro-révolutions que l'œuvre de Sade aurait apportées aux normes artistiques de son époque, et qui resteraient encore d'actualité. Je vous livre un extrait du dit-résumé, juste pour vous mettre en bouche :
« L'œuvre du « Divin Marquis » remet en cause de manière radicale les questions de limite, proportion, débordement, les notions de beauté, de laideur, de sublime et l'image du corps. Il débarrasse de manière radicale le regard de tous ses présupposés religieux, idéologiques, moraux, sociaux. »
Tout un programme. Même si l'idée restait très nébuleuse.
 Franz von Stuck, Judith et Olopheme
Franz von Stuck, Judith et Olopheme
Il faut que je précise quelque chose : je n'ai pas pris l'audioguide. Je pense que prendre un audioguide, pour voir une exposition, peut être enrichissant, mais ne doit pas être nécessaire. Le musée d'Orsay n'est pas réputé pour être le moins cher de Paris alors, me croyant maligne, j'y ai été le premier dimanche du mois, pour entrer gratuitement. Mais jen e m'attendais pas à devoir payer 5 euros pour l'audioguide de l'exposition temporaire. Par principe, j'ai dit non. La somme peut paraître modique, mais pas pour moi. En grève d'audioguide et armée de mes seules (et pauvres) connaissances scolaires sur le marquis de Sade, j'ai commencé la visite.
Etes-vous déjà entrés dans une salle de cinéma, en retard, pour vous rendre compte au bout de quelques minutes que vous vous êtes trompés de film ? Les premières salles, qui sont celles qui doivent donner envie de continuer, m'ont laissé une impression de grand fouillis. Plusieurs écrans où passent de vieux films noirs et blancs dont le nom n'est visible qu'à la fin de chaque extrait, des tableaux de plusieurs époques différentes, quelques citations de Sade aux murs... Et c'est tout. Pas d'explications. Juste cette sensation d'être au mauvais endroit. Et cette impression s'est renforcée au fur et à mesure de ma visite.
Pour être claire, je pense que le plus grand défaut de cette exposition est son manque d'explications et peu de supports de médiations mis en place. Je suis restée dans le brouillard le plus complet jusqu'à ce que, dans la troisième salle, je finisse par trouver (enfin) un panneau m'expliquant succinctement de quoi allait traiter l'exposition : l'influence des œuvres de Sade sur les formes artistiques de son époque jusqu'à aujourd'hui.
Une fois que la démarche expographique est clairement indiquée, les choses s'éclairent, et la recherche de liens logiques peut commencer. Par la suite, l'exposition se compose d'une multitude de pièces, de taille limitée, concernant chacune un thème bien précis, étudié en partant du point de vue de Sade, vers celui des peintres, sculpteurs, photographes ou autres qui l'ont représenté : le lien entre désir et violence, La luxure et la Révolution, le désir et l'infini, le sexe et la religion, etc. Tous cela par couple d'idées, dont les liens sont explicités par des œuvres et des citations des ouvrages de Sade.
Si il reste difficile de percevoir les limites entre les différentes « zones », c'est aussi que ces notions sont imbriquées les unes dans les autres. La multitude de sujets traités relève sans doute du parti pris par le commissaire d'exposition Annie Le Brun (auteur de plusieurs ouvrages sur Sade, et de l'exposition « Petits et grands théâtres du Marquis de Sade »). Cela a l'avantage de mettre en lumière la variété de sujets que le Marquis de Sade a traité au cours de sa vie, et le désavantage de perdre, encore une fois, le visiteur.
La scénographie reste très cohérente. Il faut reconnaître que ces espaces plutôt réduits par rapport à l'espace d'exposition permanente, installe une atmosphère plus calme, peut être même intime, bien que plutôt sombre, me faisant penser à ce qu'on appelait un boudoir à l'époque du Divin Marquis.
Je suis sortie avec des impressions plutôt mitigées de « Sade. Attaquer le soleil ». Je ne peux pas dire que j'ai vu l'exposition en détail, vu la taille du lieu, et je pense que l'audioguide doit être un support nécessaire à cette visite. Mais, ne l'ayant pas pris moi-même, cela reste une supposition.
Léa Gretchanovsky
#Beaux Arts
#Marquis de Sade
#Médiation
Sens et essence des meubles de Jean Nouvel
L’exposition « Jean Nouvel, mes meubles d’architecte. Sens et essence » annonce le retour de cet architecte renommé suite à une absence de 20 ans au musée des Arts Décoratifs à Paris dont il a aménagé les espaces dédiés aux expositions de graphisme et de publicité en 1998. Il a eu carte blanche pour mettre en place sa propre exposition du 27 octobre au 12 février 2017.
« Un meuble, une table, une chaise, un bureau, c’est une architecture en soi »
Jean Nouvel est bien une véritable star du bâtiment. On lui doit l’Institut du Monde Arabe, le Quai Branly, mais aussi l’antenne du musée du Louvre à Abou Dhabi. Cet architecte est souvent mis en avant pour ses réalisations architecturales. Cependant, l’exposition fait connaitre une facette moins connue de Jean Nouvel en présentant son travail de designer d’objets et de mobilier. Peu d’architectes contemporains ont créé une aussi importante collection d’objets de design.
Ensemble de tables de Jean Nouvel © SP
« Je ne suis pas un designer, mais un architecte qui fait du design »
Dans son travail d’architecte-designer, Jean Nouvel explore les modèles les plus communs. Que ce soit une table, une armoire ou un fauteuil, le « sens » de l’objet est étudié puis décortiqué afin d’en extirper « l’essence ». C’est en somme le même but qu’il poursuit à travers toutes ses créations ; « faire du sens et du sensible ».
Par contre, il considère son mobilier comme de l’anti-design. Jean Nouvel crée des meubles qu’il dessine en rapport avec la fonctionnalité spécifique du meuble et son ancrage dans la culture de l’époque. Jean Nouvel préfère la rigueur à l’exubérance, afin de créer un mobilier élémentaire, qu’il définit en tant que petite architecture de poche. Sa pratique est comparable aux typologies classiques déjà existantes tel que le « Less is More » de Mies van der Rohe.
Tables modulables de Jean Nouvel © SP
« L’émotion naît toujours de la rencontre entre la complexité des problèmes posés et la simplicité de l’objet réalisé »
L’exposition présentée par Jean Nouvel engage un dialogue avec le lieu, son histoire et sa collection. Séparée en deux sections, elle n’impose aucun parcours ou sens de visite.
La première section invite le visiteur à découvrir les pièces iconiques de l’architecte, la gamme de meubles de bureau « Less » et « LessLess ». Malgré une première pièce qui ressemble beaucoup à un showroom, le visiteur se sent rapidement libre de se promener à travers cet espace de l’exposition, de découvrir toutes les étapes de création des meubles, de s’enthousiasmer de la fonctionnalité aussi simplissime qu’elle soit, et même d’être invité à tester le confort des canapés et des chaises.
Première salle de l’exposition © SP
Entre les tables planes et fines et les armoires parallélépipèdes, la réflexion de Jean Nouvel sur son métier d’architecte et l’architecture du meuble est relatée via des écrans disposés dans chacune des salles. Jean Nouvel se transforme en guide et invite le visiteur à dialoguer avec le lieu et les œuvres.
Pour cette première section, Jean Nouvel a mis en place une scénographie qui ressemble à ses meubles : simples et fonctionnels. Dans les anciens appartements du Palais du Louvre, principalement des meubles exposés et quelques écrans numériques y ont été installés. Seul le couloir drapé d’un tissage sombre fait exception.
La deuxième section de l’exposition étonne : l’architecte y associe ses créations avec des pièces des collections permanentes d’époques qu’il affectionne particulièrement. Le visiteur se promène dans les galeries du Moyen-âge, de la Renaissance, du XVIIème et XVIIIème siècles en étant épaté d’y admirer les meubles de Jean Nouvel.
La Table au kilomètre (2011) se confronte aux retables et aux Pietà, alors que les sièges Milana (1995) dialoguent avec les Sgabelli, des sièges en bois polychrome du Palais des Doges du XVIème siècle.
Table au kilomètre © SP
Cette mise en scène fonctionne grâce à la poésie que créée le dialogue entre collections et mobilier de l’architecte, mais aussi aux jeux de lumières qui plongent le visiteur dans une semi-obscurité.
« L’architecture est à la fois grande et petite, qu’elle n’est pas moins intérieure qu'extérieure »
Au final, cette collection d’une centaine de pièces de mobilier demande à être explorée par le public. L’association du mobilier contemporain avec des œuvres datant du Moyen-âge jusqu’au 18ème siècle peut dérouter, mais impressionne rapidement grâce à la poésie créée.
Avec cette exposition, Jean Nouvel nous prouve que ce musée de l’objet, le musée des Arts décoratifs peut accueillir l’architecture en l’occurrence dans sa forme de poche.
Sarah Pfefferle
# Jean Nouvel
# Anti-design
# Architecture

Six lycéens (em)portés dans les collections
Des idées ? Un smartphone ? L'envie de passer du temps dans un musée ? Ce concours national est peut-être fait pour vous... Musées(em)portables fédère de nombreux participants dans les Hauts-de-France chaque année. Une démarche activement soutenue par le Master Expographie-Muséographie à l'Université d'Artois.
Juliette Gouesnard et Camille Roussel-Bulteel, étudiantes de ce Master 2, ont accompagné plusieurs jeunes dans leur découverte d'un musée. Ces lycéens ont ainsi pu mener leur projet jusqu'à la réalisation de leur film et leur participation au concours.
La série vidéo "Médiation au musée" témoigne de cette expérience :
- Deux lycéens et leur professeur au musée d'histoire naturelle de Lille
- Quatre lycéennes et un portable au musée de la Chartreuse de Douai
La prochaine édition de Musées (em)portables sera lancée le 1er juillet 2017 pour une remise des prix en janvier 2018 : infos et formulaire d'inscription.
Juliette Gouesnard (réalisation vidéo) Camille Roussel-Bulteel (réalisation vidéo)
Hélène Prigent (article)
En savoir plus :
- Prix 2017 Musées(em)portables : le 2ème prix ICOM remporté par les centres socio-culturels d'Avesnes-sur-Helpe et de Fourmies et le Master Expographie-Muséographie (MEM),
- Expériences et films réalisés par le MEM pour Musées(em)portables,
- Musée d'histoire naturelle de Lille,
- Musée de la Chartreuse de Douai.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
10 mai 2017
#concours
#smarphone
#création

Souvenir de stage : Une approche de la conservation préventive
C’était où ?
Mon stage de M1 s’est déroulé au sein des Musées d’Art et d’Histoire de la Rochelle : un ensemble de trois musées regroupant le musée des Beaux-arts, le Musée du Nouveau Monde, et la collection du musée d’Orbigny-Bernon, actuellement fermé au public.
Grâce à mon poste polyvalent, ce stage m’a offert une vision plurielle permettant de découvrir ou d’approfondir un grand nombre de disciplines du musée, notamment en termes de muséographie, de scénographie, d’animation, de public, d’organisation d’évènements, etc. J’aimerais aujourd’hui partager mon incroyable expérience du monde étonnant et fascinant de la conservation préventive, au sens professionnel du terme.
En effet, durant une semaine, une petite vingtaine d’étudiants de l’Institut National du Patrimoine est venu réaliser un chantier d’école dans les collections. Ils ont eu pour mission de mettre en place une action de conservation préventive sur les collections du musée fermé au public. Avec mes deux acolytes stagiaires, nous avons eu la chance de les assister et de participer à leur projet en tournant au sein de leur équipe.
Organisation !
Nous avons été répartis en plusieurs ateliers, qui ont fait l’objet de roulement suivant les journées, pour que tout le monde puisse s’exercer dans les différentes spécialités. La collection Extrême-Orient a été prise en charge par 2 équipes : les bouddhas et les laques (+ collection samouraï). Une grosse équipe s’est chargée des plâtres, une autre des arts graphiques (peintures, posters, cartes, …) puis une équipe en textiles et accessoires d’uniforme (casques, armures, épaulettes,…).
Ce travail m’a fortement fait penser à un texte de Bruno Foucart dans lequel il parle des moyens de conservation du patrimoine comme d’un service de santé[1]. En effet, pendant une semaine j’ai plutôt eu l’impression de travailler dans un bloc opératoire que dans un musée.
D’abord, il faut toujours porter des gants, puisque notre peau n’est pas neutre et que son acidité est une menace pour les objets. Le port du masque est fortement conseillé, car même si l’on ne voit pas la poussière, celle-ci est bien présente et elle provoque rapidement des quintes de toux chez les personnes qui ne sont pas protégées. Enfin la blouse est préconisée dans le traitement des gros objets et des objets infestés.
Qu’est-ce qu’on a fait ?
Ma première mission a été le dépoussiérage d’une multitude de bouddhas. Pour cela, on utilise des brosses en poils de chèvre, des microfibres avec des piques en bois pour aller dans les interstices, des minis aspirateurs, et des brosse à poils plus durs pour les plâtres. Les gestes de dépoussiérages doivent être précis et organisé. On ne le fait pas dans n’importe quel sens, et on ne commence pas n’importe où. Avant de commencer, on doit d’abord vérifier l’éventuelle fragilité de l’objet.
Après le dépoussiérage, chaque objet est ensuite photographié et inventorié. Ainsi, une saisie numérique permet de rapporter un certain nombre d’informations sur l’identité de l’objet et sa localisation précise de l’objet dans les réserves, des informations descriptives sur les matériaux, la taille, la technique…, un descriptif précis de l’état de l’objet (diagnostic général, et précision sur les altérations, les marquages, …)
Puis les objets sont conditionnés. Le conditionnement répond à une technique bien précise, et doit pouvoir s’adapter aux différents objets.
Le cas des bouddhas montre le professionnalisme du conditionnement : les cartons acides ont été protégés par du papier spécial qui est poli d’un côté pour empêcher la réaction électrostatique. Puis les bouddhas sont placés dans des mousses où leur contre-forme est faite sur mesure, puis protégés par du Tyvek©. Le tout est entreposé dans des étagères qui sont venues remplir les anciennes salles d’exposition du musée. Les étages, les salles, les étagères, les rayonnages et les cartons sont numérotés de façon à pouvoir localiser exactement les objets.
En conclusion...
Le travail avec les étudiants était extrêmement riche et important pour le musée. A 20, nous avons traité et conditionné 450 objets en une semaine. Il permet de faire une formation au personnel du musée sur les bonnes pratiques de conservation préventive. Ensuite, il a permis un travail titanesque en un laps de temps très réduit.
Les objets ont été stockés dans des lieux plus adaptés à leur conservation (température, hydrométrie) et une salle de quarantaine a été aménagée pour les objets infestés. Cela permet à la fois de ne pas infester les autres objets qui eux sont sains mais cela va aussi permettre de contrôler les évolutions possibles des infestations ou des moisissures. Cette salle va continuer d’être étudiée par les élèves et restera à leur disposition pour leurs recherches, pour leurs cours, comme un cas pratique. Travailler conjointement entre étudiants est extrêmement bénéfique, tout le monde se retrouve gagnant. Le musée a sauvé une grande partie de sa collection qui était extrêmement menacée, et il a appris des notions importantes en termes de conservation préventive.
Mélanie TOURNAIRE
[1] « Les architectes-chirurgiens chargés d’opérer sur le front des ruines sont assistés d’un véritable service de santé monumentale. » Bruno Foucart, « A l’aube du troisième millénaire », in Des Monuments historiques au Patrimoine du XVIIIe siècle à nos jours, ou les égarements du cœur et de l’esprit, Françoise Bercé, éditions Flammarion, Série Art-Histoire-Société, 2000.
Liens :
Musées d'Art et d'Histoire de la Rochelle
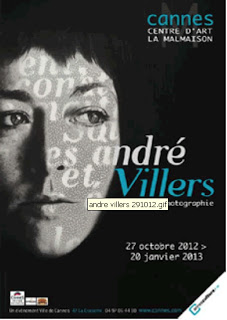
Sur la Croisette, l’art aussi y trouve sa place !
Lors des mes dernières vacances au soleil j’en ai profité pour visiter le Centre d’art : la Malmaison, qui se situe sur la croisette à Cannes.
Leo Ferre , cliché d'André Villiers
Oui, juste là ! Un endroit où l’on ne s’y attend pas. Ce centre est situé dans le seul pavillon rescapé du premier ensemble de l’ancien Grand Hôtel qui a été construit en 1863 et habité jusqu’à la fin des années 1950. Il fut démoli puis reconstruit en 1963 puis acheté par la Ville en 1970 et converti en espace muséal en 1983.
Cette petite galerie accueille des expositions temporaires. Mais évidement à La Croisette on n'expose pas n’importe qui ! Il s’agit, ici, des peintres, sculpteurs, photographes, etc. de grand renom : Picasso, Matisse, Miró, etc. et bien d’autres encore, connus et reconnus internationalement. « Ces collections prestigieuses et contemporaines sont valorisées par le caractère intimiste du lieu et par ses salons aux charmantes proportions de maison » préconise le site internet de la ville de Cannes à son sujet.
Cet hiver c’est donc André Villiers qui y est présenté. Ce photographe, de la ville voisine de Vallauris, est connu pour ses clichés de grands artistes : Fernand Léger, Jacques Prévert, Le Corbusier, Salvador Dalí, Joan Miro, Marc Chagall, Max Ernst, Jean Cocteau, Bram Van Velde, Pierre Soulages, Luis Buñuel, Federico Fellini, Léo Ferré, et encore bien d’autres…
C’est une rétrospective, de tous ses travaux et œuvres, qui lui est consacrée. Cette exposition est une invitation à la découverte de ce photographe ainsi que de son travail ; on y trouve des portraits, des photos de paysage et en grand nombre, des œuvres qui exemplifient la facette de sa recherche en chambre noire ; lors du processus de développement1 des photographies (réalisation des encadrements, et d’autres interventions). Des créations inédites provenant de sa collection personnelle !
Il s’agit d’une exposition avec une scénographie assez simple, la mise en scène est constituée de murs blancs, d’œuvres encadrées très sobrement, quelques cimaises, un faible éclairage, des cartels très simples et rien de plus. Du point de vue du visiteur cela m’a paru froid et sec comme approche, même si cela était interdit (certainement à cause des politiques des droits d’auteur) j’ai pris le risque pour mes lecteurs, de prendre quelques photos.
Vous verrez que je n’exagère pas, et que dans le contexte urbain immédiat de cette salle d’exposition, on peut remarquer un contraste assez flagrant. L’exubérance des décors, animations, couleurs, illuminations, motifs graphiques, des vitrines riches et éclatantes qui s’alignent le long de La Croisette, s’oppose complètement au style d’accrochage dépouillé qui règne dans les 390 m2 qu’offrent les salles de la Malmaison. Si on ajoute à cela le manque de textes dans les lieux, on se retrouve dans une exposition à caractère contemplatif, qui vise légèrement à une réflexion sur le travail de Villers. C’est un parcours qu’on laisse parcourir seul au visiteur, car nulle médiation (hormis l’accrochage et les cartels sommaires) est mise en place, et l’information fournie n’est pas plus approfondie que ce que l’on souhaiterait.
Tout cela ne m’a pas empêché de m’abstraire un peu de l’ambiance qui régnait sur La Croisette, et passer un moment paisible et agréable.
Andrea Vazquez
1Techniques de développement et tirage / photocollage

The Gift – L’histoire des donations architecturales. Une exposition au Architekturmuseum der TUM de Munich
Vue d’exposition « The gift. Stories of generosity and violence in architecture » © Gasgar Lucas
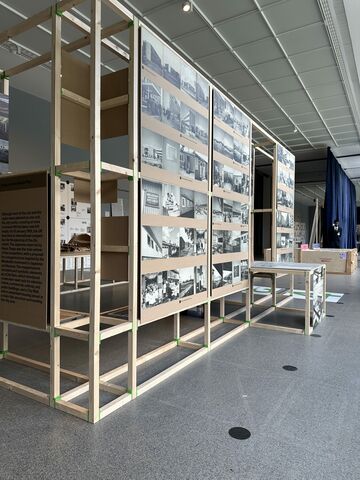
Vue d’exposition « The gift. Stories of generosity and violence in architecture”
Le contexte historique des donations architecturales
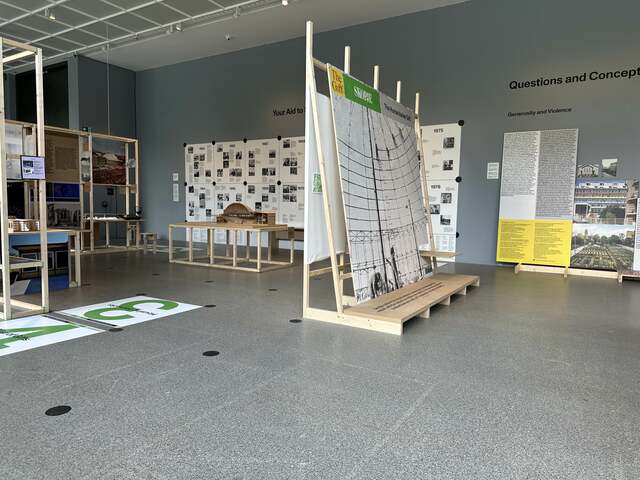
Vue d’exposition « The gift. Stories of generosity and violence in architecture »

Vue d’exposition « The gift. Stories of generosity and violence in architecture »
La vie des populations
Sources :
- https://www.architekturmuseum.de/en/exhibitions/the-gift/
- https://www.architekturmuseum.de/wp-content/uploads/2023/09/AM_THE_GIFT_BROCHURE_SCREEN_AUFLAGE2-1.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=arunnmFkOsM
- https://www.e-flux.com/architecture/the-gift/
- https://www.youtube.com/watch?v=ETAGTSbIQ6w
#Nuit ; #Hotel ; #Experience
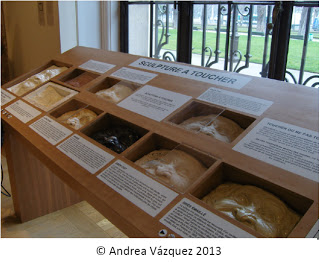
Tous égaux au Petit Palais!
J’ai trouvé un outil de médiation bien curieux au Petit Palais dans la collection permanente. Il s’agissait d’une grande table, une table de Sculpture à toucher, où l’on peut trouver et toucher 9 moulures, d’une dimension d’environ 35cm x 15cm.
J’ai trouvé un outil de médiation bien curieux au Petit Palais dans la collection permanente. Il s’agissait d’une grande table, une table de Sculpture à toucher, où l’on peut trouver et toucher 9 moulures, d’une dimension d’environ 35cm x 15cm. C’est une partie d’une sculpture, reproduite en divers matériaux, et/ou diverses étapes d’un procès avec un même matériau. Bien qu’au début je l’ai considéré comme un outil conçu pour les personnes handicapes (mal voyantes), après l’avoir, bien évidemment, essayé, et je me suis en fait rendu compte qu’il était vraiment enrichissante pour la visite pour n’importe quel type de public.
J’ai donc décidé aujourd’hui de vous parler de cette démarche qui mesemble bien intéressante et qui s’appelle la Conception Universelle. Elle préconise qu’au lieu d’adapter un outil à un handicap, cet outil est conçu depuis le début pour être accessible, et porteur d’informations à travers les expériences, la médiation, pour un large public.
On y trouve : du texte, du braille, ainsi que du son mais en plus on peut toucher ces sculptures pour connaitre la sensation que donne chaque processus, chaque matériau. Ce qui sert sert aussi au plus commun des visiteurs, car dans la plus part des musée il nous est toujours interdit de toucher, et on ne peut qu’imaginer les sensations.
Le petit extra que j’ai trouvé très sympathique et très utile pour les conservateurs, est une petite explication sur les conséquences qui peuvent avoir lieu si on touche les vraies œuvres. L’érosion dont elles souffrent, donc l’importance de les préserver et bien faire attention à elles. Le tout accompagné d’un exemple : les échantillons étaient à moitie protégés pour bien exemplifier la différence entre une sculpture à la quelle on fait attention et une autre à laquelle on touche tout le temps.
Ceque je trouve super intéressant dans cette démarche, est le fait de ne pas faire une différence entre les publics selon ses conditions physiques ou motrices, mais de pré-concevoir l’utilisation de cet outil par tout le monde. Par ce fait on est un peu plus prêt de l’égalité, car le public handicapé ne se sent plus « à part », quant aux autres, tout le monde peut profiter des expériences offertes par cet outil et enrichir ses connaissances.
Andrea Vazquez

Toutankhamon à Paris : des expositions pharaoniques
Toutânkhamon et son temps : la révolution des expositions temporaires
De plus, l’exposition dure : initialement prévue pour 4 mois, elle fermera finalement ses portes au bout de sept. L’affluence qui en découle est aussi un des facteurs d’innovation. Chacune des 1 200 000 entrées fut payante, afin de sauvegarder les trésors de Nubie. Même les scolaires devaient payer 1 franc pour entrer. La fréquentation est elle-même exceptionnelle : 108436 élèves sont venus admirer le trésor du pharaon. Toutânkhamon et son temps fait partie des premières expositions grand public qui contribue aux réflexions des musées sur les publics. La presse est à la hauteur de l’événement : quelques mois avant le début de l’exposition, un reportage télé présente l’arrivée d’une partie des œuvres à l’aéroport. Le 9 mai suivant, la visite du Général De Gaulle fait sensation en durant plus d’une heure.

Toutânkhamon et son temps : l’exposition du siècle ©Rue des Archives/AGIP
Mais plus encore, l’exposition propose une muséographie qui marque un tournant dans le milieu. L’objectif pour Christiane Desroches-Noblecourt est de mettre les objets en situation. Cette volonté s’inscrit parfaitement dans la mouvance de l’époque, en parallèle de la « muséographie sur fil de nylon » de Georges-Henri Rivière. Les objets sont présentés dans une scénographie sombre, alors que l’usage était de présenter les objets en pleine lumière. Les salles étaient baignées dans l’obscurité, permettant aux expôts de se détacher grâce à un éclairage soigneusement travaillé. Après quelques salles expliquant le pouvoir du pharaon de son temps, le visiteur entre ensuite dans un tunnel, signe de la mort du jeune roi. Après avoir tourné sur sa gauche, il découvre les salles en enfilades présentant le voyage funéraire grâce au trésor du pharaon. La scénographie propose également une salle présentant les tout débuts de l’immersif, concept inédit dans les expositions pour l’époque. Dans la « salle des papyrus », un marécage est suggéré grâce aux plants de papyrus. En son sein, une petite figurine rappelle la renaissance du pharaon après la mort. La visite se termine sur une salle abritant le masque funéraire du pharaon, apportant l’émerveillement aux visiteurs.

Le plan de l’exposition de l’exposition ©Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Une borne culturelle importante
L’exposition Toutankhamon a véritablement provoqué une petite révolution dans le milieu de la muséologie, de par sa muséographie novatrice et les conséquences d’une telle fréquentation. Face au succès grandissant que rencontrent les grosses expositions (Vermeer à l’Orangerie 1966, Picasso au Grand Palais 1966, Toutânkhamon au Petit Palais 1967), la Réunion des Musées Français (RMN) est mise en place plus vite que prévue, pour gérer ces événements. Comme l’explique Pascal Ory, l’exposition s’inscrit dans un contexte inédit de muséographie. Les premiers remous ont eu lieu en 1937, avec l’exposition Van Gogh au Nouveau Musée d’Art Moderne : l’exposition, très novatrice, est même considérée comme « trop pédagogique » pour l’époque. C’est durant cette exposition que la réflexion sur l’audimat débute. En parallèle, le ministère des Affaires Culturelles se développe. Quelques mois avant Toutânkhamon, les trésors du pharaon, André Malraux doit se battre pour obtenir « 25 km d’autoroute ». La culture « à la Malraux » est finalement à son apogée durant l’exposition, qui s’inscrit dans la volonté de la France pour trouver une place dans la culture internationale grâce à ces expositions hors-normes qui présentent des chefs-d’œuvre.
Toutânkhamon influence le milieu de la culture. Ce sont les débuts de la « religion culturelle » (Pascal Ory) : l’art devient la religion des temps nouveaux, dont les expositions sont les pèlerinages et les artistes les nouveaux dieux. Cette exposition et son succès illustrent la spectacularisation progressive des expositions d'art, et l'entrée dans une ère de mise en scène de la culture par l'état. Elle se situe aussi au début de la culture mesurée à l'aide de statistiques sur lesquelles planchent parfois des chercheurs comme Pierre Bourdieu.
Le trésor du pharaon est une mine d’or
Il est impossible de nier que l’exposition de 2019 se base sur des arguments moins nobles que celle de 1967. Tout d’abord, l’exposition n’est pas française mais internationale. En itinérance dans les plus grandes villes du monde entre 2019 et 2022, le « Toutânkhamon tour » est avant tout un véritable tour de force économique. L’Etat égyptien a décidé de sous-traiter l’organisation par la société internationale d’organisation d’évènements IMG. Cette exposition est pour l’Egypte une triple opération commerciale : une manière de faire de la diplomatie culturelle, d'attirer à nouveau des touristes que la crainte d'attentats terroristes avait fait fuir, et de financer la restauration de ses sites archéologiques et du futur "Grand musée égyptien" en cours de construction près des pyramides. De même, l’entreprise ne cache pas sa volonté de dépasser la barre des 10 millions de visiteurs. Le prix des billets est mirobolant : 24€ le tarifs plein et 22€ le tarif réduit. La boutique a elle aussi tout d’une grande : d’une taille outrageuse, elle regroupe babioles et autres tour Eiffel ensablées qui n’ont rien à voir avec le discours scientifique de l’exposition. Ici ce n’est pas une exposition classique, mais une exposition blockbuster, un grand business model américain.
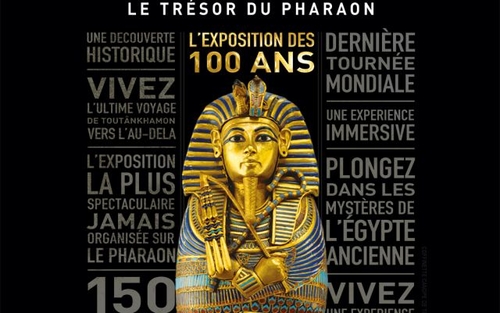
Affiche de l’exposition Toutânkhamon, les trésors du pharaon : tous les ingrédients du marketing sont réunis ©La Villette
La muséographie est quant à elle dans l’ère du temps : sombre, immersive, elle reprend tous les codes des grandes expositions-spectacles. Après une salle d’introduction avec un film qui nous présente le contexte, la foule – répartie par demi-heure – est lâchée dans un dédale de salles présentant les 150 objets réunis pour l’occasion. Les expôts sont joliment mis en valeur grâce à un éclairage bien géré… si seulement le visiteur arrive à les apercevoir devant la foule qui s’amasse. Le grand atout de l’exposition est de présenter les bijoux et autres objets précieux de sorte à voir l’avant et l’arrière de l’œuvre. Cela est d’autant plus agréable que le verso est souvent peu présenté alors qu’il est tout aussi intéressant que le recto.
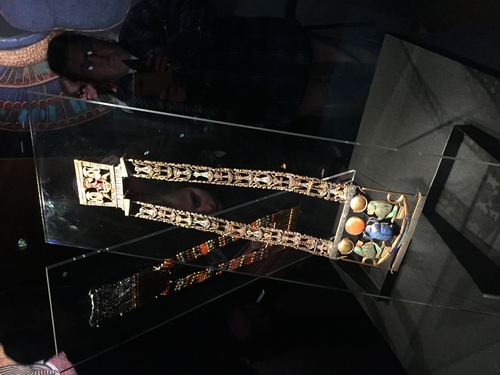

Le pire et le meilleur de Toutânkhamon 2019 : une foule incessante et le recto-verso des expôts ©C.DC
Les conditions de conservation des œuvres, déjà hautement novatrices en 1967, sont encore montées d’un cran. Ici le visiteur ne peut pas admirer les pièces maîtresses de la collection, tel que le masque funéraire, la momie ou encore le trône royal qui n’ont pas fait le voyage.
L’égyptomanie, une passion française
D’aucun ne peut nier la véritable égyptomanie qui secoue la France lorsqu’une exposition ayant trait à l’Egypte a lieu. L’égyptomanie désigne la fascination pour la culture et l’histoire de l’Egypte antique. Les Français, de par le succès des expositions et leur part importante dans le tourisme égyptien, sont connus et reconnus comme friands de cette culture. En 2006, une exposition de répliques de la tombe est programmée, que Paris accueille en 2012 à la porte de Versailles. Le succès est immédiat : environ 250 000 visiteurs ont fait face à ces copies.
Pour l’exposition de 2019, les visiteurs sont bien informés du véritable blockbuster qu’ils ont face à eux. Pourtant, cela ne les fait pas reculer : la volonté de voir une dernière fois les objets du pharaon est plus forte. L’exposition dépasse le statut d’événement pour gagner celui de rite. Aujourd’hui, celle-ci est immersive, en accord avec son temps : tout y est pensé pour vibrer plus que pour voir. Le visiteur vient voir l’éternité, un homme inscrit dans l’histoire pour toujours, qui ne meurt jamais. Tout réside dans le fait que ces trésors ne devaient être vus par personne, dédiés qu’ils sont à l’au-delà. Ici, la culture n’est plus un loisir, mais plutôt « l’ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu’il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort », (18 avril 1964 Inauguration de la maison de la Culture de Bourges Discours d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles).
A l’image de l’exposition de 1967, les visiteurs des expositions effectuent une sorte de rite. Jacques Attali explique que ces expositions, par effet de perspective, permettent au visiteur d’interroger son rapport contemporain au temps. Le rapport à la mort et à ce qui se passe après la mort fascine, et la civilisation égyptienne représente parfaitement cette ambiguïté. « C’est une vision qui nous donne un regard sur les choses que les Egyptiens ne voulaient pas que l’on voit et qui nous fascine parce que cela nous renvoie à la façon dont ce peuple pensait son immortalité, qui est bien différente de la nôtre ». (Jacques Attali).
Clémence de CARVALHO
#Toutankhamon
#blockbuster
#revolution
#1967
#egyptomanie
Pour aller plus loin : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egyptomanie-24

Un musée à la campagne
Au cœur de la vallée du Serein, dans un paysage de haies bocagères et de paisibles prairies bourguignonnes, niché dans un très beau village – un des « Plus beaux villages de France » selon le panneau qui le signale au touriste de passage – existe un petit musée aux collections foisonnantes. Ce musée, c’est le Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers-sur-Serein.
Noyers-sur-serein, commune de l’Yonne de 675 habitants, est un village médiéval, particulièrement charmant et préservé des constructions les plus modernes. Une fois qu’on y est arrivé, ne reste qu’à suivre les panneaux disséminés au fil des ruelles pour trouver le chemin du musée. Musée de France, géré par la municipalité, il a été fondé en 1873 et expose dans un espace de 1500m2 des collections artistiques aussi riches que différentes : de l’art naïf, de l’art brut, de l’art populaire. Sur trois étages, le musée fait découvrir au public de bien curieuses collections : des tableaux, évidemment, mais pas seulement. Et oui, tous les supports d’expression artistiques sont mis à l’honneur :estampes, gravures, ex-voto, boites métalliques, jouets, moulages, médaillons, statuts…
Mais c’est quoi l’art naïf, brut, et populaire ? Malheureusement, le musée ne le dit pas clairement. Le visiteur est donc mis en face de collections très hétéroclites, tant sur la typologie des œuvres présentes, que sur leurs qualités formelles, ou encore sur les sujets qui sont représentés. Pour quelle raison ces œuvres ont-elles été mises les unes avec les autres, dans un seul et unique musée ?
 Objets religieux des quatre coins du monde. C.P : P.W
Objets religieux des quatre coins du monde. C.P : P.W
De multiples donateurs et artistes, aussi bien anonymes que plus connus (Camille Bombois, Yvon Taillandier, Hokusaï Katsushika…) partagent un espace de dialogue qui les rassemble. On saisit de manière tacite ce qui lie toutes ces œuvres : le trait – simple -, les couleurs– extrêmement vives –, les sujets – des scènes de la vie quotidienne, du monde rural, du folklore local – les perspectives et les échelles – absentes - et une grande part d’innocence et de fraîcheur qui ravit un regard formaté par les représentations plus classiques. Un livret remis à l’accueil explique la provenance des collections, les donations. Par conséquent, le visiteur doit en permanence se rapporter à ce livret, ce qui complique un peu la tâche.
En somme, c’est en sollicitant l’ambiance un peu « archaïque » du cabinet de curiosité que l’on apprécie vraiment ce musée aux objets les plus fantaisistes. Chacun renferme une histoire, un voyage, une part d’exotisme, de beauté « étrange», que l’on ne voit jamais dans les musées de beaux-arts.
 Vue du rez-de-chaussée. C.P : P.W
Vue du rez-de-chaussée. C.P : P.W
Pauline Wittmann
En savoir plus :
- Le musée est ouvert :
du 1er octobre au 31 mai, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 14H30 à 18H
Juin et Septembre tous les jours sauf le mardi de 11H à 12H30 et de 14H à 18H
Juillet et Aout tous les jours sauf le mardi de 10H à 18H30
Fermeture hebdomadaire : le mardi
Fermeture annuelle : Janvier- Page web du musée sur le site de la ville #Noyers-sur-Serein#artnaïf #muséedeFrance

Un petit coin de paradis à Chaalis
C’est en déambulant au milieu d’un superbe parc de mille hectares que l’on peut découvrir les ruines d’une église abbatiale cistercienne, une chapelle dans laquelle se dévoile des fresques du Primatice ou encore un musée, ancienne abbaye aménagée en château au XIXème siècle.
C’est la faute à Rousseau
© Droits réservés
Le nouveau parcours est fluide et très agréable à éprouver car les types d’accrochage alternent entre des vitrines (des tables ou murales) et un accrochage plus classique. Par ailleurs, la diversité des supports présentés attise la curiosité du spectateur qui peut admirer des partitions ou manuscrits originaux, des sculptures, des dessins, des gravures, de l’audiovisuel, etc.
Le risque, avec les collections monographiques, est de basculer dans un parcours purement chronologique et donc beaucoup plus fastidieux. Cependant, cette difficulté a été contournée avec brio car la partie Jean-Jacques Rousseaua été structuré selon des thèmes facilement identifiables. En effet, chaque salle comporte deux ou trois panneaux explicatifs qui n’ont pas pour ambition d’être encyclopédiques sur la question abordée mais ils permettent, dans un langage clair et ordonné, d’obtenir quelques clés de compréhension et, surtout, autorise la curiosité du spectateur qui peut être amené à approfondir un aspect du philosophe. Ces grands cartels codifiés par couleur selon l’ambiance de la salle, apportent une visibilité dans la logique d’exposition et permet de ne pas perdre le spectateur.
Les choix muséographiques sont pertinents car outre la biographie de Rousseau et son rapport entre les femmes, l’éducation et les plantes, il est mis en évidence d’autres aspects moins connus. Ainsi, on découvre un Rousseau habité par la musique et surtout sa méthode d’écriture chiffrée qui est explicitée ainsi que la réception de cette dernière. C’est d’ailleurs au sein de cet espace qu’un extrait de la musique de Rousseau est diffusé. Deplus, la dernière pièce met en avant la postérité de ce grand personnage non pas en abordant le sujet de manière trop intellectuel mais en mettant en évidence le culte voué à Rousseau, la « Rousseau mania », grâce à des statuettes, des cartes à jouer ou encore des tasses à son effigie, tel une marque dérivée. Cette présentation apporte une dose d’humour qui se poursuivit par le thème « Rire avec Rousseau », confrontant le spectateur à des visions négatives du personnage par le biais de caricatures parues dans des journaux de l’époque.
Cette nouvelle scénographie, outre le fait de ne pas être mise à la portée des enfants, comme par exemple la hauteur des tables vitrines, présente Rousseau tel qu’on le connait tout en révélant certaines parties de sa personnalité souvent occultées. Mais surtout, l’intelligence de cet espace dédié à Rousseau se mesure par le parti pris qui n’a pas été de peindre le portrait de ce personnage tel que l’on pourrait se l’imaginer mais tel qu’il était : un homme aux multiples facettes.
« Ce que je sais bien, c’est que l’Identité du moi ne se prolonge que par la mémoire, et que, pour être le même en effet, il faut que je me souvienne d’avoir été. » Rousseau, « Profession de foi du Vicaire Savoyard », Emile, livre IV.
Un musée : une quête d’identité ?
 ©Droits réservés
©Droits réservés
Dans ce musée, Rousseau est, certes, mis à l’honneur mais il ne représente qu’une infime partie de l’établissement. Ainsi, le reste du musée présente une collection hétéroclite d’objets (mobilier, peinture, vaisselle, etc.) qui paraissent plutôt entreposés qu’exposés. En effet, la présentation de la collection rappelle les marchés aux puces, parfois les cabinets de curiosité, invoquant le désordre et la confusion. De plus, la logique de présentation tente difficilement de suivre un ordre chronologique.
Par ailleurs, aucun véritable sujet ne semble réunir toutes les pièces présentées. On remarque en effet, que la « partie Rousseau » est clairement définie car lorsque l’on commence celle-ci un petit cartel informe le visiteur qu’il entre dans un espace où les collections gravitent autour d’un unique thème. Cependant, le spectateur ne peut déterminer la partie qu’il a, en principe, découvert avant puisqu’il n’a pas bénéficié d’un cartel définissant un quelconque sujet, ce qui est bel est bien symptomatique du problème d’identité.
Ainsi, bien qu’aucun scénographe ne soit intervenu dans l’espace des collections, cette manière de présenter les objets ainsi que l’absence de sujet clairement défini apparaissent un peu plus compréhensibles lorsque l’on connait l’histoire du lieu. En effet, Madame Jacquemart-André avait acheté l’ancienne abbaye afin d’entreposer sa collection d’objet d’art et, il était spécifier dans le lègue de la collection, la volonté de conserver l’esprit du collectionneur, d’où cette idée d’accumulation.
C’est donc au cœur d’un magnifique écrin que le musée de l’abbaye de Chaalis vous accueille chaque année lors des célèbres « Journées de la rose », uniquement le dimanche (10h30-12h30 et13h30-17h30) lors de la saison hivernale, puis tous les jours lors de la saison estivale (11h00-18h00).
Il est a noté que le parc, la roseraie, la chapelle et l’église abbatiale sont ouverts toute l’année de 10h00 à 18h00.
En ce qui concerne le tarif comprenant l’accès au parc, à la roseraie, à l’église et la chapelle abbatiale ainsi qu’au musée, il est de 7 euros (tarif plein), de 5 euros (étudiants ou groupes adultes) ou de 3.50 euros (groupes scolaires de l’école primaire au lycée).
Alizée Buisson

Un styliste pour commissaire au musée de Valence
C’est les vacances ! Mais en tant qu’étudiante en muséographie, même en vacances, difficile de résister à l’envie d’entrer dans un musée !
De passage à Valence (la ville en France, et non celle en Espagne) avec des amis, nous profitons d’un jour orageux pour aller visiter l’exposition « De l’autre côté du miroir, reflet de collection » au musée de Valence (ou Musée d’Art et d’Archéologie de Valence) dont nous avions vu les affiches un peu partout dans la ville.
Armée de mon réflex sans flash j’ai pu à loisir prendre pleins de photographies de cette exposition. Plutôt que de vous faire un simple résumé d’une exposition que vous ne verrez peut-être jamais si vous n’êtes pas de la région ou de passage, je vous propose de vous la faire revivre à travers ce photo reportage. Je ne m’empêcherai pas pour autant d’ajouter mes petits commentaires subjectifs afin de vous faire partager mes ressentis.
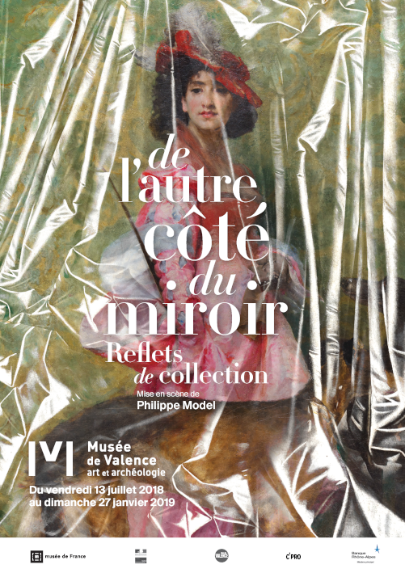
Affiche de l'exposition © Musée de Valence
Hall d'entrée:
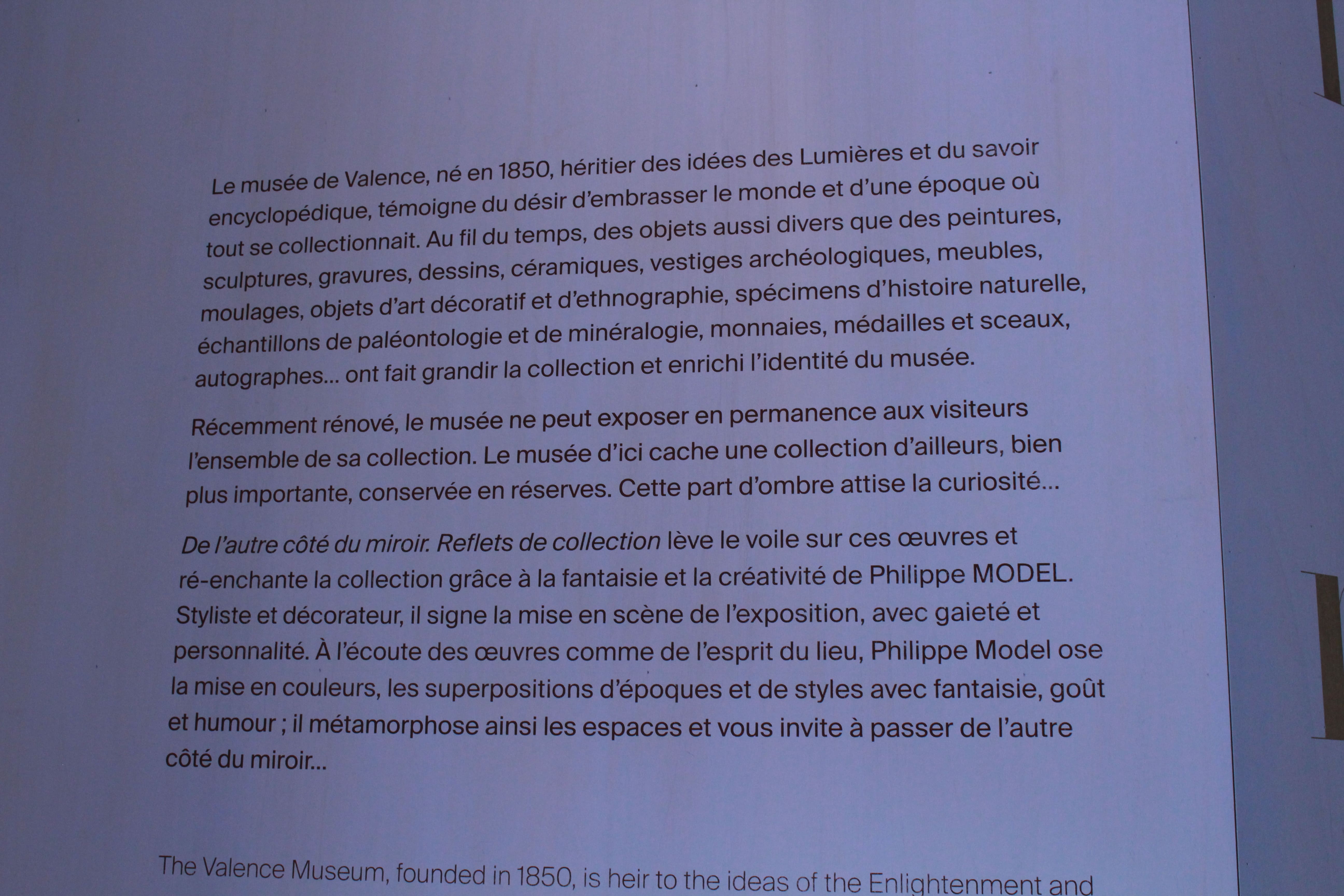
Dans l’entrée de l’exposition vous vous retrouvez dans un petit sas aux murs gris, sur votre gauche le texte d’introduction ci-dessus. A droite du texte l’entrée vers la première salle de l’exposition. L’objectif de l’exposition est la mise en valeur d’objets de la collection du musée par Philippe Model, styliste et décorateur.
Derrière vous, un mobilier sur lequel se trouve le livret de visite, un très beau livret qui sert de cartels pour l’exposition où chaque œuvre est indiquée par un numéro.
Première salle:
« Retour d’Egypte » s’apparente (comme le dit la fin du texte de salle) à un style décoratif qui dura une dizaine d’années après l’expédition en Egypte de Napoléon Bonaparte en 1798. Le texte de salle explique cette campagne d’Egypte. Des objets, dessins, meubles sont disposés sur ces pans de mur, recréant ainsi une sorte de petit cabinet d’étude sur l’Egypte.
Deuxième salle:
Vous voici dans une salle aux murs noirs, une salle dans la pénombre, sur le thème de l’ombre. Je vous avoue que là j’ai du mal à comprendre le thème en voyant les tableaux et objets autour de moi, je pense plutôt à « Sombre » qu’à « Ombre » comme titre de salle.
C’est une salle allongée, un peu comme un couloir, sur la droite des vitrines niches dans lesquelles se trouvent diverses statues. Problème majeur : le manque de lumière rend très inconfortable le fait de voir le numéro de l’objet et de lire son cartel sur le petit livret.
L’œuvre ci-dessous, à l’entrée de la pièce, bénéficie au contraire d’un éclairage qui facilite la lecture et la met en valeur
Dans un coin de la salle, vers le fond, un peu caché, un tableau se reflète dans un mur de carreaux de miroir. On ne comprend pas très bien ce que ce tableau fait là, caché dans ce petit coin, mais au moins on n’oublie pas le thème de l’exposition.
Derrière ce mur de miroir, une toute petite salle, toute noire, comme une petite grotte, montre des négatifs de photographies, d’un certain Paul Peyrouze, photographe valentinois, qui semblent flotter dans cette alcôve exigüe.
Enfin, un mur (toujours noir !) sur lequel sont accrochés des tableaux noirs qui, lorsque l’on s’approchent révèlent des silhouettes de personnages.
La qualité de la photo ne vous permet peut être pas de lire le texte aisément mais il est dit là que dès les années 1980, des artistes sont invités au musée, s’inspirant des collections pour de nouvelles créations et que l’acquisition de certaines œuvres des expositions à contribué à étoffer la collection du musée. Je vous avoue que le lien avec la salle que je viens de voir n’est pas clair, le cloisonnement des espaces et l’enchainement des thématiques ne me paraissent pas évident.
Troisième salle:
Après L’ombre, la lumière, enfin « Lumiere », sans accent, étrange… Là encore le lien entre le thème et les œuvres présentées n’est pas évident. Le regard est attiré par la collection de sanguines exposées sur les murs.
Au fond de la salle, un miroir déformant donne à la pièce une autre perspective. C’est l’arrière du tableau qui s’expose au fond à gauche et se « reflète » de manière fictive sur le sol, comme s’il était l’ombre de la fenêtre. (C’est en fait un sticker collé sur le sol.)
L'escalier:
Un amas d’œuvres colorées sur un mur tacheté de peinture vous invite joyeusement à gagner le premier étage.
On apprécie l’espace dans son ensemble mais il est regrettable qu’on ne puisse pas s’approcher de plus près de certaines œuvres pour les apprécier dans leur singularité.
L'étage, première salle:
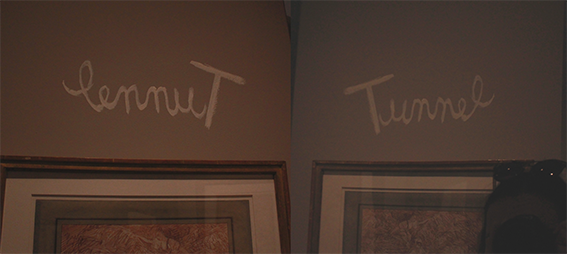
En haut des escaliers, sur votre gauche, en franchissant ce rideau, cette entrée théâtralisée, vous vous retrouvez dans un espace couloir, un « Lennut » ou « Tunnel » comme on peut le lire à travers les miroirs qui construisent cet espace.
Les œuvres s’observent et se reflètent de chaque côté, créant un espace de passage perturbant entre réalité et fiction. Où est l’œuvre vraie, où est son reflet ? Où suis je moi visiteur qui me reflète parmi ces œuvres ? C’est un espace de questionnement déstabilisant mais malheureusement très sombre et exiguë qui n’est qu’un lieu de passage dès lors qu’il y a un peu de monde.
A la sortie de ce tunnel, on arrive dans un tout petit espace encore sombre, intitulé « Point de vue », qui permet d’observer une tête de cheval sous différents angles de vue, grâce à des petits miroirs, et donne aussi un point de vue sur l’escalier.
Ensuite s’ouvre finalement un grand espace lumineux, découpé en plusieurs petites atmosphères.
Première atmosphère : en partant de cette œuvre de Raoul Dufy présente dans les collections du musée, Philippe Model créé un espace reprenant couleurs et atmosphère du tableau, dans des des créations du styliste (le mobilier notamment).
Idem pour l’atmosphère suivante : qui s’inspire cette fois d’une œuvre d’Emile Boilvin, toujours avec des créations de X : chapeaux et chaises.
Ce dernier espace, « Télécaramboscopage », rassemble des chaussures de Model avec des objets des collections, à la façon d’une boutique de chaussures de luxe aux vitrines particulièrement soignées.
Puis nous reprenons l’escalier pour sortir de l’exposition. Avant de partir, un dernier espace met en scène les coulisses de l’expo à travers des photos imprimées sur les murs. Une très bonne idée que de donner à voir les coulisses, les boites de conservation des objets, les espaces avant l’exposition, les équipes et les réflexions nécessaires à l’obtention du résultat. Peut-être qu’une vidéo montrant les coulisses du projet aurait permis de pousser plus loin dans cette idée.
En sortant de l’exposition, une petite urne nous propose d’y déposer notre livret de visite si nous ne souhaitons pas le conserver. Une bonne idée pour limiter le nombre de tirages, réduire un peu les déchets pour des livrets de visite qui, on le sait bien, finissent très souvent à la poubelle.
C’est ici que s’achève notre visite de l’exposition « De l’autre côté du miroir, reflet de collection » au musée de Valence. Sans vous familiariser avec toutes les œuvres de cette collection, j’espère vous avoir sensibilisés à l’atmosphère. J’ai vu les objets de cette collection certes mais je n’ai pas bien compris leur rapprochement, ce qui me laisse sur une sensation de brouillon. C’’est original mais c’est un peu « random » comme on dit en anglais. Les objets sont-ils mis en valeur ? La collection n’est-elle pas plutôt noyée dans cette scénographie singulière qui crée des espaces de déambulations originaux mais nous fait finalement passer à côté des objets eux-mêmes. Le travail du styliste est intéressant, du fait de sa sensibilité aux couleurs, aux matières, aux textures mais non à l’espace d’exposition comme espace de circulation thématique. N’aurait-il pas mis de côté le visiteur au profit d’une immersion à travers des univers, qui ne font pas toujours sens. Nous sommes bel et bien passés de l’autre côté de quelque chose mais je ne sais pas très bien de quoi.
Julie Schafir
Site du musée :
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=mus%C3%A9e+de+valence&ie=UTF-8&oe=UTF-8
#Valence
#Collection
#Stylisme
#Singulier
Photographies de Julie Schafir

Une histoire de bulles
Nos voisins belges n’excellent pas seulement dans le brassage de la bière ou la fabrication du chocolat, ils sont également les maîtres de la BD et le prouvent au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles.

© CBBD
Nos voisins belges n’excellent pas seulement dans le brassage de la bière ou la fabrication du chocolat, ils sont également les maîtres de la BD et le prouvent au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles.
A peine la grille d’entrée poussée, le hall baigné de lumière par une superbe verrière me transporte sur une agora où la brasserie, la librairie et la bibliothèque structurent l’espace public. La 2CV de Boule et Bill, et la fusée de Tintin sont telles deux colosses à l’entrée d’un majestueux escalier menant à ce qui semble être le temple de la BD. Les quatre niveaux de ce monde me tendaient alors les bras.
La première présentation de l’exposition permanente retrace l’histoire de la bande dessinée, des dessins rupestres aux ouvrages que l’on connait aujourd’hui. Comme toutes les autres, elle est traduite en français, en flamand, ainsi qu’en anglais. Trop étendu chronologiquement, ce préambule pourtant concis m’a paru peu indispensable pour aborder les salles à venir.
A la sortie de cette introduction, j’espérais un nouvel éclairage mais cette fois-ci braqué sur la fabrication d’une bande dessiné, mais rien de cela ne m’attendait. La salle suivante nommée « La Gallery », est basse de plafond, sombre telle une chambre noire où l’on aurait aligné des chevalets de verre. Le lieu regorge de planches originales, le Saint Graal de l’amateur. Chacune d’entre elles possède son propre cartel où figurent le nom de l’auteur de la série, son titre, et la date de réalisation. L’enchainement de plus d’une centaine de planches de style différent devient très vite lassant, aucun parcours ou discours n’est proposé aux visiteurs. Les dernières planches ne reçoivent alors qu’un simple regard passant.
A l’étage, sous les dômes de verres, « le Musée de l’imaginaire » présente, les principaux auteurs de la bande dessinée belge. Trois parcours muséographiques, d’époques et de formes différentes, invitent à découvrir ou redécouvrir les travaux de ces protagonistes du 9ème art qui ont œuvré pour son essor. Leur travail est retranscrit à travers leur biographie, et des imprimés de leurs séries, auxquels s’intègrent des textes descriptifs de leur style. L’univers des artistes les plus populaires est mis en scène grâce à des décors reconstitués, certes défraichis et un peu datés, mais qui contribuent néanmoins à faire voyager le visiteur dans la série phare de l’auteur.
Fiers de travailler dans un si bel édifice Art Nouveau, les responsables du CBBD n’ont pas hésité à intégrer au parcours muséographique, l’histoire et l’évolution du lieu. Cette présentation bien que succincte et instructive, est pourtant mal insérée dans le discours, l'on tombe dessus par hasard.
Dans cette exposition permanente, on peut principalement regretter le manque de diversité des supports. La lecture consécutive du travail de chaque auteur lasse rapidement. Malheureusement aucun objet, ou album original n’est présenté, il aurait pu casser la continuité des récits en apportant une vision nouvelle et complémentaire sur l’œuvre de l’auteur. Des tentatives de diversification, comme des maquettes mal réalisées, ou quelques vitrines de revues et d’objets publicitaires vieillissants, ne suffisent pas immerger le visiteur dans l’imaginaire du dessinateur.
 © CBBD-Daniel Fouss
© CBBD-Daniel Fouss
L’espace dédié aux expositions temporaires est plus restreint, il se situe sur une mezzanine surplombant l’exposition permanente. Au moment de ma visite deux créateurs étaient mis à l’honneur durant quatre mois et demi. C’est le cas de l’auteur britannique Posy Simmonds qui pour la première fois a vu son oeuvre retracée lors d’une exposition. Celle-ci présente de nombreux croquis et planches originales de l’artiste, illustrant ainsi le processus de création de ses histoires. La muséographie se raconte au fil du parcours grâce à différents supports numériques, comme la vidéo ou l’utilisation de borne tactile. Les panneaux explicatifs plus traditionnels, sont le point faible de cette présentation. Le discours est trop complexe, et surtout excessivement long.
A contrario, les écrits de la rétrospective de François Walthéry sont eux plus judicieux. Beaucoup moins denses, ils ne gardent que l’essentiel, ce qui éclaircit le discours. Le propos est illustré par de très beaux décors reconstitués, agrémentés d’extraits vidéo montrant l’artiste à l’ouvrage. La compréhension est simplifiée par la présence de nombreux croquis, planches originales et produits dérivés qui retracent la création de l’artiste. Ce qui fait la force de cette exposition, c’est l’aller-retour incessant entre la personnalité haute en couleur de l’auteur et celle de son héroïne, une hôtesse de l’air charmante et charmeuse qui vit des aventures extraordinaires aux quatre coins du globe. Natacha laisse d’ailleurs entrevoir ses atouts lorsque l’on pénètre dans une partie déconseillée aux enfants.
Le dernier lieu d’exposition se situe à l’entresol. Cet « espace St Roch », que je pensais être le prolongement de « La Gallery », propose en réalité une sorte de petite exposition temporaire, qui retrace les étapes importantes de la vie d’Edgar P. Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer. Cette biographie illustrée a été réalisée par Louis Alloing et Rodolphe qui ont retracé son existence en s’appropriant son style. Cette proposition est la plus novatrice du musée, l’originalité de sa forme aurait dû être davantage soulignée. La mettre à la fin du parcours ne la valorise pas, le visiteur rassasié, ne prend plus la peine de s’attarder sur le travail réalisé.
La visite s’achève, je descends retrouver la réalité, et ferme dernière moi les grilles d’un monde imaginaire, où la bande dessinée s’est dévoilée à travers son histoire et ses auteurs, pour que chacun puisse apprécier sa diversité.
Boris Boulanger

Une nouvelle aire de « jeux » au Palais des Beaux-Arts de Lille
Lille, une ville baptisée capitale européenne de la culture
Lille détient plusieurs lieux consacrés à l’exposition : le Musée de l’Hospice Comtesse, le Musée d’Histoire Naturelle, le Tripostal, l’Institut de la photographie, le musée Pasteur ou encore la gare saint-Sauveur. Depuis 2004, Lille est capitale européenne de la culture. Cette désignation permet à la ville d’offrir un programme culturel toujours plus complet et diversifié. Aujourd’hui, nous faisons arrêt au Palais des Beaux-Arts.
Le Palais des Beaux-Arts, un musée géré par la ville de Lille
Le Palais des Beaux-Arts est un musée municipal dirigé par la ville. Il a vu le jour le 6 mars 1892. Ce musée abrite des collections de l’Antiquité au XXème siècle. En tant que musée d’état, le Palais des Beaux-Arts possède un PSC, Projet Scientifique Culturel. Ce PSC est un document rédigé « opérationnel et stratégique qui définit l’identité et les orientations du musée », selon le Ministère de la culture. Il évoque les collections, la politique des publics… C’est un document de référence pour l’ensemble de l’équipe du musée.

Palais des Beaux-Arts de Lille©Céline Chevalier
Une institution au plus près de son public
Les PSC des musées de Lille, le Palais des Beaux-Arts, le musée de l’Hospice Comtesse et le musée d’histoire naturelle, est réécrit tous les 10 ans. Il présente le cahier des charges sur les accomplissements du musée, les événements produits, la stratégie adoptée envers les publics…
Celui du Palais des Beaux-Arts a le souci des publics, dans la volonté d’inclure l’ensemble des publics au sein de leur parcours.
Celui en cours d’écriture propose une refonte totale du parcours de visite. Il présente un réaménagement des collections afin de les rendre plus accessibles. De cette réflexion menée autour des collections et de ses enjeux tout en s’emparant de la politique de développement des publics, va naître un espace dédié aux enfants au sein du parcours.
Un projet de refonte avec un espace dédié aux enfants
C’est d’ici 2024 qu'un espace sera totalement dédié à l’accueil des enfants. L’espace en question est déjà défini par sa luminosité et est situé au balcon du premier étage, au-dessus de l’atrium. Il abrite pour le moment la galerie d’art moderne.

Galerie d’art moderne, balcon premier étage ©M. Catherine
Cet espace est fait pour accueillir des enfants à partir de 3-4 ans, de jeunes visiteurs lecteurs avec des cartels simplifiés afin de permettre une compréhension adaptée à leur âge.
Cet espace sera ludique et coloré, pour attirer l’œil des plus petits, donner envie d’être traversé. L’enfant en tant que visiteur sera acteur de sa visite par différentes manipulations et une approche multi-sensorielle : sentir, toucher, écouter… L’espace, co-créé avec le scénographe, sera rythmé par des zones interactives (tiroirs secrets, porte dérobée, etc)
L’équipe du musée souhaite disposer au total une dizaine d’œuvres, des originaux. L’enfant sera ainsi réellement mis au même rang qu’un adulte. Ces œuvres seront de différentes typologies avec des présentations à la fois de peintures, sculptures…, de différentes époques, art ancien, art contemporain… Elles seraient à 50 cm du sol et dans l’idéal sans barre de mise à distance afin de permettre leur contemplation. Cet espace s’axe sur la pratique de l’enfant tout en y intégrant un endroit consacré aux livres et à la détente afin de permettre une pause et prolonger la visite.
Un point fort sera la médiation. Quoique le parcours de visite soit libre, une médiation humaine est souhaitée. Elle permettra d’accompagner les visiteurs au besoin dans leur parcours actif et autonome, mais également de sécuriser l’œuvre. De nombreux outils de médiations seront présents afin d’activer une participation de l’enfant par le biais de mises en situation, d’expérimentation, de jeux d’approche multi-sensorielle. Ces outils de médiations auront pour objectif de permettre la compréhension des enjeux de l’artiste.
Un espace évolutif
Ce projet a pour objectif de faire intégralement partie du parcours de visite des visiteurs et de devenir un espace permanent dédié aux enfants où les thématiques et les œuvres seront modifiées tous les deux ans. Pour cette première apparition, la thématique tournera autour du jeu intitulé « À quoi tu joues ? ». Cette thématique verra le jour sous trois angles : Jeux de stratégies, Jeux symboliques et Jeux de plein air. Elle regroupera différentes œuvres, peintures, sculpture de l’Antiquité à nos jours, et présentera comment la thématique a évolué au sein des différentes périodes et l’histoire du jeu à travers le temps.
Par la suite, le musée envisage pour sa deuxième édition une thématique autour des douze mois de l’année où chaque œuvre représentera un mois de l’année et sera rythmé par des rituels marquant les enfants: noël, la rentrée des classes, les saisons…
Vivement 2024 pour découvrir cet espace dédié aux enfants.
Nos remerciements à Céline Chevalier, chargée des projets pédagogiques, Service de la médiation et de l’implication des publics pour les échanges sur ce projet.
Maryline Catherine
Pour en savoir plus :
#Lille #Palais des Beaux-Arts #espace pour enfants
Verdures, du tissage aux pixels au Musée Bargoin à Clermont-Ferrand
Le Musée Bargoin se situe en plein cœur de Clermont-Ferrand et ses collections permanentes sont constituées de découvertes archéologiques locales. À cela s'ajoutent des expositions temporaires à la scénographie originale centrées sur les arts textiles.
Le musée accueillait jusqu'au 21 mai 2017 l'exposition Verdures, qui a l'originalité d'allier textile ancien et numérique. Quel lien peut-on établir entre des tapisseries datant de la renaissance et des œuvres très contemporaines ?
© photo C. L.
La première œuvre s'intitule Akousmaflore, voilà un titre bien curieux ! Le sous-titre l'est encore plus : « Vous êtes invités à caresser les plantes délicatement ». Lorsque l'on touche les plantes, elles émettent des sons, nous parlent. L'interaction avec les végétaux est beaucoup plus riche qu'elle ne l'est habituellement, même s'il s'agit peut-être de cris de protestation de la part des plantes...
On beat one tree, Naziha Mestaoui © photo C. L.
Au premier étage, la salle est plongée dans le noir, équipée d'un immense écran. Des formes vertes apparaissent, se transforment petit à petit sous nos yeux en arbre. Grâce à On beat one tree, en se plaçant sur un socle tactile, vous pouvez créer un arbre et le voir s'épanouir. Il grandit au rythme des battements de cœurs du planteur. Je n'ai pas compris si bouger les bras permettait de contrôler le dit arbre, mais j'ai essayé.
Planter un arbre n'a pas que des vertus esthétiques, les végétaux jouent un rôle important pour maintenir l'équilibre de l'écosystème mondial, Ainsi dans le même espace, une vidéo montre la plantation de mangroves dans des espaces menacés par la montée des eaux. Interroger la relation entre les hommes et la nature interpelle les publics à propos de la crise écologique que nous traversons.
La visite se poursuit un étage plus haut, à notre droite, une installation de l'artiste Anne-Sophie Emard, Souche. Des cubes empilés les uns sur les autres diffusent des vidéos, ou plutôt des images en mouvement, mélangeant des parcelles de nature et d'humanité. L'expérience du sensible est au cœur de cette œuvre, rappelant que notre environnement nous façonne. L’œuvre résulte de l'assemblage de plusieurs éléments : les images semblent tissées, tout comme les tapisseries fabriquées par un enchevêtrement de fil.

Souche, Anne-Sophie Emard © photo C. L.
Tout en transparence, Paysage DPI d'Isabelle Dehay, montre le développement de végétaux, grandissant lentement sur des écrans de voile qui se superposent. Ici le textile devient le support de la création.
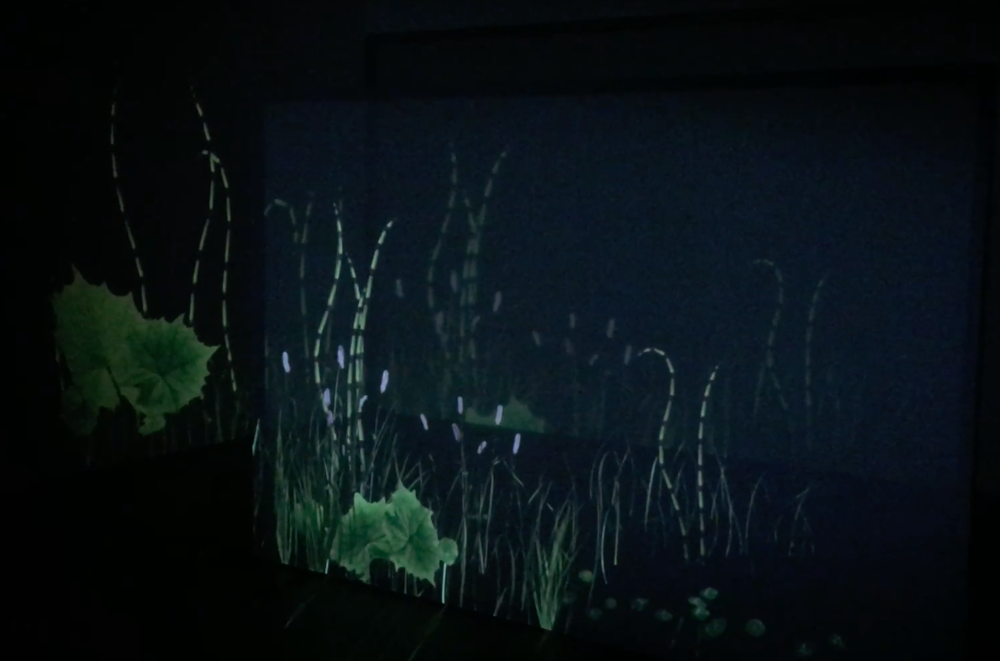
Paysage DPI, Isabelle Dehay © photo C. L.
Deux œuvres assez contemplatives qui nous obligent à passer plusieurs minutes à les observer pour les apprécier pleinement. Des sièges disposés dans les deux espaces permettent de le faire confortablement et le spectacle est assez reposant.
Juste à côté, sont exposées les fameuses tapisseries d'Anglards-de-Salers, fabriquées à Aubusson. Ici, l'ambiance diffère beaucoup, plus d'obscurité mais une ambiance très bucolique. La scénographie nous transporte dans un jardin verdoyant où de confortables transats sont installés face aux tapisseries.

© photo C. L.
Parfois de taille impressionnante, parfois plus petites, elles sont les témoins du savoir-faire des manufactures d'Aubusson. Confectionnées en 1586 lors du mariage de Renée de Chalus d'Orcival et de Guy de Montclar, elles constituent un ensemble baptisé le « Bestiaire fantastique ». Au cours du XVIe siècle, elles seront déplacées dans le château de la Trémollière et redécouvertes cent ans plus tard lorsque le bâtiment devient un presbytère. Les tapisseries, exceptionnellement bien conservées, restaurées à deux reprises et d'une grande richesse iconographique, sont classées Monuments Historiques en 1908.
Dans leur décor, une végétation luxuriante se mêle à l'architecture médiévale, à la faune et aux créatures fantastiques, le réalisme et le fantastique. Si les humains sont absents de ces représentations, on aperçoit des bâtiments en haut des tapisseries, des châteaux, des églises et des villages qui symbolisent la Culture. Cette dernière est matérialisée en haut des tapisseries, elle jouxte la nature mais une séparation est clairement établie entre les deux. Ces œuvres illustrent la pensée médiévale opposant humanité et nature. Notre regard est-il toujours le même cinq siècles plus tard ?

© photo C. L.
Au sol, deux reproductions de tapisseries sont des puzzles géants. Les pièces ont beau être énormes, nous avons beau avoir bac +9 à nous deux, il nous a bien fallu dix minutes pour terminer le plus petit …

© photo C. L.
L'unité de base de l'exposition est le pixel. Dans l'escalier, les tapisseries sont minutieusement découpées, mettant ainsi en valeur tous leurs éléments, toute la richesse de leur décor. Les tentures d'Aubusson et les œuvres numériques exposées se composent d'un assemblage d'éléments, qu'il s'agisse de fils entrelacés ou de minuscules pixels.

© photo C. L.
Cette exposition a l'audace de réunir des œuvres du XVIe siècle et trois œuvres numériques, elles ne sont pas exposées dans le même espace mais traitent du même sujet. Cette mise en regard de créations qui diffèrent par leur temporalité et leur support permet de renouveler la vision que nous pouvons porter sur l'art de la renaissance. D'autres parts, toutes les œuvres interrogent le rapport entre humanité et nature et surtout, remettent en cause le regard anthropocentré dans lequel nous vivons.
Clémence L.
#ArtsTextiles
#MuséeBargoin
#ArtContemporain

Verlaine à Mons ou comment exposer un geste passionnel ?
Si la littérature fait couler beaucoup d’encre, elleest aussi capable parfois de donner corps à un récit vivant dans un lieu d’exposition. A mi-chemin entre roman policier, théâtre et poésie « Verlaine –cellule 252 Turbulences poétiques » semble bien être une exposition sur une figure littéraire comme on en attendait depuis longtemps. Sujet peu exploité par les commissaires hors les maisons d’écrivains et la BNF, le littéraire et le genre poétique s’accordent une place de choix pour l’événement culturel de l’année « Mons 2015, capitale européenne de la culture ». Avec Verlaine en tête d’affiche, la ville de Mons rend hommage à son plus célèbre détenu...
Exposition "Verlaine - Cellule 252 Turbulences Poétiques"

Portrait de Paul Verlaine de profil par Jehan Rictus, dessin; 1895 © Bibliothèque Royale de Belgique
Quand un musée consacré aux beaux-arts s’empare d’un des épisodes les plus célèbres de la littérature française.
Exposer le littéraire ?
La forme biographique apparaît, au premier abord, par nature incompatible avec le format exposition qui s’attache à démontrer, argumenter, révéler et justifier le parti-pris d’un discours. Exposer le littéraire est une démarche délicate qui consisterait donc à extraire une quintessence de l’œuvre et de la vie de l’écrivain. En ce sens, l’exposition de Mons tend à donner au public une « idée » plutôt que de se tenir à une «connaissance » de l’esprit verlainien. Si l’exposition vise à retracer les liens étroits qu’il a tissés avec la Belgique, le cœur du propos vise surtout à mettre à nu la passion déchirante entre Verlaine et Rimbaud. Point de départ d’un récit à tension dramatique où est mise en scène une destinée humaine : celle d’un poète luttant entre Éros et Thanatos. En soi, un beau geste muséal des commissaires.
La symbolique du geste meurtrier, pré-texte d’un destin littéraire à expographier
Plus qu’un objet en soi, le revolver, c’est la symbolique du geste du tir qui prend tout son sens et constitue le cœur du récit de l’exposition. Par cette articulation du discours, on se positionne nécessairement dans un avant et un après. Comment rendre lisible spatialement et esthétiquement cette histoire ? Digne d’une enquête policière sans qu’elle y ressemble pour autant, l’exposition met en exergue comme toile de fond le décor d’une dispute à l’origine d’une relation passionnelle meurtrière avec comme pièce à conviction le fameux revolver Lefaucheux ; objet de collection retrouvé à l’occasion pour l’événement.
Exposé dans une vitrine bien close, il repose telle une relique dans la 3ème section du parcours. Même si le traitement scénographique tend à fétichiser le revolver, on peut être satisfait que la muséographisation de cette dispute ne soit pas passée par des reconstitutions vidéos montrant la scène du crime rejouée par des acteurs ! Ce « geste » marque de son empreinte notre esprit, mais cet épisode ne se veut pas exclusif, nous sommes invités après une présentation biographique de Verlaine à traverser sa vie tumultueuse partagée entre écriture, passion, folie, errance, déchéance et résurrection.
Le revolver Lefaucheux de Paul Verlaine, vers 1870 © Coll. Privée
L’écrit démultiplié sous toutes ses formes
Tout au long du parcours proposé, l’écriture occupe une grande place dans l’espace. Ici les mots retrouvent leur plénitude expressive et émotionnelle dans une scénographie rythmée savamment travaillée, privilégiant des installations textuelles visuelles et sonores. L’écrit et la poésie se trouvent magnifiés quels que soient le support utilisé et l’endroit où ils sont inscrits et positionnés : citations et épistoles sur les murs, frise chronologique, mots aimantés sur des tableaux magnétiques, manuscrits inédits dans les vitrines (lettres échangées entre les deux poètes), documents numérisés intégrés dans des tablettes tactiles… sans oublier les petits poèmes imprimés à emporter chez soi … l’écrit a une plasticité, ici déclinée.
Quand l’écrit suggère l’oralité
Exposer des vers : la poésie verlainienne est là pour nous rappeler la puissance langagière de ce genre littéraire. En lisant tous ces fragments de poèmes sur le mur, le visiteur seul ou accompagné peut à loisir se les répéter à voix haute : l’exposition permet l’oralité. De ce point de vue, exposer l’écrit devient un sujet passionnant. Tel peut être notre curiosité satisfaite en (re)découvrant les épistoles de Verlaine comme on aurait pu le faire avec l’argot de Céline! Muséographier le littéraire revient donc à exposer une langue grâce à sa retranscription spatiale.
A travers toutes ces composantes textuelles réunies dans l’espace d’exposition, ressort l’esprit plus que la figure littéraire du poète. Nous pouvons nous rendre compte ainsi d’une puissance créative à l’œuvre en train d’éclore. Mettre en espace la poésie et tous ces sentiments connexes, c’est donner une certaine idée de la représentativité du monde de Verlaine. En sortant de cette exposition, l’effet souhaité désiré est de se trouver plus proche du poète en partageant sa sensibilité. C’est ainsi que l’on échappe à une vision trop fétichiste du personnage.
Anamorphose de Paul Verlaine
La section « épilogue » constitue le dernier tempsfort de l’exposition : la figure de Verlaine se décompose en anamorphose pour laisser place à ses écrits. Et le public est convié à prolonger la plume de Verlaine en recomposant les poèmes.
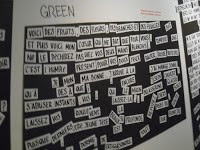 Section 11 "De la poésie avant toute chose" © Sandra Pain
Section 11 "De la poésie avant toute chose" © Sandra Pain
Les grands hommes partent mais les écrits restent
...Et le travail d’écriture continue hors-les-murs du musée en investissant façades et sols des rues de la ville. Sur une longueur de 10 km, le visiteur peut s’offrir une lecture urbaine méditative et cela en revenant tant qu’il le souhaite sur ses pas pour savourer une dernière fois...ici, la beauté d’un vers bien placé, ou là, la résonance d’une syllabe bien trouvée.
Ce projet baptisé “La Phrase”, a mobilisé sur le terrain pendant un an, une équipe de graphistes et de documentalistes. Jour après jour, ils ont peint et calligraphié avec soin sur le sol ces milliers de lettres. Belle métaphore de l’errance et de la liberté qui relève d’une prouesse expocitégraphique.
Sandra Pain
Pour aller plus loin :
www.mons2015.eu/fr/paul-verlaine-à-mons
http://www.latribunedelart.com/exposition-verlaine-cellule-no-2-turbulences-poétiques
# Verlaine
# Rimbaud
# Poésie
Visite à la loupe
Vous avez certainement tous remarqué de très petits objets dans les musées. Vous avez également certainement constaté que ce ne sont pas ceux envers lesquels nous sommes les plus attentifs. Entre se perdre dans la contemplation d’un tableau ou d’une pièce, le choix est souvent vite fait. Cela tient certainement du fait que les moyens ne sont pas mis en œuvre dans les musées pour pouvoir apprécier ces petits objets. Et pourtant ces derniers sont tout aussi intéressants que les autres, ils sont simplement plus difficiles à appréhender du fait de leur petite taille. J’ai donc été curieuse d’aller découvrir l’exposition Archi-timbrée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, une exposition qui présente cinquante timbres au milieu des œuvres monumentales des collections permanentes du Musée des Monuments français… Me demandant comment serait mis en valeur l’un des plus petits supports existant en allant voir cette exposition, j’ai trouvé des réponses.
Le livret d’accompagnement à la visite
Si vous allez sur la page de l’exposition du site internet vous verrez qu’elle mentionne un« catalogue offert ». C’est en fait un livret d’accompagnement à la visite qui est essentiel pour profiter de l’exposition : non seulement il présente l’exposition, mais il comporte un plan ainsi que des fiches sur certains expôts que vous trouverez dans le parcours. Cet outil d’aide à la visite dont je vais évoquer les atouts fait entièrement partie de l’exposition.
Le repérage des timbres
Vue d’un support de présentation de timbre devantune maquette © C.D.
Ma première questionen entrant dans l’exposition était « est-ce que je vais facilement trouver ces timbres ? ». Parce qu’il faut savoir que la galerie des moulages présente 350 estampages en plâtre et 60 maquettes d’architecture et de charpente ; que la galerie des peintures murales et des vitraux compte une centaine de copies de peintures murales emblématiques ; et que la galerie d’architecture moderne et contemporaine expose une centaine de maquettes, éléments de bâtiments, dessins et photographies. Alors imaginer cinquante timbres au milieu de tout cela, ce n’est pas évident. Ça relève même de la chasse au trésor. Pourtant, plus de peur que de mal, il s’avère que dès le début du parcours on les repère très bien !
Chaque timbre est présenté sur un support proche du format A4 de la forme d’un timbre. Ce support tient sur quatre pieds blancs ou est directement posé sur le mobilier d’exposition. Pour être certain de le repérer, une pastille jaune et bleue avec un numéro est posée au sol devant l’œuvre à laquelle le timbre fait écho. Ces numéros se retrouvent également au début du livret d’accompagnement à la visite (atout 1). Ce-dernier propose effectivement un plan de repérage juste après l’introduction à l’exposition. Trois pages présentent les trois galeries du musée avec l’emplacement précis des différents timbres du parcours. Avec tout cela, impossible de passer à côté d’un des timbres !
La lisibilité des timbres
Vue d’un support de présentation de timbre de près avec utilisation de la loupe © C.D.
Une fois les timbres repérés, encore faut-il pouvoir les observer. Pour cela, rien de tel qu’une bonne vieille loupe. Chaque support de timbre comporte une loupe que le visiteur peut manier librement. Elle permet d’apercevoir des détails autrement difficiles à appréhender. Pour compléter cette observation le livret d’accompagnement à la visite contient une représentation en taille réelle de trente-six timbres du parcours (atout 2). Libre à chacun d’en observer les détails au plus près. Pour vérifier si le visiteur a bien observé les timbres de l’exposition, un jeu multimédia est proposé en fin de parcours. Il se joue à deux, chaque joueur devant relever des défis comme retrouver les morceaux manquants de plusieurs timbres, ou encore trouver les particularités communes d’une série de timbre. De quoi réactiver notre mémoire, ce qui n’est jamais inutile.
Le lien entre les timbres et les collections permanentes
Comment le lien est-il fait entre les timbres présentés sur leur support et les œuvres de la collection permanente du musée ? Le lien est signalé physiquement par les pastilles au sol puisque les supports sont placés de sorte que l’observation de l’expôt se fasse le plus confortablement possible. Si l’expôt à observer est une sculpture monumentale, le support est éloigné de plusieurs mètres afin de pouvoir l’embrasser du regard. Si l’expôt à mettre en relation avec le timbre est une maquette, le support est placé à proximité directe, voire sur le mobilier d’exposition.
Cette réflexion sur le positionnement des supports aide le visiteur à orienter son regard et à apprécier le lien entre les timbres et les expôts. Le lien se fait donc évidemment aussi par la représentation qui illustre le timbre. Chaque timbre dialogue avec l’expôt par cette représentation imagée. Le lien est parfois évident car la représentation du timbre est un gros plan d’une œuvre monumentale. Il est parfois moins perceptible quand un timbre représente un monument et que l’expôt ne figure qu’une partie de ce monument qu’il faut alors retrouver dans le timbre (d’où l’utilité de la loupe).
La recherche a alors un côté ludique appréciable. Le timbre peut également représenter un personnage qui a eu un rôle majeur dans l’histoire d’un monument dont une partie est exposée. Les liens se font ainsi de multiples façons ce qui crée un rythme de visite assez dynamique. Enfin, pour comprendre la pertinence de la mise en regard d’un timbre et d’un expôt, il faut se reporter au livret d’accompagnement à la visite (atout 3). Ce dernier développe du contenu pour dix-huit des timbres présentés. Chacun a une double page sur laquelle on retrouve la représentation du timbre et de l’expôt, des documents tels des maquettes de timbre, des photographies ou encore des bons à tirer, ainsi qu’un texte permettant d’expliquer les raisons historiques, commémoratives et touristiques du choix de la représentation de tel ou tel monument sur le timbre.
Au final, ma curiosité a été satisfaite au cours de cette visite. Du point de vue du professionnel, elle permet de réfléchir aux outils mobilisables pour la mise en valeur des petits objets dans les expositions. Du point de vue du visiteur, elle permet de regarder différemment le timbre, un support qui fait partie de notre quotidien mais que l’on regarde finalement assez peu. Bref, chacun y trouve son compte et risque (heureusement) de ne plus porter la même attention aux petits objets qu’il croisera dans les musées.
C.D.
Exposition Archi-timbrée – Voyage philatélique dans l’architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine, du 15 avril au 21 septembre 2015.
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/25791-archi-timbree.html
http://www.citechaillot.fr/data/expositions_bc521/fiche/24557/cp_architimbree_8c041.pdf
#Exposition
#Timbre
#Architecture

Visite au Musée Bourdelle
Pour occuper un après-midi pluvieux à Paris (et parce qu'une place de cinéma coûte trop cher), j'ai décidé de me rendre au musée dédié à l'artiste Antoine Bourdelle que je ne connaissais pas encore.
Un musée atelier à Paris le samedi 12 novembre 2016
Né en 1861 à Montauban, Antoine Bourdelle montre très tôt des prédispositions pour le dessin mais c'est ses sculptures qui le rendront célèbre. Il étudie aux beaux-arts de Toulouse avant de travailler pour le sculpteur Auguste Rodin à partir de 1893. Il réalise en 1895 le Monument aux Morts, aux Combattants et Défenseurs du Tarn-et-Garonne de 1870-1871 pour la ville de Montauban. S'il est mieux connu pour ses sculptures, Bourdelle est un artiste polyvalent, un peintre et architecte qui a participé à différents projets architecturaux, tels la construction du théâtre des Champs-Élysées.
Le musée est installé dans la maison occupée par Antoine Bourdelle à partir de 1885, à proximité d'autres artistes contemporains, tels que Eugène Carrière ou Jean-Paul Laurens. Il a souhaité, comme son professeur, Auguste Rodin, faire de ce bâtiment un témoin de son œuvre. Ce sera chose faite le 4 juillet 1949. Il s'agit d'un musée géré par la ville de Paris et possédant l'appellation Musée de France. Les œuvres de Bourdelle sont disposées dans plusieurs salles, dans les jardins et sur la terrasse, la visite alterne donc entre intérieur et extérieur.

Statues dans le jardin © Musée Bourdelle
Après avoir traversé l'accueil, les publics pénètrent dans le jardin sur rue habité par plusieurs statues en bronze de taille variée mais souvent de grand format. La visite peut se poursuivre vers une cours intérieure végétalisée où sont disséminées d'autres œuvres. Après cette courte promenade sous la pluie mais néanmoins agréable, les curieux quelques peu refroidis retrouvent la chaleur de la maison de l'artiste.
L'ancien atelier d'Antoine Bourdelle a été investi par le musée et est dédié à la création. Dans cet espace, le but est de présenter les différentes étapes de la réalisation d'une œuvre, les différentes techniques utilisées par l'artiste et son équipe et que son matériel. Les outils utilisés ainsi que leur usage sont exposés, ils sont accompagnés d'un bloc de terre ou de marbre qui montrent l'effet de l'outil sur ces matériaux. Deux écrans diffusent des vidéos expliquant la réalisation de bronzes reprenant les techniques utilisées par Bourdelle. Une installation invite les publics à « mettre la main à la pâte », en retirant les différents morceaux d'un moule, amovibles, pour révéler un plâtre représentant un visage. Les enfants comme les adultes prennent plaisir à découvrir la petite sculpture puis à reconstituer soigneusement le moule. Enfin, une vitrine présente les différentes étapes de la fabrication d'un buste, de la première épreuve à l'œuvre finale. Le musée n'a pas seulement pour ambition de présenter les œuvres réalisées par Antoine Bourdelle, mais également de donner à voir le processus créatif.

Galerie © Musée Bourdelle
De l'autre côté du bâtiment, dans une grande galerie bâtie en 1992, sont disposées des œuvres de manière chronologique afin de démontrer l'évolution artistique d'Antoine Bourdelle. Pour finir, les publics peuvent contempler les créations de Madeleine Charnaux, son élève à l'Académie de la Grande Chaumière.
Dans l'atelier de peinture, la scénographie reconstitue l'intérieur tel qu'il existait du vivant de l'article. Un album que les visiteurs peuvent feuilleter réunit les peintures de Bourdelle. Un second est constitué par des photos de Bourdelle et de sa famille, ainsi que son travail à partir de négatifs. Particulièrement impressionnant par ses dimensions, le grand hall, construit en 1961, abrite des plâtres monumentaux. Pour finir la visite, la terrasse permet de surplomber les statues du jardin et abrite une série de bustes d'hommes célèbres.
Si d'une façon générale l'exposition permanente manque de textes explicatifs, ce musée offre un cadre agréable pour découvrir l'œuvre de Bourdelle. Le jardin et le grand hall permettent d'apprécier le gigantisme de certaines sculptures et il est intéressant de comparer le même sujet modelé en plâtre et en bronze. De plus, la partie atelier donne la possibilité́ d'en apprendre plus sur le travail du sculpteur et notamment sur l'équipe qui l'accompagne lors de chaque création.
Clémence L.
#Bourdelle
#Parismusées
#sculpture
#beaux-arts
Pour plus d'info :
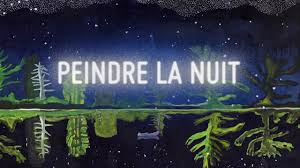
Visite ta nuit
Sas. Noir. Etoile. Prépare toi.
Ferme les yeux, que vois-tu ? Qu'entends-tu ?
Prends ton pinceau et peins.
C'est le noir. Puis c'est le crépuscule. Puis c'est la peine ombre. Puis c'est la nuit. Puis tu fais la fête. Tu fais la fête à Paris. Tu fais la fête ailleurs. Tu reconnais les réverbères. Et puis tu ne les reconnais plus. Tu penses reconnaître ces formes. Et tu t'envoles. Le cosmos ?
Admire ces étoiles qui pétillent, le calme autour de toi. Abstraction. Immersion ?
Tu es déboussolé ? Juste un instant, habitue-toi.
Cette citation, dans la pénombre, ravit
ton imaginaire.
«Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés des campagnes, l’on
voit, plongé dans d’amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes,
indécises, fantastiques. L’ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court,
vient, revient, par diverses formes, en s’aplatissant, en se collant contre la terre.»
Comte de Lautréamont,
Les chants de Maldoror,1890
Comme les ombres que tu supposes dans la nuit,
l'encre de chine et l'aquarelle semblent précieuses dans ces faisceaux blancs.
Tu t'approches, tu plisses les yeux
Tu reconnais ces paysages, ce sont ceux qui t'entourent, des halos
Ils te rappellent le cinéma, des couleurs, des néons, un univers rétro à la Lalaland.
Le réverbère ? La couleur dans la nuit ? C'est l'éclat.
Tes yeux doivent s'habituer à cette œuvre de Philippe Parreno,
qui réveille tes sens engourdis,
C'est l'entrée de la nuit ?
L'entrée dans le côté festif de la Nuit.
Paris. Tu fais la fête avec Auguste Chabaud.
Libre, sans jugement.
Les formes prennent des couleurs,
mais du gris, du noir, du sombre, des ombres, le soir, la nuit.
Tout d'un coup. Un rythme ? Qu'entends-tu ?
La fête vient te chercher, elle t'appelle.
Tu rentres de soirée ? La vie nocturne. Toi, tu ne dors pas.
Les fenêtres sont éteintes
tu passes de l'interieur à l'exterieur ce n'est plus seulement
la lumière artificielle qui vient sur toi c'est toi
qui est éclairé
tu es dehors tu es dedans tu vois les phares quelqu'un vient te chercher
t'es peinard chez toi mais tu sens des irruptions c'est hors de ta portée
Avec qui es-tu ?
Es-tu seul.e ?
La nuit te confronte à toi même
et à tes peurs
à une certaine oppression ?
L'inspiration, le malaise, c'est troublant, la nuit t'inspire
Ces formes, ces halos, tu les perçois ?
Ca vient d'ici ou de là bas
Ca te donne envie de peindre, de dessiner, de créer
Ils l'ont fait eux, les surréalistes.
Mais ça t'échappe.
A quel moment tu rêves ?
Ferme et ouvre un œil, ils faisaient comme cela
Un peu de blingbling
(Jean-Luc Verna et Bruno Pelassy)
C'est éphémère,
et pourtant si présent et poignant
We are with you in the night
« Dans le jour, nos yeux sont arrêtés par un inscrutable (le
soleil, que l’on ne peut regarder en face), dans une nuit, ils
sont entraînés plus loin par le fait qu’il y a toujours davantage
à contempler que ce que l’on a déjà vu. (...) L’infini du ciel étoilé
ne se laisse pas totaliser dans une image. (...) Les deux
facultés qui rendent la connaissance possible sont tenues
en échec : l’entendement est incapable de dénombrer les
étoiles, l’imagination ne parvient pas à les disposer dans une figure.
C’est donc « le ciel étoilé » tel qu’on le voit, sans souci de le connaître, qui éveille
un sentiment de sublime. Le sublime de la nuit enseigne à l’Homme qu’il possède
une autre destination que le savoir. »
Michael Foessel, La Nuit, 2017
D'un coup tu t'envoles, tu quittes la surface
l'abstraction et la représentation
La nuit est présente dans les objets mais aussi sur les tableaux
ton regard va du bas vers le haut.
Stop. Tu te balades dans les visions de quelque chose,
un coup dans un sens un coup dans l'autre, un coup à l'endroit un coup à l'envers ?
c'est solide, minéral, tu découvres un nouveau territoire
il semble inhabité,
toute la fascination de la découverte en une série de photo
La conquête spatiale à la conquête de ce sol rocailleux ?
La lune, les constellations, les étoiles, les planètes, toi aussi tu es là haut
Après avoir vu les formes, la nature, les corps se transformer tu assistes à la découverte du cosmos
les différents horizons se perdent
Et si tu ne voyais plus ?
La transition entre les couleurs et formes qui se créent la nuit
Stop.
Ferme les yeux et peints. Que ressens-tu ?
Les fluides sont en mouvement, des paillettes sous tes paupières
Et puis tu sors de toi, et tu rentres dans la nuit
Tu perds tes repères,
à nouveau, et tu t'envoles et là c'est parti
Dans l'espace, la voie lactée, cette traînée violette, qui t'entraine ça ressemble à des UV tu rêves et tes rêves t'emportent, et ton équilibre avec, tu peux même entendre le son de l'espace. Ferme les yeux et laisse toi guider par les lucioles.
Le bien-être de l'espace, du vide, du noir.
Et puis,
Tu t'émerveilles une dernière fois devant la verdure, le bleu de la nuit, le blanc de la voie lactée,
ce nouveau monde découvert, et ta perception remise en cause
Ils me rappellent le cinéma, des couleurs, des néons, un univers rétro
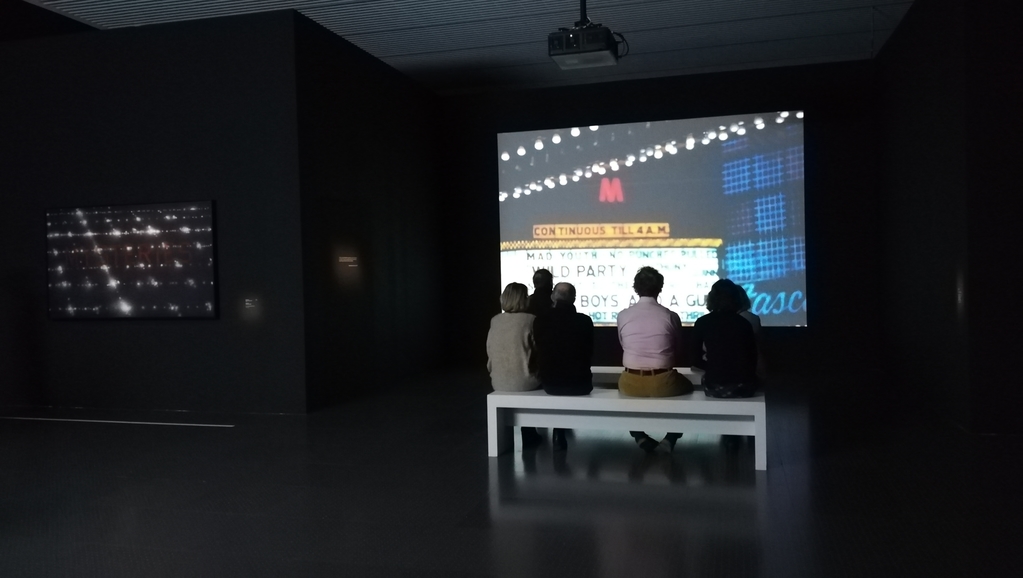
Œuvres et projection dans la partie Se perdre dans la nuit © C.Camarella
tu es dehors tu es dedans tu vois les phares quelqu'un vient te chercher
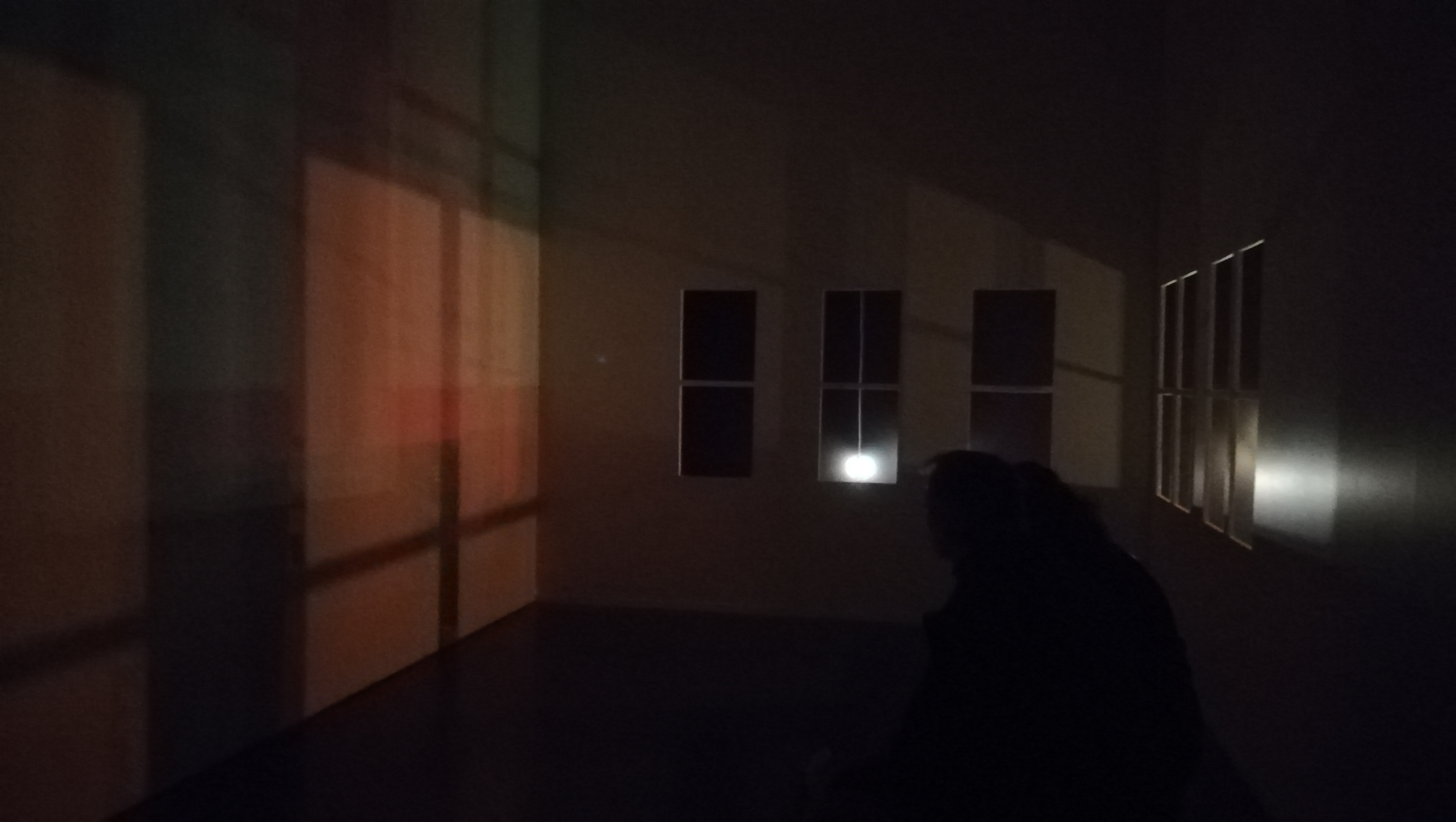
Œuvre de Spencer Finch, Study for light in an emply room (studio at night) © C.Camarella
Ferme et ouvre un œil, ils faisaient comme cela, les surréalistes.
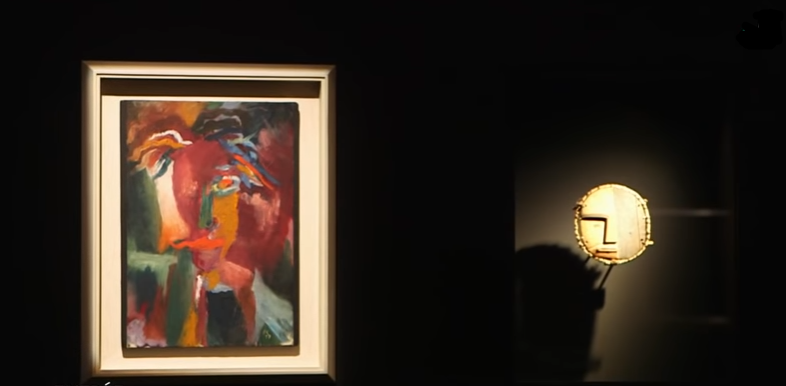
Œuvres surréalistes © Capture de la vidéo La nuit tous les châssis sont gris
Et si tu ne voyais plus ?

Mortuary de Daisuke Yokota © C. Camarella
Dans l'espace, la voie lactée, cette traînée violette, qui t'entraine ça ressemble à des UV tu rêves.

Œuvre de Helen Frankenthaler, Stargazing © C.Camarella
Vous l’avez compris, j’ai vécu l’exposition de façon très immersive, sans doute à l’image de ce qu’indique le Centre Pompidou :
« À travers une approche liée à la perception de la nuit plutôt qu’à son iconographie, l’exposition se présente elle-même comme une expérience nocturne, une déambulation qui transforme le visiteur en noctambule, et qui transmet ce vertige que procure la nuit : vertige des sens, vertige intérieur, vertige cosmique. On avance dans l’exposition comme on avance dans la nuit. »
C. Camarella
#Peindrelanuit
#CentrePompidouMetz
#Visitetanuit
Pour plus d'info :
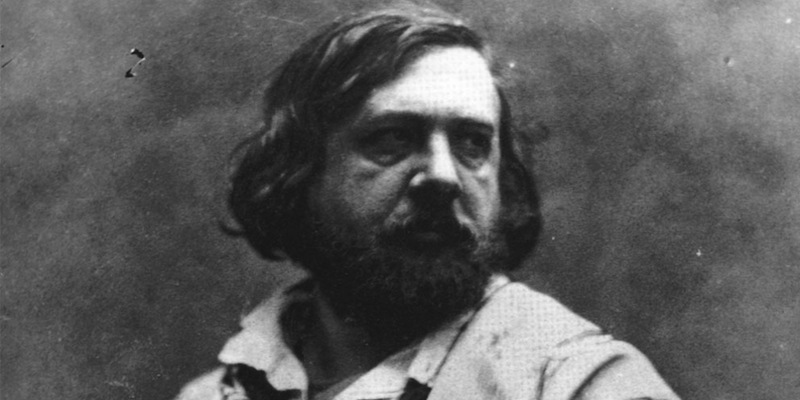
Visiter à sauts et à gambades
Théophile Gautier et l'art de voyager
Paris, mai 1858.
Le poète, romancier, critique d’art et journaliste Théophile Gautier (1811-1872) n’a alors qu’une seule et unique envie : s’échapper et partir loin de l’effervescence de la capitale ! S’échapper loin de Paris, oui… cela aurait été tellement simple s’il n’était alors contraint d’alimenter sans cesse les feuilletons littéraires du journal Le Moniteur Universel[1] ; car son activité littéraire dans ce journal l’entretien non seulement lui-même, mais aussi sa famille, ses sœurs et même ses maitresses. Pourtant, une petite escapade loin de Paris, Th. Gautier en rêve depuis des semaines ; Th.Gautier la veut ! Une seule possibilité : demander à son journal un voyage de reportage qui pourrait lui fournir la matière nécessaire pour remplir les pages de ses futurs feuilletons. Et voilà que le poète trouve un événement qui lui donnerait un prétexte en or pour s’extraire, ne serait-ce que quelques jours, de la capitale : la grande exposition de l’industrie prévue pour le 23 et le 24 mai aux Pays-Bas, à La Haye !
 Et le journal accepte ! mais ne lui accorde que… six jours !
Et le journal accepte ! mais ne lui accorde que… six jours !
© H. VALENTIN, Portrait de Th. Gautier en 1830,in Tourneux, Maurice, ThéophileGautier : sa biographie, Paris, Baur, 1876
Six jours… !
Quelques affaires jetées dans sa valise, et voilà l’écrivain qui se lance dès le lendemain dans un voyage qui, de Paris à La Haye, va l’amener à traverser la France et la Hollande en passant par… la Suisse et l’Allemagne ! L’époque n’est certes pas du tout encore aux trains à grande vitesse, aux avions, ou bien encore aux tour-opérateurs qui, aujourd’hui, proposent des offres de séjours culturels à foison… mais qu’importe ! rien n’arrête le poète plein de fougue dans son projet d’escapade,culturelle, par locomotive, par bateau à vapeur, et par voiture, à travers l’Europe germanophone ! Lui qui, pourtant, avoue ne pas parler un mot d’allemand !
Paris, Dijon, Dôle, Pontarlier, pour enfin arriver… en Suisse, à Neuchâtel, où le poète rejoint, au bord du lac, « le cottage » charmant d’un ami de Paris. Mais à peine invité pour le thé, impossible de rester sur place ! Le voilà qui reprend la route dès l’après midi, en locomotive, pour être à Berne avant la tombée de la nuit ! D’un village à un autre, le temps du voyage, forêts, ponts, fontaines, habits traditionnels, lacis inextricable de ruelles, arcades de maisons, vitraux d’églises… absolument tout excite la curiosité de notre écrivain ! Mais tout juste arrivé à Berne, le voilà aussitôt qui repart, dès le lendemain, en train, pour rejoindre Bâle :
« Il y a deux manières de voyager, explique-t-il : la première consiste à passer dans chaque ville trois ou quatre jours, une semaine ou davantage s’il le faut, pour visiter les églises, les édifices, les musées, les curiosités locales, étudier les mœurs, l’administration, les procédés de fabrique, etc.,etc. ; la seconde se borne à prendre le prospect général des choses, à voir ce qui se présente sans qu’on le cherche, sous l’angle d’incidence de la route, à se donner l’éblouissement rapide d’une ville ou d’un pays. »
Théophile en Suisse...
 A Bâle, Th. Gautier visite sur le champ l’église gothique, et surtout le musée municipal où il découvre plusieurs peintures des Holbein, avant d’aller déguster « d’excellentes truites au gratin », et prendre son café sur la terrasse d’un grand hôtel de la ville, profitant d’une vue imprenable sur le Rhin en fumant son cigare. 17h.. et le voilà de nouveau dans un train, direction Strasbourg où il arrive à 22h, et d’où il repart dès le lendemain pour aller en Allemagne, direction Heidelberg !
A Bâle, Th. Gautier visite sur le champ l’église gothique, et surtout le musée municipal où il découvre plusieurs peintures des Holbein, avant d’aller déguster « d’excellentes truites au gratin », et prendre son café sur la terrasse d’un grand hôtel de la ville, profitant d’une vue imprenable sur le Rhin en fumant son cigare. 17h.. et le voilà de nouveau dans un train, direction Strasbourg où il arrive à 22h, et d’où il repart dès le lendemain pour aller en Allemagne, direction Heidelberg !
Une fois arrivé, Th. Gautier se raisonne tout de même : le voilà qui entame déjà sa troisième journée, et hors de question à présent, comme il a pu le faire les jours précédents en Suisse, de « perdre à la table des hôtels un temps précieux » ! Peu lui importe que son estomac commence à gargouiller ! A peine a-t-il posé le pied en gare d’Heidelberg, qu’il s’élance sur le site des ruines du château !
© Ch. PhillipKOESTER, Un artiste devant les ruines duchâteau d’Heidelberg,v. 1840, Heidelberg, Kurpfaelzisches Museum
« Après le Parthénon et l’Alhambra, le châteaud’Heidelberg est la plus belle ruine du monde. (…) Et comme le petit Spartiatequi cachait un renard sous sa robe, nous laissions [alors] stoïquement la faim nous ronger le ventre, car nous avons l’œil plus goulu que l’estomac ! »
De la même manière que le peintre Eugène Delacroix (1798-1863) pouvait, quelques années auparavant en août 1850, s’ériger contre la restauration des fresques peintes des églises gothiques, Th. Gautier proteste contre le projet, véhiculé par une rumeur locale, de restauration de ces ruines ; car ce sont ces ruines qui, justement, rendent le site exceptionnel :
« Le bruit répandu d’une restauration prochaine a soulevé chez tout le monde artiste des tirades élégiaques et passionnées. Si l’on relevait une seule des pierres tombées, si l’on arrachait le lierre des façades, les arbres poussés dans les chambres, si l’on remettait des nez et des bras aux statues invalides, l’on crierait (…) au sacrilège ! (…) Car oui, nous aimons les ruines ruinées !…»
Théophile enfin aux Pays Bas...
Après Manheim, Düsseldorf, Rotterdam… Th.Gautier arrive Hollande, traversant d’immenses plaines ondulées par les dunes au loin vers la mer et par le gris violet des bruyères ! Et le voilà qui débarque enfin à La Haye ! cette ville où doit se tenir cette fameuse exposition de l’industrie, cet événement culturel qui « était le motif plausible, honnête et modéré(…) donné à [son] naïve envie » de quitter, l’instant de quelques jours, l’agitation parisienne, et qui, apprend-t-il sur place, a finalement été décalé d’un mois… La Haye, cette ville où il est impossible de passer, « ne fût-ce qu’une heure, sans aller au musée », non parce qu’il est grand, mais parce qu’il ne recèle, selon le poète, que de chefs-d’œuvre ! Après avoir admiré au rez-de-chaussée, une collection de chinoiseries et de curiosités diverses rapportées des pays exotiques par les marchands des XVIIe et XVIIIe siècles, c’est à l’étage du musée qu’il passe plusieurs heures à admirer la Leçond’anatomie du docteur Tulp de Rembrandt, l’Adam et Evede Rubens, un Portrait d’homme d’Holbein, l’Infante de Vélasquez, la Suzanne au bain de Rembrandt, ou bien encore une Vue d’une ville hollandaisede Vermeer.
© R. Tilleman, Vue de la Leçon d’anatomie du docteur Tulpde Rembrandt à la Mauritshuis, 2014, La Haye
Mais voilà que l’heure tourne, toujours et encore !
« Diable ! déjà midi ! comme les chefs-d’œuvre (…) abrègent le temps qu’on dit si long ! »
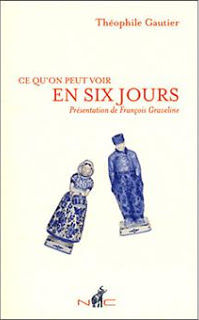
Th.Gautier aimerait encore passer un peu de temps pour admirer une grande peinture de Jordaens… mais il n’a plus le temps !
Il se rappelle son rendez-vous pour le déjeuner, dans le cadre de son reportage pour Le Moniteur Universel, avec le commissaire de la future exposition de l’industrie, finalement repoussée, ainsi qu’avec un directeur de presse ! Au sixième jour de son voyage, précipité dans son retour pour Paris, le poète traverse alors Rotterdam, Anvers et Bruxelles, non sans aller voir, dans cette dernière ville, un Rubens, un Van Dyck et un Calabrèse ; bien trop rapidement, sans doute, regrette-t-il… Mais après tout, qu’importe ? en vient-il à conclure, au terme de son intense tourisme culturel en six jours à travers l’Europe, et en une phrase qui, sans doute, résonne d’autant mieux à notre époque contemporaine où la facilité de mobilité, liée au développement considérable des moyens de transports, semblerait presque nous faire oublier cette part de fougue et d’aventure, pourtant magique et essentielle, dans tout désir et envie de découverte :
« Car le voyage, comme la vie, se compose desacrifices. Qui veut tout voir, ne voit rien. C’est assez de voir quelque chose !... »
Camille Noé MARCOUX
#Voyage
#Tourisme
#Théophile Gautier
* Théophile GAUTIER, Ce qu’on peut voir en six jours, Paris, éd. Nicolas Chaudun, 2011 [1858], 8€
[1] A l’époque, les « feuilletons littéraires » sont les récits publiés en bas de la première page du journal, sous la forme d’épisodes.
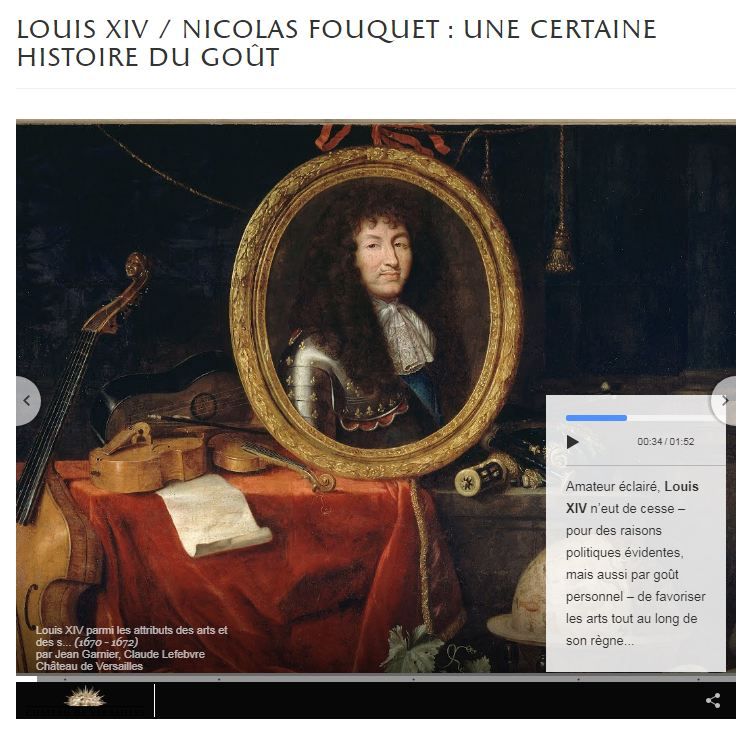
Zoom sur les expositions virtuelles
Ces dernières années ont été marquées par la ludification du musée. Entre les escape games,les chatbots et l’usage de la réalité augmentée, les nouvelles technologies n’ont pas fini de jouer avec le patrimoine.
Depuis le confinement causé par la pandémie du COVID-19, un autre dispositif ludique est plébiscité : l’exposition virtuelle. Par définition, il s’agit d’une exposition diffusée sur internet, mais selon les moyens employés, il existe une grande hétérogénéité des formes. Allant du simple « slide » aux reconstitutions immersives, voici quelques exemples :
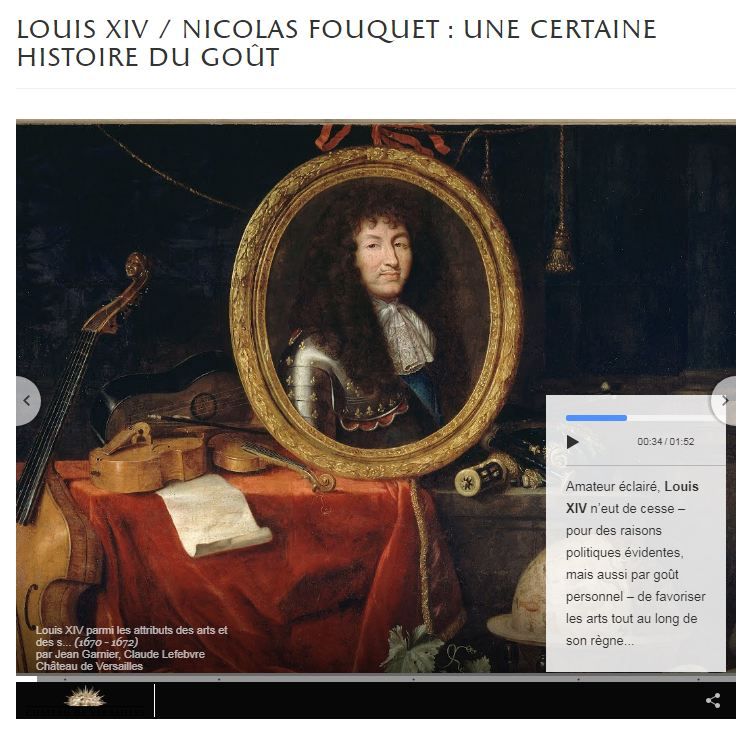
Exposition « Louis XIV et Nicolas Fouquet, une histoire de goût », du Château de Versailles, créé spécialement pour le web, sous forme de slide multimédia (images, textes, audio…)
©Château de Versailles http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-fouquet-:-une-certaine-histoire-du-gout

Exposition « L’Estuaire de la Seine, l’invention d’un paysage » par le Musée d’art moderne André Malraux. Un moyen de “faire perdurer” cette exposition en publiant sur le site du musée un corpus de textes et d’œuvres.
©MuMa Le Havre http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/lestuaire-de-la-seine-linvention-dun-paysage

Une mise en page dynamique pour l’exposition « Les Nadar, une légende photographique », de la BnF. Le contenu se « déploie » à mesure que l’on parcourt la page.
©BnFhttp://expositions.bnf.fr/les-nadar/
Il existe même des expositions dans lesquelles des environnements entiers sont simulés. C’est précisément le travail de l’UMA, l’Universal Museum of Arts, fondé par l’historien de l’art Jean Vergès : un musée fictif qui collabore avec les “ vrais musées ” pour réaliser des expositions gratuites sur internet.
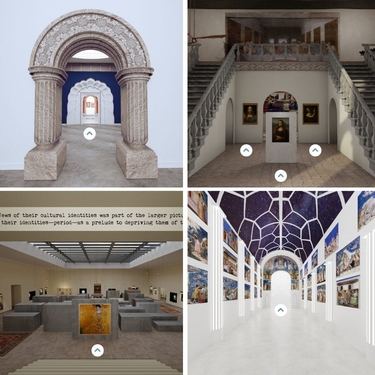
Captures d’écran de diverses entrées d’expositions © UMAhttps://the-uma.org/fr
La page d’accueil liste les expositions en cours et celles à venir. En cliquant sur l’exposition de notre choix, nous voici dans un environnement pensé par un architecte contemporain. Selon le propos de l’exposition, la scénographie va de la plus classique (type ancien palais réhabilité) à la plus ambitieuse (architecture totalement fantasmée). Pour naviguer dans l’espace, il faut maintenir le bouton clic enfoncé et bouger la souris, ou utiliser les flèches directionnelles qui apparaissent sur l’écran. Si l’on n’utilise pas souvent d’ordinateur où que l’on ne joue pas aux jeux en ligne, cette manipulation peut demander un petit temps d’adaptation.

Navigation dans un espace d’exposition © UMA
Lorsque nous cliquons sur une œuvre qui nous intéresse, une fenêtre d’information apparaît. Elle contient le cartel de l’œuvre, un commentaire descriptif ainsi qu’un propos lié à l’exposition.
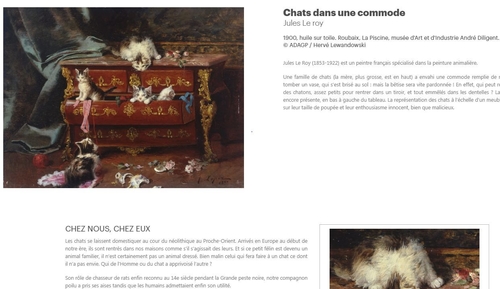
Fenêtre d’informations © UMA
L’implication d’un musée dans ce genre de projet varie. Ainsi, l’exposition « Chats dans l’histoire de l’art »lancée le 7 juillet 2018 a été imaginée par la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, alors qu’une des prochaines expositions intitulée « De la Renaissance au XXème siècle »nécessite pour les musées concernés, un simple envoi de photos à l’UMA. Dans tous les cas, les expositions de l’UMA ne sont pas un simple rassemblement d’œuvres en haute qualité car elles s’accompagnent bel un bien d’un propos scientifique. L’UMA fait appel à des spécialistes qui ont champ libre sur la sélection des œuvres.
Quel est l’intérêt d’exporter les expositions en ligne ? Le premier argument qui nous vient est celui de la démocratisation : avoir accès à une exposition gratuite, à tout moment. D’autant que la tendance actuelle défend de plus en plus le partage des biens communs, dont les œuvres d’art (les créations de Microfolies, les versements sur wikimédia…). Avec les expositions virtuelles, le musée se montre également garant de la qualité d’image, de la « bonne version » de l’œuvre, car les prises de vues retouchées sont nombreuses sur le net.
Sur un support numérique, il y a la possibilité de zoomer sur des détails tels que la touche d’un peintre. Vous ne verrez jamais la Joconde aussi près que depuis un écran, c’est un fait. « Le contact avec l’œuvre physique est unique et irremplaçable. Mais nous sommes convaincus que la reproduction d’une œuvre peut émouvoir, intriguer et enthousiasmer... Au même titre que l’écoute d’un artiste sur Spotify nous pousse à aller voir son concert ! »explique l’UMA.
Autre argument fort en faveur de l’exposition virtuelle, le pouvoir de créer une exposition sans les contraintes qu’imposent la matérialité : pas de problèmes d’espace, pas de convoiements, pas d’assurances, pas de risques de conservation préventive… On réunit ce qu’on veut ! Une utopie réalisée qui fera sourire les amateurs d’arts. « Cela n’a donc rien d’un musée ! » dirons les réfractaires. Encore une fois, l’UMA n’entend pas remplacer le musée mais « diffuser son image et renforcer l’affirmation de sa pertinence actuelle ».
Faire des expositions en ligne, est-ce vraiment une manière de démocratiser l’art ? Pas vraiment, puisque l’UMA précise jouer un rôle complémentaire. Ce qui veut dire que dans la réalité, ce concept tombe dans les mains d’un public averti. Autre exemple, le géant Google Arts & Culture, qui est une mine d’or de ressources, n’a jamais transcendé les foules, jusqu’à ce qu’ils lancent une fonction permettant aux gens de trouver leur sosie en peinture grâce à leur selfies. C’est plutôt ce genre d’actions culturelles qui « démocratisent »l’art et donnent aux gens l’envie de s’intéresser aux musées.
Un conseil aux établissements qui souhaitent développer des expositions virtuelles : exposez l'inexposable ! L’exposition « Chats dans l’histoire de l’art », aussi adorable soit-elle, peut être réalisée dans n’importe quel musée. Il serait plus pertinent d’exposer des sujets sensibles, complètement décalés, que les musées ne sont peut-être pas encore prêts à accueillir…
B.O
#expositionvirtuelle
#democratisation